Abonnés Articles en ACCÈS LIBRE Actu Livres Economie Environnement Genre Guerre
21.07.2024 à 06:00
Littérature européenne : la sélection d’été du Grand Continent
celianmartin
Charles Quint prend le large. Tallinn se vide. On intrigue à Paris.
Pour accompagner votre été, nous avons sélectionné 22 récits curieux et nouveaux parus en allemand, espagnol, italien, français et polonais.
La sélection des candidats en lice pour le Prix Grand Continent sera annoncée à l'automne.
L’article Littérature européenne : la sélection d’été du Grand Continent est apparu en premier sur Le Grand Continent.
Texte intégral (8201 mots)
Lire à l’échelle pertinente. Que ce soit avec nos sélections mensuelles d’essais ou notre Prix Grand Continent, les dernières parutions sont au cœur de la revue, dans les principales langues du débat européen. Pour ne rien rater, abonnez-vous
Arno Geiger, Reise nach Laredo (Hanser Verlag), Hanser, 2024

« En chaque homme se cache un roi démissionnaire ».
Le roman raconte les derniers jours de la vie de Charles Quint. Ayant abdiqué, retiré dans un monastère à Yuste, en Castille, l’empereur végète tristement entouré d’une Cour déférente, mais qui l’indiffère. Arno Geiger imagine sa rencontre avec un petit garçon de onze ans, qui est en fait un fils naturel ignorant tout de sa noble ascendance. Les deux conviennent de s’enfuir à dos de mulet et de cheval (l’empereur prenant le mulet, le seul animal qu’il arrive encore à monter). Le roman est le récit de ce voyage improbable d’un empereur déchu, et dont les gens qu’il croise ignorent l’identité, et d’un gamin qui, peu à peu, parvient à le ramener à la vie. Un récit très prenant, d’une écriture singulière et très soignée. (Anne Weber)
Martina Hefter, Hey, Guten Morgen, wie geht es dir ?, Klett Cotta, 2024

Le dernier roman de Martina Hefter (lauréate du prix Ingeborg Bachmann 2005) a pour narratrice une femme entre deux âges qui s’occupe de son compagnon, très malade et handicapé. La nuit, elle se met à fréquenter des forums de rencontre où sévissent des love scammers, des escrocs, résidant le plus souvent en Afrique, qui essaient d’extorquer de l’argent à des Européennes en mal d’amour. Elle n’est pas dupe et leur raconte à son tour des mensonges sur sa vie. Elle tombe un jour sur un certain Benu qui n’a pas l’air d’être qu’un escroc. Entre les deux, une vraie histoire d’amour (virtuelle) commence, mais pleine de défiance et d’hésitations des deux côtés.
Le roman fait donc apparaître aussi l’Europe telle qu’elle est vue, espérée, rêvée de loin, une Europe vue de l’extérieur. Il a un aspect politique, qui reste cependant discret, ni démonstratif ni théorique. L’écriture émeut, dans une esthétique résolument contemporaine (la transcription de chats, par exemple, y compris d’émojis qui ne sont pas reproduits tels quels, mais qui, par les noms qu’ils reçoivent, gagnent un aspect poétique inattendu). Un livre à la fois profond, inventif et très actuel. (Anne Weber)
Durs Grünbein, Der Komet, Suhrkamp, novembre 2023

Le personnage principal est une femme issue d’un milieu modeste. Le récit narre la vie de Dora W., qui arrive de Silésie à Dresde. Elle devient mère à seize ans et assiste à la destruction de la ville sous les bombes à vingt-cinq ans. Être gardienne de chèvres à la campagne, puis vendeuse et aide-jardinière dans une petite ville de Basse-Silésie sont les premières étapes de sa vie avant qu’elle ne trouve l’homme de sa vie en Oskar, un compagnon boucher. Elle le suit à Dresde pour y fonder une famille. Elle y passe une courte période ; ce sont ses années d’or, semble-t-il, mais ensuite, la guerre la frappe et ses perspectives s’effondrent, comme tous les autres. Avec elle, c’est la fin de Dresde dans une société empoisonnée par la volonté de puissance et l’illusion raciale.
Avec son histoire, Dors Grünbein (lauréat du Prix Georg Büchner) suit un destin dans le contexte historique, avant et après l’invasion du national-socialisme dans chaque vie individuelle. Que fait la dictature de ces personnes qui ne sont guère à la hauteur de ses exigences et qui se débrouillent tant bien que mal ? Dans ce contexte, l’apparition de la comète de Halley en 1910, qui a alimenté les fantasmes de fin du monde, prend une signification symbolique pour l’anéantissement de la métropole saxonne dans la tempête de feu de février 1945.
À travers l’exemple de Dora W., l’auteur raconte comment l’histoire arrive à ceux qui n’ont pas d’histoire, comme une horreur et une prise de conscience trop tardive.
Nora Bossong, Reichskanzlerplatz, Suhrkamp, 2024

Dans son nouveau roman, Nora Bossong brosse le portrait de la femme qu’est devenue Magda Goebbels et celui de son jeune amant. Deux personnes prises dans les rouages des événements historiques, impliquées différemment, coupables différemment. Y compris contre eux-mêmes.
Lorsque Hans fait la connaissance de la jeune et belle belle-mère de son ami d’école Hellmut Quandt, il ne se doute pas encore du rôle que Magda va jouer dans sa vie, pour lui personnellement, mais aussi des années plus tard en tant que fanatique du national-socialisme et en tnat que mère modèle du Troisième Reich. La République de Weimar est encore en plein essor et Hans est aussi violemment que désespérément amoureux de Hellmut. Mais après un accident, Hans et Magda entament une liaison dont ils espèrent tirer réconfort et avantages : elle veut échapper à son mariage, il veut cacher son homosexualité. Ce n’est que lorsque Magda fait la connaissance de Joseph Goebbels et adhère au parti national-socialiste que Hans et elle se séparent. Alors que Magda apparaît bientôt avec ses enfants dans les actualités hebdomadaires, Hans se retrouve de plus en plus en danger. Un roman qui raconte sur vingt ans le parcours de deux personnes et celui d’un pays qui, l’un comme l’autre, n’étaient pas inéluctables.
Juan Manuel de Prada, Mil ojos esconde la noche. La ciudad sin luz, Espasa, 2024

Prada s’intéresse à la communauté d’artistes espagnols qui, après la guerre civile, se sont installés dans le Paris occupé par les Allemands, où les conditions de vie étaient particulièrement difficiles. Ils devaient donc utiliser toutes les ressources à leur disposition pour survivre, même si cela les mettait face à de grands dilemmes moraux.
Le redoutable commissaire Urraca, attaché de police à l’ambassade d’Espagne à Paris, confie à Navales une mission qui lui va comme un gant : faire adhérer des artistes espagnols du Paris occupé aux postulats phalangistes. Dans les pages de ce roman, nous retrouvons des personnalités aussi connues que Picasso, César González Ruano et Gregorio Marañón, ainsi que d’autres personnages secondaires intéressants comme Serrano Suñer, Ana de Pombo et María Casares. Une série de personnages dont les vicissitudes oscillent entre la tragédie, le portrait naturel des abîmes les plus profonds de l’abjection et le roman picaresque le plus pur.
Juan Manuel de Prada allie son immense talent narratif à sa connaissance approfondie du panorama intellectuel, artistique et surtout littéraire de l’Espagne de la première moitié du XXe siècle. Le résultat est un projet littéraire mémorable et d’une qualité extraordinaire dans la grande tradition baroque espagnole : Quevedo, Valle-Inclán et Ramón Gómez de la Serna.
Anna Pacheco, Estuve aquí y me acordé de nosotros, Anagrama, 2024

Le tourisme a changé le visage de nombreuses villes. S’il a été un moteur économique, il a aussi généré des effets indésirables et est aujourd’hui clairement insoutenable. Ce livre explore la contradiction entre le luxe que les hôtels haut de gamme vendent à leurs clients et la réalité sociale, économique et professionnelle de ceux qui y travaillent.
À mi-chemin entre le travail anthropologique de terrain, la chronique et l’essai, Anna Pacheco construit un récit magistral sur le tourisme de luxe à Barcelone et réfléchit au repos dans un avenir post-capitaliste. Par une incursion dans le monde du tourisme pour examiner la dynamique du travail qu’il cache, ce livre incisif met le doigt sur un problème brûlant — et l’explore en profondeur. Il s’agit sans aucun doute d’un ouvrage essentiel pour mieux comprendre les grands défis auxquels l’Europe est confrontée en matière urbaine, économique et sociale. (Pablo Cerezo)
Eduardo Manzano, España diversa, Crítica, 2024

L’histoire de l’Espagne est l’histoire d’un passé changeant, paradoxal qui ne peut pas tomber dans la simplification. La richesse et la complexité de cette histoire retrouvent leur centralité dans ce livre. Face aux lectures essentialistes intéressées et aux batailles idéologiques pour le récit qui abondent aujourd’hui, Eduardo Manzano propose un voyage passionnant pour redécouvrir cet héritage sous la forme d’une mosaïque d’identités, de cultures, de territoires, de langues et de civilisations — qui n’est pas sans faire penser à l’histoire de l’Europe en général. De l’Hispanie romaine à la course aux Indes, de l’Al-Andalus musulman à la Transition et de la Sépharade juive à l’unification bourbonienne, on y trouve les clés d’une histoire plurielle, provocante, documentée et ironique.
Avec un récit puissant, loin du langage académique et non dépourvu d’ironie, España diversa ne se contente pas de débarrasser l’histoire espagnole de ses clichés, mais nous apprend que c’est le changement, et non le maintien des essences, qui nous caractérise.
« C’est un livre très important parce qu’il montre que l’Espagne, à travers son histoire, a toujours été un pays diversifié, avec des identités multiples, ce qui est exactement le cas de l’Europe. Pour moi, c’est le livre le plus important qui a été publié cette année en Espagne ». (Guillermo Altares)
Eduardo Halfon, Tarántula, Libros del Asteroide, 2024

Fin 1984, deux jeunes frères guatémaltèques, exilés depuis des années aux États-Unis, reviennent au Guatemala pour partir dans une colonie d’enfants juifs dans une forêt perdue des hautes montagnes. Ils connaissent peu leur pays d’origine et parlent à peine l’espagnol. Leurs parents ont insisté pour qu’ils viennent passer quelques jours au campement afin d’apprendre non seulement les techniques de survie en milieu sauvage, mais aussi les techniques de survie en milieu sauvage pour les enfants juifs, ce qui n’est pas la même chose, leur a-t-on dit. Mais un matin, les enfants découvrent que le camp a été transformé en quelque chose de bien plus sinistre : désormais, chacun devra trouver son propre moyen de survie.
Dans ce livre, l’auteur revient sur un événement de son enfance dans le Guatemala complexe et violent des années 1980, dont les motifs et les ramifications ne commenceront à être élucidés que des décennies plus tard, lors de rencontres fortuites à Paris et à Berlin avec certains de ses protagonistes énigmatiques. Une nouvelle pièce dans le grand roman en marche qu’est l’œuvre d’Eduardo Halfon, l’un des projets littéraires les plus importants de la scène littéraire actuelle.
Laura Casielles, Arena en los ojos, Libros del KO, 2024

Mémoire et silence de la colonisation espagnole du Maroc et du Sahara occidental
Depuis des décennies, le regard espagnol qui se pose sur le Maroc et le Sahara occidental se nourrit de malentendus, de pirouettes rhétoriques, de méfiance, de patriotisme et de nostalgie. Dans ce livre, Laura Casielles bouscule les discours les plus répétés et les confronte à des témoignages plus humbles en s’appuyant sur des scénarios historiques pour démonter les fantasmes orientalistes et les sophismes belliqueux. Cette approche permet de comprendre que les relations que l’Espagne a entretenues avec le Maroc et le Sahara occidental au cours des XIX et XX siècles étaient, effectivement, des rapports coloniaux. Dans cet ouvrage, qui associe le meilleur de la chronique et de la littérature de voyage aux outils les plus récents des études post-coloniales, l’autrice libère le passé et le présent des carcans discursifs pour nous permettre d’imaginer de nouvelles façons de nous relier les uns aux autres. Car, comme elle le dit elle-même dans un passage de ce livre, « il faut voir plus de choses, de plus en plus de choses ».
Stefano Massini, Mein Kampf da Adolf Hitler, Einaudi, 2024

Après de nombreuses années de recherche et d’écriture, reprenant mot pour mot le texte original, en y greffant des centaines de discours et de déclarations d’Hitler lui-même, Stefano Massini nous livre sa biopsie du texte maudit, une distillation féroce où la religion nazie de la rage et de la peur, le culte de l’ego et l’exaltation des masses nous apparaissent dans toute leur force de puissant déjà-vu.
Primo Levi a écrit que rien n’est plus nécessaire que la connaissance pour éviter que la tragédie ne se reproduise, surtout si elle prend lentement forme dans la séduction progressive des masses. Un siècle après qu’Adolf Hitler a dicté son manifeste politique dans une cellule de Landsberg am Lech, ces pages sont devenues l’un des symboles du mal absolu, et à ce titre soumises à l’anathème séculaire qui en a fait un livre interdit. Mais ce cône d’ombre, fils d’un retrait freudien, a contribué à accroître sa mythologie jusqu’à ce qu’en 2016, l’Allemagne décide d’autoriser à nouveau sa diffusion en librairie, précisément pour démonter sa légende et percevoir ses échos dans le présent, avec la conscience que rien ne peut plus détruire l’horreur que le sens critique, et donc la reconversion du monstre dans les périmètres de la réalité. Oui, car Mein Kampf n’est au fond que l’autobiographie d’un trentenaire délirant en quête de boucs émissaires et de débordements existentiels, avec la circonstance aggravante toutefois d’une propension marquée à l’empathie, à l’aube d’un vingtième siècle qui allait élire son apothéose dans le charisme. De cette formule, répétée et encore émulée sous toutes les latitudes, découle l’urgence de nous confronter plus que jamais à un texte qui n’est jamais mort, capable de se re-proposer sous d’autres marques et d’autres couleurs, surtout à une époque où la propagande s’est ramifiée en ligne, et nous atteint désormais par capillarité.
Paolo Giordano, Il corpo umano, Einaudi, 2024

Un roman de guerre, ou plutôt un roman sur la guerre, dans ses multiples incarnations : la guerre proprement dite, celle d’Afghanistan ; celle, plus insaisissable mais tout aussi douloureuse, des relations intimes, affectives et familiales ; et celle, invisible et très dangereuse, de la rage contre soi-même. Un roman qui nous rappelle ce que signifie être humain.
Dans la vie d’un soldat, le « corps militaire » est une seconde maison, l’uniforme une seconde peau qui unifie celui qui le porte. Mais sous l’uniforme, les « corps humains » sont tous différents, souvent de jeunes cœurs qui battent, chacun avec ses contradictions, ses fragilités. Le lieutenant Alessandro Egitto, en Afghanistan depuis cent quatre-vingt-onze jours, le sait bien. Les vingt-sept jeunes hommes de la troisième section de la compagnie Charlie commandée par le maréchal Antonio René le savent bien. Roberto Ietri, le dernier arrivé, qui a à peine vingt ans et se sent inexpérimenté en tout, le sait très bien.Pour eux, la mission dans la vallée du Gulistan est la première grande épreuve de leur vie. Au moment de partir, ils ignorent que la région à laquelle ils sont destinés est l’une des plus dangereuses de toute la zone de conflit. C’est là où l’ennemi est, mais ne se voit pas, à l’abri d’une montagne qui domine la base militaire « Ice » et semble vouloir à tout prix montrer son innocence. Difficile de croire qu’elle abrite une myriade de ravins d’où les talibans épient le moindre mouvement, tandis qu’au camp de base, les soldats, épuisés par la chaleur et la conviction rampante que la menace est irréelle, passent leurs journées entre tours de garde et distractions en tout genre. Jusqu’à ce que la guerre explose sous leurs pieds et grêle au-dessus de leurs têtes. Le corps militaire éclate alors en plusieurs corps humains : certains agissent, d’autres sont paralysés ; certains font de bons choix, d’autres de mauvais ; certains vivent, d’autres meurent. Pour ceux qui restent, la vie change en un instant. Et lorsqu’ils rentreront chez eux, ils auront irrémédiablement franchi la ligne d’ombre qui sépare la jeunesse de l’âge adulte.
Michele Masneri, Paradiso, Gli Adelphi, 2024

« Le jour le plus chaud d’un des étés les plus chauds de mémoire d’homme ».
Federico Desideri, jeune journaliste plein d’espoir mais peu satisfait, est chargé, par le rédacteur en chef du magazine « de niche » avec lequel il collabore, de se rendre à Rome pour interviewer un célèbre réalisateur, auteur d’un film au succès foudroyant, au centre duquel se trouve un charmeur mémorable. Federico découvre rapidement que le réalisateur est un fugitif, mais en contrepartie, lors d’une soirée mondaine, il se voit présenter l’homme qui aurait servi de modèle à ce personnage : Barry Volpicelli. Sorte de psychopompe à mi-chemin entre le joueur de flûte et le Bruno Cortona du Fanfaron de Dino Risi, Barry conduira Federico dans un lieu enchanteur : Paradiso, un immense ensemble de villas et de bungalows délabrés sur la côte du Latium, où il vit en compagnie d’un petit groupe de vieux fous attachants et farfelus. Un ambassadeur qui accumule les produits discount, un gynécologue à la retraite qui élève des poulets d’ornement, le prince Gelasio Aldobrandi qui, en proie à une perpétuelle angoisse « mystico-héraldique », poursuit le rêve irréalisable d’un héritier, un couple de lesbiennes qui regrette l’époque glorieuse où elles étaient invitées au Vatican par le pape Ratzinger, une ancienne bellone qui accuse tout le cinéma italien de lui avoir volé ses idées et, enfin, la première et la deuxième Madame Volpicelli. Entre des conversations interminables d’une futilité délirante et une nuit où l’on menace de tuer l’un des invités, entre l’arrivée d’un célèbre influenceur et une mort suspecte, le jeune Federico verra et apprendra beaucoup de choses pendant son séjour au Paradiso. Jusqu’au moment où il se rend compte qu’il ne peut pas, ou ne veut pas, partir.
Alain Damasio, Vallée du silicium, Seuil, 2024

« Ce qui manque furieusement à notre époque, c’est un art de vivre avec les technologies. Une faculté d’accueil et de filtre, d’empuissantement choisi et de déconnexion assumée. Des pratiques qui nous ouvrent le monde chaque fois que l’addiction rôde, un rythme d’utilisation qui ne soit pas algorithmé, une écologie de l’attention qui nous décadre et une relation aux IA qui ne soit ni brute ni soumise ». À San Francisco, au cœur de la Silicon Valley, Alain Damasio met à l’épreuve sa pensée technocritique, dans l’idée de changer d’axe et de regard. Il arpente « le centre du monde » et se laisse traverser par un réel qui le bouleverse. Composé de sept chroniques littéraires et d’une nouvelle de science-fiction inédite, Vallée du silicium déploie un essai technopoétique troué par des visions qui entrelacent fascination, nostalgie et espoir. Du siège d’Apple aux quartiers dévastés par la drogue, de rencontres en portraits, l’auteur interroge tour à tour la prolifération des IA, l’art de coder et les métavers, les voitures autonomes ou l’avenir de nos corps, pour en dégager une lecture politique de l’époque et nous faire pressentir ces vies étranges qui nous attendent.
Marie Cosnay, Des Îles, III. Mer d’Albóran, 2023, L’Ogre, 2024

« Comment meurt-on ? En faisant beaucoup d’histoires. La vie des morts est un récit sans fin. Les vivants ne font pas le poids, même quand ils font tout pour se faire remarquer. Le silence et l’invisibilité sont des leurres. La mer d’Alborán, l’entre deux mers, selon son nom arabe, puisqu’outre qu’elle joint ce que les temps ont voulu séparer à tout prix, lie aussi la Méditerranée et l’Atlantique, nous attendait. Ainsi que l’archipel des Baléares ».
Que fait la politique d’immigration européenne aux liens, aux familles et aux corps ? Que faire des corps des disparus de l’exil et comment leur rendre la dignité humaine qui leur a été niée jusque dans la mort ? Sur les côtes de la mer d’Alborán, Marie Cosnay explore la question des morts sur les routes de l’exil, le refus européen de leur accorder une inhumation ou un rapatriement dignes. Elle démasque les meneurs d’un commerce sordide, les vautours qui s’enrichissent du désespoir des familles de disparus, autour de la recherche de ces corps, de leur identification et cherche inlassablement le frère de son ami Ryad, disparu en mer d’Alborán, en tentant de voir les bateaux, de modéliser les naufrages, pour comprendre ces drames.
Des îles (mer d’Alborán 2023) est le dernier volume d’une trilogie qui restera, comme un témoignage au présent de la période que nous traversons, à la fois « l’instruction d’un procès à venir » et le récit d’une catastrophe humanitaire.
Xavier Bouvet, Le Bateau blanc, Le Bruit du monde, 2024

« À dix heures, Tallinn est vide, en suspension entre deux occupants. Ce silence d’une heure, une heure précisément, marque la césure entre quatre années de guerre et une nouvelle occupation soviétique de cinquante ans. Dans la partition estonienne, ce n’est même pas une pause : un simple soupir ».
En septembre 1944, les Allemands fuient l’Estonie qu’ils occupaient depuis trois ans, tandis que l’Union soviétique s’apprête à envahir de nouveau le petit État balte. Quelques Estoniens vont tenter de s’infiltrer dans cet interstice pour former un gouvernement indépendant et restaurer la République. Ils n’ont que quelques jours pour réaliser cette mission ; un navire envoyé par la résistance en exil doit les sauver de la descente du rideau de fer. À leur tête, l’avocat Otto Tief, retiré de la vie politique depuis dix ans, soucieux d’accomplir son devoir et de retrouver sa famille à Stockholm. Tief s’engage aux côtés de son ami Jüri Uluots, dernier Premier ministre d’une République condamnée par l’Union soviétique de Molotov et de Staline. Autour d’eux cheminent la poétesse Marie Under, prise au piège d’une capitale assiégée, et tous les destins soumis aux décisions impossibles, aux renoncements et au déracinement. Captivé par le silence entourant ces événements, Xavier Bouvet a souhaité raconter le sursaut des individus face à l’irruption de la violence et de l’inexorable, et décrire les résonances intimes du fracas de l’Histoire. Il compose une fresque haletante, dont on achève la lecture le cœur serré.
Sergueï Shikalov, Espèces dangereuses, Seuil, 2024

Un soir d’automne, un trentenaire russe est visité par des fantômes. Fantômes de sa jeunesse et de toutes les autres : celles et ceux qui crurent un temps que leur pays ne les rangeait plus dans la catégorie des espèces dangereuses, des « pervers sexuels ».
Il décrit une Russie peu connue des Occidentaux, une Russie progressiste qui, le temps d’une décennie, a cru aux droits de l’homme et à l’amour libre. Il évoque l’espoir frémissant des jeunes Russes de ne plus faire semblant, d’être enfin acceptés par leur famille et par la « patrie ». Pouvoir se tenir la main dans les rues de Moscou, oser embrasser son amoureux lors du premier concert de Mylène Farmer à Saint-Pétersbourg, s’éblouir de l’Europe et des États-Unis, ouvrir grand les yeux sur les opportunités d’un monde nouveau.
Espèces dangereuses est le récit polyphonique d’un rêve auquel « on » a cru ensemble. « On », ce pronom qui n’existait pas dans sa jeunesse russe mais qui lui permet aujourd’hui d’y retourner en y emmenant tous les autres : les disparus, les oubliés, les gommés.
« Sergueï Shikalov s’est installé en France en 2016, après l’adoption de lois liberticides et discriminatoires visant les homosexuels en Russie. Il a écrit, directement en français, un premier roman fort sur cet exil, les années de liberté que sa génération a vécues sans voir le pire arriver. Récit d’une mémoire qui excède la sienne, texte sociologique émouvant, interrogation sur une communauté impossible, Espèces dangereuses dépasse ses enjeux propres par une pensée de l’usage de la langue et des formes du récit ». (Hugo Pradelle, En attendant Nadeau)
Fatima Ouassak, Rue du passage, JC Lattès, 2024

Au début des années 1980, pour échapper à l’étroitesse de son appartement, une enfant explore avec curiosité ce qui l’entoure : son quartier, l’école au bout de la rue, et l’usine aux trois cheminées où son père travaille. L’enfant habite rue du Passage, au cœur d’une communauté d’habitants venus de l’autre côté de la Méditerranée. Pour la guider dans cet immense terrain de jeu, elle s’est mis en tête de trouver son ange-gardien : serait-ce le passeur de cassettes, qui fait transiter des enregistrements audio d’un continent à l’autre ? La doseuse d’épices, cette diva capricieuse ? Ou la caftanière, dont le talent de couturière rachète la mauvaise réputation ? Au fil des aventures joyeuses de l’enfant, ces métiers précieux, et d’autres encore, sont pour la première fois nommés, et racontés. Car sinon, qui s’en souviendra ?
Dans ce récit saisissant, à la puissance évocatrice, Fatima Ouassak restitue un monde resté aux marges de l’Histoire et de la sociologie : la classe ouvrière immigrée. Rue du Passage célèbre ces passeurs et passeuses, dont le travail a permis aux exilés de faire communauté, de survivre et de transmettre savoirs et résistance.
« Convaincue de la force de l’imagination, dans le sillage de Castoriadis, Ricœur ou Glissant — pour ne citer que des hommes —, Fatima Ouassak travaille farouchement à transmettre ce qu’elle voit de merveilleux dans le monde, sans jamais dissoudre dans le conte l’expérience réelle de ceux qui le peuplent. La vie du quartier se déroule, au rythme des naissances et des morts, des douleurs de l’exil, des joies des retrouvailles à la mosquée, dans le square de l’île aux oiseaux — non sans lutte contre la municipalité — ou au moyen de cassettes qui dressent des ponts invisibles sur la Méditerranée grâce à un facteur boiteux qui n’est pas sans rappeler le colosse de Rhodes, un pied sur chaque rive (ou presque) ». (Sirîne Poirier, En attendant Nadeau)
Guillaume Marie, Je vais entrer, José Corti, 2024

Il ne saisissait pas tellement l’intérêt de vivre avec les gens. Il a su assez tôt qu’il n’y arriverait pas. Il n’avait pas envie d’apprendre un métier, de gagner de l’argent, d’avoir un savoir-faire ou même de la beauté. Il ne voyait pas pourquoi il aurait dû séduire, les femmes ou bien les hommes, faire le beau, être fort. Il s’en fichait vraiment. C’était quelqu’un de très doux. Vivre lui suffisait. Regarder le ciel, les rochers, les oiseaux. Le reste n’était rien. Il n’avait pas envie de s’extraire de sa condition. Il n’avait pas envie de conquérir quoi que ce soit.
Sa vie durant, Benoît Labre parcourt l’Europe à pied, jusqu’à l’épuisement. Dans Je vais entrer dans un pays, Guillaume Marie retraverse avec justesse et dépouillement son histoire, celle d’une solitude au milieu du XVIIIe siècle, qui se confronte d’abord au rejet de tous puis devient, à l’encontre de ce qu’il cherche, un objet de fascination.
« Peut-on encore composer des “vies de saints”, comme il y a mille ans ? Après Christian Bobin, Pascal Quignard, Pierre Michon et quelques autres, Guillaume Marie se confronte à ce défi, et le résultat est plus que convaincant : extrêmement touchant. Ici, pas de miracles hautement glorifiés, ni de pieuses exagérations destinées à l’édification des fidèles. Pour cette hagiographie contemporaine, l’auteur se place au ras du sol, là où avancent péniblement les pieds noirs de crasse de son personnage, ce jeune homme roux et maigre en rupture de ban […] : Benoît-Joseph Labre (1748-1783), le saint patron des vagabonds et des délabrés en tout genre, canonisé en 1881. Un cœur pur en qui l’auteur semble vouloir trouver un frère ». (Denis Cosnard, Le Monde des Livres)
Małgorzata I. Niemczyńska, Borys, Mando, 2024

Lorsqu’Isaac retourne dans son appartement encombré, il le trouve inopinément complètement vide. Que s’est-il passé ici ? Dans une ville étrange, sans nom, soumise à l’état d’urgence depuis des temps immémoriaux, les gens sont porteurs d’un grand mystère. Tout le monde parle de Boris, tout le monde le cherche. Qui est cet homme insaisissable ? Un premier roman courageux de l’auteur de Mrożek. Le strip-tease d’un névrosé.
« Boris ou un jour d’été de Małgorzata I. Niemczyńska est un roman sur une ville balnéaire gouvernée par l’omniprésent Boris et dans laquelle l’état d’urgence prévaut depuis des années. À l’instar de Tomasz Różycki dans Les voleurs d’ampoules et de Georgi Gospodinov dans L’abri du temps, l’auteur recrée avec succès le climat et les spécificités de la dépression d’Europe centrale ». (Karolina Felberg, Kultura Liberalna)
Maciej Jakubowiak, Hanka, Czarne, 2024

Il y a d’abord eu Albina. Elle a suivi quelques cours à l’école du village, mais son père ne lui a pas permis d’aller plus loin. Ensuite, il y a eu Hanka, déjà titulaire d’un diplôme d’études secondaires, employée de bureau à la mine, et même sportive dans sa jeunesse. Et après Hanka, il y a Maciek, qui a fait de bonnes études et qui fait partie de l’intelligentsia urbaine. À première vue, il s’agit d’une histoire exemplaire de promotion dans le contexte du XXe siècle. Cependant, une question troublante traverse les pages de cet essai autobiographique : s’agit-il vraiment d’une promotion ? Car, après tout, pour parler d’une vie meilleure, il faut supposer que la précédente était pire. Et quand on reconnaît qu’on est enfin devenu quelqu’un, on suppose tacitement que ses prédécesseurs dans le relais des générations étaient des moins que rien.
Maciej Jakubowiak prend sa propre famille comme un cas d’étude, mais il utilise sa propre histoire comme point de départ d’une réflexion plus large sur la promotion sociale. Quel rôle l’éducation, l’État et le travail jouent-ils réellement ? Que nous laisse-t-il : les histoires des parents et des grands-parents, l’attitude face à l’argent et aux voyages, ou peut-être le ventre ? Et comment décrire le fait que, bien que les choses aillent mieux, elles n’ont peut-être pas tout à fait fonctionné ?
« Si, comme moi, vous attendiez un Eribon polonais, le voici. Cet essai magnifiquement écrit raconte l’histoire d’une famille ordinaire et explique comment la pauvreté et l’exclusion ont frappé plusieurs générations de Polonais. Hanka, qui se sentait nulle, a eu de la chance : un fils talentueux qui voyait en elle une grande héroïne littéraire. Mais c’est lui qui a une dette envers elle, et c’est aussi ce dont parle ce livre. Plein d’esprit, émouvant et important ». (Joanna Kuciel-Frydryszak)
Wit Szostak, Rumowiska, Powergraph, 2024

Les « débris » (Rumowiska) sont des ruisseaux nombreux, avec chacun sa propre source. Il y a l’histoire du grand-père Tomasz, opposant clandestin et député, les secrets de la grand-mère Helena et de leur petit-fils. C’est l’histoire d’une maison pleine de souvenirs, d’objets mémorables, de secrets cachés et de locataires mystérieux. C’est l’histoire de ceux dont on n’a jamais parlé à voix haute dans la famille. Ces histoires peuvent-elles se rencontrer et se croiser, se fondre en une seule rivière ? Ou resteront-elles à jamais séparées ?
Se fondant dans le courant du roman, Rumowiska est un essai sur la rivière à la façon d’un Élisée Reclus autant qu’une histoire sur les petites gens, pleine de méandres et d’embranchements que l’on découvre à la volée. Faut-il voir dans ces histoires des formes illustrées de l’essai ? Qui raconte vraiment ces vies minuscules, et d’où nous viennent-elles ?
Marta Hermanowicz, Koniec, Artrage, 2024

Un roman métaphysique et blasphématoire sur la tragédie de la guerre, qui ne se termine pas avec la signature des traités de paix, mais reste dans ses victimes et se transmet aux générations suivantes. Malwina, une jeune fille dotée d’une sensibilité extraordinaire, fait des rêves de guerre — souvenirs de sa grand-mère — ce qui la fait vivre simultanément dans deux réalités, celle de la guerre (principalement celle du Kresy et de Sibérie) et celle de la Pologne des années 1990.
Les réalités s’interpénètrent, se chevauchent. Malwina, l’attrape-rêves de sa grand-mère, qui a survécu à la tourmente de la guerre, devient une sorte de dibbouk qui donne la parole aux morts. Pour elle, la guerre continue sur les fronts de la nuit et du jour. Une prose puissante, émouvante et brillamment construite.
L’article Littérature européenne : la sélection d’été du Grand Continent est apparu en premier sur Le Grand Continent.
31.05.2024 à 14:21
15 livres à lire en juin 2024
celianmartin
De Van Gogh à Beauvoir en passant par la sécurité nucléaire et l'histoire de l'antisémitisme en Europe, juin est riche parutions.
Nous vous invitons à découvrir notre sélection de 15 titres en 5 langues.
L’article 15 livres à lire en juin 2024 est apparu en premier sur Le Grand Continent.
Texte intégral (5266 mots)
Lire — à l’échelle pertinente : chaque mois, le Grand Continent vous propose une sélection des dernières sorties en sociale en plusieurs langues. Pour ne rien rater, abonnez-vous
Gerard Toal, Oceans Rise Empires Fall. Why Geopolitics Hastens Climate Catastrophe, Oxford University Press

« Il est devenu tout à fait clair que les effets de l’accélération du changement climatique seront catastrophiques, qu’il s’agisse de la montée des eaux, des tempêtes plus violentes ou de la désertification. Dès lors, pourquoi les États-nations éprouvent-ils tant de difficultés à mettre en œuvre des politiques transnationales susceptibles de réduire la production de carbone et de ralentir le réchauffement de la planète ? Dans Oceans Rise, Empires Fall, Gerard Toal désigne la géopolitique comme coupable. Les États préféreraient réduire les émissions dans l’abstrait, mais dans la grande compétition mondiale pour le pouvoir géopolitique, ils donnent toujours la priorité à l’accès aux combustibles à base de carbone, nécessaires pour générer le type de croissance économique qui les aide à rivaliser avec les concurrents. Malgré ce que nous savons aujourd’hui des effets à long terme du changement climatique, les luttes géopolitiques continuent donc de mettre à l’écart les tentatives d’arrêter ou de ralentir le processus.
Le conflit ukrainien, en particulier, met en lumière nos priorités. Pour éviter de dépendre des vastes réserves de pétrole et de gaz de la Russie, les États ont augmenté la production de combustibles fossiles, ce qui accroît nécessairement la quantité de carbone dans l’atmosphère. Les impératifs de contrôle territorial des grandes puissances empêchent toute collaboration pour relever les défis communs. Les drames territoriaux, technologiques et de ressources qui se jouent sur l’échiquier géopolitique masquent actuellement la détérioration des systèmes de survie de la planète. Dans la compétition entre la géopolitique et les politiques climatiques durables, la première a la priorité, en particulier lorsque la concurrence se transforme en conflit ouvert. »
Parution le 4 juin
Jörg Später, Adornos Erben. Eine Geschichte aus der Bundesrepublik, Suhrkamp

« En octobre 1949, Theodor W. Adorno est revenu de son exil américain dans sa ville natale pour enseigner à nouveau dans une université allemande. Francfort était en ruines, les nazis n’avaient fait que changer de vêtements, mais les étudiants affluaient. Le philosophe fut bientôt entendu chaque semaine à la radio et devint un maître à penser et un “éducateur” de la jeune République fédérale. Lorsque Adorno mourut en 1969, l’Institut de recherche sociale et son directeur étaient connus dans toute l’Allemagne. L’École de Francfort était au zénith de son influence.
Cet espace de pensée et ses métamorphoses entre l’après-guerre et la réunification sont le sujet de ce livre, douze collaborateurs d’Adorno ses protagonistes. Après la mort du “maître”, ils se sont dispersés des rives du Main vers Giessen, Lüneburg ou Starnberg. Jörg Später suit leurs parcours et décrit la façon dont ils ont accepté et transformé l’héritage d’Adorno dans les domaines de la science, de la politique et des nouveaux mouvements sociaux. Adornos Erben réécrit l’histoire de la théorie critique comme un grand récit polyphonique de l’ancienne République fédérale — un pays qui a existé vingt ans avec Adorno et vingt ans sans lui. »
Parution le 17 juin
Richard Overy, Why War ?, W. W. Norton & Company
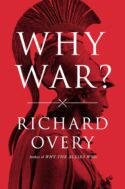
« Pourquoi la guerre a-t-elle été si présente dans le passé de l’humanité ? Richard Overy n’est pas le premier chercheur à se pencher sur cette question. En 1931, à la demande de la Société des Nations, Albert Einstein invita Sigmund Freud à collaborer à un court ouvrage examinant s’il existait “un moyen de délivrer l’humanité de la menace de la guerre”. Publié l’année suivante sous la forme d’un pamphlet intitulé “Pourquoi la guerre ?”, cet ouvrage présente la conclusion de Freud selon laquelle la “pulsion de mort” rend toute délivrance impossible, l’impulsion psychologique à la destruction étant universelle dans le règne animal. Les guerres mondiales de la fin des années 1930 et des années 1940 semblaient être une preuve suffisante de cette triste conclusion. Historien éminent de ces guerres, Richard Overy apporte ses vastes connaissances et ses années d’expérience pour démêler les motivations complexes de la guerre. Son approche consiste à distinguer ses principaux moteurs et motivations et à examiner la manière dont chacun d’entre eux a contribué à l’organisation des conflits. »
Parution le 4 juin
Berna León, Javier Carbonell et Javier Soria (dir.), La desigualdad en España, Lengua de Trapo

« L’ascenseur social fonctionne-t-il en Espagne ? Est-il vrai que l’inégalité est nécessaire à la croissance économique ? Dans quelle mesure l’héritage influence-t-il la réussite professionnelle ? Lorsque l’inégalité est étudiée, les réponses à ces questions proviennent généralement exclusivement de l’économie, des sciences politiques ou de la sociologie, mais pas, comme le propose cet ouvrage, d’un point de vue transversal. Les thèmes abordés vont des racines historiques de l’accumulation des richesses au fossé entre les générations, en passant par l’influence du système fiscal, le fossé professionnel entre les hommes et les femmes ou la relation entre la génétique et l’inégalité. Plus de trente experts — nationaux et internationaux — se réunissent dans ces pages pour démonter les mythes qui soutiennent et perpétuent l’inégalité en Espagne. Ce livre offre non seulement une radiographie exhaustive du sujet, mais lance également un appel à l’action pour parvenir à une société plus juste et plus égalitaire. »
Paru le 22 mai
Ivan G. Marcus, How the West Became Antisemitic : Jews and the Formation of Europe, 800–1500, Princeton University Press
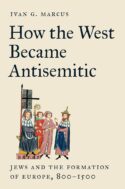
« Dans l’Europe médiévale, les Juifs n’étaient pas des victimes passives de la communauté chrétienne, comme on le croit souvent, mais ils s’affirmaient de manière surprenante, formant une civilisation juive au sein de la société chrétienne latine. Juifs et chrétiens se considéraient tous deux comme le peuple élu de Dieu. Ces revendications contradictoires ont alimenté l’essor de leurs deux cultures, qui sont devenues des rivales pour la suprématie. Dans How the West Became Antisemitic, Ivan Marcus montre comment la concurrence entre chrétiens et juifs dans l’Europe médiévale a jeté les bases de l’antisémitisme moderne.
Les juifs acceptaient les chrétiens comme des pratiquants égarés de leurs coutumes ancestrales, mais considéraient le christianisme comme une idolâtrie. Les chrétiens, quant à eux, considéraient les juifs eux-mêmes — et non le judaïsme — comme méprisables. Ils dirigeaient leur haine contre un Juif réel ou imaginaire : un implacable “ennemi intérieur”. Pour eux, les juifs étaient définitivement et ontologiquement autres, donc impossibles à convertir au christianisme. C’est ainsi que les chrétiens en sont venus à haïr les Juifs, d’abord pour des raisons religieuses, puis pour des raisons raciales. Même lorsque les Juifs ne vivaient plus parmi eux, les chrétiens médiévaux ne pouvaient pas oublier leurs anciens voisins. L’antisémitisme moderne, fondé sur l’image d’un Juif puissant et dominant le monde, est une transformation de cette haine médiévale. »
Parution le 11 juin
Samuel J. Hirst, Against the Liberal Order. The Soviet Union, Turkey, and Statist Internationalism, 1919-1939, Oxford University Press

« Au lendemain de la Première Guerre mondiale, les grandes puissances occidentales ont cherché à redéfinir les normes internationales selon leur vision libérale. Elles ont mis en place des organisations multilatérales dirigées par l’Occident pour réguler les flux transfrontaliers, qui ont joué un rôle essentiel dans l’établissement d’un ordre mondial interconnecté. À rebours de cette transformation bien étudiée, Samuel Hirst examine en détail les réponses de l’Union soviétique vaincue de l’entre-deux-guerres et de la Turquie du début de la République, qui ont défié ce nouvel ordre.
Alors que Mustafa Kemal Atatürk prend les armes en 1920 pour renverser les termes de l’accord de Paris, Lénine lui fournit une aide militaire et économique dans le cadre d’un partenariat que les deux parties qualifient d’anti-impérialiste. Au cours des deux décennies suivantes, les États soviétique et turc ont coordonné des mesures communes pour accélérer leur développement dans des domaines allant de l’aviation à la linguistique. Plus important encore, les ingénieurs et architectes soviétiques ont aidé leurs collègues d’Ankara à lancer un plan quinquennal et à construire d’énormes usines d’État pour produire des textiles et remplacer les importations occidentales. Alors que la coopération des kémalistes avec les bolcheviks a souvent été décrite comme pragmatique, ce livre démontre que Moscou et Ankara se sont en fait rapprochés dans le cadre d’une convergence idéologique ancrée dans l’anxiété du sous-développement par rapport à l’Occident, aboutissant progressivement à un internationalisme étatique comme alternative à l’internationalisation libérale de l’Occident. »
Parution le 27 juin
John Ma, Polis. A New History of the Ancient Greek City-State from the Early Iron Age to the End of Antiquity, Princeton University Press
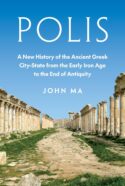
« La polis grecque, ou cité-État, était une institution politique résiliente et adaptable, fondée sur les principes de citoyenneté, de liberté et d’égalité. Apparue vers 650 avant notre ère et ayant perduré jusqu’en 350 de notre ère, elle offrait un moyen de collaboration avec les autres cités-états et de négociation sociale entre une communauté et ses élites, mais à quel prix ? Polis propose un panorama exhaustif de la cité-État grecque antique, de ses diverses formes et de ses caractéristiques durables sur une période d’un millénaire.
Il livre une nouvelle histoire de la polis, retraçant son expansion et son développement en tant que dénominateur commun pour des centaines de communautés, de la mer Noire à l’Afrique du Nord et du Proche-Orient à l’Italie. Il explore ses remarquables réalisations en tant que forme politique offrant à ses membres communauté, autonomie, prospérité, biens publics et espaces de justice sociale. Il nous rappelle également que derrière les succès de l’idéologie et des institutions civiques se cachent des liens avec la domination, l’impérialisme et l’esclavage. Le récit de John Ma, vaste et multiforme, s’appuie sur un riche ensemble de preuves historiques, tout en se confrontant aux vifs débats universitaires et en proposant de nouvelles lectures d’Aristote en tant que grand théoricien de la polis. Polis transforme notre compréhension de l’Antiquité tout en nous mettant au défi de nous attaquer à l’héritage moral d’une idée dont le succès même reposait sur l’inclusion de certains et l’exclusion d’autres. »
Parution le 15 juin
Claire Morelon, Streetscapes of War and Revolution. Prague, 1914-1920, Cambridge University Press
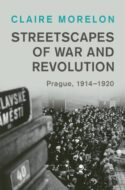
« Prague est entrée dans la Première Guerre mondiale en tant que troisième ville de l’empire des Habsbourg. En 1918, elle est devenue la capitale d’un tout nouvel État-nation, la Tchécoslovaquie. Claire Morelon explore l’aspect, la sonorité et la sensation de cette transition au niveau de la rue. Grâce à des recherches approfondies dans les archives, elle a soigneusement reconstitué la texture sensorielle de la ville, depuis les affiches placardées sur les murs jusqu’aux vitrines des magasins, en passant par les badges portés par les passants et les foules qui se rassemblent pour protester ou célébrer. Le résultat est à la fois un récit atmosphérique de la vie au milieu de la guerre et du changement de régime, et une nouvelle interprétation de l’effondrement impérial vu d’en bas, dans laquelle l’expérience de la vie sur le front intérieur des Habsbourg est essentielle pour comprendre l’ordre mondial de l’après-Versailles qui s’en est suivi. Prague offre un terrain d’étude de cas idéal pour examiner la transition de l’empire à l’État-nation, qui repose sur les rêves révolutionnaires d’une distribution plus équitable et de nouvelles formes de participation politique. »
Parution le 6 juin
Christopher Hobbs, Sarah Tzinieris et Sukesh Aghara (dir.), The Oxford Handbook of Nuclear Security, Oxford University Press

« Le Oxford Handbook of Nuclear Security propose un examen complet des efforts déployés pour sécuriser les actifs nucléaires sensibles et atténuer le risque de terrorisme nucléaire émanant d’acteurs non étatiques. Il vise à donner au lecteur une compréhension globale de la sécurité nucléaire en explorant ses dimensions juridiques, politiques et techniques aux niveaux international, national et organisationnel. Reconnaissant qu’il n’existe pas d’approche unique de la sécurité nucléaire, l’ouvrage explore les éléments et concepts fondamentaux dans la pratique à travers un certain nombre d’études de cas qui montrent comment et pourquoi les approches nationales et organisationnelles ont divergé. Bien qu’il soit axé sur la critique des activités passées et actuelles, l’ouvrage aborde également des aspects inexplorés mais pourtant cruciaux de la sécurité nucléaire, ainsi que la manière dont les lacunes des efforts internationaux pourraient être comblées. »
Parution le 20 juin
José María Barreda Fontes, Un militante de base en (la) Transición, Catarata

« José María Barreda, qui se définit comme un “militant de base”, offre dans ce livre des clés pour comprendre les motivations des étudiants qui se sont engagés contre le franquisme et ont contribué à ce que, si le dictateur est mort dans son lit, la dictature soit vaincue dans la rue. L’auteur rend compte de leur évolution idéologique, parallèle à celle de la gauche dans son ensemble, depuis l’influence de Vatican II, en passant par l’abandon du léninisme par le PCE, l’abandon du marxisme par le PSOE, jusqu’aux convictions sociales-démocrates qui conduisent à la lutte pour que tous les êtres humains soient traités avec dignité et bénéficient d’une sécurité du berceau à la tombe. Tout cela dans un contexte historique où la sortie de la dictature se jouait dans la tension entre les réformistes du régime et les rupturistes de l’opposition démocratique. »
Parution le 3 juin
Adriano Prosperi, Missionari. Dalle Indie remote alle Indie interne, Laterza

« Le missionnaire est l’une des figures clés de la modernité : un homme prêt à partir vers des contrées lointaines en obéissant à un ordre ou à cette voix intérieure que l’on appelle la vocation. Il est alors le médiateur de la rencontre entre les hommes, le professionnel du contact entre des peuples qui s’ignorent, le témoin placé à la jonction de cultures et d’univers mentaux différents, souvent incompatibles. Il lui revient de concilier l’idée occidentale de Dieu comme personne avec les notions totalement différentes des cultures orientales.
Son modèle devait se heurter à celui du croisé, prêt à toutes les violences, y compris la guerre, pour obtenir par la force l’adhésion qui lui était refusée. Au fil du temps, le pouvoir de donner la missio, longtemps concentré entre les mains du pontife, a été progressivement délégué à d’autres figures de la hiérarchie ecclésiastique, mais aussi aux souverains des États européens qui voyaient dans l’organisation des ordres missionnaires un puissant instrument de domination coloniale. »
Parution le 21 juin
Kellie Carter Jackson, We Refuse. A Forceful History of Black Resistance, Basic Books
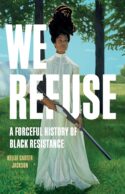
« La résistance des Noirs à la suprématie blanche est souvent réduite à une simple dialectique binaire entre la non-violence de Martin Luther King Jr. et le “par tous les moyens” de Malcolm X. Dans We Refuse, l’historienne Kellie Carter Jackson nous invite à dépasser cette fausse alternative en proposant un examen sans complaisance de l’ampleur des réponses apportées par les Noirs à l’oppression blanche, en particulier celles mises en œuvre par les femmes noires.
Le rejet de la “violence noire” comme forme illégitime de résistance est lui-même une manifestation de la suprématie blanche, une distraction de la violence insidieuse et implacable du racisme structurel. La force, qu’il s’agisse d’arrêts de travail, de destructions de biens ou de révoltes armées, a joué un rôle essentiel dans l’obtention de la liberté et de la justice pour les Noirs depuis l’époque des révolutions américaine et haïtienne. Mais la violence n’est qu’un outil parmi d’autres. Kellie Carter Jackson examine d’autres tactiques, non moins vitales, qui ont façonné la lutte des Noirs, depuis le pouvoir réparateur de la joie face à la souffrance jusqu’à la force tranquille du simple fait de s’éloigner. »
Parution le 4 juin
Marine Rouch, Chère Simone de Beauvoir. Vies et voix de femmes « ordinaires ». Correspondances croisées 1958-1986, Flammarion

« Simone de Beauvoir a sans doute été l’intellectuelle de gauche la plus influente en France et dans le monde, des années 1950 jusqu’à sa mort, en 1986. Comme toute célébrité, elle a reçu des milliers de lettres. Mais contrairement à d’autres figures publiques et de façon tout à fait exceptionnelle, elle en a conservé environ 20 000 et a entretenu de nombreuses correspondances suivies, notamment avec ses lectrices “ordinaires”. Lorsqu’il y a dix ans je me suis lancée dans la lecture de ces lettres, j’ai eu l’immense privilège de rencontrer cinq des correspondantes les plus assidues de Simone de Beauvoir : Colette Avrane, Huguette-Céline Bastide, Mireille Cardot, Claire Cayron et Blossom Margaret Douthat Segaloff. Ce sont leurs lettres, accompagnées des réponses de l’écrivaine, qui sont publiées dans ce recueil.
Véritable plongée dans l’intimité de cinq femmes, ces lettres donnent aussi à voir le tissu culturel et social des Trente Glorieuses. L’adolescence, le lesbianisme, la contraception, le couple, les violences conjugales, la lutte contre l’ordre dominant bourgeois ou encore l’anticolonialisme et le racisme sont autant de sujets abordés. On y découvre en même temps un aspect inédit de la personnalité et de la trajectoire intellectuelle de Beauvoir qui permet de renouer avec la radicalité et la portée révolutionnaire de sa pensée. »
Parution le 12 juin
Michael Lobel, Van Gogh and the End of Nature, Yale University Press

« Vincent van Gogh (1853-1890) est le plus souvent présenté comme le peintre de la nature par excellence, dont l’œuvre tire sa force de ses rencontres directes avec des paysages intacts.
Michael Lobel bouleverse cette vision banale en montrant comment les tableaux de Van Gogh sont inséparables de l’ère industrielle moderne dans laquelle l’artiste a vécu — depuis ses usines et ses ciels pollués jusqu’à ses mines de charbon et ses usines à gaz — et comment son art s’est inspiré des déchets et de la pollution pour ses sujets, voire pour les matériaux mêmes dont il était fait. Michael Lobel souligne comment l’engagement de Van Gogh dans les réalités environnementales de son époque constitue un avertissement répété des menaces de changement climatique et de destruction écologique auxquelles nous sommes confrontés aujourd’hui. »
Parution le 25 juin
Christian Seignobos et Henry Tourneux, Aux marges des grands royaumes. Une histoire orale de Maroua, Afrique centrale, CNRS Éditions

« Comment articuler histoire et tradition orale ? À cette question structurelle pour l’histoire de l’Afrique — et bien au-delà —, il est répondu ici par l’exemple, par l’établissement d’une source nouvelle : les récits historiques de la région de Maroua, aujourd’hui au nord du Cameroun, du traditionniste Oumarou Tchinda, enregistré au tournant des années 1980 et 1990. Placés en première partie du volume, ces récits originaux en fulfulde, traduits en français, conservent toute la spontanéité et la musicalité de la parole vive. Ils sont éclairés par une introduction qui donne les clés de l’histoire de la région et présente les conditions d’enquête comme celles de l’établissement du texte. En deuxième partie, la chronique en langue originale est enrichie d’un vaste commentaire, nourri des récits de plusieurs autres traditionnistes rencontrés et enregistrés au fil des années, parmi lesquels Saïdou Mal Hamadou et Hamadou Dalil.
Cet ensemble documentaire d’une très grande richesse permet de revenir sur les principaux moments qui ont marqué la région du XVIIIe au début du XXe siècle — entre conquête peule, chefferies traditionnelles et période coloniale. Il nous transmet des mémoires enchâssées conduisant de la période mythique des hommes à queue qui vivaient jadis dans les termitières jusqu’aux hauts faits de Zigla Greng, le prince des brigands, qui défrayait la chronique à l’heure de l’occupation allemande. »
Parution le 13 juin
L’article 15 livres à lire en juin 2024 est apparu en premier sur Le Grand Continent.
03.05.2024 à 06:00
20 livres à lire en mai 2024
celianmartin
De Nietzsche à Matteotti en passant par Charlie Chaplin, notre sélection des nouvelles parutions en sciences sociales pour le mois de mai vous fait voyager en cinq langues. De l’Asie centrale du « Grand jeu » à l’importance des épices venues des îles Moluques — et de celle de la poésie à l’âge du désenchantement.
L’article 20 livres à lire en mai 2024 est apparu en premier sur Le Grand Continent.
Texte intégral (7172 mots)
Lire — à l’échelle pertinente : chaque mois, le Grand Continent vous propose une sélection des dernières sorties en sociale en plusieurs langues. Pour ne rien rater, abonnez-vous
Barbara Emerson, The First Cold War. Anglo-Russian Relations in the 19th Century, Hurst

« La Grande-Bretagne et la Russie ont maintenu une civilité glaciale pendant quelques années après la défaite de Napoléon en 1815. Mais dès les années 1820, leurs relations ont dégénéré en une rivalité acrimonieuse et constante autour de la Perse, de l’Empire ottoman, de l’Asie centrale — le Grand Jeu — et, vers la fin du siècle, de l’Asie de l’Est.
The First Cold War restitue le point de vue russe sur ce « jeu », en s’appuyant sur les archives tsaristes. Chacune des deux puissances mondiales est alors convaincue des visées expansionnistes de l’autre, qu’elle considèrent comme s’exerçant à ses dépens. Quand l’une réussit, l’autre fait monter les enchères, et c’est ainsi que les choses s’enveniment. Londres et Saint-Pétersbourg n’ont certes été en guerre ouverte qu’une seule fois, lors de la guerre de Crimée. Mais la russophobie et l’anglophobie se sont enracinées de part et d’autre tandis que ces deux grands empires restaient au bord des hostilités pendant près d’un siècle.
Ce n’est que lorsque la Grande-Bretagne et la Russie ont reconnu qu’elles avaient plus à craindre de l’Allemagne wilhelminienne qu’elles ont largement mis de côté leurs rivalités par la convention anglo-russe de 1907, qui a également eu des répercussions majeures sur l’équilibre des pouvoirs en Europe. »
Roger Crowley, Spice. The 16th-Century Contest that Shaped the Modern World, Yale University Press
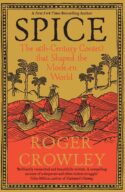
« Les épices ont été le moteur de l’économie mondiale au début des temps modernes et, pour les Européens, elles représentaient une richesse sans précédent. Les clous de girofle et les noix de muscade ne pouvaient atteindre l’Europe qu’en empruntant un réseau complexe de routes commerciales et, pendant des décennies, les explorateurs espagnols et portugais ont rivalisé pour trouver leur source insaisissable. Mais lorsque les Portugais ont finalement atteint les îles à épices des Moluques en 1511, ils ont déclenché une compétition féroce pour leur contrôle.
Roger Crowley montre comment cette lutte a façonné le monde moderne. De 1511 à 1571, les puissances européennes ont relié les océans, établi de vastes empires maritimes et donné naissance au commerce mondial, tout cela dans le but de contrôler l’approvisionnement en épices. Nous emmenant en voyage depuis les chantiers navals de Séville jusqu’à l’immensité du Pacifique, en passant par les îles volcaniques aux épices d’Indonésie, le cercle arctique et les côtes chinoises, cette histoire est riche en témoignages vivants des aventures, des naufrages et des sièges qui ont marqué les premières rencontres coloniales – et remodelé l’économie mondiale pour les siècles à venir. »
Parution le 14 mai
Sous la direction de Giuliano da Empoli.
Avec les contributions d’Anu Bradford, Josep Borrell, Julia Cagé, Javier Cercas, Dipesh Chakrabarty, Pierre Charbonnier, Aude Darnal, Jean-Yves Dormagen, Niall Ferguson, Timothy Garton Ash, Jean-Marc Jancovici, Paul Magnette, Hugo Micheron, Branko Milanovic, Nicholas Mulder, Vladislav Sourkov, Bruno Tertrais, Isabella Weber, Lea Ypi.
Fanny Bugnon, L’Élection interdite. Itinéraire de Joséphine Pencalet, ouvrière bretonne (1886-1972), Seuil

« En 1925, des femmes se présentent aux élections municipales sous la bannière communiste, alors même qu’elles n’ont pas le droit de vote, et encore moins celui d’être élues. Parmi elles, Joséphine Pencalet à Douarnenez, en Bretagne. Fille de marin, elle fait partie de ces sardinières, les Penn Sardin, qui quelques mois plus tôt ont défrayé la chronique pour avoir mené une grève dure, longue et victorieuse. Elle est élue. C’est une première dans la vie politique française. Mais la victoire est de courte durée. L’élection est invalidée et Joséphine Pencalet tombe dans l’oubli jusqu’à sa redécouverte progressive à la faveur des initiatives de passeurs de la mémoire locale et du renouveau féministe. Mais qui était vraiment Joséphine Pencalet ? Une Louise Michel bretonne ? Une féministe avant l’heure ?
Pour répondre à ces questions, Fanny Bugnon se penche sur les archives, les traces et les silences laissés par cette femme au destin tout à la fois ordinaire et remarquable. Retraçant son itinéraire, elle dévoile les enjeux sociaux, politiques et économiques qui ont traversé la condition féminine au cours du XXe siècle, bien au-delà du port breton. »
Parution le 10 mai
Irad Malkin et Josine Blok, Drawing Lots. From Egalitarianism to Democracy in Ancient Greece, Oxford University Press

« Cet ouvrage rédigé par deux historiens de renom propose une étude complète du tirage au sort en tant qu’institution centrale de la société grecque antique. Les auteurs explorent l’état d’esprit égalitaire, « horizontal », exprimé par le recours au tirage au sort, qui s’oppose à une vision descendante de l’autorité et de la souveraineté. Le tirage au sort présuppose l’égalité entre ceux qui y prennent part. Il était utilisé pour distribuer des terres, des héritages, du butin, de la viande sacrificielle, sélectionner des individus, fixer des tours, mélanger et réorganiser des groupes, ou encore connaître la volonté des dieux.
Le tirage au sort cristallisait les frontières de la communauté et soulignait sa souveraineté. Le livre étudie ensuite la transposition du tirage au sort au gouvernement de la polis. L’égalitarisme implicite du tirage au sort est souvent en conflit avec les perceptions descendantes de la société et les valeurs d’inégalité, de statut et de mérite. Le tirage au sort a été introduit dans les oligarchies et les démocraties à un rythme et à une échelle inégaux. »
Parution le 21 mai
Juan Francisco Fuentes, Bienvenido Mister Chaplin. La americanización del ocio y la cultura en la España de entreguerras, Taurus

« Après la Première Guerre mondiale, l’influence américaine se répand dans le monde entier, et l’Espagne n’y échappe pas. À une époque de modernisation intense de la société, l’irruption de la culture de masse américaine y suscite une passion soudaine. Pour de nombreux Espagnols nés avec le siècle, la « Yanquilandia », comme Unamuno appelait le vieil ennemi de 98, devient un modèle de civilisation et façonne de manière décisive leur vision du monde. Les émigrants transmettent dans leurs lettres et leurs photographies l’image des États-Unis comme une terre promise, pleine de progrès techniques et sociaux, et les architectes construisent des gratte-ciel — ou « rascacielitos » — qui tentent d’imiter ceux de New York et de Chicago.
Juan Francisco Fuentes décrit l’esprit des « happy twenties » espagnoles, une époque marquée, malgré le nationalisme et le puritanisme officiels, par l’hédonisme, la liberté et la fascination pour l’American way of life. En Espagne, on danse le fox-trot et le charleston, le jazz et les marques américaines triomphent, les stars du cinéma muet comme Charles Chaplin et Buster Keaton font fureur et inspirent l’avant-garde artistique et littéraire et, en particulier, la Génération de 27. Cette idylle avec les États-Unis, qui touche aussi la gauche, même en pleine guerre de Sécession, est un phénomène aussi révélateur que méconnu. »
Parution le 23 mai
Dagmar Herzog, Eugenische Phantasmen. Eine deutsche Geschichte, Suhrkamp

« Ce livre tente d’élaborer une histoire intellectuelle de la déficience mentale en retraçant les débats sur la valeur de la vie handicapée tels qu’ils ont été menés au cours des 150 dernières années. L’abîme de cette époque a été un projet de meurtre de masse presque inimaginable, qui a une histoire complexe et une postérité étonnamment longue. Désapprendre l’eugénisme s’est avéré être un processus extraordinairement tenace en Allemagne, qui n’est toujours pas terminé aujourd’hui.
Dagmar Herzog décrit les conflits récurrents sur l’interprétation des faits et les conséquences pratiques à en tirer. Dans ces débats à forte charge tant politique qu’émotionnelle, des concepts issus de la médecine et de la pédagogie se sont mêlés à des conceptions théologiques, mais aussi à celles concernant le travail et la sexualité, la vulnérabilité humaine et l’interdépendance. Comment penser et ressentir les concitoyens atteints de troubles cognitifs et de diagnostics psychiatriques les plus divers ? Comment les traiter ? En débattant de ces questions, les Allemands se sont toujours interrogés sur l’image qu’ils avaient d’eux-mêmes en tant que nation. »
Parution le 20 mai
Pierre Haroche, Dans la forge du monde. Comment l’Europe est façonnée par le choc des puissances, Fayard

« Les Européens ont été les premiers à faire le tour du globe, en 1522. Ils ont donné à la mondialisation son impulsion par les voyages, le commerce et la colonisation, unifiant le monde comme leur vaste empire. Ils n’étaient pas une civilisation, ils étaient la civilisation.
Aujourd’hui, ils assistent au retour du balancier : désormais, l’histoire, c’est les autres. La rivalité entre les États-Unis et la Chine relègue au second plan un Vieux Continent confronté à nouveau à la guerre contre la Russie. Voilà le phénomène que Pierre Haroche met en lumière : le rôle de plus en plus crucial de la nouvelle compétition mondiale entre puissances dans le destin européen. Sous l’effet des dernières crises, dont l’électrochoc ukrainien, les Européens sont contraints d’innover, de se repenser, pour surmonter leurs faiblesses. Une nouvelle Europe est en train de sortir de la forge du monde. Explorer cette boucle inattendue, cette valse séculaire entre deux entités titanesques — l’Europe et le monde —, tel est le projet de ce livre. Car nous sommes à la croisée des chemins. »
Parution le 2 mai
Fabio Fiore, L’affaire Matteotti. Storia di un delitto, Laterza

« Le 10 juin 1924, à 16h30, à Rome, sur le lungotevere Arnaldo da Brescia, un homme est embarqué de force dans une voiture. Il s’agit de Giacomo Matteotti, opposant indomptable au fascisme et à Benito Mussolini. Le « crime de Matteotti », dont on commémore cette année le centenaire, est sans doute la plus grande « affaire » de l’histoire italienne.
Fabio Fiore commence par analyser la scène et décrire les mécanismes du crime. Ensuite, il en débusque les auteurs et leurs commanditaires — le Duce et son entourage — et raconte la formidable lutte pour le pouvoir et la survie d’hommes divisés sur tout, mais unis par le mensonge et par la certitude que pour se sauver, ils doivent sauver Benito Mussolini à tout prix. Il s’interroge ensuite sur les motivations possibles du crime. Enfin, comme dans tout crime, il y a un « après », les multiples « issues de secours » de l’affaire : des procès de 1926 et 1947 au sort de chaque protagoniste dans les décennies suivantes. Mais il y a surtout Giacomo Matteotti. Jusqu’à présent, cette figure était comme un fantôme : une absence, un corps, la victime. L’auteur nous invite à nous demander : qui est Matteotti, qui était-il ? Et pourquoi lui ? »
Parution le 17 mai
Michael A. Cook, A History of the Muslim World : From Its Origins to the Dawn of Modernity, Princeton University Press
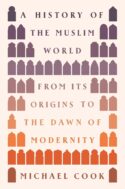
« Ce livre décrit et explique les principaux événements, personnalités, conflits et convergences qui ont façonné l’histoire du monde musulman. Le corps de l’ouvrage conduit le lecteur des origines de l’islam à la veille du XIXe siècle, et un épilogue poursuit l’histoire jusqu’à nos jours. Michael Cook propose ainsi une vaste histoire d’une civilisation remarquable à la fois par son unité et sa diversité.
Après avoir planté le décor dans le Moyen-Orient de la fin de l’Antiquité, le livre dépeint la montée de l’islam comme l’un des grands cygnes noirs de l’histoire. Il présente ensuite l’essor spectaculaire du califat, un empire qui, au moment de son éclatement, a favorisé la formation d’une nouvelle civilisation. Il couvre ensuite les diverses histoires des principales régions du monde musulman, en fournissant un compte rendu détaillé des principaux développements militaires, politiques et culturels qui ont accompagné l’expansion de l’islam vers l’est et vers l’ouest, du Moyen-Orient aux rives de l’Atlantique et du Pacifique. »
Parution le 7 mai
Sarah Rey, Manus. Une autre histoire de Rome, Albin Michel

« Le corps est un langage à Rome, dont Sarah Rey propose d’étudier la grammaire à travers le prisme riche et original de la main. Que nous apprend-t-elle du monde romain, de sa symbolique et de ses usages, des plus traditionnels aux plus surprenants ?
La main prête serment à Rome, scelle les contrats, pratique les rituels, soigne, commande, exécute, affranchit, est aussi éloquente que la voix…, mais elle peut encore se montrer impie, défaillante ou disgracieuse, et être frappée d’interdit. Dextra ou sinistra, célébrée ou crainte, et parfois même mutilée, la main se révèle un outil essentiel dans l’élaboration des codes moraux, sociaux et religieux des débuts de la République à l’avènement de l’Empire. Sarah Rey montre combien son importance est manifeste au sein de toutes les couches de la population romaine, des élites dirigeantes aux travailleurs manuels, artisans comme paysans, en passant par les soldats, les prêtres et les médecins. On explore ainsi, à travers la main, toute une série d’expressions de ce qui fait au quotidien la romanité. »
Parution le 2 mai
Gilles Vergnon, Changer la vie ?. Le temps du socialisme en Europe de 1875 à nos jours, Gallimard

« Le mouvement socialiste plonge ses racines dans les idées révolutionnaires internationalistes du XIXe siècle, se développe dans les pays industrialisés d’Europe au long du XXe et façonne le visage politique, social et culturel du Vieux Continent — à la différence de son « frère ennemi », le communisme, qui se déploie dans le même temps à l’échelle mondiale.
Gilles Vergnon élargit la focale au-delà de la France, met l’accent sur les temps forts du socialisme européen, ses combats, ses principales figures, ses controverses et ses échecs. Il suit son accommodation progressive aux contraintes de l’exercice gouvernemental et ses transformations au contact du réel.
Tout à la fois idée, formalisée en doctrine, tendance partisane et culture politique le socialisme semble affaibli cent cinquante ans après son émergence, et traverse dans certains pays une crise identitaire majeure. Il n’en reste pas moins un mouvement omniprésent et un acteur essentiel de la scène politique et sociale européenne. »
Parution le 30 mai
Michel Foucault, Nietzsche. Cours, conférences et travaux, Seuil

« Les Cours, conférences et travaux sont des témoignages inédits du « travail » de Foucault avec Nietzsche. Ces textes datent des deux grandes périodes de sa vie intellectuelle : d’abord le début des années 1950, quand il s’intéresse à Hegel et à la phénoménologie, ainsi qu’au marxisme. Le jeune Foucault expérimente alors de nouvelles approches pour développer une philosophie fondée sur l’expérience et l’analyse du discours. Ensuite, après la publication des Mots et les Choses en 1966, lorsque Foucault revient avec élan à Nietzsche pour élaborer sa propre méthode généalogique, relançant ainsi son projet d’une histoire de la vérité et du dire vrai.
C’est à travers la confrontation avec Nietzsche que Foucault aura construit sa propre manière de philosopher. Ces Cours, conférences et travaux sont indispensables pour comprendre comment Foucault a lu Nietzsche, en particulier au moment décisif où il le découvre. Ils sont essentiels pour saisir le Nietzsche de Foucault. »
Parution le 31 mai.
Sabrina Pisu, Il mio silenzio è una stella. Vita di Francesca Morvillo, giudice innamorata di giustizia, Einaudi

« Depuis le 23 mai 1992, date du massacre de Capaci, Francesca Morvillo a été enfermée et invisibilisée, réduite au statut de « femme de » Giovanni Falcone, morte d’une tragique fatalité. Au contraire, elle fut une magistrate d’une extrême valeur, pendant plus de seize ans substitut du procureur au Tribunal des mineurs de Palerme où, avec une approche avant-gardiste, elle a tenté de réhabiliter des mineurs qui s’étaient retrouvés en prison. Plus tard, à la Cour d’appel, elle a suivi des procès cruciaux contre la mafia, dont celui contre Vito Ciancimino. À partir de témoignages exclusifs, comme celui de son frère Alfredo, et de documents inédits, Sabrina Pisu esquisse un portrait profond de Francesca Morvillo : une femme libre et réservée, éprise d’un idéal de justice, qui préférait aux mots l’engagement silencieux et le devoir quotidien. »
Paru le 30 avril
Arnau Fernández Pasalodos, Hasta su total extermino. La guerra antipartisana en España (1936-1952), Galaxia Gutenberg

« La guerre civile espagnole, traditionnellement délimitée entre 1936 et 1939, a eu un autre visage : celui de la guerre irrégulière, un affrontement aux caractéristiques très différentes qui a d’ailleurs duré jusqu’en 1952. Dans ce livre, Arnau Fernández Pasalodos se penche sur cette guerre et sur les dynamiques qui ont déterminé le fonctionnement de la Garde civile au début du régime franquiste. Il en ressort un portrait à multiples facettes de la brutalité et de la répression exercées à tous les niveaux à l’encontre des partisans, de leurs collaborateurs, de leurs familles et même des civils en dehors du conflit. Mais en même temps, ce livre met en lumière un autre aspect que l’historiographie a négligé : la réalité de l’action de la garde civile dans la lutte anti-guérilla. De nombreux membres de ce corps n’étaient pas là pour des raisons idéologiques, mais par nécessité. Ils recevaient l’un des salaires les plus bas en échange d’une vie de misère. Ils avaient peur et évitaient souvent d’obéir aux ordres qu’ils recevaient. »
Parution le 8 mai
Charles Taylor, Cosmic Connections. Poetry in the Age of Disenchantment, Harvard University Press

« Réagissant à la chute des ordres cosmiques à la fois métaphysiques et moraux, les romantiques ont eu recours à la poésie pour reprendre contact avec la réalité placée au-delà de leur existence fragmentée. Ils ont cherché à surmonter le désenchantement et ont tâtonné vers un nouveau sens de la vie. Leurs réalisations ont été prolongées par les générations post-romantiques. Charles Taylor nous emmène de Hölderlin, Novalis, Keats et Shelley à Hopkins, Rilke, Baudelaire et Mallarmé, puis à Eliot, Miłosz et au-delà.
En recherchant une compréhension plus profonde et une orientation différente de la vie, le langage de la poésie n’est pas simplement une présentation agréable de doctrines déjà élaborées ailleurs. Au contraire, insiste Taylor, la poésie nous persuade par l’expérience de la connexion. La conviction qui en résulte est très différente de celle obtenue par la force de l’argumentation. Par sa nature même, le raisonnement de la poésie est souvent incomplet, provisoire et énigmatique. Mais en même temps, sa perspicacité est trop émouvante — trop manifestement vraie — pour être ignorée. »
Parution le 21 mai
Sous la direction de Giuliano da Empoli.
Avec les contributions d’Anu Bradford, Josep Borrell, Julia Cagé, Javier Cercas, Dipesh Chakrabarty, Pierre Charbonnier, Aude Darnal, Jean-Yves Dormagen, Niall Ferguson, Timothy Garton Ash, Jean-Marc Jancovici, Paul Magnette, Hugo Micheron, Branko Milanovic, Nicholas Mulder, Vladislav Sourkov, Bruno Tertrais, Isabella Weber, Lea Ypi.
W. Daniel Wilson, Goethe und die Juden. Faszination und Feindschaft, C.H. Beck

« Les relations de Goethe avec les juifs de son temps étaient plus qu’ambiguës. À côté d’une certaine fascination, il y avait des préjugés et — surtout dans les dernières années de Goethe — une véritable hostilité, qu’il n’exprimait toutefois qu’en privé. Sur la base de sources jusqu’ici inexploitées, W. Daniel Wilson dévoile cet aspect difficile de l’œuvre et de l’activité de Goethe.
« Selon les anciennes lois, aucun juif ne peut passer la nuit à Iéna. Cette louable disposition devrait certainement être mieux maintenue à l’avenir que jusqu’à présent ». C’est ce qu’écrivait Goethe dans une lettre de 1816. Dans ses déclarations et activités publiques, il se présentait le plus souvent comme un ami des juifs, afin de ne pas perdre ses nombreux admirateurs et admiratrices juifs. Mais c’est surtout à partir de 1796 qu’il s’opposa fermement à l’émancipation des juifs. Cette attitude n’était d’ailleurs qu’en contradiction apparente avec ses contacts amicaux avec certains juifs cultivés. »
Parution le 16 mai
Eugene Rogan, The Damascus Events. The 1860 Massacre and the Destruction of the Old Ottoman World, Basic Books.

« Le 9 juillet 1860, une foule en colère déferle sur les quartiers chrétiens de Damas. Pendant huit jours, la violence fait rage, causant la mort de cinq mille chrétiens, le pillage de milliers de magasins et la destruction d’églises, de maisons et de monastères. Cette flambée soudaine et féroce a choqué le monde entier, laissant les chrétiens syriens vulnérables.
S’appuyant sur des témoignages inédits, Eugene Rogan raconte comment une ville multiculturelle paisible a été engloutie par les massacres. Il retrace la manière dont les tensions croissantes entre les communautés musulmanes et chrétiennes ont conduit certains à considérer l’extermination comme une solution raisonnable. Il raconte également la suite de ce désastre, et comment le gouvernement ottoman s’est empressé de reprendre le contrôle de la ville, de mettre fin à la violence et de réintégrer les chrétiens dans la communauté. Ces efforts de reconstruction de Damas ont été couronnés de succès et ont permis de préserver la paix pendant les 150 années suivantes, jusqu’en 2011. »
Parution le 7 mai
Isaac Nakhimovsky, The Holy Alliance : Liberalism and the Politics of Federation, Princeton University Press

« La Sainte-Alliance est aujourd’hui associée à une conspiration réactionnaire. Dans ce livre, Isaac Nakhimovsky montre qu’elle puise ses origines dans la pensée des Lumières, expliquant pourquoi de nombreux contemporains libéraux l’ont d’abord accueillie comme la naissance d’une Europe fédérale et l’aube d’une ère de paix et de prospérité pour le monde. En examinant comment la Sainte-Alliance a pu représenter à la fois une idée de progrès et un emblème de réaction, Isaac Nakhimovsky offre un nouveau point de vue sur l’histoire des alternatives fédératives à l’État-nation. Il en résulte une meilleure compréhension de l’attrait récurrent de ces alternatives et des raisons pour lesquelles la politique de fédération a également été associée à une résistance bien ancrée aux objectifs émancipateurs du libéralisme.
Isaac Nakhimovsky relie l’histoire de la Sainte-Alliance à l’histoire transatlantique mieux connue du constitutionnalisme du XVIIIe siècle et des efforts déployés au XIXe siècle pour abolir l’esclavage et la guerre. Il montre également comment la Sainte-Alliance a été intégrée dans divers récits libéraux de progrès. De la Société des Nations à la guerre froide, des analogies historiques avec la Sainte-Alliance ont continué à être établies tout au long du XXe siècle, et Isaac Nakhimovsky montre comment certains des problèmes politiques fondamentaux soulevés par la Sainte-Alliance ont continué à réapparaître sous de nouvelles formes et dans de nouvelles circonstances. »
Parution le 28 mai
Bastien Cabot, La gauche et les migrations. Une histoire de l’internationalisme (XIXe – XXIe siècle), PUF
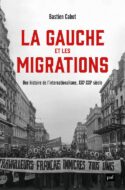
« Depuis plus de quarante ans que le sujet migratoire s’est imposé dans le débat public, la presse n’a pas cessé de souligner le tabou qu’il représenterait pour les formations se réclamant, de façon très large, du socialisme. Pourtant, pendant près d’un siècle et demi, celui-ci a mobilisé l’imaginaire de l’« internationalisme » comme un moyen d’expier les effets mortifères des frontières. Cette aspiration a-t-elle été à la hauteur de ses ambitions, et peut-elle l’être encore ? Ou bien était-elle déterminée par un contexte historique et des expériences individuelles aujourd’hui périmées ?
Cet ouvrage de synthèse historique propose un tour d’horizon mondial du rapport des gauches aux migrations, depuis la fin du XVIIIe siècle jusqu’à nos jours. Nous y croisons des adeptes de Jakob Frank pris dans le tourbillon révolutionnaire français, des travailleurs chinois chassés de Californie à la fin du XIXe siècle, des ouvriers vietnamiens employés dans les usines est-allemandes puis engagés comme experts en Angola… Par-delà leur diversité, ces trajectoires interrogent la tension constitutive de la modernité socialiste, entre un horizon mondial et des réalités nationales ou locales qui lui résistent. »
Parution le 22 mai
Guillaume Sacriste, Le Parlement européen contre la démocratie ? Repenser le parlementarisme transnational, Presses de Sciences-Po

« Le continent européen fait face à une série de crises sans précédent dont la guerre en Ukraine, la crise climatique et la montée du populisme sont les plus saillantes à ce jour. Sous-équipée par rapport à la Chine et aux États-Unis pour y répondre et incapable d’investir massivement au même titre que ses concurrents, l’Europe décroche.
Cette faiblesse de l’Union trouve son origine dans l’illégitimité congénitale du Parlement européen. Les nombreuses tentatives des parlementaires fédéralistes pour l’imposer comme le garant de la démocratie européenne ont échoué : impuissante à mobiliser les ressources collectives des sociétés, l’institution semble jouer contre elle-même. D’autres voies sont pourtant possibles pour permettre à l’Union d’agir démocratiquement, comme la création, à côté du Parlement européen, d’une seconde chambre constituée de représentants des parlements des États membres, dont la légitimité, notamment en matière fiscale, ne fait pas question. »
Parution le 17 mai
L’article 20 livres à lire en mai 2024 est apparu en premier sur Le Grand Continent.
21.04.2024 à 17:30
« Tout commence avec le feu », une conversation avec Hélène Cixous
Matheo Malik
Incendire, le dernier livre d'Hélène Cixous, part de l’expérience vécue d’un méga-feu pour remonter le fil de ses vies.
Dans une conversation fleuve avec le critique d’art Hans Ulrich Obrist, elle jette des ponts entre la permanence d’un ailleurs très ancien et le motif tout proche de la fin du monde pour penser son rapport à la langue et à l’inachevé — accompagnée par Montaigne, Kafka, Rilke, Ronsard, Moïse et la Méduse.
L’article « Tout commence avec le feu », une conversation avec Hélène Cixous est apparu en premier sur Le Grand Continent.
Texte intégral (9864 mots)
La traduction est au cœur du projet de la revue. Depuis notre lancement, nous avons ouvert nos pages aux plus grandes voix de la littérature mondiale — des Prix Nobel Wole Soyinka ou Mario Vargas Llosa à la romancière Scholastique Mukasonga ou au poète Philippe Jaccottet. Premier prix qui reconnaît chaque année un grand récit européen et dont la dotation est sa traduction dans les autres langues continentales, le Prix Grand Continent a été remis l’année dernière au polonais Tomasz Różycki.
Pour soutenir notre travail, nous vous demandons de penser à vous abonner
Dans une précédente conversation avec Olivier Zam et Donatien Grau, interrogée sur votre enfance en Algérie, vous avez répondu que vous étiez « un amas de continents, de contradictions, de compatibles incompatibilités », « le résultat de l’histoire du monde au milieu du XXe siècle, une époque marquée par la violence, les promesses, l’espoir et le désespoir ». Pourriez-vous commencer par aborder ce thème ?
Je commencerai par dire que, lorsqu’on m’a posé cette question, une pensée m’a directement traversé l’esprit : en réalité, l’espoir est quelque chose que je ne connais pas. D’ailleurs, vous utilisez le mot espoir et non celui d’espérance. Au fond, on se confronte déjà à un problème linguistique. L’espérance ne renvoie pas à la même chose que l’espoir. Je pense qu’en allemand, il n’existe qu’un seul et unique mot pour exprimer ces deux réalités. En français, nous en avons deux ; quelque chose s’introduit, qui distingue et affirme que l’espoir et l’espérance, ce n’est pas du tout la même chose. En français, l’espérance renvoie à une vertu. On dit que c’est une liberté théologale : l’espérance, la foi, la charité, ce sont des émotions chrétiennes.
L’espoir, c’est tout à fait autre chose. À y réfléchir, je me dis qu’en Algérie, quand j’étais petite, j’ai abandonné tout espoir. Je n’attendais ni n’espérais rien de ce pays, dévoré par les démons, par les haines et par les racismes. Et toute jeune, je me suis dit que c’était un pays qu’il fallait fuir — ce que j’ai fait. Je n’ai pensé qu’à ça, et dès que j’ai eu dix-huit ans, j’ai fui, parce que je n’avais pas d’espoir. Ça, c’est très important.
L’espérance, au fond, c’est un état. Par la suite, je me suis demandé dans ma vie : ai-je espéré ? Et si oui, quoi ? A alors émergé une question très importante : celle de l’attente. Car en français et, plus généralement, dans les langues romanes, nous fonctionnons avec le mot esperanza qui renvoie à l’idée d’attente — idée beaucoup moins présente dans Hoffnung où il n’y a pas d’attente, où l’on est déjà dans un autre monde.
Dans les langues romanes, nous fonctionnons avec le mot esperanza qui renvoie à l’idée d’attente — idée beaucoup moins présente dans Hoffnung où il n’y a pas d’attente, où l’on est déjà dans un autre monde.
Hélène Cixous
Pourtant, en allemand, Hofnung et Zuversicht renvoient à deux idées distinctes…
Zuversicht, c’est autre chose : c’est ce qui va, c’est le moteur de l’espoir. On ne peut imaginer d’espoir vivant sans Zuversicht. Il faut qu’il y ait un acte de foi, c’est-à-dire qu’il faut croire, et qu’il faut qu’il y ait de la confiance. Rétrospectivement, je suis arrivé à la conclusion que quand j’étais enfant, je ne croyais pas. Je ne croyais pas que l’Algérie puisse un jour avoir la chance d’atteindre une forme d’idéal, qui aurait reposé sur la liberté de penser, le désir de progresser, voire même l’écologie, ce genre de choses. Quand je regarde mon existence, qui est très ancienne, je me dis que je ne crois pas avoir véritablement exercé beaucoup d’espoir — de l’urgence peut-être, à la limite.
D’un autre côté, je ne peux pas nier le fait de connaître l’espoir, d’abord puisque c’est une idée qui infuse la langue courante. On l’invoque constamment, par exemple lorsqu’on dit « j’espère bien ». Au fond, cela signifie que les humains n’existent pas sans cette dimension temporelle ; un avenir doit impérativement se dessiner. Mais dans ce cas-là, est-ce de l’espoir ou une simple rationalité ? J’ai la ferme conviction que l’humanité va poursuivre sa route. Bien que le risque qu’elle s’auto-détruise totalement soit réel, je ne crois pas que cela arrivera — ce qui ne doit pas nous empêcher de faire mieux. Mais il y a bel et bien des menaces, et je les prends très au sérieux ; je reviens longuement là-dessus dans Incendire.
Il y a des moments où on peut légitimement se dire, par exemple en Algérie, qu’on ne peut pas faire mieux, qu’il n’y a rien à faire. Quand je vois la situation entre l’Ukraine et la Russie, je me dis que pour le moment et pour longtemps — peut-être un siècle, peut-être deux — on ne peut pas espérer mieux. Tout ça, ce sont des raffinements, des nuances que l’on place et entasse dans l’image globale de l’espérance. En tant qu’individu, en tant que singularité absolue, il y a des moments où on peut s’autoriser à espérer ; mais ce n’est pas du tout mon genre.
Il y a des moments où on peut s’autoriser à espérer ; mais ce n’est pas du tout mon genre.
Hélène Cixous
Avant de parler d’Incendire plus en détail, pourriez-vous parler du feu, puisque ce livre s’ouvre là-dessus. Vous me disiez que la littérature commençait avec la guerre et que la guerre commençait avec le feu. Je me rappelle d’ailleurs de ma dernière conversation avec Agnès Varda où je lui avais posé une question sur ses projets qui n’avaient pas aboutis. Elle m’a répondu qu’elle aurait aimé monter une installation qui se serait appelée « Feu Madame Cinéma ». Elle disait qu’au fond, le cinéma aussi commence par le feu. Qu’en pensez-vous ?
C’est une évidence, je n’invente rien quand j’affirme que littérature, feu et guerre sont parties prenantes. J’observe et je me dis que tout commence avec l’incendie. C’est lui qui inaugure l’histoire de mon livre. Je suis convaincu que l’histoire, l’historicisation, l’historicité de notre mémoire et de nos vies commencent avec le feu, c’est-à-dire avec quelque chose qui détruit et qu’on appréhende comme une force radicale qui annihile. Sauf qu’après le feu, il y a parfois quelque chose.
Venons-en à la littérature. En Occident — je ne peux pas rendre compte de ce qui se passe littérairement ailleurs —, la littérature constitue notre héritage. Alors prenons le feu, celui qui nous guide dans notre esprit mythologique. Troie tombe et est détruite par le feu. Il y a des textes tellement beaux qui racontent cet épisode, et ils ne sont pas dans l’œuvre d’Homère mais dans celle de Virgile, qui nous donne à penser la morale publique dans sa totalité et représente dans ses vers l’allégorie, la métaphore et la prophétie de toutes les pestes. Pour moi, le nazisme constitue son incarnation la plus totale.
Troie brûle. La plupart des gens ont péri comme les Juifs avec les nazis. C’est un peuple détruit par une force maléfique. Ceux qui survivent — ils sont très peu — assistent à la dévoration par le feu de leur ville, c’est-à-dire leur pays, leurs racines et leur sol. Et puis le personnage qui va incarner l’espoir dort : c’est Énée. Il dort à poings fermés et, comme le dit Virgile avec une expression absolument admirable : « Jam proximus ardet Ucalegon » (« déjà, tout proche, la demeure d’Ucalégon s’embrase »). La demeure de son voisin brûle déjà. Et Énée dort.
Ce motif de l’homme qui dort alors que l’incendie ravage son monde s’est transmis et continue de structurer notre époque, en étant par exemple mobilisé par les chefs d’État au XXe siècle : « vous dormez ? ça brûle ! mais vous ne voyez pas que ça brûle ? ». Freud l’a quant à lui identifié dans des rêves archétypiques où le rêveur rêve que « tu ne vois pas que ça brûle ? Tu ne vois pas que… », « non, je dors ! ». C’est un thème qui illustre la nécessité d’être éveillé, de voir la catastrophe, de la voir revenir. Quant au réveil, au réveil dans les flammes, il s’agit de la grande question des Juifs en Allemagne : « Toi-même, tu te livres au feu, réveille-toi ! Mais si tu es réveillé, qu’est-ce que tu vas faire ? » La même question revient à chaque fois — je l’ai vécue personnellement dans ma maison du Sud-Ouest.
Le motif de l’homme qui dort alors que l’incendie ravage son monde s’est transmis et continue de structurer notre époque.
Hélène Cixous
C’est cette expérience cauchemardesque qui ouvre Incendire.
Ce cauchemar était bien réel et a eu lieu dans ma région du Sud-Ouest qui a été ravagée par le feu. On pourrait tenir le même discours sur le Canada qui a été en proie aux flammes l’été dernier et de tous les endroits dans l’univers qui ont flambé, qui sont d’ailleurs de plus en plus nombreux — je pense à la Californie qui en est constamment victime.
Ça s’est passé autour de ma maison, dans cette région qui est habituellement paisible. Le Sud-Ouest n’est pas central — il est par exemple épargné par la politique. Il dispose d’une forêt, la forêt des Landes. Ma maison est à cent mètres de la forêt, je vis avec elle depuis maintenant soixante ans. Tout d’un coup, quelque chose que j’ai toujours aperçu comme une sorte de fantôme lointain, m’en estimant préservée s’est brusquement imposé. Le feu était là.
Il dévore la forêt de la manière la plus spectaculaire, la plus terrifiante possible. Il approche. Ce n’est qu’à ce moment-là que j’ai véritablement fait l’expérience de l’incendie. J’y avais déjà été confrontée à plusieurs reprises par le passé. Mais celui des Landes était différent : il a commencé à tout détruire. Je me suis interrogé en me demandant comment nommer cette chose. Le mot qui m’est venu à l’esprit, qui m’a accueilli, c’était « biblique ». Je n’avais jamais vu une chose pareille, aussi destructrice, aussi meurtrière.
Le feu a détruit et a dévoré. Mais comment celui qui voit approcher le feu réagit-il ? C’est la question des Juifs qui m’occupent très souvent et que ma famille a vécu très directement. Le nazisme est déjà là en 1929. En 1933, il est au pouvoir, ma mère est alors partie depuis trois ans. Pourquoi vivre dans un pays en proie aux flammes ? C’est une jeune femme qui va donc voir s’il existe sur terre des pays qui sont moins menaçants et effrayants que l’Allemagne qui commence déjà à souffrir de la peste.
Le feu a détruit et a dévoré. Mais comment celui qui voit approcher le feu réagit-il ?
Hélène Cixous
Les dates sont instructives car l’histoire nous apprend beaucoup de choses, par exemple qu’en 1929, on peut déjà être réveillé à l’image de ma mère qui n’avait que 19 ans mais qui était suffisamment alerte pour savoir qu’il fallait partir — sans savoir qu’elle ne reviendrait jamais. Elle est de fait revenue très souvent, en particulier à Osnabrück, pour chercher ma grand-mère qui y vivait avec une grande partie de sa famille. Elle lui disait, « viens, sors, suis-moi, on va ailleurs ! ». Et celle-ci lui répondait « Non ». Ce « non » m’a beaucoup occupée lorsque j’étais petite. Je me demandais constamment pourquoi ma grand-mère n’était pas partie, tout comme le reste de ma famille, mes oncles et mes tantes, mes cousins et mes cousines.
Certains sont partis, la moitié peut-être, tous à une date différente, en 1932, 1933, 1934, 1935… À chaque fois, ce sont d’autres personnes, quelque chose d’autre s’est réveillé, ou ne s’est pas réveillé. Et voilà. Lorsque j’examine cela, je me dis que je reviens à ce qui m’arrivait du temps de l’incendie, au moment où je découvrais ce que c’était un grand incendie, un incendie meurtrier, destructeur et radical.
Quels étaient les premiers signes de l’incendie ? C’était l’odeur ?
J’ai justement été surprise, je pensais qu’un incendie se percevait d’abord par la vue, comme dans l’Énéide et dans l’Iliade, mais en réalité, la première expérience physique qui s’est abattue sur nous — si on ne l’a jamais ressenti, on ne peut l’imaginer — c’est d’abord l’odeur. Et l’odeur s’apparente à des sons de trompette, à une attaque, une sorte de rafale de mitraillette, comme un bombardement. On sent des choses qu’on n’a jamais senties dans la vie et qui ne sont pas stables, on demande alors aux gens s’ils ont sentis la même chose, tout le monde s’interroge sur l’odeur et seulement après, dans un second temps, la fumée apparaît.
On pense souvent qu’elle prend la forme de colonnes verticales qui montent, mais cette représentation n’est pas exacte. Je me suis rendu au bord de la mer pour l’observer et elle m’a davantage fait penser à une sorte de train monstrueux, horizontal et homogène. La fumée de l’incendie s’apparente à une colonne de blindés au ras de la terre qui envahit tout l’horizon, et est tous les jours d’une autre couleur. Contempler ce spectacle suscite un questionnement profond. J’ai demandé au feu et à l’odeur quand tout cela cessera.
On entendait aussi un bruit terrible dans la maison. Je ne peux même pas le décrire, c’est absolument indescriptible de violence et d’archaïsme. Ce fracas était causé par les avions bombardiers, volant vingt mètres au-dessus du sol.
Lorsque les pompiers et la police sont venus réveiller les habitants de Cazaux en pleine nuit et leur ont donné un quart d’heure pour partir, j’ai ressenti que j’avais accompli une forme de cycle. La petite localité allait brûler. On n’a pas donné aux gens qui habitaient ici la liberté de rester isolés. Seulement, à trois heures du matin, ils n’ont pas pu réunir leurs animaux. Il y avait de tout : des chats, des chiens, des poules… Cent cinquante animaux domestiques ont brûlé vif. J’ai eu la conviction que la vie n’était plus ici mais là-bas, loin.
L’odeur du feu s’apparente à des sons de trompette, à une attaque, une sorte de rafale de mitraillette, comme un bombardement.
Hélène Cixous
Par hasard, j’avais la chance d’être accompagnée par une amie qui avait une voiture très performante. Je l’ai réveillée le matin pour lui dire qu’on embarquait les chats et qu’on s’en allait immédiatement. En face de nous, il y avait Arcachon et l’océan : on ne pouvait pas aller plus avant. Nous nous sommes donc lancés sur une route qui pénétrait dans les terres pour fuir et avons emprunté des tunnels complètement enfumés sur des kilomètres, sans lumière. Sur le côté de l’autoroute se trouvaient des centaines de camions immobilisés à qui on avait donné l’ordre de s’arrêter. Ils ne pouvaient pas rebrousser chemin. C’était une vision de fin du monde. La route derrière nous était coupée : on ne pouvait plus sortir ni revenir, ce qui m’a profondément marqué et m’a rendu physiquement malade. Au fur et à mesure que j’examinais la situation et rentrais dans une forme d’introspection en me demandant ce qu’il m’arrivait, je me suis rendu compte que j’étais confrontée à une sorte de terreur pure mais concrétisée, qui correspondait exactement au contenu du mot « traumatisme », qui a toujours été un mot abstrait pour moi, mais qui là, touchait, hantait et animait tous mes membres et tout mon corps.
Plus tard, quand je suis revenue — j’étais partie sans rien, en laissant la maison telle quelle — je me suis dit que tout était perdu. J’avais des amis résiniers, qui sont nés et vivent dans la forêt — ce sont en quelque sorte des indigènes de la forêt. Leurs vies sont complètement parties en fumée sous leurs yeux : leur univers a disparu d’un seul coup. Je les entendais pleurer et je ne m’en suis jamais remise. J’étais angoissé pour l’éternité, convaincue que ça allait recommencer, que ça ne pouvait pas ne pas recommencer. Il y avait déjà des signes avant-coureur. Quand, après des semaines et des semaines, les feux ont fini par se stabiliser, les pompiers — dont on apprend progressivement le vocabulaire — ont affirmé que l’incendie était maîtrisé, ce qui ne veut pas du tout dire que le feu est éteint mais simplement encerclé. L’incendie s’est éteint bien plus tard, ce qui constitue du reste une illusion, car le sol et la terre en dessous continuent de brûler.
Et là, plongée dans l’histoire des êtres humains, je me suis aperçue que l’humanité s’auto-détruisait sans cesse. Il était évident que le désastre allait recommencer. Par exemple, à peine trois mois après la fin de ces incendies géants, des gens recommençaient à fumer dans la forêt, le long des sentiers forestiers parcourus par ces espèces de crayons géants que forment le tronc des pins calcinés.
Plongée dans l’histoire des êtres humains, je me suis aperçue que l’humanité s’auto-détruisait sans cesse. Il était évident que le désastre allait recommencer.
Hélène Cixous
Quelque temps auparavant, un autre feu brûlait à Paris, celui de Notre-Dame. En parallèle, d’énormes feux ont ravagé l’Amazonie. Ce qui m’a frappé, c’est que le feu de Notre Dame a bien plus retenu l’attention que les feux amazoniens. Le différentiel dans l’attention portée à ces deux feux était très important.
C’est une question de médiatisation et d’idéologie. La perception de l’incendie de Notre-Dame était structurée par l’histoire de l’Église et de la géopolitique française, tandis que celle de la forêt est relative à une forme d’humanité primitive éternelle. Qu’on ne s’intéresse pas aux habitants de Cazaux, aux poulets ou aux chats qui ont brûlé n’est pas très étonnant. En revanche, l’argent a afflué dans le cas de Notre-Dame. Il n’était pas donné par des millionnaires, mais par des catholiques ordinaires. C’est une toute autre histoire, un tout autre rapport au feu.
Mais moi, ce qui m’accompagne sans cesse, c’est l’histoire d’un peuple qui va inévitablement être réduit en cendres. Le sort des juifs livrés au nazisme — ceux qui ont fui, ceux qui n’ont pas fui — c’est une histoire, une tragédie, des millions de tragédies tout à fait singulières.
Une autre chose qui m’a toujours accompagnée depuis que je suis toute petite — je suis une littéraire et j’ai la chance d’être angliciste — c’est le merveilleux Journal de l’Année de la Peste, de Daniel Defoe. C’est un chef d’œuvre inimaginable, il est même incroyable qu’un tel ouvrage existe. Ce faux journal qui est en réalité un roman constitue la matrice de toute la littérature anglaise, et de la nôtre également. Defoe se met dans la peau d’un archiviste et décrit la grande peste de Londres et d’autres épisodes de peste qui ont secoué l’histoire européenne. Il faut garder à l’esprit que ces épidémies pouvaient détruire une population en quelques mois, des millions de gens étaient anéantis. Chaque paroisse envoie chaque jour le bilan de ses morts : certaines en ont trois ou quatre, d’autres déjà cinquante et le lendemain, le bilan atteint la centaine. Le nombre de morts est exponentiel et se pose encore et toujours la question du départ et de la fuite. La seule différence est que lorsque je me trouvais à Arcachon et que le feu gagnait, l’unité de décompte n’était pas le nombre de morts mais le nombre d’hectares partis en fumée. Mais à l’image de la peste de Defoe, je voyais la mort avancer tous les jours.
C’est la même chose dans la Bible, où l’histoire de l’exode trouve un fort écho chez moi : les Juifs ne veulent plus être esclaves, ils décident de partir, mais ils ne partent pas. Les pourparlers entre Moïse et Dieu sont incessants. Dieu lui dit qu’il va envoyer tel fléau et que Pharaon cédera. Sauf qu’économiquement et politiquement, un temps incroyable est nécessaire avant de pouvoir passer à l’acte. Mais qu’attendent-ils ? On pourrait commenter à l’infini. Pour moi, cet épisode de la Bible est riche d’enseignement et résonne avec notre époque. Nous tous, maintenant, qu’attendons-nous ? Nous savons pertinemment que l’incendie est là et que les gouvernements agissent comme Pharaon, comme le peuple juif qui attend et diffère son départ : « Non, mais ce sera plus tard ! Mais plus tard, c’est déjà maintenant ! ».
Nous tous, maintenant, qu’attendons-nous ?
Hélène Cixous
En parlant d’Incendire, vous avez pu dire que ce livre « contenait tout ».
Pendant le confinement, le temps s’est arrêté. Dès lors, comment et pourquoi écrire ? Après tout, on écrit toujours pour l’avenir. On n’écrit pas pour maintenant. S’il n’y a plus de futur, que faire ? Que devient l’écriture ? Le sentiment qui m’habite, c’est que quand j’écris en 2023, j’écris en et pour 2033, mais également en 1033. On écrit pour tous les siècles passés, mais aussi pour ceux qui vont venir. On est déjà dans un là-bas qu’on ne connaît pas.
Pendant le confinement, je me suis dit qu’il y avait peu de temps. Or quand il n’y a plus de temps, on ne fait plus rien. On est dans un autre univers et l’une des premières choses que j’ai remarqué, c’est que je ne pouvais rien dire. Les gens autour de moi m’incitaient à écrire et à dire quelque chose. Et quand mon pays a brûlé, je me suis dit que quelque chose touchait le vital, c’est-à-dire l’écriture. Il me faut faire un effort absolument colossal pour me dire qu’il y a à vivre. Même si ce qu’on vit, c’est la mort.
Je reviens à pourquoi Incendire « contient tout ». Peut être tout d’abord parce que l’âge joue. Je n’ai plus beaucoup de temps devant moi : c’est quelque chose qui m’accompagne comme une sorte de fantôme quotidien. C’est objectif et c’est une question qu’il faut toujours se poser. Combien de temps a-t-on devant soi ? Quand on écrit, on a en général dix, vingt, trente, quarante ans devant soi. Mais moi, j’ai cinq ans maximum. Dès lors, que fait-on quand la vie dure cinq ans ? Ce sont des questions importantes, énormes.
Quand j’écris en 2023, j’écris en et pour 2033, mais également en 1033.
Hélène Cixous
Avec ce livre, je devais d’abord réussir à nommer quelque chose qui m’arrivait, que je n’avais jamais vécu mais qui dans le même temps avait eu lieu je ne sais combien de fois dans l’histoire de l’humanité sans que j’y assiste directement. Cette fois-là, cela m’arrivait. Tout d’un coup, voilà la destruction, la faim, l’incendie et la mort. Tout ce qu’on éprouve, c’est quelque chose qu’on n’a jamais éprouvé, qu’on n’éprouvera jamais. Cela a battu le rappel d’expérience de mon archive à moi, de mes mémoires qui m’ont toujours accompagné, comme ce qui me détermine dans ma vision du monde, donc l’expérience du nazisme et de la destruction du peuple juif et l’expérience du colonialisme, ce qui se passait en Algérie, et comment on a réduit les peuples en esclavage.
Tout cela est constamment avec moi. Cela me constitue. Observant ma vie comme si elle était une pièce jouée au théâtre de mon existence, j’ai trouvé que les mots venaient naturellement, m’aidant à comprendre. Chaque fois que je trouvais le mot juste, une révélation se produisait : tout se déroulait « exactement comme la peste ». Ces réflexions m’ont amené à contempler mes origines et mes racines, empreintes d’un héritage de destruction et de survie.
Quant à mes recherches généalogiques, elles sont principalement axées sur ma lignée allemande, en partie parce qu’elle est plus facilement accessible. Néanmoins, il existe une autre branche familiale, distincte et éloignée, mais tout aussi essentielle pour comprendre qui je suis. Est-il approprié de la qualifier d’algérienne ? Pas tout à fait. Le parcours commence en réalité en Espagne avec les Juifs d’Espagne, et par un hasard providentiel, je détiens des archives anciennes de cette partie de ma famille. Ces archives, qui sont de véritables joyaux historiques, révèlent qu’un de mes ancêtres est né à Gibraltar en 1820. Ce personnage, bien qu’anglais de naissance, a rejoint l’armée française en tant qu’interprète à l’âge de quinze ans, une singularité en soi. Cette période coïncide avec le début de la conquête de l’Algérie en 1830, un tournant qui s’inscrit dans une histoire s’étendant sur deux ou trois siècles.
Tout d’un coup, voilà la destruction, la faim, l’incendie et la mort.
Hélène Cixous
Tout commence là.
Et après, je me suis souvent interrogée : « Qu’est-ce qu’un interprète de quinze ans, britannique, qui se retrouve à travailler pour l’armée française ? En 1835 ? » Cette réflexion m’emmenait à 1835, une époque où je vivais, pour ainsi dire, en France. À cette époque, j’avais un témoin exceptionnel, Victor Hugo, qui documentait ces années dans les moindres détails. Je savais donc précisément ce qui se passait en France en 1835. Je pensais à ce petit Jonas, débarqué en Algérie avec l’armée française, une armée de conquête. Qu’est-ce qu’il savait, lui, à quinze ans ? Je ne sais même pas quelle langue il parlait. Il était affilié au bureau arabe de l’armée française, probablement un organisme de communication et d’échange. Ce jeune homme, à seulement quinze ans, devait maîtriser plusieurs langues, se débrouiller. Savait-il qui était le roi de France à cette époque ? Je ne pouvais le deviner, et je pense que lui-même s’en moquait éperdument. Nous ne pouvons qu’émettre des hypothèses, mais j’ai en ma possession tous les documents très précis de cette période.
Tandis qu’en France se déroulait le long chemin vers la République, l’Algérie et l’Afrique du Nord étaient en pleine transformation. Ce processus marque le continent africain jusqu’à aujourd’hui.
Durant ce temps, je pouvais aussi me tourner vers l’Allemagne, suivant l’impact de la Révolution française et de Napoléon dans l’imaginaire germanophone. C’est incroyable de voir Napoléon observé par Hegel, suivi par le fantasme allemand à travers la littérature, la musique. Beethoven, par exemple, est omniprésent. Tout cela se déroulait alors que mon petit personnage, lui, naviguait entre les langues et les continents. C’est mon histoire. Et pendant ce temps, je me demandais quelles archives j’avais à ma disposition.
D’un côté, il y avait l’Afrique, européanisée, et de l’autre, les archives allemandes. Je me concentrais sur ce que je connaissais — les archives de ma famille, un mélange entre l’Autriche et l’Allemagne, dominées par cette dernière. Et je me demandais qui avait laissé des traces. Il y en avait une qui était extraordinaire. Il s’agissait d’un autre Jonas : Horst Jonas. C’est un cousin de ma mère, le seul de la famille à avoir survécu à trois, quatre camps de concentration successifs, et à en être sorti vivant. La question juive s’imposait alors.
Je me suis demandé quelles archives étaient à ma disposition.
Hélène Cixous
C’est un résistant né en 1914, mort assez jeune en 1967. Il a aussi été membre du parti communiste allemand.
Tout à fait, c’était un communiste. Je me demandais pourquoi on ne parlait pas tellement de Horst Jonas dans la famille ? Qu’avait-il fait ? Et bien il n’avait pas été déporté en tant que juif, mais comme résistant. C’est une autre histoire. De plus, il adhérait complètement à l’idéologie communiste. Il était en RDA. Je me rappelle toujours du regard un peu gêné de ma mère qui me disait : « Oui, mais Horst, c’est Horst ».
Toutes ces lignes qui plongent dans le passé posent immanquablement la question du futur. Comment l’avez-vous envisagé ?
Ce livre est une sorte de recueil complet — une démarche peu courante — qui rassemble deux ou trois siècles sous un tout petit volume. C’est donc très théâtral et cela conserve tous ces mystères. Peut-être que, dans le futur, il y aura des réponses, je n’en sais rien, un certain mystère demeure.
Surtout du côté, justement, des archives d’Afrique du Nord, qui sont bien plus courtes que celles d’Allemagne. Pour moi, c’est tout à fait passionnant. Mais je me dis aussi qu’il a fallu du temps. En effet, être l’archiviste de ces familles innombrables, c’est un rôle pour lequel je semble être née. Et je me demande pourquoi. Parce que c’est comme si j’étais perchée, là, en haut d’un arbre, observant ces mouvements de l’humanité. C’est un peu comme un cadeau que m’a offert le temps qui passe. Quand je suis arrivée à Osnabrück, j’étais déjà riche de connaissances : le traité de Westphalie, la fondation de la ville par Charlemagne 1500 ans plus tôt — toutes ces traces historiques qui sont là, immenses et vivantes. Ce que je ne savais pas, c’était la proximité avec Osnabrück de la forêt de Teutoburger Wald, à seulement dix kilomètres, où s’est déroulée la bataille d’Arminius en 9 ap. J-C, la Hermannsschlacht. Cet événement, fondateur pour l’Allemagne, a longtemps été recherché dans les régions de Hanovre et de Westphalie. On savait qu’il devait se trouver là, mais il est resté introuvable jusqu’à il y a deux ou trois ans.
À Osnabrück, ils ont immédiatement érigé deux musées extraordinaires. Le musée Nussbaum, qui raconte un autre univers, et le musée de la Hermannsschlacht, construit récemment, très beau d’ailleurs, où ils accumulent progressivement tout ce qu’ils ont trouvé sur le champ de bataille. Et ils en trouvent sans cesse. Ce sont des signes, des mondes qui émettent constamment des signes, des signes qui semblent raconter le passé, mais en même temps désignent précisément ce qui nous attend, comme la fin du monde, par exemple !
Lors d’une précédente conversation, vous m’aviez dit que les gens étaient fascinés par l’Apocalypse. Pour vous, face à l’abysse, la recette serait de lire ?
C’est de lire et donc d’écrire. En tant qu’écrivain de notre époque, une époque révolutionnaire marquée par un changement complet des médiums, je me dis souvent que j’écris les dernières lettres au monde. J’écris encore des lettres, mais de moins en moins. Il y a des problèmes avec la Poste, des soucis de timbres. Toutes ces petites choses que j’observe me fascinent. Souvent, j’entends mes éditeurs dire que c’est fini, que les gens ne liront plus. Mais moi, je persiste à dire non. La littérature ne s’est jamais éteinte, tout comme la musique, même interdite, car c’est essentiel, c’est l’air que nous respirons. Les hommes en ont besoin, même s’ils essaient de le minimiser. Même aujourd’hui, alors qu’on nous menace avec l’IA, l’intelligence artificielle, je garde confiance. Je me dis que c’est structurel. On ne peut pas dire à un homme qu’il va vivre sans cœur, sans poumons.
Je me dis souvent que j’écris les dernières lettres au monde. J’écris encore des lettres, mais de moins en moins. Il y a des problèmes avec la Poste, des soucis de timbres.
Hélène Cixous
D’où vient le titre, Incendire ?
Incendire, c’est parce que cet incendie parle. Et comment exprimer l’incendie ? Comment décrire cette force qui nous dépasse totalement ? C’est un défi, et il faut le relever. La question qui se pose est : qu’emportons nous ? C’est ce que je me demandais lors de mes premiers incendies. Mon tout premier incendie, c’était ici, là où nous sommes. L’immeuble a pris feu en pleine nuit, les flammes se propageant rapidement. Les pompiers sont intervenus, montant jusqu’au septième étage, mais pas plus haut. Or je vis au dixième. Chez moi, j’avais des trésors : mes chats, mes manuscrits, de nombreux écrits précieux. Alors, je me suis interrogée : « Si les pompiers atteignent mon étage, que dois-je sauver en priorité ? » La pensée qui s’est imposée à moi était que, même si mes manuscrits, destinés à la Bibliothèque nationale, disparaissaient, je ne pourrais pas supporter la perte de mes chats. Mais comment choisir ? J’en ai deux. À chaque fois, cette question biblique ressurgit : qui sauver, qui sera sauvé ? On ne peut en choisir qu’un, et je n’ai jamais trouvé de réponse à cette question. Heureusement, l’incendie a été maîtrisé, mais cette interrogation m’a hantée. C’était pareil là bas, j’ai revécu cette question cruciale de l’incendie à une échelle titanesque : qui vas-tu sauver ?
On revient aux animaux de compagnie. Vous avez inventé le néologisme « animot ». D’où vous est-il venu ?
J’étais en train d’écrire un texte intitulé « Écrire aveugle ». Justement, je tentais d’explorer ce qu’est l’acte d’écrire. En français, quand on dit « écrire aveugle », cela peut se comprendre de deux manières : soit écrire en étant aveugle, soit écrire rend aveugle. Cette ambivalence, tu ne peux pas la trancher, c’est indécidable. En anglais, ça devient « writing blind », mais cela perd une partie du sens, et c’est là que réside la complexité de l’interprétation. J’essayais de décrire, de capturer ce geste étrange qu’est l’écriture, où on devient un aveugle qui voit, avançant à tâtons, presque comme un animal. Ce n’est pas une question de maîtrise, de rationalisation, ou de construction délibérée. C’est plutôt ce qui vient naturellement. Et cela m’arrive constamment, dans tous mes textes. Ils regorgent de néologismes.
Ce serait une jolie idée de faire un livre de tous les néologismes.
Bien sûr, il y en a qui essaient, des chercheurs par exemple, et cela demande un travail colossal. Pour moi, si le mot n’est pas là, il finit par venir. Je ne vais pas me contraindre simplement parce qu’un mot n’existe pas encore. J’ai rapidement adopté l’usage de plusieurs langues. Ce n’est pas seulement parler plusieurs langues en français, mais un dialogue entre les langues. Souvent, je puise dans l’anglais, l’allemand, ou d’autres langues, parce que parfois le mot que je cherche n’existe pas dans une langue mais dans une autre. Et cela fonctionne ainsi. Au début, il y avait des lecteurs qui disaient : « Mais on ne comprend pas. Ça veut dire quoi ? » Puis, je me suis demandé pourquoi je devrais me limiter, ou limiter mon livre, à un lecteur qui ne veut pas s’aventurer au-delà de sa propre langue, qui est limitée, alors que nous sommes européens — mondiaux, même. On peut jouer avec à l’infini, avec les langues. Les mots ont leur propre vie : ils apportent toutes sortes de choses, comme des chats, des chiens. Ils sont vivants, ces mots. Ils se cachent et réapparaissent, travaillant sans cesse.
À chaque fois, cette question biblique ressurgit : qui sauver, qui sera sauvé ?
Hélène Cixous
Dans un texte paru en 2019, « Max und Moritz, et Ma Mère », vous revenez sur les origines de la notion d’écriture féminine.
Il s’agit d’expériences primitives, que j’ai couchées sur le papier. Je raconte ma rencontre avec Max und Moritz, qui sont des compagnons de toujours. C’est par eux que j’ai découvert Wilhelm Busch, un écrivain génial qui manque en France.
Personne ne devrait ignorer Max und Moritz — même Freud en parle. Je les ai vraiment rencontrés à l’âge de sept ans, bien que je devais déjà les connaître. Mais c’est ma mère qui nous a présenté Max und Moritz, à mon frère et à moi. Nous avions ces personnages et elle a commencé à nous les lire, puis à nous les traduire. Et quelle traduction ! Je n’ai jamais vu une traduction aussi remarquable, faite spécialement pour nous, pendant que nous jouions. Ces histoires étaient des airs de mirlitons. Je peux écrire à la manière de Max und Moritz, et d’ailleurs, j’utilise beaucoup leur style dans ce texte. C’est une langue très « Max und Moritz ». J’ai vécu avec Max et Moritz : tous ces personnages sont réels, ils sont vivants…
C’était pendant la guerre que ma mère nous les lisait — ce motif de la mère qui lit à son enfant est présent dans toute la littérature. On se rend compte que c’est un thème récurrent, à commencer par la mère du narrateur dans À la recherche du temps perdu. Sans oublier Rousseau, initié à la littérature par sa mère, qui, à sa mort, lui a légué sa bibliothèque. On constate un lien profond entre la littérature et le maternel.
Lorsque l’on vous interroge sur l’écriture qui vous accompagne depuis toujours, vous répondez Montaigne.
Montaigne est une présence constante dans ma vie, je ne fais rien sans lui : il est comme une sorte de grand-oncle. Il occupe une place très spéciale, incarnant ce que je considère comme le plus noble et le plus merveilleux en France. Du reste, je trouve extraordinaire que Shakespeare ait lu Montaigne.
Mais, ces derniers temps, je me rends compte que la figure avec laquelle j’entretiens un lien permanent, aussi durable que celui avec Montaigne, c’est Kafka. À chaque fois que je rencontre un problème, je sens la présence des deux, quand bien même ils ne relèveraient pas du tout des mêmes univers.
Montaigne est une présence constante dans ma vie, je ne fais rien sans lui.
Hélène Cixous
Et Kafka, sur quel territoire se trouve-t-il ?
Je pense que c’est la perfection même.
Montaigne est un raffiné, c’est un aristocrate et son écriture est aristocratique, elle est tellement belle, elle est tellement riche, elle est tellement… Et puis il est tellement noble, noble moralement, c’est incroyable à quel point… Il est contre la peine de mort, contre le racisme. C’est inouï, sa modernité, alors je me dis qu’on est béni avec un ancêtre comme Montaigne.
Mais avec Kafka, je ressens une compréhension totale. Je pense que le judaïsme de Kafka, qui n’était pas valorisé initialement, a été grandement minimisé dans les premières éditions de ses œuvres ici. On n’en a peut-être pas toujours conscience, mais Kafka a été présenté et traduit avec une réduction incroyable de tout ce qui était essentiel à son identité. Ce n’est que récemment, avec l’apparition de nouvelles traductions et la nouvelle édition de Kafka en Allemagne, que quelque chose d’immense a émergé : la présence constante et complexe de son héritage juif. Je pense que l’aventure de Kafka se situe aussi, ou a pu se situer, dans cette exploration non destinée à la publication, mais qui était la sienne, dans sa recherche au sein des mondes contradictoires où il a forgé son être.
Mais il voulait que tous ses travaux de recherche soient détruits. Il ne voulait pas que cela lui survive.
Je pense que la marginalisation de ce gigantesque fleuve souterrain que Kafka traverse et analyse, un fleuve sans limites ni interdits, a été l’œuvre de Max Brod. Et je crois qu’il l’a fait par amitié, en se disant : « Si je révèle toute la dimension juive de Kafka, il ne sera pas bien accueilli ». Cette décision de Max Brod, pensant protéger l’œuvre et l’héritage de Kafka, a en quelque sorte occulté une part essentielle de son identité et de son écriture.
Un des éléments que j’affectionne particulièrement chez Kafka, et qui le distingue de Montaigne — car, dans sa prodigieuse richesse, Montaigne demeure ancré dans la raison — c’est cette présence constante de la fable. Pour Kafka, la fable n’est pas une simple narration ; elle est une expérience vécue. Prenons l’exemple du texte sur l’Unmacht — un terme allemand que je trouve fascinant. En français, cela équivaut à une syncope, qui évoque « une défaillance, un évanouissement ». Quand Kafka évoque la visite de l’Unmacht, il le vit authentiquement. De la même manière, je perçois des événements qui ne se manifestent pour moi qu’à travers des figures, des allégories.
Pour Kafka, la fable n’est pas une simple narration ; elle est une expérience vécue.
Hélène Cixous
Considérons cela : est-ce une impuissance, une paralysie ? Ces concepts prennent une dimension fabuleuse chez Kafka. Son écriture est constamment imprégnée de ce caractère. Dans un de ses textes, il décrit la visite de Madame Unmacht. Pour Kafka, c’est un concept colossal car l’Unmacht lui rend visite jour et nuit. Elle apparaît, haletante et plaintive : « Que c’est haut chez vous ! J’ai mal partout, mais ça suffit. Oh là là ! » Elle se présente avec sa longue robe et son chapeau orné de longues plumes. S’effondrant sur un fauteuil, elle est désagréable et se plaint continuellement. Elle demande à Kafka : « C’est haut chez vous, n’est-ce pas ? ». Il engage avec elle une longue conversation, une connaissance de longue date qu’il n’avait pas revue depuis longtemps. Je l’appelle « Madame » car elle se présente ainsi. À la lecture, on s’imagine : « Ah oui, c’est une dame, une vieille un peu excentrique ».
Cela renvoie aussi à l’époque de Montaigne, dont l’objectif était de philosopher. Montaigne se positionne en transformateur, capable d’interroger, de décrire, de recueillir toutes les anecdotes et incidents de ses voyages. Il observe minutieusement les détails de la vie quotidienne et les soumet à une analyse profonde. Il les pèse, dans le sens où l’on pèse un jugement. C’est un sage qui cherche à démêler les contradictions et les périls de la nature humaine. Kafka, en revanche, est un artiste, alors que Montaigne ne se voit pas comme un artiste, mais plutôt comme un philosophe.
Avez-vous déjà entendu parler d’Alice Hertz ? C’était une femme exceptionnelle, décédée à 107 ans. Je l’ai rencontrée quand elle en avait 103, dans le cadre de mon projet d’archive d’interviews de centenaires, intitulé « Le Témoin d’un Siècle ». Parmi les personnes interviewées, il y avait Annie Mayer et Hans-Georg Gadamer. Finalement, beaucoup de mes amis m’ont conseillé de rencontrer Alice Hertz.
Elle jouait du piano, non ?
Exactement, dans un camp de concentration. Alice est née dans une famille très littéraire à Prague, proche de Kafka. Elle m’a raconté que Kafka venait chez eux chaque semaine. Quand elle était petite fille, Kafka lui lisait des histoires avant qu’elle s’endorme. Plus tard, devenue une pianiste prodige, sa famille, n’ayant pu fuir, a été déportée dans un camp de concentration. Alice a survécu en partie grâce au piano, car ils avaient besoin d’elle pour jouer. Elle avait une photo de son fils, récemment décédé à 80 ans, dans son appartement. Elle m’a donné le livre écrit par son fils, qui était très émouvant. Il racontait comment elle a réussi à le protéger pendant cette période, en lui offrant une enfance inimaginable dans un tel contexte. Dans l’entretien, elle parlait de toute sa vie — elle a continué à nager jusqu’à 104 ans. C’est la seule personne que j’ai jamais rencontrée qui ait connu Kafka.
C’est en effet incroyable, il n’y a plus personne aujourd’hui qui a connu Kafka. Quand j’étais petite, j’étais fascinée par Kafka, je le percevais presque comme un membre de ma famille. J’ai toujours cru qu’il était de petite taille, mais j’ai été surprise d’apprendre plus tard qu’il était en réalité très grand, mesurant au moins 1 mètre 85.
Vous m’aviez confié que les plus belles choses ne peuvent pas être écrites. Il faudrait pouvoir écrire avec les yeux, avec les larmes. Ces projets non réalisés, c’est peut-être aussi cela. À Londres, vous aviez évoqué dans une précédente conversation un projet inabouti : créer quelque chose de plus digne pour les cimetières, en réaction à leur architecture souvent horrible. Cela me semble très actuel. Y a-t-il d’autres projets inaboutis, des nouveautés ?
Il y en a sûrement beaucoup, mais je ne les connais pas tous. Quand je vous dis qu’il me reste cinq ans, je le pense vraiment. Mais cinq ans, cela peut être très peu ou beaucoup. Je le dis en me résignant au sort, au destin humain. C’est une question d’âge. Et puis, autour de moi, mes amis approchant ou ayant 90 ans, je constate qu’aucun créateur n’est plus créatif à partir d’un certain âge. Je calcule, en me disant « attention », et je me rappelle ma mère qui aimait tant les dictons : « Qui veut voyager loin, ménage sa monture ».
J’ai été surprise d’apprendre que Kafka mesurait 1 mètre 85.
Hélène Cixous
Je ne sais pas exactement quels sont ces projets, car il y en a constamment, et j’écris toujours quelque chose auquel je n’avais pas pensé. Il y a des projets auxquels j’ai pensé toute ma vie, et maintenant, je commence à me dire que certains ne verront jamais le jour. Ils étaient peut-être destinés à rester non réalisés.
Pourriez-vous me parler de l’un d’entre eux ?
Non.
C’est secret ?
Vous savez, à plus de 80 ans, tout devient imprévu. Avec ma mère, qui a vécu jusqu’à 103 ans, chaque jour était une surprise. Pour moi, c’est la même chose. Je suspecte que ce que je me racontais ne se réalisera jamais, et c’est peut-être mieux ainsi.
À la manière de Rilke, quel conseil, en 2024, donneriez-vous à de jeunes poètes, à des jeunes écrivains, et à des jeunes artistes ?
Cela ne m’est jamais venu à l’esprit : je ne suis pas conseillère.
Votre mère vous a dit de toujours penser au dieu du kaïros.
Oui, mais cela, c’est ma mère. Je ne peux pas imaginer avoir un rôle de conseiller, cela ne peut être universel. Ce n’est pas que je ne peux pas, mais pour moi, ce n’est pas juste. Et puis, savez-vous, avec les jeunes poètes, par exemple, il y a quelque chose que je n’aime pas et qui me fait bien rire — c’est juste un aparté — : on parle d’une époque où le mot « poète » avait un sens. Je mentionne cela parce qu’on m’a récemment demandé d’intervenir sur Cocteau. Et j’ai répondu : pourquoi Cocteau ? Je ne le connais pas bien, je ne peux pas vraiment en parler. Pour le travail, j’ai quand même regardé Orphée. Le film a des qualités, certes, mais aussi des défauts gigantesques. Et je me disais tout le temps que cela m’amusait, car pour Cocteau, il y avait une profession, une position qui était celle de « poète ». Et c’est presque comique, c’est comme dire « informaticien » ou quelque chose du genre… Mais lui y croyait, et les autres aussi. Et même quand Rilke écrit à un jeune poète, il y croit aussi. Il croit vraiment qu’on peut donner des conseils à un jeune poète. En réalité, il se donne des conseils à lui-même — et c’est très bien.
Justement, à propos de la nouvelle génération, beaucoup se penchent à nouveau sur Le Rire de la Méduse. Il y a quelques années, quatre ou cinq ans, vous avez parlé du combat contre la phallocratie et de la construction de la féminité à travers cette œuvre. Je voulais vous demander votre avis sur la relecture actuelle du Rire de la Méduse, et sur cette idée que le genre n’est pas une limite mais une liberté, un concept souvent cité en lien avec votre travail. C’est un peu un voyage pour la nouvelle génération.
Ah oui, bien sûr, mais cela me semble évident. Il y a un moment où l’on peut exprimer ces évidences. Mais pour moi, cela implique par exemple de toujours franchir les frontières. Ce qui est magnifique, c’est ce va-et-vient, cette absence de fixation, de définition stricte. C’est ce que j’appelle une « nidentité », pas des identités, mais des « ni identités » ou des ni d’entités. C’est ce que je disais à mes contemporains. Mais si l’on remonte, chez Shakespeare, par exemple, on ne trouve que cela. Partout, il y a des personnages qui glissent d’une identité à l’autre, comme dans As You Like It, c’est incroyable. Le seul conseil, c’est « As You Like It », mais c’est un conseil dangereux car il s’adresse à la vie affective. Si on le dit à des bandits, on autorise aussi le vol, l’escroquerie, l’assassinat…
Vous souscrivez à cette idée que l’identité est une prison.
Oui complètement ! L’identité, c’est l’horreur ! C’est le « ni d’entités » qui est intéressant, car cela conserve quelque chose de l’identité. Et il y a même du « nid ». Vous pouvez avoir un nid avec plein d’identités et faire tout ce que vous voulez !
La grande littérature l’a toujours fait. Elle ne s’est jamais limitée. Pensez à la Renaissance avec Ronsard : tout est rose. Il n’y a pas que Rilke, il y a déjà Ronsard avant. On peut très bien être Rose ou tout ce que l’on veut. Ensuite, on a confiné toutes ces capacités de fluidité, de transfiguration permanente dans Ovide, où l’on passe son temps à changer d’espèce.
L’identité, c’est l’horreur ! C’est le « ni d’entités » qui est intéressant, car cela conserve quelque chose de l’identité. Et il y a même du « nid ».
Hélène Cixous
C’est une très belle conclusion ce « nid d’entités ».
Le Rire de la Méduse c’était cela. Cela touche aussi au récit, au mythe que l’on fabrique tout le temps et certains sont tenaces pour l’éternité. J’ai choisi la méduse, mais il y a d’autres personnages féminins négatifs — et ce sont des constructions. Qui a écrit ? Si on essaie de trouver des autrices aux origines de l’écriture, il n’y en a pas beaucoup.
L’article « Tout commence avec le feu », une conversation avec Hélène Cixous est apparu en premier sur Le Grand Continent.
07.04.2024 à 15:44
Le génocide des Tutsi au Rwanda : une liste de lectures
Matheo Malik
Trente ans après, par où commencer pour aborder la question du génocide des Tutsi au Rwanda ? Comment articuler les faits et les archives au travail mémoriel ? Comment étudier la question de la justice et de la réparation post-génocide ? En ce jour de commémoration, nous vous proposons 33 pistes pour s’orienter.
L’article Le génocide des Tutsi au Rwanda : une liste de lectures est apparu en premier sur Le Grand Continent.
Texte intégral (11449 mots)
Ouvrages généraux et synthèses
Florent Piton, Le génocide des Tutsi du Rwanda, La Découverte, 2018
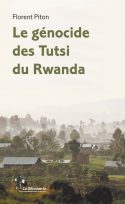
« D’avril à juillet 1994, entre 800 000 et 1 million de Tutsi sont exterminés au Rwanda. Le dernier génocide du XXe siècle ne s’inscrit pourtant pas dans une histoire séculaire d’antagonisme ethnique. Il est le produit d’un racisme importé des sciences coloniales et réapproprié par une partie des acteurs politiques rwandais et de la population. Cet ouvrage analyse l’émergence et les évolutions de ce racisme, et la manière dont il conduisit au génocide et fut mis en actes par les pratiques de violence.
Il montre ainsi que l’extermination des Tutsi, quoique n’étant pas inéluctable, ne fut ni un accident ni une réaction spontanée. En évoquant aussi bien les tueries au plus près de leurs conditions d’exécution que le rôle des acteurs de l’État et de la communauté internationale, tout particulièrement l’ONU et la France, l’auteur inscrit cet événement au cœur de notre XXe siècle et des enjeux contemporains. L’analyse des questions mémorielles et judiciaires, et de la sortie du génocide, permet enfin de comprendre que ses conséquences se font ressentir aujourd’hui encore dans tous les aspects de la vie sociale. »
Lire l’entretien avec l’auteur dans le Grand Continent
Vincent Duclert (dir.), Le Genre humain, n° 62. Le Génocide des Tutsi au Rwanda (1959-2023). Devoir de recherche et droit à la vérité, Seuil, 2023

« Les responsabilités internationales, et françaises tout particulièrement, qui ont rendu possible ce génocide « prévisible », selon les mots du rapport Muse de 2021, ont été objectivées. Les recherches récentes montrent que l’entreprise criminelle aurait pu être stoppée, même au début de la phase paroxystique engagée quelques heures après l’attentat contre l’avion présidentiel le 6 avril 1994. Cet engrenage vers l’extermination planifiée des Tutsi a été dans le même temps – on le sait avec le rapport Duclert –, combattu par des agents de l’État de la République française, par des chercheurs, journalistes, citoyens. Leurs engagements sont ici appréhendés à travers des portraits, des analyses en profondeur et des documents d’époque.
Il importe de réfléchir au sens de l’événement incommensurable qu’est le génocide des Tutsi, de rechercher les traces insondables qu’il dépose dans les sociétés, de penser l’impératif de prévention pour éviter la répétition de l’histoire tragique, de s’interroger enfin sur les raisons de la faillite collective de n’avoir pu empêcher la catastrophe. Malgré les connaissances acquises sur le génocide des Arméniens et sur la Shoah, malgré les alertes nombreuses, la France et la communauté internationale ont laissé le processus génocidaire aller jusqu’à son terme au Rwanda.
Des chercheurs français, rwandais, d’Europe et d’Afrique, se sont réunis pour composer ce volume du Genre humain. Ils se reconnaissent dans le devoir de recherche exigeant une quête déterminée, implacable, de la vérité historique. Des sources nouvelles, des sujets renouvelés, des faits démontrés livrent un important savoir, qui paraît un an avant la trentième commémoration du génocide, fragment d’une histoire commune désormais possible. »
Lire l’entretien avec l’auteur dans le Grand Continent
Stéphane Audoin-Rouzeau, Annette Becker, Samuel Kuhn et Jean-Philippe Schreiber (dir.), Le choc. Rwanda 1994 : le génocide des Tutsi, Gallimard, 2024

« Le Rwanda a sombré au printemps 1994 dans un drame historique majeur : un génocide décimant la plus grande partie de la population tutsi et dévastant le pays. C’est le choc qu’a provoqué cet événement que les auteurs et autrices du présent ouvrage, originaires du Rwanda, de Belgique, de France, entendent explorer : leur propre saisissement d’abord et la manière dont il a pu orienter leur travail d’investigation, d’écriture ou de création. Puis les racines culturelles, idéologiques, sociales et politiques de l’accomplissement du génocide.
Car ce crime de masse systématique, prémédité et planifié, est toujours le fruit d’un enchaînement complexe de causalités. Interroger le génocide des Tutsi, c’est tenter de comprendre les ressorts de notre regard sur les violences extrêmes, de notre morale, de nos lâchetés, de nos collusions. De comprendre aussi les contours de notre commune humanité. »
Lire l’entretien avec l’auteur dans le Grand Continent
Récits, témoignages, romans
Charles Habonimana, Moi, le dernier Tutsi, Plon, 2019

« Il a vu ce que des yeux ne devraient jamais voir. L’extermination des siens.
Son père et son oncle, assassinés devant lui. Sa mère, ses frères, ses sœurs, jetés vivants dans des fosses pleines d’excréments pour y mourir comme des bêtes. Ses grands-mères, ses tantes, abandonnées sans vie au hasard des fossés.
Il n’a que douze ans, mais il a vu ce que des yeux ne devraient jamais voir.
Charles Habonimana est un survivant. En avril 1994, lorsque son pays, le Rwanda, bascule dans l’horreur et la folie criminelle, il est condamné. Comme tous les autres Tutsi de Mayunzwe, son village. Comme tous les autres Tutsi du pays.
Ses bourreaux vont en décider autrement et faire de lui le symbole du génocide en marche. Il sera « le dernier Tutsi », celui que l’on tuera lorsque tous les autres, ceux du village, auront été éliminés. Placé sous ce terrible statut de mort en sursis, il voit tomber les siens, les uns après les autres. Hommes, femmes, enfants, vieillards. Peu importe.
Son témoignage revient sur ce qui fut l’une des plus terribles tragédies du siècle passé, en l’inscrivant dans l’Histoire des génocides du XXème siècle. Il se veut aussi un chant d’espérance pour l’avenir de son pays. »
Lire plus un extrait du livre sur le Grand Continent
Jean Hatzfeld, Récits des marais rwandais, Seuil, 2014

« En trois livres, Jean Hatzfeld a écrit un triptyque du génocide tutsi perpétré au Rwanda en 1994, et cet ensemble est proposé ici en un seul volume, afin de faire apparaître l’ampleur et l’articulation de cette œuvre d’écoute et d’interrogation.
Le premier tome (Dans le nu de la vie), paru en 2000, s’intéresse aux rescapés tutsis, le deuxième (Une saison de machettes, 2003) aux tueurs hutus, et le troisième (La stratégie des antilopes, 2007) raconte le vertigineux voisinage, aujourd’hui, des uns et des autres revenus sur leurs collines.
Récits des marais rwandais est issu de nombreux séjours, effectués au cours d’une dizaine d’années, dans une seule et même bourgade, Nyamata, et ses hameaux bordés de marais et de forêts, lieux des massacres. En tissant au fil des ans un lien patient, jamais rompu, avec vingt-six interlocutrices et interlocuteurs appartenant aux deux communautés, en multipliant non sans obstination ses interrogations avec eux, et en réalisant un travail d’écriture sur la langue et le souvenir à partir de ces récits, Jean Hatzfeld a constitué un univers génocidaire d’une dimension exceptionnelle, dont l’écho nous habite durablement. »
Stéphane Audoin-Rouzeau, Une initiation. Rwanda (1994-2016), Seuil, 2017

« Après trois décennies d’un parcours de recherche entièrement consacré, dès l’origine, à la violence de guerre, un « objet » imprévu a coupé ma route. On aura compris qu’il s’agit du génocide perpétré contre les Tutsi rwandais entre avril et juillet 1994, au cours duquel huit cent mille victimes au moins ont été tuées, en trois mois.
Ce qui se joue ou peut se jouer chez un chercheur, dans l’instant tout d’abord, dans l’après-coup ensuite, constitue l’axe du livre qui va suivre. Car l’objet qui a croisé ma route ne s’est pas contenté de m’arrêter pour un moment : il a subverti, rétroactivement en quelque sorte, toute la gamme de mes intérêts antérieurs. »
Jean-Pierre Chrétien, Combattre un génocide. Un historien face à l’extermination des Tutsi du Rwanda (1990-2024), Le Bord de l’eau, 2024

« Face au génocide des Tutsi (1994) et à sa préparation systématique avec la caution de la France (sans intention de s’associer à l’entreprise criminelle du régime allié contre les minorités tutsi et hutu d’opposition), Jean-Pierre Chrétien se dresse contre la catastrophe.
Il le fait par une production de connaissance, laquelle est transmise par des conférences, des articles dans la presse, des alertes dans la presse – autant d’écrits décisifs, mais épars et que ce livre décide de réunir.
La 30e commémoration du génocide des Tutsi doit relever et saluer, preuves en main, le courage d’un historien qui a été très attaqué pour son engagement alors que ses analyses étaient fondées et que son combat était juste. Ce livre est aussi une réhabilitation et une leçon pour les générations présentes et futures. »
Guillaume Ancel, Rwanda, la fin du silence. Témoignage d’un officier français, Belles Lettres, 2022

« Au lourd secret qui entoure le véritable rôle de la France et de son armée lors du génocide des Tutsi au Rwanda, Guillaume Ancel oppose la vérité de ses carnets de terrain, témoignage des missions auxquelles il a participé durant l’opération Turquoise. La fin du silence est aussi le récit du combat mené par cet ancien officier pour faire savoir ce qui s’est réellement passé durant cet été 1994 et « rendre hommage, dignement, aux centaines de milliers de victimes rwandaises que nous n’avons pas su empêcher. »
Officier de la Force d’action rapide, détaché au sein d’une unité de la Légion étrangère, le capitaine Ancel mène avec ses hommes des opérations d’extraction de personnes menacées. Sous couvert d’une opération humanitaire destinée à mettre fin aux massacres, cet officier comprend vite que la France soutient le gouvernement génocidaire rwandais dont elle a formé l’armée. Il décrit les errements de l’armée française, ballotée au gré de décisions politiques dont les motivations sont toujours tenues secrètes, les archives officielles restant inaccessibles. Ce témoignage dévoile également certains épisodes méconnus de cette opération « humanitaire » durant laquelle l’armée française a tué. Parfois pour défendre, parfois pour des raisons moins avouables. »
Lire l’entretien avec l’auteur dans la revue
Scholastique Mukasonga, Inyenzi ou les Cafards, Gallimard, 2006

« Quiconque visite le Rwanda est saisi par la beauté de son paysage, mais il est aussi effaré par la violence de son histoire postcoloniale. Tout se passe comme si le bien et le mal irrémédiablement inséparables avaient scellé sous ses mille et une collines un pacte d’amitié. Il y a d’un côté les collines ; il y a, de l’autre, le million de crânes qui les jonchent. Mais ce qui prédomine, dans ce récit, c’est le remords des survivants, qui se traduit par les multiples cauchemars de l’auteur. D’où ce désir manifeste de donner aux disparus une digne sépulture de mots à la fois pour apaiser les vivants et sanctifier les morts.
Avec Inyenzi, Scholastique Mukasonga a écrit un récit autobiographique précieux, un document qui nous éclaire de l’intérieur sur le Rwanda postcolonial, un livre que je rangerais à côté du Suicide d’une république de Peter Gay : l’un et l’autre nous montrent à partir d’une succession de faits pourquoi le génocide était hélas, trois fois hélas, inévitable. »
Scholastique Mukasonga, L’Iguifou. Nouvelles rwandaises, Gallimard, 2010

« L’Iguifou (« igifu » selon la graphie rwandaise), c’est le ventre insatiable, la faim, qui tenaille les déplacés tutsi de Nyamata en proie à la famine et conduit Colomba aux portes lumineuses de la mort… Mais à Nyamata, il y a aussi la peur qui accompagne les enfants jusque sur les bancs de l’école et qui, bien loin du Rwanda, s’attache encore aux pas de l’exilée comme une ombre maléfique… Kalisa, lui, conduit ses fantômes de vaches dans les prairies du souvenir et des regrets, là où autrefois les bergers poètes célébraient la gloire des généreux mammifères…
Or, en ces temps de malheur, il n’y avait pas de plus grand malheur pour une jeune fille tutsi que d’être belle, c’est sa beauté qui vouera Helena à son tragique destin… Après le génocide, ne reste que la quête du deuil impossible, deuil désiré et refusé, car c’est auprès des morts qu’il faut puiser la force de survivre. L’écriture sereine de Scholastique Mukasonga, empreinte de poésie et d’humour, gravite inlassablement autour de l’indicible, l’astre noir du génocide. »
Scholastique Mukasonga, Notre-Dame du Nil, Gallimard, 2012

« Au Rwanda, un lycée de jeunes filles perché sur la crête Congo-Nil, à 2 500 mètres d’altitude, près des sources du grand fleuve égyptien. Les familles espèrent que dans ce havre religieusement baptisé Notre-Dame du Nil, isolé, d’accès difficile, loin des tentations de la capitale, leurs filles parviendront vierges au mariage négocié pour elles dans l’intérêt du lignage. Les transgressions menacent au cœur de cette puissante et belle nature où par ailleurs un rigoureux quota « ethnique » limite à 10 % le nombre des élèves tutsi.
Sur le même sommet montagneux, dans une plantation à demi abandonnée, un « vieux Blanc », peintre et anthropologue excentrique, assure que les Tutsi descendent des pharaons noirs de Méroé. Avec passion, il peint à fresque les lycéennes dont les traits rappellent ceux de la déesse Isis et d’insoumises reines Candace sculptées sur les stèles, au bord du Nil, il y a trois millénaires. Non sans risques pour sa jeune vie, et pour bien d’autres filles du lycée, la déesse est intronisée dans le temple qu’il a bâti pour elle.
Le huis clos où doivent vivre ces lycéennes bientôt encerclées par les nervis du pouvoir hutu, les amitiés, les désirs et les haines qui traversent ces vies en fleur, les luttes politiques, les complots, les incitations aux meurtres raciaux, les persécutions sournoises puis ouvertes, les rêves et les désillusions, les espoirs de survie, c’est, dans ce microcosme existentiel, un prélude exemplaire au génocide rwandais, fascinant de vérité, d’une écriture directe et sans faille. »
Lire notre entretien avec Scholastique Mukasonga
Gaël Faye, Petit pays, Grasset, 2016

« En 1992, Gabriel, dix ans, vit au Burundi avec son père français, entrepreneur, sa mère rwandaise et sa petite sœur, Ana, dans un confortable quartier d’expatriés. Gabriel passe le plus clair de son temps avec ses copains, une joyeuse bande occupée à faire les quatre cents coups. Un quotidien paisible, une enfance douce qui vont se disloquer en même temps que ce « petit pays » d’Afrique brutalement malmené par l’Histoire. Gabriel voit avec inquiétude ses parents se séparer, puis la guerre civile se profiler, suivie du drame rwandais. Le quartier est bouleversé. Par vagues successives, la violence l’envahit, l’imprègne, et tout bascule. Gabriel se croyait un enfant, il va se découvrir métis, Tutsi, Français…
Gaël Faye évoque les tourments et les interrogations d’un enfant pris dans une Histoire qui le fait grandir plus vite que prévu. Nourri d’un drame que l’auteur connaît bien, un premier roman d’une ampleur exceptionnelle, parcouru d’ombres et de lumière, de tragique et d’humour, de personnages qui tentent de survivre à la tragédie. »
Lire notre entretien avec Gaël Faye dans la revue
Beata Umubyeyi Mairesse, Le convoi, Flammarion, 2024

« Le 18 juin 1994, quelques semaines avant la fin du génocide des Tutsi au Rwanda, Beata Umubyeyi Mairesse, alors adolescente, a eu la vie sauve grâce à un convoi humanitaire suisse. Treize ans après les faits, elle entre en contact avec l’équipe de la BBC qui a filmé et photographié ce convoi. Commence alors une enquête acharnée (entre le Rwanda, le Royaume-Uni, la Suisse, la France, l’Italie et l’Afrique du Sud) pour recomposer les événements auprès des témoins encore vivants : rescapés, humanitaires, journalistes.
Le génocide des Tutsi, comme d’autres faits historiques africains, a été principalement raconté au monde à travers des images et des interprétations occidentales, faisant parfois des victimes les figurants de leur propre histoire.
Nourri de réflexions sur l’acte de témoigner et la valeur des traces, entre recherche d’archives et écriture de soi, Le convoi est un livre sobre et bouleversant : il offre une contribution essentielle à la réappropriation et à la transmission de cette mémoire collective. »
Robert Stockhammer, Ruanda. Über einen anderen Genozid schreiben, Suhrkamp, 2005

« Au Rwanda, au moins 800 000 personnes ont été assassinées en 1994. Dans cet essai, Robert Stockhammer se confronte à l’aporie selon laquelle les comparaisons entre le génocide rwandais et la Shoah sont aussi problématiques qu’inévitables.
Il explore donc la pression comparative qui pèse sur l’écriture de cet « autre » génocide au Rwanda, examinant les ouvrages que les Africains et les Européens ont écrits depuis lors sur le sujet, dont de nombreux textes littéraires, mais aussi des témoignages de survivants et des reportages.
Au lieu de répéter le discours de « l’indicible », cette étude philologique décrit les conditions de la dicibilité. »
Motivations et modalités des violences génocidaires
Sarah E. Brown, Gender and the Genocide in Rwanda. Women as Rescuers and Perpetrators, Routledge, 2018

« Ce livre examine la mobilisation, le rôle et la trajectoire des femmes secouristes et auteurs de crimes pendant le génocide de 1994 au Rwanda.
Si l’on a beaucoup écrit sur la victimisation des femmes pendant le génocide de 1994 au Rwanda, on a très peu parlé des femmes qui ont secouru des victimes ciblées ou perpétré des crimes contre l’humanité. Ce livre explore et analyse le rôle joué par les femmes qui ont exercé leur pouvoir en tant que sauveteuses et en tant qu’auteurs de crimes pendant le génocide au Rwanda. En tant que femmes, elles ont agi et pris des décisions dans le contexte d’un système patriarcal profondément enraciné qui limitait leurs choix.
Ce travail se penche sur les deux voies divergentes empruntées par les femmes au cours de cette période : sauver du génocide ou perpétrer le génocide. Il cherche à répondre à trois questions. Premièrement, comment certaines femmes rwandaises ont-elles été mobilisées pour participer au génocide, et par qui ? Ensuite, quelles ont été les actions spécifiques des femmes pendant cette période de violence et de bouleversements ? Enfin, quelles ont été les trajectoires des femmes sauveteuses et des femmes auteurs après le génocide ? En comparant et en opposant la façon dont les femmes sauveteuses et perpétratrices ont été mobilisées, les actions qu’elles ont entreprises et leurs trajectoires après le génocide, et en concluant par une discussion plus large sur l’impact à long terme de l’ignorance de ces femmes, ce livre développe une vision plus nuancée et holistique de l’action des femmes et du génocide au Rwanda. »
Jean-Pierre Chrétien et Marcel Kabanda, Rwanda. Racisme et génocide. L’idéologie hamitique, Belin, 2013
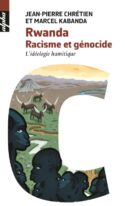
« Le génocide des Tutsi du Rwanda en 1994 est emblématique de la catastrophe qui a frappé toute l’Afrique des Grands Lacs depuis une vingtaine d’années. Il n’a été le fruit ni d’une fureur conjoncturelle, ni d’une fatalité ethnographique ou biologique, mais il est le produit très moderne d’une option extrémiste, jouant du racisme comme arme de contrôle du pouvoir. En effet, cette mise en condition de tout un pays aurait été impossible sans l’inscription durable dans la culture de cette région d’Afrique d’une idéologie racialiste, discriminant, sous les étiquettes hutu et tutsi, des autochtones et des envahisseurs, le « vrai peuple » rwandais majoritaire et une « race de féodaux ».
Ce livre décrypte la construction de cette idéologie, trop méconnue, qui oppose les « vrais Africains » à des « faux nègres », ceux qu’on a appelés les Hamites depuis les années 1860 dans la littérature africaniste. Le schéma racial dit « hamitique » est né de la même matrice intellectuelle que celui opposant Aryens et Sémites, qui a embrasé l’Europe dans les années 1930-1940. »
Jean-Pierre Chrétien (dir.), Rwanda. Les médias du génocide, Karthala, 2002
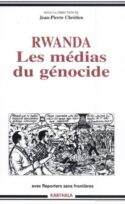
« Il manquait à la connaissance du génocide rwandais une étude de la propagande qui l’a rendu possible. Plus d’une année de travail aura été nécessaire aux auteurs pour retrouver et traduire des collections presque complètes des journaux extrémistes et des enregistrements de la Radio-télévision libre des Mille Collines. Cette étude démontre comment, entre 1990 et 1994, à côté d’une floraison de journaux rassemblant des démocrates hutu et tutsi, l’État rwandais a ouvertement encouragé un réseau de médias extrémistes faisant l’apologie de la haine et de l’intégrisme ethnique.
Les extraits les plus significatifs de cette propagande de la haine sont ici présentés et restitués dans leur contexte. Après la description des acteurs et de l’organisation des médias rwandais proches du régime au tournant des années 90, l’étude fait apparaître, textes et images à l’appui, leurs grandes orientations.
Cette enquête a été lancée par Reporters sans frontières avec les auteurs dès septembre 1994. Cette nouvelle édition 2002 est complétée par un index. Un ouvrage dirigé par Jean-Pierre Chrétien avec les contributions de Jean-François Dupaquier, Marcel Kabanda et Joseph Ngarambe. »
Hélène Dumas, Le Génocide au village. Le massacre des Tutsi au Rwanda, Seuil, 2014

« Fruit d’une enquête d’une dizaine d’années dans une commune du Rwanda, cette histoire « à la loupe » reconstitue, à travers ses lieux, ses acteurs et ses rescapés, l’exécution à l’échelle locale du dernier génocide du XXe siècle, concentré sur quelques mois (avril-mi-juillet 1994), et révèle la très grande proximité géographique, sociale, familiale des bourreaux et de leurs victimes. Nourri des témoignages aux procès, ceux des survivants, des tueurs et des témoins, mais aussi de déambulations sur les lieux de l’extermination, le récit met en lumière les mécanismes de ces massacres de proximité et la créativité meurtrière des bourreaux qui ont assuré la redoutable efficacité du génocide des Tutsi. Il éclaire l’ampleur de la participation populaire, ainsi que le rôle des imaginaires de guerre défensive et d’animalisation des victimes qui ont animé les tueurs.
Ce texte est aussi l’histoire de la confrontation d’un chercheur à la violence inouïe d’une parole et de la commotion produite par les traces physiques de l’extermination. À ce titre, il invite à une réflexion sur les manières de faire l’histoire d’un événement dont tant de dimensions demeurent inédites au regard des autres configurations de violence extrême. »
Lee Ann Fujii, Killing Neighbors ; Webs of Violence in Rwanda, Cornell University Press, 2009
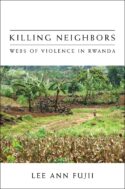
« Lors des terribles événements survenus au Rwanda au milieu des années 1990, des dizaines de milliers de Hutus ont tué leurs amis Tutsis, leurs voisins et même des membres de leur famille. Cette violence effroyable a éclipsé un fait presque aussi remarquable : des centaines de milliers de Hutus n’ont tué personne. En revisitant les motivations et les contextes spécifiques du génocide rwandais, Lee Ann Fujii se concentre sur les actions individuelles plutôt que sur des catégories générales.
Elle montre que la haine et la peur ethniques n’expliquent pas de manière satisfaisante la mobilisation des Rwandais les uns contre les autres. Les entretiens approfondis qu’elle a menés dans les prisons rwandaises et dans deux communautés rurales constituent la base de sa thèse selon laquelle la participation massive au génocide n’était pas le seul résultat d’antagonismes ethniques. C’est plutôt le contexte social de l’action qui a été déterminant. Une forte dynamique de groupe a façonné la participation au génocide. Les individus se sont joints au génocide et ont continué à y participer au fil du temps parce que le fait de tuer en groupes conférait une identité à ceux qui agissaient de manière destructrice. Les auteurs du génocide ont créé de nouveaux groupes centrés sur la destruction des liens antérieurs en tuant les membres de leur famille. »
Jean-Paul Kimonyo, Rwanda. Un génocide populaire, Karthala, 2008

« D’avril à juillet 1994, le Rwanda a connu un génocide qui a fait environ un million de victimes. La plupart des Tutsi qui vivaient à l’intérieur du pays ont été exterminés. Des milliers de Hutu, considérés comme des « complices » de ces derniers parce qu’ils n’adhéraient pas à l’idéologie raciste et au projet d’éradication mené par les extrémistes, y ont également péri.
Ce génocide, reconnu dès le lendemain de sa perpétration par la communauté internationale qui, auparavant, avait feint de n’y voir qu’une banale guerre « interethnique », a suscité une masse de publications, portant notamment sur la préparation politique et médiatique des tueries, sur le déroulement et la cruauté de celles-ci, sur le traitement judiciaire de ces crimes contre l’humanité, enfin sur les enjeux internationaux, en particulier sur le rôle de la France. Mais les raisons et les conditions de sa mise en œuvre sur le plan local restent peu étudiées.
L’étude de Jean-Paul Kimonyo vient combler cette lacune en portant l’attention sur la société rwandaise elle-même, dans laquelle a mûri la haine et a fonctionné le conditionnement, rendant possible ce massacre de masse, où des gens ont tué ou laissé tuer leurs voisins. L’auteur s’appuie sur deux exemples précis, les préfectures de Butare et de Kibuye, des régions où les Tutsi étaient nombreux et qui étaient éloignées du front de la guerre civile opposant l’armée officielle et les maquisards du FPR. Il observe plus précisément encore deux communes au sein de ces préfectures. Pour la première fois, nous avons une étude locale du génocide fondée sur de réelles enquêtes de terrain et sur des sources de première main trouvées sur place.
Cette enquête montre un génocide « populaire », où les petits cadres locaux jouent un rôle décisif, où les frustrations sociales face à l’État sont mobilisées contre le bouc émissaire tutsi, où même les aspirations démocratiques sont dévoyées en haine raciste selon la logique totalitaire dite du « Hutu-power ». Cette analyse n’exonère en rien les tireurs de ficelles, politiques ou militaires, mais elle montre la profondeur du mal qui rongeait la société rwandaise depuis des décennies. »
Scott Straus, The Order of Genocide ; Race, Power, and War in Rwanda, Cornell University Press, 2006
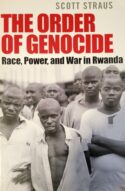
« Le génocide des Tutsis rwandais est devenu la pierre de touche des débats sur les causes de la violence de masse et les responsabilités de la communauté internationale. Pourtant, un certain nombre de questions essentielles sur cette tragédie restent sans réponse : Comment la violence s’est-elle propagée d’une communauté à l’autre et a-t-elle si rapidement englouti la nation ? Pourquoi des individus ont-ils pris des décisions qui les ont amenés à prendre des machettes contre leurs voisins ? Et quelle était la logique qui a présidé à la campagne d’extermination ?
Selon Scott Straus, bon nombre des idées largement répandues sur les causes et le déroulement du génocide des Tutsis sont incomplètes. Elles se concentrent en grande partie sur les actions de l’élite dirigeante ou sur l’inaction de la communauté internationale. Beaucoup moins sur la manière dont les décisions de l’élite se sont transformées en violence exterminatrice généralisée. Les interprétations actuelles mettent l’accent sur trois causes principales du génocide : l’identité ethnique, l’idéologie et l’endoctrinement par les médias de masse (en particulier l’influence des radios haineuses). Les recherches de Scott Straus ne nient pas l’importance de l’ethnicité, mais il constate qu’elle a plutôt fonctionné comme un arrière-plan. Il insiste plutôt sur la peur et l’intimidation intra-ethnique comme principaux moteurs de la violence. »
Violaine Baraduc, Tout les oblige à mourir. L’infanticide génocidaire au Rwanda en 1994, CNRS Éditions, 2024
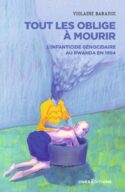
« En 1994, le génocide perpétré contre les Tutsi du Rwanda n’épargne pas les relations les plus intimes. Dans certaines familles « mixtes », des grands-parents, des oncles, des tantes, des cousins, des maris, et même des pères ou des mères, s’en prennent à leurs proches. Ainsi de Béata Nyirankoko et Patricie Mukamana. Après plusieurs semaines de massacres sur tout le territoire, ces deux paysannes hutu se résignent à tuer les enfants qu’elles ont eus avec leur maris tutsi.
À partir d’entretiens, d’archives judiciaires et d’observations, cette enquête donne à entendre les voix des deux mères et celles de différents membres de leur famille, accusés ou rescapés. Interrogeant le rôle des femmes et des rapports de genre dans les tueries, elle dévoile certains rouages essentiels du retournement des liens affectifs et sociaux à l’œuvre durant un génocide commandité par l’État, mais massivement exécuté par la population. »
Hélène Dumas, Sans ciel ni terre. Paroles orphelines du génocide des Tutsi (1994-2006), La Découverte, 2019

« Dans l’amas des archives de la principale institution chargée de l’histoire et de la mémoire du génocide au Rwanda, plusieurs liasses de fragiles petits cahiers d’écoliers renfermaient dans le silence de la poussière accumulée les récits d’une centaine d’enfants survivants.
Rédigés en 2006 à l’initiative d’une association rwandaise de rescapés, dans une perspective testimoniale et de catharsis psychologique, ces témoignages d’enfants devenus entre-temps des jeunes hommes et des jeunes femmes, racontent en trois scansions chronologiques souvent subverties ce que fut leur expérience du génocide, de la « vie d’avant » puis de la « vie d’après ». Leurs mots, le cruel réalisme des scènes décrites, la puissance des affects exprimés, livrent à l’historien une entrée incomparable dans les subjectivités survivantes et permettent, aussi, d’investir le discours et la gestuelle meurtrière de ceux qui éradiquèrent à jamais leur monde de l’enfance.
Le livre tente une écriture de l’histoire du génocide des Tutsi à hauteur d’enfant. Il donne à voir et à entendre l’expression singulière d’une expérience collective, au plus près des mots des enfants, au plus près du grain de la source. Tentative historiographique qui est aussi une mise à l’épreuve affective et morale pour l’historienne face à une source saturée de violence et de douleur. Loin des postulats abstraits sur « l’indicible », le livre propose une réflexion sur les conditions rendant audibles les récits terribles d’une telle expérience de déréliction au crépuscule de notre tragique XXe siècle. »
Sandrine Ricci, Avant de tuer les femmes, vous devez les violer ! Rwanda, rapports de sexe et génocide ds Tutsi, Syllepse, 2019

« En 1994, le Rwanda devient tristement célèbre : un génocide d’une intensité inouïe fauche près d’un million de vies en cent jours. Le groupe minoritaire identifié comme Tutsi est la principale cible des massacres. Les femmes, quant à elles, connaissent un sort particulier. Violées et tuées, violées et réduites en esclavage sexuel par les soldats, les miliciens, les politiciens ou par de simples quidams.
En adoptant une perspective féministe, l’auteure prend la mesure des soubassements culturels, sociaux et politiques sur lesquels repose la systématisation du viol en temps de guerre. Elle nous permet de comprendre comment ces hommes et ces femmes du Rwanda, minuscule territoire culturellement et linguistiquement homogène, ont pu en arriver à commettre des actes si monstrueux.
Au Rwanda, l’endoctrinement des foules a encouragé la stigmatisation de l’« Autre », les médias de la haine propageant la représentation des femmes tutsi comme des êtres dotés d’un charme maléfique et d’une sexualité dévorante au service de leur « race ». L’ennemi « femme » apparaît toujours différent de l’ennemi-tout-court. »
Les acteurs internationaux
Linda Melvern, A People Betrayed ; The Role of the West in Rwanda’s Genocide, Zed, 2024 (4e édition)
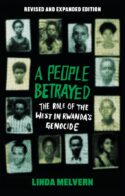
« Après trente ans de recherches, notamment dans des archives gouvernementales récemment déclassifiées, cette nouvelle édition révisée et augmentée du classique de Linda Melvern révèle comment les décideurs politiques continuent de refuser de reconnaître leurs responsabilités en vertu du droit international.
Elle comprend de nombreux éléments nouveaux qui tiennent compte des informations révélées lors du procès de Félicien Kabuga, le financier présumé du génocide, qui s’est tenu en 2022. Ces nouveaux éléments alimentent non seulement une chronologie révisée et une section entièrement nouvelle sur la préparation du génocide.
Tout au long de l’ouvrage, Linda Melvern révèle avec une précision inégalée l’ampleur, la rapidité et l’intensité du génocide et dénonce les gouvernements et les individus occidentaux qui auraient pu empêcher ce qui se passait s’ils avaient choisi d’agir. Il en ressort un réquisitoire choquant sur la façon dont le Rwanda a été ignoré en 1994 et sur la façon dont l’Occident s’en souvient mal aujourd’hui. Un réquisitoire qui rend d’autant plus poignants les récits de Linda Melvern sur l’héroïsme méconnu des Occidentaux qui sont restés sur place pendant les violences, qu’il s’agisse des volontaires engagés dans le maintien de la paix ou des travailleurs des ONG. »
Vincent Duclert, La France face au génocide des Tutsi. Le grand scandale de la Ve République, Tallandier, 2024
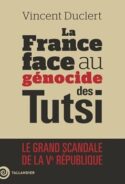
« Entre le 7 avril et le 4 juillet 1994, en moins de cent jours, plus d’un million de Tutsi, ainsi que des opposants politiques, sont exterminés à l’instigation du régime extrémiste hutu. La France est alors un soutien majeur du gouvernement rwandais. Malgré les alertes sur l’ampleur des persécutions et massacres de Tutsi, les autorités françaises interviennent tardivement, avec l’opération militaro-humanitaire Turquoise. Le rôle de la présidence de François Mitterrand est pointé du doigt mais sa reconnaissance se heurte à un déni indépassable durant près de trente ans. En 2021, les « responsabilités lourdes et accablantes » de la France dans le génocide des Tutsi sont établies par une commission de chercheurs présidée par Vincent Duclert.
Dans cet ouvrage, Vincent Duclert amplifie le constat et affirme qu’il s’agit du plus grand scandale de la Ve République. Il reprend la longue histoire des relations franco-rwandaises, revisite l’intégralité des archives et les complète de documents et témoignages inédits. Il démontre la profondeur des liens entre le sommet de l’État et le régime d’Habyarimana. Il décrit des systèmes de commandement militaire et politique parallèles, leurs dérives, les tensions avec les hommes de terrain. Il souligne enfin que tous les éléments étaient à la disposition de la présidence française pour que le génocide soit anticipé, compris et arrêté. Pourtant, l’impensable s’est déroulé sous nos yeux incrédules. »
Lire l’entretien avec Vincent Duclert
Le rôle des églises
Timothy Longman, Christianity and Genocide in Rwanda, Cambridge University Press, 2010
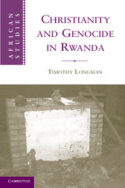
« Bien que le Rwanda soit l’un des pays les plus chrétiens d’Afrique, lors du génocide de 1994, les édifices religieux sont devenus les principaux lieux de massacre. Pour expliquer pourquoi tant de chrétiens ont participé à la violence, ce livre examine l’histoire de l’engagement chrétien au Rwanda et se tourne ensuite vers un riche corpus de recherches originales au niveau national et local pour soutenir que les églises du Rwanda se sont constamment alliées à l’État et ont joué un rôle dans sa politique ethnique.
La comparaison de deux paroisses presbytériennes locales à Kibuye avant le génocide démontre que des forces progressistes cherchaient à démocratiser les églises. Tout comme les politiciens hutus ont utilisé le génocide des Tutsis pour asseoir leur pouvoir politique et écraser les réformes démocratiques, les chefs religieux ont soutenu le génocide pour assurer leur propre pouvoir. Le fait que le christianisme ait incité certains Rwandais à s’opposer au génocide montre que l’opposition des églises était possible et qu’elle aurait pu freiner la violence. »
Philippe Denis, The Genocide against the Tutsi, and the Rwandan Churches. Between Grief and Denial, 2022
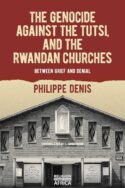
« Pourquoi certains secteurs des églises rwandaises ont-ils adopté une attitude ambiguë à l’égard du génocide contre les Tutsi qui a coûté la vie à près de 800 000 personnes en trois mois, entre avril et juillet 1994 ? Qu’est-ce qui a empêché les églises d’admettre qu’elles pouvaient avoir une certaine responsabilité ? Et comment expliquer les efforts déployés par d’autres secteurs de l’Église pour se souvenir et commémorer le génocide ?
S’appuyant sur des entretiens avec des survivants du génocide, des Rwandais en exil, des missionnaires et des représentants du gouvernement, ainsi que sur les archives de l’Église, ce livre est la première étude universitaire sur le christianisme et le génocide des Tutsi à explorer en profondeur ces questions controversées. Il révèle une plus grande diversité interne au sein des églises chrétiennes qu’on ne le pense souvent. Alors que des chrétiens, protestants comme catholiques, ont pris des risques pour abriter des Tutsi, d’autres ont adhéré sans esprit critique au point de vue du gouvernement intérimaire selon lequel les Tutsi étaient des ennemis du peuple et certains, même des prêtres et des pasteurs, ont prêté main forte aux tueurs. Les responsables ecclésiastiques se sont contentés de condamner la guerre mais n’ont jamais réellement dénoncé le génocide contre les Tutsi. En se concentrant sur la période du génocide en 1994 et les années suivantes (jusqu’en 2000), Philippe Denis examine en détail les réponses de deux églises, l’Église catholique, la plus grande et la plus complexe, et l’Église presbytérienne du Rwanda, qui a fait un aveu de culpabilité inconditionnel en décembre 1996.
Une étude de cas est consacrée à la paroisse catholique La Crête Congo-Nil, dans l’ouest du Rwanda, dirigée à l’époque par le prêtre français Gabriel Maindron, un homme que les survivants accusent de ne pas s’être opposé publiquement au génocide et d’avoir entretenu des liens étroits avec les autorités et certains de ses auteurs. »
Timothée Brunet-Lefèvre, Le père Seromba. Destructeur de l’Église de Nyange (Rwanda, 1994), Hoosh, 2021

« Le crime de génocide est imprescriptible, mais il n’est pas indélébile pour autant. Il est par excellence, dans les mots de Jean-Pierre Karegeye, le crime « qui ne porte pas toutes ses traces ».
Il ne suffit pas aujourd’hui de se rendre sur la scène de crime pour comprendre ce qui s’est produit dans la paroisse du père Seromba.
Ce que l’on désigne comme Nyange est resté un souvenir : celui de la vie avant 1994 et celui de l’extermination. Ce livre fait le choix de restituer la parole des acteurs sociaux, d’écouter, au détour de leurs hésitations, dans leur désespoir et leur dignité, ces récits qui se sont fait entendre au cœur du Tribunal Pénal International pour le Rwanda. »
Justice et mémoires
Timothy Longman, Memory and Justice in Post-Genocide Rwanda, Cambridge University Press, 2017
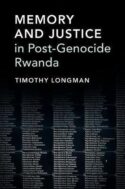
« Après des périodes de conflit et de tragédie, de nombreux pays mettent en œuvre des programmes et des politiques de justice transitionnelle, dont aucun n’est plus étendu que celui mis en oeuvre au Rwanda après le génocide. Replaçant les initiatives de justice transitionnelle du Rwanda dans leur contexte historique et politique, ce livre examine le projet entrepris par le gouvernement post-génocidaire pour façonner la mémoire collective de la population rwandaise, à la fois par des réformes politiques et judiciaires, mais aussi par des commémorations publiques et des monuments commémoratifs.
S’appuyant sur plus de deux décennies de recherche sur le terrain au Rwanda, Timothy Longman explore la réponse du Rwanda à la fois au niveau gouvernemental et au niveau local. Il affirme qu’en dépit de bonnes intentions et d’innovations importantes, le contexte politique autoritaire du Rwanda a entravé la capacité de la justice transitionnelle à apporter les transformations sociales et politiques radicales que ses défenseurs espéraient. En outre, elle continue d’accentuer les inégalités politiques et économiques qui soulignent les divisions ethniques et constituent un obstacle important à la réconciliation. »
Paul Christoph Bornkamm, Rwanda’s Gacaca Courts ; Between Retribution and Reparation, Oxford University Press
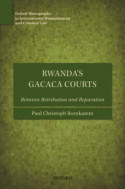
« Les tribunaux Gacaca du Rwanda constituent une réponse innovante au génocide de 1994. Intégrant à la fois des éléments de la résolution des conflits africains et des tribunaux pénaux de type occidental, les juridictions gacaca s’inscrivent dans la tendance récente à faire revivre les mécanismes traditionnels de base comme moyen de faire face à un passé violent. Conçus comme une approche holistique des poursuites et des sanctions, ainsi que de la guérison et de la réparation, ils reflètent également l’importance croissante de la participation des victimes dans la justice pénale internationale.
Cet ouvrage examine de manière critique les réalisations des tribunaux Gacaca en tant que mécanisme de justice pénale et outil de guérison, de réparation et de réconciliation des communautés brisées. Ayant poursuivi plus d’un million de personnes soupçonnées de crimes pendant le génocide de 1994, les tribunaux Gacaca ont été à la fois loués pour leur efficacité et condamnés pour leur manque de régularité. S’appuyant sur une analyse approfondie des procédures judiciaires, ce livre fournit une analyse détaillée de la législation Gacaca et de sa mise en œuvre pratique. Il examine les tribunaux Gacaca dans le cadre de la justice pénale transitionnelle et internationale. »
Rafaëlle Maison, Pouvoir et génocide dans l’œuvre du Tribunal pénal international pour le Rwanda, Dalloz, 2017

« La majorité des analystes contemporains s’accordent pour présenter un récit historique du génocide, en analysant ses origines lointaines, le contexte du conflit, la radicalisation des forces politiques en opposition, puis le coup d’Etat, la prise de contrôle de l’appareil étatique et les massacres locaux, jusqu’à la défaite. Dans ce tableau, la question du soutien politique, diplomatique et matériel de la France qui aurait permis la mise en place de stratégies conduisant au génocide, jusqu’à l’opération Turquoise, a été récemment approfondie.
En quoi l’œuvre du Tribunal pénal international pour le Rwanda institué par le Conseil de sécurité approche-t-elle de cette description historique ? De quels moyens juridiques le Tribunal disposait-t-il pour saisir les principaux agents du génocide ? A quoi attribuer l’échec relatif, si l’on peut parler d’échec, de l’institution ? Cet essai ne prétend pas répondre définitivement à cette dernière question : il espère plutôt justifier qu’elle soit posée.
Cet ouvrage repose sur l’analyse de différentes sources : les travaux relatifs à l’histoire du génocide, afin de mesurer comment il fut judiciairement appréhendé ; les témoignages des acteurs des procès aussi utilisés, de même que les documents publics des Nations Unies. »
Caroline Williamson Sinalo, Rwanda After Genocide ; Gender, Identity and Post-Traumatic Growth, Cambridge University Press, 2018
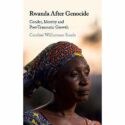
« Lors du génocide de 1994 au Rwanda, près d’un million de personnes ont été brutalement assassinées en l’espace de treize semaines seulement.
Ce livre propose une étude approfondie de la reconstruction post-traumatique au travers des témoignages d’hommes et de femmes qui ont survécu, mettant en lumière les façons dont ils ont pu construire une nouvelle vie, souvent meilleure. Ce faisant, Caroline Williamson Sinalo préconise une nouvelle lecture du traumatisme : une lecture qui reconnaît non seulement les réponses négatives, mais aussi les réponses positives aux expériences traumatisantes.
À travers une analyse des témoignages enregistrés en kinyarwanda par les archives du génocide au Rwanda, le livre offre une alternative aux paradigmes dominants sur le traumatisme, révélant que, malgré les innombrables récits d’horreur, de douleur et de perte au Rwanda, il existe également des récits de force, de rétablissement et de développement. »
L’article Le génocide des Tutsi au Rwanda : une liste de lectures est apparu en premier sur Le Grand Continent.

