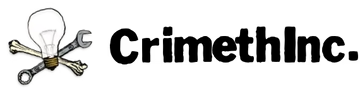29.12.2023 à 22:41
2023 : l'année dans le rétro : Un monde au bord du gouffre
CrimethInc. Ex-Workers Collective
Texte intégral (4995 mots)

Bonne année ! Bravo d’y avoir survécu. Faisons le point sur la situation.
Lors de notre bilan de l’année 2022, nous avions documenté le déclin des mouvements sociaux qui avaient suivi les révoltes de 2019 et 2020. Des stratégies auparavant couronnées de succès produisaient des retours moindres et les autorités avaient appris de leurs défaites. Notre époque reste définie par cette particularité : même les luttes les plus acharnées ont largement échoué à obtenir leurs revendications intermédiaires. Apparemment, celleux qui administrent un ordre social de plus en plus fragile que certain·es appellent late capitalism (ou « capitalisme tardif », NdT) ne sont pas en position de céder du terrain. Au lieu d’offrir des concessions aux désespéré·es et aux révolté·es, les gouvernements de tous bords politiques investissent dans des technologies répressives et renforcent leur dépendance à la police.
À l’étranger, les conséquences en étaient déjà claires il y a un an:
L’invasion de l’Ukraine se place dans la continuité d’un processus de militarisation et de déplacement forcé déjà visibles en Syrie. En plein effondrement écologique, en pleine guerre – effets secondaires de l’accumulation du capital et de ses conséquences – de plus en plus de personnes sont forcées à l’exil partout dans le monde.
L’invasion de l’Ukraine est probablement un indicateur des événements à venir. Ces dernières décennies, les gouvernements, partout dans le monde, ont investi des milliards de dollars dans des technologies de contrôle des foules et dans l’équipement militaire, tout en se limitant à quelques mesures cosmétiques pour répondre à la croissance des inégalités ou à la destruction du monde naturel. Alors que les crises économiques et écologiques s’intensifient, de plus en plus de gouvernements chercheront à résoudre leurs problèmes internes par des conflits avec leurs voisins.
Malheureusement, les événements de 2023 ont donné raison à nos peurs. Tandis que l’invasion russe de l’Ukraine se transformait en épuisante guerre d’usure, la guerre civile éclatait au Soudan, l’Azerbaïdjan envahissait le Haut-Karabakh à des fins d’épuration ethnique et maintenant, le gouvernement israélien poursuit ce même projet à Gaza. Ce ne sont pas des cas isolés, mais des aperçus du futur qui nous attend si nous n’arrivons pas à changer de trajectoire.
Cela nous montre ce qui est en jeu, dans nos efforts maladroits pour changer le monde. Dans ces conditions, s’il n’est pas possible d’obtenir nos demandes intermédiaires, il sera peut-être plus facile de poursuivre franchement des objectifs de transformation révolutionnaire.
Heureusement, nous ne sommes pas les seul·es à nous mobiliser sur ces questions. Cette année, nous avons été inspiré·es par la ténacité des participant·es aux luttes en cours, comme le combat pour mettre fin à Cop City ; par l’empathie qui a poussé des personnes partout dans le monde à agir en solidarité avec les habitant·es de Gaza ; par le courage des rebelles, de l’Équateur à la France. Nos expériences communes en manifestations, dans nos projets d’entraide, nos concerts, nos salons du livre et nos discussions passionnées ont maintenu notre foi dans le potentiel de l’humanité. Cette histoire est loin d’être finie.
2024 sera probablement une année en dents de scie. Aux États-Unis, la campagne électorale s’annonce chaotique, ce qui se traduira en conflit social dans les rues. C’est à nous de montrer qu’au lieu de choisir entre les fascistes et des centristes déterminé·es à préserver un système autodestructeur, les gens peuvent se rassembler dans des réseaux fondés sur la solidarité, l’entraide, et une vision plus ambitieuse de ce que nos vies pourraient être.
C’est la meilleure manière de se préparer à toute éventualité.
Dans cet article, nous ferons le bilan de nos propres efforts de l’année passée – la couverture médiatique que nous avons fournie de l’intérieur des mouvements sociaux, et les projets auxquels nous avons participé.
La Tragédie en cours en Palestine
Le 7 octobre, des militant·es du Hamas et d’autres groupes palestiniens ont franchi les barrières à la frontière de Gaza et lancé une série de plusieurs attaques, tuant 1139 personnes. Le gouvernement israélien a sauté sur l’occasion pour lancer une opération de nettoyage ethnique dans la Bande de Gaza. Fin 2023, ils avaient massacré plus de 21 000 Palestinien·nes, dont les deux tiers étaient des femmes et des enfants.
En réaction, les États-Unis ont connu une vague de manifestations et d’actions directes. Début novembre, nous avons publié un texte de Fayer, collectif juif qui a participé à la lutte contre Cop City à Atlanta, expliquant pourquoi iels s’engagent pour la solidarité avec les Palestinien·nes et les actions qu’iels pensent nécessaire pour mettre un terme à l’attaque de l’armée israélienne. Dans les semaines qui ont suivi, nous avons publié des rapports d’anarchistes qui ont participé au blocage du port de Tacoma, d’un bâtiment de Raytheon, et de divers locaux d’Amazon pour interrompre le flux d’armes et d’argent en direction de l’armée israélienne.
En ce début d’année 2024, mettre un terme au nettoyage ethnique de Gaza reste l’un des défis les plus urgents qui nous attendent.

Manifestation au Port de Tacoma, dans l’État de Washington, le 6 novembre 2023.
Stop à Cop City, défendons la forêt
Ces deux dernières années, le mouvement pour stopper Cop City et défendre la forêt de Weelaunee est devenu l’une des luttes les plus féroces en Amérique du Nord. Utilisant différentes stratégies, les opposant·es au projet d’un centre de militarisation de la police ont systématiquement détruit des équipements et forcé les constructeurs à se retirer du chantier. En représailles, les autorités ont repoussé les limites en termes de répression, allant jusqu’au meurtre d’un·e défenseur·se de la forêt. Elles ont porté plainte contre 61 autres, dont les membres d’un collectif de soutien juridique pour fraude un motif particulièrement étrange. Le premier de ces procès est prévu pour début janvier 2024.
Nous avons publié un vaste panel de perspectives, venant de différent·es participant·es au mouvement, y compris sur les valeurs qui les encouragent à continuer le combat. Le dernier article en date de notre série exhaustive sur l’histoire de cette lutte retrace son évolution dans la seconde moitié de 2023. Nous explorons les manières dont le mouvement a cherché à maintenir un caractère participatif et combatif, malgré des pressions intenses.
Nous considérons le combat contre Cop City comme un pont entre la rébellion pour George Floyd de 2020 et les mouvements du futur. En cherchant à dépasser les limites atteintes par le mouvement de 2020, les participant·es sont devenu·es un exemple qui sera utile la prochaine fois qu’un événement motivera un grand nombre de personnes à passer à l’action.

Le chantier de Cop City le 5 mars 2023.
Europe
En janvier, nous avons publié un photoreportage documentant la confrontation entre des milliers de policiers et de manifestant·es à Lützerath, où le gouvernement allemand avait pour objectif d’expulser un camp écologiste.
En février, nous avons publié un article sur l’anarchiste italien emprisonné Alfredo Cospito. Il en était alors à plus de 100 jours de grève de la faim, pour exiger de ne plus être enfermé à l’isolement. Selon nous, la grève d’Alfredo est un avertissement : un message sur les conditions de vie qui se préparent pour nous tou·tes, dans une société qui traite de plus en plus la vie humaine comme inconséquente.
En mars, nous avons couvert le mouvement contre la réforme des retraites en France, qui escaladait jusqu’à devenir un conflit majeur. En juin, les rues françaises explosaient à nouveau après le meurtre de Nahel Merzouk, 17 ans, par la police. Malheureusement, comme l’observait l’un·e de nos contributeurices par la suite, ces dernières années, différentes catégories de la population française se sont révoltées successivement et non en même temps, permettant aux autorités de traverser l’orage.
Plus à l’Est, nous avons couvert la mutinerie de l’entreprise militaire privée Wagner contre le gouvernement de Vladimir Poutine, du point de vue des anarchistes russes. À notre avis, de tels conflits internes sont la conséquence inévitable de la militarisation de la société et de la centralité croissante des forces armées dans l’action politique d’État. En Russie, comme au Soudan, le gouvernement a armé des mercenaires pour faire son sale boulot, créant les conditions d’un conflit armé. Au Soudan, la guerre civile qui a résulté de cette stratégie est catastrophique pour les civil·es.
Ailleurs, nous avons partagé une histoire inspirante de solidarité entre réfugié·es et exilé·es : des anarchistes russes en exil en Arménie ont cherché à soutenir les squatteur·ses arménien·nes. Lorsque l’Azerbaïdjan a envahi le Haut-Karabakh, nous avons publié les perspectives des anarchistes arménien·nes sur les événements.
Enfin, nous avons examiné la décision du gouvernement grec d’expulser le camp de réfugié·es autogéré de Lavrio décision à l’intersection de la guerre du gouvernement turc contre les Kurdes, du gouvernement grec contre les espaces autonomes, et de l’Union Européenne contre les migrant·es.

Tout ce qui monte doit un jour redescendre. France, printemps 2023.
Moyen-Orient
À l’occasion du 8 mars, Journée internationale de lutte pour les droits des femmes, nous avons publié un compte-rendu sur l’origine du slogan “Jin, Jiyan, Azadi” (“Femme, Vie, Liberté”) retraçant sa diffusion depuis la partie du Kurdistan sous contrôle turc jusqu’à l’Iran, et partout dans le monde. Peu après, en réponse au séisme qui a détruit la Syrie et la Turquie en février, nous diffusions les communiqués de soutiens des mouvements de libération dans ces régions, expliquant comment les gouvernements turcs et syriens avaient non seulement échoué à protéger leurs sujets, mais avaient en plus profité de la catastrophe pour les bloquer et même les bombarder.
Plus tard dans le mois, nous avons publié le rapport d’un anarchiste israélien expliquant que les efforts du Premier ministre Benjamin Nétanyahou pour renforcer son pouvoir, et le mouvement de protestation qui a émergé en réponse, représentaient un conflit entre des élites en compétition et leurs modèles coloniaux respectifs, dont aucun n’offre de proposition réelle pour revenir sur l’oppression et la déportation des Palestinien·es. En octobre, le lendemain des attaques du 7 octobre, nous avons publié une interview très lue avec un autre anarchiste israélien, Jonathan Pollak, sur l’escalade de la violence en Palestine et la répression du gouvernement israélien contre celleux qui agissent en solidarité avec les Palestinien·es.
Nous avons suivi par le point de vue d’un Palestinien vivant dans la partie de Palestine qui a été occupée en 1948, qui décrivait la vie sous la domination coloniale et soulignait l’importance de l’organisation de terrain et de la solidarité dans la lutte pour la libération de la Palestine.
Amérique latine
Au Brésil, 2023 commençait par une reprise maladroite de l’incident du 6 janvier 2021, lorsque les soutiens de Donald Trump ont pris d’assaut le Capitole dans l’espoir de le maintenir au pouvoir. En même temps, au Pérou, un mouvement de protestation tumultueux culminait en une marche sur la capitale, Lima. Nous avons parlé à des anarchistes péruvien·nes pour mieux comprendre ces événements.
L’année s’est terminée sur l’élection de Javier Milei en Argentine. Nous avons mené une interview avec des anarchistes de Rosario pour comprendre les décennies de lutte sociale et de restructuration économique qui ont créé les conditions de cette prise de pouvoir.

Barricades autour du palais présidentiel le 20 décembre 2001, juste avant que le Président Fernando De la Rua ne fuie avec un hélicoptère sur le toit. La dernière fois qu’un gouvernement a tenté d’imposer un capitalisme débridé à la population d’Argentine, ça c’est finit comme ça.
Histoire
Nos publications historiques cette année se sont majoritairement centrées sur le début du 21e siècle. Nous avons chroniqué la victoire antifasciste de la “bataille de York” en Pennsylvanie en 2002, comparant cette lutte haute en couleurs à la situation deux décennies plus tard, bien plus sombre. Nous avons exploré l’histoire du réseau d’organisation anarchiste Bash Back! en amont d’une nouvelle convergence Bash Back!. Enfin, pour offrir une référence historique à celleux qui cherchent à agir aujourd’hui contre les trafiquants d’armes, nous sommes revenu·es sur la campagne Smash EDO en Grande-Bretagne il y a une décennie.
Dans l’année à venir, nous espérons publier davantage sur les 19e et 20e siècles.
Le point de vue d’un policier à Sainte-Soline au printemps 2023.
Dans nos mémoires
En janvier, la police a assassiné que ses camarades défenseur·ses de la forêt connaissaient sous le nom de Tortuguita. Tortuguita occupait la forêt Weelaunee à Atlanta depuis des mois, et avait courageusement choisi de l’occuper à nouveau après un raid policier en décembre d’avant. Les milliers de personnes qui ont participé au mouvement pour stopper Cop City ont gardé le soutenir de Tortuguita vivant, malgré les forces de la répression et de l’effacement.

Manuel Terán, alias Tortuguita.
En février, notre amie de longue date Jen Angel a été tuée à Oakland, en Californie. Jen a passé sa vie à construire des infrastructures pour faciliter l’organisation, les publications et les relations anarchistes.

Jen Angel.
Le 19 avril 2023, trois anarchistes ont été tués au combat près de Bakhmout : un Américain, Cooper Andrews, un Irlandais, Finbar Cafferkey, et un Russe, Dmitry Petrov. Nous avons publié une biographie de Dmitry. Pendant une décennie et demi, il a participé à la lutte révolutionnaire en Russie, au Bélarus, au Rojava et en Ukraine face à une tyrannie qui s’intensifiait. L’histoire de sa vie est une plongée dans l’histoire récente de l’ancienne Union soviétique. C’est également un exemple inspirant de tout ce qu’un·e anarchiste peut accomplir, même dans l’adversité.

Dmitry Petrov.
Active Distribution a publié un court recueil, qui contient notre biographie ainsi que certains de ses écrits et ceux de ses camarades. PM Press distribue désormais ces livres aux États-Unis.
Le 6 décembre,1 l’auteur et insurgé anarchiste Alfred Bonanno est décédé. Bonnano proposait un refus du travail et la quête d’une révolte joyeuse comme mesures révolutionnaires dans la lutte contre toutes formes de domination et de désespoir. Ses idées ont beaucoup influencé le développement de nos propres projets collectifs. Nous avons préparé une courte histoire de sa vie.
Enfin, nous voulons exprimer notre gratitude pour celleux que nous avions peur de perdre cette année, et qui sont toujours avec nous aujourd’hui. Il était facile d’imaginer qu’Alfredo Cospito ne survive pas à sa grève de la faim, mais il a survécu. De même, un participant à la manifestation violemment réprimée de Sainte-Soline, en France, est resté longtemps dans le coma à cause d’un policier qui a tenté de le tuer en lui tirant une grenade dans la tête. Heureusement, Serge s’est remis.

“Tortuguita vit ; la lutte continue.” Une banderole déployée lors d’une marche blanche en janvier 2023, pendant laquelle une voiture de police a pris feu.
Événements publics
En 2023, nous avons participé à des salons du livre et des présentations aux États-Unis, de Boston et New York à Sacramento et Oakland, en passant par le Canada, le Mexique, l’Équateur, le Brésil, l’Angleterre, l’Écosse, les Pays-Bas, l’Allemagne, la Slovénie et ailleurs.
L’un des événements les plus enthousiasmants de l’année, c’était le rassemblement anarchiste mondial à Saint-Imier, en Suisse. Ce festival célébrait le 151e anniversaire du congrès fondateur de la fédération connue sous le nom d’Internationale anti-autoritaire – à la suite de l’Association Internationale des Travailleurs [sic], l’une des plus importantes organisations ouvrières européennes au 19e siècle. Attirant un nombre honorable de 5 000 personnes – venues majoritairement d’Europe centrale, mais aussi d’aussi loin que le Chili et l’Australie – le rassemblement de Saint-Imier a peut-être été le plus grand événement exclusivement anarchiste de l’année.
Avec l’aide de participant·es d’Allemagne, de Russie, du Bélarus, de Finlande, des Etats-Unis et d’ailleurs dans le monde, nous avons publié un rapport complet sur le rassemblement, suivi d’une réflexion plus spécifique sur les dynamiques et les discours autour du genre et de la sexualité lors de l’événement.

Un sticker vu pendant le rassemblement de Saint-Imier. “Aime l’anarchie, Aime les gens, Aime la nature, Aime les animaux, Aime l’humanité, Aime la solidarité, Aime l’empathie, Aime la participation”.
Posters
Cette année, pour célébrer l’énième réimpression de notre classique poster sur le genre, nous en avons sorti une version 2023 qui répond aux menaces actuelles contre l’autodétermination du genre et les formes de solidarité et d’autodéfense collective qui les contrebalancent. En parallèle, nous avons publié une discussion sur les manières dont les lignes de front du discours sur le genre ont bougé depuis la publication de l’original du poster, il y a deux décennies. C’est l’un des textes les plus complets et réfléchis que nous ayons finis cette année.

Notre nouveau poster “gender remix” en action.
En plus, nous avons préparé des posters en solidarité avec les Palestinien·nes et avec celleux qui cherchent à défendre la forêt à Atlanta et ailleurs dans le monde. Ces posters sont tous disponibles pour être téléchargés, imprimés et collés sur les murs de votre communauté.

Un autre de nos posters dans son habitat naturel.
Zines
Cette année, nous avons sorti trois zines sur le mouvement Stop Cop City, couvrant l’histoire du mouvement en détail, les différentes stratégies employées par les participant·es, les plaintes RICO, etc. Ils ont été distribués à Atlanta et dans tous les événements en soutien aux quatre coins des États-Unis.
Nous avons aussi publiés des zines offrant des perspectives palestiniennes, traitant de la lutte pour l’autodétermination de genre, expliquant comment survivre à un procès pour délit grave, et rappelant les leçons de la “green scare,” ou “peur verte”, l’opération fédérale contre les militant·es écologistes.
Pour faciliter l’impression, nous avons mis en place une nouvelle option “ink lite”, pour que vous puissiez imprimer nos zines même quand vous êtes presque à court d’encre.

Une rue d’Atlanta après un affrontement entre la police et des manifestant·es Stop Cop City en novembre 2023.
Audio
Après une accalmie dans nos efforts audio, nous avons rassemblé une nouvelle équipe pour préparer des versions audio de nos articles. Cette année, nous avons sorti 20 « audio zines » de ce type, dont cinq sur les efforts vers une solidarité avec la Palestine et cinq sur le mouvement Stop Cop City à Atlanta.
Vous pouvez les écouter ici.

Langues
Au cours de l’année 2023, nous avons publié des dizaines d’articles en espagnol; plus d’une dizaine en français, en italien, et en polonais; et plusieurs articles en basque, bulgare, chinois, tchèque, allemand, grec, coréen, portugais, russe et turc. Nous avons également ajouté des textes en danois, néerlandais, japonais et kurde. Nous avons également publié des posters et des zines dans nombre de ces langues. Vous pouvez trouver un guide complet de notre contenu non-anglophone ici.
Nous avons récemment ajouté une version en turc de notre introduction à l’anarchisme, Pour tout changer. Elle est maintenant disponible dans 34 langues au total.
Nous sommes reconnaissant·es envers tou·tes les traducteurices partout dans le monde qui ont travaillé avec nous pour rendre notre travail accessible à davantage de monde. Si vous pouvez nous aider à traduire n’importe laquelle de nos publications dans n’importe quelle langue, n’hésitez pas à nous contacter!

Face-à-face entre la police et les manifestant·es à Lützerath, en Allemagne, en janvier 2023.
Films
En hommage à Alfredo Bonanno, nous avons réalisé un court-métrage adaptant la section finale de l’une de ses œuvres les plus connues, La Joie armée.
Nous avons également publié une courte vidéo pour célébrer Steal Something from Work Day, (« Fête du vol au travail », NdT), inspirée du travail du réalisateur yougoslave Dušan Makavejev.
Enfin, nous vous invitons à participer à notre tradition des fêtes en regardant l’édition de 2023 de “It’s the Most Wonderful Time of the Year”.
It’s the most wonderful time of the year, édition 2023.
Et plus encore !
Cet article ne fait qu’effleurer la surface de tout ce que nous avons fait cette année – les aventures dans lesquelles nous nous sommes embarqué·es, les relations que nous avons entretenues, les formes artistiques que nous avons partagé·es. Le plus intéressant est rarement rendu public !
Comme toujours, tous nos efforts sont libres de droits, produits et distribués bénévolement. Nous n’essayons pas de concentrer un pouvoir entre nos mains, mais d’établir des modèles reproductibles et de mettre des ressources à la disposition de mouvements horizontaux. C’est pour cela que l’on vous embête rarement avec des demandes de dons. Si vous voulez nous soutenir financièrement, vous pouvez le faire ici – mais la meilleure chose que vous puissiez faire pour nous, c’est lancer vos propres projets dans le même esprit, ou participer à nos efforts.
Merci de nous avoir suivi·es à nouveau à travers cette année. Nous avons hâte de voir ce qui nous attend.

-
Il s’avère que le 6 décembre est aussi l’anniversaire du meurtre d’Alexandros Grigoropoulos, déclencheur de la révolte grecque de 2008. On peut considérer que le déroulement de cette révolte est un argument en faveur de certaines thèses de Bonanno sur l’organisation agressive et les structures autonomes. ↩
26.11.2023 à 18:37
Retour vers le futur : Le retour de la droite ultralibérale en Argentine
CrimethInc. Ex-Workers Collective
Texte intégral (8290 mots)

La semaine dernière, l’extrême droite a remporté des victoires électorales aux Pays-Bas et en Argentine. La vague réactionnaire mondiale qui avait porté Donald Trump au pouvoir n’a pas pris fin avec sa défaite électorale en 2020, ni avec celle de Jair Bolsonaro au Brésil. Dans l’article ci-dessous, un·e anarchiste argentin·e analyse les raisons de la victoire électorale de Javier Milei et replace la ligne politique du nouveau président dans son contexte historique. Même si la rhétorique « anarcho-capitaliste » de Milei peut sembler nouvelle, ce n’est que le nouveau chapitre d’une très ancienne histoire argentine : l’alliance d’un capitalisme assassin et d’une violence d’État impitoyable.
Retour vers le futur
Javier Milei, nouveau président élu en Argentine, proposait dans sa campagne électorale d’abolir le peso argentin pour faire du dollar étasunien la monnaie nationale, d’éliminer la Banque centrale, de privatiser la santé et l’éducation, de privatiser ou fermer tous les médias publics, et de privatiser la majeure partie de l’infrastructure économique et stratégique du pays.
Le personnage et la ligne politique de Milei en auraient fait un excellent super-méchant dans une œuvre de fiction anarchiste ultra dramatique. Il y a peu, il se baladait encore dans un costume de super-héros noir et jaune en se surnommant « Capitaine Ancap ». Il dissertait en toute décontraction sur le marché libre, qui devrait selon lui réguler tous les aspects de la société – y compris la vente d’enfants et d’organes humains, ou la liberté de vendre un bras pour survivre – et affirmait qu’une personne forcée de choisir entre mourir de faim ou travailler 18 heures par jour est « bien sûr » libre, puisque c’est son choix. Lorsqu’il ne nous régalait pas de tels délices philosophiques, il apparaissait dans des émissions de débat où l’on pouvait le voir hurler comme un enragé contre les « merdes de gauchistes », le « Marxisme culturel », le mensonge du réchauffement climatique, etc.
La vice-présidente de Milei, Victoria Villaruel, n’est connue que pour sa défense virulente des chefs militaires emprisonnés pour la torture et la disparition de milliers de personnes, pendant la dernière dictature militaire des années 1970 en Argentine. Milei et elle réfutent tou·tes deux la véracité du chiffre, établi depuis longtemps, de 30 000 mort·es ou disparu·es. Milei nie publiquement l’existence du génocide systématique commis par la dictature, et qualifie uniquement ces actions d’« excès ». Ces « excès » ? Un réseau de centaines de centres de détention clandestins, des victimes jetées droguées mais vivantes dans le Rio de La Plata depuis des hélicoptères et plusieurs centaines de nouveaux-nés enlevé·es à des prisonnières accusées de subversion, pour les donner à des familles militaires.

Javier Milei en “Captain Ancap.”
Son entourage n’est pas plus glorieux. Il compte des masculinistes, des partisan·es de la théorie de la Terre plate, un soi-disant philosophe qui appelle à la privatisation des océans, etc.
En résumé, sa ligne politique est un cauchemar pour les anarchistes. Elle s’oppose également aux opinions d’une grande partie de la population argentine. On parle ici d’une société dotée d’un fort sens de la justice sociale, dans laquelle le courant dominant des deux dernières décennies a été le kirchnérisme, sorte de tendance péroniste progressiste de centre-gauche, née du soulèvement de 2001. À l’exception du mandat présidentiel de Mauricio Macri, de 2015 à 2019, l’Argentine a été gouvernée sans interruption par des gouvernements kirchnéristes depuis 2003. La première décennie de gouvernement kirchnériste a vraiment amélioré la qualité de vie de nombreux·ses Argentin·es, en réduisant à la fois les taux de chômage et de pauvreté et en maîtrisant l’inflation (du moins selon les standards argentins). Elle représentait un tournant à gauche à la fois dans le discours public et dans la politique gouvernementale, un changement majeur par rapport à l’hégémonie néolibérale des années 90.
Mais la seconde décennie de gouvernement kirchnériste a été un moindre succès, marquée par des scandales de corruption et l’un des confinements les plus longs au monde pour le COVID-19. Malgré une batterie de mesures économiques protectionnistes – limitation des importations, taxe des exportations, établissement de contrôles sur les devises et taux de changes variés pour le peso argentin – le peso a connu une dévaluation continue au cours de la dernière décennie. Cela a conduit à une forte inflation – plus de 100 % dans les 12 derniers mois – qui a plongé des millions de personnes sous le seuil de pauvreté. Au jour de l’élection, plus de 55 % des mineur·es et 40 % des Argentin·es vivaient officiellement dans la pauvreté.
Dans ce contexte, Milei a recueilli pratiquement 56 % des votes au second tour, après n’en avoir capté que 30 % au premier tour du 22 octobre.
Comment en est-on arrivé·es là ? Vers où allons-nous ? Et que faire ?

Affrontements devant le Congrès pendant le débat sur la réforme des retraites en 2017.
« Viva la Libertad ! » – Liberté de travailler ou mourir de faim, de se soumettre ou d’être tué·e
Au début, la plupart des gens percevaient Milei comme une nouveauté exotique – un économiste obscur devenu l’invité régulier des plateaux télé et des chaînes d’info en continu, augmentant l’audimat en vociférant contre la « caste politique », appelant à « assécher le marais », son visage tournant au rouge tomate quand il s’attaquait à « l’idéologie du genre ».
Ses apparitions télévisées lui ont assuré un fan club de jeunes hommes de la classe moyenne politiquement aliénés. Il leur offrait un moyen de canaliser leur ressentiment contre l’État-providence qui, selon eux, soutiendrait des hordes de feignant·es avec l’argent des impôts d’Argentin·es travailleur·ses. Contre les immigré·es qui, imaginent-ils, viendraient en Argentine profiter de l’éducation et de la santé publiques gratuites. Contre le politiquement correct, les intérêts mondialisés, le vaccin contre le COVID-19 et les quarantaines. Et, étrangement, contre la « domination socialiste » en Argentine, alors qu’il s’agit d’un pays capitaliste dont le gouvernement était, au mieux, de centre-gauche modéré.
Ces jeunes hommes se sont rassemblés en ligne, surtout autour de vidéos TikTok de Javier Milei et de l’alt-right brésilienne et étasunienne. Ils sont devenus les militants du jeune parti « La Libertad Avanza » lorsque Javier Milei a annoncé son intention de se présenter à l’élection du congrès en 2021. Les drapeaux jaunes de Gadsden et les casquettes « Make Argentina Great Again » (référence au slogan de Trump, NdT) ont alors commencé à apparaître dans ses meetings de campagne.

“Make Argentina Great Again.”
Milei a été élu au Congrès en misant sur un courant de ressentiment qui couvait au sein d’une catégorie spécifique de la population argentine – des hommes jeunes, urbains, de la classe moyenne, en mobilité sociale descendante. Mais à mesure que leur écosystème, leur influence et leur portée s’accroissaient, ces jeunes hommes sont devenus des éléments-clés du succès de l’extrême-droite pour capter le mécontentement social de la crise économique et politique en Argentine.
La raison de ce succès, c’est qu’à mesure que la vie s’appauvrit, la logique entrepreneuriale et la hustle culture (ou culture du burn-out, de la productivité toxique, NdT) s’infiltrent de plus en plus dans la société, en particulier chez les jeunes. La logique du capitalisme est de plus en plus considérée comme du bon sens. Si tu es pauvre, ce n’est pas à cause de raisons systémiques, mais simplement parce que tu ne travailles probablement pas assez. Si tu ne gagnes pas assez d’argent, ce n’est pas parce que les salaires sont trop bas, mais juste que tu dois travailler plus. Si tu veux changer de conditions de vies, si tu veux être « libre », tu ne devrais pas t’organiser avec les autres : tu devrais lancer ta propre entreprise, vendre des biens, aspirer non seulement à t’échapper de l’oppression du salariat, mais à avoir quelques salarié·es sous tes ordres un jour toi aussi. La liberté est un objectif purement individuel, un jeu à sommes nulles dans lequel tu dois exploiter les autres pour être libre toi-même.
À mesure que l’hégémonie capitaliste avance, le « collectivisme et le socialisme » sont blâmés pour les échecs du capitalisme. Le capitalisme progressiste et LGBT-friendly répond, dans son idéologie sinon dans sa pratique, aux luttes de certaines des personnes opprimées dans la société, tout en réduisant de nombreuses autres à une pauvreté écrasante. Dans ces conditions, la rage des chômeur·ses et travailleur·ses pauvres est facilement redirigée, non vers la classe capitaliste, mais vers un ressentiment envers des boucs émissaires désignés par l’extrême droite pseudo-libertarienne.
Vous avez certainement un sentiment de déjà-vu. Nul besoin d’une analyse poussée des événements du monde pour voir les ressemblances avec Trump aux États-Unis ou Bolsonaro au Brésil. Les similarités sont toutes tirées du guide de la Nouvelle droite fasciste. La politique victimaire, les guerres culturelles, les sous-entendus racistes, l’obsession clairement fasciste pour une nation humiliée, en quête d’un homme fort pour la guider face à ses nombreux ennemis, étrangers comme de l’intérieur. Et l’aspect paranoïaque : le socialisme serait partout, même chez des acteurices politiques qui ne pourraient pas en être plus éloigné·es. En Argentine, la vraie gauche, dominée par les trotskystes du Frente de Izquierda (« Front de Gauche », alliance électorale composée de 4 partis trotskystes distincts), n’a rassemblé que 3 % des votes aux dernières élections. Cela montre à quel point la gauche a échoué à se présenter comme une alternative crédible, même dans un contexte de mécontentement populaire massif et de méfiance envers la classe politique.
Milei et ses « libertariens » ont réussi à confondre dans les esprits les mouvements sociaux radicaux de gauche et le gouvernement kirchnériste de centre-gauche, tout comme Trump avait réussi à associer « antifa » et Démocrates dans les esprits de ses soutiens. Partant de là, la guerre culturelle était facile. Les socialistes veulent un État orwellien qui contrôlerait et oppresserait les travailleur·ses exemplaires du pays ; des hordes feignantes et violentes vivent des aides sociales tandis que des bon·nes travailleur·ses souffrent sous le poids des taxes ; et tout ceci, au service d’une classe sociale corrompue qui s’accroche au pouvoir.
Seule, cette catégorie de la population représentait 30 % des votes au premier tour des élections en octobre – bien plus que le maximum estimé de 15 % environ, mais pas suffisant pour atteindre le pouvoir. C’est là que l’on retrouve une autre ressemblance frappante avec le trumpisme étasunien. L’ancien président, Mauricio Macri, et son ancienne ministre de la Défense, Patricia Bullrich (arrivée 3e aux élections avec 23 % des votes) ont immédiatement offert leur soutien à Javier Milei au second tour. Leur électorat n’est ni le vote jeune, ni celui qui veut changer le système en profondeur, mais plutôt le vote classique anti-péroniste et anti-kirchnériste de l’oligarchie et de la classe supérieure argentine. Comme les Républicain·es traditionnellement conservateurices face au succès de Trump, iels ont immédiatement abandonné leur critique sévère de Javier Milei pour sauter sur l’occasion de revenir au pouvoir avec et derrière lui.

Même si des personnes comme Mauricio Macri et Patricia Bullrich peuvent réprouver l’extravagance de Milei et s’étouffer face à la vulgarité des manières de l’homme, qui faisait la tournée des meetings avec une tronçonneuse en guise de métaphore dramatique de sa volonté de couper les dépenses publiques, la ligne politique de Milei est incontestablement celle de leurs rêves absolus. Cette partie de l’électorat a toujours rêvé de privatiser l’industrie, d’utiliser l’État pour servir les intérêts du capital, de le réduire à des fonctions de répression pour discipliner la société. Iels manquaient simplement du capital politique nécessaire pour pouvoir insinuer que telles étaient leurs intentions sans se condamner politiquement.
À présent, au lendemain des élections, les postes-clés de l’administration Milei à venir ont été confiés aux ancien·nes ministres et économistes du désastreux gouvernement Macri. Nestor Kirchner avait enfin libéré l’Argentine du poids de la dette du FMI, Macri a emprunté la plus large somme de toute l’histoire du FMI en 2018. La majeure partie a été utilisée, non pour financer des projets d’infrastructure ou pour renforcer l’économie, mais pour distribuer des paiements aux capitalistes. Une partie a été illégalement dirigée hors du pays.
La promesse de campagne « d’assécher le marais » a déjà été oublié avant même que Milei ne prête serment. Les noms des nouvelleaux ministres et consultant·es sont un vrai bottin mondain des politicien·nes de droite discrédité·es du dernier quart de siècle.

Il y a des différences entre le trumpisme et le phénomène ultralibéral en Argentine. Dans une certaine mesure, Trump était protectionniste dans le domaine économique, alors que Milei est un fervent et dogmatique partisan du libre marché. Trump est clairement un opportuniste, une sorte de coquille vide. Milei croit réellement au modèle le plus réactionnaire, le plus vil, le plus anachronique du capitalisme que l’on puisse imaginer aujourd’hui. Cette idéologie l’a conduit à déclarer – ouvertement, clairement et de façon répétée – qu’il n’existe pas de droit à l’éducation ou à la santé, que si quelque chose n’est pas profitable dans le contexte du marché, elle n’est pas nécessaire et ne devrait pas exister. Les routes devraient être privatisées et les organes vitaux devraient être un bien sur le marché. Milei a beau parler « d’anarchisme », son bras droit est une fervente défenseuse de l’armée argentine et de son passé criminel, dont le plan pour gérer les mouvements sociaux est de faire usage d’une violence ouverte.
La différence-clé entre le trumpisme et le phénomène Milei, c’est l’âge de leurs soutiens. Même s’il promeut un modèle économique qui ramènerait l’Argentine au 19e siècle, Milei a étrangement réussi à faire passer ses idées et sa personne comme nouvelles, de rebelles. Exception faite de quelques poches jeunes radicalisées, la base électorale de Trump est généralement plus âgée, rurale et isolée, alors que la majorité des moins de 30 ans s’opposent fermement à lui. À l’inverse, Javier Milei a fait son chemin dans les quartiers populaires et chez les travailleur·ses pauvres ; il s’est construit un électorat jeune grâce à ses discours agités et l’image de ses partisan·es, « non des moutons à guider, mais des lions à réveiller », sa domination de TikTok et des nouveaux réseaux sociaux.
En conséquence, les définitions les plus largement répandues de la liberté et de la rébellion, chez les adolescent·es et vingtenaires en Argentine aujourd’hui, sont non seulement diamétralement opposées à nos valeurs de solidarité et d’entraide, mais elles cooptent notre vocabulaire, s’appropriant ouvertement les termes « anarchiste » et « libertarien ». Derrière ces mots, on trouve la version la plus rance du « libertarianisme » et du capitalisme ultralibéral. C’est la société vue par l’entrepreneur-influenceur TikTok.
Malgré leurs différences, Bolsonaro, Trump et Milei sont de fidèles alliés. Bolsonaro est attendu à l’inauguration de Milei, et Trump a récemment annoncé son intention de lui rendre visite en Argentine. Ensemble, les trois forment l’avant-garde d’une internationale proto-fasciste en cours de création. Malgré le mélange fatigué de xénophobie, de répression et d’austérité capitaliste proposée par leur modèle, cette résurgence de l’extrême-droite s’est positionnée avec succès comme une nouvelle alternative à la politique à la papa, au moins en Argentine. Conséquence de de l’échec du centre-gauche à améliorer la vie quotidienne et de l’incorporation de nombreux·ses acteurices du mouvement social post-2001 dans l’appareil d’État, l’alternative ultralibérale a réussi à se présenter comme l’expression d’une rébellion de la jeunesse.
Pour reprendre les mots d’un communiqué publié après les élections par certaines organisations anarchistes en Argentine :
Pour qu’une option politique d’extrême droite ait pris cette ampleur, c’est que la défaite est culturelle, idéologique et couve depuis longtemps – à commencer par le « retrait » de beaucoup de projets émancipateurs, sans parler des projets progressistes, dans la majorité des quartiers populaires et des syndicats ; l’absence d’une vision concrète pour lutter contre le système capitaliste, et d’un projet révolutionnaire déterminé à s’opposer à la machine à appauvrir la société qu’est le néolibéralisme. Un processus dans lequel l’État a progressivement incorporé et institutionnalisé de nombreux outils et pratiques du peuple, ramenant toute action politique dans son camp et transformant l’isoloir en seul horizon d’action politique. Ce vide laissé par l’absence de rébellion, de présence contestataire, de lutte sociale, a été rempli par la rhétorique pseudo-fasciste et ultralibérale d’une poignée d’économistes et d’éléments réactionnaires.

Affrontements devant le congrès pendant le débat sur la réforme des retraites en 2017.
L’Histoire se répète à nouveau
Même si Milei a revu le packaging et le marketing, ses idées ne diffèrent guère de l’ultralibéralisme classique. Ironie du sort, s’il y a bien un endroit au monde où de telles expériences ultralibérales ont déjà été tentées, c’est en Argentine.
Le mouvement péroniste émerge en 1940 autour de la figure du général Juan Domingo Perón. Il mélange projet économique capitaliste protectionniste, fort État-providence et rhétorique de « justice sociale. » Des décennies d’antagonisme entre le péronisme, souvent allié aux forces de gauche, et l’oligarchie et l’armée argentines, culminent avec le coup d’État militaire de 1976, le sixième coup d’État en Argentine au 20e siècle.
La junte militaire lance alors la célèbre guerre sale, contre ce qui restait des organisations de guérilla armée dans le pays : l’aile gauche péroniste des « Montoneros » et l’Armée révolutionnaire du peuple, trotskyste. Fin 1975, les deux organisations sont déjà largement défaites et démantelées, et avec elles toute autre personne considérée comme « subversive », même de loin. Main dans la main avec le FMI, qui vient de fournir ce qui était à l’époque le plus gros emprunt de l’Histoire accordé à un pays latino-américain et qui exige, en retour, des réformes économiques néolibérales, la junte impose la première vague de réformes néolibérales dans le pays. Elle détruit les politiques protectionnistes de Perón, supprimant les droits de douane sur les imports et décimant l’industrie nationale, tout en éliminant toute taxe ou restriction sur les exports. En même temps, elle supprime l’encadrement des loyers, annule toutes les subventions accordées aux transports publics et attaque les syndicats et les droits à la négociation collective.
Les résultats sont désastreux pour la majorité de la société argentine. Les travailleur·ses subissent les effets les plus brutaux d’années d’inflation à trois chiffres par an, conséquence d’une dette étrangère en augmentation constante. En 1982, une junte impopulaire lance le pays dans une guerre avec la Grande-Bretagne pour les îles malouines, dans un effort désespéré pour détourner l’attention des problèmes intérieurs, sacrifiant encore environ un millier de vies avant le retour à la démocratie capitaliste en 1983.
Mais le poids de la dette écrasante du FMI s’avère impossible à supporter. Les années 1980 sont une décennie de taux astronomiques d’inflation annuelle, généralement dans les 400 à 600 %. En 1989, l’inflation jette 47 % du pays sous le seuil de pauvreté. Puis, une vague de superinflation – 200 % en un mois – conduit à des pillages généralisés et des affrontements qui laissent derrière eux plus de 40 mort·es.
Arrive alors 1991, dans la vague de la chute du mur de Berlin et du bloc de l’Est. Francis Fukuyama déclare « la fin de l’Histoire », le triomphe du capitalisme néolibéral comme le meilleur et le seul monde possible. L’Argentine met fin à l’inflation en utilisant la « convertibilité », qui lie artificiellement le peso argentin au dollar à un taux de change de un-pour-un. Cette politique est financée par un nouveau prêt du FMI, cette fois de l’ordre d’un milliard de dollars US – l’un des nombreux prêts du FMI à l’Argentine au cours des années 1990. Dans le même temps, le nouveau président élu, Carlos Menem, lance une nouvelle vague sans précédent de réformes néolibérales, centrées sur la privatisation de l’industrie, le relâchement ou la suppression des contrôles à l’import, la restructuration de l’État et la dérégulation de l’économie. Les entreprises privées et la loi du marché sont à l’ordre du jour – et effectivement, les premières années sont celles d’une relative stabilité et prospérité. Pour la première fois depuis des décennies, l’inflation est sous contrôle, l’afflux de devises fraîches dans les coffres de l’État permet quelques coupes dans les taxes et les améliorations initiales dans le commerce et l’infrastructure, via les investissements étrangers, couplées à l’absence de droits de douane, apportent emplois, augmentation de salaires et biens peu chers dans le pays.
Mais c’était une bulle spéculative. Incapables de tenir la compétition à l’international, les petites entreprises et usines commencent à fermer. Les investisseurs étrangers, qui avaient mis la main sur les infrastructures publiques, commencent à tenter de stabiliser leurs profits et ne ré-investissent pas. Sans surprise, cela conduit à la détérioration rapide des services publiques, surtout le transport. La balance du commerce extérieur, dans laquelle les dollars quittent le pays plus rapidement qu’ils n’y entrent, rend l’échange en un-pour-un de moins en moins viable. Alors que de plus en plus de gens perdent leur travail, le milieu et la fin des années 90 voient émerger une résistance ouverte aux fermetures d’usines, ouvrant la voie au mouvement des travailleur·ses au chômage, connu sous le nom de piqueteros – célèbres pour leur utilisation des blocages de routes comme démonstration de force et outil symbolique pour attirer l’attention sur leur lutte.
Tout ceci culmine en décembre 2001. Après une course vers les banques provoquée par la rumeur d’une dévaluation du peso argentin, le ministre de l’Économie d’alors, Domingo Cavallo, impose ce qui sera connu plus tard sous le nom de corralito, limitant le retrait d’argent liquide en banque à 200 dollars par semaine. Cela déclenche une crise au sein de la classe moyenne, combinée à une vague de mécontentement au sein des classes populaires argentines, les plus durement touchées par un taux de chômage de plus de 20 % et de pauvreté de plus de 40 %. Le 19 décembre 2001, des pillages généralisés éclatent dans plusieurs villes du pays, majoritairement dans la région de Buenos Aires. En réaction, cette nuit-là, le président De la Rua déclare l’état d’urgence – le premier dans le pays depuis 1989. Des dizaines de milliers de personnes se rassemblent immédiatement sur la Plaza de Mayo, devant le palais présidentiel, tandis que des centaines de milliers d’autres sortent sur leurs balcons en solidarité pour frapper leurs casseroles dans une cacophonie rebelle sans fin. La police lance une forte répression ; après des heures de bataille rangée, elle réussit à évacuer la place et disperser les manifestant·es.
Cela aurait pu en rester là, si la nuit de l’état d’urgence n’avait pas été un mercredi. Comme l’explique l’un.e des témoins1 :
La fortune sourit aux audacieux. Comment sinon expliquer que le matin après la féroce répression ait été un jeudi ? Jeudi. Le jour de la semaine pendant lequel, depuis les temps les plus sombres de la dictature en 1977, les mères et grands-mères des personnes enlevées et disparues aux mains de la junte militaire se rassemblent en des vigiles pour réclamer la justice pour leurs enfants. Chaque. Jeudi. À ma connaissance, sans exception, pluie ou soleil, elles sont là avec leurs foulards blancs, marchant dans un silence digne, de défiance, devant le palais présidentiel, sur la Plaza de Mayo.
Donc, le jeudi 20 décembre au matin, un peu après 10 heures, les Mères de la Plaza de Mayo arrivèrent sur la place. C’était cinq heures environ après qu’un calme tendu soit retombé sur Buenos Aires, après que la police eût finalement réussi à disperser les dizaines de milliers de personnes dans les rues – mais apparemment, pas avant que la foule ne réussisse plusieurs tentatives de rentrer dans le Congrès. Cette nuit aurait pu être le début de la fin de la « Bataille de Buenos Aires. »
Mais au cours de la matinée, des tentatives dispersées avaient déjà été tentées pour reprendre la place, ou au moins pour se rassembler à nouveau face à l’interdiction des rassemblements publics. À la TV, un jeune homme implorait les gens de descendre, de ne pas aller au travail, de prendre une journée, une heure, un moment pour aider à changer le cours de l’Histoire. Mais lorsque les Mères arrivèrent, il n’y avait probablement pas plus d’une ou deux cents personnes présentes.
Peu après leur arrivée, la police reçu l’ordre de disperser les quelques dizaines de Mères et la centaine de soutiens présents. Des femmes âgées, la plupart de 70 ou 80 ans, firent face avec bravoure aux charges et aux fouets de la police montée. De petites dames âgées, à l’air frêle mais porteuse de décennies de courage et de résolution inébranlables, face à la violence sans bornes d’un gouvernement à l’agonie. Armées seulement de leur dignité. Le pays regardait cela en direct à la télévision.
Je ne sais pas si le soulèvement argentin avait besoin d’une autre étincelle, ou si le feu était déjà hors de contrôle à ce moment-là. On ne le saura jamais. Mais je sais que l’impact de ces scènes était incalculable. Si une étincelle finale avait manqué, alors ces scènes l’ont allumée. Elles étaient aussi – et je suis sûr·e que des milliers de personnes partagent cette expérience avec moi – les dernières images que j’aie vues avant de me rendre moi-même en centre-ville.
Ce jour-là, le 20 décembre 2021, les jeunes, la classe ouvrière et les chômeur·ses de l’Argentine assiègent le palais présidentiel, avec des dizaines de milliers de personnes « jeunes et vieilles, se lançant face aux balles et au gaz, sans savoir si les balles tirées sur elles seraient de caoutchouc ou de plomb. »2
À la fin de la journée, malgré une répression meurtrière qui tua 39 personnes en deux jours, nous avions forcé le président à démissionner et le regardions fuir le palais en hélicoptère. Il semblait, à l’époque, que ce soit le point final de l’expérience néolibérale en Argentine, et une leçon sur la relation intrinsèque entre les politiques ultralibérales et la répression, un exemple du coût énorme en vies humaines des deux expériences néolibérales.
Nous pensions que cela servirait à vacciner l’Argentine contre le retour du néolibéralisme pour des générations. Le temps nous a donné tort.

Le président Fernando De la Rua fuit le palais présidentiel dans un hélicoptère posé sur le toit, dans l’après-midi du 20 décembre 2001.
Les Ultralibéraux, l’armée, et la répression : une histoire d’amour
La présidence Milei ne commencera pas avant le 10 décembre, mais les promesses non tenues s’accumulent déjà. De coupes budgétaires et d’une austérité payée « par la classe politique », on est déjà passé·es à « ce sera six mois extrêmement durs pour tout le monde. » Il a déjà annoncé la possibilité de ne pas payer les primes de fin d’année des fonctionnaires. Il avait assuré une solution immédiate à l’inflation ; à présent, « ça prendra 18 à 24 mois. » Finalement, dans un clin d’œil à la promesse de Trump « d’assécher le marais », la caste politique qu’il vilipendait l’entoure désormais et occupe les postes gouvernementaux – y compris les personnes responsables des désastres économiques et sociaux des années 1990 et du gouvernement Macri.
Par d’autres aspects, en revanche, Milei a été très clair : il gouvernera aussi près de son idéologie que l’équilibre des pouvoirs dans les branches du gouvernement et dans la rue le lui permettront. Le lendemain de son élection, il annonçait son intention réelle de vendre ou fermer tous les médias publics et de suspendre tous les projets d’infrastructure publics. Sans surprise, on assiste déjà à une campagne de propagande dans les médias privés pour monter les travailleur·ses du secteur privé et la société toute entière contre les fonctionnaires et les employé·es des chaînes médiatiques publiques. Les médias privés publient des chiffres de salaires faux et gonflés, et prétendent que les fonctionnaires veulent préserver « leurs privilèges aux dépends de la société ». Non contents de l’insécurité née des conflits entre pauvres qui apparaissent dans nos quartiers, ces réactionnaires tentent désormais de façon concertée de provoquer un cannibalisme social, dans lequel les travailleur·ses qui ont toujours accès à la sécurité de l’emploi et à la couverture sociale qui va avec sont présenté·es comme des privilégié·es, qui profitent aux dépends des autres.
Alors que la résistance se prépare déjà contre les licenciements, privatisations et l’austérité à venir – avec des appels à assemblées générales ouvertes lancés par les travailleur·ses, syndicats et organisations sociales pour discuter de la situation et commencer à organiser la résistance – la symbiose entre les réformes ultralibérales, les médias privés et l’appareil répressif de l’État devient évidente. Beaucoup, dans les médias, avertissent contre un danger de « coup d’État » en référence à la possible agitation sociale qui pourrait renverser le gouvernement Milei. Cette rhétorique a pour but de confondre révolte populaire et saisie militaire du pouvoir.
En même temps, l’ancien président Mauricio Macri encourage, à la télévision, les jeunes partisans de Milei à attaquer celleux qui pourraient prendre la rue contre les licenciements et les coupes budgétaires. Dégoulinant de classisme et de racisme, il suggère que « les orcs », son surnom pour les travailleur·ses sans emploi et autres piqueteros, « devraient réfléchir à deux fois à ce qu’ils font dans les rues, car les jeunes ne vont pas les laisser leur voler cette opportunité de changer le pays. » Le vocabulaire, Macri nous qualifiant « d’orcs » et Milei de « merdes de gauchistes », d’obstacles au changement et à un « meilleur futur pour les meilleur·es des Argentin·es », n’est pas seulement le reflet du classisme et du racisme de la classe moyenne supérieure et de l’oligarchie argentines. C’est un outil conçu et utilisé en toute conscience pour commencer à stigmatiser et ostraciser la résistance populaire, afin d’immuniser la plus grande partie possible de la société contre les mouvements sociaux lorsque l’affrontement commencera.

Combats devant le Congrès pendant le débat de 2017 sur la réforme des retraites.
Moins d’une semaine après l’élection, la première apparition publique de la vice-présidente de Milei, Victoria Villaruel, était consacrée à la visite d’un local de la police, où elle est apparue flanquée d’officiers, disant vouloir leur accorder plus de fonds et d’équipement. En parallèle, le camp Milei annonce déjà qu’iels essayeront de modifier la loi de défense nationale pour permettre à nouveau l’utilisation de l’armée à des fins de sécurité intérieure, y compris contre les « terroristes. » Le message est clair pour les anarchistes, la gauche, et toute autre personne qui envisagerait de prendre la rue pour s’opposer au nouveau gouvernement : nous serons qualifié·es de terroristes. À partir de là, il ne faudra pas attendre longtemps avant que la célèbre armée argentine ne soit à nouveau lâchée contre toute chose ou personne qui pourrait avoir la malchance d’être qualifié·e de « subversive. »
Ce n’est pas une coïncidence si la vice-présidente de Milei est Victoria Villaruel, défenseuse fanatique des membres de l’armée condamnés pour crimes contre l’humanité commis pendant la dernière dictature. L’armée, et l’appareil répressif de l’État en général, sont des éléments essentiels du projet ultralibéral, en particulier dans des pays avec des réseaux de résistance bien développés, comme l’Argentine. Malgré tous leurs discours sur « l’anarcho-capitalisme », oxymore ridicule, l’ultralibéralisme constitue un dégraissage de l’État pour que celui-ci défende mieux les intérêts de la propriété et de la classe capitaliste. C’est l’État se débarrassant du bagage du système de protection sociale, des programmes sociaux et de toute responsabilité concernant la masse de la société. C’est une transformation de l’État capitaliste en sa forme la plus obscène et crue : un instrument pour préserver la société de classes et discipliner tout·es celleux qui s’y opposent.
Ce n’est pas une coïncidence si Milei a refusé de répondre à un·e journaliste qui lui demandait franchement s’il croyait en la démocratie. Le projet ultralibéral place le marché au-dessus de tout ; il considère que la propriété, le capital et l’exploitation sont les seuls droits inaliénables. De ce point de vue, « l’immaturité » et les « caprices » de la société – même dans la forme la plus ancrée dans le modèle de la démocratie représentative capitaliste, comme voter pour retirer leur poste à des politicien·nes, ou rejeter leur politique au Parlement – ne sont que des obstacles à franchir. Cet état d’esprit est résumé au mieux par la phrase d’Henry Kissinger sur le Chili des années 1970 : « Les problèmes sont trop importants pour laisser les électeurs chiliens décider par eux-mêmes. »
Ce n’est pas une coïncidence si c’est précisément au Chili qu’a eu lieu l’autre expérience ultralibérale principale en Amérique latine, main dans la main avec la dictature Pinochet et avec le soutien matériel des États-Unis. Au Chili, les « Chicago Boys », un groupe d’économistes chiliens éduqués à l’université de Chicago et adhérant aux idées de Milton Friedman (révéré par Javier Milei), ont pu mettre en place une batterie de réformes néolibérales. La condition préalable et indispensable à la mise en place de ces réformes, c’était une junte militaire qui a tué et fait disparaître des dissident·es par milliers, tout comme en Argentine. Les conséquences durables de plusieurs de ces réformes (comme les privatisations des retraites, des systèmes de bourse pour l’école ou l’université, et des transports publics) ont déclenché la révolte chilienne de 2019.
La liberté pour le marché est nécessairement synonyme d’exploitation des travailleur·ses et de misère pour la majorité de la société. L’histoire de ce pays le prouve. Quand cet état de fait finit immanquablement par créer suffisamment de résistance populaire, la seule manière de le maintenir est alors la force brute de l’État. Malgré la rhétorique creuse de Milei et Villaruel sur la liberté, ce sont les héritier·es des politiques de Pinochet et des Chicago Boys, de Martinez de Hoz pendant la dictature argentine, et du néolibéralisme des années 1990 qui a volé 38 vies en une semaine avant de céder le pouvoir. Chouchouter les forces de sécurité de l’État et minimiser les crimes de la dictature argentine ne sont pas seulement des manœuvres dans une guerre culturelle. Iels savent aussi bien que nous que tôt ou tard, l’ultralibéralisme ne peut être imposé que par la répression et la violence – et iels ont bien l’intention d’en user à nouveau.

Barricades autour du palais présidentiel le 20 décembre 2001.
Les « Forces du Paradis » contre les Orcs
Aujourd’hui, beaucoup d’entre nous ont peur. Inutile de tenter de le cacher. Beaucoup d’entre nous n’ont pas envie de se battre. Peut-être parce qu’à présent, pour la première fois depuis des décennies, nous nous retrouvons uniquement sur la défensive. Nous combattons sur plusieurs fronts, dont celui pour la mémoire collective de la dernière dictature, que nous pensions avoir remporté pour toujours depuis des années. Nous combattons même sur d’autres fronts que nous pensions avoir conquis il y a un siècle, comme celui pour l’éducation et la santé publiques.
Avant, je souriais sous le masque, me réjouissant d’affronter en face les gardiens de l’État. Maintenant, je joue mon rôle dans les assemblées et les affrontements avec regret, parfaitement conscient·e du nombre de vies perdues aux mains de la répression la dernière fois. Peut-être parce que celleux de ma génération sont plus âgé·es maintenant. Nous avons plus à perdre. La vie nous a appris la peur qui était absente dans les combats de notre jeunesse.
Ou peut-être que nous avons peur parce qu’en 2001, lorsque la dernière expérience néolibérale en Argentine a atteint son apogée désastreuse, avec un taux de pauvreté de 50 %, et que la fureur des dépossédé·es culminait en pillages généralisés et en siège du palais présidentiel, c’était nous – les jeunes – qui étions au premier rang des combats. Aujourd’hui, dans un retournement de situation qui nous donne l’impression d’être bien plus âgé·es que nous ne le sommes, une large partie de la jeunesse est justement derrière Milei et le nouveau gouvernement ultralibéral.
C’est un nouvel exemple de l’échec du progressisme et de la gauche de gouvernement, qui ont échoué à attaquer le capitalisme à la racine. En Argentine, après le soulèvement de 2001, elle a échoué à donner le coup fatal lorsque la bête était déjà blessée, discréditée et à son plus faible. À la place, la gauche de gouvernement a tenté de l’apprivoiser et de la gouverner. Ce processus a intégré des centaines, sinon des milliers de militant·es et combattant·es des années 1990 et du soulèvement de 2001 dans la machine étatique. Oui, l’État a pris une apparence progressiste, en légalisant le mariage gay, en s’attaquant à l’oligarchie rurale, en défiant les monopoles médiatiques privés, en libérant enfin le pays de la dette du FMI et en plaçant même les termes « redistribution des richesses » dans le débat public. Mais associer la gauche à l’État et à la situation financière désastreuse a ouvert la voie à la victoire actuelle de l’extrême droite ultralibérale.
Peut-être sommes-nous condamné·es à un cycle sans fin, dans lequel chaque génération doit réapprendre les douloureuses leçons du passé. Si l’on se rappelle que cette génération n’a pas connu grand-chose d’autre qu’une pauvreté à 40 %, une inflation annuelle à 3 chiffres, l’érosion de la qualité de la santé et de l’éducation publiques, la corruption grotesque d’une classe politique qui prêche la justice sociale et la redistribution des richesses tout en partant en vacances sur des yachts en Méditerranée… Peut-on leur reprocher de se tourner avec désespoir vers un homme qui leur promet d’être « libres » de tout ça ? Ça n’a aucun sens d’avertir le chauffeur Uber ou le gamin qui livre pour Rappi qu’ils perdront leur couverture sociale ou leurs droits à congés payés, alors qu’ils n’ont aucun des deux. Mais l’alternative qu’ils appellent de leurs vœux est encore pire.
Les événements des prochains mois dépendront de plusieurs facteurs. Les syndicats bureaucratiques majoritaires se retireront-ils de la lutte pour tenter de plier devant l’orage, ou soutiendront-ils leurs travailleur·ses face aux licenciements ? Se mobiliseront-ils en solidarité avec les chômeur·ses, appelleront-ils à une grève générale si Milei tente de réformer la loi travail ou les lois de négociation collective ? Les gens se mobiliseront-ils pour défendre les institutions et les entreprises publiques ? Est-ce que l’extrême droite réussira à mobiliser efficacement les politiques de guerre culturelle pour décourager toute solidarité avec les personnes les plus opprimées et vulnérables du pays ?
Même si Milei peut compter sur le solide soutien de sa base de jeunes fanatiques et des classes moyennes et supérieures fortement anti-kirchnéristes et anti-péroniste, une grande partie de son électorat est constitué de chômeur·ses et de travailleur·ses pauvres. Ces personnes ont voté pour lui à cause d’un espoir, placé en de mauvaises mains mais sincère : celui qu’il pourrait vraiment améliorer leurs vies. Iels n’ont pas de lien idéologique avec son ultralibéralisme et ne sont pas en position d’attendre patiemment six mois que les choses « s’aggravent avant d’aller mieux. » Si l’inflation devient hors de contrôle et que le poids de l’austérité et des coupes budgétaires tombe seulement sur les épaules des Argentin·es les plus vulnérables, le conflit social pourrait à nouveau se répandre.
Les mouvements sociaux argentins sont actuellement démoralisés. Le camp anarchiste, malgré les efforts louables de générations de militant·es, est actuellement faible en nombre et la présence d’anarchistes dans les mouvements sociaux est marginale. Même si le mouvement conserve certains lieux et qu’il existe des initiatives pour commencer à mettre en place une présence anarchiste plus cohérente et plus visible, nous ne sommes pas beaucoup plus qu’un souvenir de ce qui fut un jour l’un des mouvements anarchistes les plus puissants au monde.
Mais nous devrions tout·es être parfaitement conscient·es que l’Histoire ne tend pas vers la libération comme par magie. Ce n’est pas parce que nous avons vaincu les forces du néolibéralisme avant qu’elles sont destinées à tomber à nouveau. L’Histoire sera ce que nous en faisons. Rien de plus, rien de moins. La défaite des politiques ultralibérales – au 19e siècle, sous Pinochet, sous la dernière dictature, ou en 2001 – s’est toujours faite au prix d’immenses luttes, de sacrifices et de vies perdues.
La dernière expérience néolibérale en Argentine a déclenché la pire crise économique et sociale dans l’histoire du pays. Avant le soulèvement de décembre 2001, les révolutionnaires, les organisateurices et, oui, les anarchistes – même peu nombreux·ses à l’époque – ont travaillé pendant des années. C’est-à-dire, construire des organisations de chômeur·ses indépendant·es des syndicats majoritaires et des partis politiques. Tenir des assemblées générales au travail, dans les écoles, dans les universités. Faire preuve de solidarité, apporter une aide matérielle là où l’on a besoin de nous. Tout cela devra être fait à nouveau.
Camarades, les jours qui s’annoncent exigeront de nous que nous redoublions nos efforts et travaillions à l’unité la plus large des organisations populaires, dans le contexte d’une stratégie de lutte populaire dans les rues. […] Il nous faut dépasser la division et l’individualisme qui ont créé le contexte qui a porté ce personnage au pouvoir. Il est inutile de prêcher les convaincu·es. Il est de notre devoir de parler à chaque collègue au travail, à chaque voisin·e, toujours dans une perspective de lutte et d’organisation sur le terrain.
-« Y Ahora Que Pasa ? » Communiqué joint publié le 21 novembre 2023 par la Federacion Anarquista Rosario, l’Organización Anarquista Tucumán, l’Organización Anarquista Cordoba, et l’Organización Anarquista Santa Cruz.
Un jour viendra, comme en 2001, où il faudra reprendre les rues – en tant que personnes jeunes et âgées, que travailleur·ses, qu’étudiant·es, en tant que membres divers d’une société, en solidarité entre eux, qui en ont marre de la classe capitaliste et de ses politicien·nes. Au cri de “Que se vayan todos,” notre rage collective les a vaincus en seulement 48 heures, en décembre 2001.
Espérons qu’au moment venu, nous le ferons à nouveau.

Affrontements dans les environs du Palais présidentiel, le 20 décembre 2001.
03.11.2023 à 12:07
Stratégies de solidarité avec les Palestinien·nes : élargir la boîte à outils : Des revendications à l’action directe
CrimethInc. Ex-Workers Collective
Texte intégral (4889 mots)

À Atlanta, en Géorgie, des écologistes et des militant·es pour l’abolition de la police se sont battu·es pendant plus de trois ans pour mettre fin à la construction d’un centre de militarisation de la police connu son le nom de Cop City. La même police qui cherche à écraser ce mouvement s’est entraînée pendant des dizaines d’années avec la police israélienne, avec laquelle elle a pu échanger des stratégies létales de contre-insurrection. Dans le texte qui suit, des membres d’un collectif juif qui a participé à la lutte de Stop Cop City expliquent les raisons de leur engagement dans la solidarité avec les Palestinien·nes, et ce qu’il est nécessaire de faire pour mettre fin à l’attaque sur Gaza.
Fayer, un collectif d’anarchistes juif·ves, a participé à la lutte contre Cop City depuis ses débuts et a fait face aux fascistes dans toute la région.
Pour nous, la lutte contre le fascisme n’est pas une question d’« alliance » ; c’est un combat direct et personnel pour nos vies. Le savoir a mis le feu à nos cœurs, en tant qu’anarchistes et en tant que Juif·ves.
– Collectif Fayer, Finding Our Own Fire
Aujourd’hui, iels cherchent à mettre fin au bain de sang à Gaza. Selon leurs propres mots :
Fayer est un collectif d’artistes, de révolutionnaires, de travailleur·ses, d’étudiant·es, de criminel·les, et d’amoureux·ses qui se battent pour la terre, la vie bonne, et la libération totale. Les membres du collectif participent au mouvement pour la défense de la forêt d’Atlanta depuis sa création, et organisent des activités religieuses au sein de la forêt telles que des dîners de Shabbat, des rassemblements pour Souccot, la fête de Pourim, entre autres fêtes juives. Iels participent ainsi à faire exister un lien spirituel entre la communauté juive radicale d’Atlanta et la forêt de Weelaunee qu’elle cherche à défendre. Avec la reprise des attaques sionistes contre Gaza et le peuple palestinien, qui sont soutenues par le Georgia International Law Enforcement Exchange Program1 installé à Atlanta, nous nous sommes retrouvé·es dans la situation unique d’être proches des rouages de la machine et de sa violence locale, tout en étant éloigné·es de sa campagne génocidaire impitoyable. C’est pourquoi nous avons décidé qu’il était impératif d’exposer la situation depuis notre point de vue, ainsi que ce qu’elle implique pour la lutte de la forêt d’Atlanta et la libération palestinienne.
Le collectif Fayer traite ici des manifestations appelant à un cessez-le-feu à Gaza et affirmer que les mouvements de solidarité doivent cesser d’être simplement revendicatifs pour passer à l’action directe, tout en proposant quelques modèles pour s’organiser.
Le cessez-le-feu à Gaza commence ici
Dans les semaines qui ont suivi la déclaration de guerre d’Israël à la Palestine, des personnes du monde entier ont participé à des manifestations contre les frappes aériennes israéliennes à Gaza. La plupart des grandes manifestations ont eu lieu en Europe et aux États-Unis. 70 000 personnes sont descendues dans la rue à Londres samedi dernier pour demander la fin des frappes israéliennes et de la fourniture d’armes à Israël. À Berlin (où les manifestations pro-palestiennes sont maintenant interdites), des manifestant·es ont affronté la police, qui a utilisé des gaz lacrymogènes, des canons à eau et la force contre elles et eux. Des manifestations en soutien à la Palestine ont également eu lieu dans la plupart des grandes villes étasuniennes. À Chicago, 25 000 personnes se sont réunies le 21 octobre. Pendant trois week-ends consécutifs, le Mouvement de la jeunesse palestinienne a appelé à des manifestations à Atlanta qui ont rassemblé plus de 1 000 personnes dans les rues pour exiger la fin de l’occupation israélienne et du bombardement génocidaire de Gaza.
Au jeudi 2 novembre, l’armée israélienne avait tué 9 193 Palestinien·nes et en avait blessé au moins 32 000. Au moins la moitié des mort·es étaient des civil·es non-combattant·es, dont au moins 3 760 enfants palestinien·nes.
Le soutien populaire pour les Palestinien·nes n’a jamais été aussi grand malgré les tentatives des politicien·nes et des profiteur·ses de guerre d’instrumentaliser l’identité juive, d’interdire et de réprimer les manifestations de solidarité, et de se rallier autour du « droit d’Israël à se défendre ». Mais pour arrêter le génocide à Gaza, les militant·es étasunien·nes vont devoir passer de la demande d’un cessez-le-feu à son imposition. Cela nécessitera de passer de revendications qui font appel à la conscience des élu·es à des tactiques qui créent une crise politique pour les politicien·nes et perturbent la capacité des corporations à tirer profit de l’oppression et du génocide des Palestinien·nes.

Manifestant·es à Durham, Caroline du Nord bloquant l’autoroute 147 à l’heure de pointe, le 2 novembre 2023. Au même moment, des manifestant·es à Philadelphie étaient en train de bloquer la gare de la 30 th street.
75 années de guerre
À la suite de la Nakba (« catastrophe ») de 1948, 78 % des terres palestiniennes historiques ont été déclarées État juif. Environ 500 villages palestiniens ont fait l’objet d’un nettoyage ethnique et quelque 700 000 Palestinien·nes sont devenu·es réfugié·es. Ce contexte est essentiel pour comprendre les événements ultérieurs comme la guerre des Six Jours de 1967 ou la guerre du Kippour/Ramadan de 1973, pendant laquelle une coalition d’États arabes a tenté de reprendre le territoire perdu lors de la guerre des Six Jours.
Le 7 octobre 2023, cinquantième anniversaire du début de la guerre du Kippour/Ramadan, des militants du Hamas et d’autres groupes palestiniens ont franchi la frontière de Gaza par la terre, la mer et les airs lors d’une offensive surprise2. Ces attaques ont fait au moins1 405 mort·es et 5 431 blessé·es israélien·nes, dont un nombre inconnu d’enfants3. Le Hamas a pris d’assaut plusieurs colonies dans le territoire autour de Gaza, et a enlevé 242 personnes comme otages. Le gouvernement israélien a fait évacuer la zone pour reprendre le contrôle au Hamas, puis a procédé à une évacuation plus large encore afin de créer une zone tampon en vue de l’invasion militaire actuellement en cours.
Jusqu’à présent, le Hamas a relâché quatre civiles israéliennes. L’organisation a annoncé être prête à relâcher tous·tes les otages en échange de la restitution de tous·tes les prisonnier·es palestinien·nes détenu·es dans les prisons israéliennes, bien qu’ils aient déclaré il y a quelques jours que « presque 50 » otages avaient été tué·es par les raids aériens israéliens.
Avant le 7 octobre, 5 200 prisonnier·es politiques palestinien·nes étaient détenu·es en Israël, soit plus de 25 fois le nombre d’otages pris par le Hamas. Certaines estimations avancent que le nombre total de prisonnier·es palestinien·nes a doublé depuis le 7 octobre.
Les frappes aériennes d’Israël sur Gaza ont ciblé des infrastructures civiles, dont des écoles, des organismes humanitaires, des mosquées et des résidences. La controverse autour de la question de la provenance du missile ayant frappé l’hôpital Al-Ahli illustre à quel point il est difficile d’obtenir des informations sur les souffrances qui ont lieu en Palestine et à quel point les responsables israéliens sont prêt·es à justifier n’importe quelle atrocité : peu de temps après l’explosion de l’hôpital, un collaborateur du Premier ministre Benjamin Netanyahu avait publié sur un réseau social qu’Israël avait bombardé l’hôpital pare que des combattants du Hamas se trouvaient à l’intérieur, avant de rapidement supprimer son message.
Les forces de défense d’Israël (IDF) font depuis longtemps usage de stratégies militaires ciblant les civil·es et leurs infrastructures. En 2008, le colonel de l’IDF Gabi Siboni décrivait la stratégie de force disproportionnée d’Israël durant la Seconde guerre du Liban de 2006 comme politique de déploiement d’une « force disproportionnée par rapport aux actions de l’ennemi et la menace qu’il constitue », force qui « vise à infliger des dommages et un châtiment dans une mesure qui demandera un long et coûteux processus de reconstruction ». Faisant partie de la doctrine Dahiya de la guerre asymétrique, la stratégie de la guerre disproportionnée cible majoritairement les infrastructures civiles plutôt que les combattants ennemis, et cherche à dissuader de futures attaques en contraignant l’économie et la population civile à une lente et coûteuse reconstruction.
Cette approche de la guerre par la politique de la terre brûlée est manifeste dans les frappes israéliennes sur Gaza. Ces attaques contre les infrastructures paraissent représenter une stratégie intentionnelle dans laquelle les civil·es et les ressources dont iels dépendent sont devenu·es les principales cibles de guerre. Cela suggère que la stratégie de force disproportionnée qu’Israël a développée au Liban est à l’œuvre dans la destruction dévastatrice de vies et d’infrastructures vitales en Palestine.

Une photographie de Palestine Action montrant un·e manifestant·e occuper le toit de Howmet Fastening Systems à Leicester, au Royaume-Uni. Howmet fabrique des composants pour les F-35 israéliens.
« Cessez-le-feu immédiat ! »
Des manifestations pour la libération palestinienne ont eu lieu dans la plupart des grandes villes aux États-Unis, réunissant parfois plusieurs milliers de personnes. Bon nombre d’entre elles tracent une ligne directe entre la lutte pour la libération palestinienne et la lutte contre le colonialisme des États-Unis. Les manifestant·es ont souligné le fait que le gouvernement des États-Unis est le plus grand donateur de l’armée israélienne et que la plupart des armes utilisées pour tuer des Palestinien·nes sont fabriquées par des entreprises basées aux États-Unis.
À Atlanta, les manifestant·es ont désigné le GILEE (Georgia International Law Enforcement Exchange) comme un lien local entre l’oppression israélienne des Palestinien·nes et la violence policière et la répression auxquelles font face les habitant·es d’Atlanta. Installé à l’Université d’État de Géorgie, le GILEE facilite l’échange international de tactiques de maintien de l’ordre et de répression entre les forces de police de Géorgie et d’Israël. Cinq commandants du département de police d’Atlanta devaient se rendre en Israël du 13 au 21 octobre dans le cadre du GILEE.
Les militant·es d’Atlanta sont parfaitement au courant du réseau international de répression qui lie les mouvements Stop Cop City et Defend the Atlanta Forest au mouvement de libération palestinienne. Beaucoup ont fait remarquer que les forces israéliennes s’entraîneront à Cop City si le projet voit le jour. Le 12 octobre, 300 étudiant·es de l’Université d’État de Géorgie ont quitté les cours pour protester contre le GILEE, qu’iels considèrent comme faisant partie d’un système d’« échanges meurtriers ». Le 25 octobre, les étudiant·es de l’Université d’Emory ont organisé un débrayage de plus de 100 étudiants pour exiger que l’administration d’Emory se désengage de Cop City, du Atlanta Committee for Progress4, et du programme GILEE.
Les liens entre le département de police d’Atlanta, Cop City et les forces militaires israéliennes sont devenus un sujet d’attention publique à Atlanta grâce aux mouvements Stop Cop City et Defend the Atlanta Forest. Mais le GILEE n’est que l’un des dizaines de programmes d’échanges criminels de ce genre aux États-Unis. Huit ans avant que la police de Minneapolis n’assassine George Floyd, par exemple, des officiers du département de police de Minneapolis avaient reçu un entraînement des forces de police israéliennes lors d’une conférence à Chicago.
Les juif·ves vivant aux États-Unis se sont aussi mobilisé·es contre le bombardement et l’invasion de Gaza, exhortant Biden à appeler à un cessez-le-feu. La grande majorité de ces manifestant·es rejette le sionisme (le mouvement né à la fin du XIXe siècle pour établir un État juif sur la terre de Palestine historique et le soutenir par tous les moyens nécessaires) comme composante de l’identité juive. Au contraire, de nombreux·ses juif·ves antisionistes embrassent l’éthique diasporique que le peuple juif incarne depuis des millénaires.
L’une des plus grandes organisations aux États-Unis appelant pour la libération de la Palestine est Jewish Voice for Peace (JVP)5, un groupe de solidarité avec la Palestine fondé en 1996. Elle avait notamment suscité la controverse en 2019 quand elle avait officiellement adopté une position antisioniste. Le 18 octobre 2023, à Washington, D.C., Jewish Voice for Peace a organisé le plus grand rassemblement juif de solidarité avec les Palestinien·nes jamais vu. Selon JVP, 10 000 personnes venu·es de tout le pays ont convergé vers l’Esplanade nationale pour un rassemblement des « Juif·ves contre le génocide ». Près de 500 juif·ves — dont 25 rabbins — sont entré·es dans le Cannon Building du Capitole en portant des t-shirts sur lesquels étaient inscrits en gras « Not In Our Name6 ». Iels ont tenu un sit-in pendant plus de trois heures avant d’être arrêté·es et traînés dehors, menottes aux poings.
Jewish Voice for Peace n’est pas la seule organisation juive qui a vu le jour en réponse à des dizaines d’années de violence contre les Palestinien·nes. En 2014, l’armée israélienne a lancé l’« opération Bordure protectrice », une offensive militaire sur Gaza qui a tué plus de 2 200 Palestinien·nes, dont plus de 65 % de civil·es. En réponse à ces attaques, un petit groupe de jeunes juif·ves qui s’opposaient au soutien des institutions juives étasuniennes à l’invasion de Gaza a fondé IfNotNow7, une organisation de jeunes juif·ves basée aux États-Unis. La veille de la manifestation de JVP au Capitole le 18 octobre, des membres de IfNotNow ont bloqué les treize entrées de la Maison-Blanche pendant que le personnel était à l’intérieur, et ont engagé de petites escarmouches avec la police du Secret Service à l’extérieur.
Bien que le nombre de Juif·ves qui se sont mobilisé·es aux États-Unis pendant les quatre dernières semaines soit impressionnant, ni les revendications qu’iels ont présentées ni le nombre effroyable de civil·es tué·es en Palestine n’ont influencé la décision des élu·es.

Le site de Cambridge du marchand d’armes Elbit System repeint en rouge le 16 octobre 2023 en solidarité avec les personnes qui souffrent en Palestine.
Comment faire un cessez-le-feu
Les récentes manifestations contre le génocide en Palestine démontrent que la lutte de libération palestinienne bénéficie d’un soutien populaire à l’échelle nationale, à la fois parmi les Juif·ves et les non-Juif·ves. Si ces manifestations ont échoué à mettre fin aux attaques contre les Palestinien·nes, c’est parce qu’elles sont conçues pour faire appel à la conscience de politicien·nes pour qui le soutien à Israël n’est pas soumis à une évaluation morale, mais à des calculs économiques. Ailleurs, des groupes qui luttent pour la libération de la Palestine cherchent à créer une crise économique pour les profiteurs de guerre en ciblant les entreprises qui bénéficient du bombardement et de l’invasion de Gaza.
Actif à la fois au Royaume-Uni et aux États-Unis, un groupe nommé Palestine Action a ciblé l’entreprise de fabrication d’armes Elbit Systems, qui fournit 85 % de la flotte de drones d’Israël. Le 12 octobre, des militant·es à Cambridge, dans le Massachusetts ont éclaboussé de peinture rouge la façade d’un bureau de Elbit avant de s’y enfermer elleux-même pour en bloquer l’accès. Palestine Action a récemment annoncé son lancement aux États-Unis avec un webinaire Zoom le 24 octobre pour expliquer leurs stratégies, cibles et tactiques. Tôt ce même matin, des militant·es ont ciblé l’Intercontinental Real Estate, qui possède l’immeuble de bureaux loué à Elbit à Cambridge. Selon un témoignage, iels ont « brisé le boîtier de l’interphone, recouvert la façade du bureau de l’Intercontinental à Brighton de peinture rouge, et tagué “Expulsez Elbit” en grandes lettres noires. »
Selon le reportage du Globes, le prix des actions d’Elbit a chuté de près de 10 % depuis le 7 octobre, pendant que d’autres fabricants d’armes ont connu une augmentation de 5 à 17 % pendant la même période.
Plus tôt cette année, Palestine Action a contraint une usine appartenant à la filiale d’Elbit UAV Defence Systems à fermer définitivement après que des militant·es l’ont assiégée pendant 60 jours consécutifs. Le groupe a également forcé Elbit à vendre sa filiale Ferranti, basée à Oldham, en janvier 2022, après 18 mois d’actions directes continues dans l’usine. Six mois plus tard, l’entreprise a définitivement fermé son siège londonien après la quinzième action sur le site.
En plus de cibler Elbit Systems et ses filiales, Palestine Action a également mené une campagne de ciblage tertiaire, en organisant des actions dans les bureaux et les entrepôts d’entreprises en lien économique avec Elbit. Le ciblage tertiaire vise à exercer une pression sur les principaux acteurs d’un projet en incitant les entreprises qui ont moins d’intérêts dans le projet à couper leurs liens avec eux. Le ciblage tertiaire avait également été utilisé par la campagne Stop Huntingdon Animal Cruelty (SHAC) au début des années 2000 et par la campagne Stop Reeves Young du mouvement Stop Cop City.
Les mouvements aux États-Unis utilisent depuis longtemps des tactiques telles que les blocages, les manifestations devant les domiciles ou les bureaux, les sit-in, le vandalisme, et le sabotage pour agir contre les guerres à l’étranger. Le mois dernier, les actions ciblées contre des profiteurs de guerre tels que Elbit Systems et ses filiales ont montré que le sentiment anticolonial populaire peut être canalisé vers une action efficace en frappant le cœur des processus économiques qui rendent la guerre possible, plutôt que la conscience des élu·es. À des milliers de kilomètres du génocide en Palestine, les personnes vivant aux États-Unis peuvent se sentir impuissantes à mettre fin aux attaques dévastatrices d’Israël. Mais les militant·es qui vivent dans le cœur colonial ont en fait le pouvoir de directement perturber le fonctionnement des institutions et des profiteurs de guerre qui bénéficient du génocide à Gaza.

Une carte des cibles potentielles d’actions par Palestine Action US. « Si vous vivez à l’est du Mississippi, vous vivez à moins de trois heures d’un bureau ou d’une usine d’Elbit Systems, la plus grande entreprise d’armes israélienne, la cible de notre campagne internationale d’action directe. »
Postface de l’éditeur : Usages et limites du ciblage tertiaire
Dans le bilan de la campagne SHAC que nous avions préparé avec des participant·es à ce mouvement à la suite d’une vague de répression qui avait entraîné l’emprisonnement de nombreux organisateur·ices à la fois aux États-Unis et au Royaume-Uni, nous avions soutenu que les stratégies de ciblage tertiaire avaient plus de chance de succès contre de plus petites cibles que Huntingdon Life Sciences, l’entreprise d’expérimentation d’expérimentation animale que la campagne SHAC cherchait à mettre hors d’état de nuire. Avant la campagne SHAC, un mouvement antérieur ayant utilisé la même stratégie avait réussi à faire fermer un magasin de fourrures individuel ; mais en cherchant à faire fermer Huntingdon Life Sciences, qui était alors la plus grande entreprise européenne d’expérimentation animale, les militant·es avaient choisi une cible de grande notoriété. Chaque fois que la campagne avait été sur le point de faire fermer HLS, les agences gouvernementales étaient intervenues pour renflouer l’entreprise.
Notre conclusion était donc que :
il serait probablement judicieux pour les prochain·es à expérimenter ce modèle de se fixer des objectifs plus modestes, plutôt que plus ambitieux, puisque la campagne SHAC elle-même n’a pas encore été un succès. Peut-être existe-t-il un juste milieu encore inexploré entre faire fermer un magasin individuel de fourrures et chercher à faire fermer la plus grande entreprise européenne d’expérimentation animale.
Malgré cela, la plupart des efforts ultérieurs utilisant le modèle SHAC s’en sont pris à de plus grands adversaires, notamment des projets d’infrastructure capitalistes transnationaux et des entreprises travaillant avec le gouvernement de la ville d’Atlanta pour construire Cop City. Quand l’infrastructure d’État est en jeu, les agences gouvernementales vont presque toujours intervenir pour protéger les entreprises ou autres institutions des conséquences du ciblage tertiaire. Pour être capable de priver les principaux acteurs du complexe militaro-industriel de l’ensemble de leurs ressources, un mouvement se devrait d’être particulièrement puissant.
Il ne s’agit pas nécessairement d’un argument contre le ciblage tertiaire, mais plutôt d’un rappel visant à fixer des attentes réalistes et à formuler des objectifs atteignables. Même s’il n’est pas possible de faire fermer toutes les entreprises d’armement du monde les unes après les autres (du moins, pas sans un changement social à une échelle encore plus grande), l’ouverture d’un champ d’actions plus conflictuelles pourrait offrir un moyen de pression supplémentaire sur les politicien·nes et autres décideur·ses qui donnent aujourd’hui à Israël carte blanche pour mener à bien son nettoyage ethnique. L’élargissement de l’éventail des stratégies auxquelles des militant·es peuvent participer et la multiplication des cibles qu’iels peuvent identifier pourrait ouvrir de nouveaux théâtres d’opérations en donnant à de nouveaux·lles participant·es des points d’intervention locaux, et en intensifiant l’intensité des protestations en cours et de la pression sur celle et ceux qui détiennent le pouvoir d’arrêter les flots d’armes et de sang.
Des manifestant·es juif·ves expriment leur solidarité avec les Palestinien·nes en bloquant l’autoroute 147 à Durham, en Caroline du Nord, à l’heure de pointe, le 2 novembre 2023. À Durham et ailleurs aux États-Unis, les blocages d’autoroute menés par le mouvement Black lives qui a fait irruption sur la scène nationale avec le soulèvement de Ferguson 2014 ont créé un précédent pour les actions que nous voyions maintenant d’autres mouvements employer.
-
Programme d’échange international des forces de l’ordre de Géorgie (ndt) ↩
-
Selon l’IDF, au moins « 3000 militants » auraient participé à l’attaque. ↩
-
Certains articles suggèrent que des Israélien·nes auraient été tué·es par les forces israéliennes le 7 octobre, que ce soit à la suite de « tirs croisés nourris » ou de « tirs d’obus sur des maisons avec tous·tes leurs occupant·es à l’intérieur afin d’éliminer les terroristes, mais aussi les otages ». ↩
-
Comité d’Atlanta pour le progrès (ndt) ↩
-
Voix juive pour la paix (ndt) ↩
-
Pas en notre nom (ndt) ↩
-
Sans doute en référence à l’expression « If not now, then when? », « Si ce n’est pas maintenant, alors quand ? » (ndt) ↩
17.10.2023 à 12:24
De la Galilée à Gaza : Une voix de Palestine
CrimethInc. Ex-Workers Collective
Texte intégral (2123 mots)

En ce moment même l’armée israélienne fait pleuvoir les bombes sur les personnes piégées dans Gaza. Les militaires ont déjà tué presque 3000 personnes et provoqué le déplacement de plus d’un million d’autres. Il ne s’agit pourtant que du dernier chapitre en date d’un siècle de violences coloniales visant les Palestinien⋅nes.
Nous pleurons toutes les personnes qui ont été tuées, blessées ou contraintes à fuir la région le 7 octobre et les jours qui ont suivi. Mais comme dans toute lutte, ce sont ceux qui ont le plus de pouvoir qui ont également le plus de poids pour déterminer la forme que le conflit prendra. Nous nous inquiétons pour la vie des Palestinien⋅nes à Gaza et ailleurs dans le monde, non pas malgré la mort d’Israélien⋅nes, mais parce que la seule façon d’assurer la sécurité de qui que ce soit dans la région est de mettre fin à l’oppression des Palestinien⋅nes.
Les grands médias d’Europe et d’Amérique du Nord ont passé les dix derniers jours à focaliser l’attention sur les souffrances israéliennes plutôt qu’à analyser la série d’événements qui ont conduit à cette situation. La grande majorité de l’ensemble des points de vue provient de l’extérieur de la Palestine. Il est crucial d’entendre directement ce que les Palestinien⋅nes ont à dire, car ils comprennent sans doute mieux que quiconque ce qui a mené à ces événements.
Il a été difficile de communiquer avec des habitant⋅es de Gaza, notamment en raison des frappes aériennes israéliennes ciblant les infrastructures de communication. Pour l’instant, nous présentons le point de vue d’un Palestinien vivant au nord de la Palestine. Il nous parle de différents aspects de la vie sous la colonisation, et de la lutte pour la libération au travers de l’organisation et de la solidarité au niveau local.
Pour plus de contexte, vous pouvez lire cet entretien avec un anarchiste de Jaffa.
Une voix de la Galilée palestinienne
Je vous écris aujourd’hui de la Galilée palestinienne, une partie de la Palestine occupée par les forces coloniales sionistes pendant la Nakba [catastrophe] en 1948. J’écris ces mots en octobre 2023, un mois qui restera à jamais dans les mémoires comme un tournant pour la Palestine et la lutte palestinienne. J’écris anonymement, car j’écris depuis le ventre de la bête et que la surveillance et la persécution politique qu’exerce Israël dans les territoires de 1948 sont sans précédent, parce que le fascisme et le totalitarisme du projet colonial s’intensifient de jour en jour, et que chaque mot que nous exprimons est un risque que nous prenons.
Alors que j’écris ces mots, des avions de guerre traversent les cieux au-dessus de ma tête. Le son de leurs moteurs emplit les environs. Ils traversent le ciel depuis dix jours, jour et nuit, à toute heure.
Tous ces avions de guerre se dirigent vers Gaza. Au moment où j’écris ces mots, un génocide y est perpétré. À seulement deux heures d’ici, à Gaza, Israël – avec le soutien des puissances impérialistes mondiales – est en train d’effacer mon peuple de la surface de la Terre.
Gaza : La Nakba en cours et le soumoud
Gaza, notre chère Gaza, Gaza la résistance, Gaza le symbole éternel de la résilience humaine, Gaza la blessure, le crève-cœur, Gaza le soumoud [ténacité].
Gaza est située sur la côte est de la Méditerranée, bordée par des colonies israéliennes à l’Est et au Nord, et par l’Égypte au Sud-Ouest. Avec une population de plus de 2,2 millions d’habitant⋅es sur seulement 365 kilomètres carrés, c’est l’un des endroits les plus densément peuplés au monde. 70 % des Palestinien⋅nes de Gaza sont des réfugié⋅es dont les familles ont été expulsées des villes voisines par les milices coloniales sionistes en 1948, durant la Nakba.

En 2007, Israël a imposé un blocus terrestre, aérien et maritime à Gaza. Depuis, l’État d’Israël a mené cinq agressions majeures contre Gaza.
La première a eu lieu en 2008, après l’imposition du blocus. Elle a duré 22 jours, pendant lesquels 1385 Palestinien⋅nes, dont 318 enfants, ont été tué⋅es.
La deuxième a commencé en novembre 2012. Elle a duré 8 jours. 168 Palestinien⋅nes, dont 33 enfants, ont été tué⋅es.
La troisième a commencé en juillet 2014 et a duré 50 jours. 2251 Palestinien⋅nes, dont 556 enfants, ont été tué⋅es, et 1500 enfants sont devenu⋅es orphelin⋅es.
En mai 2021, la quatrième agression a eu lieu, lors du soulèvement de la dignité qui a éclaté dans toute la Palestine, de la mer jusqu’au Jourdain. Elle a duré onze jours, durant lesquels 230 Palestinien⋅nes, dont 67 enfants, ont été tué⋅es. Douze de ces enfants ont été tué⋅es alors qu’iels participaient à un programme de guérison des traumatismes.

Aujourd’hui, une cinquième agression a lieu à Gaza, et elle est plus brutale et catastrophique que toutes celles qui l’ont précédée. Les frappes aériennes israéliennes ont déjà tué près de 3000 personnes et blessé plus de 12 000. Plus de 45 familles ont été complètement rayées des registres d’état civil. Plus d’un million de personnes ont été déplacées et forcées de fuir leur domicile à cause des bombes israéliennes. Israël a coupé l’électricité, le ravitaillement en nourriture et en carburant, et bombarde les immeubles résidentiels, les écoles, les mosquées, les hôpitaux et les ambulances. Des quartiers entiers ont disparu.
Les gens commencent à mourir de faim et n’ont aucun endroit pour se cacher, aucun moyen de s’échapper. Tout cela se produit avec le soutien clair et éhonté des gouvernements occidentaux, comme les États-Unis et le Royaume-Uni, qui se sont empressés d’envoyer un soutien militaire à Israël. Tout cela se produit alors que la propagande coloniale israélienne est omniprésente dans les médias internationaux et tente de fabriquer une campagne anti-palestinienne et de la présenter comme une « guerre contre le terrorisme » dans le but de légitimer le nettoyage ethnique de masse et la Nakba qui touche la Palestine depuis plus de 75 ans.
« Qui est le terroriste ? » – La fabrique du consentement
Comme nous en avons été témoins dans l’histoire, la propagande et la tactique de « fabrique du consentement » ont toujours été utilisées par les entités coloniales, impériales et fascistes pour légitimer, maintenir et étendre leur contrôle. C’est aussi comme cela qu’elles légitiment l’extermination et le nettoyage ethnique de masse.
La fabrique du consentement est la stratégie de l’État qui vise à créer un système dans lequel les gens en viennent à obéir et à consentir sans poser de questions aux principes, aux idées et aux plans défendus par la propagande et les médias de masse. Elle a été utilisée pour servir les intérêts des États-Unis et de leurs alliés durant les invasions de l’Afghanistan en 2001, de l’Irak en 2003 et pendant les guerres et les atrocités commises en Syrie, au Yémen, en Libye et dans de nombreux autres endroits dans le monde, avec pour résultat la perte de millions de vies innocentes et tant de souffrances humaines.
Aujourd’hui, les médias de masse cherchent à nous déshumaniser en tant que peuple palestinien, nous qualifient de terroristes afin de justifier plus facilement toutes les atrocités commises par Israël et ses alliés – à la fois à Gaza en particulier et contre les Palestinien⋅nes en général.
En tant qu’Arabes et Palestinien⋅nes, nous savons très bien ce que ça fait d’être vu⋅es et traité⋅es comme des « terroristes ». Mais l’ampleur de la campagne de propagande anti-Palestinien⋅nes menée actuellement dans le monde par les États, les gouvernements et les médias est sans précédent pour nous.
Pendant la Seconde intifada, après les événements du 11 septembre 2001, le groupe de hip-hop palestinien « DAM » avait sorti le morceau « Meen Erhabi ? » – « Qui est le terroriste ? » Pendant cette période, des phrases telles que « mort aux terroristes arabes » étaient criées par les colons israélien⋅nes dans toute la Palestine occupée. Je me rappelle que j’écoutais cette chanson tous les jours. Elle a façonné ma conscience d’enfant. Aujourd’hui, 22 ans plus tard, le système global propage le récit selon lequel « le Palestinien est un terroriste » comme jamais auparavant, et nous le répétons encore et encore : le colonisateur est le terroriste, le colon est le terroriste, tous les gouvernements qui soutiennent Israël sont terroristes, Israël est le terroriste.
Le système contre le peuple
La situation en Palestine dévoile la cruauté et la brutalité du système mondial, mais aussi le pouvoir immense des peuples du monde entier.
Du point de vue du système mondial, nous avons assisté à tellement d’atrocités et de laideur au cours de la semaine écoulée. Les États-Unis ont déployé le « Gerald R. Ford » – le plus grand navire de guerre jamais construit – et le Royaume-Uni a mobilisé ses navires de la marine royale afin de soutenir Israël dans le génocide qu’il est en train de commettre.
La police française frappe les manifestant⋅es qui soutiennent la Palestine. Les autorités françaises exigent l’expulsion des immigré⋅es ayant participé à une manifestation pro-palestinienne. En Allemagne, la police arrête et frappe des personnes pour le simple fait de tenir le drapeau palestinien. Ces entités coloniales et gouvernements fascistes dévoilent une nouvelle fois leur vrai visage. En tant que Palestinien⋅nes, nous avons toujours su que le système mondial était contre nous, c’est quelque chose que nous comprenons dès le plus jeune âge. Nous n’attendons rien d’entités coloniales. Nous n’avons aucune confiance dans les gouvernements ou les puissances mondiales. Notre confiance réside dans le peuple et dans le pouvoir du peuple seulement.
Malgré toutes ces atrocités, nous sommes également témoins de la voix de la libération et de la justice qui résonne dans les rues de la planète, nous constatons le pouvoir du peuple. Le peuple connaît la vérité, et il n’est pas possible d’étouffer cette connaissance.
Nous avons vu des milliers de personnes marcher pour la libération de la Palestine dans les rues de Londres et de Paris, même après que les manifestations pour la Palestine ont été interdites.
Nous avons vu les rues de Lisbonne et de Porto pleines de rage, d’amour et de solidarité. Nous avons vu des dizaines de milliers de nos frères et sœurs se rassembler pour la Palestine en Irak, au Yémen, en Jordanie et au Maroc.
Aujourd’hui, tous les efforts pour faire éclater la vérité au grand jour comptent. Chaque drapeau palestinien levé compte. Chaque expression de solidarité compte. Chaque effort d’organisation pour la Palestine compte. Chaque « de la mer au Jourdain » compte.
Oui, ces jours sont douloureux au-delà de toute compréhension, mais nous savons aujourd’hui plus que jamais que la libération est inévitable.
Ce n’est qu’une question de temps. La Palestine sera libre.
09.10.2023 à 00:36
« Une superpuissance nucléaire et un peuple dépossédé » : Un anarchiste de Jaffa, à propos de la violence en Palestine et de la répression israélienne
CrimethInc. Ex-Workers Collective
Texte intégral (9911 mots)

Le 7 octobre, le Hamas, parti au pouvoir dans la bande de Gaza, a franchi les murs de séparation qui encerclent la zone pour mener une série d’attaques. Le gouvernement israélien a répliqué par une opération militaire de grande envergure. Si les deux parties ont pris pour cible des civils et des soldats, ces événements ne peuvent être compris qu’au prisme de plusieurs décennies de répression et de nettoyage ethnique.
Au moment de ces attaques, nous terminions un entretien avec Jonathan Pollak, un anarchiste de Jaffa, une ville palestinienne majoritairement arabe jusqu’à encore récemment. Participant de longue date au collectif Anarchist Against The Wall 1 et à d’autres actions de solidarité anticoloniale, Jonathan est actuellement poursuivi et risque une peine de prison pour avoir participé à une manifestation en début d’année. Dans l’entretien qui suit, il nous partage sa perception du nouveau cycle de violences qui se déroule actuellement. Il témoigne également de la façon dont le système judiciaire israélien oppresse structurellement les Palestinien·nes, explique comment soutenir les prisonnier·es palestinien·nes, et évalue l’efficacité des efforts de solidarité qui se sont déployés au fil des ans.
Pour plus de contexte sur la situation en Israël et en Palestine, vous pouvez consulter notre histoire de l’anarchisme israélien contemporain, notre reportage sur le soulèvement de Haïfa en 2021, et notre couverture du conflit politique au sein de la société israélienne au début de cette année.
Nous espérons partager les perspectives des anti-autoritaires de Gaza dès que nous aurons réussi à communiquer avec elles et eux. En offrant cet espace à une personne qui a grandi dans la société israélienne, nous ne cherchons pas à mettre particulièrement en avant le point de vue ou la personnalité de citoyen·nes israélien·nes, mais plutôt à montrer que la situation ne peut être réduite à un conflit ethnique binaire, de la même façon que nous l’avons fait en publiant les points de vue des anarchistes russes sur l’invasion de l’Ukraine. La photo ci-dessus, prise par Oren Ziv/ActiveStills, montre des manifestants brûlant des pneus dans la ville de Beita.
Intensification des hostilités
Le samedi 7 octobre, alors que nous nous apprêtions à publier cet entretien, le Hamas a mené une vague d’attaques coordonnées. Le gouvernement israélien a réagi en lançant une offensive militaire à grande échelle. Comment perçois-tu ces événements depuis l’endroit où tu te situes ?
C’est un événement d’ampleur historique pour la résistance palestinienne au colonialisme israélien, qui se poursuit toujours aujourd’hui. Il est trop tôt pour savoir exactement ce qui va se passer, et je préfère donc parler du contexte général de la situation plutôt que de donner une analyse d’une affaire encore en cours et dont les détails ne sont pas encore clairs. Tout ce que je pourrais dire maintenant pourrait être dépassé dans quelques heures.
Ce qui est certain, en revanche, c’est que d’horribles journées sont à venir.
La version courte de cette histoire est que les forces du Hamas ont réussi à briser le siège qu’Israël impose brutalement à la bande de Gaza et à pénétrer dans les colonies israéliennes de l’autre côté du mur, voire à s’en emparer complètement dans certains cas. Le nombre de morts du côté israélien s’élève à plusieurs centaines, et les images diffusées dans les médias sont effroyables et choquantes, en particulier sur les réseaux sociaux. Mais je m’avance un peu.
Certains des termes que j’utilise dans ce contexte peuvent être déroutants pour les personnes qui suivent un peu ce qui se passe en Palestine et qui sont habituées à ce que le terme « colonies israéliennes » soit réservé aux zones occupées par Israël à partir de 1967. Je pense cependant qu’il est nécessaire de comprendre Israël comme un projet colonial à part entière, et le sionisme comme un mouvement colonial pour la suprématie juive. Il serait négligent d’ignorer la longue histoire du nettoyage ethnique israélien, qui a abouti en 1948 au nettoyage ethnique des Palestinien·nes par Israël, et que l’on connaît sous le nom de Nakba. La bande de Gaza d’aujourd’hui, qui n’est qu’une fraction du district de Gaza de la Palestine d’avant 1948, est le foyer de réfugié·es de 94 villes et villages du district historique qui ont été complètement dépeuplés. Aujourd’hui, 80 % des résident·es de la bande de Gaza sont des réfugié·es, assiégé·es dans une zone qui, avec ses 365 km², est la plus grande prison à ciel ouvert du monde. Les villes qui ont été prises ou attaquées par les Palestiniens au début des combats actuels sont quelques-unes des villes dépeuplées dont certain·es des réfugié·es ont été dépossédé·es.
Dans les médias internationaux, l’histoire est principalement présentée soit comme une guerre bilatérale entre Israël et Gaza, soit comme une agression palestinienne unilatérale et insensée, dépourvue de tout contexte. Le contexte qui manque, bien sûr, est que les Palestinien·nes ont connu des années et des années d’assujettissement colonial, et c’est particulièrement vrai pour les Palestinien·nes de la bande de Gaza.
Comme je le disais, les images sont sordides et épouvantables. Il est impossible de ne pas en être affecté. Cependant, elles ne se suffisent pas à elles-mêmes. Au-delà du contexte historique déjà mentionné, dans les deux dernières décennies, Gaza a été encore et encore réduite en poussière par les raids aériens et les opérations militaires israéliennes. Maintenant, une fois de plus, les bombardements ont recommencé et, au sein des courants dominants de la société israélienne et de ses médias, il est ouvertement question de perpétrer un génocide à Gaza. Si rien n’est fait pour l’empêcher, il pourrait effectivement avoir lieu.
Si nous demandons aux Palestinien·nes de ne pas se tourner vers la violence, nous ne devons pas oublier à quelle réalité iels sont confronté·es. Quand les Palestinien·nes de Gaza ont manifesté en 2017 et 2018 contre la clôture israélienne qui les emprisonne, iels ont été abattu·es par centaines. Les images qui circulent actuellement sont sordides et choquantes. Je n’ai pas l’intention de les euphémiser, de les justifier ou de les excuser, mais au cours de la lutte, le chemin de la libération prend presque toujours des tournants épouvantables.
L’African National Congress [une des principales organisations-cadres de la lutte contre l’apartheid en Afrique du Sud] est souvent citée par ignorance comme un point de référence pour celles et ceux qui cherchent à soutenir que la violence n’a aucun rôle à jouer dans la lutte. Mais après la création de son aile militaire, le MK [uMkhonto we Sizwe, « Lance de la Nation »], l’ANC n’a jamais renoncé à la violence. Nelson Mandela [membre de l’ANC et cofondateur du MK] a refusé de la récuser, même après plusieurs dizaines d’années d’emprisonnement. En 1985, le président de l’ANC, Oliver Tambo, a déclaré au Los Angeles Times,
« Par le passé, nous disions que l’ANC ne prendrait jamais délibérément la vie d’innocent·es, mais aujourd’hui, en regardant ce qui se passe en Afrique du Sud, il est difficile d’affirmer que des civil·es ne vont pas mourir. »
Le contexte de lutte ici est celui d’une superpuissance nucléaire et d’un peuple dépossédé. Le colonialisme ne faiblit pas. Il ne reculera pas de lui-même, même si on le lui demande gentiment. Le décolonialisme est une cause noble, mais le chemin pour y parvenir est souvent laid et entaché de violence. En l’absence d’alternative réaliste pour parvenir à la libération, les gens sont contraints de commettre des actes injustifiables. C’est la réalité fondamentale de la disparité du pouvoir. Demander à ce que les opprimé·es agissent toujours de la manière la plus pure, c’est leur demander de rester à jamais dans la servitude.

Un manifestant évacuant un enfant blessé par un tir israélien pendant une manifestation à Beita. Photographie de Oren Ziv/ActiveStills.
L’affaire judiciaire
Revenons un peu en arrière – Jonathan, tu es en plein procès dans un tribunal qui dépend du gouvernement israélien, accusé d’avoir lancé des pierres pendant une manifestation en Cisjordanie. Peux-tu nous expliquer le contexte dans lequel tu as été arrêté ?
J’ai été arrêté à Beita, un village près de la ville de Naplouse en Cisjordanie.
Beita a une longue tradition de résistance au colonialisme israélien. C’était un des centres de la résistance durant la Première intifada (1987-1993). Début 1988, une vingtaine d’hommes de Beita et de la ville voisine de Huwara ont été encerclés par l’armée israélienne après avoir été identifiés par le Shin Bet, la tristement célèbre police secrète israélienne, comme étant impliqués dans des jets de pierre. Ils ont été attachés avec des serflex puis les soldats leur ont brisé les os à coup de pierres et de matraques. Les soldats exécutaient l’ordre direct du ministre de la Défense de l’époque, Yitzhak Rabin, qui avait publiquement appelé à une politique consistant à « briser les bras et les jambes ».
Plus tard la même année, Beita a été le théâtre de l’un des incidents les plus marquants de l’intifada, quand un groupe de jeunes colons israéliens, mené par l’extrémiste Romam Aldube, a fait une incursion dans la ville sous prétexte d’y faire une sortie à l’occasion de Pessa’h. Après qu’Aldube a abattu un résident du village dans les oliveraies entourant la ville, le groupe a continué à l’intérieur même de Beita, où il a été accueilli par des habitants sortis pour se défendre. Les colons ont finalement été désarmés par les habitants, mais pas avant que leurs tirs ne tuent deux autres Palestiniens ainsi qu’une jeune fille de 13 ans, abattue par erreur par Aldube lui-même au cours de l’affrontement.
À la suite de cet incident, de nombreux appels ont été lancés dans la société israélienne pour « rayer Beita de la carte ». En représailles, et bien que les détails de l’incident aient déjà été clarifiés pour les militaires via plusieurs débriefings opérationnels, l’armée israélienne a détruit quinze maisons du village et arrêté tous les hommes, puis déporté six d’entre eux en Jordanie.
Ces dernières années, Beita a été marquée de conflits constants avec l’armée israélienne et les colons qui cherchent à établir des colonies sur des terres volées appartenant à la ville. La manifestation lors de laquelle j’ai été arrêté, le 27 janvier, faisait partie d’un soulèvement local qui a commencé en mai 2021, à la suite de l’établissement d’une colonie israélienne dans la zone de Jabel (mont) Sabih aux abords de la ville. Pendant ces manifestations, dix personnes ont été tuées par des tirs israéliens, certains par des tirs de sniper. Des milliers de personnes ont été gravement blessées et des centaines ont été arrêtées. Le soulèvement est parvenu à forcer l’évacuation des colons, mais seulement de façon temporaire et avec la promesse du gouvernement qu’ils seraient plus tard autorisés à revenir. Après le départ des colons, l’endroit a été utilisé comme base militaire et, récemment, les colons sont revenus occuper les maisons construites avec l’aide du gouvernement.
J’ai été arrêté lors d’une descente de la police aux frontières (une unité paramilitaire de la police israélienne) dans le village, après une manifestation. Au poste de police, j’ai entendu deux officiers qui m’avaient arrêté préparer ensemble leurs déclarations ; ils m’ont ensuite inculpé pour agression aggravée contre des officiers de police (jet de pierres), obstruction contre des officiers de police, et émeute. J’ai été détenu en prison pendant trois semaines, puis assigné à résidence en raison de la détérioration de mon état de santé.

Des familles de Palestinien·nes détenu·es attendent qu’on les laissent entrer dans la prison/tribunal militaire d’Ofer, près de Ramallah. Photograph by Oren Ziv/ActiveStills.
Tu as demandé à être jugé par un tribunal militaire plutôt que civil, comme le sont les Palestinien·nes. Peux-tu nous expliquer le sens de cette demande ?
Je ne suis évidemment pas un admirateur de l’État, ni de celui-ci ni d’aucun autre. Mais dans les soi-disant démocraties, la notion de violence légitime de l’État – qui est le fondement même des systèmes juridiques et répressifs – découle d’une fausse éthique de la justice et d’une idée erronée selon laquelle ces systèmes représentent les intérêts collectifs de celles et ceux qui sont soumis·es à son autorité.
Il existe un mécanisme unique dans l’apartheid israélien, qui n’existait même pas dans le système d’apartheid sud-africain. En Cisjordanie, il existe deux systèmes judiciaires parallèles : un pour les Palestinien·nes, et un pour les colons juif·ves. En étant accusé des mêmes délits – même quand ils ont lieu au même endroit, au même moment et pendant les mêmes circonstances – je serai poursuivi et jugé dans le cadre du droit pénal civil tandis que mes camarades palestinien·nes seront confronté·es à un tribunal militaire, ce qui montre bien la réalité d’une dictature militaire totale. Pour appréhender les Palestinien·nes, le gouvernement utilise des forces armées, qui les arrêtent souvent au milieu de la nuit, violemment et l’arme à la main. Il peut s’écouler jusqu’à 96 heures avant de voir un juge (24 heures pour moi), et même quand c’est finalement le cas, ce juge sera un soldat en uniforme, tout comme le procureur. Iels seront jugé·es selon la loi militaire draconienne d’Israël, sans doute sans possibilité de liberté sous caution, et leur peine sera prononcée après leur condamnation dans un système ou moins d’une personne sur 400 est acquittée.
Ce double système judiciaire est souvent mentionné comme l’une des principales composantes de l’apartheid israélien. C’est une manifestation si éclatante de l’apartheid que même certain·es sionistes modérés ne peuvent l’occulter. Pourtant ils ne reconnaissent pas qu’il s’agit d’un élément fondamental du sionisme en tant que mouvement de colonisation, car iels se concentrent uniquement sur l’occupation de 1967 et sur le contrôle par Israël de la Cisjordanie et de la bande de Gaza. On entend souvent dire que le système est mauvais, mais qu’il n’est pas raciste puisque la distinction se fait sur la citoyenneté. Cette affirmation est fausse. Il existe une minorité palestinienne (20 % de la population israélienne) dont les membres vivent sur les zones occupées par Israël en 1948 et disposent de la citoyenneté israélienne (contrairement aux Palestinien·nes qui vivent en Cisjordanie ou dans la bande Gaza, qui vivent sous le contrôle d’Israël en tant que sujets sans citoyenneté). On le sait assez peu, mais même les Palestinien·nes qui disposent de la citoyenneté sont parfois jugé·es par les tribunaux militaires de Cisjordanie. La vérité en la matière est simple : j’ai été inculpé devant un tribunal civil parce que l’État me considère comme Juif. Si j’avais été un Palestinien possédant la citoyenneté israélienne, j’aurais probablement été jugé devant un tribunal militaire. Le système fonctionne selon des critères ethniques et religieux.
Les lois elles-mêmes sont différentes, et la loi militaire n’est en fait pas une législation, mais plutôt un ensemble de décrets émis par le commandement militaire de la région. L’un de ces décrets, l’Ordre 101, interdit par exemple tout rassemblement de nature politique de dix personnes ou plus (par exemple, un repas au cours duquel on parle politique), même si ce rassemblement a lieu sur une propriété privée. C’est un délit passible de dix ans de prison. De même, toute organisation politique ou association peut être déclarée hors-la-loi, ce qui arrive régulièrement.
Je vois l’anarchisme comme une idéologie – ou plutôt un mouvement – de lutte. Je crois qu’en général l’activisme ne devrait pas être moralisateur (c’est-à-dire complaisant et paternaliste), mais plutôt dirigé vers un changement effectif. En soi, il n’y a rien de positif à perdre du temps en prison au lieu d’essayer de faire quelque chose d’utile à l’extérieur. J’ai demandé à être jugé par une cour militaire afin de mettre en lumière un système dont très peu sont conscient·es, et en même temps, pour essayer de le saper. Nous avons donc présenté un argument juridique assez solide, compte tenu des limites du droit israélien, mais la cour l’a simplement ignoré sur la base d’un point technique inventé de toute pièce – un bricolage juridique assez impressionnant. Ma décision de refuser de reconnaître la légitimité du tribunal après que ma requête a été rejetée faisait également partie de ma stratégie.
Il existe également une raison plus fondamentale pour laquelle je refuse de coopérer avec la cour et de me conformer aux procédures, qui découle de ma compréhension du pouvoir et de ma propre expérience des systèmes judiciaire et carcéral. Ces systèmes sont conçus de telle sorte que l’on est toujours en train de plaider ou d’attendre, toujours à la merci du pouvoir, dénué·e de toute agentivité.
La non-coopération renverse tout ce système de contrôle. Elle permet de récupérer du pouvoir et de l’agentivité dans une situation dans laquelle vous êtes censé ne pas en avoir. Il y a certainement un prix à payer, et il faut le considérer à chaque fois, selon les circonstances. Je ne préconise pas cette stratégie dès que l’on est confronté au système judiciaire, mais j’ai constaté qu’elle avait le mérite de me redonner beaucoup de contrôle sur la situation.
Mes chances d’être acquitté ou d’éviter la prison étaient inexistantes au départ, je n’avais de toute façon pas grand-chose à perdre.

Une vue du tribunal militaire d’Ofer depuis l’extérieur. Photographie de Oren Ziv/ActiveStills.
Ce n’est pas la première fois que tu fais face à une peine de prison, non ?
Non… Je crois que c’est peut-être la sixième fois, mais je ne suis pas sûr à cent pour cent. Par contre, mes camarades palestinien·nes entrent et sortent de prison en permanence, et il est très difficile d’imaginer une vie sans la menace de l’emprisonnement, étant donné les circonstances dans lesquelles nous vivons. En fait j’ai de la chance (ou le privilège) d’avoir passé si peu de temps en prison au cours de vingt et quelques années de militantisme. Ça aussi, c’est une des conséquences de l’apartheid israélien.
Tu as mentionné que tu avais été relâché plus tôt cette année à cause de problèmes de santé. Peux-tu nous décrire les conditions de vie dans les différents établissements où tu as séjourné ?
Tout comme le système judiciaire, l’emprisonnement est lui aussi ségrégué. Il existe des quartiers et des prisons différentes pour les prisonnier·es politiques palestinien·nes (Israël les appelle « prisonniers de sécurité ») et pour tous·tes les autres. Les conditions sont bien plus difficiles pour les prisonnier·es politiques, dont les visites sont plus limitées, qui n’ont pas accès au téléphone, entre autres restrictions. Cependant, l’organisation, la solidarité et parfois même la résistance y sont également plus fortes. Malgré le fait que je suis poursuivi sur des accusations politiques pour lesquelles les Palestinien·nes sont classé·es « prisonnier·es de sécurité », et bien que j’ai demandé à être détenu avec mes camarades, j’ai toujours été classé comme un détenu « normal ».
Le système israélien comporte trois niveaux d’incarcération distincts : la détention avant inculpation, la détention après inculpation et l’emprisonnement après la condamnation. La détention avant l’inculpation est la phase où les conditions sont les plus mauvaises, où l’accès au monde extérieur est le plus limité. À cette étape, les communications téléphoniques et l’accès à une télévision ou une radio sont interdits, tout comme l’achat de fournitures à la cantine. Aucun livre ou matériel de lecture n’est autorisé, à l’exception de la Bible ou du Coran. Légalement, vous avez droit à une heure de promenade par jour, mais il est rare d’avoir ne serait-ce que quelques minutes. Certaines de ces conditions s’améliorent progressivement une fois que vous êtes inculpé·e ou condamné·e, selon la prison et le quartier dans lequel vous vous trouvez.
Les conditions matérielles sont très variables. Le nombre de personnes dans une même cellule peut aller de deux à vingt ; j’ai connu les deux extrêmes. Je préfère généralement disposer du plus d’intimité possible, mais ça dépend vraiment de qui sont les compagnons de cellule. Être coincé dans une cellule avec une seule autre personne peut être assez difficile à supporter, surtout pour quelqu’un comme moi qui n’est pas très doué pour faire la conversation.
Les drogues et les addictions sont également un problème, et il y en a beaucoup qui circule. Antidouleurs, opiacés, agonistes opioïdes, on trouve de tout. Mais l’approvisionnement n’est jamais stable et il arrive donc souvent d’être bloqué dans une cellule avec plusieurs personnes qui naviguent entre sevrages forcés et défonce. Il y a toujours des bagarres pour avoir une part du peu qui arrive jusqu’aux cellules. Les détenu·es non fumeur·ses ont techniquement le droit d’être placé·es dans des cellules non-fumeurs, mais c’est seulement théorique. En réalité, la seule cellule non-fumeurs dans laquelle j’ai été détenu était une cellule d’isolement. Je n’ai même pas eu droit à une cellule non-fumeurs quand j’ai contracté une bronchite aiguë.
La forme de violence la plus répandue entre détenu·es à part les bagarres à coup de poing est le coup de surin (les filtres de cigarettes brûlés et pressés sont très répandus et faciles à se procurer) et les aspersions d’eau bouillante mélangée à du sucre.
Je suis végan depuis près de trente ans. Je souffre de diabète de type 1 et d’intolérance au gluten (maladie cœliaque) ; je fais aussi de l’épilepsie depuis que j’ai reçu un tir de gaz lacrymogène en pleine tête lors d’une manifestation. Cela fait de la nourriture une lutte constante en prison, car je ne peux pratiquement rien manger qui ait été préparé dans une cuisine de prison. Il faut en général attendre entre une et deux semaines pour que de la nourriture soit disponible et encore plus longtemps pour obtenir tout ce dont j’ai besoin et à quoi j’ai droit. Entre-temps, mon régime alimentaire se compose essentiellement de concombres et, quand j’ai de la chance, de carottes.
Pendant mon dernier passage en prison, j’ai perdu environ 12 kilos en trois semaines – environ 15 % de ma masse corporelle. J’ai contracté une bronchite aiguë qui a fait grimper ma glycémie à des niveaux potentiellement mortels.
J’ai eu la chance d’être assigné à résidence sous caution, principalement en raison de mon état de santé. C’est une chance que les Palestinien·nes n’ont pas. Cette expérience d’incarcération m’a fait douter de la manière dont gérer mon affaire politico-judiciaire, et m’a peut-être même un peu brisé. Il m’a fallu un moment pour récupérer physiquement, et encore plus pour revenir à moi mentalement et émotionnellement. Je devais prendre des décisions sur la façon de gérer l’affaire, mais aucune des options n’était bonne et je n’étais pas en état de les prendre. Au final, j’ai réalisé que j’étais face à un choix binaire : soit je devais revenir sur l’accord que j’avais passé avec moi-même quand adolescent j’avais découvert le monde miroir du véganarchisme, et réalisé à quel point le monde était tordu et foutu, soit je devais le respecter et… continuer à vivre. C’est un choix plutôt facile, non ? Presque pas un choix du tout finalement.
Fais-tu l’objet d’autres accusations ?
À part les accusations dont on a déjà parlé, quelques affaires sont en cours – des accusations pour lesquelles je n’ai pas encore été inculpé, mais je pourrais l’être. La plus notable est celle d’« incitation à la violence et au terrorisme » suite à un article que j’ai publié quand j’étais emprisonné en 2020, qui appelait les gens à soutenir et à rejoindre la résistance palestinienne au colonialisme israélien.

Des manifestant·es à Beita emploient une tactique de « confusion nocturne » pour harceler les colons, en faisant clignoter des pointeurs laser et des lumières sur la colonie, en marchant vers elle avec des torches enflammées et en dirigeant vers elle la fumée de pneus enflammés. Photographie de Oren Ziv/ActiveStills.
Est-ce que tu reçois du soutien de la part de groupes de la société israélienne, depuis la Palestine, à l’international ? Qu’est-ce que les gens peuvent faire pour vous soutenir, toi et celles et ceux qui s’organisent ici ?
J’ai des cercles de soutien au sein de la communauté anarchiste et parmi les Palestinien·nes. Je pense que la chose la plus utile à faire en ce moment est de soutenir les campagnes de boycott, désinvestissement et sanctions (BDS) à l’encontre d’Israël. Il y en a beaucoup, c’est relativement efficace et il est assez facile de s’y impliquer.
Pour ce qui est de me soutenir, j’ai l’impression que soutenir la lutte des prisonnier·es palestinien·nes en général est la meilleure façon de me soutenir personnellement.
Il y a actuellement plus de 5 000 Palestinien·nes détenu·es dans les prisons israéliennes. Environ un quart sont ce qu’Israël appelle des « détenu·es administratifs », qui peuvent être maintenu·es en détention indéfiniment, sans accusation ni procès, sur base de « preuves secrètes ».
Il est estimé qu’un homme palestinien sur cinq vivant sous l’administration israélienne a été incarcéré au moins une fois par Israël.
L’organisation qui soutient le mieux les prisonnier·es palestinien·es est l’Association Addameer de soutien aux prisonniers et de défense des droits de l’Homme2: une organisation palestinienne non gouvernementale qui travaille à soutenir les prisonnier·es palestinien·nes détenu·es dans les prisons israéliennes et palestiniennes. Fondée en 1991 par un groupe de militant·es intéréssé·es par les droits de l’Homme, le centre propose une aide juridique gratuite aux prisonnier·es politiques, défend leurs droits au niveau national et international, et travaille à mettre fin à la torture et aux violations des droits des prisonnier·es par le biais de suivis, de procédures légales et de campagnes de solidarité.
Addameer est l’une des six principales organisations de la société civile palestinienne qu’Israël a qualifiée d’organisation terroriste sans autre forme de procès en 2021, sur la base là-aussi de « preuves secrètes ». Iels font un travail crucial pour soutenir les prisonnier·es politiques palestinien·nes détenu·es par Israël ou par l’Autorité palestinienne et il est essentiel de les soutenir.
Samidoun est un réseau international d’activistes qui s’efforcent de construire une solidarité avec les prisonnier·es palestinien·nes dans leur lutte pour la liberté. Iels travaillent à sensibiliser et à fournir des ressources sur les prisonnier·es politiques palestinien·nes, leurs conditions, leurs demandes, et leur lutte pour la liberté, pour eux, leurs compagnons et pour leur terre. Samidoun s’efforce également d’organiser des campagnes locales et internationales afin de faire advenir des changements et de défendre les droits et les libertés des prisonnier·es palestinien·nes.
Vous pouvez suivre l’évolution de mon affaire ici grâce à mon groupe de soutien local. Ce sera probablement encore dans quelques mois, mais quand je retournerai en prison, ça me ferait plaisir de recevoir du courrier. La façon la plus simple de faire ça est d’envoyer un mail à la même adresse que la dernière fois que j’étais derrière les barreaux support.jonathan@proton.me, et il me sera transmis. Je ferai mon maximum pour répondre, même si mes possibilités sont assez limitées, car les timbres postaux sont rares. Comme toujours quand on écrit à des prisonnier·es, il faut garder à l’esprit que toutes les correspondances sont surveillées.
Historique
Tu as participé à la création d’Anarchists Against the Wall, un collectif qui a bénéficié d’une certaine reconnaissance internationale au début des années 2000. Qu’est-il advenu de ce projet ? Et à quoi ressemble le mouvement anarchiste en Israël aujourd’hui ?
Je n’aime pas vraiment présenter ça comme si j’avais « participé à la création » d’AAtW, surtout parce qu’il me semble que c’est une description erronée de la façon dont ce groupe – et en fait la plupart des groupes d’action directe – a commencé. Il n’y a pas eu un moment en particulier. Au début du millénaire, la Seconde intifada était à son apogée, et nous étions un petit groupe de personnes rejoignant la résistance palestinienne et pratiquant l’action directe. Ça a pris de l’ampleur et nous nous sommes regroupé·es, mais nous n’avons jamais « fondé » un groupe. Même le nom n’a pas vraiment été un choix intentionnel. Nous avions pour habitude d’envoyer des communiqués de presse avec un nom différent à chaque fois. C’est par hasard que ce nom avait été utilisé le jour où l’armée a tiré à balles réelles sur l’un d’entre nous. Dans la frénésie médiatique qui a suivi, nous avons profité de notre notoriété et conservé ce nom.
Vingt ans plus tard, le projet AAtW n’existe plus, mais je pense qu’il y a des leçons à en tirer, à la fois positives et négatives. De la même façon que tout ça a commencé, l’AAtW n’a pas disparu à un moment donné, il s’est étiolé. Les anarchistes vivent dans la société contre laquelle iels luttent et ne sont pas immunisé·es à ses maux. La lutte contre les dynamiques de pouvoir est toujours difficile et je pense que, vers la fin, il était trop difficile de ne pas rester embourbé·es dans nos problèmes. On parle d’un groupe assez restreint de personnes dont les liens politiques ont été en grande partie forgés par l’affinité et la confiance. Un autre point important à souligner, la dissolution de l’AAtW a été contemporaine du reflux de la résistance palestinienne à la fin des années 2010.
Après que je sois déjà parti, le groupe s’est effondré en raison de désaccords fondamentaux sur les questions de violence et de non-violence. L’histoire de l’anarchisme contemporain en Israël publiée par CrimethInc. en 2013 raconte à mon avis assez bien cette partie de l’histoire, bien que je sois en désaccord avec certaines des autres questions abordées dans le texte.
Les anarchistes sont toujours impliqué·es dans la résistance au sionisme et à la colonisation israélienne. En accord avec ses « origines », le mouvement anarchiste en Israël reste aussi très attaché à la question du droit des animaux. Les gens qui font partie du mouvement sont impliqués dans le soutien aux réfugié·es et aux personnes sans-papiers, dans l’activité culturelle et contre-culturelle, dans l’éducation radicale, etc.
Cependant, bien que les anarchistes soient présent·es à chaque fois qu’un activisme radical émerge, j’ai l’impression qu’il n’existe pas de mouvement anarchiste distinct pour le moment, peut-être en raison de l’absence d’une forte tradition anarchiste ici.

Jonathan Pollak arrêté lors d’une manifestation dans le village cisjordanien de Nabi Saleh en 2011. Photographie de Oren Ziv/ActiveStills.
De ce point de vue, qu’est ce qu’Anarchists Against the Wall a réussi à accomplir selon toi ? Quelles leçons – ou au moins quelles hypothèses – transmettrais-tu aux anarchistes d’ailleurs sur la base de tes expériences ?
Je pense qu’à cause de l’exposition relativement importante dont a bénéficié AatW, les gens ont tendance à faire de ce collectif plus que ce qu’il n’était en réalité. Au début, ce n’était guère plus qu’un petit groupe de personnes très déterminées, un groupe affinitaire élargi en fait. Il s’est ensuite un peu développé, avec quelques dizaines de personnes composant son noyau et peut-être quelques centaines d’autres gravitant autour de manière sporadique.
À mes yeux, la caractéristique la plus importante d’AAtW était l’abandon des fausses allégeances nationales et même des identités, en faveur d’un changement de camp pour rejoindre directement la lutte des Palestinien·nes contre le colonialisme israélien. Dans une société soudée et militariste comme Israël, c’était un écart considérable par rapport aux traditions de la gauche. Ce n’est sans doute pas grand-chose, mais c’était quand même extraordinaire. Notre but était de reconnaître notre position privilégiée, et de l’utiliser en la renversant dans notre relation avec la résistance palestinienne. Pas pour arriver comme des chevaliers blancs, mais plutôt comme une ressource. Nous avions comme principe de base de rejoindre la lutte palestinienne et de suivre les recommandations des Palestinien·nes.
Je crois que le fait de nous considérer comme des allié·es participant à la lutte plutôt que comme des sympathisant·es issu·es du contexte de la société israélienne a été la plus grande contribution de l’AatW, et celle qui a eu l’effet le plus durable, y compris en dehors de son cercle le plus proche.
En tant que groupe initialement petit et très soudé, il n’était au début pas nécessaire d’articuler beaucoup de questions. Certaines choses étaient très claires pour la plupart des personnes impliquées, alors qu’elles étaient très tabou dans la politique israélienne, même dans les franges les plus radicales – par exemple, notre attitude envers la violence, notre place dans la lutte ou notre position antagoniste vis-à-vis d’Israël. Tout cela s’est dilué et est devenu sans doute plus confus à mesure que le groupe a pris en importance. AAtW était à l’époque la seule organisation qui soutenait directement la résistance populaire en Cisjordanie, ce qui signifie qu’au fil du temps, des personnes ont rejoint le groupe en partageant certains des principes de base sans pour autant être d’accord avec l’orientation politique d’origine. Rétrospectivement, en commençant comme un petit groupe homogène d’action directe, nous n’avions pas à disposition les outils pour faire face à ce qui allait arriver.
Je suis à peu près certain que la solution ne se trouve pas dans une ligne politique stricte, mais je considère que les désaccords qui ont émergé sur des sujets comme le militantisme ou la question de savoir si nous devions adopter une perspective israélienne ou anti-israélienne ont été le principal catalyseur de mon départ du groupe. Peut-être que c’est la leçon à retenir, que la bonne vieille organisation anarchiste en groupes affinitaires est le meilleur moyen de permettre une organisation à plus grande échelle tout en conservant l’autonomie et la diversité, et sans forcer un compromis politique étouffant. Bien sûr, il n’existe pas de solution miracle, et certains des problèmes auxquels l’AAtW a été confrontée après mon départ n’avaient rien à voir avec tout cela, mais j’ai le sentiment qu’il s’agit quand même d’une leçon pertinente à retenir.
Quel impact le nouveau gouvernement a-t-il eu sur les sociétés israéliennes et palestiniennes dans leur ensemble ? Comment la nouvelle législation limitant les pouvoirs de la Cour Suprême peut-elle affecter la situation, à la fois pour toi personnellement, mais aussi pour les activistes en général ? [Cette question et la réponse qui suit ont été rédigées avant les événements du 7 octobre.]
Le gouvernement actuel est l’un des pires et des plus dangereux qu’Israël ait jamais connu, et pourtant la barre est haute. Il exprime et applique de manière flagrante des politiques de nettoyage ethnique. Les menaces qu’il représente sont nombreuses, mais la plus importante est sans doute celle qui lui est la moins spécifique : ce gouvernement est l’incarnation de la course effrénée de tous·tes les politicien·nes israélien·ne vers l’extrême droite. Le principal point de discorde au sein de la société israélienne, et celui qui attire le plus l’attention à l’échelle internationale, est l’attaque contre le système judiciaire – mais il s’agit là d’un désaccord presque esthétique, maquillé sous la forme d’une lutte pour la démocratie. En réalité, il s’agit d’un conflit interne sur la meilleure façon de gérer et de maintenir la suprématie juive, qui jouit d’un soutien presque total dans la société israélienne, y compris parmi les soi-disant libéraux.
Les changements spécifiques que la coalition actuelle cherche à mettre en œuvre affaibliront sans doute les tribunaux et les rendront certainement un peu moins libéraux, mais les tribunaux n’ont jamais défendu nos droits et encore moins ceux des Palestinien·nes, et n’ont jamais freiné les politiques gouvernementales. Même pas un peu. Le système judiciaire israélien est et a toujours été une pierre angulaire du colonialisme israélien entre le fleuve et la mer ; il a été essentiel pour permettre la mise en œuvre des politiques sionistes et fournir au système qui les entoure un habillage juridique libéral de bon aloi. Israël dépend de sa capacité à se présenter et à se vendre comme une soi-disant démocratie dynamique. L’affaiblissement du système judiciaire pourrait être préjudiciable, mais je crois que la perspective d’une victoire du mouvement de protestation représente un danger encore plus grand pour la lutte globale contre le colonialisme et l’apartheid.
Le mouvement de protestation est dominé par un amalgame de militaires réservistes, d’anciens hauts responsables de la célèbre police secrète israélienne, le Shin Bet, d’économistes libéraux, et de divers autres groupes de sionistes et de nationalistes. Quelques éléments plus radicaux se sont aussi impliqués, mais leur rôle et leur influence sont minimes. Le drapeau israélien est composé de symboles juifs, et est un emblème de l’exclusivité et de la suprématie juive, et ce n’est donc pas une surprise qu’il soit le principal symbole du mouvement de protestation. Ces groupes sont attachés à l’idée qu’Israël est une démocratie et que la suprématie juive n’est pas en contradiction avec cette idée. Dans l’ensemble, c’est aussi le sentiment le plus répandu parmi les foules qui participent aux manifestations. Toute victoire du mouvement sera utilisée pour renforcer l’idée erronée et dangereuse selon laquelle la démocratie israélienne a triomphé, suggérant à tort que la démocratie israélienne a déjà existé.

Manifestants à Beita. Photographie de Oren Ziv/ActiveStills.
Les anarchistes ont-ils joué un rôle dans les manifestations ?
La question de la participation aux manifestations a divisé les anarchistes locaux. Alors que beaucoup se sentent exclu·es, certain·es se sont impliqué·es dans le « Bloc radical », qui, comme son nom l’indique, est une coalition souple de radicaux·ales participant aux manifestations. De ce que j’en comprends, iels se considèrent davantage comme des contre-manifestant·es.
Bien que je respecte le choix d’essayer de mobiliser la société israélienne et les efforts qui sont investis là-dedans, je pense néanmoins qu’il s’agit d’une erreur étant donné les circonstances actuelles. Le mouvement de protestation est si vaste – et si fermement enraciné dans l’idée qu’Israël est une démocratie qui doit être sauvée – qu’il aspirera, cooptera ou éliminera toute tendance divergente en son sein. Pour les raisons expliquées précédemment, je crois que le mouvement actuel est peut-être la plus grande menace pour la lutte contre le colonialisme depuis les accords d’Oslo, et qu’Israël est capable de l’utiliser pour rétablir sa position internationale de la même façon que les accords d’Oslo avaient été utilisés pour se remettre de la Première intifada au début des années 1990. À cette époque, tout ce qui s’est passé en fin de compte, c’est le renforcement de la domination sur les Palestinien·nes et l’intensification de leur dépossession.
Dans les années 1990, l’extrême droite israélienne, qui considérait les accords d’Oslo comme un compromis défaitiste, s’y était opposée et était descendue massivement dans la rue. Nous aussi, nous opposions aux accords – car il était clair déjà à l’époque qu’ils seraient utilisés par Israël pour sa propre réhabilitation ou pire, pour éradiquer le soulèvement palestinien. À aucun moment, cependant, nous n’avons considéré rejoindre les manifestations massives de la droite pour contrecarrer l’exécution des accords. Je crois que la situation aujourd’hui est assez similaire. Peut-être qu’un exemple plus familier serait à chercher dans l’opposition de nombreux fascistes et nazis à la globalisation. Est-ce que quiconque pourrait ne serait-ce qu’imaginer se joindre à eux ?
Pour autant, mon malaise à l’idée de participer de près ou de loin aux manifestations pour la fausse démocratie est plus profond. Je pense que dans une situation coloniale comme celle de la Palestine, notre rôle n’est pas, et ne devrait pas être celui de modéré·es dans au sein d’une société coloniale. Nous devons rejeter cette société, son point de vue, sa politique interne. Nous devons comprendre que la disparité du pouvoir signifie que le changement ne peut pas venir de l’intérieur de la société israélienne. Notre rôle est de l’affaiblir, de créer des failles, de semer la division, de résister fermement. En période de conflit, nous ne devons pas essayer de nous frayer un chemin dans la société israélienne, mais de nous en éloigner et de lutter contre elle.
Depuis l’extérieur, toute la région ressemble à une poudrière prête à s’enflammer. Que faudrait-il pour que quelque chose de positif se produise ? Qu’est-ce qui te donne de l’espoir ?
Je ne préfère pas faire le commerce de l’espoir, car comme tout commerce, c’est un spectacle de tromperie. J’ai grandi dans le mouvement de libération animale du milieu et de la fin des années 1990, à l’époque de la première « Peur verte ». Je me souviens d’avoir lu une lettre que Free (Jeff Luers) avait envoyée depuis sa cellule à un zine, peut-être un an ou deux après sa condamnation, et qui a eu un impact durable sur moi. C’était il y a longtemps et je n’arrive pas à retrouver cette lettre même si internet est censé rendre les documents les plus rares accessibles d’un clic. Je vais sans doute répondre un peu à côté, mais Free, condamné à plus de vingt ans de prison, évoquait la rébellion du ghetto de Varsovie pour montrer que l’espoir ou la perspective de réussite n’est pas un critère pertinent de lutte ou de résistance. Cela a fait mouche pour moi à l’époque, et c’est encore le cas aujourd’hui.
Le futur ne peut pas être prédit. Un·e bon·ne ami·e qui avait été impliqué·e dans la résistance clandestine au régime d’apartheid en Afrique du Sud m’a confié que la fin des années 1980 avait été la période la plus sombre. [Le président Pieter Willem] Botha était au pouvoir, les États-Unis soutenaient encore fermement l’Afrique du Sud blanche en tant qu’important bastion antisoviétique, et la fin de l’apartheid était encore loin d’être en vue. Puis l’URSS s’est effondrée et la situation géopolitique a radicalement changé, presque du jour au lendemain. Au début, tout le monde croyait que tout était terminé, car les Soviétiques étaient les principaux soutiens de l’ANC. Mais un effet secondaire moins évident était que le gouvernement d’apartheid pro-occidental d’Afrique du Sud se trouvait soudainement beaucoup moins important dans le monde post-Guerre froide ; le fait qu’un fort mouvement existait déjà sur place pour profiter de ces changements géopolitiques a été à l’origine du changement politique et de la chute (imparfaite) de l’apartheid.
La morale de l’histoire c’est qu’il faut organiser et construire des mouvements de résistance même quand tout semble perdu. Ma vision de l’anarchisme n’est pas utopique. À mes yeux, chaque victoire, chaque succès, doit immédiatement être perçue comme un échec, comme une structure de pouvoir à combattre et à abattre. On dit que le mieux est l’ennemi du bien, mais c’est seulement parce qu’on manque d’imagination et que le bien n’est jamais assez bien. L’imperfection est une constante, mais on continue de se battre, transformant chaque victoire en défaite puis en lutte.

Jonathan Pollak escorté à une audience de placement en détention provisoire au tribunal de première instance de Jérusalem, les jambes entravées. Photographie de Oren Ziv/ActiveStills.
Appendice: Déclaration de Jonathan Pollak suite à sa condamnation
Dix manifestants ont été tués par les soldats israéliens dans le village cisjordanien de Beita près de Naplouse depuis que les manifestations ont commencé, en mai 2021. Le 27 janvier de cette année, j’ai été arrêté par des agents de la police aux frontières israélienne alors que je rentrais chez moi après une manifestation contre le colonialisme israélien et le vol des terres du village en vue de l’établissement d’une nouvelle colonie exclusivement juive. J’ai ensuite été inculpé pour jet de pierres, et je me tiens maintenant devant ce tribunal pour plaider ma cause. L’affaire repose uniquement sur les faux témoignages des trois agents de la police aux frontières qui m’ont arrêté. La police a refusé de mener une enquête sérieuse au-delà de ces témoignages, même après que j’ai explicitement rapporté avoir entendu les trois agents coordonner leurs témoignages entre eux. Contrairement à la police, qui ne pouvait pas se donner la peine de le faire, j’ai des preuves qui discréditent les témoignages des agents et montrent qu’ils sont truffés de mensonges. Dans des conditions normales, ce serait un procès que je serais heureux de laisser se dérouler jusqu’au bout.
Les circonstances, cependant, sont loin d’être normales. Cette affaire, de manière inhabituelle, se déroule après que l’accusé – moi – a demandé à ce que le procès se déroule non pas à la cour pénale israélienne, mais plutôt dans un tribunal militaire bien plus draconien, où les Palestinien·nes sont jugé·es pour des faits similaires. J’ai demandé à être jugé par un tribunal militaire, car c’est là que mes camarades palestinien·nes, qui sont régulièrement arrêté·es lors de manifestations comme celle après laquelle j’ai été arrêté, sont jugé·es et condamné·es à de lourdes peines sur la base de maigres preuves, souvent fabriquées de toutes pièces. Comme on pouvait s’y attendre, le procureur s’est opposé à cette demande et le tribunal l’a rejetée. Le raisonnement médiocre (et pas tout à fait exact) du procureur de la République était que mon lieu de vie ne se trouvait pas en Cisjordanie. Cependant, les colons israéliens qui vivent et travaillent en Cisjordanie ne sont, par principe, pas non plus inculpés par les tribunaux militaires. Où se trouve alors leur « lieu de vie » ? Le principal argument de la cour pour rejeter ma demande était que les délits pour lesquels j’étais poursuivi n’étaient pas classés comme des délits « de sécurité ».
Je ne suis pas expert en droit et je n’ai pas les outils pour évaluer la légalité de la décision de la cour, et je n’y accorde de toute façon pas beaucoup d’importance. Mais une chose est sûre : les Palestinien·nes, et pas seulement celles et ceux qui vivent directement sous la dictature militaire qu’Israël exerce en Cisjordanie, sont jugé·es par milliers dans les tribunaux militaires israéliens pour des chefs d’accusation identiques ou similaires. Je ne suis épargné d’un tel sort que parce que l’État me considère à la fois comme un citoyen et comme un membre de la religion juive dominante. Mon ami Tareq Barghouth – un Palestinien habitant à Jérusalem et ancien membre du barreau israélien – a été jugé, reconnu coupable et condamné par un soldat israélien en uniforme dans un tribunal militaire en Cisjordanie. Pendant ce temps, Amiram Ben Uliel, un habitant d’un avant-poste colonial israélien en Cisjordanie et meurtrier de la famille Dawabsheh, qui a été reconnu coupable d’infractions terroristes autrement plus graves, a été jugé dans un tribunal civil à Jérusalem.
Il y a à peine deux mois, des colons israéliens ont abattu Qussai Ma’atan dans le village de Burqa en Cisjordanie. Deux colons ont été arrêtés pour suspicion de meurtre. Au même moment, des habitants de Burqa ont également été arrêtés pour des soupçons bien moins graves, à savoir d’avoir participé aux affrontements qui ont suivi l’invasion de leur village par des colons. Plusieurs audiences ont eu lieu dans l’affaire des colons. Elles ont été tenues dans un tribunal civil israélien, avant même qu’une seule audience ait eu lieu dans l’affaire des Palestiniens, qui a été jugée par un tribunal militaire. La raison est simple, les Palestinien·nes ne doivent être présenté·es à un tribunal qu’après un délai de 96 heures, soit quatre fois le délai prévu par le Code pénal israélien.
Cette politique discriminatoire a beau en effet être considérée comme légale selon les standards de la loi israélienne, au fond, dans son cœur, elle n’en reste pas moins l’expression distincte du régime d’apartheid d’Israël entre le fleuve et la mer.
Mais la loi n’est pas la justice. L’apartheid sud-africain était protégé par la loi en son temps, comme le colonialisme français en Algérie, la suprématie blanche en Rhodésie et d’innombrables autres régimes coloniaux vaincus qui étaient manifestement injustes. La loi, dans les faits, est souvent conçue pour être le contraire de la justice.
L’injustice du statu quo est si évidente et indéniable que même l’ancien chef du célèbre Mossad, Tamir Pardo, a été récemment forcé de reconnaître que « dans un territoire où deux peuples sont jugés selon deux systèmes judiciaires, il s’agit d’un État d’apartheid. »
Cette affaire, malgré ce que la lecture de l’acte d’accusation pourrait laisser penser, n’a pas grand-chose à voir avec une émeute, ou avec l’obstruction et l’agression de policiers, mais plutôt avec la répression et la criminalisation de la résistance au colonialisme israélien et à son régime d’apartheid. Ma réponse aux accusations et aux faits décrits dans l’acte d’accusation n’est pas pertinente. Puisque la manière même dont cette audience est menée est une expression de l’apartheid israélien, ma coopération serait de la complaisance. Depuis plus de vingt ans j’ai consacré mon temps à lutter contre le régime colonial d’Israël, et je ne veux ni ne peux coopérer avec lui maintenant, même si ma décision signifie que je serai à nouveau mis derrière les barreaux.
Par conséquent, bien que n’ayant aucune intention d’admettre quelque chose que je n’ai pas fait, je n’interrogerai pas les témoins de l’État, je n’appellerai personne pour me défendre et je ne témoignerai pas moi-même ; je ne contesterai pas les soi-disant preuves de l’accusation ni ne présenterai la moindre preuve pour me défendre. Le colonialisme israélien et son régime d’apartheid sont illégitimes dans leur essence même. Ce tribunal est illégitime. Les procédures dans cette affaire, qui complètent d’autres procédures dans des tribunaux militaires parallèles et illégitimes, dont la raison d’être est la suppression de la résistance, sont toutes illégitimes. La seule réponse raisonnable à cette accusation, à cette réalité, est la lutte pour la liberté et la libération. Aucune voix n’est plus forte que celle du soulèvement !
- GÉNÉRALISTES
- Basta
- Blast
- L'Autre Quotidien
- Alternatives Eco.
- La Croix
- Euronews
- Le Figaro
- France 24
- FTVI
- HuffPost
- L'Humanité
- LCP
- Le Media
- Le Monde
- Libération
- Mediapart
- La Tribune
- EUROPE
- Courrier Europe Centle
- Euractiv
- Toute l'Europe
- INTERNATIONAL
- Equaltimes
- CADTM
- Courrier International
- Global Voices
- Info Asie
- Inkyfada
- I.R.I.S
- Jeune Afrique
- Kurdistan au féminin
- N-Y Times
- Orient XXI
- Of AFP
- Rojava I.C
- OSINT / INVESTIGATION
- OFF Investigation
- OpenFacto°
- Bellingcat
- Disclose
- G.I.J.N
- MÉDIAS D'OPINION
- AOC
- Au Poste
- Cause Commune
- CrimethInc.
- Issues
- Les Jours
- Le Monde Moderne
- LVSL
- Marianne
- Médias Libres
- Quartier Général
- Rapports de force
- Reflets
- Rézo
- StreetPress
- OBSERVATOIRES
- Armements
- Acrimed
- Catastrophes naturelles
- Conspis
- Culture
- Extrême-droite
- Human Rights
- Inégalités
- Information
- Internet actu ✝
- Justice fiscale
- Liberté de création
- Multinationales
- Situationnisme
- Sondages
- Street-Médics
- Routes de la Soie
- Vrai ou Fake ?