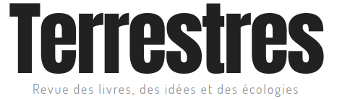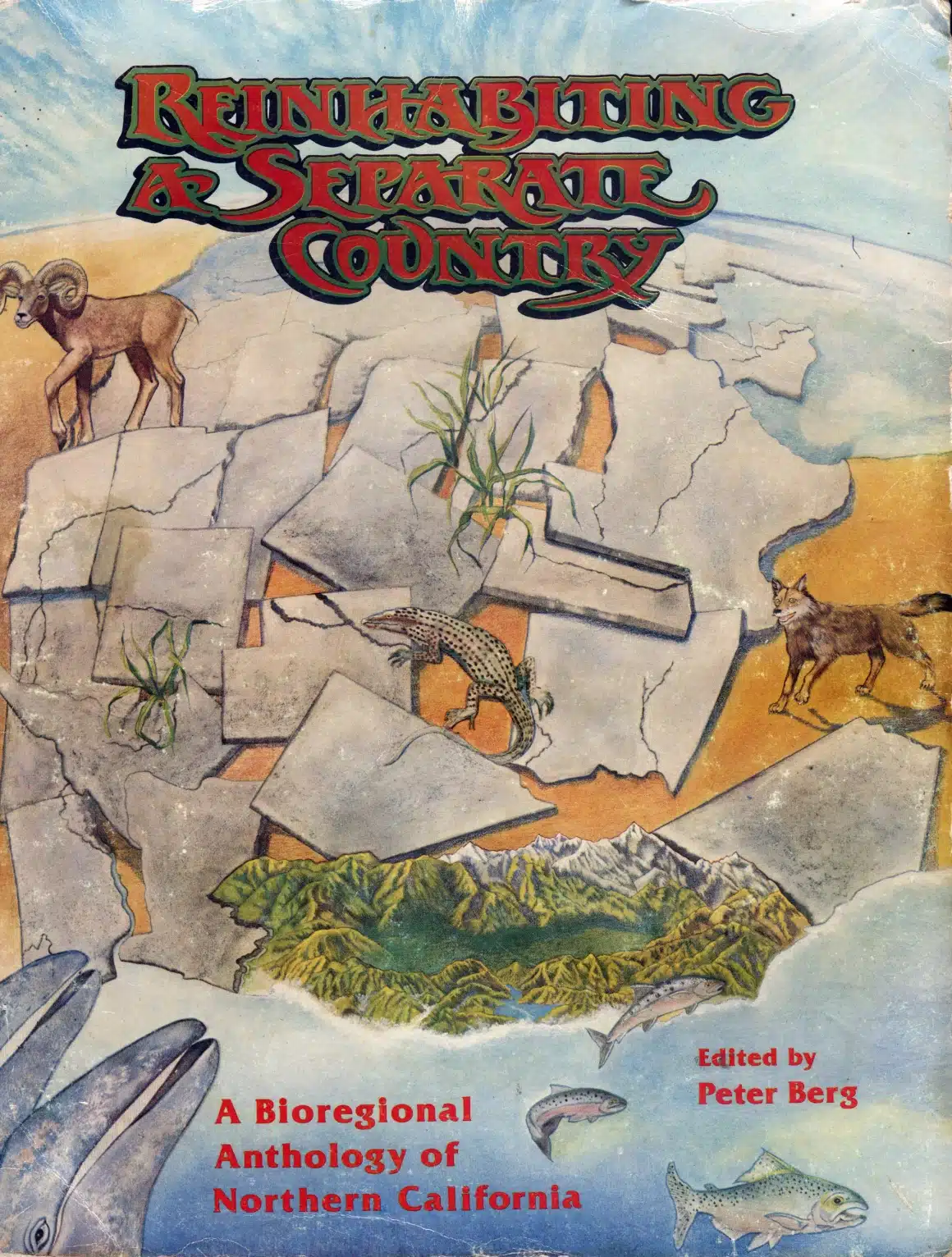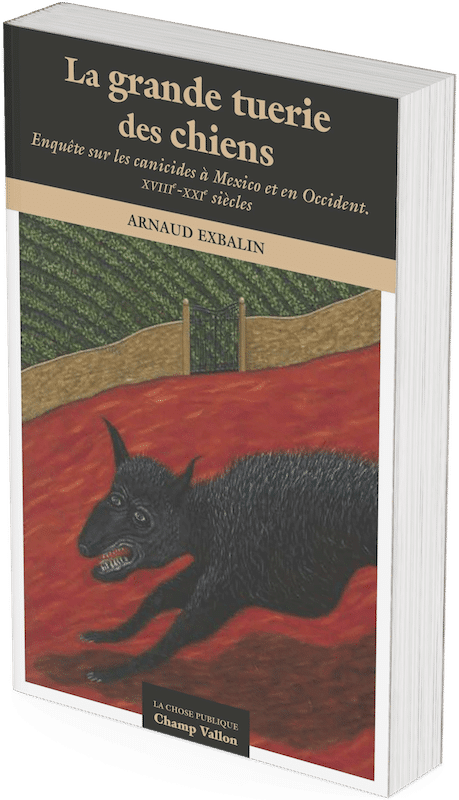
À propos de La grande tuerie des chiens. Enquête sur les caninicides à Mexico et en Occident (XVIIIe-XXIe siècles), Arnaud Exbalin, Champ Vallon, collection « La chose publique », 2023.
Plusieurs campagnes d’extermination des chiens errants se sont déroulées dans les rues de Mexico à la fin du XVIIIe siècle. Ces tueries étaient assurées par la police de proximité, aux heures creuses de la nuit, et la comptabilité des cadavres de chiens était consignée par écrit. L’ouvrage La grande tuerie des chiens part précisément de la découverte, aux archives municipales de Mexico, d’une liasse recensant près de 35 000 de ces exécutions de chiens pour la seule décennie 1790.
Il est toujours délicat d’analyser la violence d’une société dont on n’est pas. À travers les archives, l’historien doit se laisser dépayser par des comportements révolus, étrangers à sa propre sensibilité, en s’interdisant l’anachronisme de ses jugements moraux. Dans un essai intitulé Le grand massacre des chats, Robert Darnton avait ainsi cherché à expliquer à travers le contexte social et culturel du Paris d’Ancien Régime la cruauté hilare des ouvriers typographes qui, en 1730, avaient mis à mort tous les félins de la rue Saint-Séverin. Arnaud Exbalin rend d’ailleurs hommage dans son titre à cet essai devenu célèbre parmi les historiens. Pourtant, La grande tuerie des chiens n’explore pas seulement la distance qui nous éloigne des rapports d’antan entre humains et animaux. L’enquête dévoile surtout la diversité d’opinions et d’attitudes qui s’opposent et se répondent dans le Mexico du XVIIIe et du début du XIXe siècle : vice-rois, policiers, vendeuses d’étal, maîtres de chiens et voleurs, les chiens eux-mêmes, chacun a eu des raisons pour agir et réagir d’une manière différente.
Ainsi, l’auteur cherche d’abord à éclairer les discordances d’intérêts et les raisons des dissensus à l’œuvre au cours des campagnes de « décanisation », c’est-à-dire d’élimination ou réduction de la population canine dans un espace donné. Cela apparaît clairement dans les condamnations de policiers pour des actions jugées abusives, comme l’exécution d’une chienne de race et la confiscation de ses chiots, ou la protestation d’un voisinage contre une descente policière menée contre les chiens du quartier.
À première vue, les quantités de chiens liquidés et l’appareil institutionnel mobilisé peuvent déconcerter : pourquoi faire des chiens de rue une affaire de vice-roi ? En orchestrant le massacre méthodique des chiens de rue, la police de Mexico dénoue à coup de burin les rapports que les animaux et les humains de Mexico ont construits et entretenus durant toute l’époque moderne. Et c’est cela, le sujet de La grande tuerie des chiens : le changement de mœurs des citadins et des chiens tel qu’il se joue dans l’exécution sommaire des chiens sans maître. De fait, les massacres de chiens à Mexico dans les années 1790 sont discutés à la lumière d’autres politiques de décanisation ayant eu cours dans d’autres villes d’Europe et d’Amérique. Ainsi, l’ouvrage aborde de manière plus large les logiques communes aux réformes des institutions urbaines durant le siècle des Lumières, à la transformation écologique des villes entre le XVIIIe et le XIXe siècle et à cette espèce de « procès de civilisation » urbain qui tient dans la clarification des rapports anthropozoolgiques légitimes.
Entre chien et loup : domestication, rapports anthropozoologiques et féralisation
Avant de discuter l’ouvrage, il convient d’établir le caractère historique du chien, la plus ancienne des domestications et la seule à survenir au paléolithique. Elle est aussi la plus universelle puisqu’elle accompagne la diffusion de l’humanité y compris dans la migration de la Sibérie vers l’Alaska, avant l’élévation du niveau de la mer du début de l’Holocène. Pour se faire une idée de la grande gamme de rapports possibles auxquels la domestication du loup peut aboutir dans les différentes régions du monde, il suffit de voir comment le chien actionne des travois dans les plaines du Mississippi tandis qu’il constitue un mets de luxe pour les aristocraties incaïques des Andes. Avec les invasions espagnoles, les chiens de chasse et les chiens de berger débarquent et agissent dans les batailles et les campagnes mésoaméricaines. Ce faisant, les colons ibériques n’introduisaient pas une nouvelle espèce animale, mais ils introduisaient, par contre, des rapports anthropozoologiques tout à fait nouveaux dans cette région du monde où les chiens n’étaient employés ni comme arme de guerre ni comme outil de travail.
Entre les événements de l’invasion européenne et les millénaires de compagnonnage canin en Mésoamérique, on comprend l’intérêt d’enrichir l’enquête sur les massacres de chiens avec des « focales » historiques plus amples, de la domestication canine aux bouleversements écologiques enclenchés par la Conquête espagnole, en passant par la longue durée des rapports anthropozoologiques : « La rencontre entre le molosse espagnol dévoreur d’Indiens et le chien autochtone, le xoloitzcuintle, sera une manière de relire l’histoire du Mexique colonial » (p. 25). Ce faisant, l’ouvrage accomplit le tour de force de discuter des travaux de différentes disciplines — archéologie, histoire et anthropologie. Toutefois, nous voudrions discuter cette proposition historiographique dont la pertinence ne fait aucun doute, mais dont l’application pose un problème de méthode intéressant. Comment articuler dans un même récit des échelles de temps aussi disparates que le demi-siècle, la millénaire divergence biologique entre le chien et le loup, et le long divorce géographique entre l’Amérique et l’Eurasie ?
Une partie de l’histoire d’extrême longue durée des rapports entre chiens et humains se joue également dans des temporalités suffisamment brusques pour que l’observation à l’œil nu de l’archive enrichisse l’observation au microscope des ossements archéozoologiques.
Ces différentes temporalités sont certes télescopées par les débarquements européens du début de l’époque moderne, mais il est difficile d’analyser les changements des rapports entre humains et chiens dans le contexte mexicain du XVIe siècle en renvoyant le lecteur à des considérations sur les évolutions précoloniales des sociétés américaines dans la longue durée (p. 50-61). Ainsi, la place des chiens dans la culture teneek au XXe siècle et les récits de voyageurs français dans l’Amérique du Nord du XVIIe siècle sont des contrepoints qui donnent matière à réfléchir, mais il est difficile de les mettre en relation avec ce qu’il se passe dans la Nouvelle-Espagne du XVIe siècle (sauf à postuler une indianité générique, ce que l’auteur ne fait pas). Ainsi, bien que l’auteur déconstruise à tour de rôle les représentations des chiens de la propagande anti-espagnole qui circule dans l’Europe de l’époque moderne, l’imagerie nationaliste du Porfiriat et les métaphores du muralisme mexicain, le propos de l’auteur est parfois piégé par la métaphore de départ : celle des « antagonismes canins », entre les chiens sanguinaires des colons et la race de chiens muets que les Mésoaméricains élevaient pour des sacrifices rituels et une consommation alimentaire. Il y a comme une opposition parfaite entre le dogue de guerre utilisé par les conquistadores dans des mises à mort spectaculaires (aperreamiento) et le chien glabre et édenté qui deviendra symbole national dans les bras de Frida Kahlo, le fameux xoloitzcuintle. Opposition parfaite, car artificielle, puisqu’il s’agit d’un symbolisme grossier qui représente mal la diversité de chiens de l’Europe comme du Mexique et qui représente plus mal encore les conquêtes coloniales qui n’ont été possibles qu’avec le concours de groupes politiques indigènes alliés aux Espagnols
Quoiqu’il en soit, par-delà l’extrême longue durée des rapports entre chiens et humains, une partie de cette histoire se joue également dans des temporalités suffisamment brusques pour que l’observation à l’œil nu de l’archive enrichisse l’observation au microscope des ossements archéozoologiques. C’est précisément dans cette temporalité d’historien que les hypothèses de l’auteur prennent toute leur force. De même que les massacres rompent des relations anthropozoologiques de longue haleine, les interactions quotidiennes constituent une forme de conditionnement et de sélection des chiens de ville, ou les chiens de campagne avec la chasse au lévrier ou la garde de moutons. Par ailleurs, les introductions biologiques menées par les Espagnols ont eu des effets imprévus et qui échappent au sens propre du terme de leur contrôle : une fois la séquence militaire achevée, on assiste à la formation de bandes de chiens féralisés qui menacent les troupeaux des éleveurs. La forme des corps, le comportement intra- et inter-espèce et l’évolution des populations de chiens ne peuvent pas être considérés comme des données naturelles et des invariants historiques. Fatalement, toute étude dédiée au chien relève nécessairement de l’histoire humaine, y compris lorsque leurs rapports se désengagent.

Pour éviter les malentendus, il convient de signaler que l’auteur emploie le concept de domestication pour désigner la divergence biologique du chien d’avec le loup au fil des interactions avec les sociétés humaines, mais également pour caractériser une sélection génétique ou une modification d’ordre éthologique d’une espèce domestique. Il est possible, par conséquent, que les biologistes ou les éthologues se crispent devant l’emprunt de leurs concepts, comme ceux de domestication ou de féralisation, quand leur usage devient trop libre. C’est ainsi que certaines facilités de langage pourraient être reprochées à l’auteur, comme la métaphore du retour à l’état sauvage pour la féralisation : « La domestication peut, dans certaines configurations et pour certaines espèces, être susceptible de régresser. Le chien, le cheval ou le cochon, cas bien connus, faute d’empreinte humaine, ont la faculté de “ repasser ” à l’état sauvage et donc de se déprendre de leur état domestique » (p. 50). Or, l’idée de régression de la domestication cache l’irréversibilité du processus évolutif. Autrement dit, un chien qui s’éloigne des rapports domestiques ne devient pas loup, mais chien « ensauvagé
Cette réserve ne saurait entacher l’intérêt interdisciplinaire de l’ouvrage : travailler l’historicité des rapports anthropozoologiques et l’évolution d’un animal domestique à travers la problématique de la féralisation est une entreprise encore rare et l’ouvrage montre avec force combien l’Amérique coloniale est un terrain privilégié pour écrire cette histoire. Ainsi, l’auteur reprend une discussion extrêmement intéressante sur les configurations anthropozoologiques dans la longue durée, ce qui donne du relief à son interprétation sur les tueries de chiens : « En faisant éliminer les canidés par milliers et en réitérant l’opération pendant des décennies, les autorités auraient incité les propriétaires à reprendre le contrôle sur leurs propres chiens, ce qui engendra des formes de domestications urbaines où l’homme, lié par la laisse, était lui-même inclus dans le processus » (p. 13). Par ailleurs, l’expression d’« entreprise domesticatoire » (p. 63) rappelle la proposition de Jean-Pierre Digard qui parlait de « système domesticatoire » pour étudier, par-delà la divergence biologique de la domestication, les rapports historiques entre les écosystèmes, les sociétés humaines et les espèces animales.
De fait, les hypothèses de l’auteur sur l’évolution historique de l’éthologie canine résonnent parfaitement avec des concepts récemment développés dans les études animales. Nous pensons notamment aux travaux sur les « collectifs symbiotiques
Pour une lecture critique des travaux de Scott, lire aussi sur Terrestres : Charles Stépanoff,« Comment en sommes-nous arrivés là ? », juin 2020.
Précisément, A. Exbalin signe des passages riches sur l’éthologie canine en contexte historique, notamment lorsqu’il montre de manière particulièrement convaincante les rapports entre la capacité trophique d’un espace urbain, la déprise anthropique qui suit une catastrophe — politique ou écologique — et la prolifération de chiens que les acteurs historiques constatent, par exemple, après l’inondation de Mexico en 1629 (p. 92-96). En mettant ainsi en système agents écologiques, conjoncture politique et développement urbain, l’auteur livre un bel exemple d’interdisciplinarité entre écologie et histoire. Par ailleurs, il y a des passages particulièrement passionnants sur les interactions entre humains et canidés à l’échelle quotidienne. Lorsque l’auteur explique la perception policière du désordre du marché ou de la nuit par l’impuissance à gouverner (p. 109-111), il parvient également à donner sens aux aboiements des chiens qui préviennent leurs maîtres voleurs de l’intrusion de policiers, aux infidélités des chiens de garde face au bout de viande qui achète leur silence, aux amabilités du voisinage pour des chiens qui n’ont pas besoin de maître attitré pour vivre parmi les humains. En prenant les tueries de chiens comme objet d’étude, A. Exbalin élargit la focale sur toutes les interactions entre humains et non-humains dans lesquelles s’inscrivent les politiques canicides de la ville.
Coulisses de la modernité : massacres de chiens, éclairage public et police des mœurs
Au cœur de l’ouvrage, du deuxième au sixième chapitre, A. Exbalin plonge le lecteur dans le vacarme d’un Mexico révolu, dans les tracas habituels des voisinages, les calculs politiques des vice-rois et les combines entre éboueurs et policiers. Ce faisant, il accorde une grande attention à la temporalité quotidienne, en racontant par exemple comment les vaches laitières étaient amenées avant l’aube depuis les campagnes environnantes jusque dans les places de Mexico. Aux premières lueurs du jour, c’était aussi dans l’une de ces places que la comptabilité des chiens abattus au cours de la nuit était faite. La ville se réveillait, les étals se déployaient et les passants cheminaient pendant que les dépouilles de chiens, une patte tranchée à chaque cadavre pour prévenir la fraude, étaient expulsées hors de la ville (p. 85-88), tandis que les chiens de rue ayant survécu à la nuit se terraient dans les terrains vagues où s’amassaient les ordures.
Le zèle contre les chiens pouvait permettre la revalorisation de son salaire, l’obtention d’une titulature et l’acquisition d’une monture.
Car, depuis la réforme de la police municipale en 1790, les routines du jour et celles de la nuit qui donnaient la ville en partage entre chiens et humains sont en mutation. L’éclairage public et la menace des hallebardes refoulent les chiens errants des espaces centraux de Mexico. La nuit tombée, chacun des policiers de proximité prenait son poste, allumait sa lampe à huile et signalait périodiquement sa présence en clamant l’heure. Il patrouillait à l’affût des urgences : signaler un incendie, appeler un curé pour une extrême-onction, amener un médecin pour un accouchement. Ce corps de police était composé, à son origine en 1790, de 90 hommes munis d’une hallebarde, d’un sifflet et d’une échelle, dotés d’instructions imprimées, d’une matricule et d’un secteur par individu. Pour se faire une idée de l’extension de ce maillage policier, on compte pour l’éclairage de la ville à la fin du siècle un millier de lanternes à huile (p. 120-121). Ensuite, en 1792, huit escouades mobiles sont créées à destination des faubourgs sans éclairage, chacune composée d’un brigadier et de huit serenos (p. 124). En addition aux autres tâches qui leur incombaient, les serenos poursuivaient et abattaient les chiens des rues durant leurs patrouilles pour obtenir des primes (un demi real par chien et 3 pesos supplémentaires lorsqu’on atteignait les cent chiens) et parfois en vue d’une promotion. En effet, à partir de 1805, le zèle contre les chiens pouvait permettre la revalorisation de son salaire, l’obtention d’une titulature et l’acquisition d’une monture. Ainsi, les tueries de chiens ne sont pas une curiosité anodine dans l’expérimentation institutionnelle que connaît Mexico à la fin de l’époque moderne. Comme l’auteur le montre, elles participent pleinement d’une « forme de professionnalisation de la police nocturne » (p. 124).

BnF, département Cartes et plans, GE SH 18 PF 1 QUARTER DIV 34 P 2
BnF, département Cartes et plans, GE SH 18 PF 1 QUARTER DIV 34 P 2
BnF, département Cartes et plans, GE SH 18 PF 1 QUARTER DIV 34 P 2
Ce qui nous mène à l’hypothèse centrale de l’auteur. Quel lien alors unit police de proximité, éclairage public et massacre des chiens ? Pour les mêmes raisons qui font qu’une augmentation des chiens errants manifestait une situation de crise, leur élimination marquait une reprise en main de la ville (p. 231-232). Bien sûr, une politique canicide ne recouvre pas la même signification dans tous les contextes, ainsi que le montre l’auteur en comparant les enjeux politiques auxquels ont fait face les différents vice-rois de la Nouvelle-Espagne ayant recours aux tueries de chiens (p. 96). Pour autant, la décanisation, tout comme la présence policière et l’éclairage nocturne, vise à étendre le domaine de la souveraineté municipale à travers une extension du contrôle municipal sur le temps nocturne et sur la mobilité animale.
Cette rénovation urbaine contraint par ailleurs les citadins à adapter leurs comportements, obligés qu’ils devenaient de marquer la différence entre un chien errant et un chien qu’ils ne voudraient pas retrouver mort au petit matin, alors même que des rapports intermédiaires sont pratiqués notamment avec les chiens nourris par tout un voisinage, sans qu’on lui reconnaisse de maître attitré. Dès lors, les tueries de chiens disciplinent autant les comportements des chiens que ceux des maîtres, les deux étant, en un sens, tenus par la même laisse : un objet qui restreint les rapports anthropocanins au périmètre domestique et aux mobilités surveillées. D’ailleurs, le parallèle entre la discipline exercée sur les pauvres et celle exercée sur les chiens est particulièrement frappant (p. 166-170). La perspective, inspirée des travaux de Michel Foucault, qui consiste à analyser ce qu’une société rejette à ses marges comme un révélateur des logiques politiques qui l’animent, s’applique particulièrement bien aux chiens errants. Pour citer l’auteur, « Les reproches formulés à l’encontre des mendiants sont similaires à ceux adressés aux chiens parias : mendicité, vacarme, gêne pour les fidèles des églises et les malades. Dans la phraséologie des faiseurs de réformes, chiens et vagabonds étaient dotés des mêmes traits d’immoralité auxquels s’ajoutaient les stigmates de la saleté et de la criminalité » (p. 168). En miroir, la persécution de l’errance des chiens et des pauvres en ville dicte un certain savoir-vivre aux citadins.
Quand le chien devient un loup pour l’homme. De quoi les tueries de chiens sont-elles le nom ?
Un tour de force de l’ouvrage consiste à faire émerger, au fil de la lecture, une histoire réunissant des villes dont les trajectoires ne paraissent en rien connectées. Aux chapitres 7 et 8, l’auteur compare la gestion urbaine des chiens errants dans les villes de New York, Mexico, Madrid et Istanbul au XIXe et au XXe siècle — et c’est d’ailleurs comme cela qu’il convient de comprendre l’usage du concept d’« Occident », comme une construction d’un cadre chronologique et géographique contre-intuitif. Cet aspect est d’autant plus réussi que l’auteur y parvient sans recourir à des concepts globalisants prêts à l’emploi, qui risquent d’énoncer tout ensemble l’observation et l’interprétation, aboutissant à une simple tautologie de l’hypothèse de départ. Une expression comme « modernisation urbaine » renferme ce danger, mais le concept est matérialisé tout au long de l’ouvrage par des pratiques et des artéfacts concrets. En effet, l’éclairage public, la police de proximité et le contrôle du vivant dans l’espace urbain s’accomplissent ensemble et peuvent servir de critère pour établir des chronologies et des comparaisons entre des contextes urbains disparates.
Les tueries de chiens ne seraient pas une réponse à la mauvaise hygiène des villes préindustrielles, mais renverraient à une mutation historique plus profonde de l’administration des comportements urbains, tant pour les populations humaines qu’animales.
Ainsi, au fur et à mesure que l’on s’approche des conclusions de l’ouvrage, les massacres de chiens cessent d’être l’objet de l’analyse pour devenir un indicateur de plus large portée : les politiques de décanisation sont élevées en « bons révélateurs du degré de sophistication policière des villes » (p. 232), dans un dispositif plus ample qui recouvre la discipline des pauvres et l’éclairage public pour bâtir, à travers la rénovation urbaine, « un ordre nocturne idéal » (p. 175). Cette proposition a le mérite de renverser le préjugé diffusionniste qui tiendrait les capitales européennes pour devancières dans le front pionnier de l’histoire, car cette triade constitue en l’occurrence des « avancées qui font de certaines cités du Nouveau Monde des villes à l’avant-garde de la modernité urbaine » (p. 120). En effet, avec la réforme de 1790, un corps de police est mandaté pour les massacres de chiens, tandis qu’ailleurs ceux-ci étaient relégués à des couches marginales de la population — les chiffonniers à Madrid ou les forçats à Bogota.
Les vertus de l’histoire comparée sont flagrantes dans l’enquête, un même phénomène étant scruté à travers différents contextes pour mettre en évidence leur dénominateur commun et les facteurs explicatifs secondaires. En ce sens, le cas de Mexico revêt un intérêt tout particulier, puisqu’au cours des rénovations urbaines européennes, l’éradication de la rage était un argument récurrent dans les débats sur le contrôle des populations animales, la morsure d’un chien enragé étant fatale avant Jenner et Pasteur (p. 210-212). Mais les préoccupations sanitaires suffisent-elles à expliquer les massacres de chiens du XVIIIe et du XIXe siècle ? A. Exbalin affirme que les séquences de décanisation à Mexico ne correspondent pas à une réaction politique contre la rage puisque les navires avaient transporté les chiens européens à travers l’Atlantique sans la zoonose (p. 8, p. 69 et p. 210). Les tueries de chiens ne seraient pas une réponse à la mauvaise hygiène des villes préindustrielles, mais renverraient à une mutation historique plus profonde de l’administration des comportements urbains, tant pour les populations humaines qu’animales. Malgré cette proposition enthousiasmante, la première des tueries de chiens dont fait état l’archive centrale de l’enquête, la fameuse liasse 3662, est ordonnée après la détection d’un cas de rage en 1709 par le Tribunal de Médecine de la vice-royauté. L’auteur lui-même signale cette contradiction (p. 113-114). Pourtant, il ne s’agit pas là d’une simple coïncidence : la longueur du voyage transatlantique, parfois inférieure au mois parfois supérieur à deux mois, sabotait l’incubation du virus et préservait l’hémisphère américain de cette zoonose pendant près de deux siècles. Jusqu’à ce que, pour la première fois, le virus parvienne à franchir l’obstacle océanique et atteigne la Nouvelle-Espagne précisément aux débuts du XVIIIe siècle et se diffuse progressivement à des espaces américains plus éloignés de la métropole

Morgan Library, NYC
Morgan Library, NYC
Morgan Library, NYC
Cela affaiblit nécessairement une des hypothèses fortes de l’ouvrage, sans pour autant discréditer l’approche constructiviste que l’auteur promeut dans le chapitre « La fabrique du nuisible » (p. 139-164), l’une des parties les plus stimulantes de l’ouvrage. Comme d’autres travaux historiques l’ont démontré, la perception de la saleté, de la violence et de l’intolérable évolue dans le temps. Pour ne donner qu’un exemple, la baisse des crimes au cours du XIXe siècle à Paris a pour conséquence la baisse du seuil de tolérance aux actes sanglants, d’où la fascination nouvelle pour les faits divers morbides et l’interdiction de flâner dans les morgues. La grande tuerie des chiens donne précisément à voir une de ces mutations de sensibilité. En effet, la question de l’acceptabilité des tueries de chiens guide les innovations techniques et institutionnelles autour de la décanisation urbaine. Ainsi, le coup de burin est progressivement remplacé par l’empoisonnement de boulettes de viande, lui-même remplacé par la fourrière, qui permet d’expulser hors de la ville non seulement la violence canicide, mais aussi le corps même du chien indésirable. Cette tendance globale à la décanisation et à son invisibilisation fait l’objet des deux derniers chapitres de l’ouvrage. En suivant la circulation de procédés techniques et de dispositifs urbains, A. Exbalin dresse un panorama global — de New York à Istanbul — des « moyens pour limiter le nombre de chiens dans les villes : impôts pour les propriétaires, port obligatoire du collier et de la muselière, fourrières, poisons chimiques, électrocution… » (p. 194).
Pourtant, cette logique administrative peine à convaincre l’ensemble de la population, comme en témoigne le comportement même de certains membres de la police municipale. En effet, la persistance du stigmate social associé aux tueries de chiens pèse dans les négociations entre voisinage, municipalité et patrouilles. Les administrateurs débattent sur l’intérêt d’engager des tueurs de chiens qui se dédient entièrement au massacre pour contourner la répugnance qu’éprouvent les policiers à tuer des chiens ou celle qu’éprouvent les citadins envers une police canicide. Tout cela met en relief le malaise que suscite la caractéristique distinctive des décanisations mexicaines : un mélange des genres entre corps municipal et besogne canicide. En somme, les résistances et les contestations des tueries de chiens dessinent comme une économie morale où les arguments utilitaires de l’administration n’ont pas raison de la socialisation des chiens au sein d’un voisinage.
Par-delà les liens culturels et affectifs, les chiens errants étaient intégrés à une chaîne d’interactions interespèces, comme A. Exbalin le montre bien pour le Mexico d’Ancien Régime. Ainsi, les urubus noirs, les charognards de l’Amérique, ont vu leur chaîne alimentaire bousculée par les campagnes de décanisations (p. 238-239), un changement écologique qui soulève un problème logistique à l’administration municipale puisque l’ébouage de la ville reposait précisément sur ces cycles métaboliques entre déchets et commensaux. Les administrateurs sont allés jusqu’à envisager, au temps des massacres de chiens, la création de chenils fermés pour approvisionner la ville en peau et en excréments de chiens, des ressources employées dans l’industrie du cuir (p. 114-115). Les mutations urbaines de la fin du XVIIIe et du XIXe siècle semblent avoir dirigé les villes d’Europe et d’Amérique vers un régime écologique dont nous sommes les héritiers directs et que l’on pourrait caractériser par une artificialisation de l’espace urbain et une régulation agressive des commensaux (bétonnisation, stérilisation, dératisation et désinsectisation). L’intérêt de ne pas réduire ces expériences institutionnelles et technologiques à leur logique sanitaire, c’est d’envisager les choix hygiénistes du passé autrement que comme la voie unique et nécessaire du développement urbain. En somme, à travers cette dernière partie de l’enquête, l’auteur révèle la période où les massacres de chiens ont rompu avec une cohabitation de très longue durée, pour déboucher sur des institutions qui nous paraissent aujourd’hui évidentes — de la fourrière au puçage — et dont on oublie l’historicité et, éventuellement, la caducité.
Lire aussi sur Terrestres l’article de Frédérick Keck, « Animaux de tous les pays, unissez-vous ! », mars 2024.
La Grande tuerie des chiens est une enquête d’histoire au cours de laquelle l’auteur n’hésite pas à intégrer ses promenades et ses entrevues dans les quartiers de Mexico dans la narration, tout en filant un écheveau d’hypothèses particulièrement original. Son style biographique n’enlève rien à la cohérence de l’ouvrage puisque toutes les parenthèses ouvertes, parfois d’ordre historiographique, parfois d’ordre contemporain (et souvent les deux), ne détournent pas inutilement l’attention du lecteur, puisque le fil conducteur reste, de l’introduction à l’épilogue, le cheminement de pensée de l’auteur. Celui-ci nous emmène en quelques pages du Moscou de la Coupe du Monde de 2014, à la violence meurtrière des rues de Bogota, en passant par les banlieues de Bucarest lors de l’intégration de la Roumanie à l’Union européenne. Ce faisant, les relations entre chiens et humains sont scrutées autant à travers les strates des archéologues et les documents des archives municipales qu’à travers les préoccupations du temps présent.
D’une plume impeccable, l’auteur conjugue expertise et curiosité en partant constamment en excursion bibliographique pour expliquer l’archive mexicaine qui lui a servi de point de départ. Partant, A. Exbalin présente dans cet ouvrage un chantier d’histoire plutôt qu’un plan d’architecte ou un bâtiment fini. Sans adopter un surplomb d’encyclopédie difficile à tenir eu égard à l’ampleur chronologique et géographique de l’ouvrage, l’auteur livre une pierre qui peut aller à plusieurs édifices. En décentrant le regard de l’Europe, A. Exbalin enrichit la compréhension que l’on avait des mutations urbaines du siècle des Lumières et du siècle de l’industrialisation. Les historiens des techniques apprécieront l’attention accordée aux circulations de méthodes canicides à travers le globe, les spécialistes de différentes villes auront des questions nouvelles à poser à leurs archives et ceux qui s’interrogent sur nos interactions avec les animaux aujourd’hui trouveront matière à réfléchir en lisant sur ce qu’elles ont pu être par le passé.
Toutes ces enjambées entre passé et présent, entre histoire et écologie, constituent une façon efficace de revenir sur les implications environnementales du procès de civilisation des mœurs et de discipline des masses de l’époque moderne, tout comme une manière de révéler combien l’état actuel des choses peut évoluer — absences et présences d’espèces, libertés et contraintes de mouvements, discipline ou errance des populations humaines et non-humaines. Et cela reste toujours un exercice rafraîchissant pour ceux qui ne voient pas d’avenir viable dans la perpétuation de l’état actuel des choses. Nous voilà, en somme, avec un bel ouvrage qui donne à voir ce que peut l’histoire dans la réflexion écologique.
Illustration de couverture — Manuscrito del aperreamiento, 1560 — Bibliothèque nationale de France. Département des Manuscrits. Mexicain 374

SOUTENIR TERRESTRES
Nous vivons actuellement des bouleversements écologiques inouïs. La revue Terrestres a l’ambition de penser ces métamorphoses.
Soutenez Terrestres pour :
- assurer l’indépendance de la revue et de ses regards critiques
- contribuer à la création et la diffusion d’articles de fond qui nourrissent les débats contemporains
- permettre le financement des deux salaires qui co-animent la revue, aux côtés d’un collectif bénévole
- pérenniser une jeune structure qui rencontre chaque mois un public grandissant
Des dizaines de milliers de personnes lisent chaque mois notre revue singulière et indépendante. Nous nous en réjouissons, mais nous avons besoin de votre soutien pour durer et amplifier notre travail éditorial. Même pour 2 €, vous pouvez soutenir Terrestres — et cela ne prend qu’une minute..
Terrestres est une association reconnue organisme d’intérêt général : les dons que nous recevons ouvrent le droit à une réduction d’impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant. Autrement dit, pour un don de 10€, il ne vous en coûtera que 3,40€.
Merci pour votre soutien !
Soutenir la revue Terrestres