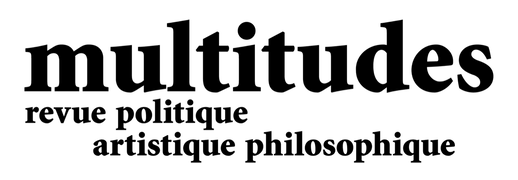17.05.2024 à 10:59
Consulter les œuvres de Denilson Baniwa
multitudes
L’article Consulter les œuvres de Denilson Baniwa est apparu en premier sur multitudes.
Texte intégral (990 mots)




























L’article Consulter les œuvres de Denilson Baniwa est apparu en premier sur multitudes.
17.05.2024 à 10:38
Une affaire de femmes… et de démocratie
Querrien Anne
L’annonce, attristante, était passée quasi inaperçue : Marie-Claire Chevalier, défendue par Gisèle Halimi lors du procès de Bobigny, est morte en janvier 2022, à 66 ans, « des suites d’une longue maladie ». Elle était devenue une figure de la lutte pour le droit des femmes après son procès pour avortement illégal à l’automne 1972, dont l’issue avait contribué à … Continuer la lecture de Une affaire de femmes… et de démocratie
L’article Une affaire de femmes… et de démocratie est apparu en premier sur multitudes.
Texte intégral (2378 mots)
L’annonce, attristante, était passée quasi inaperçue : Marie-Claire Chevalier, défendue par Gisèle Halimi lors du procès de Bobigny, est morte en janvier 2022, à 66 ans, « des suites d’une longue maladie ». Elle était devenue une figure de la lutte pour le droit des femmes après son procès pour avortement illégal à l’automne 1972, dont l’issue avait contribué à rendre possible la loi Veil autorisant l’avortement. Son avocate de l’époque, Gisèle Halimi, avait remporté une magnifique victoire dans ce procès au cours duquel cinq femmes étaient sur le banc des accusées : Marie-Claire, seize ans, qui avait avorté après un viol (et avait été dénoncée par son violeur, récompensé par une réduction de peine) et quatre autres femmes, dont sa mère, Michèle, toutes accusées de complicité ou de pratique de l’avortement. Gisèle Halimi avait accepté de les défendre à condition de pouvoir attaquer la loi de 1920, qui interdisait la contraception et l’avortement. Marie-Claire Chevalier avait courageusement accepté de mener un combat pour toutes et que son procès personnel soit un procès politique pour le droit à l’IVG.
Rappelons que si la contraception se répand dans les années 1960, l’avortement restait le grand tabou et l’inconnu des démographes. Les chiffres ont fini par éclater : dans les années 1960, la France connaît entre 250 000 et 300 000 avortements clandestins par an1 dans des conditions insalubres et traumatisantes pour un grand nombre de femmes, le plus souvent très jeunes. Le tabou se lève en même temps que se soulève le Mouvement de libération des femmes après 1968 ; les féministes rompent alors les chaînes du patriarcat en affirmant le droit des femmes à disposer de leur corps.
Viennent « Le manifeste des 343 », qui fait partie de l’historique de la désobéissance civile, et le procès de Bobigny, autre action de contestation de la loi. Le succès actuel, on l’oublie, est celui de désobéissant·es – toutes les femmes innombrables, soignants, médecins, aidants et militants qui ont œuvré depuis des décennies, dans la clandestinité et la résistance pour le droit des femmes à disposer de leur propre corps. C’est en pensant à elles – à Gisèle Halimi, à Marie-Claire, tant d’autres – pour la première fois honorées officiellement le 8 mars dernier – que l’on peut se réjouir des résultats du vote des parlementaires réunis en Congrès à Versailles et de l’adoption de la révision constitutionnelle visant à protéger la liberté d’avoir recours à une interruption volontaire de grossesse (IVG), et se joindre aux hurlements de joie qui ont éclaté partout dans la salle et sur les places, lors de la proclamation du résultat. C’est aussi une surprise, car au vu des difficultés antérieures à lancer le processus au parlement, on ne pouvait pas imaginer une si large majorité (780 voix pour contre 72), La victoire est là aussi, dans les votes de ces parlementaires parfois réticents au départ mais finalement convaincu·es, contraint·es ou assailli·es par leurs filles, amies, électrices et électeurs.
Le 4 mars 2024, la France est donc devenue le premier pays au monde à inscrire l’IVG dans sa constitution : « la liberté garantie de la femme de recourir au droit à l’interruption volontaire de grossesse ». Malgré le caractère alambiqué de la formulation, résultat d’âpres discussions sémantiques et juridiques, le résultat est là. Il nous permet même de faire l’expérience d’un sentiment dont on n’imaginait plus guère la possibilité (en dehors peut-être fugitivement d’événements sportifs ou de récompenses à des artistes aimés) et qui a même quelque chose d’embarrassant : la fierté, non pas « d’être français·e » évidemment, mais pour la France. Après, rappelons-le, une série de lois injustes et imposées sans majorité, qui semblent la marque de fabrique du gouvernement Macron II.
Il est rare que la France puisse apparaître comme pionnière : elle l’est non dans le droit à l’avortement (qu’elle a mis du temps à concéder), mais dans cette révision constitutionnelle visant explicitement à protéger la liberté d’avoir recours à l’avortement. Un demi-siècle après l’adoption de la loi Veil, il ne s’agit plus d’affirmer un droit mais bien de le protéger. C’est donc une loi contextuelle : elle est portée sous la menace, et par la troisième vague du féminisme. Il ne s’agit pas d’égalité de droits politiques ou dans le marché du travail (enjeux de la première vague), ni de « droits reproductifs » (pour reprendre la terminologie étatsunienne), mais de liberté sexuelle, de la liberté des femmes à disposer de leur corps, dans la lignée des mouvements féministes du siècle dernier. La loi est bien de l’ère post-#MeToo, marquée par une libération de la parole sur les violences sexuelles et envers les femmes, dont les menaces sur l’avortement font partie. La loi Veil est arrachée en 1975 par les féministes et par les syndicats du Ministère de la Santé, dans la situation atroce que révèle et dénonce le procès de Bobigny ; mais centrée sur la compassion, jamais elle ne fait référence au droit des femmes à disposer de leurs corps.
Cette liberté, et les corps des femmes, c’est la première chose qu’attaquent les dictatures. Dans le livre puis la série culte The Handmaid’s Tale (La servante écarlate) dont la toute dernière saison est en cours de production, Gilead dictature patriarcale instaurée aux États-Unis, se définit essentiellement par le contrôle des corps des femmes, notamment des servantes (handmaids), femmes détectées fertiles, enfermées et violées afin de produire un enfant pour les couples de la classe dominante : des femmes qui comme l’héroïne, June, travaillaient, s’amusaient, avaient des ami·es et une vie, et qui d’une minute à l’autre, se retrouvent privées de leur travail, de leur compte en banque, et de tout droit – de voter, d’avorter, de lire, de circuler. L’univers de Gilead permet de rappeler que les libertés de femmes sont toujours fragiles et les premières visées par les pouvoirs réactionnaires ou autoritaires. La série annonçait en 2017 les effets de l’arrivée de Trump au pouvoir et la menace qu’un tel spécimen d’humanité constitue en soi pour la dignité des femmes aux États-Unis et dans le monde. Mais désormais, elle illustre une menace généralisée ; la liberté des femmes sur leurs corps, qui semblait majoritairement acquise dans le monde et dans l’opinion publique, est soudain fragilisée.
Comme on sait, la loi Veil n’a pas suffi ; l’application fut lente et difficile et l’accès à l’IVG reste très inégal (en fonction de l’origine ethnique et géographique et du niveau social des femmes). Il est rendu désormais encore plus difficile par des politiques budgétaires néolibérales et la criminelle négligence gouvernementale pour les professions de care. La volonté d’apparaître comme un « phare » pour les autres pays contraste avec les retards de la France en matière de représentation politique des femmes ou d’égalité « réelle », et avec les conditions effectives d’exercice de la liberté d’avorter. C’est bien l’enjeu à venir.
Ce vote « historique » est l’aboutissement d’un processus parlementaire de 18 mois au cours duquel de nombreux·ses élu·es, relais des associations féministes, ont redoublé d’engagement. La présence d’anciennes ministres à l’égalité femmes-hommes ou aux droits des femmes, Isabelle Rome, Elisabeth Moreno, Najat Vallaud-Belkacem à cette séance singulière signalait l’union politique rarissime des femmes pour une cause féministe. Celle de représentantes d’associations comme le Planning familial œuvrant pour les droits des femmes, de militantes et institutionnelles féministes, était signifiante, là aussi dans une période de destruction systématique du tissu associatif en France.
La sénatrice (Europe Écologie-Les Verts) Mélanie Vogel qui a joué un rôle crucial dans le processus a peut-être le mieux marqué le sens politique de l’événement : « La République française, désormais, ne sera plus jamais la République sans le droit à l’avortement ».
Une prochaine étape du combat est de faire inscrire le droit à l’avortement dans ces droits humains que pratiquement tous les pays reconnaissent. En effet, la décision française a eu un écho remarquable dans le monde. Le droit à l’avortement est de plus en plus menacé dans des pays européens comme la Hongrie, la Pologne, l’Irlande et l’Italie. La décision de la Cour suprême des États-Unis dans l’affaire Dobbs v. Jackson Women’s Health, qui a annulé le droit constitutionnel à l’avortement après 49 ans, a été précisément ce qui a suscité (ou galvanisé) les efforts en France pour protéger ce droit.
L’exposé des motifs du projet de loi le dit explicitement :
« En France, la liberté de recourir à l’interruption volontaire de grossesse est aujourd’hui garantie par la loi. […] Si, dans notre pays, cette liberté n’est pas aujourd’hui directement menacée ou remise en cause, hormis par quelques courants de l’opinion heureusement très minoritaires, tel n’est pas le cas dans d’autres États et non des moindres. »
Le texte mentionne alors l’action de la Cour suprême étatsunienne :
« En mettant un terme à sa célèbre jurisprudence “Roe v. Wade” de 1973, la Cour Suprême a fait la démonstration que les droits et libertés qui nous sont les plus précieux peuvent être menacés alors qu’ils semblaient solidement acquis. »
Le texte garantit la liberté d’avorter aux femmes, et a été critiqué parce qu’il pouvait sembler exclure les femmes qui ont fait une transition vers le genre homme, et ont une identité civile d’homme. Mélanie Vogel a su désamorcer cette attaque en rappelant que la liberté est garantie à tous·tes celleux qui ont un corps susceptible de commencer un processus d’enfantement et désirant y mettre fin, marquant bien le changement de paradigme politique.
Il ne s’agit donc pas de célébrer un « phare de l’humanité », mais de redéfinir la démocratie. Pour Mélanie Vogel, « La France montre que le droit à l’avortement n’est plus une option, mais une condition de notre démocratie ». Elle ajoutait : « Je veux envoyer un message aux féministes en dehors de la France. Tout le monde m’a dit il y a un an que c’était impossible. Rien n’est impossible quand on mobilise la société ». C’est l’une des rares fois où une conquête féministe, ancrée dans l’histoire longue des révoltes et des mobilisations, devient un élément de récit national (réel ou fictif). Et où se révèle l’efficacité de la désobéissance civile : un acte public de refus d’accepter une loi injuste a changé le monde jusqu’à pénétrer la Constitution.
1L’INED donne le chiffre de 250 000 avortements clandestins par an dans les années 1960. Simone Veil, lors de son discours à l’Assemblée Nationale, évoque le chiffre de 300 000 avortements clandestins par an. La juriste A.-M. Dourlen-Rollier avance le chiffre de 800 000 avortements par an, ce qui signifierait que 50 % des grossesses étaient interrompus dans la clandestinité dans les années 1960.
L’article Une affaire de femmes… et de démocratie est apparu en premier sur multitudes.
17.05.2024 à 10:37
Mon droit à ma vie
multitudes
Si l’on peut s’honorer que la France vienne de constitutionnaliser le droit à l’avortement, à la suite des longues luttes des femmes, la France n’est par contre pas du tout pionnière dans le domaine de la question de l’aide à la fin de vie. Elle est encore loin de pouvoir rejoindre des pays pourtant voisins … Continuer la lecture de Mon droit à ma vie
L’article Mon droit à ma vie est apparu en premier sur multitudes.
Texte intégral (1276 mots)
Si l’on peut s’honorer que la France vienne de constitutionnaliser le droit à l’avortement, à la suite des longues luttes des femmes, la France n’est par contre pas du tout pionnière dans le domaine de la question de l’aide à la fin de vie. Elle est encore loin de pouvoir rejoindre des pays pourtant voisins comme la Belgique, les Pays Bas ou la Suisse qui, depuis plus de vingt ans déjà, assurent un droit à l’euthanasie librement choisie par tout·e citoyen·ne. Les débats continuent pour une énième révision de la loi sur « la fin de vie » dite Léonetti de 2005 qui s’est arrêtée en chemin.
Depuis toujours c’était la famille qui avait principalement en charge la fin de vie de ses membres, tout particulièrement lorsqu’elle jugeait qu’il était temps. Trop de souffrances ou plus simplement de gâtisme conduisaient les proches à prendre le soir autour de la table l’ultime décision. C’est sans doute pourquoi on utilisait communément l’expression du « bouillon de onze heures », celui que l’on portait à l’aïeul, sans doute un peu cérémonieusement, pour qu’il parte entouré des siens.
La plupart des gens meurent maintenant le plus souvent seuls et dans une institution quelconque, Ehpad ou hôpital. Les soignants préviennent le plus souvent discrètement ceux qui visitent le mourant en phase terminale puisque ce sont bien les médecins qui décident presque toujours de débrancher volontairement le système d’aide à la fin de vie. Mais les proches refusent le plus souvent absolument de comprendre ce qu’on tente de leur suggérer tant la fin définitive de celui qui est toujours là dans son lit est incompréhensible. Car on ne peut comprendre, cumprehendere-prendre avec soi, la mort. Seulement la subir, du mieux que l’on peut.
Pour cette raison, tous les sondages depuis 20 ans montrent que l’immense majorité des gens (85 % en France) veulent pouvoir maitriser autant que possible la façon dont leur propre fin de vie doit se dérouler, y compris les croyants.
Et pourtant, tous les pouvoirs institués sans exception s’y opposent absolument.
Les religions, force totalement prééminente en la matière, s’entendent toutes pour proclamer « sacrée » la vie, comme si tout le monde n’était pas d’accord, du moins en Occident ! Le problème est que c’est à la nôtre de vie qu’ils s’intéressent pour que la proclamation quasi incessante de cette quasi banalité ne vise qu’à interdire précisément notre libre choix, alors que nous ne leur avons rien demandé. De quel droit ?
Les médecins s’accordent aussi sur leurs compétences exclusives à décider de qu’il faut faire pour prolonger au mieux notre vie. De quel droit aussi ? Et notamment pour les gens de plus en plus nombreux qui confient à leur médecin – pour les heureux qui en ont un encore – ce qu’il doit advenir en cas de problèmes graves de santé ou rédigent des « directives anticipées » dans un registre à présent officiel repris dans la loi Leonetti qui inscrit à la manière libre de chacun tous ceux qui ne veulent pas d’« acharnement thérapeutique ». Mais qui connaît cette possibilité restée trop confidentielle ?
Comment un professionnel, fût-il « des hôpitaux », pourrait-il savoir mieux que vous ce qu’il convient de faire dans ces instants critiques si vous les avez expressément anticipés ?
La résistance au changement vient d’un pouvoir médical imbu de son monopole à pouvoir à décider lui-même de ce qui est bon pour vous. Hypocrisie d’un corps médical confronté à la mort quotidiennement qui débranche définitivement ou entame une sédation, mais refuse éthiquement le rôle officiel d’une aide à mourir qui le déchargerait pourtant de la responsabilité pénale. Les intenses débats des différentes conventions citoyennes comme celui sur la bio-éthique sont là pour toujours retarder une évolution de la loi en multipliant de faux enjeux sur « laisser mourir ou faire mourir ». Oui, souvent on laisse mourir dans des conditions épouvantables, seulement dénoncées par des associations comme Le droit de mourir dans la dignité, ou Le Choix, citoyens pour une mort choisie.
Ce pouvoir médical oppose la fausse alternative des soins palliatifs contre le libre choix de sa fin de vie. Il nous faut les deux et, aujourd’hui, les soignants pratiquant les soins à une meilleure fin de vie possible dans le respect du choix de la personne augmentent.
Mais l’État, encore et toujours, s’obstine, même devenu laïc, à faire respecter dans ses lois l’interdit absolu promulgué par les trois religions monothéistes d’un quelconque contrôle sur la fin de vie, exactement comme elles luttent toujours contre nôtre maitrise à la donner. L’État qui ne cesse d’entretenir la confusion en annonçant fort justement vouloir séparer enfin la question des soins palliatifs de celle de l’aide à mourir, mais se donne une politique d’investissement jugée totalement incomplète par tous les soignants, qui ne fera que maintenir l’existant.
En ne laissant aucune possibilité aux gens de soins palliatifs suffisants ni de libre choix, il en oblige beaucoup à partir seuls dans des suicides nécessairement horribles, ou à l’étranger en Belgique, Hollande ou Suisse.
Pourtant, certaines institutions comme l’Académie nationale de médecine, ou le Comité consultatif national d’éthique ont fait des rapports sur cette double nécessité et d’une vraie politique de soins palliatifs et d’une aide à mourir.
La seule issue est donc maintenant de suivre les femmes qui viennent de faire inscrire dans la constitution même le droit d’être libre et maitre de leur corps. Nous aussi, citoyennes et citoyens dans notre communauté, l’exigeons pour ce qui en est de notre droit de vivre, ou pas. Lois et constitution doivent nous garantir de la même façon une maitrise du droit sur notre vie.
L’article Mon droit à ma vie est apparu en premier sur multitudes.
17.05.2024 à 10:36
À quels Jeux voulons‑nous jouer ?
multitudes
Imaginez d’aller vers Roma 2024 plutôt qu’en direction de Paris 2024. C’est-à-dire, imaginez les Jeux Olympiques déplacés quelques 1400 kilomètres plus au Sud, là ils avaient été hébergés en 1960. Il y a une dizaine d’années, ce scénario était vraisemblable, puisque les deux villes étaient alors rivales. Plusieurs ouvriers franciliens travaillant sur les chantiers des … Continuer la lecture de À quels Jeux voulons‑nous jouer ?
L’article À quels Jeux voulons‑nous jouer ? est apparu en premier sur multitudes.
Texte intégral (2999 mots)
Imaginez d’aller vers Roma 2024 plutôt qu’en direction de Paris 2024. C’est-à-dire, imaginez les Jeux Olympiques déplacés quelques 1400 kilomètres plus au Sud, là ils avaient été hébergés en 1960. Il y a une dizaine d’années, ce scénario était vraisemblable, puisque les deux villes étaient alors rivales.
Plusieurs ouvriers franciliens travaillant sur les chantiers des JO et des infrastructures complémentaires seraient peut-être toujours en vie : Maxime Wagner, Abdoulaye Soumahoro, Seydou Fofana, Jérémy Wasson, Joao Baptista Fernandes Miranda, Amara Dioumassy1…
Souvent d’origine étrangère et en situation de précarité contractuelle, ces hommes sont morts pendant les travaux engagés en vue de l’été 2024, notamment lors de l’agrandissement du réseau de transports et malgré l’attention revendiquée aux normes de sécurité. L’année dernière, beaucoup d’entre leurs collègues ont entamé des actions de grève et d’occupation – comme celle de l’Arena de la porte de La Chapelle – pour dénoncer les conditions d’irrégularité dans lesquelles ils étaient employés : il y aurait eu (un peu) moins d’exploitation de la main d’œuvre migrante autour du périphérique parisien. Moins de « travail » aussi, moins d’« emploi », dira-t-on aussi sans doute.
Une foule d’« indésirables » – c’est-à-dire de personnes extrêmement vulnérables (sans-abris, toxicomanes, sans-papiers…) – ne serait pas en train d’être expulsée de la capitale contre sa volonté et loin des réseaux familiers d’aide. La gentrification de la ville de Paris et des communes limitrophes aurait progressé probablement moins vite. Cet été, on aurait vraisemblablement trouvé moins de locations Air BnB destinées à des touristes aisés2. La mise en place de nouveaux systèmes de surveillance vidéo et d’automatisation du contrôle aurait manqué d’un prétexte pour être actée 3.
Cependant, la candidature romaine a fait long feu il y a dix ans, suite au choix de la maire Cinque Stelle Virginia Raggi de retirer la candidature à cause des coûts d’organisation d’un tel méga-événement. L’engagement enthousiaste du premier ministre Matteo Renzi n’avait pas suffi, ni celui d’une fameuse lettre de soutien de la part de l’ensemble des athlètes ayant gagné une médaille à Rio 2016. Un seul parmi elleux n’avait pas signé et avait plutôt défendu le doute sur l’opportunité de ce projet, devenant ainsi l’objet de nombreuses pressions et critiques.
Qu’avait-il vu aux jeux brésiliens, le joueur de volleyball Luca Vettori (médaille d’argent) ? Qu’est-ce qui l’avait fait hésiter, et finalement promouvoir ce renoncement ? Dans un article récemment publié4, il évoque les souvenirs de l’été 2016 en écho à la fiction du village olympique « totalitaire » de W de Georges Perec. Il raconte une expérience cloisonnée au sein d’un circuit évènementiel soigneusement séparé de la vie quotidienne des habitant·es de Rio, de ses réalités sociales, de ses problèmes aussi. Dans ce court texte, il ne revient pas sur les polémiques de la lettre et ses raisons à l’époque de ne pas soutenir l’accueil italien des JO. Toutefois nous pouvons entrevoir dans le malaise dont il témoigne la trace subjective d’une certaine gouvernance verticale et déracinée de l’évènement, qui induira le Nouvel Obs à répondre « nulle part » à la demande « où étaient les classes populaires ? 5 ». Cette difficulté à inclure la population locale – alors qu’une audience globale et un tourisme d’élite jouissaient insouciamment des Jeux – faisait écho à des questionnements critiques au sujet de l’intégration durable des nouvelles infrastructures dans le tissu de la ville et de ses besoins sociaux6. Sans oublier : la sécurisation violente de la ville pour occulter le mal-être social et la criminalité, les morts sur les chantiers de construction à marche forcée, les problèmes de corruption…
Malgré sa dimension prestigieuse et les magnifiques valeurs qui le couronnent (la fête, le sport, l’internationalisme…), ce digne fils du XXe siècle qu’est l’arbre olympique n’arrive pas à cacher la forêt d’effets indésirables dont il est responsable. Il est pourtant difficile d’affirmer que la responsabilité de ces conséquences lui appartient entièrement, comme si les JO étaient un OVNI atterrissant de nulle part sur le sol des grandes villes et leur imposant son métabolisme tyrannique ! On pourrait plutôt le considérer comme un catalyseur capable d’accélérer des stratégies déjà déployées des pouvoirs publics et privés en charge de les organiser. En ce sens, cet évènement géant peut être envisagé comme un papier de tournesol qui rend (plus) visibles des phénomènes préexistants : l’éloignement des personnes vulnérables des espaces publics, la rente immobilière plutôt que le droit au logement, la mise en œuvre de grandes infrastructures dont l’utilité est questionnée par les mouvements citoyens (voir les ZAD), la configuration d’un réseau de surveillance automatisé de plus en plus envahissant… Cela n’a fait que surfer sur la vague des Jeux Olympique pour prendre plus d’élan.
En se plaçant sur un marché mondial de l’attention les États (du Nord, en général) semblent investir des milliards d’euros dans l’organisation des JO dans une optique de visibilité et de renommée monétisables, par exemple, en termes de tourisme international ou de soft power géopolitique. Au jeu « national » de la rentabilisation de l’attention collective concentrée par le sport jouent également les grandes entreprises privées – de LVMH à Coca Cola7 – qui financent les Jeux et les athlètes par des sponsorisations généreuses. À défaut de renoncer à l’organisation de ces manifestations, autant pour l’argent public employé que pour l’attention commune qui leur est prêtée, il y aurait moyen de se demander comment mieux orienter ces investissements, d’une façon plus juste et durable. Vous souvenez-vous du poing levé de Tommie Smith et John Carlos à Mexico en 1968, canalisant le regard synchronisé par les JO vers une lutte émancipatrice ?
La situation olympique n’est pas isolée, en réalité. Les controverses qui la concernent se reflètent dans une série d’autres méga-événements sportifs, comme la Coupe du Monde de football masculine qui a franchi une nouvelle frontière d’indécence lors de sa dernière pétro-édition au Qatar (stades dans le désert climatisés, censure des droits des minorités…). Ces situations ont posé de plus en plus radicalement la question de comment « hériter » d’une importante tradition sportive collective dont l’injustice sociale et l’insoutenabilité environnementale dessinent la nécessité d’une certaine « fermeture ».
Les termes choisis renvoient à une série de travaux en sciences sociales – accueillis dans cette revue8 – qui nous permettent peut-être de trouver un concept, celui de « commun négatif », pour décrire le besoin de prendre en charge des réalités comme celle des JO qui, tout en nous reliant et en occupant une place importante dans le système culturel actuel, ont tendance à générer des effets délétères, des « ruines » plus ou moins littérales. Bien sûr, beaucoup de choses y compris désirables dépendent des Jeux Olympiques : par exemple la valorisation du sport et plus précisément de sports mineurs qui n’auraient sans cet évènement qu’une visibilité et une soutenabilité économique très faible. En même temps, cette machine se branche sur des écosystèmes de communs négatifs dont il faut prendre soin tactiquement, y compris via des politiques de renoncement et démantèlement : le tourisme international, la publicité médiatique, les infrastructures inutiles… N’oublions pas d’inclure également dans la liste une morale extrêmement épuisante du travail et de « l’excellence » que nous partageons au sein des sociétés néolibérales et qu’on doit apprendre à refuser : celle-ci prolifère au sein d’évènements sportifs hautement compétitifs et demande à être désertée, comme le montre la sociologue du travail italienne Francesca Coin en commentant des cas de retrait de grands athlètes (à l’instar de Simone Biles et Michael Phelps)9.
Comment jeter l’eau sale du bain olympique contemporain tout en préservant le bébé d’un certain commun sportif ? Une petite idée peut nous venir du monde du football, qui constitue la contrée la plus démesurée de la logique médiatico-financière régissant le sport professionnel, tout en alimentant un plaisir quotidien de millions d’athlètes ou de fans en dehors de tout circuit commercial et spectaculaire. Le foot, en effet, a représenté depuis de nombreuses années le front le plus avancé de la marchandisation, gentrification et médiatisation de la pratique sportive. L’exemple de la transformation des stades anglais – raconté par le beau court-métrage de Nicolas Goureau This Means More (2019) – est éloquent dans la mesure où ces lieux communautaires ont été transformés en dispositifs d’enrichissement strictement disciplinés par des propriétaires souhaitant rentabiliser leurs capitaux.
Beaucoup d’usages et de classes sociales ont été expulsées par ces processus, mais cette situation d’exclusion n’a pas été simplement subie par ces personnes : elle a parfois donné lieu à des véritables tactiques de soustraction et de création d’espaces alternatifs connus sous le nom de protest club. Dans des cas comme l’Austria Salzburg (fondé en opposition à la gestion par Red Bull de l’équipe autrichienne), l’United of Manchester (équipe alternative issue d’un abandon du célèbre Manchester United) ou encore l’Affordable Football Club Liverpool (projet opposé à la gestion du Liverpoool FC), il s’est agi de refuser une appropriation de l’expérience du football par des logiques verticales et capitalistes, mais sans renoncer à la passion pour ce sport : d’où la création par des supporters de ces équipes locales parallèles, basées sur une gestion coopérative et directe, en dehors de l’économie attentionnelle et marchande des grands championnats. En quittant les sommets glorieux, ils ont préféré demeurer fidèles aux puissances politiques du jeu qui sont celles de la spéculation et du virtuel au-delà du donné, comme nous l’apprend Brian Massumi. Les protest club nous enseignent à en finir avec leur Olympe pour infinir nos jeux…
1Voir : « Au Grand Paris Express, des morts et des accidentés par pertes et profits », Blast, 25/07/2023 ; Cécile Hautefeuille, « Chantiers des JO : Amara Dioumassy est mort dans l’indifférence générale », Mediapart, 6/7/2023.
2Les processus de nettoyage social et gentrification constitue une tendance politique et urbanistique bien reconnue au sein de ces méga-événements sportifs, voir : Centre on Housing Rights and Evictions, FAIR PLAY FOR HOUSING RIGHTS, 2007, www.ruig-gian.org/ressources/Report %20Fair %20Play %20FINAL %20FINAL %20070531.pdf
3Voir les commentaires de la Quadrature du Net à ce propos : « VSA et Jeux Olympiques : Coup d’envoi pour les entreprises de surveillance », 26/1/2024, www.laquadrature.net/2024/01/26/vsa-et-jeux-olympiques-coup-denvoi-pour-les-entreprises-de-surveillance
4Luca Vettori, « Un atleta sono le sue vittorie », Doppiozero, 5/3/2024, www.doppiozero.com/un-atleta-sono-le-sue-vittorie
5Gourvan Le Quellec, « JO 2016 : un modèle olympique à revoir d’urgence », Le nouvel Obs, 25/08/2016.
6Voir à ce sujet : Justine Ninnin, Alba Zaluar et Christovam Barcellos, « Mondialisation et méga-événements à Rio de Janeiro : quand les enjeux de sécurité et d’urbanisation développent les logiques de marché dans les favelas », IdeAs, no 7, 2016, https://journals.openedition.org/ideas/1402
7Mathias Tépot, « JO 2024 : pour LVMH, l’important, c’est de gagner », Médiapart, 26/3/2024.
8Voir notamment la majeure du numéro 93, 2023.
9Voir : Francesca Coin, Le grandi dimissioni, Turin, Einaudi, 2023.
L’article À quels Jeux voulons‑nous jouer ? est apparu en premier sur multitudes.
17.05.2024 à 10:35
Guerre ou paix ? L’urgence d’une autre politique des drogues
multitudes
La guerre à la drogue fait rage, et ces derniers temps, elle s’était imposée semble-t-il sans discussion. Les fusillades, les morts, les quartiers en proie au trafic, c’est, à l’évidence, une urgence : Place net XXL, c’est le mot d’ordre du gouvernement. Ce mardi 2 avril, trois nouvelles opérations anti-drogue ont été annoncées à Nantes, Toulouse et … Continuer la lecture de Guerre ou paix ?
L’urgence d’une autre politique des drogues
L’article Guerre ou paix ? <br> L’urgence d’une autre politique des drogues est apparu en premier sur multitudes.
Texte intégral (1761 mots)
La guerre à la drogue fait rage, et ces derniers temps, elle s’était imposée semble-t-il sans discussion. Les fusillades, les morts, les quartiers en proie au trafic, c’est, à l’évidence, une urgence : Place net XXL, c’est le mot d’ordre du gouvernement. Ce mardi 2 avril, trois nouvelles opérations anti-drogue ont été annoncées à Nantes, Toulouse et Strasbourg. Sauf que la veille, au 1er avril, l’annonce de la légalisation du cannabis en Allemagne a introduit une faille d’où surgit, une nouvelle fois, ce serpent de mer : la légalisation du cannabis, recommandée par une succession de rapports, dont le dernier le 5 mai 2021, par la mission d’information parlementaire aboutissait à la proposition d’une « légalisation encadrée et régulée du cannabis ». Les rapporteurs, Caroline Janvier et Jean Baptiste Moreau, tous deux députés de la majorité présidentielle, étaient persuadés que le débat allait s’ouvrir sur cette question.
Ce n’est pas ce qui s’est passé, le tournant répressif s’est au contraire renforcé depuis la nouvelle mandature, ce qui se traduit par une escalade continue d’une violence meurtrière. Car du point de vue de l’expertise, il n’y a pas de doute possible, la stratégie adoptée par les pouvoirs publics en France exacerbe la violence du trafic. Le ministre de l’Intérieur entend réprimer tous les maillons de la chaîne, usagers de drogues, trafiquants de rue et gros trafiquants. C’est la stratégie de la guerre à la drogue dont l’objectif est d’éliminer la production, le trafic et la consommation des drogues illicites, stratégie qui s’est révélée inefficace et même contre-productive. Elle a pour principale conséquence d’engendrer une criminalisation de masse et de rendre les marchés illicites plus instables et plus violents. Ainsi, le démantèlement des points de deal exacerbe la concurrence entre trafiquants, ce dont le ministre se félicite : la fébrilité des trafiquants témoignerait de l’efficacité des forces de police.
« Faire place nette », c’est-à-dire éliminer le trafic de drogues partout en France, ce serait la condition sine qua non pour garantir la tranquillité et la sécurité des habitants. Voilà qui ne devrait pas rassurer les habitants, qui par expérience, constatent que les petits trafiquants de rue se remplacent aisément. Plutôt que de lutter contre le cannabis, ne vaudrait-il pas mieux lutter contre l’utilisation des armes à feu et autres violences ?
C’est précisément ce que propose une expertise fondée sur la comparaison des résultats selon les stratégies et les dispositifs, santé ou sécurité. Ainsi, concernant les problèmes posés les marchés des drogues illicites, le Consortium international sur les politiques des drogues (IDPC), recommande d’accorder la priorité à la réduction des conséquences les plus dommageables liées au marché des drogues comme la violence, la corruption, le blanchiment de l’argent1. C’est là un changement de perspective aussi radical que l’a été la réduction des risques liés à l’usage de drogues au milieu des années 1990. En termes de sécurité, il s’agit d’abord de recentrer la répression sur les responsables de l’expansion du marché des drogues plutôt que le bas de la chaîne, consommateurs, petits dealers de rue, mules qui transportent la marchandise dans leurs corps ou encore petits cultivateurs, qui tous ont été jusqu’à présent les principales cibles de la guerre à la drogue.
L’enjeu est de définir les priorités de l’action publique avec des stratégies de dissuasion ciblée. Ainsi, les organisations trafiquantes transnationales qui ont investi les ports d’Anvers, de Rotterdam ou de Hambourg se sont révélées particulièrement menaçantes en termes de violence et comme en termes de corruption.
La France peut mener des actions contre le trafic transnational en coordination avec ses voisins européens, mais au niveau national, la stratégie adoptée maintient un objectif d’intervention tout azimut, en commençant par ceux qui sont désignés comme les premiers coupables à savoir les consommateurs : « il n’y aurait pas de marché de la drogue s’il n’y avait pas de consommateurs » a répété le ministre de la justice après le ministre de l’intérieur.
Mais les consommateurs existent et l’expérience de ces trente dernières années a montré que les seules actions efficaces les concernant relèvent du champ de la santé avec la réduction des risques liée à l’usage mais aussi dans le soin et dans la prévention. Les pays européens en ont pris acte avec à minima des mesures de décriminalisation de l’usage et de la petite détention afin d’éviter toute incarcération. En France, Il y a toujours des usagers incarcérés dans la mesure où la détention pour consommation personnelle n’est pas distinguée du trafic. Pour l’essentiel les personnes incarcérées sont des petits trafiquants de rue, condamnés ainsi à l’exclusion sociale et à l’enfermement dans la délinquance. Il conviendrait de distinguer les auteurs de violence des acteurs non violents du marché illicite. Les alternatives à l’incarcération sont recommandées pour les acteurs non violents tandis que la dissuasion doit cibler les personnes et les gangs les plus violents. Aux États-Unis, l’opération Cessez le feu (Operation Ceasefire) à Boston sert de référence pour ce qui concerne ce ciblage sélectif. À l’opposé de la tolérance zéro qui sévissait dans les années 90, la stratégie policière et judiciaire s’est donnée pour objectif la réduction des homicides commis par des gangs violents sans chercher à réduire le marché des drogues. Cette stratégie, négociée avec tous les acteurs y compris les jeunes appartenant aux gangs, a obtenu une baisse de 66 % des homicides après le lancement des opérations en 19962. Au reste, l’action ne s’est pas limitée à la répression, elle s’est accompagnée d’actions d’insertion pour les jeunes du quartier appartenant ou non aux gangs.
Dans la lutte contre le trafic, l’Allemagne vient de franchir un pas de plus avec la légalisation du cannabis, une stratégie de régulation que recommandent désormais les experts internationaux réunis dans la commission globale de politique en matière de drogues3. Malte avait déjà franchi ce pas ainsi que le Luxembourg et d’autres pays vont suivre, dont tout d’abord la Suisse, les Pays-Bas et la Tchéquie. Les résultats obtenus par les États qui ont fait le choix de la légalisation sont attentivement suivis. Si le marché illicite du cannabis n’est pas éradiqué, du moins, est-il sensiblement réduit. Son évolution dépend de plusieurs facteurs dont la capacité du marché légal à entrer en concurrence avec le marché noir, mais aussi le type de cadre légal adopté. Les traditions de violence et de corruption, différentes selon les États sont également un facteur à prendre en compte. Il est difficile de prévoir quelle sera l’incidence de la légalisation du cannabis sur le crime organisé.
Quoiqu’il en soit, nous n’en avons pas fini avec les conséquences désastreuses de la prohibition des drogues. Il faut se souvenir que les organisations mafieuses engendrées par la prohibition de l’alcool aux États-Unis ont perduré bien au-delà de son abrogation en 1933. Du moins peut-on éviter de continuer à alimenter le crime organisé transnational, protéger la santé des consommateurs et pacifier autant que possible les relations que les êtres humains entretiennent entre eux.
1https://idpc.net/fr/principes-politiques
2IDPC – La_dissuasion_ciblee_le_ciblage_selectif_le_trafic.pdf
3f2020report_FR_web_0.pd.pdf / Commission globale de politique en matière de drogues : « L’application des lois sur les drogues, viser les responsables du crime organisé », 2020).
L’article Guerre ou paix ? <br> L’urgence d’une autre politique des drogues est apparu en premier sur multitudes.
17.05.2024 à 10:33
DAO Hypercapitalisme ou gouvernance démocratique ?
multitudes
DAO
Hypercapitalisme ou gouvernance démocratique ?
Malgré sa proximité avec le courant cypherpunk, le secteur des cryptomonnaies n’a pas toujours été fidèle à ses valeurs anarchistes, la finance capitaliste investissant toujours davantage dans les cryptomonnaies pour s’approprier ces nouveaux produits financiers. Cette ambiguïté se retrouve dans les DAO, cette nouvelle forme de gouvernance créée par la technologie blockchain. Cette gouvernance décentralisée est en effet tout à la fois l’expérimentation d’une démocratie radicale, bien qu’asociale, et un retour à une ploutocratie qui peut cacher la violence de ses décisions par l’automatisme des mécanismes informatiques.
DAO
Hypercapitalism or Democratic Governance?
Despite its proximity to the cypherpunk field, the cryptocurrency sector hasn’t always been true to its anarchist values, capitalist finance investing ever more in cryptocurrencies to appropriate these new financial products. This ambiguity is reflected in DAOs, this new form of governance created by blockchain technology. This decentralized governance is in fact both an experiment in radical, even if asocial, democracy, and a return to a plutocracy that can hide the violence of its decisions through the automatism of computer mechanisms.
L’article DAO <br>Hypercapitalisme ou gouvernance démocratique ? est apparu en premier sur multitudes.
Texte intégral (6689 mots)
Depuis la création du Bitcoin en 2009, le champ des cryptomonnaies est devenu une culture à part entière. Des milliers de projets sont apparus, des plus sérieux comme le Bitcoin ou Ethereum aux plus inutiles, tels le Dogecoin et le Shiba Inu, qui ont transformé certains chanceux en milliardaires.
Nées aux confins de la culture cypherpunk, les cryptomonnaies mélangent deux mouvements totalement opposés. Se retrouvant dans le rejet d’un capitalisme régulé par l’État, un mouvement hyper-capitaliste et un mouvement porteur d’un projet démocratique se côtoient sans jamais s’avouer leur différence. En effet, profitant du peu de régulations de ce secteur, un certain nombre de fonds d’investissement issus de la finance traditionnelle ont très rapidement introduit leurs capitaux dans ce nouveau marché pour capter ses aspects technologiques les plus innovants.
Sans être dupe de l’importance de la tendance hyper-capitaliste dans le champ des cryptomonnaies, cet article montrera que la culture qu’elles ont fait émerger est aussi porteuse de modèles de gouvernance beaucoup plus horizontaux que ceux que nous connaissons. Sous la forme de DAO (Decentralized Autonomous Organization), ces modèles sont encore en construction et il est nécessaire de mettre en lumière leurs potentialités et leurs contradictions pour comprendre la voie qu’ils ouvrent pour repenser la notion de gouvernance.
Qu’est-ce qu’un cypherpunk ?
Difficile de parler de la dimension politique du Bitcoin et autres cryptomonnaies sans évoquer le mouvement cypherpunk. Ce mouvement informel regroupe des personnes soucieuses de la préservation de leurs données personnelles et de la confidentialité de leurs échanges (transactions monétaires ou communications). Son histoire se confond de plus avec celle d’internet car sa date de naissance est le 19 septembre 1992, précédant de peu l’apparition du premier navigateur internet et le développement du world wide web. Ce jour-là, une discussion importante sur le rôle de la cryptographie dans la modernité rassemble le mathématicien Eric Hugues, l’informaticien John Gilmore, l’activiste et hackeuse Judith Milhon et l’ancien ingénieur d’Intel Timothy May. Ce dernier y lit certains passages de son Manifeste crypto-anarchiste qu’il avait écrit 4 ans auparavant :
« Tout comme la technologie de l’imprimerie a altéré et réduit le pouvoir des corporations médiévales et la structure sociale de pouvoir, les méthodes cryptologiques altèrent fondamentalement la nature de l’interférence du gouvernement et des grandes sociétés dans les transactions économiques1. »
Judith Milhon déclare alors « Vous êtes tous des crypto-anarchistes – ce que j’appellerai des cypherpunks ». Cet acte de naissance aux allures de société secrète rapproche les cypherpunks du cyberpunk, un genre de science-fiction dystopique qui explore les potentialités fictionnelles des nouvelles technologies et de l’informatique. Alors que le cyberpunk décrit une société décadente, les cypherpunks pensent au contraire que la technologie, en particulier internet et la cryptographie, peuvent être des facteurs d’émancipation. Cet utopisme est fortement inspiré par l’économiste libéral Friedrich Hayek et son idée d’un ordre spontané qui pourrait émerger d’un marché non contrôlé par l’État.
Le mouvement Cypherpunk a très vite des démêlés avec la justice américaine dans l’affaire du PGP, un logiciel libre de chiffrement créé par Phil Zimmermann qui s’est diffusé à travers le monde. En effet, les lois américaines considèrent les produits cryptographiques comme des munitions et il est donc impossible de les exporter sans autorisation. En 1996 Bill Clinton assouplit heureusement la loi sur les produits cryptographiques et cette première bataille s’achève rapidement. Cependant, la création du site WikiLeaks par Julian Assange en 2006 scellera le divorce définitif entre les Cypherpunks et les autorités américaines. En créant une plateforme pour les lanceurs d’alerte, Julian Assange met en application les principes d’un internet libéré du contrôle des gouvernements. Mais depuis la publication de documents américains datant des guerres en Afghanistan et en Irak, il est accusé d’espionnage par les États-Unis et pourrait être condamné à 175 ans de prison. Il est pour l’instant incarcéré en Angleterre et peut être extradé d’un moment à l’autre aux États-Unis.
Hal Finney, autre figure du mouvement Cypherpunk morte en 2014, s’intéresse au lancement du Bitcoin, et Satoshi Nakamoto lui envoie la première transaction Bitcoin en janvier 2009. Atteint de sclérose en plaque, il a continué à travailler sur le Bitcoin jusqu’à la fin de sa vie. Il a publié le 19 mars 2013 sur le forum Bitcoin Talk le post « Bitcoin and Me2 » dans lequel il raconte son histoire et son rapport au Bitcoin. Depuis sa mort en 2014, certains considèrent qu’il pourrait être Satoshi Nakamoto (un pseudonyme) lui-même.
Bitcoin, Ethereum et contrat intelligent
Il n’est pas anodin que Satoshi Nakamoto publie le livre blanc du Bitcoin en 2008 sur un forum Cypherpunk car, en réalité, l’architecture de ce réseau et sa sécurité sont l’héritier du travail des personnalités les plus influentes de ce mouvement. Qu’est-ce que le Bitcoin ? Avant d’être une monnaie numérique, il s’agit d’un programme informatique appelé blockchain3. Une blockchain est un registre comptable numérique dont l’authenticité est garantie par un réseau d’ordinateurs. Grâce à un calcul cryptographique, ces ordinateurs ajoutent continuellement de nouveaux blocs à cette chaîne pour enregistrer chaque nouvel état de ce livre de compte. Pour garantir la sécurité de la blockchain, c’est-à-dire garantir la validité de ce livre comptable, ces ordinateurs appelés « mineurs » effectuent un calcul cryptographique complexe. En récompense, ces mineurs reçoivent la monnaie de cette blockchain : le Bitcoin.
La force subversive du Bitcoin repose sur trois éléments : le fonctionnement et la sécurité du réseau Bitcoin ne dépendent que d’un réseau d’ordinateurs anonymes, les utilisateurs ont leur vie privée protégée puisque seule l’adresse de leur compte est visible sur le réseau, et le nombre d’unités possible est limité à 21 millions. Il y a néanmoins une inflation puisque les Bitcoins sont créés peu à peu en récompense du minage mais il n’y aura jamais plus de 21 millions de Bitcoin, le dernier devant être créé en 2140. Puisqu’il y a actuellement plus de 19 millions de Bitcoin, l’inflation est en réalité dérisoire. C’est pour cette raison qu’on a vu dans cette monnaie une réponse à la crise monétaire de 2008. Depuis, le Bitcoin a peu à peu acquis le statut « d’or numérique » grâce à sa rareté.
Après le Bitcoin, d’autres blockchains sont apparues dont Ethereum, la plus célèbre après le Bitcoin. Ethereum a été créé par Vitalik Buterin, un jeune informaticien russo-canadien qui a intégré la communauté Bitcoin dès 2011 à l’âge de 17 ans. Après avoir tenté d’améliorer le réseau Bitcoin pour le rendre plus polyvalent, il développe sa propre blockchain et en publie le livre blanc en 20144. Soucieux aussi de la protection des données personnelles, Vitalik Buterin voit rapidement les potentialités ouvertes par les blockchains sur les questions de gouvernance. Cette nouvelle génération de blockchains permet la construction d’applications basées sur des smart-contracts. Ces smart-contracts ou « contrats intelligents » sont des programmes automatisés qui permettent d’effectuer des transactions sans l’intervention de tiers de confiance. Ils se déclenchent dès que les conditions initiales indiquées dans ce smart-contract sont réunies. Ces applications décentralisées forment une nouvelle étape d’internet, ce qu’on appelle le « web3 », qui se définit avant tout en réaction au web2, celui des GAFAM, qui n’était pas soucieux de la vie privée des utilisateurs car trop centralisé. Dans le web3, au contraire, ceux-ci redeviennent propriétaires de leurs données personnelles. S’ils décident de les monétiser, ceci se fera justement en toute transparence grâce aux smart-contracts. Peu à peu, les cas d’utilisation de la technologie blockchain se sont multipliés : finance, gaming, réseaux sociaux, internet des objets – mais aussi gouvernance décentralisée grâce aux DAO.
Tous ceux qui participent aux web3 ne partagent pas les mêmes valeurs éthiques. Au contraire, si les puristes restent fidèles aux principes du Cypherpunk, beaucoup d’entrepreneurs utilisent le web3 comme une nouvelle étape du marketing digital. Pour ces derniers, la décentralisation et la réappropriation des données personnelles ne sont que des outils pour renforcer l’engagement des communautés qui se construisent autour des marques et produits. Les partisans des DAO voient au contraire le potentiel communautaire et démocratique de cette technologie.
Les DAO, origines et enjeux
Les DAO ou « organisations autonomes décentralisées » sont des communautés dont la gouvernance est liée à la technologie blockchain et aux cryptomonnaies. Aux yeux de certains, elles représentent un modèle radicalement nouveau de coordination des actions humaines à large échelle, grâce à leurs six qualités définitoires : « les DAO sont auto-poïétiques, a-légales, super-scalables, exécutables, accessibles sans permission, alignées, co-propriétaires et mnémoniques5. »
Dès septembre 2013, Vitalik Buterin publie une série d’articles sur les « Decentralized Autonomous Corporation6 » dans Bitcoin Magazine, avant d’utiliser le sigle DAO à partir de 2014. Dès ces premiers articles, Vitalik Buterin se questionne sur l’apport de l’informatique et en particulier du Bitcoin sur les prises de décision. Un programme informatique automatise en effet certains processus mais cela ne nous renseigne pas sur celui qui écrit ou qui déclenche ce programme. Vitalik Buterin propose une réponse apparemment simple à ce problème : la prise de décision sur le code revient au « distribued computing ». Le réseau Bitcoin est déjà un modèle de gouvernance décentralisée. Lorsqu’un développeur veut changer le code de la blockchain, il ne peut obliger les mineurs à faire la mise à jour sur leur machine. Si le changement est refusé, la blockchain gardera son ancien code. Cette gouvernance décentralisée se fait donc sans vote et de manière complètement anonyme, le pouvoir de vote de chaque mineur dépendant uniquement de la puissance de calcul qu’il fournit au réseau. Cependant, cette gouvernance reste encore très informelle et est limitée aux problèmes de la mise à jour du réseau.
Lorsque Vitalik Buterin publie sa seconde série d’articles sur le même sujet en 2014, Ethereum est en pleine construction. Grâce à ses smart-contracts, cette blockchain permet d’imaginer de vraies DAO. Les smart-contracts en effet permettent de créer des jetons (tokens) aux multiples usages. Une DAO peut ainsi avoir son propre jeton qui symbolise un pouvoir de vote. Chaque détenteur de ce jeton pourra voter et le vote déclenche un autre smart-contract qui applique automatiquement la décision.
Une des toutes premières DAO construites sur la blockchain Ethereum a porté le nom symbolique de The DAO et a été créée par la société Slock.it en 2016. Le whitepaper de The DAO7 définit clairement son but : « The DAO est un code hébergé sur la blockchain qui émule le fonctionnement d’un fonds de placement, et qui peut financer et percevoir des fonds d’autres entités ayant des activités sur une blockchain. » En d’autres termes, The DAO a un but proche des sites de crowdfunding classiques. Une communauté de 4 000 membres s’est construite autour de ce projet, aidant les développeurs à construire le code à la fois pour la collecte, la distribution des fonds et pour la procédure de vote. Cependant, aucun cadre juridique ou aucune procédure précise pour l’examen des dossiers des projets à financer n’ont été élaborés. Malgré le sérieux de Slock.It, The DAO est avant tout une expérimentation qui sera au fondement de toutes les autres DAO et le début de The DAO a été un remarquable succès. Une phase de souscription a été ouverte pendant 28 jours pour acheter ses tokens. Ceux-ci avaient trois fonctions (qui sont souvent utilisées dans les jetons de DAO) : ils représentent un pouvoir de vote ; ils permettent de récupérer une partie des revenus de la DAO ; et ils peuvent évidemment être revendus. Le projet a récupéré l’équivalent de 150 millions de dollars à la fin de la période de souscription.
Malheureusement, cette success story s’est vite transformée en drame. Le 17 juin 2016, un hacker a réussi à détourner 50 millions de dollars. Ce hack historique, même s’il n’est pas le plus important vécu par l’écosystème blockchain, a révélé la fragilité de ces modèles de gouvernance en termes de sécurité. La gestion des fonds par un code n’évite pas automatiquement tous les problèmes de gestion, et ce hack a montré la naïveté des fondateurs de cette première DAO.
Le hacker ne pouvant obtenir ses fonds qu’après un délai de 35 jours, il était possible de chercher une solution pour les récupérer. La communauté des développeurs et des mineurs d’Ethereum s’est alors déchirée autour d’un choix symbolique. Soit on corrigeait les effets du piratage en reprenant un état de la blockchain avant le hack, soit on considérait que le code devait rester immuable. Les votes ont conduit à une victoire très claire de la décision de reprendre un état antérieur de la blockchain pour annuler le hack. Une minorité a alors décidé de garder la blockchain originelle pour respecter l’immutabilité du code, en la renommant Ethereum Classic. Une fois les fonds récupérés sur la blockchain Ethereum, le projet The DAO a été fermé, le hack ayant eu raison de cette expérimentation originelle. Cependant, au-delà de la nécessité de sécuriser davantage les smart-contracts, la résolution du hack a permis de mettre à jour le problème de la gouvernance, non pas du projet The DAO mais de la blockchain Ethereum elle-même. Le déchirement de la communauté qui a conduit à la création de deux réseaux est lié à la fois à l’illusion de l’immutabilité du code et à une imprécision des règles de la gouvernance de la blockchain. Cela montre que la question de la gouvernance est inséparable de la technologie blockchain. Son fonctionnement en réseau crée inévitablement du collectif.
Cette gouvernance collective implique en fait la définition de beaucoup de paramètres. Il faut définir le pouvoir de vote de chacun et donc le poids de chaque jeton. Nous reviendrons sur ce problème car il entraîne le plus souvent un capitalisme au sein même de la gouvernance dans la plupart des DAO existantes. De plus, il faut définir le périmètre d’action de la DAO, d’autant plus si elle est liée à un projet particulier construit par une équipe. Dans ce cas, la DAO a-t-elle tout pouvoir sur l’avenir du projet même si l’équipe considère qu’une décision est néfaste ? Ou au contraire la DAO a-t-elle un champ d’action limité à un domaine ? Enfin, il faut définir le processus de décision : qui a le droit d’émettre une proposition ? Quel temps allouer aux discussions précédant le vote ? Combien de temps les membres de la DAO ont-ils pour voter ? Toutes ces questions montrent que ni la décentralisation ni l’automatisation de la prise de décision ne peuvent être complets. On constate que beaucoup de projets commencent par un mode de gouvernance centralisé et progressent peu à peu vers la décentralisation.
Polkadot, un exemple de décentralisation progressive
Les conséquences du hack de The DAO, qui ont conduit à un déchirement de la communauté Ethereum, ont eu un effet positif car elles ont permis de prendre conscience de la nécessité d’édicter des règles claires de gouvernance. Cette prise de conscience est renforcée par le statut ambigu des actifs numériques dans le monde de la finance et en particulier dans la législation américaine. En effet, celle-ci distingue en particulier les Commodities, telles que les matières premières, et les Securities, qui sont des actifs mobiliers comme les actions boursières. Cette seconde catégorie est contrôlée par la SEC (Securities and Exchange Commission) qui définit quel actif est une security et qui a le droit de servir d’intermédiaire dans les échanges de ces actifs. Depuis les années 1940, la SEC utilise le test de Howey 8 pour définir si un actif est une security. Un actif est considéré comme une valeur mobilière selon ce test s’il répond à trois critères : l’argent des investisseurs est géré par une entreprise commune, les investisseurs s’attendent à générer des gains, les bénéfices ne dépendent pas des investisseurs. La décentralisation de la gouvernance est donc souvent vue dans les projets de cryptomonnaies comme un moyen de contourner le premier et le troisième critère. Cette question ouvre évidemment un débat sur le statut de ces actifs (security ou nouvelle catégorie de la finance capitaliste ?) qui dépasse le cadre de cet article.
Parmi tous les exemples possibles, la transformation du modèle de gouvernance de la blockchain Polkadot peut être privilégiée car celle-ci a été construite par Gavin Wood, un des cofondateurs de Ethereum avec Vitalik Buterin, et parce qu’elle est considérée comme une des blockchains les plus décentralisées. La gouvernance de Polkadot est en réalité passée par trois étapes. La première étape a été celle de la création du réseau lui-même. Gavin Wood a ensuite mis en place une fondation à but non lucratif, la Web3 Foundation, qui a pour but de suivre le développement du réseau. C’est cette fondation qui a fait la levée de fonds pour le financement de ce projet. La Fondation a engagé ensuite la société Parity, créée aussi par Gavin Wood, pour construire le code et les infrastructures de la blockchain. Parity ne possède donc pas la blockchain Polkadot mais a le statut de prestataire de service.
Une fois la blockchain Polkadot mise en route, la deuxième étape a permis de définir une première forme de gouvernance, un début de décentralisation. Cette première gouvernance était composée de trois instances : les détenteurs de la cryptomonnaies DOT, le concile et le comité technique. De plus, les détendeurs de DOT pouvaient déléguer leur pouvoir de vote à des représentants s’ils ne voulaient pas voter eux-mêmes. Le concile était composé de treize membres élus parmi les détenteurs de DOT et avait trois rôles : il servait à proposer les référendums les plus sensibles, à annuler les référendums malveillants par son droit de véto et à élire le comité technique. Quant à ce dernier, il était composé d’experts qui avaient déjà contribué au réseau ; il avait également pour rôle d’annuler les référendums malveillants mais aussi de résoudre les bugs qui pouvaient se produire sur le réseau. Dans cette première forme de gouvernance, il ne pouvait enfin y avoir qu’un vote référendaire à la fois. Elle est donc encore loin d’être décentralisée car un organe central avait encore un droit de véto et pouvait décider du moment où une proposition était soumise au vote.
La deuxième forme de gouvernance a été mise en place en 2023 et s’appelle « OpenGov ». Cette gouvernance ouverte se propose d’expérimenter une décentralisation quasi intégrale. Le concile a été dissous et les membres de la communauté ont alors tout pouvoir sur les référendums. De plus, plusieurs votes référendaires peuvent avoir lieu en même temps, ce qui donne une plus grande agilité à ce dispositif. La délégation du pouvoir de vote est toujours possible mais on peut maintenant choisir des représentants différents selon le domaine de la proposition soumise au vote. Enfin le comité technique est remplacé par l’association technique Polkadot dont l’accès sera facilité. Décentralisation et agilité sont donc les maîtres mots de cette nouvelle organisation dans laquelle Parity, la société qui a créé le code de Polkadot, n’est plus qu’un acteur parmi d’autres dans l’avenir de cette blockchain. Malgré cette volonté de décentralisation extrême, il ne faut pas être naïf sur sa réalité car le pouvoir de vote revient aux détenteurs de DOT, token qui a un prix en équivalent dollar. Comme toute DAO, celle-ci risque d’être prisonnière d’une ploutocratie qui ne veut pas dire son nom.
Les DAO sont-elles des ploutocraties écocidaires ?
Malgré leurs potentialités dans le renouveau des modèles de gouvernance, les DAO souffrent de plusieurs maladies structurelles. Même si elles peuvent varier sur l’étendue de leur domaine de décision, les DAO appliquent souvent la même règle pour déterminer le pouvoir de vote de chacun : celui-ci est proportionnel au nombre de tokens possédé. Certaines DAO essaient de donner plus de pouvoir de vote à ceux qui conservent plus longtemps leurs tokens mais cela ne change pas le problème fondamental : ce sont souvent les plus riches investisseurs qui contrôlent les décisions de la communauté.
Une première piste serait de ne pas donner de prix à ces tokens. S’ils ne peuvent être ni achetés ni vendus9, la DAO peut définir librement comment les obtenir : cela peut être en proportion des tâches effectuées au sein de l’organisation, selon une estimation du degré de compétence. Dans ce cas, la technologie blockchain permet de construire des modèles de gouvernance qui allient transparence du processus, reconnaissance de l’implication et de l’expertise, et confidentialité des votants.
Une autre serait d’expérimenter d’autres mécanismes de vote rendus possibles par la technologie blockchain. L’université des sciences sociales de Singapour a ainsi proposé un nouveau modèle de gouvernance10 pour éviter la concentration du pouvoir de vote par ceux qui détiennent le plus de jetons de la DAO. Ce modèle utilise la notion de conviction pour changer le rythme des votes. Un vote ne pouvant être accepté que dans une durée déterminée, il est possible de parier pour ou contre le vote en fonction de l’issue du vote qu’on estime majoritaire. Cela a pour effet de l’accélérer ou de le ralentir selon le choix de la majorité des parieurs. Selon l’issue du vote, les parieurs qui ont gagné seront récompensés ainsi que celui qui a fait la proposition si elle est acceptée. De plus, contrairement aux votes eux-mêmes, les paris sur le vote sont anonymes et obligent à engager des jetons. Cette possibilité de prendre un risque supplémentaire pour supporter ou rejeter plus fortement une proposition selon ses convictions a pour but de favoriser les bonnes propositions et de rééquilibrer le pouvoir de vote. Pour l’instant, ce nouveau modèle construit à partir de la théorie des jeux n’a pas encore été appliqué, ce qui ne permet pas de savoir s’il atteint son but. Il montre néanmoins la plasticité des modèles de gouvernance qu’il est possible de construire grâce à la technologie blockchain.
Une autre maladie souvent dénoncée dans les blockchains est leur consommation d’électricité. Les estimations de la dépense énergétique causée par le minage du Bitcoin sont vertigineuses : on parle d’un tiers de la consommation électrique de toutes les infrastructures numériques dans le monde, l’équivalent des dépenses électriques d’un pays comme la Finlande, ou encore de 75 % des ménages français. Comme l’écrit l’artiste et théoricienne Hito Steyerl :
« En raison du gaspillage d’énergie, les cryptomonnaies ont provoqué des pannes de courant et des problèmes de réseau dans des endroits comme le Kosovo, la Géorgie/Abkhazie et le Kazakhstan. Les gens ont commencé à protester contre les pannes d’électricité causées par les protocoles Proof-Of-Work des cryptomonnaies. Paradoxalement, la tentative d’automatisation de la confiance par les cryptotechnologies finit par saper leur condition même, à savoir un approvisionnement stable en électricité. […] Tout projet de décentralisation basé sur le Web manque d’une base fiable tant que le pouvoir électrique et gouvernemental n’est pas décentralisé11. »
Toutefois, le 15 septembre 2022, Ethereum est passé du mécanisme de Proof-of-Work, utilisé par le Bitcoin et cause d’une dépense énergétique proprement délirante, vers un mécanisme Proof-of-Stake. Cette opération, intitulée The Merge, aurait permis à la blockchain de réduire sa consommation énergétique de 99,95 %, réduisant les consommations mondiales d’électricité de l’équivalent de celle d’un pays comme le Chili.
Expérimenter une gouvernance sans confiance
Les DAO sont-elles un nouveau modèle de gouvernance ou ne sont-elles qu’une nouvelle technologie utilisable pour des modèles de gouvernance classique ? Même si on opte pour la seconde interprétation, on peut cependant noter qu’elles permettent de gagner en transparence et efficacité. De plus, elles ont le mérite de nous obliger à penser les règles électorales qui seront à l’origine des prises de décision. Cette mise en lumière de procédures qui nous semblent quasi-naturelles est donc salutaire pour prendre une distance critique vis-à-vis de ces anciens modèles de décision.
Hito Steyerl adresse aux DAO une critique radicale : « Le contrat social évoqué par le projet d’organisation autonome décentralisée est souvent implicitement un contrat antisocial – parce qu’il n’a tout simplement aucun concept du social. […] L’horizon politique des DAO – en tant que communautés de copropriétaires – résonne intimement avec un contexte de privatisation rampante » (ibid.). Une approche plus nuancée soulignerait que les DAO et leur automatisation entraînent un modèle de gouvernance implicitement rousseauiste. L’acte politique se concentre ici dans le moment du choix de la loi. Il incarne la volonté générale du peuple comme celui de la DAO. Si on peut complexifier à loisir le modèle de décision, le moment de l’application n’est guère pensé. Les DAO peuvent être alors considérées comme des gouvernances sans tiers de confiance car elles ne dépendent d’aucun pouvoir exécutif, l’application étant automatisée par le smart-contract. Appliqué au monde de l’entreprise, qui est un des terrains privilégiés des partisans des DAO, ce mode d’application peut conduire à un management brutal, qui serait l’envers de cette gouvernance horizontale. Sous couvert d’une « tyrannie de la majorité », ce management risque de gagner en légitimité si le moment de l’application reste un impensé des DAO.
Si cet impensé peut se comprendre lorsqu’il s’agit simplement de modifier un programme informatique, il devient plus problématique s’il a des conséquences sur des comportements humains. Si elles veulent éviter ce management brutal, les DAO se retrouvent face à un dilemme qu’elles ne pourront pas éviter : soit elles devront limiter leurs domaines d’application, soit elles devront lever cet impensé. Malheureusement, l’anarchisme inhérent aux pères fondateurs de cette gouvernance décentralisée risque d’être très facilement subverti par ce management car, en réalité, le modèle applicatif des décisions d’une DAO n’est autre que celui de la sous-traitance. Une DAO n’a en soi pas d’employés, elle a simplement des actionnaires. Lorsque l’application de la décision ne peut pas être automatisée dans un code informatique, elle est déléguée à une entreprise externe. C’est pour cette raison que l’attention s’est constamment portée sur les règles et la prise de décision et non sur l’application de ces décisions.
La technologie peut-elle nous aider à changer nos modèles de gouvernance ? Lointaine héritière du mouvement Cypherpunk et de ses idéaux de décentralisation, la technologie blockchain a développé la promesse d’une gouvernance horizontale grâce aux DAO, ces organisations décentralisées autonomes utilisant la technologie des smart-contracts pour construire des processus de votes transparents et paramétrables. Cependant, cette volonté d’éliminer tout tiers de confiance laisse impensé le moment de l’application et introduit implicitement le modèle économique de la sous-traitance. Les idéaux de décentralisation sont ici rongés par un culte inavoué de l’efficacité, et seule l’évolution des DAO nous dira si ce nouveau modèle de gouvernance est autre chose qu’un outil récupéré par un doux capitalisme.
1Timothy May, Le manifeste crypto-anarchiste, août 1988, envoyé sur la mailing list cypherpunk : https://cypherpunks.venona.com/date/1992/11/msg00204.html. Consulté en juillet 2023.
2« Bitcoin and me », forum Bitcoin Talk, 19 mars 2013, consulté en janvier 2024 : https://bitcointalk.org/index.php?topic=155054.0
3Pour une introduction sur les blockchains, voir « Total Record. Les protocoles blockchain face au post-capitalisme », Multitudes no 71, 2018, p. 70-79.
4Vitalik Buterin, Ethereum whitepaper, 2014, https://ethereum.org/en/whitepaper/, consulté en janvier 2024.
5Kei Kreutler, « Eight Qualities of Decentralised Autonomous Organisations » in Ruth Catlow & Penny Rafferty, Radical Friends. Decentralised Autonomous Organisation and the Arts, London, Torque, 2022, p. 96-100.
6« Bootstraping a decentralized autonomous corporation », Bitcoin magazine, 19 sept. 2013, 21 sept. 2013 et 24 sept. 2013. https://bitcoinmagazine.com/technical/bootstrapping-a-decentralized-autonomous-corporation-part-i-1379644274 ; https://bitcoinmagazine.com/technical/bootstrapping-an-autonomous-decentralized-corporation-part-2-interacting-with-the-world-1379808279 ; https://bitcoinmagazine.com/technical/bootstrapping-a-decentralized-autonomous-corporation-part-3-identity-corp-1380073003 (consultés en janvier 2024).
7Whitepaper de The DAO, consulté en juillet 2013 : https://github.com/the-dao/whitepaper
8Ce test est issu du procès de la SEC contre W. J. Howey Co. en 1946.
9Il est possible en fait de créer des tokens non transférables et même des tokens, appelés Soulbound Tokens, qui synthétisent l’activité d’un utilisateur sur les applications d’une blockchain.
10Ce modèle est décrit dans l’article « Singapore University of Social Sciences proposed a new voting mechanism for DAO governance », DAO Times, 26 mai 2023. Consulté en janvier 2024 : https://daotimes.com/singapore-university-of-social-sciences-proposed-a-new-voting-mechanism-for-dao-governance
11Hito Steyerl, « Walk the Walk. Beyond Blockchain Orientalism » in Ruth Catlow & Penny Rafferty, Radical Friends. Decentralised Autonomous Organisation and the Arts, London, Torque, 2022, p. 127-132.
L’article DAO <br>Hypercapitalisme ou gouvernance démocratique ? est apparu en premier sur multitudes.
- GÉNÉRALISTES
- Ballast
- Fakir
- Interstices
- Lava
- La revue des médias
- Le Grand Continent
- Le Monde Diplomatique
- Le Nouvel Obs
- Lundi Matin
- Multitudes
- Politis
- Regards
- Smolny
- Socialter
- The Conversation
- UPMagazine
- Usbek & Rica
- Le Zéphyr
- CULTURE / IDÉES 1/2
- Accattone
- Contretemps
- A Contretemps
- Alter-éditions
- CQFD
- Comptoir (Le)
- Déferlante (La)
- Esprit
- Frustration
- IDÉES 2/2
- L'Intimiste
- Jef Klak
- Lignes de Crêtes
- NonFiction
- Période
- Philo Mag
- Terrestres
- Vie des Idées
- THINK-TANKS
- Fondation Copernic
- Institut La Boétie
- Institut Rousseau
- TECH
- Goodtech.info
- Quadrature du Net
- INTERNATIONAL
- Alencontre
- Alterinfos
- CETRI
- ESSF
- Inprecor
- Journal des Alternatives
- Guitinews
- MULTILINGUES
- Kedistan
- Quatrième Internationale
- Viewpoint Magazine
- +972 mag
- PODCASTS
- Arrêt sur Images
- Le Diplo
- LSD
- Thinkerview
- Pas des sites de confiance
- Brut
- Contre-Attaque
- Korii
- Positivr
- Regain
- Slate
- Ulyces