
25.12.2025 à 07:00
David Guiraud insoumis à taille humaine
Texte intégral (2810 mots)
Les élections municipales seront-elles un tournant pour La France insoumise ? Le parti de Jean-Luc Mélenchon avait délaissé les élections locales ; il espère désormais conquérir quelques villes – au risque de créer des « baronnies ». Roubaix est sur la liste des conquêtes possibles. Et c’est David Guiraud, le député du Nord, qui part à l’abordage.
Dans le Grand Café, celui qui fait face à l’hôtel de ville de Roubaix, on vient autant s’abriter de la pluie que pour déjeuner. Tout le monde se salue, d’un air entendu et sympathique. Ce jour-là, le maire sortant, Guillaume Delbar, et son équipe déjeunent à une table à l’étage. Son challenger, David Guiraud, et moi sommes attablés au rez-de-chaussée, en vitrine. Quand l’édile de droite sort avec son aréopage, il ne manque pas de venir saluer l’insoumis : on se rend des civilités cordiales, presque joviales. Il y a dans ces échanges quelque chose qui existe davantage dans les réalités locales qu’à l’Assemblée nationale : la rivalité existe, la tension politique est là, mais la vie commune impose des formes de civilité. Cette proximité sans affrontement spectaculaire dit déjà beaucoup de celui qui l’accepte sans façon : la bataille sera rude, mais elle se jouera sur le terrain du quotidien et de la crédibilité réelle des projets plus que dans les postures et les post-assassins sur les réseaux sociaux.
David Guiraud a trente et un ans. On le connaît pour ses interventions à l’Assemblée et à la télévision, coupantes et efficaces, ses questions qui font mouche et ses emportements millimétrés qui deviennent des extraits viraux. Mais réduire son parcours à ces instants serait passer à côté de l’essentiel : sa campagne est d’abord une histoire d’installation et de filiation. Car le député LFI n’est pas né à Roubaix. Il est le fils de son père, maire socialiste des Lilas en Seine-Saint-Denis, qui lui a transmis très tôt une culture municipale, un sens de l’action locale, une familiarité avec le pouvoir, ses rouages et ses grandeurs modestes. Fils de socialiste, il a aussi grandi avec l’idée que la politique peut transformer concrètement une ville. Mais il connaît l’exigence qui a accaparé son père durant toute son enfance. Parachuté à Roubaix par La France insoumise, il a choisi, contrairement à d’autres, de s’installer tout de suite dans la ville, d’y vivre, d’y inscrire son quotidien. Ce choix a compté : au lieu de rester une silhouette de passage, il s’est fait un voisin, un interlocuteur, une présence.
Entre la mairie des Lilas que son père dirigea et l’Assemblée nationale – où il était collaborateur d’Éric Coqurel –, David Guiraud a construit une trajectoire singulière. Cette double filiation forme son profil composite : bagarreur et gestionnaire, orateur et organisateur, héritier et autonome.
En vérité, David Guiraud a une double paternité politique. D’un côté, son père biologique, de l’autre, un père d’adoption politique : Éric Coquerel, dont il a été le collaborateur parlementaire durant plusieurs années. À ses côtés, il a appris le travail d’amendement, la précision des dossiers, la confrontation parlementaire, l’art d’occuper la scène politique nationale. Entre la mairie des Lilas et l’Assemblée nationale, entre un socialisme municipal de terrain et une insoumission parlementaire offensive, David Guiraud a construit une trajectoire singulière. Cette double filiation forme son profil composite : bagarreur et gestionnaire, orateur et organisateur, héritier et autonome.
Architecture politique
On le retrouve dans son local de campagne, pensé comme un atelier-usine politique. Très vaste, il peut accueillir une centaine de personnes. Les murs portent des plans, les tables recouvertes de maquettes de la ville : il montre, avec une baguette de maître d’école, les portions de la ville, les structures et les ambitions, les liaisons piétonnes existantes et à venir, les projets de reconversions de friches. Le directeur de campagne, architecte, tient une place centrale : il traduit volontiers des enjeux sociaux en dispositifs spatiaux. Ce n’est pas un simple argument de communication ; la question urbaine n’est pas accessoire mais constitutive du projet.
Elle structure l’édifice des propositions. David Guiraud et son équipe ne séparent pas l’écologie, le social et l’emploi. Nawri Khamallah explique la logique avec des mots d’architecte mais une visée sociale : « Si on repense les parcours entre les écoles et les transports, si on crée des espaces partagés qui favorisent la micro-économie, on fabrique aussi de la sécurité, de l’emploi, de la mixité ». Ce vocabulaire technique est pris comme un outil pour rendre le politique intelligible : les plans servent à mettre à plat des choix qui, sinon resteraient abstraits.
La mémoire de Roubaix traverse notre entretien. Ville ouvrière, productrice, organisée, elle fut longtemps un exemple pour la gauche municipale. Cette mémoire s’accroche aux pierres des usines, aux vieux commerces, aux syndicalismes encore vivaces. Elle explique l’attachement des habitants à leur ville et la colère que suscite le déclassement. La désindustrialisation a laissé des traces profondes : chômage, précarité, logements dégradés, équipements publics qui s’usent. Sur ces terrains, la parole de David Guiraud résonne : il évoque des parcours de rénovation, des fonds de solidarité, des coopératives pour relancer des activités locales. Il sait aussi que les retours électoraux sont marqués par l’abstention, que beaucoup ont cessé de croire dans les vertus du vote.
Dans la ville, les opinions sont multiples. Une boulangère du centre dit : « Il est jeune, on le voit, il écoute. Mais nous avons eu des élus qui disaient la même chose. Moi, j’attends de voir. » Un éducateur associatif qui sirote un café devant la gare note : « Ce qui change, c’est la volonté d’impliquer les jeunes. Guiraud, je me demande si c’est juste du spectacle ou si c’est une porte pour dialoguer. Mais franchement, j’ai envie d’y croire. » Un retraité, prudent, nuance : « On a besoin que cela tienne sur la durée, que ce ne soit pas que de la com’. » David Guiraud entend ces voix et répète qu’il ne vend pas des illusions : sa communication est un moyen, pas une fin.
Insoumission à échelle locale
La campagne, dans sa mécanique, articule action culturelle, travail de proximité et technicité des politiques publiques. L’équipe a abattu un travail titanesque : ils ont produit un programme de plusieurs centaines de mesures… un peu à l’image du programme de La France insoumise, la fameuse bible intitulée L’avenir en commun, qui comprend le même nombre de mesures. Et d’ailleurs, David Guiraud explique comment il l’a élaboré : de la même façon que le mouvement au niveau national. L’équipe est allée voir les associations et les habitants et a noté doléances et propositions. Résultats : tout est là et chacun est censé y retrouver ce qu’il a raconté. Et, donc, de valider la proposition. On sait qu’à la fin, il n’émergera dans le fort de la campagne que quelques idées-forces mais cela permet, dans un premier temps, de rassembler tout le monde et de faire montre d’une envie de participation. Déjà des idées affleurent, plus fortes que d’autres : par exemple celles du directeur de campagne, qui met en garde contre la gentrification : « On ne veut pas transformer Roubaix pour ceux qui viendront après. Il faut des modèles qui permettent à ceux qui sont là de rester ». C’est sur ce fil que la campagne construit ses propositions de mixtes fonctionnelles et de préservation des loyers.
Les adversaires politiques sont bien présents : la droite municipale, portée par un maire habile à apparaître comme gestionnaire ; l’extrême droite qui prospère sur le ressentiment. David Guiraud ne minimise pas ces forces. Il identifie deux fronts : l’affrontement politique traditionnel – campagnes, débats, tractations – et la lutte contre la résignation. « Le vrai adversaire, me dit-il, c’est que les gens cessent de penser que la ville peut changer. » Pour lui, le remède est double : des résultats tangibles à court terme et une stratégie de long terme de transformation urbaine et socio-économique. Objectif : que les Roubaisiens ne se sentent plus abandonnés par tous, à commencer par leurs propres élus.
L’urbanisme n’est pas un simple volet esthétique ; il est au cœur de la justice sociale. David Guiraud imagine des parcours piétons qui relient écoles et équipements, des micro-ateliers d’économie circulaire sur des friches, des lieux culturels portés par des collectifs locaux. L’architecture, ici, est conçue comme une fabrique de communs. Son architecte de campagne parle volontiers d’« urbanisme d’usage » : des interventions modestes mais visibles pour transformer la manière dont la ville est vécue.
Faire mieux
« Je suis militant depuis dix ans. » Dans l’intervalle, David Guiraud est devenu une figure médiatique, pas une star mais une voix identifiée – « J’avais mon rond de serviette dans les médias », dit-il en souriant. Et pourtant il n’a pas voulu se présenter pendant ces années-là : il tenait à finir ses études, à vivre une première expérience « de collaboration » auprès d’Éric Coquerel. « J’étais à l’école de la politique, je ne suis pas un ovni. Mais je voulais bosser, pas forcément être devant. » 2022 arrive et l’idée s’impose : « Je me dis que ça peut être le moment ». Il décrit, sans dramatiser, ce moment banal et décisif de tant de trajectoires politiques : une maturation, des encouragements, puis une porte qui s’entrouvre.
Il précise tout de suite un nœud biographique : Les Lilas. « Je ne voulais pas me présenter là-bas. Je n’avais pas envie d’être dans l’ombre de mon père, ni d’être dans sa lumière. » Il cherche un territoire qui lui ressemble davantage et, à ce moment, des camarades l’appellent : à Roubaix, en 2017, la gauche avait été éliminée au premier tour, faute d’unité et de projet. « Pourtant, quand tu regardes la sociologie, c’est très populaire. » Il sent qu’il manque quelqu’un qui veut y aller pour gagner. Le comité électoral s’en mêle. Il arrive, observe, tranche une première chose : s’installer. « À partir du moment où je suis candidat là-bas, j’y habite. » Il en parle comme d’une condition éthique et d’une évidence pratique, surtout pour un trentenaire sans enfants : « Vivre dans sa ville, c’est la première condition si tu veux t’implanter vite. » Après la campagne, il achète un appart sur place et « s’enkyste ». Sa compagne accepte de bouger avec lui. « Je n’avais pas forcément l’objectif d’être maire. Mais j’ai tout de suite eu une pratique du mandat très locale. »
David Guiraud revendique une forme de loyauté disciplinée à LFI et, en même temps, une autonomie municipale : « Les municipales, c’est 30 000 communes. On ne peut pas avoir un seul discours pour tous. »
Il décrit ensuite la mécanique parlementaire « à petits bras » transposée à l’échelle d’une ville pauvre : « On répond à tout le monde. On traite tous les dossiers. On est deux salariés, parfois un de plus, c’est ridicule par rapport à une mairie, mais on s’y met. » À Wattrelos aussi, dit-il, mais surtout à Roubaix. Il cite des luttes, parfois gagnées, parfois perdues : des emplois francs arrachés, des fermetures administratives combattues, des commerces soutenus – « le Grand Café », glisse-t-il. Ce qui l’exalte : « Réussir à faire changer des trucs localement ». Ce qui le travaille : « Voir tout ce qu’on pourrait faire si la mairie faisait son taf ». C’est là que la question urbaine l’agrippe pour de bon. « Franchement, si les élus étaient à la hauteur, on pourrait faire énormément de choses. »
Sa critique des doctrines actuelles tient en une phrase : « On densifie et on vide les pauvres. » Le renouvellement urbain, pour lui, commence par réparer ce qui a été abandonné par les bailleurs, détruire ce qui est irrémédiable, rouvrir les espaces verts, les parkings, « rouvrir ce qui appartient aux gens ». Sa ligne : plus d’habitants, pas moins ; et surtout des logements adaptés à la vie réelle des Roubaisiens, « y compris la jeunesse non étudiante ». « On construit des logements étudiants sur les friches… et les jeunes de Roubaix, qui ne sont pas tous à la fac, ils vivent où ? »
La mixité sociale ? « Notre ville remplit une fonction politique : elle accueille. Oui, les autres villes doivent prendre leur part. » Il détaille la réalité économique : pas de « mono-employeur » massif, mais une mosaïque de services, d’activités, des logistiques qui ferment, des PME qui tiennent, des boîtes de l’immobilier au sud de la métropole. « C’est diffus. » Une jeunesse « en colère », parfois, mais « pas de grandes manifs ». « À Roubaix, les gens se débrouillent. »
La nouvelle France insoumise ?
Une question interroge quand on imagine un insoumis à la tête d’un exécutif municipal : comment vont-ils composer avec les entreprises, serrer les mains de ceux qu’ils dénoncent à longueurs de tribunes, « faire le tour des patrons » comme le font tant de maires. Il ne botte pas en touche : « Je ne serai pas là pour commander en chef de ma commune avec des patrons. Mais s’ils m’interpellent, je répondrai. La bonne gestion n’est pas un gros mot. »
Il revendique une forme de loyauté disciplinée à LFI et, en même temps, une autonomie municipale : « Les municipales, c’est 30 000 communes. On ne peut pas avoir un seul discours pour tous. » Il reconnaît des frottements, des désaccords de tempo, assume d’avoir parfois « pris la main » sur une annonce. « Ce n’est pas dictatorial. On a besoin de discipline, oui, mais aussi d’initiative. » Pourquoi LFI lui laisse-t-elle cette marge ? « Parce que je suis loyal. Je ne fais pas ça pour me pousser moi. Et parce qu’ils pensent peut-être que je peux y arriver : alors ça vaut le coup de soutenir. »
« Plus c’est local, plus c’est complexe. » Il décrit des espaces de discussion entre députés candidats, des allers-retours avec le comité électoral, la réalité triviale des lundis-mardis-mercredis à Paris où, entre deux votes, on parle de logements et d’éclairage public. Il n’idéalise pas. Il assume. On lui dit qu’on l’accusera de tout – parachutage (déjà fait), radicalité (bien sûr), incompétence gestionnaire (à démontrer). Il hausse les épaules : « On établira la vérité. » Et il reformule, une dernière fois, l’idée fixe qui traverse toute sa campagne : « Rendre Roubaix vivable pour ceux qui y vivent. Pas pour une vitrine. Pas pour demain au détriment d’aujourd’hui. »
Quand on se lève, la pluie a cessé. Il jette un dernier regard vers l’hôtel de ville. La scène s’emboîte : le local-atelier où l’on manie des maquettes comme des promesses tangibles ; la double filiation politique condensée dans un projet urbain. « On verra, dit-il, mais au moins, on fait. » Et, dans cette phrase, quelque chose de Roubaix répond.
***
Cet article est extrait du n°63 de la revue Regards, publié en octobre 2025 et toujours disponible dans notre boutique !
***
24.12.2025 à 12:40
Trump veut le pétrole vénézuélien
Texte intégral (1516 mots)
La newsletter du 24 décembre 
par Catherine Tricot
Donald Trump n’est pas en mode pause pour les fêtes. Il réactive son objectif d’annexer le Groenland et met en place un blocus naval militaire contre le Venezuela. Pour accéder aux réserves stratégiques, la guerre gronde.
« Drill baby, drill » fut le slogan de campagne de Donal Trump. Le président américain a une obsession : le pétrole. Celle pour le pétrole vénézuélien n’a rien de neuf. Il faut dire que ce pays détient la première réserve mondiale de pétrole conventionnel, près de 20%. Tandis que le Canada, autre pays convoité par Trump, se place au quatrième rang mondial.
En juin 2023, il critiquait Joe Biden : « Quand je suis parti, le Venezuela était sur le point de s’effondrer. Nous l’aurions repris, nous aurions gardé tout ce pétrole qui est juste à côté ». Les États-Unis ne digèrent pas les nationalisations opérées par Hugo Chavez en 2007. Dans un discours typiquement colonial, Trump annonce qu’il va récupérer ces ressources – étant entendu que le bien des entreprises américaines se confond avec le sien et avec celui du pays.
Le 17 décembre, il menace à nouveau : « Le Venezuela doit rendre aux États-Unis d’Amérique tout le pétrole, les terres et les autres actifs qu’ils nous ont précédemment volés… Le choc pour eux ne ressemblera à rien de ce qu’ils ont vu auparavant ». John Bolton, son ancien conseiller à la sécurité nationale, le cite et confirme : pour Trump, le Venezuela fait « vraiment partie des États-Unis » et une invasion serait « cool ».
Le contrôle du pétrole vénézuélien est l’un des axes de la stratégie de sécurité nationale américaine rendue publique le 5 décembre. Il répond à trois objectifs : assurer la sécurité énergétique des États-Unis ; provoquer un changement de régime à Caracas ; récupérer les investissements des compagnies pétrolières américaines (Chevron, Exxon Mobil, Conoco). A plusieurs reprises, Trump a déclaré avoir « des droits pétroliers » (sic) sur le Venezuela.
Cette guerre est la continuation des actions américaines contre les nationalisations de 2007. Depuis 2015, des sanctions économiques et financières, unilatérales et illégales en droit international, frappent l’économie du pays. Trump les intensifie. Une stratégie déjà employée en particulier contre Allende au Chili. Trump reprend l’expression de Nixon ordonnant à la CIA de « faire souffrir l’économie » (« make the economy scream »).
C’est ce qui se produit : le Venezuela est dans une crise sociale et financière profonde qui fait souffrir la population. Les Vénézuéliens qui fuient le pays se comptent par millions, l’hyperinflation est galopante.
Depuis cet été, l’administration Trump relate en boucle la fable de la lutte contre le narcoterrorisme et met en scène le spectacle des bateaux de trafiquants bombardés. On est désormais passé à l’étape suivante : le blocus naval militaire et la saisie de cargaisons de pétrole dans les eaux internationales… un acte de pure piraterie.
Donald Trump s’appuie aussi sur une opposition déterminée à revenir aux affaires. Pour María Corina Machado, prix Nobel de la paix 2025, « nous avons besoin d’une menace réelle, crédible et sévère pour que le régime comprenne que le coût de rester est plus élevé que celui de partir ». Intervenant le 5 novembre dernier à l’American Business Forum (un des forums les plus influent du monde capitaliste), elle livre son programme : « Nous ouvrirons les marchés. Nous offrirons une sécurité totale pour l’investissement étranger et un programme de privatisation massive et transparent vous attend […] Nous transformerons le Venezuela : d’un centre criminel des Amériques, il deviendra le hub énergétique des Amériques. »
Le Venezuela vient de porter ces menaces et actes de piraterie devant le conseil de sécurité de l’ONU. Il faut arrêter cette guerre qui vise l’annexion de richesses et la colonisation d’un pays. Trump doit être stoppé ou toute l’Amérique, Sud et Nord, est en danger imminent.
 POLÉMIQUE DU JOUR
POLÉMIQUE DU JOUR
La République survivra à « joyeux Noël »

En cette fin décembre, on a le droit à une polémique à la con. Au nom d’une vision de la laïcité absolument dérisoire, on se retrouve à débattre : ceux qui disent « joyeux Noël » et ceux qui leur opposent « joyeuses fêtes ». Comme si la neutralité de l’État ou la robustesse de la République se jouaient dans une formule de politesse. Cette fixation révèle surtout une paresse intellectuelle : on confond laïcité et police du langage, liberté de conscience et crispation identitaire. En traquant des mots inoffensifs, on s’empêche de se retrouver, de croire, de ne pas croire, et surtout de vivre ensemble sans polémique permanente. Bref, un débat parfaitement inutile, donc très médiatisé. Joyeux Noël et à l’année prochaine !
P.P.-V.
ON VOUS RECOMMANDE…
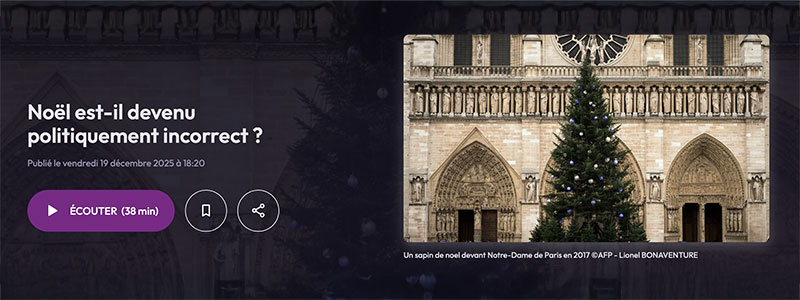
« Noël est-il devenu politiquement incorrect ? », une émission-débat sur France Culture. Marine Le Pen et les présentateurs de CNews qui souhaitent un joyeux Noël quand l’insoumis Eric Coquerel ou les présentateurs de BFMTV disent joyeuses fêtes… Tel est le débat de cette fin d’année : heureusement, les deux intervenants arrivent à prendre de la hauteur.
C’EST CADEAU 


ÇA SE PASSE SUR REGARDS.FR
Pour recevoir cette newsletter quotidiennement (et gratuitement) dans votre boîte mail, suivez le lien : regards.fr/newsletter !
24.12.2025 à 07:00
Le cercle des lecteurs disparus
Texte intégral (3792 mots)
Moins d’un Français sur deux lit plus d’un livre par an en dehors de l’école et du travail… Un chiffre en chute libre. Le livre va-t-il, un jour, devenir un objet obsolète ? Le recul de la lecture a pris de telles proportions que le phénomène affole désormais certains neuroscientifiques.
T ourner les pages d’un roman sans voir les heures filer, la tête confortablement calée sur l’oreiller. Cette image appartiendra-t-elle bientôt au passé ? Et si les livres n’étaient pas condamnés à finir au bûcher comme dans Fahrenheit 451, mais entre les mains d’une élite très restreinte, avec les conséquences décrites par Ray Bradbury dans sa dystopie qui met en scène une société lobotomisée ? Le recul de la lecture a pris de telles proportions – tous âges confondus – que le phénomène affole désormais bien au-delà des cercles réactionnaires qui tiennent des discours aux accents déclinistes. À commencer par certains neuroscientifiques et chercheurs en psychologie cognitive, qui en viennent à échafauder des hypothèses n’ayant rien à envier aux récits d’anticipation des auteurs de science-fiction. « Depuis la révolution numérique, au tournant du 21èmesiècle, le temps que le cerveau des jeunes consacre aux livres a été très nettement réduit, supplanté par le temps consacré aux réseaux sociaux et aux jeux vidéo, soit à des textes très courts, peu soignés, et à des images sur écrans, pointe Olivier Houdé, professeur de psychologie, spécialiste du développement cognitif des enfants.
Depuis l’imprimerie, le réseau neuro-culturel impliqué dans la lecture s’est renforcé, puis il s’est massivement étendu avec l’avènement des lois Ferry qui ont institué l’école obligatoire. Une évolution qui pourrait arriver à un point de bascule
L’une des conséquences probables, pour les générations à venir, est une atrophie progressive du réseau neuronal de la lecture. Il restera, certes, toujours une sorte de « kit minimal de survie », telle une boîte aux lettres du cerveau humain, évitant l’illettrisme, qui permettra de décoder des consignes, messages et textes courts. Et concernant ce kit, rien n’exclut qu’une intelligence artificielle le remplace très vite ! » C’est dire combien pour lui, l’heure est grave. Et elle l’est d’autant plus quand cette désaffection pour la lecture touche des enfants et des adolescents en plein développement, selon Michel Desmurget, chercheur en neurosciences : « Des adultes ayant grandi avec des livres qui cesseraient de lire pendant cinq ans auraient toutes les chances de réussir à s’y remettre s’ils décidaient de revenir à cette activité. Car les bases sont acquises. Pour des enfants et des adolescents, ce n’est pas la même histoire », affirme cet auteur d’un ouvrage intituléFaites-les lire ! Pour en finir avec le crétin digital. « La construction cérébrale dépend de la nature des aliments donnés au cerveau dans les périodes critiques. Plus un enfant passe de temps sur les écrans, moins la structure anatomique de son cerveau va se mettre en place. »
Un phénomène qui date et s’accentue
Contemporaine des premières statistiques sur les pratiques culturelles des Français, au milieu des années 1950, l’inquiétude ne date pas d’hier. Mais longtemps, le camp progressiste a balayé ces lamentations se moquant du « C’était mieux avant », des attaques visant d’abord la jeunesse qui ne serait plus ce qu’elle était. Au milieu des années 2010, la sociologue Sylvie Octobre clamait ainsi dans les colonnes du Monde : « Les jeunes lisent toujours, mais pas des livres ». Même son de cloche du côté du cofondateur de Mediapart, Edwy Plenel, qui s’inscrivait en faux contre ce constat d’un effondrement de la lecture, dans une interview donnée à la revue des Cahiers pédagogiques : « On dit que les jeunes lisent moins : mais ils n’arrêtent pas de lire ! » En 2023, Carine Roucan, enseignante en littérature à l’université Le Havre Normandie, tentait encore d’apaiser les craintes dans un article intitulé « Oui, les jeunes lisent encore. Mais différemment ! », paru sur le site The Conversation. Et en un sens, ils ont raison : les jeunes continuent bien de lire… mais pas des romans, exception faite de la new romance – des histoires d’amour populaires abordant des sujets actuels – qui a le vent en poupe chez les adolescentes. À part les mangas et bandes dessinées qui n’ont pas disparu des bibliothèques, surtout de textes courts sur Internet, de posts sur les réseaux sociaux, de fils WhatsApp, etc. Entendons-nous bien, ce n’est pas la lecture en général qui est en perte de vitesse, mais bien celle des livres – imprimés ou numériques.
Force est de constater que les Français lisent de moins en moins d’ouvrages, quelle que soit la classe d’âge. La soif de romans et d’essais se tarit, y compris chez les vieux. En 1988, 73% des Français de 15 ans et plus lisaient au moins un livre par an en dehors de l’école et du travail. En 2018, ils n’étaient plus que 62% et le pourcentage est même tombé à 48% aujourd’hui. À noter que la BD n’est pas épargnée par ce recul. À quoi s’ajoute la part de lecture quotidienne, qui a atteint son plus bas niveau depuis dix ans, selon la sixième édition du baromètre « Les Français et la lecture », réalisé par Ipsos pour le Centre national du livre (CNL), dont les résultats ont été rendus publics au printemps dernier. Sans oublier un renversement qui n’est pas rassurant : alors qu’il y a trente ans, les gros lecteurs étaient jeunes, aujourd’hui ils sont âgés. Bref, tous les clignotants sont au rouge. Et ça commence à se voir.
La faute aux écrans ?
En cause ? De nombreuses études incriminent un usage intensif des écrans qui empiète sur la lecture de livres. « Sur leur temps libre, les Français consacrent ainsi presque une journée par semaine aux écrans (hors études/travail) et jusqu’à plus de 35 heures chez les moins de 25 ans, soit quasiment autant de temps aux écrans chaque jour qu’à lire des livres chaque semaine », révèle ainsi l’enquête menée pour le CNL. Nul doute que les notifications permanentes capturent l’attention au détriment d’activités qui demandent de la concentration. Cerise sur le gâteau, ces moments déjà réduits à portion congrue sont aussi parasités par l’envoi de messages ou la fréquentation des réseaux sociaux qui contribuent à hacher la lecture. Ainsi, 27% des lecteurs et plus de la moitié des 15-24 ans se laissent distraire par leur smartphone alors qu’ils tournent les pages. À ce propos, Bruno Patino établit une comparaison surprenante, dans La Civilisation du poisson rouge, entre le temps d’attention de ce vertébré aquatique et celui de la génération Y, dite « digital native » : « 8 secondes, c’est le temps d’attention d’un poisson rouge : au-delà, ce dernier remet à zéro son univers mental et découvre ainsi un monde nouveau à chaque tour de bocal […] 9 seconde, c’est le temps d’attention d’un Millenial : au-delà, son cerveau décroche et il lui faut un nouveau stimulus », affirme-t-il sur la foi de calculs réalisés par les ingénieurs de Google. Et d’en conclure : « Nous sommes tous sur le chemin de l’addiction : enfants, jeunes, adultes. »
Nul doute que la surconsommation d’écrans en tout genre détourne enfants comme adultes des livres. Mais sur un plan plus philosophique, il se peut que la lecture pâtisse aussi, dans l’ombre, d’une accélération du temps inhérente à la modernité. C’est en tout cas l’hypothèse de l’historienne Mona Ozouf qui insiste, dans La Cause des livres, sur « la difficulté de se procurer, dans notre société, les biens qui [lui] sont indispensables : le silence, la solitude et même l’ennui ». Diagnostic conforté par la philosophe Myriam Revault d’Allonnes, dans Télérama, il y a plusieurs années de cela : « J’entends déplorer fréquemment que les élèves ne lisent plus, ou, plus souvent encore, qu’ils ne savent plus lire un livre du début à la fin et se satisfont de fragments, soulignait-elle alors. Mais la lecture fragmentée n’est pas liée simplement à l’existence autour de nous des écrans qui nous sollicitent en permanence. Elle s’explique plus profondément par le rapport qu’entretient l’individu contemporain avec le temps – ce qu’on appelle le « présentisme », à savoir la prégnance de l’instant, de l’immédiateté, l’appréhension du temps comme une succession de moments au détriment de la prise en compte de la durée, de l’existence du passé et de l’avenir. Cette incapacité à envisager la longue durée affecte fatalement la pratique de la lecture, qui est à la fois de l’ordre de la mémoire et du projet. » Dans son ouvrage intitulé Accélération. Une critique sociale du temps, le sociologue et philosophe allemand Hartmut Rosa relève l’existence d’un paradoxe : alors que les outils techniques promettaient de nous faire gagner du temps, nous n’avons jamais eu autant l’impression de manquer de temps.
Les jeunes continuent bien de lire… mais pas des romans. À part les mangas et bandes dessinées qui n’ont pas disparu des bibliothèques, il s’agit surtout de textes courts sur Internet, de posts sur les réseaux sociaux, de fils WhatsApp, etc. Ce n’est pas la lecture en général qui est en perte de vitesse, mais bien celle des livres – imprimés ou numériques.
Fast-food, speed-dating, haut débit… Le quotidien est pris dans une frénésie qui participe de la victoire du « format court dans tous les domaines », souligne le sociologue Bernard Lahire, auteur d’un manifeste intitulé Savoir ou périr paru à la rentrée. « Dans les années 90, le cinéma arrivait en tête des préférences des jeunes, devant la lecture, dans les enquêtes sur leurs préférences. Interrogés, ils disaient qu’en deux heures, ils avaient toute l’histoire », souligne Bernard Lahire. Cette tendance à l’accélération affecte jusqu’à l’école qui peine, du même coup, à fabriquer des lecteurs : « Depuis très longtemps, elle habitue les élèves à ne pas lire ! Les enseignants manquent de temps, on leur demande d’aller toujours plus vite, ce qui n’est pas compatible avec la lecture de textes longs. » Plus longtemps les élèves séjournent à l’école, moins ils lisent pour eux-mêmes, montraient déjà les sociologues Christian Baudelot, Marie Cartier et Christine Detrez en 1999, dans Et pourtant, ils lisent… Sauf qu’à l’époque, le décrochage avait lieu au lycée, à l’approche du bac. Aujourd’hui, la pression commence bien plus tôt. Selon Bernard Lahire, c’est toute la machine scolaire – soumise à une obsession de l’évaluation – qui tourne à l’envers : on la cadence pour terminer le programme et pouvoir noter les copies lors des examens et concours. Autrement dit, l’école ne permet plus de développer, en toute tranquillité, des apprentissages. Ce qui contribue, selon ce sociologue, à une « culture du découpage des œuvres en petits morceaux, en extraits de textes. Les semaines sont si surchargées, les programmes si denses que les élèves manquent de disponibilité pour lire des œuvres du début à la fin ».
La responsabilité de l’école
Mais le désamour pour les livres pourrait aussi être lié à une hiérarchie scolaire qui fait la part belle aux mathématiques, si l’on en croit la sociologue Sylvie Octobre, autrice de Deux pouces et des neurones. Les cultures juvéniles de l’ère médiatique à l’ère numérique. Interrogée dans Le Monde, elle invoquait il y a déjà dix ans le « glissement de notre société de ce qu’on appelait les humanités vers le technico-commercial. Auparavant, les filières les plus prestigieuses nécessitaient une pratique assidue de la lecture. Or la lecture, en tant que loisir tout du moins, n’est plus vraiment obligatoire pour devenir ingénieur. » Plutôt que des romans, expliquait-elle alors, « les 15-29 ans lisent des textos, Wikipédia, des blogs… Il y a bien des façons de lire. En réalité, on n’a jamais tant lu : des textes, des publicités, des articles, etc. ». Depuis, les faits lui ont largement donné raison.
Reste une question : faut-il voir dans cette victoire de la lecture fragmentée une véritable rupture anthropologique, ou au contraire dédramatiser la désaffection grandissante pour les bouquins, sujette à déploration depuis des décennies ? Craindre que l’explosion des non-lecteurs n’ait des conséquences désastreuses, ou se rassurer sur la capacité des livres-audio et autres supports à prendre le relais ? « Les discours d’affolement, de déclin, me laissent circonspect. Même des collègues qui étaient assez prudents se lâchent plus aujourd’hui, on a l’impression qu’un seuil a été dépassé. Pourtant, les données montrent que les gens lisent moins de livres, mais la lecture ne se réduit pas à la lecture de livres », insiste Bernard Lahire qui refuse de céder à la panique morale. D’autant que cette baisse, qui peut interpeller lorsqu’elle touche les sciences humaines et sociales, n’a pas le même impact dans toutes les disciplines, selon lui : « Dans beaucoup de domaines scientifiques, les innovations ou les révolutions viennent de ceux qui ont su s’approprier des connaissances très étendues, ce qui se traduit par une pratique intensive de la lecture dans le cas des sciences humaines et sociales avec Marx, Durkheim, Freud, etc., et sans doute aussi de la biologie si l’on pense à Darwin. C’est pourquoi je plaide, en Sciences Humaines et Sociales, pour que les étudiants lisent des livres en entier, pas des bribes et des commentaires sur ces livres », reconnaît-il. Mais, pondère-t-il, « on peut être un ingénieur formidable sans lire énormément. Le mathématicien Alexandre Grothendieck n’aimait pas du tout lire les ouvrages de ses collègues, il préférait téléphoner aux gens pour leur demander de lui résumer le propos ! »
Il n’empêche que l’organisation sociale que nous connaissons aujourd’hui et son rapport à la science se sont construits sur un savoir qui s’est sédimenté dans des textes, depuis l’invention de l’écriture. Une histoire qui a débuté en Mésopotamie et en Égypte il y a près de 6000 ans, et façonné les sociétés lettrées d’aujourd’hui. « On peut supposer que l’ensemble des mutations de la connaissance en Occident, depuis la Mésopotamie et la Grèce antique, doit être attribuée à une configuration historique très particulière. Celle-ci allie des techniques (l’écriture et la lecture) et des formes institutionnelles de transmission et d’accumulation des savoirs (l’école, la classe, la pédagogie et la culture scolaire) », analyse le chercheur Jean-Claude Ruano-Borbalan dans un article intitulé « Des sociétés orales aux sociétés scolaires », paru dans le magazine Sciences humaines. Ce lien au livre est d’ailleurs si central que l’on a pris l’habitude de « décrire […] le monde comme un texte ou un texte comme le monde », observe Alberto Manguel, essayiste canado-argentin, dans son Histoire de la lecture. Une métaphore qui traverse les sociétés juive, chrétienne et islamique, lesquelles font des livres sacrés le Verbe divin lui-même. « Pour la plupart des sociétés alphabétisées – pour l’islam, pour les sociétés juives et chrétiennes telles que la mienne, pour les anciens Mayas, pour les vastes cultures bouddhistes – la lecture se trouve au début du contrat social », insiste Alberto Manguel. De sorte que l’apprentissage de la lecture s’apparente à un rite initiatique, comme dans la société juive médiévale qui célébrait ce passage lors de la fête de Shavuot : on drapait alors le garçon qui allait être initié dans un châle de prière, puis son père le conduisait au maître qui prenait celui-ci sur ses genoux et lui montrait une ardoise où figuraient l’alphabet hébreu. Le maître lisait chaque mot à haute voix et l’enfant répétait. Ensuite on enduisait l’ardoise de miel et l’enfant la léchait, « assimilant ainsi physiquement les mots sacrés ». Il mangeait aussi des œufs durs épluchés et des gâteaux au miel sur lesquels étaient inscrits des versets bibliques, après les avoir lus à haute voix. « L’enfant qui apprend à lire est admis dans la mémoire commune par la voie des livres et découvre ainsi un passé partagé qu’il ou elle renouvelle, à un degré plus ou moins grand, à chaque lecture », résume Alberto Manguel.
Cette dimension symbolique s’est accompagnée du développement de compétences cognitives spécifiques, rappelle Olivier Houdé : « Le réseau neuronal de la lecture n’existait pas biologiquement dans le cerveau de nos lointains ancêtres avant l’invention de l’écriture et de la lecture. Ce réseau a dû se construire par recyclage neuronal et une empreinte culturelle nouvelle dans des régions cérébrales antérieurement dédiées à la vision des objets qui, elle, existait depuis la nuit des temps. De la même façon, le réseau neuronal de la lecture doit se reconstruire, se façonner, telle une empreinte éducative singulière et nouvelle, dans le cerveau de chaque enfant au cours de son développement cognitif, en particulier à l’école en CP. C’est un formidable défi, tout à la fois biologique et culturel ! », explique-t-il. De la révolution de l’imprimerie – et la relative démocratisation du livre – à la Renaissance, le réseau neuro-culturel impliqué dans la lecture s’est renforcé, puis il s’est massivement étendu avec l’avènement des lois Ferry qui ont institué l’école obligatoire. Une évolution qui pourrait arriver à un point de bascule : « La richesse et la profondeur du réseau neuro-culturel de la lecture d’antan, jusqu’aux joies inégalables que procurent la littérature et la poésie et que connaissaient encore les générations de la fin du 20ème siècle, auront probablement bientôt disparu de la population générale. Resteront quelques exceptions, comme les érudits au Moyen Âge, gamberge Olivier Houdé. Par ce scénario encore hypothétique, les circuits courts du cerveau, de l’œil au pouce, auront peu à peu colonisé, puis remplacé les circuits longs : ceux de la pensée élaborée et du raisonnement. Ces circuits courts œil-pouce tourneront alors de plus en plus rapidement, mais in fine à vide. »
Le savoir est une arme
De quoi dessiner un scénario catastrophe : si cette hypothèse scientifique se vérifie, la désaffection pour les livres pourrait affecter nos capacités à décrypter les fake news qui empoisonnent la vie démocratique et même la manière de faire société. « Depuis l’émergence du langage, l’humanité n’a rien inventé de mieux que la lecture pour structurer la pensée, organiser le développement du cerveau et civiliser notre rapport au monde ; le livre construit littéralement l’enfant dans sa triple composante intellectuelle, émotionnelle et sociale », énumère Michel Demurget dans Faites-les lire ! Pour en finir avec le crétin digital. Loin d’être un simple loisir, la lecture forge des cerveaux à même de comprendre des réalités complexes, et contribue à cimenter la société : « J’ai épluché la littérature scientifique dans tous les sens et je n’ai pas trouvé de meilleur antidote à l’abêtissement des esprits que la lecture. Elle est une véritable machine à façonner l’intelligence dans sa dimension cognitive (celle qui permet de penser, de réfléchir et de raisonner), mais aussi, plus largement, socio-émotionnelle (celle qui permet de se comprendre et de comprendre autrui, au bénéfice des relations sociales) », défend ce chercheur en neurosciences. Des travaux ont notamment permis de montrer l’influence positive du volume de lecture – surtout s’il s’agit de fiction – accumulé tout au long de la vie sur le degré d’empathie. En donnant accès à la psyché des personnages, à leurs émotions et leurs pensées, la littérature offre, en effet, la possibilité au lecteur d’éprouver une myriade de vies. Autre intérêt – et non des moindres – de la lecture approfondie : elle favorise la capacité à distinguer le vrai du faux, à écarter les fausses informations amplifiées aujourd’hui par l’intelligence artificielle et les réseaux sociaux et à développer l’esprit critique. Autant de compétences indispensables, par les temps qui courent. Pour éviter que la réalité ne rattrape la fiction, relisons donc Ray Bradbury qui prophétisait dès 1953 : « Il n’y a pas besoin de brûler des livres pour détruire une culture. Juste de faire en sorte que les gens arrêtent de les lire. »
***
Cet article est extrait du n°63 de la revue Regards, publié en octobre 2025 et toujours disponible dans notre boutique !
***
23.12.2025 à 11:48
L’affaire Epstein, miroir d’une démocratie qui pourrit de l’intérieur
Texte intégral (1625 mots)
La newsletter du 23 décembre 
Sous couvert de dénoncer les puissants, la galaxie trumpiste transforme l’affaire Epstein en mythe total, dissolvant les faits dans le soupçon permanent.
L’affaire Epstein, du nom de ce prédateur sexuel américain, suicidé en prison en 2019, revient par vagues, par fracas successifs, charriant son lot de documents, de photos, de révélations partielles et de fantasmes totaux. Ces derniers jours, des milliers de pages ont été rendues publiques par l’administration américaine qui aura fini par y consentir sous une pression devenue intenable. On y voit Jeffrey Epstein poser avec des figures du pouvoir et de la célébrité : Bill Clinton, Mick Jagger, princes, milliardaires, stars mondialisées, intellectuels. La promesse était celle de la transparence. Le résultat est tout autre : les images sont caviardées, les visages floutés, les noms parfois masqués.
C’est là que la mécanique politique déraille. Pour les militants de la galaxie complotiste influente parmi les soutiens Maga de Trump, ces rectangles noirs apposés sur les photos sont une preuve en soi. La preuve que « l’État profond » continue de protéger les puissants. La preuve que la vérité existe, mais qu’on la leur vole. Peu importe que le caviardage réponde à des impératifs juridiques élémentaires, présomption d’innocence, protection de tiers non mis en cause. Peu importe que la présence sur une photo ne constitue pas une preuve de crime. Ce qui compte, c’est l’impression persistante d’un mensonge organisé.
Car au fond, ce que cherchent les MAGA n’est pas la vérité. Ils cherchent leur vérité. Une vérité dans laquelle les élites sont nécessairement coupables, pédocriminelles, corrompues jusqu’à l’os. Chaque document devient une pièce à conviction, même lorsqu’il ne dit rien. Chaque silence, chaque flou, chaque noir devient un aveu. La réalité n’est plus ce qui est établi, mais ce qui conforte une vision du monde déjà verrouillée.
Le drame est que cette dynamique ne relève plus de la simple marginalité politique. Elle ronge le cœur même de la démocratie américaine. La défiance envers les élites s’est muée en ressentiment, puis en haine. Une haine indistincte, paranoïaque, qui ne distingue plus le pouvoir économique du champ culturel, ni les crimes avérés des soupçons fabriqués. Comme au temps des sorcières de Salem, on traque des signes qui n’en sont pas. Comme au temps du maccarthysme, on désigne des ennemis de l’intérieur, accusés de conspirer contre la nation.
L’affaire Epstein agit ici comme un révélateur brutal. Oui, il y a eu des crimes massifs. Oui, il y a eu des complicités. Oui, la justice américaine manque toujours à l’appel. Mais cette vérité-là, documentée, complexe, incomplète, les Qanons n’en veulent pas. Ils lui préfèrent une mythologie totale, où tout est lié, où tout confirme tout, où l’ennemi est partout et donc nulle part.
Le danger est grand ; il est même déjà là. Quand une société cesse de chercher le vrai pour ne plus chercher que la confirmation de ses haines, elle bascule. Non vers plus de justice, mais vers la chasse. Non vers la démocratie, mais vers le soupçon permanent. Epstein n’est plus seulement un criminel mort. Il est devenu le gouffre où une Amérique y projette ses fantasmes les plus sordides… et s’y perd.
 NAZIS DU JOUR
NAZIS DU JOUR
L’antisémitisme au coeur de la droite étasunienne

Ce week-end à Phoenix se tenait l’AmericaFest, grand rassemblement de la galaxie trumpiste MAGA. L’édition 2025 n’a pas été marquée par des discours ouvertement antisémites, mais par une fracture interne autour des théories complotistes et de la place accordée à des figures d’extrême droite radicale comme Nick Fuentes, influenceur suprémaciste et antisémite notoire. Sur scène, certains ont refusé de tracer des lignes rouges face à l’antisémitisme, au nom de l’unité du mouvement. D’autres ont dénoncé cette complaisance. Voilà où en est le débat du côté du camp républicain. Coincé entre ses ambitions et une base radicalisée, le vice-président J. D. Vance, présent pour conclure le raout, s’est situé du côté de ceux qui condamnait l’antisémitisme… mais il refuse de les mettre au ban du grand mouvement MAGA. À AmericaFest, ce n’est pas l’extrême droite antisémite qui a triomphé, mais son droit à exister au cœur du trumpisme.
L.L.C.
ON VOUS RECOMMANDE…

« La Fabrique du mensonge – Elon Musk : la conquête du pouvoir en 80 000 tweets », un documentaire de France 2. On suit la transformation de ce démocrate, écolo, technophile devenu soutien actif de Trump via son refus des syndicats puis son déni du covid. Sa méchanceté et sa mythomanie sont sans limite. Sa fortune stratosphérique (600 milliards) est désormais mise au service de son idéologie néonazie et transhumaniste. Depuis des années, il bénéficie des financements publics ; désormais, il compte sur l’appui de toute l’administration américaine. Ce documentaire donne la mesure du danger des oligarques.
C’EST CADEAU 


Macron n’a jamais autant mouillé le maillot pour nous vendre l’armée
ÇA SE PASSE SUR REGARDS.FR
Pour recevoir cette newsletter quotidiennement (et gratuitement) dans votre boîte mail, suivez le lien : regards.fr/newsletter !
23.12.2025 à 11:33
L’affaire Epstein, miroir d’une démocratie qui pourrit de l’intérieur
Texte intégral (625 mots)
Sous couvert de dénoncer les puissants, la galaxie trumpiste transforme l’affaire Epstein en mythe total, dissolvant les faits dans le soupçon permanent.
L’affaire Epstein, du nom de ce prédateur sexuel américain, suicidé en prison en 2019, revient par vagues, par fracas successifs, charriant son lot de documents, de photos, de révélations partielles et de fantasmes totaux. Ces derniers jours, des milliers de pages ont été rendues publiques par l’administration américaine qui aura fini par y consentir sous une pression devenue intenable. On y voit Jeffrey Epstein poser avec des figures du pouvoir et de la célébrité : Bill Clinton, Mick Jagger, princes, milliardaires, stars mondialisées, intellectuels. La promesse était celle de la transparence. Le résultat est tout autre : les images sont caviardées, les visages floutés, les noms parfois masqués.
C’est là que la mécanique politique déraille. Pour les militants de la galaxie complotiste influente parmi les soutiens Maga de Trump, ces rectangles noirs apposés sur les photos sont une preuve en soi. La preuve que « l’État profond » continue de protéger les puissants. La preuve que la vérité existe, mais qu’on la leur vole. Peu importe que le caviardage réponde à des impératifs juridiques élémentaires, présomption d’innocence, protection de tiers non mis en cause. Peu importe que la présence sur une photo ne constitue pas une preuve de crime. Ce qui compte, c’est l’impression persistante d’un mensonge organisé.
Car au fond, ce que cherchent les MAGA n’est pas la vérité. Ils cherchent leur vérité. Une vérité dans laquelle les élites sont nécessairement coupables, pédocriminelles, corrompues jusqu’à l’os. Chaque document devient une pièce à conviction, même lorsqu’il ne dit rien. Chaque silence, chaque flou, chaque noir devient un aveu. La réalité n’est plus ce qui est établi, mais ce qui conforte une vision du monde déjà verrouillée.
Le drame est que cette dynamique ne relève plus de la simple marginalité politique. Elle ronge le cœur même de la démocratie américaine. La défiance envers les élites s’est muée en ressentiment, puis en haine. Une haine indistincte, paranoïaque, qui ne distingue plus le pouvoir économique du champ culturel, ni les crimes avérés des soupçons fabriqués. Comme au temps des sorcières de Salem, on traque des signes qui n’en sont pas. Comme au temps du maccarthysme, on désigne des ennemis de l’intérieur, accusés de conspirer contre la nation.
L’affaire Epstein agit ici comme un révélateur brutal. Oui, il y a eu des crimes massifs. Oui, il y a eu des complicités. Oui, la justice américaine manque toujours à l’appel. Mais cette vérité-là, documentée, complexe, incomplète, les Qanons n’en veulent pas. Ils lui préfèrent une mythologie totale, où tout est lié, où tout confirme tout, où l’ennemi est partout et donc nulle part.
Le danger est grand ; il est même déjà là. Quand une société cesse de chercher le vrai pour ne plus chercher que la confirmation de ses haines, elle bascule. Non vers plus de justice, mais vers la chasse. Non vers la démocratie, mais vers le soupçon permanent. Epstein n’est plus seulement un criminel mort. Il est devenu le gouffre où une Amérique y projette ses fantasmes les plus sordides… et s’y perd.
23.12.2025 à 09:01
Sauver la République, modifier la Constitution
Lire plus (239 mots)
SOMMAIRE
- Pourquoi il faut modifier la Constitution… d’urgence !
- Benjamin Morel : « Notre Constitution a été conçue pour éviter l’effondrement de l’État, pas pour l’installation d’un pouvoir autoritaire durable »
- « Il faut modifier la Constitution pour empêcher l’avènement d’un régime autoritaire »
- Bardella est-il fake ?
- Fractures françaises : la colère monte, le RN prospère
- Marine Le Pen, la démocratie confisquée
Le budget, ce piège sans fin
- La grenade dégoupillée
- Réforme des retraites : quand la Macronie tend le piège, la gauche cherche la sortie
- La tentation du deal
Déjà disponible pour les abonnées !
Et pour les autres, ça se passe dans notre boutique
MENSUEL – décembre 25 – 4 € en version numérique
23.12.2025 à 07:00
Ugo Bernalicis : « La première des sécurités, c’est la liberté »
Texte intégral (2500 mots)
Dans le débat omniprésent de la sécurité, que dit la gauche ? Que faire des policiers, de leurs syndicats, de leurs dérives ? Quelle formation et quelles missions ? On en a causé avec le député insoumis Ugo Bernalicis.
D’un pas pressé, Ugo Bernalicis nous amène littéralement « Au Coin de la Rue », à côté de l’Assemblée, pour parler sécurité. C’est le thème de prédilection du député du Nord. Quelques jours plus tôt, lui et ses camarades parlementaires ont fait tomber le gouvernement Barnier. Entre l’excitation politique, un pad thaï et une pinte d’IPA, Ugo Bernalicis développe son programme.
Regards. Ma première question sera très ouverte et peut sembler étrange mais… c’est quoi, une politique de gauche en matière de sécurité ?
Ugo bernalicis. Une politique de gauche en matière de sécurité, c’est une politique qui vise à traiter les causes plutôt que les effets. Globalement, la gauche, dans tous les domaines, a pour objectif de s’attaquer aux causes profondes des problématiques, plutôt que de se focaliser uniquement sur leurs manifestations. Concernant les causes de la délinquance, il y a plusieurs facteurs qui entrent en jeu, notamment les inégalités sociales, la misère, le manque d’éducation, etc. Dans les déterminants du passage à l’acte, tous ces facteurs pèsent. Il existe des exceptions, bien sûr, mais les études montrent qu’il existe une corrélation claire entre le taux de chômage et le taux d’incarcération. Une politique de sécurité efficace consisterait en une politique de reconnaissance des citoyens, de bien-être, de plein-emploi, d’investissement dans les services publics – remettre des profs dans chaque classe et pas plus de 20 élèves par classe !
À droite, on dit souvent que « la première des libertés, c’est la sécurité » et on accuse la gauche de laxisme, mais on pourrait retourner cet argument en disant que « la première des sécurités, c’est la liberté ». Une autre idée serait de dire que « la première des sécurités, c’est la Sécurité sociale ». D’ailleurs, dans le bloc de constitutionnalité, la seule notion de sécurité explicitement mentionnée est celle de la Sécurité sociale. Pour le reste, on parle de « sûreté ».
Une fois qu’on a ça en tête – et il ne faut pas lâcher ce discours-là –, il faut aussi inclure des mesures préventives. Une politique de gauche ne peut se limiter à une approche purement répressive, c’est un échec absolu qui n’est plus à démontrer. Chaque type de délinquance doit recevoir une réponse appropriée. Celui qui vole parce qu’il a faim ne peut être mis dans le même panier que le crime organisé. Après, ce n’est pas parce qu’on va régler la question sociale qu’on aura tout résolu. C’est peut-être vrai à la fin de l’histoire, mais pas au début !
La gauche répond souvent « police de proximité », comme une formule magique. C’est aussi la proposition de La France insoumise. En quoi est-ce que ça consiste concrètement ?
En effet, il est important de mettre en place une police nationale de proximité. Mais pas en tant qu’un groupement à part du reste de la police. Une police de proximité n’a aucun sens si l’on maintient les brigade anti-criminalité (BAC). Cette police de proximité doit, en fait, être la base de fonctionnement de la police. La « police de proximité », c’est « la police », nationale et municipale, composée de 50 ou 60 000 policiers et, à côté, il y a des polices spécialisées qui font leur travail en fonction de leurs domaines de compétence.
On a déjà un bon exemple de ce que devrait être la police de proximité, c’est la gendarmerie nationale. Elle est, par construction, de proximité. Les gendarmes travaillent pour une caserne et vivent à quelques kilomètres de celle-ci, ils s’occupent d’un territoire à taille humaine, leurs enfants vont dans l’école du coin, ils font leurs courses dans les mêmes supermarchés que tout le monde, etc. Résultat : les gendarmes connaissent les gens et vice versa. Du coup, il y a beaucoup moins de dérives en gendarmerie.
« Ce n’est pas le job de la police de proximité d’arrêter les grands bandits ou les individus les plus dangereux, c’est celui des polices spécialisées comme la police judiciaire. Un policier n’est ni la BRI, ni le RAID. »
Faire un travail de proximité, c’est assumer que le temps de répression n’est pas la principale activité du policier. C’est un temps de présence dans l’espace public et le quotidien, de discussion avec les gens. Être là, tout simplement. Ensuite, quand il y a des problèmes, la police est là pour essayer de les résoudre. Pour ça, il faut être en lien avec les mairies, les bailleurs, être inséré dans le tissu social. Néanmoins, la police de proximité doit rester dans son rôle de répression pour les premiers niveaux d’infraction : tapage, vol à la tire, etc. Car son rôle n’est pas non plus dans la prévention et l’assistance sociale. Pour se faire, il y a deux conditions : la première est que cette police ait peu ou pas d’armes à feu. Quant à l’argument comme quoi « c’est pas votre police de proximité qui va arrêter un mec avec une kalachnikov », je réponds : oui, exactement ! Ce n’est pas le job de la police de proximité d’arrêter les grands bandits ou les individus les plus dangereux, c’est celui des polices spécialisées comme la police judiciaire. Un policier n’est ni la BRI, ni le RAID, par contre, il est la première source de renseignements des enquêteurs.
La deuxième condition pour une véritable police de proximité, c’est de libérer les policiers des deux principales actions qui nuisent à sa mission : les contrôles d’identité – censés lutter contre l’immigration illégale mais qui ne produit que racisme et bavures – et la répression contre le cannabis – qui pèse pour 20% de l’activité policière et oblige les policiers à maintenir la stratégie du harcèlement des points de deal et des consommateurs sans que le trafic ne soit impacté. Ça redonnerait un temps de travail incroyable aux policiers. Et là, tout le problème réside dans les ordres qu’on donne aux policiers.
Côté police, il faut tout réformer, du sol au plafond. Du super-pouvoir des syndicats, à Beauvau comme dans chaque commissariat, jusqu’à la façon dont on recrute et forme les policiers… Mais par où commencer ?
Demain, on arrive au pouvoir, on a 240 000 policiers et gendarmes à diriger, on leur dit quoi ? Qu’on part des besoins de la population. On oblige que les conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance – auxquels on invite aussi les gens ! – se réunissent une fois par an afin que les habitants posent des questions, expriment leurs demandes et que les policiers rendent des comptes. Il faut qu’il y ait des aller-retours entre la police et les citoyens.
Concernant les effectifs, on ne va pas virer tous les policiers en fonction au prétexte qu’ils sont sous-formés, qu’ils ont une culture néfaste et que la majorité d’entre eux votent pour l’extrême droite. Les policiers sont conditionnés à une chose : obéir, qu’importe si les syndicats essaient de tout saboter – on n’a pas besoin d’eux, le rapport de force qu’on leur donne n’est que celui qu’on veut bien leur céder – ou si un certain nombre démissionne. On a l’exemple de Pierre Joxe : on ne va pas nous faire croire que quand il arrive au ministère de l’intérieur, les policiers sont tout-gentils et qu’ils n’ont pas été travaillés depuis des années par la droite. S’il faut virer des policiers, ce ne peut être pour leurs idées, mais pour leurs actes : racistes, sexistes, etc. Le cadre permet déjà de sanctionner, pour peu qu’il y ait une volonté politique. La gauche doit assumer que la police, en tant que service public, doit être plus contrôlée que d’autres. Parce qu’elle a des prérogatives qui ne sont pas celles de n’importe quel fonctionnaire : ils ont des armes et la capacité de faire un usage légal de la force.
« On ne gagne pas une présidentielle en parlant mieux que les autres de sécurité. Mais on peut perdre si on en parle moins bien. Ce sera la même chose quand on gouvernera le pays : on ne sera pas jugé sur notre bonne gestion de la police, mais on sera sanctionné si on la gère mal. »
Ensuite vient la question du recrutement et donc de la formation. Ça commence par ouvrir des écoles de police et par rallonger la formation initiale à deux ans, dans un premier temps, puis à trois ans. Il faut assumer de ne plus recruter n’importe qui avant de les lâcher dans la nature sans même connaître les bases des droits et des libertés publiques. Mais ce qui pèse le plus dans les pratiques professionnelles aujourd’hui, ce n’est pas la formation mais le mimétisme des pairs, dont le racisme, le sexisme, les violences, etc.
Début décembre, le site d’informations Basta a publié une enquête montrant que « la France présente les chiffres les plus élevés [d’Europe, ndlr] : entre 2020 et 2022, le pays a enregistré 107 décès en garde à vue ou lors d’interventions policières ». Comment s’extirpe-t-on de cette situation ?
On a aussi les chiffres les plus élevés en prison. On n’a pas le temps de changer la culture violente de la police. Donc, dans un premier temps, on va donner des ordres : fin des contrôles d’identité – autant d’outrages en moins – et fin des gardes-à-vue pour outrage – c’est ce que font les Allemands. Les gardes-à-vue pour flagrant délit, terminé aussi ! Aujourd’hui, il y a des indicateurs de performance au ministère de l’intérieur sur le nombre de garde à vues. La politique du chiffre n’a jamais été supprimée. Avant de mettre quelqu’un en garde à vue, je suis pour que le policier prévienne le parquet et attende son avis. Ça changerait beaucoup de choses ! Je suis aussi pour que le parquet vienne dans les commissariats plus souvent et, dans l’idéal, je suis même pour qu’il y ait un procureur dans chaque commissariat pour assumer son autre mission qui est celle du contrôle de la police, de la régularité, de la légalité de son action. Enfin, s’il faut mettre du pognon dans la police, ça ne doit pas être pour acheter des LBD mais pour avoir des locaux de garde à vue qui soient corrects, dignes. En Écosse, un modèle en la matière, les cellules ressemblent à des chambres, les détenus ont un repas chaud et pour quelle conséquence ? Quasiment pas de violence en garde à vue, ni de la part des policiers ni des détenus.
Et quid du « sentiment d’insécurité » ? Selon une étude Ifop de novembre 2024, « 8 français sur 10 déclarent avoir le sentiment que la délinquance a augmenté ». Fantasme ? Que répondre à ces gens-là ?
Éteignez la télé. Ce sondage ne montre que la puissance de feu médiatique. Plus sérieusement, on a les enquêtes de victimations qui sont faites par l’Insee et le ministère de l’intérieur, les seules enquêtes dont la valeur et la viabilité permettent de construire une politique publique. C’est insuffisant et il faut recréer ce qu’Édouard Philippe a supprimé : l’Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice (qui avait été créé par Joxe). Il s’agit d’une structure scientifique, autonome, chargée d’évaluer l’action publique et de faire des propositions. Mais il faut aller encore plus loin et déployer ce modèle à l’échelle locale, par le biais des CLSPD évoqués plus avant. Ainsi, on partirait des besoins des habitants pour adapter la politique de sécurité selon les territoires. Un tel outil nous permettrait d’éviter les erreurs de Chevènement et de Jospin. Quand ils ont remis en place un peu de police de proximité, il y a eu une augmentation du nombre de plaintes. Ils ont été incapables d’expliquer le phénomène et la droite a gagné en dénonçant une augmentation de la délinquance dûe à leur politique !
Pourquoi la gauche est inaudible sur ces questions ?
La question de la sécurité est victime d’un clivage et ce n’est pas le clivage gauche-droite. C’est celui où, d’un côté, il y a les tenants d’un système – le capitalisme – et de l’autre les « irresponsables ». Il suffit d’agiter le foulard de la peur, à grands coups de reportages sur des faits divers, de dire que la police les protège et de discréditer immédiatement toute personne qui critique la police. Et ça fonctionne hyper bien électoralement, sans parler une seconde des questions sociales. On ne gagne pas une présidentielle en parlant mieux que les autres de sécurité. Mais on peut perdre si on en parle moins bien. Et je pense que ce sera la même chose quand on gouvernera le pays : on ne sera pas jugé sur notre bonne gestion de la police, mais on sera sanctionné si on la gère mal. Je crois que le fond est là, la gauche n’a rien à gagner à parler sécurité, mais elle a tout à perdre.
***
Cet article est extrait du n°62 de la revue Regards, publié en avril 2025 et toujours disponible dans notre boutique !
***
22.12.2025 à 13:14
Extrême droite : la combattre sans compter
Texte intégral (1161 mots)
Face à Marion Maréchal sur LCI, Marine Tondelier a vacillé. Pour la gauche, l’alerte se confirme.
LCI organise des grandes émissions politiques avec de possibles candidats à l’élection présidentielle. Déjà ! Marine Tondelier, désignée candidate des Ecologistes pour la primaire des gauches, était l’invitée ce vendredi de la chaîne d’infos. Elle était notamment opposée à Marion Maréchal. A écouter ce face-à-face, on peut être inquiet de la solidité de la gauche, surtout après le fiasco de Glucksmann face à Zemmour dans la même émission.
Marine Tondelier n’est pas la moins expérimentée ni la moins assurée dans les débats politiques. Mais cela n’a pas suffi. L’échec va au-delà de celui d’une personne.
Le thème proposé par Marion Maréchal, auquel Marine Tondelier avait consenti, était celui de l’immigration, de l’insécurité et de la laïcité. Chacune est venue préparée et bardée de chiffres. Marine Tondelier a tenté de corriger, rectifier et faire des mises au point sur les données mises en avant par son adversaire. Mais c’est Marion Maréchal qui a imposé les termes du débat et le cœur de son discours : les immigrés sont la cause première de l’insécurité ; ils compromettent la laïcité et l’égalité femmes-hommes, chères à notre nation.
Le problème central n’est pas que Marion Maréchal manipule la réalité, même si c’est bien sûr ce qu’elle fait. Le problème est qu’elle organise et impose un discours. Elle donne une cohérence idéologique à des données sélectionnées, exagérées ou sorties de leur contexte. Elle ne cherche pas seulement à avoir raison : elle structure son récit et le rend crédible.
On ne peut s’opposer à cette structure idéologique renforcée depuis des décennies en lui opposant d’autres chiffres. Rétablir des vérités partielles ne suffit pas à neutraliser l’efficacité d’une vision partout répétée. L’extrême droite ne gagne pas parce que ses chiffres sont exacts. Elle gagne parce qu’ils viennent confirmer une lecture du réel qui donne sens à des angoisses. Tant que cette lecture ne sera pas remplacée par une autre, elle continuera de prospérer.
Il faut prendre garde à la manière dont on répond aux logiques déployées par l’extrême droite. C’est le cas lorsque l’on répond que les immigrés délinquants ne le sont pas parce qu’ils sont immigrés mais parce qu’ils sont des pauvres. Ainsi, soutenir, comme trop souvent à gauche, qu’il y a davantage d’immigrés dans les prisons parce qu’ils sont les plus pauvres est un argument inflammable… quand bien même il ne serait pas neuf. Il est, en fait, catastrophique. Il vise sans le vouloir la masse des hommes jeunes des quartiers populaires, immigrés ou non, à la fois exclus et en révolte contre ce monde qui ne leur fait pas de place. Donc on admettrait que les pauvres étant potentiellement délinquants, il faut les contrôler, les reléguer et les réprimer ? Au lieu de s’en tenir à la logique policière de la suspicion et de la contrainte, il est plus juste d’user d’une autre logique.
Ce n’est pas en assimilant classes populaires et classes dangereuses qu’on a pu contenir la tentation désespérée du hors-la-loi et de la violence. C’est quand on cesse de reléguer, qu’on intègre, qu’on ouvre à la possibilité de progression sociale, qu’on rompt le cycle infernal de la mise à l’écart et de la violence. Désigner les immigrés comme des délinquants potentiels contribue à exacerber leur ressentiment, leur désespérance et à nourrir l’idée qu’il n’y a pas d’autre solution que l’écart à l’égard de la loi. La politique anti-immigrée n’écarte pas la violence : elle la nourrit, la légitime et ouvre la possibilité de son extension sans fin.
Face au projet d’extrême droite qu’il faut désigner comme tel, et qui se traduit en projet de tri, d’exclusion, de hiérarchisation des vies, la question pour la gauche est celui d’affirmer valeurs, principes, finalités. En l’occurrence, dire qu’il faut une politique d’accueil des migrants aujourd’hui abandonnée. Et exprimer que la gauche vise la construction d’une France, d’un monde où chacun peut prendre place et nourrir l’espoir d’une vie meilleure. C’est le fond de notre projet et de la lutte contre la criminalité.
S’en tenir à discuter et corriger les chiffres sans proposer un autre récit revient à perdre la bataille avant même qu’elle ne commence. Ce qu’il faut opposer à Marion Maréchal, ce n’est pas seulement une meilleure lecture des données, c’est un projet alternatif. Une autre explication globale de ce qui produit l’insécurité, les tensions sociales, la violence.
L’impréparation évidente de la cheffe des écologistes est aussi le symptôme que la force des punchlines ne suffit pas quand il faut combattre une extrême droite solide. On ne va pas à un débat de cette nature sans savoir précisément ce que l’on veut y défendre. Dans un débat politique, celui qui sait où il va a toujours un avantage sur celui qui improvise ses réponses en défense. Le passage sur la question du voile des petites filles était une caricature : il ne fut même pas opposé à Marion Maréchal qu’elle ne s’intéresse au sort des femmes qu’au seul sujet du voile et qu’elle défend une vision archaïque des rôles sexuels ; que la gauche entend défendre les libertés pour toutes face à leurs ennemis, fascistes de tout poils, islamistes compris et qu’elle défend une laïcité qui permet à chacun de vivre selon ses convictions.
Ce débat n’est pas un accident médiatique mais un symptôme. On ne peut affronter l’extrême droite sans un projet et une vision solide, alternative au monde qui va mal. Les chiffres ne viennent qu’éclairer cette proposition politique et les punchlines, l’ancrer dans les mémoires. Pas l’inverse.
22.12.2025 à 13:13
Extrême droite : la combattre sans compter
Texte intégral (2128 mots)
La newsletter du 22 décembre 
par Catherine Tricot
Face à Marion Maréchal sur LCI, Marine Tondelier a vacillé. Pour la gauche, l’alerte se confirme.
LCI organise des grandes émissions politiques avec de possibles candidats à l’élection présidentielle. Déjà ! Marine Tondelier, désignée candidate des Ecologistes pour la primaire des gauches, était l’invitée ce vendredi de la chaîne d’infos. Elle était notamment opposée à Marion Maréchal. A écouter ce face-à-face, on peut être inquiet de la solidité de la gauche, surtout après le fiasco de Glucksmann face à Zemmour dans la même émission.
Marine Tondelier n’est pas la moins expérimentée ni la moins assurée dans les débats politiques. Mais cela n’a pas suffi. L’échec va au-delà de celui d’une personne.
Le thème proposé par Marion Maréchal, auquel Marine Tondelier avait consenti, était celui de l’immigration, de l’insécurité et de la laïcité. Chacune est venue préparée et bardée de chiffres. Marine Tondelier a tenté de corriger, rectifier et faire des mises au point sur les données mises en avant par son adversaire. Mais c’est Marion Maréchal qui a imposé les termes du débat et le cœur de son discours : les immigrés sont la cause première de l’insécurité ; ils compromettent la laïcité et l’égalité femmes-hommes, chères à notre nation.
Le problème central n’est pas que Marion Maréchal manipule la réalité, même si c’est bien sûr ce qu’elle fait. Le problème est qu’elle organise et impose un discours. Elle donne une cohérence idéologique à des données sélectionnées, exagérées ou sorties de leur contexte. Elle ne cherche pas seulement à avoir raison : elle structure son récit et le rend crédible.
On ne peut s’opposer à cette structure idéologique renforcée depuis des décennies en lui opposant d’autres chiffres. Rétablir des vérités partielles ne suffit pas à neutraliser l’efficacité d’une vision partout répétée. L’extrême droite ne gagne pas parce que ses chiffres sont exacts. Elle gagne parce qu’ils viennent confirmer une lecture du réel qui donne sens à des angoisses. Tant que cette lecture ne sera pas remplacée par une autre, elle continuera de prospérer.
Il faut prendre garde à la manière dont on répond aux logiques déployées par l’extrême droite. C’est le cas lorsque l’on répond que les immigrés délinquants ne le sont pas parce qu’ils sont immigrés mais parce qu’ils sont des pauvres. Ainsi, soutenir, comme trop souvent à gauche, qu’il y a davantage d’immigrés dans les prisons parce qu’ils sont les plus pauvres est un argument inflammable… quand bien même il ne serait pas neuf. Il est, en fait, catastrophique. Il vise sans le vouloir la masse des hommes jeunes des quartiers populaires, immigrés ou non, à la fois exclus et en révolte contre ce monde qui ne leur fait pas de place. Donc on admettrait que les pauvres étant potentiellement délinquants, il faut les contrôler, les reléguer et les réprimer ? Au lieu de s’en tenir à la logique policière de la suspicion et de la contrainte, il est plus juste d’user d’une autre logique.
Ce n’est pas en assimilant classes populaires et classes dangereuses qu’on a pu contenir la tentation désespérée du hors-la-loi et de la violence. C’est quand on cesse de reléguer, qu’on intègre, qu’on ouvre à la possibilité de progression sociale, qu’on rompt le cycle infernal de la mise à l’écart et de la violence. Désigner les immigrés comme des délinquants potentiels contribue à exacerber leur ressentiment, leur désespérance et à nourrir l’idée qu’il n’y a pas d’autre solution que l’écart à l’égard de la loi. La politique anti-immigrée n’écarte pas la violence : elle la nourrit, la légitime et ouvre la possibilité de son extension sans fin.
Face au projet d’extrême droite qu’il faut désigner comme tel, et qui se traduit en projet de tri, d’exclusion, de hiérarchisation des vies, la question pour la gauche est celui d’affirmer valeurs, principes, finalités. En l’occurrence, dire qu’il faut une politique d’accueil des migrants aujourd’hui abandonnée. Et exprimer que la gauche vise la construction d’une France, d’un monde où chacun peut prendre place et nourrir l’espoir d’une vie meilleure. C’est le fond de notre projet et de la lutte contre la criminalité.
S’en tenir à discuter et corriger les chiffres sans proposer un autre récit revient à perdre la bataille avant même qu’elle ne commence. Ce qu’il faut opposer à Marion Maréchal, ce n’est pas seulement une meilleure lecture des données, c’est un projet alternatif. Une autre explication globale de ce qui produit l’insécurité, les tensions sociales, la violence.
L’impréparation évidente de la cheffe des écologistes est aussi le symptôme que la force des punchlines ne suffit pas quand il faut combattre une extrême droite solide. On ne va pas à un débat de cette nature sans savoir précisément ce que l’on veut y défendre. Dans un débat politique, celui qui sait où il va a toujours un avantage sur celui qui improvise ses réponses en défense. Le passage sur la question du voile des petites filles était une caricature : il ne fut même pas opposé à Marion Maréchal qu’elle ne s’intéresse au sort des femmes qu’au seul sujet du voile et qu’elle défend une vision archaïque des rôles sexuels ; que la gauche entend défendre les libertés pour toutes face à leurs ennemis, fascistes de tout poils, islamistes compris et qu’elle défend une laïcité qui permet à chacun de vivre selon ses convictions.
Ce débat n’est pas un accident médiatique mais un symptôme. On ne peut affronter l’extrême droite sans un projet et une vision solide, alternative au monde qui va mal. Les chiffres ne viennent qu’éclairer cette proposition politique et les punchlines, l’ancrer dans les mémoires. Pas l’inverse.
 APPEL DU JOUR
APPEL DU JOUR
Chère lectrice, cher lecteur…

Vous êtes des milliers à nous lire chaque jour. On est ravis et on travaille dur pour cela. A votre tour de faire, si vous le pouvez, votre effort. La newsletter est gratuite pour vous mais chère à produire. Contribuez autant que vous le pouvez. Rappelez-vous que deux tiers de votre don sera défiscalisé. Si vous donnez 30 euros, il vous en coûtera 10. Et pour nous, ce sera une aide précieuse. D’ici quelques jours, chacun va débrancher. Alors ne reportez plus. Si vous ne l’avez pas encore fait, c’est le moment, c’est ici et c’est simple : vous choisissez montant et mode de paiement.
Bon repos à tout le monde et merci !
La rédaction
ON VOUS RECOMMANDE…

100 ans d’évolution de l’habitat, sur Arte. Il y a un siècle survenait la révolution de l’architecture moderne. Elle ne fut pas seulement esthétique. Elle se produisit d’abord dans la conception des logements. Les architectes modernes rêvaient de bons logements pour tous en lieu et place des taudis étroits qui dominaient. Les Bruno Taut, Le Corbusier, Walter Gropius, Margarete Schütte-Lihotzky ou Ernst May ont imaginé des bâtiments, beaux par leur volumes, proposant des logements éclairés, avec salle de bains, chambres et séjour. C’est cette révolution que raconte ces trois épisodes de 30 minutes, centrés sur une pièce : le séjour, la cuisine, la salle de bain. Où l’on découvre l’origine des cuisines Ikea qui ont conquis le monde. Plaisant.
C’EST CADEAU 


Une réflexion pertinente d’un député catalan après la débâcle du Parti socialiste espagnol dans les élections régionales en Estrémadure. On vous en traduit deux points :
- « Ce que fait le PSOE est innommable : face à une droite bien réelle, une gauche de façade ne suffit pas »
- « L’argument selon lequel l’extrême droite serait quelque chose de nouveau ne tient plus : quand les gens n’ont pas d’avenir, ils votent pour le passé (même s’il est inventé). »
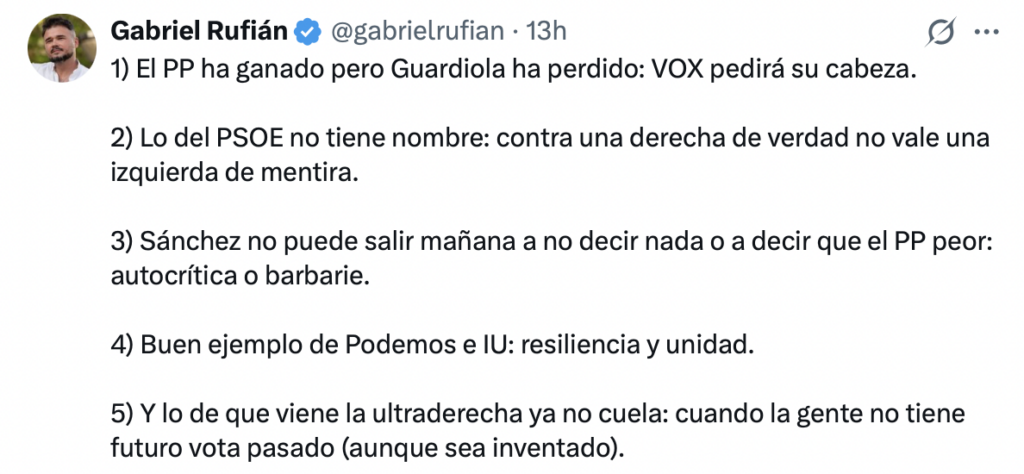
ÇA SE PASSE SUR REGARDS.FR
Pour recevoir cette newsletter quotidiennement (et gratuitement) dans votre boîte mail, suivez le lien : regards.fr/newsletter !
22.12.2025 à 07:00
Les féministes mangent-elles les hommes ?
Texte intégral (1575 mots)
Masculinité, place des hommes dans le combat féministe, peur de la vasectomie sociétale : on parle des hommes, des vrais, avec Mathieu Palain.
Mathieu Palain est écrivain et journaliste, auteur de Nos pères, nos frères, nos amis (2023, Les Arènes)
Regards. On entend souvent parler des difficultés liées à la prise de conscience masculine vis-à-vis des questions de genre. Qu’est-ce qui, selon toi, freine cette évolution ?
Mathieu Palain. Il y a un décalage énorme entre des hommes qui refusent de s’interroger parce qu’ils se sentent agressés par ce débat et des femmes qui ont fait un travail colossal de prise de conscience. Beaucoup d’hommes se disent : « Pourquoi je devrais me remettre en question ? Je n’ai rien fait de mal ». Mais ils ignorent que ce travail n’est pas lié à avoir un casier judiciaire. Il s’agit de comprendre des comportements systémiques ancrés en nous.
L’un des freins majeurs est le sentiment d’attaque ressenti par certains hommes face aux revendications féministes. Beaucoup perçoivent cette remise en question comme une accusation généralisée, alors qu’il s’agit simplement de reconnaître un problème structurel. De plus, les normes patriarcales sont profondément enracinées dans l’éducation et la culture, ce qui rend difficile leur remise en cause.
Il faut aussi ajouter que la masculinité traditionnelle repose sur des valeurs profondément ancrées dans nos sociétés, comme la force, l’autorité et le contrôle. Remettre en question ces valeurs revient pour certains à remettre en cause leur propre identité. C’est pourquoi tant d’hommes résistent à ces évolutions. Pourtant, des études montrent que des sociétés plus égalitaires bénéficient à tous, y compris aux hommes, en réduisant les attentes oppressives liées aux rôles genrés.
Un autre élément important, c’est l’influence des réseaux sociaux et des discours réactionnaires qui se développent en réponse aux avancées du féminisme. On observe aujourd’hui des figures publiques et des influenceurs qui prônent une vision ultra-traditionnelle de la masculinité, allant jusqu’à promouvoir des comportements toxiques sous couvert de « virilité » retrouvée. Ces discours trouvent un écho chez de nombreux jeunes hommes en quête de repères et qui se sentent déstabilisés par les changements en cours.
Mais il y a aussi un vrai phénomène de rejet, non seulement des féministes, mais aussi de la remise en question de certains privilèges masculins. Beaucoup d’hommes ont grandi avec l’idée que leur place dans la société était naturelle et lorsqu’on leur dit que cette place est en réalité construite sur des inégalités, il y a un réflexe de défense. Certains se sentent attaqués dans leur identité et leur valeur, alors que le but du féminisme n’est pas d’accuser individuellement les hommes, mais bien de repenser des structures qui créent des déséquilibres.
Mais est-ce que tu vois cette déconstruction se mettre en place concrètement ?
Oui, je la vois. Je vois des hommes de mon âge qui prennent conscience de la différence avec leurs pères. Beaucoup réalisent qu’ils ne peuvent pas reproduire ce modèle car leur partenaire ne l’accepterait pas. Mais je vois aussi des jeunes garçons dans les collèges qui adoptent parfois des discours de masculinisme extrême. Face à eux, il y a des jeunes filles très politisées, prêtes à les confronter. Ce fossé entre les deux sexes est flagrant, mais il prouve que la conscience évolue, même si cela reste conflictuel.
J’observe également de plus en plus d’hommes qui prennent la parole pour dénoncer des comportements sexistes ou partager leurs propres remises en question. Il y a encore du chemin à parcourir, mais les discussions se multiplient, notamment dans les médias et sur les réseaux sociaux. Il est essentiel de continuer ces conversations, sans jugement, pour encourager davantage d’hommes à s’interroger sur leurs comportements.
Par ailleurs, de plus en plus d’entreprises mettent en place des formations sur l’égalité homme-femme et le respect en milieu professionnel. Ce sont des petites avancées qui permettent de sensibiliser davantage d’hommes à ces problématiques. Ces formations, lorsqu’elles sont bien construites et participatives, peuvent être des outils très efficaces pour lutter contre les stéréotypes de genre et instaurer des relations professionnelles plus équilibrées.
« La masculinité traditionnelle repose sur des valeurs profondément ancrées dans nos sociétés, comme la force, l’autorité et le contrôle. Remettre en question ces valeurs revient pour certains à remettre en cause leur propre identité. C’est pourquoi tant d’hommes résistent à ces évolutions. »
On voit aussi des transformations dans le domaine de la parentalité. De plus en plus de pères revendiquent un rôle plus actif dans l’éducation de leurs enfants, remettant en cause l’idée selon laquelle l’homme devrait avant tout être un pourvoyeur économique. Ces évolutions montrent que la masculinité est en train de se redéfinir.
Mais cette redéfinition ne se fait pas sans heurts. Certaines résistances sont particulièrement visibles dans les sphères conservatrices, où le modèle du « chef de famille » reste prédominant. Dans ces milieux, tout changement est perçu comme une menace et non comme une opportunité de progresser vers plus d’égalité.
Ce décalage entre les jeunes filles politisées et les garçons peut-il réellement être comblé ?
Je pense que oui, mais cela prendra du temps. Le problème vient du conditionnement très précoce. On élève les filles et les garçons différemment, ce qui se traduit par cette séparation à l’adolescence. Pourtant, il y a des signes positifs : les jeunes générations sont baignées dans un discours féministe et de consentement bien plus que nous à l’époque. Cela donne de l’espoir. Il faut un véritable effort collectif pour changer les mentalités et ne pas laisser ces écarts se creuser davantage.
L’éducation joue un rôle central dans cette transformation. Il faudrait intégrer dès le plus jeune âge des cours sur l’égalité, le consentement et la gestion des émotions. De nombreux programmes scolaires commencent à inclure ces thématiques, mais ils restent minoritaires. Si l’on veut vraiment réduire cet écart, il faut que l’ensemble de la société s’engage dans cette direction.
L’accès à des modèles masculins plus diversifiés dans les médias et la culture populaire peut aussi jouer un rôle clé. Voir des hommes qui s’expriment librement sur leurs émotions ou qui adoptent des attitudes plus égalitaires dans des films ou des séries pourrait aider à transformer les représentations collectives. Il faudrait également que les parents jouent un rôle actif en encourageant leurs enfants, garçons comme filles, à remettre en question les normes de genre et à développer des comportements égalitaires.
« On devrait enseigner aux jeunes garçons qu’ils ont le droit d’exprimer leurs sentiments, d’être vulnérables sans que cela ne soit perçu comme une faiblesse. »
Il y a aussi la question de la charge mentale qui reste largement inégalement répartie dans de nombreux foyers. Tant que cette charge sera considérée comme une « affaire de femmes », la déconstruction de la masculinité restera incomplète. Les hommes doivent comprendre qu’un rôle actif dans la gestion du foyer n’est pas un « coup de main », mais bien une responsabilité partagée.
Selon toi, qu’est-ce qui définit un homme aujourd’hui ?
Ce n’est plus être fort ou dominateur. Un homme, pour moi, c’est quelqu’un qui assume ses responsabilités et ses émotions. Beaucoup d’hommes n’ont pas été éduqués pour cela. Par exemple, aller voir un psy est encore perçu comme une faiblesse. C’est ce qui doit changer : accepter qu’avoir des émotions ne fait pas de nous des êtres faibles. On devrait enseigner aux jeunes garçons qu’ils ont le droit d’exprimer leurs sentiments, d’être vulnérables sans que cela ne soit perçu comme une faiblesse.
Un homme, c’est aussi quelqu’un qui écoute, qui respecte et qui n’a pas peur de remettre en question ses certitudes. C’est une définition plus ouverte, qui permet à chacun de se sentir libre d’être soi, sans les carcans imposés par la société.
***
Cet article est extrait du n°62 de la revue Regards, publié en avril 2025 et toujours disponible dans notre boutique !
***
- GÉNÉRALISTES
- Ballast
- Fakir
- Interstices
- Issues
- Korii
- Lava
- La revue des médias
- Time [Fr]
- Mouais
- Multitudes
- Positivr
- Regards
- Slate
- Smolny
- Socialter
- UPMagazine
- Le Zéphyr
- Idées ‧ Politique ‧ A à F
- Accattone
- À Contretemps
- Alter-éditions
- Contre-Attaque
- Contretemps
- CQFD
- Comptoir (Le)
- Déferlante (La)
- Esprit
- Frustration
- Idées ‧ Politique ‧ i à z
- L'Intimiste
- Jef Klak
- Lignes de Crêtes
- NonFiction
- Nouveaux Cahiers du Socialisme
- Période
- ARTS
- L'Autre Quotidien
- Villa Albertine
- THINK-TANKS
- Fondation Copernic
- Institut La Boétie
- Institut Rousseau
- TECH
- Dans les algorithmes
- Framablog
- Gigawatts.fr
- Goodtech.info
- Quadrature du Net
- INTERNATIONAL
- Alencontre
- Alterinfos
- AlterQuebec
- CETRI
- ESSF
- Inprecor
- Journal des Alternatives
- Guitinews
- MULTILINGUES
- Kedistan
- Quatrième Internationale
- Viewpoint Magazine
- +972 mag
- PODCASTS
- Arrêt sur Images
- Le Diplo
- LSD
- Thinkerview
