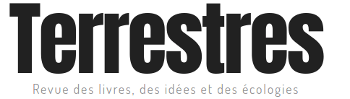12.09.2025 à 15:30
Élisée Reclus, l’Anthropocène avant l’heure
Dès 1860, alors que le carbone n’a pas encore envahi l’atmosphère et que le plastique n’existe pas, le géographe et militant anarchiste Élisée Reclus décrit les humains comme des agents géologiques qui modifient le climat. Tout au long de son œuvre monumentale, il parvient à rendre le monde plus familier tout en déployant l’idée d’une condition terrestre.
L’article Élisée Reclus, l’Anthropocène avant l’heure est apparu en premier sur Terrestres.
Texte intégral (4358 mots)
Ce texte est un extrait du livre « Élisée Reclus & la solidarité terrestre », de Roméo Bondon, qui vient de paraître dans la collection « Précurseurs de la décroissance » des éditions du Passager clandestin.
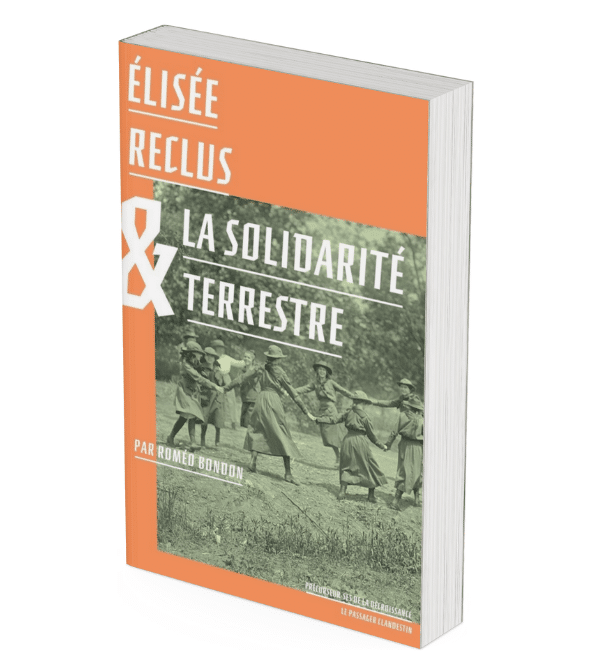
Interagir avec la Terre
Au moment de saluer son ami et camarade, mort quelques jours plus tôt, Pierre Kropotkine a ces mots pénétrants : c’était « l’un de ceux qui avaient le mieux senti et vécu la liaison qui rattache l’homme à la Terre entière, ainsi qu’au coin du globe où il lutte et jouit de la vie1 ». Tout est dit. Des premiers articles publiés dans la Revue des Deux Mondes jusqu’à L’Homme et la Terre, en passant par La Terre et les dix-neuf volumes de la Nouvelle géographie universelle, Élisée Reclus n’aura de cesse de répéter, préciser, démontrer que les actions humaines sur la planète ne sont pas sans effets et, dès lors, qu’elles impliquent des responsabilités2.
Dans un article publié en 1864 à propos de Man and Nature, un ouvrage du diplomate américain et tenant de la préservation de la nature George Perkins Marsh3, Reclus note que les humains, « devenus, par la force de l’association, de véritables agents géologiques, […] ont transformé de diverses manières la surface des continents, changé l’économie des eaux courantes, modifié les climats eux-mêmes4 ». Inaugurant une conception dialectique du progrès n’allant jamais sans sa part de « régrès » qu’il conservera jusque dans ses derniers textes5, il détaille à partir de plusieurs exemples la diversité des modalités que recoupe l’action humaine sur la nature. « D’un côté elle détruit, de l’autre elle détériore » suivant l’état social et les progrès de chaque peuple, elle contribue tantôt à dégrader la nature, tantôt à l’embellir6 ». Et d’ajouter que, devenue « conscience de la terre », l’humanité se civilise à mesure qu’elle comprend que « son intérêt propre se confond avec l’intérêt de tous et celui de la nature elle-même7 ».
Difficile de ne pas penser à la notion désormais bien connue d’anthropocène pour décrire cette ère dans laquelle nous serions désormais entrés :
Sans qu’il soit nécessaire d’admettre un changement d’axe et la variation des latitudes terrestres, on peut affirmer que l’époque actuelle, comme les époques antérieures, offre aussi, dans ses climats, toute une série de changements successifs, et déjà l’histoire nous prouve que, dans ces modifications si importantes du régime de notre globe, les travaux de l’humanité entrent pour une très large part8.
Évidemment, il ne s’agit pas pour Reclus de trouver le « clou d’or » datant précisément le début de cette nouvelle période géologique. Le carbone contenu dans l’atmosphère commence tout juste à augmenter sous les coups d’une industrialisation féroce, tandis que le plastique, qui est la marque de notre temps, n’est pas encore connu. Néanmoins, sa conscience des effets planétaires produits par des modifications localisées qui s’ajoutent les unes aux autres a de quoi nous interpeller.
Pour aller plus loin, vous pouvez lire aussi dans Terrestres « Enquêter, s’émerveiller et se révolter avec Élisée Reclus » de Roméo Bondon, septembre 2023.
Miroir de cette conception originale, Reclus n’hésite pas à conférer aux éléments ou à des milieux naturels une personnalité, voire une capacité d’action. Ainsi, sous sa plume, les montagnes sont « des êtres doués de vie9 » qui se révèlent composés d’« individus géographiques modifiant de mille manières les climats et tous les phénomènes vitaux des régions environnantes par le seul fait de leur position au milieu des plaines10 ». Dès lors, c’est bel et bien « l’action combinée de la Nature et de l’Homme lui-même, réagissant sur la Terre qui l’a formé11 », qu’il s’agit de décrire sur toutes les parties du monde et dans le moindre des phénomènes observés.

Rendre le monde plus familier
Les deux Histoires, d’un ruisseau et d’une montagne, publiées respectivement en 1869 et en 1880, sont peut-être ses textes qui illustrent le mieux cette démarche. Ils font ainsi écho à sa conviction selon laquelle « la science doit être une chose vivante12 ». Les deux récits paraissent aux éditions Hetzel, qui publient également Jules Verne, dans une collection intitulée « Bibliothèque d’éducation et de récréation », ce qui donne une bonne indication de la teneur des ouvrages : deux promenades informées, l’une au sein d’un bassin hydrographique, de la source à l’océan, l’autre dans un massif montagneux, auprès des animaux et des humains qui le peuplent. Au moment où il commence à travailler sur ce second opus, Élisée confie son intention à son éditeur, mais aussi ses doutes : « Mon livre est à la fois science et poésie, mais il vaudrait mieux qu’il fût l’un ou l’autre ; je crains bien que le genre lui-même ne soit faux13. » C’est pourtant bien ce mélange qui a assuré aux deux Histoires une postérité que n’ont pas démentie les plus récentes rééditions, ce à quoi il faut ajouter un engagement de l’auteur dans son texte, n’hésitant pas à mobiliser son expérience, à convoquer les sens des lecteurs et des lectrices, à conclure, comme toujours, sur un horizon émancipateur, celui d’une fraternité universelle14.
Aussi, quelle que soit l’échelle à laquelle il se situe et qu’importe le pas de temps considéré, Élisée Reclus tente de saisir les phénomènes terrestres avec une certaine familiarité. En cela, les évolutions de l’époque en matière de transport l’y ont sans doute aidé. Comme il l’écrit en ouverture d’un article publié en 1866,
[Il] se manifeste depuis quelque temps une véritable ferveur dans les sentiments d’amour qui rattachent les hommes d’art et de science à la nature. Les voyageurs se répandent en essaims dans toutes les contrées d’un accès facile, remarquables par la beauté de leurs sites ou le charme de leur climat9.
Le monde, nous dit Reclus, subit une forme d’amoindrissement à mesure que les voies de communication se multiplient. Son usage n’en est devenu que plus accessible et son usure, diraient aujourd’hui certains critiques du tourisme, que plus rapide15.
Dans le dernier tome de la Nouvelle géographie universelle, Élisée adopte un regard rétrospectif sur les évolutions dont il a été le contemporain durant les vingt années qu’ont nécessitées la fabrication et la publication exhaustive de son grand-œuvre : « Partout, le réseau des voyages couvre la planète comme un filet aux mailles rétrécies. […] Chaque année, se raccourcit la durée du tour du monde, devenu maintenant pour quelques blasés une fantaisie banale16. »

Sa longue et continue pratique de la Terre l’a évidemment rendu sensible aux façons de la représenter17. Il fait un usage abondant de la cartographie et a pu s’appuyer pour cela sur les compétences de l’anarchiste suisse Charles Perron18. Ensemble, ils développent des cartes non seulement de localisation, mais également économiques, statistiques et géopolitiques, ce qui constitue une véritable nouveauté pour l’époque.
Mais ça n’est pas tout. La tentative la plus originale, sans doute, pour « dépouiller l’État du monopole de la production des images du monde19 » a été le projet de construction de globe terrestre pour l’Exposition universelle de 1900, qui s’est tenue à Paris. Son but, alors : « Faire entrer la géographie dans la cité20. » Il partage des préoccupations pédagogiques avec l’ensemble du milieu anarchiste, ainsi qu’avec l’urbaniste écossais Patrick Geddes, qui travaille avec le neveu d’Élisée, Paul Reclus, ce « constructeur de globes, de reliefs et de dispositifs de représentation du monde les plus divers21 », à produire une représentation à échelle réduite de la surface terrestre de l’Écosse.
La planète, cette « grande patrie », est donc pour Élisée un lieu familier, aussi bien parce qu’il en connaît de nombreuses régions que parce qu’il tente, à défaut, par l’imagination et la connaissance, de se situer parmi les sociétés qu’il évoque, pleinement imprégné par les paysages qu’il décrit, en se plaçant « du point de vue de la solidarité humaine22 ».
Enfin, la description de la Terre, cet « ensemble merveilleux de rythme et de beauté23 », ne serait pas complète sans accorder une place de choix aux autres animaux – en un mot, à tout ce qui vit. Cette inclusion, assez banale pour les végétaux à une époque où la géographie botanique prend son essor, l’est beaucoup moins pour la faune, sauvage et domestique, qui est abordée dans chaque tome de la Nouvelle géographie universelle et devient un thème et une préoccupation à part dans les derniers textes d’Élisée Reclus. La mention de tel ou tel animal se double à la fin de sa vie d’une valorisation de la coopération interspécifique, notamment dans « La grande famille24 », ou de prises de position éthiques, comme dans « À propos du végétarisme25 ».
À écouter, un épisode des Sons Terrestres : « Histoire d’un ruisseau, d’Élisée Reclus », des extraits lus par la compagnie Le rouge et le vert, 2021.
Image d’ouverture : Photographie Jean Reutlinger, vers 1907-1914, Wikimedia.

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !
Depuis 2018, Terrestres est la revue de référence des écologies radicales.
À travers des essais, enquêtes, traductions inédites et récits de résistances, nous explorons les nouvelles pensées et pratiques nécessaires pour répondre à la catastrophe écologique.
Chaque semaine, nous publions en accès libre des articles qui approfondissent les enjeux écologiques, politiques, et sociaux, tout en critiquant l’emprise du capitalisme sur le vivant. Plus qu’une revue, Terrestres est un laboratoire d’idées et un lieu de réflexions critiques, essentielles à l’élaboration d’alternatives justes et émancipatrices.
En nous lisant, en partageant nos articles et en nous soutenant, par vos dons si vous le pouvez, vous prenez le parti de l’écologie radicale dans la bataille culturelle qui fait rage.
Merci  !
!
Notes
- Pierre Kropotkine, « Élisée Reclus », Les Temps nouveaux, 15 juillet 1905.
- C’est ce dont témoigne, entre autres textes, ceux réunis dans Libre nature (op. cit.), une anthologie à laquelle le livre « Élisée Reclus et la solidarité terrestre » doit beaucoup.
- Philippe Pelletier, « Élisée Reclus et George Perkins Marsh, convergence et rupture », Annales de géographie, vol. 732, no 2, 2020, p. 104-127.
- « De l’action humaine sur la géographie physique », Revue des Deux Mondes, vol. 54, 1864, repris dans Libre nature, op. cit., p. 49. Voir, dans la partie « Textes choisis », l’extrait 3 de « La libre nature ».
- Voir, dans la partie « Textes choisis », les extraits de « Cause animale et progrès social ».
- « De l’action humaine sur la géographie physique », art. cit., p. 50.
- Ibid.
- La Terre. Description des phénomènes de la vie du globe, t. II, Hachette, 1868-1869, p. 502.
- Du sentiment de la nature…, op. cit.
- La Terre, t. I, op. cit., p. 157.
- « Préface », dans L’Homme et la Terre, t. I, Librairie universelle, 1905-1908, p. II.
- « Lettre à M. de Gerandol », 11 janvier 1877, dans Correspondance, t. II, op. cit., p. 182.
- « Lettre à P.-J. Hetzel », 26 juin 1872, citée dans Federico Ferretti, Élisée Reclus. Pour une géographie nouvelle, éditions du CTHS, 2014, p. 90.
- Benoît Bodlet, Les histoires d’Élisée Reclus. Divulgation scientifique et émancipation, Presses universitaires de Lyon, 2024.
- Rodolphe Christin, L’usure du monde. Critique de la déraison touristique, L’échappée, 2014.
- « Dernier mot », dans Nouvelle géographie universelle. Tome XIX. L’Amérique du Sud : l’Amazonie et la Plata, Hachette, 1894, repris dans Libre nature, Héros-Limite, 2022, p. 137.
- Écrits cartographiques, Héros-Limite, 2016.
- Federico Ferretti, « Charles Perron et la juste représentation du monde », visionscarto.net, 5 février 2010.
- Federico Ferretti, « Globes, savoir situé et éducation à la beauté : Patrick Geddes géographe et sa relation avec les Reclus », Annales de géographie, vol. 706, no 6, 2015, p. 687.
- Soizic Alavoine-Muller, « Un globe terrestre pour l’Exposition universelle de 1900. L’utopie géographique d’Élisée Reclus », L’Espace géographique, vol. 32, no 2, 2003, p. 156-170.
- Federico Ferretti, « Globes, savoir situé et éducation à la beauté », art. cit., p. 686.
- « Dernier mot », op. cit., p. 137.
- Ibid., p. 139.
- Voir l’extrait 2 de « Cause animale et progrès social » dans la partie « Textes choisis » du livre « Élisée Reclus & la solidarité terrestre ».
- Voir l’extrait 1 de « Cause animale et progrès social » dans la partie « Textes choisis » du livre « Élisée Reclus & la solidarité terrestre ».
L’article Élisée Reclus, l’Anthropocène avant l’heure est apparu en premier sur Terrestres.
03.09.2025 à 11:58
Pour une écologie de la libération : antiracisme et écologie politique
Alors que la possibilité du fascisme prend corps à grande vitesse, il ne s’agit plus de convaincre, mais d’organiser le camp de l’émancipation, observe Fatima Ouassak dans ce texte incisif, qui ouvre le livre collectif « Terres et liberté ». Elle appelle à assumer la radicalité et à construire un front commun écologiste et antiraciste : l’écologie de la libération.
L’article Pour une écologie de la libération : antiracisme et écologie politique est apparu en premier sur Terrestres.
Texte intégral (4563 mots)
Ce texte est l’introduction par Fatima Ouassak du livre collectif qu’elle a coordonné : Terres et Liberté. Manifeste antiraciste pour une écologie de la libération, paru en mai 2025 aux éditions Les Liens qui Libèrent. L’ouvrage est la première parution de la collection « Écologies de la libération », que dirige Fatima Ouassak.
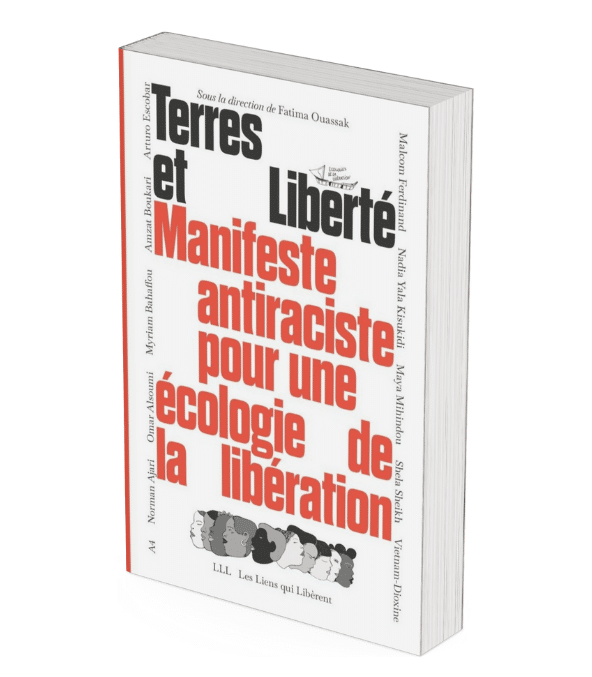
« Chaque génération doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission, la remplir, ou la trahir. »
Frantz Fanon, Les Damnés de la terre, 1961
Nous vivons à l’aube d’un basculement historique en Occident. Mille bruits de fond le laissent entendre : l’idée même de changement structurel — vers plus de justice — rendu nécessaire par l’urgence climatique est abandonnée par les grandes puissances mondiales, et le fascisme allié au néolibéralisme gagne partout du terrain. L’horizon s’obscurcit d’une possible gestion fasciste de l’urgence climatique : plus question de partager l’eau, l’air, la terre, la possibilité de vivre bien, de vivre tout court, avec celleux décrété·es indignes d’appartenir à l’humanité. Cette possibilité du fascisme prend corps — l’air de rien — très vite.
Dans le même temps — pour partie en réaction — grandit dans le camp de l’émancipation une exigence radicale de justice : la domination des un·es sur les autres n’est plus supportable. Cette exigence est le fruit d’une prise de conscience collective : celle de militant·es, d’intellectuel·les, de syndicalistes, de paysan·nes, d’avocat·tes, d’artistes, d’éditeur·ices, de journalistes engagé·es qui partagent l’ambition de construire un front commun contre ce qui ravage le monde.
En France, ce souffle radical pointe son nez aux portes de l’écologie politique. Le terrain est favorable : depuis une dizaine d’années se tisse un début d’alliance entre luttes écologistes et antiracistes, et on voit arriver une production théorique d’une écologie décoloniale. Un travail qui s’est ancré dans des luttes locales pour les soutenir et s’en inspirer, et qui a mené, en 2020, à un mot d’ordre partagé entre écologistes et antiracistes : « On veut respirer ! ».
La question est stratégique. La lutte continue, nous sommes d’accord. Mais avec qui ? Pour quoi faire ? S’agit-il de monter en radicalité dans une course contre la montre face au grand capital acoquiné avec l’extrême droite et d’adopter une stratégie révolutionnaire ? S’agit-il au contraire d’arrondir les angles pour freiner le train qui risque de tous·tes nous précipiter dans le ravin et de se ranger derrière une stratégie de repli ? Foncer et faire feu de tout bois ? Ou se terrer et se protéger des vents mauvais ? Nous considérons ici qu’il faut en écologie, comme en tout, résister corps et âme au fascisme. Face aux possibles basculements mortifères, nous n’avons plus le temps de prendre des pincettes en faisant le dos rond.
Va donc pour la course contre la montre et le feu
Partant de là, remplir notre mission, c’est assumer notre radicalité, la revendiquer. Cela risque de provoquer des controverses ? Tant mieux, vive la controverse ! Cela risque de cliver ? Encore heureux : il ne s’agit pas de convaincre les partisan·nes de la suprématie blanche de rejoindre le camp de l’émancipation. Il s’agit d’organiser le camp de l’émancipation, où nous sommes suffisamment nombreux·ses, et de construire des maquis — physiques, intellectuels et culturels. Remplir notre mission, c’est, malgré les critiques que nous pouvons lui adresser, ne pas rompre avec le champ de l’écologie. Le rapport critique à l’écologie ne doit pas viser à nous en débarrasser, mais au contraire à nous l’approprier. Répondre à notre mission, c’est aussi, dans un contexte d’extrême-droitisation des champs politique et médiatique, refuser de mettre la question raciale sous le tapis. Alors que l’antiracisme est diabolisé et que la défense de la liberté de circuler est taxée de haute trahison, du courage, il en faut. Mais personne n’a dit que notre mission était facile.
Depuis, nous sommes nombreux·ses à avoir découvert la mission de notre génération : travailler à un projet écologiste où l’égale dignité humaine est à la fois le centre et l’horizon. Reste à savoir si nous nous apprêtons à la remplir ou à la trahir. Voilà très précisément où nous en sommes aujourd’hui.
Il s’agit d’analyser précisément la singularité coloniale, islamophobe et anti-migrant·es du fascisme qui se répand aujourd’hui en Europe. Et comprendre que tout se tient : ce qui ravage la Terre ravage les populations non blanches, ce qui ravage les populations non blanches ravage la Terre.
Terres et Liberté est le premier point de ralliement que nous proposons, entre écologie et antiracisme. À l’heure où, en France, la terre se soulève aussi bien pour empêcher l’accaparement de l’eau au profit de quelques-un·es que pour dénoncer le meurtre d’un adolescent tué par la police, à l’heure où ce qui agite en silence les populations non blanches concerne l’enterrement des parents, quelle est la terre où reposer en paix ? Ici ou là-bas ? C’est une question derrière laquelle se cachent mille autres. Quelle est la terre où se reposer et vivre en paix ? Celle où faire grandir ses enfants ? Ces questionnements sont à la fois singuliers et universels. La terre ne concerne pas seulement les conditions de subsistance. Elle est aussi affaire de dignité car la libération de la terre est une condition à l’émancipation de celleux qui l’habitent.
C’est précisément cet enjeu que nous cherchons ici à explorer. Terres au pluriel car toutes ne se valent pas : elles sont souvent traitées comme le sont leurs habitant·es. Et Liberté au singulier pour rappeler que personne n’est libre si tout le monde ne l’est pas. Premier ouvrage de la collection « Écologies de la libération », Terres et Liberté vise à introduire les principaux enjeux, sujets de débat, champs d’action et luttes menées, dans une perspective croisée écologiste et antiraciste.
Une conviction nous anime : si nous y travaillons sérieusement, l’antiracisme peut devenir le nouveau souffle de l’écologie politique, et l’enrichir de joies militantes, de savoirs académiques, d’espérance, et d’une histoire pleine de détermination à vivre libres.
Terres au pluriel car toutes ne se valent pas : elles sont souvent traitées comme le sont leurs habitant·es. Et Liberté au singulier pour rappeler que personne n’est libre si tout le monde ne l’est pas.
Le maquis où il est désormais possible de verser dans un pot commun les héritages antiracistes et les héritages écologistes, c’est l’écologie de la libération. La pensée de Frantz Fanon, celle de Maria Lugones, la vision politique d’Abdelkrim El Khattabi, celle de Thomas Sankara, la libération de l’Algérie malgré cent trente-deux ans de destruction, la lutte pour protéger la terre guyanaise, la résistance en Kanaky, la résilience en Palestine… forment ce maquis où l’on peut résister pour contrer « l’écologie des frontières » mobilisée par les dirigeant·es d’extrême droite. Et où renouveler nos imaginaires, préciser nos horizons idéologiques, dans le détail. Qu’entendons-nous exactement par « racisme environnemental », « écocide », « extractivisme », « effondrement » et « fin du monde », « habiter colonial », « réparation », « justice climatique », « éthique du soin », « rhizome », « libération animale », « ancrage territorial »… ? Autant de définitions nécessaires pour déployer des outils d’émancipation.
L’écologie de la libération, c’est notre réponse à l’urgence que constituent les conséquences du dérèglement climatique et la montée en puissance des fascismes alliés au néolibéralisme en France et en Europe. C’est l’ensemble des grilles d’analyse, projets politiques et mouvements sociaux qui visent à libérer les animaux humains et non humains d’un système d’exploitation et de domination : les grilles d’analyse permettent de comprendre les ravages écologiques sur les êtres et les terres produits par la combinaison de systèmes d’oppression patriarcale, capitaliste et coloniale ; les projets politiques ouvrent des horizons écologistes à la fois anticapitalistes et anticolonialistes ; les mouvements sociaux se composent de collectifs d’habitant·es, d’associations culturelles, de tiers-lieux, d’entreprises, de syndicats, qui luttent contre le système responsable du dérèglement climatique et ses conséquences, avec au centre, les enjeux d’égale dignité humaine. Tout notre travail ici consiste à donner de la voix et du coffre à cette écologie de la libération. Se saisir des impensés et des angles morts de l’écologie politique — suprématie blanche et occidentale, rapports de domination coloniale et racisme environnemental entre autres — pour développer de nouveaux outils critiques. Une manière d’ouvrir un véritable espace antiraciste, et de participer ainsi aux ruptures et au renouvellement nécessaires dans l’écologie, en France et en Europe. La mission de notre génération est de travailler à un front commun écologiste, radicalement antiraciste. Travaillons-y vite, partout, nombreux·ses.
Image d’accueil : « Bush Babies » de Njideka Akunyili Crosby, 2017. Wikiart.

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !
Depuis 2018, Terrestres est la revue de référence des écologies radicales.
À travers des essais, enquêtes, traductions inédites et récits de résistances, nous explorons les nouvelles pensées et pratiques nécessaires pour répondre à la catastrophe écologique.
Chaque semaine, nous publions en accès libre des articles qui approfondissent les enjeux écologiques, politiques, et sociaux, tout en critiquant l’emprise du capitalisme sur le vivant. Plus qu’une revue, Terrestres est un laboratoire d’idées et un lieu de réflexions critiques, essentielles à l’élaboration d’alternatives justes et émancipatrices.
En nous lisant, en partageant nos articles et en nous soutenant, par vos dons si vous le pouvez, vous prenez le parti de l’écologie radicale dans la bataille culturelle qui fait rage.
Merci  !
!
L’article Pour une écologie de la libération : antiracisme et écologie politique est apparu en premier sur Terrestres.
21.06.2025 à 18:43
Pendant ce temps, l’insupportable quotidien de Gaza
Dans son livre "Gaza, Vie", le journaliste Rami Abou Jamous raconte comment lui et ses proches tentent de s’habituer à la "demi-vie" de misère et d’humiliation dans les camps de tentes, sous la menace constante des bombes. Des récits directs et sensibles sur la peur, le dénuement et la débrouille. Mais c’était avant la famine organisée… Depuis, le génocide se poursuit.
L’article Pendant ce temps, l’insupportable quotidien de Gaza est apparu en premier sur Terrestres.
Texte intégral (7474 mots)
Nous sommes en train de vivre un génocide, ce mot que beaucoup de gens refusent d’employer parce qu’ils considèrent qu’il est réservé à un seul peuple. Moi, je peux vous dire qu’on est en train de vivre un gazacide, un palestinocide, un génocide « spécial Palestiniens », « spécial Gazaouis », avec des méthodes de tuerie et des boucheries comme on n’en a jamais vu : bombardements 24 heures sur 24, jour et nuit. Un arsenal militaire inédit qui tue les gens dans leurs maisons, sous leurs tentes, dans les écoles, les hôpitaux, dans la rue. Des déplacements forcés d’un quartier à l’autre, du nord vers le sud, de l’ouest vers l’est, de l’est vers l’ouest, de l’ouest vers le sud. Affamer les gens, anéantir le système de santé, laisser mourir lentement, sans soins, les patients atteints de maladies graves et les blessés.
« Obeida est mort. Il avait 18 ans », chronique de Rami Abou Jamous parue dans OrientXXI le 17 juin 2025
Bombardements, assassinats, famine… À Gaza, la situation est insupportable. Ce printemps, de plus en plus de médias français le reconnaissaient – jusqu’à ce que l’attention ne se détourne vers l’Iran suite aux frappes israéliennes. Mais il y a bien longtemps que la situation est insupportable. Le journaliste Rami Abou Jamous en témoigne dans ses chroniques régulières pour le site OrientXXI et dans deux livres. Le premier, Journal de bord de Gaza, est un recueil de ces chroniques paru chez Libertalia/OrientXXI en 2024 (nous en avions publié un extrait ici). Le second s’appelle Gaza, Vie. L’histoire d’un père et de son fils, il a été écrit en collaboration avec Lilya Melkonian et est paru chez Stock en mars dernier. L’extrait qui suit en est tiré (pp. 121-134).
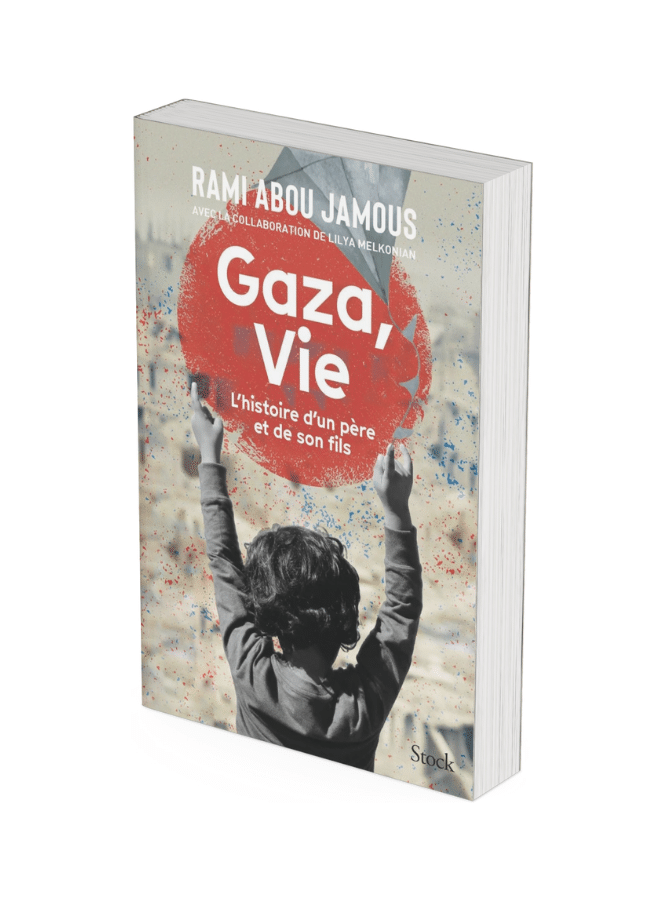
Les semaines passent et la vie à Rafah est de plus en plus intense. Je sens que je change, comme la plupart des déplacés. Les mêmes doutes, les mêmes craintes. Et, inéluctablement, avec le temps, nous acceptons l’inacceptable, nous nous habituons à cette nouvelle vie d’humiliations.
[Ma compagne] Sabah et moi avons le sentiment paradoxal d’être davantage en sécurité, parfois la guerre semble derrière nous, puis les mauvaises nouvelles nous rattrapent. Pas un jour ne passe sans qu’on nous en annonce. Tel ami est mort à Khan Younès. Tel autre voisin de Gaza Ville aussi. Tel membre de la famille de Sabah n’a pas survécu à un bombardement à Nousseirat. Les drames s’enchaînent : j’apprends le décès de Bilal Jadallah, mon ancien associé, avec qui j’avais fondé la Maison de la Presse. Il avait arrêté le fixing, et à force d’assister à des rencontres de diplomates dans le cadre de ses fonctions, il avait développé des ambitions politiques. Je le considérais comme un grand frère. Nous nous sommes vus pour la dernière fois à la Maison de la presse et je me souviens qu’il s’inquiétait des conséquences de la guerre sur l’avenir de la bande de Gaza. Il a été tué en essayant de se réfugier dans le Sud, comme nous. Je suis bouleversé. Je ne peux décrire la tristesse qui nous envahit à mesure que nous apprenons le décès de ces êtres si chers à nos cœurs.
C’est comme si nous nagions en pleine mer et qu’un courant nous éloignait du rivage. Alors que nous essayons de garder la tête hors de l’eau, un tourbillon sous-marin tente de nous couler. Parfois, l’un de nous est pris dedans et sombre vers les profondeurs de la mort. Pendant ce temps-là, nous y restons coincés, en vie, mais toujours prisonniers. Lors de cette tentative de survie, nous perdons la profondeur de nos émotions.
La ville de Rafah est à l’image de la situation de la bande de Gaza. Elle change vite, et beaucoup. Jusqu’à présent il n’y a pas eu ici d’incursion terrestre. C’est pour ça que nous avons choisi d’y poser nos valises plutôt qu’à Deir el-Balah, comme un ami nous l’a proposé, ou chez un autre à Khan Younès. Mon pari, c’est que les Israéliens descendront du nord vers le sud de la bande de Gaza au fur et à mesure, et que Rafah sera la dernière ville à être ciblée. Visiblement nous ne sommes pas les seuls à le croire. Avec le temps, l’endroit se densifie. À notre arrivée, à la frontière avec l’Égypte, le long du mur d’acier, de béton et de barbelés, il n’y avait pas de déplacés. Les gens savaient qu’il ne fallait pas trop s’en approcher. Maintenant qu’il n’y a plus de place dans l’enceinte de la ville, nous avons vu s’y ériger des tentes, des toits de tôle, des bâches. Chaque évacuation d’une ville, récemment Nousseirat, amène son lot d’habitants et de réfugiés d’autres zones qui viennent s’ajouter aux milliers d’exilés. Au début de la guerre, Gaza a été divisé en 2 300 blocs par les Israéliens, ces blocs leur servant aujourd’hui à organiser notre évacuation. À ce moment-là une grande partie des habitants refusaient de partir. Mais face aux tueries et aux « israéleries », ils ont fini par s’y plier. Nous avons compris de quoi cette armée était capable, et désormais, à la moindre instruction, tout le monde accourt vers le Sud, où les gens s’entassent et sont humiliés.
Chaque jour, je vois défiler un flot continu d’hommes, de femmes, de vieillards et d’enfants en charrette, en bus, en camion ou à pied, qui, après avoir vécu les uns sur les autres à l’hôpital Al-Shifa ou dans les écoles de l’UNRWA, s’installent à Rafah. Pour certains, c’est le troisième ou quatrième déplacement. C’est ce qui est arrivé à mon ami Hassoun, le chauffeur de Gaza Presse, mon vendeur de cosmétiques. Après avoir dormi devant l’hôpital Al-Shifa, celui que je considère comme mon petit frère s’est réfugié chez un ami à Nousseirat, emmenant ses parents, son frère, sa femme et ses deux enfants. Il y avait son propre logement dans un immeuble où une soixantaine de personnes s’étaient entassées. Puis Nousseirat a été attaqué, il m’a donc appelé pour m’annoncer qu’il nous rejoindrait à Rafah. J’ai cherché en vain un logement digne de ce nom pour eux. Ils ont fini par s’installer sous une tente. J’ai tout fait pour qu’ils y vivent dans de bonnes conditions. Avec Hassoun, nous avons construit des toilettes à côté de la tente, pour que lui et sa famille aient leur intimité. Parce que dans ces camps de fortune, tout le monde partage tout. Quel déchirement de voir les femmes et les enfants faire la queue nuit et jour pour soulager leurs besoins, prendre une douche ou espérer recevoir de l’aide humanitaire. Dans une société comme la nôtre, c’était inconcevable il y a peu de temps. Encore une humiliation. Nous avons donc creusé derrière la tente de la famille de Hassoun, puis nous avons cherché un panneau solaire afin qu’ils aient un peu d’électricité, pour leur éviter l’interminable file d’attente dans les écoles ou les hôpitaux – où l’on trouve toujours de l’électricité pour recharger les portables, les lampes torches ou les batteries de secours. Nous l’avons payé 1 200 shekels, contre 200 shekels avant la guerre. Un vrai business est en plein essor : pour gagner un peu d’argent, les heureux propriétaires d’un panneau solaire revendent aujourd’hui du courant – 1,35 euro la recharge du téléphone portable.

Ensuite, nous avons déniché des tapis, des chaises, des matelas, des couvertures, une batterie de secours pour alimenter des LED. De façon surréaliste, nous avons aménagé cette tente de 5 mètres carrés – un bout de tissu pour neuf personnes qui ne protège ni de la chaleur, ni du froid, ni des bombes – comme si nous achetions des meubles pour son nouvel appartement. C’est la première fois que je me sens aussi impuissant. J’en ai pleuré, je ne m’en remets pas. Je comprends désormais la frustration de mes frères exilés aux États-Unis, désespérés de ne pouvoir m’aider. Ils transfèrent régulièrement de l’argent sur mon compte, mais les deux seules banques de Rafah ont de moins en moins de liquidités. Au départ, nous pouvions retirer des espèces avec des montants plafonnés. Maintenant, il n’y a plus du tout de liquide dans les distributeurs. Il faut passer par un réseau de bureaux de change, un circuit parallèle : contre un virement, leurs propriétaires nous donnent de l’argent liquide, en prélevant au passage 20 ou 30 % de frais de service. Grâce à nos virements, ils achètent des marchandises provenant d’Israël et d’Égypte qu’ils nous revendent ensuite à des prix exorbitants. Il y a aussi des Palestiniens qui profitent de la guerre.
Quelques semaines après notre arrivée à Rafah, la famille de Sabah elle aussi nous a rejoints. Ses parents, ses frères et sœurs, chacun son conjoint et ses enfants. Au total une trentaine de personnes. Ils sont partis de Nousseirat après un message de l’armée israélienne leur demandant de quitter la ville. Ils souhaitaient prendre la route le lendemain mais les massacres ont tout de suite été très intenses. Ils ont donc décidé en urgence d’un départ pour Rafah en charrette et à pied, en pleine nuit. Ce soir-là, il pleut des cordes, le réseau téléphonique est coupé, et nous n’arrivons ni à les joindre ni à les localiser. Sans tente, la famille de Sabah passe une nuit dans la rue, sous la pluie. Quand nous les trouvons, le lendemain, j’active mon réseau et me démène pour leur dénicher une tente. Une petite tente qui, dans le reste du monde, servirait à faire du camping à la plage ou à la montagne. À Rafah, c’est devenu le rêve de toutes les familles gazaouies.
C’est une guerre psychologique : nous habituer à ces demi-vies. Comme lors de la Nakba de 1948. L’histoire se répète devant mes yeux et je ne peux m’empêcher de faire cette comparaison.
Évidemment, nous n’en trouvons pas. Comme pour Hassoun, il n’y en a plus nulle part. Des bâches, du bois et des planches leur permettront de se construire un refuge. Voir ces abris de fortune pousser partout est un véritable choc pour nous. Nous n’avions jamais vu ça, mais avec le temps, nous nous y sommes malheureusement habitués. Désormais, quand nous demandons à quelqu’un où il loge, nous ne nous attendons plus à ce qu’il donne l’adresse d’un appartement. Nous savons qu’il va nous parler du garage, de la bâche, de la tente ou de l’école dans laquelle il dort. C’est une guerre psychologique : nous habituer à ces demi-vies. Comme lors de la Nakba de 1948. À l’époque, les milices juives, notamment les Haganah, avaient expulsé la population palestinienne de ses villes comme Haïfa, Jaffa ou au nord du pays, vers des camps, sous des tentes. Ces tentes se sont ensuite transformées en toiles, en tôle, puis en dur. Aujourd’hui, ces lieux s’appellent des « camps de réfugiés ». Ceux par exemple de Yebna et de Fallouja sont en fait d’anciens villages entiers qui ont été déplacés en 1948 et 1967. Mes grands-parents l’ont vécu. Aujourd’hui, à Gaza, nous revivons la même chose : les habitants de Chajaya, de Beit Hanoun ont tous dû partir, et s’installent tous ensemble dans un même lieu, côte à côte. Se connaître entre réfugiés, c’est s’assurer une meilleure protection et du réconfort. 75 % des Gazaouis sont des descendants de ces victimes, survivants de la Nakba de 1948 qui avaient fui les massacres de ces milices juives. Les descendants de ces milices se sont transformés en armée, et opèrent de la même manière.
Lire aussi sur Terrestres : Suzanne Beth, « Démembrer et pulvériser les corps : sur la guerre d’anéantissement à Gaza », janvier 2025.
L’histoire se répète devant mes yeux et je ne peux m’empêcher de faire cette comparaison. J’y pense chaque fois que je regarde le visage de Sabah. À force de cuisiner sur un four d’argile, il rougit avec la chaleur et noircit avec la fumée. Je la complimente souvent en lui disant que ces nouvelles couleurs lui vont à merveille, elle qui a la peau si blanche semble bronzée. [Mon fils] Walid, lui, a gardé l’habitude de vouloir cuisiner avec nous, comme à Gaza Ville. Il est toujours dans nos pattes lorsque nous préparons le pain. Nous continuons à lui faire croire qu’à part le mode de cuisson, rien n’a vraiment changé dans notre quotidien. Il a appris à préparer du feu avec des brindilles de bois ou du papier. Quand je vois dans ces yeux à quel point il est heureux de vivre cette expérience, je ressens une immense tristesse. À deux ans et demi, il devrait être à la crèche ou à la maternelle, avoir un robinet d’eau chaude, un micro-ondes. Au lieu de ça il n’apprend rien d’autre que cette nouvelle vie, toujours plus dure. Pour autant, j’essaie plus que tout de transformer ces moments en joie. Je tente de métamorphoser notre réalité pour la rendre moins difficile à supporter.
Tout le monde à Rafah vit ce que nous vivons. Tout le monde a le visage noirci par la fumée des fours d’argile et le soleil, tout le monde a maigri, les traits de ceux que nous croisons sont tirés par la fatigue et l’inquiétude. Les enfants, leurs parents, les personnes âgées, soit 1,6 million de personnes chassées de chez elles par les bombardements, entassées, épuisées. Et depuis quelques jours, la pénurie fait irruption. L’aide humanitaire en provenance du terminal Rafah qui arrive d’Égypte est insuffisante, d’autant qu’elle passe d’abord par le poste de Kerem Shalom, et le contrôle de l’armée d’occupation, avant d’être enfin distribuée au compte-goutte. En plus de la faim, nous manquons progressivement de tout, y compris de produits d’hygiène. Pour les femmes, la situation est désolante. Elles utilisent des bouts de tissu en guise de serviettes hygiéniques. Pour les jeunes enfants, c’est la même chose : les couches sont quasiment introuvables. J’ai réussi à en acheter pour Walid, mais à un prix exorbitant. Le savon et le shampoing sont aux abonnés absents. Heureusement que j’en ai constitué un stock dès notre arrivée ici. Ceux qui n’en ont pas le fabriquent avec un mélange de maïzena et d’eau. Logiquement, le manque d’hygiène apporte son lot de maladies dermatologiques, pour la plupart moyenâgeuses, comme la gale.
La pénurie de gaz a poussé les gens à chercher du bois partout. Maintenant que le bois des arbres a lui-même commencé à manquer, les habitants scient les poteaux électriques pour les brûler ou se rendent jusqu’aux anciens tunnels qui relient Rafah à l’Égypte, bouchés depuis des années. Là-bas les galeries étaient soutenues par des structures en bois : elles ont donc été réouvertes pour en sortir les derniers piliers.
Des proches me racontent leur insoutenable quotidien : ils broient du bétail pour faire de la farine et du pain, ils mangent de la nourriture pour animaux ou des plantes sauvages comestibles qui poussent dans des terrains vagues.
Impossible, aussi, de trouver des chaussures neuves. À force d’errance, nos souliers se sont abîmés, déchirés. Partout, on aperçoit des petits pieds nus. L’autre jour, j’ai naïvement laissé ma seule paire à l’entrée de l’appartement, devant la porte, à côté des tongs des enfants. Elles m’ont été volées. Je suis resté en tongs pendant des jours, jusqu’à ce qu’un ami m’en prête. Il faut aussi faire attention aux vols de linge étendu aux fenêtres. Du jamais vu.
Face à tant de misère, les premiers larcins d’aide humanitaire ont débuté. Les camions qui les acheminent via l’Égypte traversent des camps de fortune. C’est devenu un jeu : des enfants organisent des barrages à l’aide de pierres pour essayer de bloquer quelques camions, espérant y trouver des cartons de nourriture ou de vêtements. Par semaine, seuls 50 véhicules sont autorisés par l’armée israélienne à pénétrer dans le territoire. Pour 2,3 millions de Gazaouis. Puis ce jeu d’enfants s’est transformé en pillage organisé par des clans, installés à côté du terminal de Kerem Shalom, sous les yeux de l’armée israélienne qui laisse faire. De là, ils détournent les marchandises. Ces camions sont protégés par les policiers du Hamas, ils sont systématiquement bombardés. Ils espèrent sûrement que ces deux groupes armés, les clans et le Hamas, s’entretuent après la guerre.

À force de ne manger que des boîtes de conserve et quelques rares légumes – quand nous avons les moyens de nous les offrir –, nous faisons l’expérience de la malnutrition. Pendant ce temps-là, au Nord, la famine est apparue.
Sur place, les proches avec qui je corresponds me racontent leur insoutenable quotidien : ils broient du bétail pour faire de la farine et du pain, ils mangent de la nourriture pour animaux ou encore des plantes sauvages comestibles qui poussent dans des terrains vagues. Au téléphone, la petite fille d’anciens voisins de notre tour me confie rêver de légumes et de viande, pas de chocolat. Accablé par son récit apocalyptique, je décide de tenter ma chance. Je me rends au terminal Rafah. Là-bas je passe devant chaque camion d’aide humanitaire qui s’apprête à rejoindre le Nord et demande aux hommes à bord s’ils accepteraient de transporter un petit sac avec quelques légumes et une conserve de viande hachée, que nous appelons ici la « Bolobeef ». L’un des chauffeurs m’entend : son frère s’y rend justement le lendemain. Il accepte d’embarquer mon paquet. Miracle, le colis parvient à mes voisins, qui m’ont décrit l’émotion de l’enfant en mangeant. J’en pleure de joie.
Lire aussi sur Terrestres : Forum palestinien d’agroécologie, « En Palestine, « L’huile qu’on attend un an, les soldats la jettent en un instant », février 2025.
Motivé par ce succès, je décide de tenter ma chance une deuxième fois. L’un de mes amis connaît un conducteur de poids lourd autorisé à livrer du fioul aux ONG étrangères à Gaza Ville. J’achète le matin même 15 kg de chaque légume que je trouve : des cagettes de tomates, de concombres, d’oignons et de pommes de terre, 20 kg de riz et des conserves de lentilles et de viande hachée, et les répartis dans deux gros sacs. Au total, cela représente 1 200 euros de nourriture que l’homme accepte de transporter discrètement dans son camion. Il me prévient dès le début : il est possible que les produits soient confisqués sur la route par les Israéliens. Par chance, tout s’est déroulé comme prévu. À l’arrivée, les sacs sont réceptionnés par mon ami Fadi dit « le moustachu ». Il me rappelle quelques jours plus tard : il s’est servi pour sa famille et a distribué le reste dans son quartier, sans dire que c’était de ma part, comme je le lui avais demandé. Quelques jours plus tard, il me décrit la joie des familles qui se sont régalées. Je suis chaviré par l’émotion.
Mais ma troisième tentative échoue… cette fois-ci l’armée d’occupation interdit au camion de passer. Pourquoi affamer des enfants ? Qu’ont-ils à voir avec le Hamas ?
C’est ainsi que des milliers de victimes sont morts parce qu’une application d’IA en a décidé ainsi.
Les Israéliens nous avaient demandé de nous réfugier à Rafah, soi-disant une zone sûre. Nous savions pourtant qu’il n’y aurait pas de zones sûres à Gaza. Et voilà que les bombardements s’intensifient ici aussi. Des immeubles entiers sont détruits, des familles décimées. Souvent, avec Sabah, nous nous arrêtons devant des décombres pour y lire des inscriptions peintes sur du béton : « Ci-gît tel ou tel membre de telle famille. » Ce sont des dépouilles que personne n’a réussi à sortir des gravats, faute de moyens. Des tombeaux en pleine ville parmi lesquels nous évoluons chaque jour : jamais je n’oublierai ces images, gravées à vie dans ma mémoire. Des écoles abritant désormais des centaines de familles sont aussi ciblées, sous prétexte que des membres du Hamas y vivent. Je ne comprends pas pourquoi les Israéliens ne profitent pas des sorties quotidiennes de ces hommes-là pour les tuer dehors, loin des femmes et des enfants. Pourquoi les viser une fois de retour dans l’école ? D’autant que les médias israéliens ont révélé que leur armée utilise un logiciel d’intelligence artificielle nommé « Lavender » pour déterminer leurs cibles. C’est ainsi que des milliers de victimes sont morts parce qu’une application d’IA en a décidé ainsi. Je me pose de plus en plus de questions sur la sécurité des miens, Sabah, Walid et ses demi-frères. Est-ce que je pourrais aussi être visé par l’armée d’occupation ? De nombreux journalistes le sont désormais. Devrais-je loger ailleurs qu’à l’appartement ? C’est la première fois que j’envisage de m’éloigner de ma famille. Mais un jour que je trouve le courage de lui confier mon angoisse, c’est Sabah qui répond à mes questions : « On vit tous ensemble, on meurt tous ensemble. » Que dire de plus ?
Photographie d’accueil : une femme fait brûler du papier et du nylon pour entretenir un feu, Gaza, avril 2025. Photo Hosny Salah sur Pixabay. Sa page Instagram : hosnysalahl

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !
Depuis 2018, Terrestres est la revue de référence des écologies radicales.
À travers des essais, enquêtes, traductions inédites et récits de résistances, nous explorons les nouvelles pensées et pratiques nécessaires pour répondre à la catastrophe écologique.
Chaque semaine, nous publions en accès libre des articles qui approfondissent les enjeux écologiques, politiques, et sociaux, tout en critiquant l’emprise du capitalisme sur le vivant. Plus qu’une revue, Terrestres est un laboratoire d’idées et un lieu de réflexions critiques, essentielles à l’élaboration d’alternatives justes et émancipatrices.
En nous lisant, en partageant nos articles et en nous soutenant, par vos dons si vous le pouvez, vous prenez le parti de l’écologie radicale dans la bataille culturelle qui fait rage.
Merci  !
!
L’article Pendant ce temps, l’insupportable quotidien de Gaza est apparu en premier sur Terrestres.
- GÉNÉRALISTES
- Ballast
- Fakir
- Interstices
- Issues
- Korii
- Lava
- La revue des médias
- Time [Fr]
- Mouais
- Multitudes
- Positivr
- Regards
- Slate
- Smolny
- Socialter
- UPMagazine
- Le Zéphyr
- Idées ‧ Politique ‧ A à F
- Accattone
- À Contretemps
- Alter-éditions
- Contre-Attaque
- Contretemps
- CQFD
- Comptoir (Le)
- Déferlante (La)
- Esprit
- Frustration
- Idées ‧ Politique ‧ i à z
- L'Intimiste
- Jef Klak
- Lignes de Crêtes
- NonFiction
- Nouveaux Cahiers du Socialisme
- Période
- ARTS
- L'Autre Quotidien
- Villa Albertine
- THINK-TANKS
- Fondation Copernic
- Institut La Boétie
- Institut Rousseau
- TECH
- Dans les algorithmes
- Framablog
- Gigawatts.fr
- Goodtech.info
- Quadrature du Net
- INTERNATIONAL
- Alencontre
- Alterinfos
- AlterQuebec
- CETRI
- ESSF
- Inprecor
- Journal des Alternatives
- Guitinews
- MULTILINGUES
- Kedistan
- Quatrième Internationale
- Viewpoint Magazine
- +972 mag
- PODCASTS
- Arrêt sur Images
- Le Diplo
- LSD
- Thinkerview