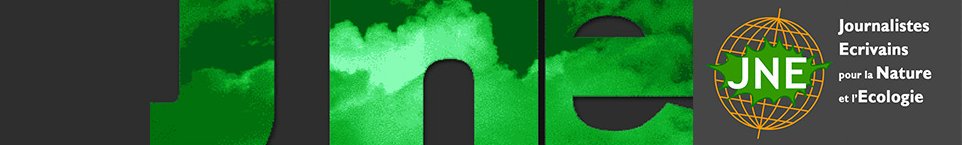Comprendre facilement les chats par Dr Laetitia Barlerin et Marc Giraud (JNE). Illustrations Valérie Pettinari
Lire plus (182 mots)
C’est un guide fort sympathique sur les chats que les éditions Delachaux et Niestlé viennent de publier. De format poche, le guide contient pourtant une somme d’informations pour connaître le langage de nos chers félins. Les dessins sont particulièrement soignés et parlants. Parmi les explications données sur telle ou telle posture, le lecteur ne manquera pas de s’étonner de certaines informations, notamment que les chats « caquètent » ! Et s’il se ronge les ongles, ce n’est pas par nervosité.
Éditions Delachaux et Niestlé, 80 pages, 12,90 € – www.delachauxetniestle.com
Contact presse : Laureen Gatien. Tél.: : 01 70 96 87 81 – lgatien@lamartiniere.fr
(Christine Virbel)
.
L’article Comprendre facilement les chats par Dr Laetitia Barlerin et Marc Giraud (JNE). Illustrations Valérie Pettinari est apparu en premier sur Journalistes Écrivains pour la Nature et l'Écologie.
Chronique naturaliste d’un jardin citadin
Texte intégral (2993 mots)
Depuis 20 ans, l’auteur de ce texte habite un quartier pavillonnaire de Saverne, ville située au pied des Vosges du Nord. Construite dans les années 50, sa maison est dotée d’un jardin avec des arbres fruitiers. Il évoque ses observations de la faune, particulièrement les oiseaux, et de la flore sauvage effectuées au cours de ces vingt années.
par Jean-Claude Génot *
Ce modeste jardin d’environ 280 m2 comporte un compost entouré d’un muret et une cabane de jardin. Il est séparé en deux parties par une allée en béton. C’est un jardin verger et en 2005 il comptait un cognassier aux branches s’étalant en étoile à partir d’un tronc très bas, un cerisier, deux pommiers et un mirabellier. Un épicéa sans doute planté par les premiers propriétaires était présent juste devant la cabane de jardin. Un sureau pousse près la façade juste à côté de la porte donnant sur le jardin et un houx en limite avec les voisins. Les maisons de ce quartier ont été construites au plus près de la rue pour laisser le maximum d’espace à l’arrière pour les jardins qui avaient une importance alimentaire plus importante dans les années 50.

La maison est encadrée par deux plates-bandes et un petit jardinet à l’avant d’une quinzaine de m2. Ce quartier s’est construit sur une colline sous-vosgienne dont le sous-sol est traversé par des sources. Ce dernier est une mosaïque géologique composé de grès, de marnes, de calcaires, de lœss car nous sommes dans le champ de faille de Saverne liée à la formation du fossé rhénan apparu il y a 25 millions d’années. En 20 ans, ce jardin a fait l’objet de nombreuses modifications, passant de la pelouse arboricole au jardin fleuri et boisé. Au départ, une pelouse bien tondue occupait les deux parties du jardin, avec les arbres fruitiers taillés de façon sévère et aucune haie, sinon un « mur vert » de thuya qui cachait tout juste les voisins. Une des pelouses est devenue un potager fleuri entre autres d’onagres, d’asters, de menthes et de bourraches et jardiné aujourd’hui en permaculture. L’autre pelouse est devenue une prairie fleurie (cardamine, coucou, épervière orangée, bugle rampant, lotier corniculé, trèfle blanc, millepertuis, brunelle, achillée mille feuilles, séneçon jacobée, etc.) grâce à une tonte tardive.
L’ombrage des haies et de certains arbres favorise une flore des bois composée de l’anémone des bois, du muguet, du sceau de Salomon, de l’hépatique et de la pulmonaire officinale. Le cerisier est mort, mais il sert de support à un lierre devenu exubérant. Un pommier est également mort, mais il a été remplacé par deux autres de variété différente. Le mirabellier a toujours été dépérissant, mais arrive encore à fournir des fruits alors qu’il ne lui reste plus beaucoup de branches vivantes. Son futur remplaçant est déjà planté : un quetschier d’Alsace haute tige. Enfin, l’épicéa qui devait avoir l’âge de la maison a été coupé car il acidifiait la prairie gagnée par la mousse et risquait d’endommager la cabane en cas de tempête. A la base du tronc conservé pour nourrir les insectes qui se nourrissent de bois mort, pousse un chêne venu spontanément, probablement grâce au geai qui transporte des glands. Un figuier a été planté contre la façade plein sud où il s’est bien développé. Initialement, une haie de troènes et de noisetier bordait la terrasse située dans un angle de la maison. Une autre haie avec du charme, du troène et du houx sépare le potager du fond du jardin où se trouve le mirabellier.

Il est vite apparu nécessaire de développer des haies au fond du jardin, sur toute une longueur du terrain et le long de l’atelier d’un voisin dont la façade en béton conserve la chaleur en été. Une haie de charmes a été plantée et elle atteint aujourd’hui la hauteur de la toiture du bâtiment et participe à l’îlot de verdure et de fraîcheur, constitué par trois haies où depuis peu est apparue une orchidée, la listère à feuilles ovales. L’une d’elle est constituée d’un cornouiller sanguin, planté, qui s’est multiplié par ses racines pour densifier la haie et d’une aubépine plantée également, qui atteint aujourd’hui 5 m de haut, d’un troène et d’un églantier venus spontanément. La haie qui longe toute la maison est un mélange d’arbustes plantés (fusain, églantier, noisetier, aubépine, lilas, amélanchier, seringat) et d’arbustes et d’arbres venus spontanément comme le sureau, le cornouiller sanguin et l’érable champêtre. Mon jardin est une véritable pépinière installée spontanément par les animaux (oiseaux, écureuil, petits rongeurs) qui le fréquentent avec les arbres et arbustes suivants : noisetier, frêne, chêne, saule marsault, noyer, églantier, sorbier des oiseleurs et bouleau. La liste des végétaux comporte 45 espèces de plantes à fleurs, 20 espèces d’arbres et arbustes et 3 lianes (clématite, lierre et ronce). Les arbres et certains arbustes dépassent largement la hauteur autorisée en termes de voisinage, mais pour l’instant ils sont tolérés par mes voisins, moyennant une taille des branches qui empiètent un des voisins.

En 20 ans, j’ai réussi à observer ou entendre 52 espèces d’oiseaux dans le jardin et son voisinage. Ces contacts visuels ou auditifs s’effectuent au gré du temps passé dans le jardin, mais aussi depuis mon bureau dont une grande fenêtre m’offre une vue imprenable, notamment en hiver quand les oiseaux viennent à la mangeoire. Au printemps, les oiseaux qui ont le plus fréquemment niché dans le jardin sont le rougequeue noir qui a installé son nid plusieurs fois sous le toit de la maison et une fois dans le sous-sol, le merle et la fauvette à tête noire qui nichent dans les haies ou dans le lierre qui recouvre le cerisier mort et le moineau domestique sous le toit de la maison également.

Mais de nombreuses autres espèces nicheuses chantent régulièrement dans le jardin ou autour : le verdier, le rougequeue à front blanc, le serin cini, la mésange bleue, la mésange charbonnière et la tourterelle turque. Parmi les oiseaux fréquemment posés au sol : le pic vert, la corneille, la pie, la tourterelle turque, le merle, le rougegorge et le pigeon ramier. Le jardin est à moins de 800 m de la forêt, ce qui explique les observations du pigeon ramier, du geai des chênes et du pic épeiche et les chants de la grive musicienne, du pinson des arbres, de l’accenteur mouchet ou encore des pouillots fitis et véloce. Chaque année, entre fin octobre et début novembre, les grues cendrées en migration volent au-dessus du jardin de jour comme de nuit avec parfois des groupes d’une centaine d’oiseaux. A cette saison des passages, j’ai pu observer à une seule occasion six milans royaux qui ont tourné un moment au-dessus du jardin. En hiver, le nourrissage à la mangeoire permet d’observer les mésanges bleue et charbonnière mais aussi, plus rares, les mésanges noire, huppée et à longue queue. Le rougegorge n’est jamais loin, mais reste dans la haie contrairement aux moineaux qui disputent la place aux mésanges.

Aux pinsons des arbres s’ajoutent leurs cousins venus des régions septentrionales, les pinsons du nord au plumage orangé, et les tarins des aulnes. La mangeoire attire plus rarement la sittelle, le gros-bec, le bouvreuil et le chardonneret. Le compost intéresse l’étourneau et la grive litorne qui vient également consommer les fruits de l’églantier. Les choucas, eux, viennent consommer les boules de graisse contenant des graines de tournesol.
Certaines observations sont marquantes comme cette pie qui est venue dans la haie pour prélever un jeune merle et le manger ensuite au sol (30 avril 2013). Le matin même une corneille avait essayé en vain d’accéder au nid, mais la pie possède la bonne taille pour se faufiler dans la végétation dense. Une corneille, toujours elle, a attaqué un écureuil, mais ce dernier a été plus vif (7 janvier 2006). Une autre fois, deux corneilles ont essayé, mais ils ont également essuyé un échec (4 avril 2008). Un épervier a tenté d’attaquer un moineau dans la haie mais en vain (14 août 2016). Deux faucons crécerelles s’accouplent avec de nombreux cris sur les branches d’un épicéa situé à une trentaine de mètres du jardin (1er mai, 2 mai et 13 mai 2022). Si j’ai un regret d’avoir coupé mon épicéa, c’est uniquement parce qu’en fin d’hiver il a accueilli plusieurs années de suite un hibou moyen-duc qui nous a gratifié de son chant nocturne. Le souvenir le plus remarquable à ce jour est celui d’un hibou grand-duc, le plus grand rapace nocturne d’Europe, perché sur un arbre chez des voisins qui a chanté à cinq reprises vers 3 heures du matin une nuit d’été (9 juillet 2023). Cet oiseau niche à moins d’un kilomètre dans une carrière abandonnée ce qui explique sa présence dans le quartier. Enfin il y a des espèces que j’ai contactées une seule fois comme le rare torcol, ce pic migrateur qui vit dans les vergers, ou encore le grimpereau des jardins au bec recourbé.
Pour le reste de la faune, l’orvet est un hôte régulier souvent délogé sous les jardinières, posées au sol. Une jeune couleuvre à collier a été observée dans le compost à une seule reprise. Un crapaud a déjà été observé à plusieurs reprises et à une seule occasion la grenouille verte. L’été 2025 a été l’occasion de la première observation d’un lézard des murailles, un effet des canicules ? En ce qui concerne les mammifères, le hérisson est un hôte occasionnel, l’écureuil était fréquent jusqu’à ce que deux maisons se construisent à la place des jardins avec des arbres, mitoyens du nôtre. Des pipistrelles ont été observées en chasse à la tombée de la nuit et certaines se réfugient derrière les volets, trahissant leur présence par leurs crottes minuscules. L’espèce la plus omniprésente est la fouine qui a longtemps occupé le grenier de la maison avant notre arrivée puis a continué jusqu’à la réfection de la toiture et l’isolation des rampants. Mais ce mustélidé anthropophile fréquente le quartier et vient souvent déposer sa crotte sur notre paillasson après une visite nocturne du jardin.

Côté insectes, faute de connaissances suffisantes, je n’ai noté que certaines espèces particulières comme la mante religieuse (un effet du réchauffement climatique ?), l’aeschne bleue (une libellule), le moro-sphynx, un papillon colibri facile à repérer avec son vol stationnaire ou encore l’abeille charpentière ou bourdon noir qui se distingue par sa couleur noire violacée et sa grande taille par rapport à une abeille classique.
Ce modeste jardin est une fenêtre sur le monde naturel, la petite nature comme la nommait le naturaliste et artiste Robert Hainard, celle des zones pavillonnaires. On voit le rythme quotidien des oiseaux telles les corneilles qui volent vers les champs de bon matin et reviennent en fin de journée à leur dortoir situé en ville. On perçoit la raréfaction de certains oiseaux, comme le torcol contacté une seule fois et l’hirondelle des fenêtres qui a niché une fois en 20 ans. A l’inverse, le survol du héron cendré avec son cri grinçant et de la cigogne blanche traduit un statut favorable pour ces deux espèces, particulièrement pour la cigogne qui dépasse les 1 000 couples dans le Bas-Rhin. Hormis le nombre de jours de neige en diminution et les récentes canicules, les effets concrets du réchauffement climatique sur la végétation sont visibles notamment avec le houx en bonne santé et la prolifération du lierre grâce à la diminution des jours de gel en hiver. Mais un jardin de taille limitée, aussi diversifié soit-il, ne peut pas à lui seul accueillir une faune et une flore d’une grande richesse. L’environnement est déterminant et il est vraisemblable que les effets cumulés de l’urbanisation de certains jardins, de l’élimination de nombreux arbres non remplacés et de la gestion intensive des gazons ont joué un rôle dans la rareté de certaines espèces parmi lesquelles l’écureuil et le hérisson.
* Ecologue
Photo du haut : le potager en permaculture © JC Génot
L’article Chronique naturaliste d’un jardin citadin est apparu en premier sur Journalistes Écrivains pour la Nature et l'Écologie.
Contourner les chambres d’agriculture, est-ce possible ?
Texte intégral (1728 mots)
Face à tous les dysfonctionnements des chambres d’agriculture et compte tenu que la très grande majorité de ces établissements publics sont aux mains de la FNSEA, JA (Jeunes agriculteurs, syndicat frère de la FNSEA) et Coordination rurale (CR), donc ne veulent rien changer, est-il envisageable de les contourner lorsqu’on est paysan ou à la recherche d’une installation ?
par Pierre Grillet
Lors de l’installation d’un agriculteur, les chambres d’agriculture sont le plus souvent sollicitées. Pourtant, il existe des alternatives possibles (au moins partiellement) comme le réseau CIVAM (Centres d’initiatives pour valoriser l’agriculture et le milieu rural) qui réunit des groupes d’agriculteurs et de ruraux qui souhaitent travailler de manière collective à la transition agro-écologique et défendre ainsi un autre développement agricole et rural. Les CIVAM proposent un accompagnement à la création d’activité en milieu rural et agricole. D’autres structures existent comme les GAB, groupements de producteur·rices en Agriculture Biologique, ou encore l’ADEAR ou ARDEAR (Association pour le développement de l’emploi agricole et rural) dont le but est de maintenir et d’installer des agriculteurs qui incarnent la vision de l’agriculture paysanne (1).
Une chambre d’agriculture alternative au Pays basque qui associe paysans et non paysans…
Ne se sentant pas concernés par les orientations des chambres officielles, des paysans du Pays Basque ont décidé de prendre eux-mêmes en main leur destin. Depuis les années 80, un groupement foncier agricole (GFA) est créé pour le rachat des terres, puis le syndicat ELB (Rassemblement des paysans du Pays basque rattaché à la Confédération paysanne dès 1987) voit le jour en 1982, issu d’une scission au sein de la FDSEA (Fédération départementale des syndicats d’exploitants agricoles).
Ces paysans décident de créer en 2005 la chambre d’agriculture alternative Euskal Herriko Laborantza Ganbara (EHLG), dans laquelle ELB (la Confédération paysanne du Pays Basque) est majoritaire. Sur son site (2), on peut lire : « Euskal Herriko Laborantza Ganbara est une association loi 1901 de développement agricole et rural, créée le 15 janvier 2005. Elle a pour objet de contribuer au développement d’une agriculture paysanne et durable ainsi qu’à la préservation du patrimoine rural et paysan, dans le cadre d’un développement local concerté sur le territoire Pays Basque ».
Endossant le même rôle qu’une chambre d’agriculture départementale, elle encourage une politique agricole et un mode de fonctionnement différents des chambres officielles. Alors que les chambres d’agriculture classiques sont le domaine réservé des exploitants agricoles, la chambre alternative du Pays Basque est ouverte aux citoyens. Tous les six ans, la chambre alternative élit ses représentants et parmi ceux-ci, des écologistes et des consommateurs. Le collectif tient à ce que tous les acteurs concernés puissent discuter des problèmes et trouvent ensemble des solutions. « L’agriculture n’est pas le problème des agriculteurs uniquement, mais de la société tout entière », soulignait fort justement Beñat Molimos, co-président d’EHLG au journal Basta. La chambre alternative souhaite « une agriculture paysanne à taille humaine, autonome en intrants, relocalisée et respectueuse de ses travailleurs ».
Ce qui se passe au Pays Basque est considéré par la Confédération paysanne comme un laboratoire de l’agriculture paysanne. Une aventure qui a connu à ses débuts, de nombreux soucis, l’État français ne supportant pas une telle initiative. Cependant, l’État a perdu tous ses procès et cette chambre alternative fonctionne et bénéficie de nombreux dons émanant de citoyens. Au journal Reporterre, Michel Berhocoirigoin, premier Président d’EHLG, était catégorique : « Deux types d’agriculture se confrontent. Le discours dominant veut qu’il y ait de la place pour toutes les agricultures. Cela est faux : l’une est prédatrice de l’autre ». Basta résume ainsi cette expérience basque : « Protéger la biodiversité, améliorer le sort des petits paysans, développer l’économie locale, intégrer écologistes et consommateurs dans ses instances : le beau bilan de la seule chambre d’agriculture alternative de France, au Pays basque » (3). La chambre d’agriculture alternative du Pays Basque prouve que ce type d’expérience peut voir le jour dans d’autres régions et départements sans attendre un éventuel remplacement de la FNSEA ! Michel Berhocoirigoin (4) le disait lui-même auprès de Reporterre : « On ne demande qu’une seule chose, c’est être copié ! ». Une initiative qui a suscité un très fort intérêt lors de sa présentation au Village de l’eau à Melle en 2024.
Lutter contre une tendance lourde : l’effondrement et la disparition des petites et moyennes fermes au profit des grandes exploitations
L’une des préoccupations importantes de cette chambre concerne la transmission des fermes. Celle-ci s’est donc associée à la fondation Terre solidaire qui interroge sur son site le coordinateur d’EHLG, Iker Elosegi : « Nous nous attaquons à tous les sujets liés à la destruction de l’environnement et de l’alimentation. La question est de se demander comment on arrive à faire en sorte que les fermes sur lesquelles il n’y a pas de repreneur continuent à vivre. C’est la question de la transmission. Le but du projet financé par la Fondation Terre Solidaire est d’accompagner les paysans locaux qui ne souhaitent pas transmettre leurs fermes à l’Etat pour faciliter leurs transmissions à des repreneurs qui cultiveront en agriculture paysanne. Et ainsi éviter qu’elles soient incorporées dans de grandes parcelles de l’agro-industrie »…
Le Pays Basque : une terre propice à ce type d’initiatives. Un exemple applicable partout ailleurs ?
« Sur notre territoire, c’est une mosaïque de montagnes, de cours d’eau, de petites parcelles. Elles sont vraiment le reflet de l’agriculture paysanne avec ces questions de qualité du sol ou des eaux essentielles pour nous », rappelle Iker Elosegi auprès de Terre Solidaire. Une terre plutôt favorable pour les petites exploitations. L’exemple à suivre, c’est certainement la possibilité d’alternatives partout sur le territoire national, tout en prenant en compte les particularismes de chaque région. À l’heure où de plus en plus de personnes réfléchissent à la manière de créer des bio-régions qui se distingueraient par des particularités fortes au niveau de leur environnement (tel un bassin versant, un bocage, une montagne, une vallée, le Pays Basque…) et non pas définies par des limites administratives arbitraires, ce type d’alternative doit nous permettre de réfléchir sur de nouvelles manières de soutenir les paysans en y associant toute la population. Si un « copier-coller » de l’alternative basque n’est sans doute pas possible partout, son existence devrait nous inciter à trouver les bonnes formules ailleurs sachant que c’est possible puisqu’ils l’ont fait !
En Isère, le rêve serait-il devenu réalité ?
« En 2024, révolté-e-s par les politiques de la Chambre d’Agriculture de l’Isère dominée par le syndicat productiviste FNSEA, une trentaine de paysan-ne-s ont fondé la Chambre d’Agriculture Indépendante de l’Isère. Cette démarche s’inspire de l’initiative similaire menée au Pays Basque.
Les activités de la Chambre d’Agriculture Indépendante de l’Isère regroupent une centaine de paysan-ne-s, et celle-ci a soutenu l’installation d’une vingtaine de producteurs et productrices en deux ans.
La Chambre est financée par les adhésions de ses membres. Elle ne dispose d’aucun-e salarié-e permanent-e, mais indemnise les prestations des paysan-ne-s réalisant des formations et de l’accompagnement des personnes souhaitant s’installer en agriculture ».
Attention : la chambre d’agriculture indépendante de l’Isère n’existe pas encore. Il s’agit d’un songe du media « Ici Grenoble » (5).
Mais qui sait un, jour ? À Grenoble et partout ailleurs ? Voilà un beau projet collectif à construire partout en France en fonction des particularités locales…
(1) Site de réseau CIVAM : https://www.civam.org/ ; GAB : https://www.fnab.org/notre-reseau/ ; ADEAR ou ARDEAR : https://www.agriculturepaysanne.org/ARDEAR-Nouvelle-Aquitaine (de nombreux autres sites concernant cette association dans d’autres régions de France).
(2) Site de Euskal Herriko Laborantza Ganbara (EHLG) : https://ehlgbai.org/
(3) Ce paragraphe a été rédigé, entre autres, à partir de trois articles dont nous recommandons la lecture pour approfondir l’expérience : « Au Pays basque, les paysans ont créé leur chambre d’agriculture alternative ». Chloé Rebillard. 2020 (17 février). Reporterre. https://reporterre.net/Au-Pays-basque-les-paysans-ont-cree-leur-chambre-d-agriculture-alternative . « Une chambre d’agriculture alternative au Pays basque ». Noah Bergot Fondation Terre solidaire. 2025 (17 janvier). https://fondation-terresolidaire.org/entretiens/transition-ecologique-agriculture/ « Au Pays basque, une chambre d’agriculture alternative fait vaciller le modèle productiviste et polluant » Lola Keraron. Basta. 2021 (22 juin . https://basta.media/EHLG-chambre-d-agriculture-alternative-pays-basque-fromage-de-brebis-pain-Herriko
(4) Michel Berhocoirigoin, éleveur et militant basque, est décédé en 2021.
(5) Site Ici Grenoble : https://www.ici-grenoble.org/
Illustration : une petite ferme dans le bocage gâtinais deux-sévrien. Dessin : Denis Clavreul. L’enjeu pour les années à venir réside dans le maintien et la multiplication des petites fermes. Un enjeu qui semble bien peu priorisé par les habituelles chambres d’agriculture.
L’article Contourner les chambres d’agriculture, est-ce possible ? est apparu en premier sur Journalistes Écrivains pour la Nature et l'Écologie.