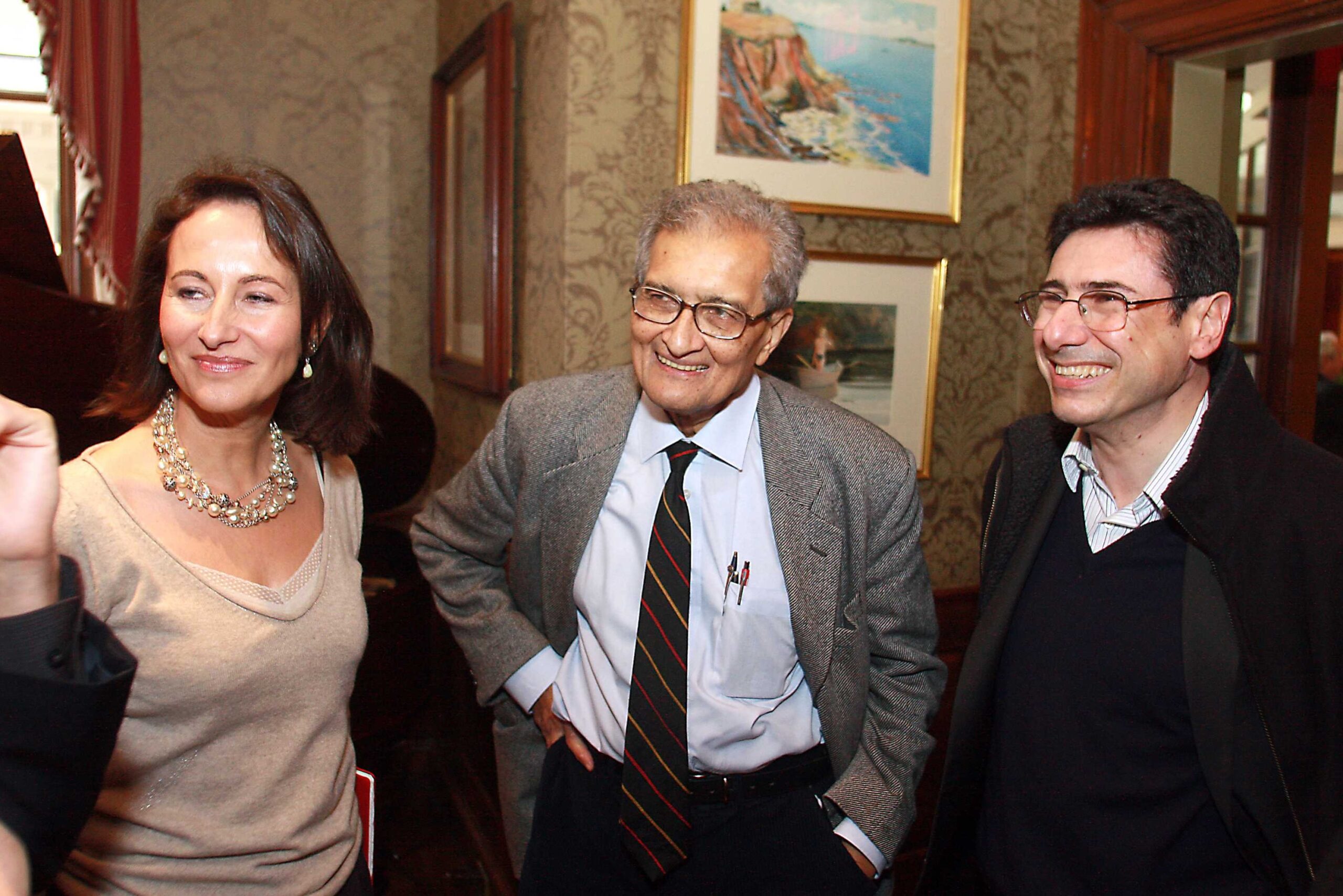02.11.2025 à 06:30
Philippe Aghion, une trajectoire intellectuelle : grand entretien avec le prix Nobel d’Économie 2025
« Je sentais que Schumpeter avait raison… »
À partir d’une intuition à Harvard dans les années 1980, Philippe Aghion a bâti une carrière d’économiste qui l’a conduit cette année à la plus prestigieuse distinction de la discipline.
Du MIT au Collège de France, entretien fleuve sur son parcours, ses influences et ses convictions.
L’article Philippe Aghion, une trajectoire intellectuelle : grand entretien avec le prix Nobel d’Économie 2025 est apparu en premier sur Le Grand Continent.
Texte intégral (8105 mots)
Vous souhaitez soutenir la première revue européenne indépendante ? Découvrez nos offres et abonnez-vous au Grand Continent
Comment votre trajectoire intellectuelle vous a-t-elle mené à la question de la croissance, de l’innovation et de son rôle central pour le développement des économies modernes ?
Je suis venu à l’économie par la politique.
La pauvreté était mon obsession — et la question lancinante : comment sortir de la pauvreté ? À un moment donné, j’ai compris qu’on ne peut pas sortir de la pauvreté sans avoir de la croissance — ou du moins que c’est très compliqué. Alors, comment peut-on rendre cette prospérité partagée ? Il y avait donc un peu l’idée issue de mon passé politique à gauche de dire : je veux sortir les gens de la pauvreté et je veux que cela soit partagé.
On apprenait avec le modèle de Solow qu’il fallait quelque chose qui s’appelait le progrès technique.
On ne voyait pas trop d’où ça venait.
D’autre part, Schumpeter parlait de destruction créatrice — mais il n’y avait pas de modèle schumpétérien.
Schumpeter était une curiosité dans les cours de l’histoire de la pensée économique, ou bien dans le cours d’IO 35. Je me souviens du cours d’IO avec Richard E. Caves à Harvard en 1984, lorsqu’il avait mentionné que Schumpeter n’avait pas de modèle auquel se raccrocher… C’est à ce moment je pense que m’est venue l’idée de faire un modèle qui incorpore la destruction créatrice.
Ayant étudié beaucoup l’IO, j’avais une idée fixe : mettre l’IO dans la croissance.
Dès 1982, dans mon statement pour Harvard, j’avais dit que je voudrais intégrer la concurrence imparfaite dans la croissance. Il devait y avoir quelque chose à trouver. Lorsque je suis arrivé au MIT en 1987 comme professeur associé, Peter Howitt était visiteur de Western Ontario pour un an. Il avait son bureau à côté du mien et j’y suis allé un jour pour lui dire : « Écoute, tu as une formation de macroéconomiste, moi, je suis plutôt micro. Pourquoi ne pas essayer de se mettre ensemble et de faire un modèle de croissance schumpétérien ? »
Je voulais comprendre les ressorts de la prospérité — et je sentais que Schumpeter avait raison, mais je devais trouver un modèle testable et falsifiable.
On avait l’idée décrite par Schumpeter effectivement — mais pas de modèle. Et donc aucune manière de l’intégrer dans le reste de la discipline telle qu’elle progressait…
Ce n’était pas mainstream du tout !
En cours de macro, on n’étudiait pas Schumpeter.
En cours de base de micro et de macro, on n’avait pas de modèle de croissance schumpétérien. Cela n’existait pas.
Il y a quelques années, en 2018, l’économiste Paul Romer a néanmoins obtenu le prix Nobel pour la croissance endogène avec le modèle de compétition monopolistique. Est-ce que vous pourriez expliquer la différence par rapport au vôtre — le modèle schumpétérien ?
L’idée de Romer est qu’en innovant, on arrive à une meilleure division du travail, ce qui crée ensuite de la croissance.
La division du travail empêche d’avoir des rendements décroissants du capital au sein de chacun des secteurs. Donc, en divisant de plus en plus, on évite les rendements décroissants. C’est donc un modèle de croissance très youngien — issu de Allyn Young, qui s’était inspiré d’Adam Smith sur la division du travail — qui arrivait à générer de la croissance par une amélioration, en trouvant de nouvelles idées qui permettent de diviser de mieux en mieux.
Je voulais comprendre les ressorts de la prospérité — et je sentais que Schumpeter avait raison, mais je voulais trouver un modèle testable et falsifiable.
Philippe Aghion
Ce modèle mérite le prix Nobel qu’il a eu, évidemment.
Ce qui manquait toutefois, c’est que, dans la croissance, il y a de l’entrée et de la sortie. Il faut du turnover. Or dans le modèle de Romer, il n’y en avait pas. Ni de l’hétérogénéité d’ailleurs — tout le monde est pareil. Or on sait bien qu’il y a des entrants et des incumbents, des petites et des grosses entreprises, des leaders et des followers. Nous sommes dans un monde d’hétérogénéité. Tout ce qui fait la dynamique — firm dynamics, en anglais— n’est pas dans le modèle de Romer.
Notre paradigme fonctionne avec beaucoup d’autres, puisque nous avons fait un modèle de step-by-step innovation que d’autres ont beaucoup utilisé. Le papier de Klette et Kortum en 2004 36 avait été très important, introduisant les firm dynamics pleinement dans le modèle schumpétérien.
Nous avons ouvert une voie qui a été fructueuse parce que non seulement il y a eu des développements théoriques très utiles — qui ont permis de voir la relation entre concurrence, IO et croissance dans le modèle de step-by-step innovation — mais nous avons en plus pu réconcilier la croissance avec des hypothèses bien connues — comme le fait que la distribution de la taille des entreprises est très asymétrique, que le taux d’exit des petites entreprises est plus grand que celui des grandes entreprises, qu’il y a une relation positive entre l’âge et la taille des entreprises, etc…
Nous avons ouvert un champ de la théorie de la croissance qui permet d’intégrer toutes ces questions et de tester la théorie de la croissance avec des données micro, c’est-à-dire des données d’entreprises. Auparavant, le modèle de Solow sans rendements décroissants faisait des cross-country growth regressions. Aujourd’hui, ces papiers ne seraient jamais publiés ; la croissance se teste : il y a un dialogue permanent entre nos théories et de nouvelles données microéconomiques, alors qu’avec Romer, cela n’était pas possible.
Un point central dans le modèle schumpétérien et dans votre modèle est celui des profits, qui relève d’une tradition « autrichienne » — assez lointaine de votre propre tradition politique. Dans celle-ci, l’entrepreneur, avec son innovation et ses profits individuels, vient perturber le modèle économique existant avec une innovation et fait des profits qui n’existent pas à la marge dans le modèle le plus traditionnel de concurrence parfaite.
Cette dimension était également présente dans les travaux de Romer.
Personnellement, je ne connaissais pas du tout le modèle Romer quand j’ai travaillé avec Peter Howitt en 1987. La différence, chez nous, c’est la contradiction au cœur du processus de croissance dans le modèle schumpétérien.
D’un côté, pour motiver l’innovation il faut des profits issus des rentes d’innovation.
Mais de l’autre, les innovateurs d’hier sont tentés d’utiliser leurs rentes pour empêcher de nouvelles innovations, parce qu’ils ne veulent pas être eux-mêmes sujets à la destruction créatrice. Cette contradiction est au cœur du processus de croissance, ce qui donne lieu à une économie politique de la croissance.
Schumpeter lui-même était très soucieux du risque que les premiers innovateurs deviendraient des entrenched incumbents qui empêcheraient le processus de se perpétuer. C’est alors que la politique de concurrence et les gouvernements jouent un rôle très important, mais ces gouvernements peuvent aussi être achetés par les entreprises en place pour justement ne pas mettre en œuvre ces politiques de concurrence. Du coup, la société civile devient aussi cruciale pour contrôler les gouvernements.
Aujourd’hui, il y a deux manières de croître pour un pays. On peut d’une part être à la frontière, c’est-à-dire avoir un maximum d’entreprises qui sont ces innovateurs, qui vont faire le dernier step, qui vont même aller au-delà de la frontière. Mais il y a aussi l’imitation pour des pays qui sont au niveau du middle et du low income — et qui doivent encore rejoindre la frontière. Y a-t-il toujours intérêt à être à la frontière — ou pas ?
Depuis Deng Xiaoping, la Chine a connu une croissance de rattrapage.
Elle n’était pas à la frontière, mais elle a absorbé et imité des technologies plus avancées.
Elle avait des institutions qui le permettaient. Je mets souvent l’accent sur la réallocation de facteurs — de la campagne à la —ville, sur l’absorption, sur les transferts de technologies, ainsi que les gros investissements.
Mais à un moment donné, les pays qui commencent à rattraper épuisent les sources du rattrapage et doivent passer à une croissance par l’innovation à la frontière, c’est-à-dire innover eux-mêmes au lieu de rattraper. Cela nécessite d’autres institutions, dont la concurrence, qui est très importante.
Quand il y a plus de concurrence, on innove plus. Quand le pays adopte la stratégie du rattrapage, ce n’est pas très grave de ne pas avoir beaucoup de concurrence. À l’inverse, dans l’innovation à la frontière, elle est très importante, car tout le monde se fait la course. C’est ce qu’on appelle l’émulation neck-and-neck.
L’idée que la distance à la frontière module les politiques publiques pertinentes est un point vraiment central dans votre chaire.
En effet.
Pendant la phase de rattrapage se développent souvent de grosses entreprises — comme les chaebols en Corée, les keiretsus au Japon — qui non seulement inhibent l’entrée de nouvelles entreprises innovantes, mais qui font pression sur les gouvernements pour ne pas passer à un monde avec plus de concurrence.
Elles bloquent le passage nécessaire d’institutions qui favorisent le rattrapage à des institutions et politiques qui favorisent l’innovation à la frontière. Le risque est ainsi de tomber dans le syndrome dit du middle income trap.
En termes sectoriels, on a l’impression que le modèle schumpétérien s’applique très bien au développement des médicaments, aux startups de la tech, etc. Mais est-ce que les secteurs de services à la personne — ceux qui connaissent les effets de la « maladie des coûts » et de la loi de Baumol — sont des secteurs dans lesquels l’avancée de la frontière par l’innovation step by step est également possible ? Ou est-ce qu’on doit penser qu’au fur et à mesure que ces secteurs de services représentent une plus grosse part de l’économie, le rôle de l’innovation sectorielle deviendra plus limité ?
Non — parce qu’il existe déjà de l’innovation dans les services !
L’innovation devient souvent plus qualitative, moins quantitative. C’est ce qu’on voit dans nos travaux avec Fabrizio Zilibotti.
C’est une innovation continue, mais elle se mesure plus difficilement dans le PIB, elle est davantage orientée vers la qualité (quality-driven) que vers la quantité.
Pourtant, elle contribue bel et bien à améliorer les standards de vie.
On peut réconcilier politique industrielle et politique de concurrence : la DARPA est un des moyens de le faire.
Philippe Aghion
En parlant de standards de vie, l’une des grandes questions aujourd’hui concerne l’articulation entre croissance et soutenabilité environnementale. Vous avez beaucoup travaillé sur la question de la croissance verte, de la taxe carbone ou des subventions à l’innovation verte. Quelles sont les leçons aujourd’hui en termes de politiques publiques ou en termes d’institutions pour concilier soutenabilité environnementale et croissance ?
Je dirais qu’il y a des politiques.
Les Chinois ont privilégié la politique industrielle verte, et les Américains aussi, avec l’Inflation Reduction Act en particulier, même s’il est un peu mis à mal en ce moment. Les Européens ont privilégié la taxe carbone, mais on a vu avec les Gilets jaunes qu’il y avait des limites à cette méthode — elle peut devenir très rapidement insupportable.
Je dirais qu’il faut les deux parce qu’il y a deux types d’externalités en jeu.
D’abord il y a les externalités environnementales comme la pollution. Mais il y a aussi des externalités technologiques, dans la décision d’innovation. On sait que les entreprises qui ont beaucoup innové dans le passé dans les technologies polluantes continuent spontanément d’innover dans les technologies polluantes. C’est ce qu’on appelle la path dependence.
Face à ces deux types d’externalités, il faut au moins deux instruments. Les travaux que j’ai faits montrent qu’il faut à la fois de la taxe carbone et une subvention à l’innovation verte ou politique industrielle verte. La politique industrielle est d’autant plus importante quand il s’agit de chaînes de valeurs — par exemple la voiture électrique, la batterie, les composants clean des batteries… La taxe carbone ne suffira pas.
Et en termes de politique industrielle ?
C’est là que le modèle de la DARPA — l’Agence pour les projets de recherche avancée de défense aux États-Unis — intervient.
Le fonctionnement de la DARPA repose sur l’argent provenant du ministère de la Défense, et donc sur des chefs d’équipe, qui ont des moyens et qui suscitent des projets concurrents. Donc, il y a une partie top–down, car ils choisissent le secteur, mais il y a aussi une partie bottom-up, c’est-à-dire qu’ils ne prennent pas une seule entreprise, mais laissent plusieurs entreprises venir.
On peut donc réconcilier politique industrielle et politique de concurrence : la DARPA est l’un des moyens de le faire.
Les Chinois en ont un autre — encore plus compétitif. Ils sélectionnent plusieurs entreprises et puis voient qui se débrouille le mieux.
Cela nous conduit à la question du lien entre innovation, entreprises et universités. Vous avez beaucoup travaillé sur la question de l’autonomie des universités et de l’effet qu’elle peut avoir sur l’innovation. Dans votre longue carrière qui vous a mené dans au moins quatre à cinq pays avec des environnements institutionnels universitaires différents, avez-vous pu observer ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas dans le monde universitaire pour l’innovation et pour l’éducation ?
Ce qui fonctionne bien pour la production académique, c’est l’autonomie des universités.
Avec un gouvernement qui dicte ce qu’il faut faire, cela ne fonctionne pas.
J’ai fait un certain nombre de travaux, à la fois sur les données américaines et sur les données européennes, montrant qu’il est important de donner de l’autonomie — liberté de choix de chercheurs, de budget et de son allocation — aux universités.
Deuxièmement, il est important d’avoir des gouvernances où d’un côté il y a le Sénat académique composé de professeurs qui décident de la politique au jour le jour, et de l’autre, un Board qui est constitué d’anciens alumni ou d’entrepreneurs. Cette séparation du Board est importante, car il élit le président de l’université. Je ne pense pas que ce soit aux étudiants ou aux professeurs de le faire. Autant il faut que les étudiants puissent évaluer leurs professeurs pour améliorer leurs performances, autant leur rôle n’est pas de choisir la direction.
Je pense qu’avec la structure bicéphale — Board académique d’un côté, Sénat de l’autre — et l’autonomie dont je parlais, il y a plus de chances d’avoir des bons résultats à l’université.
Évidemment, il faut aussi un bon financement.
Dans les universités, comment concilier innovation et frontières technologiques d’une part, et éducation et transmission des savoirs de l’autre ?
Cela dépend.
Certaines universités sont très bonnes en recherche ; d’autres sont meilleures pour l’enseignement.
Il y a ce qu’on appelle des liberal arts colleges par exemple, qui ont davantage développé leur enseignement et d’autres universités qui sont davantage tournées vers la recherche.
C’est aussi une division du travail : l’important est d’avoir l’excellence dans l’un ou dans l’autre.
Je crois en une fiscalité raisonnablement redistributive.
Philippe Aghion
En termes de valorisation des brevets et du travail académique, on sait que les États-Unis sont très désireux d’encourager les innovateurs.
Oui, ils ont les Bureaux de transfert de technologie par exemple — que nous n’avons pas ici.
Est-ce que l’Europe a des choses qui ressemblent — ou bien a-t-elle encore beaucoup de marge de progrès ?
Elle pourrait progresser là-dessus, en ayant plus d’incubateurs et de Bureaux de transfert de technologie. Les LabEx — analysés dans le papier sur les laboratoires d’excellence de mon ami Antonin Bergeaud — ont très bien fonctionné en France.
Ces laboratoires d’excellence ont reçu un financement sur dix ans, avec un jury international, ce qui a stimulé l’innovation de rupture dans les industries technologiques géographiquement situées en France. C’est une expérience très intéressante à généraliser.
Aujourd’hui, l’exemple de la recherche sur l’IA aux États-Unis donne l’impression que l’innovation de rupture se déplacerait hors des universités pour rejoindre le secteur privé, car entraîner les IA est très coûteux et les universités manquent de plus en plus de moyens. Y a-t-il un risque ? Est-ce que certaines innovations se développent mieux dans les universités et d’autres mieux dans le secteur privé ?
Je ne peux pas généraliser, car je pense que les deux types de recherche sont essentiels.
Sans doute la recherche fondamentale, qui nécessite plus de liberté, se fait-elle mieux à l’université. L’université permet la liberté et l’ouverture. L’entreprise permet davantage de concentration des ressources. Or dans les stades préliminaires de la recherche, c’est le premier aspect qui est le plus important. Plus tard dans le processus de recherche, il est au contraire plus important d’avoir davantage de focus. Naturellement, les stades ultérieurs de la recherche sont davantage conduits dans l’entreprise que dans l’université.
Ce sujet sur la distinction entre public et privé nous amène à la question centrale des inégalités. L’innovation encourage la croissance, développe les standards de vie et en même temps, on le sait — on l’a vu dans vos travaux notamment avec Bergeaud et d’autres — accroît probablement les inégalités tout en haut de la distribution. A-t-on trouvé un modèle idéal de redistribution des rentes qui ne décourage ni la croissance, ni l’innovation, mais qui assure quand même une redistribution relativement égalitaire des fruits de la croissance ?
Il faudrait commencer par préciser que l’innovation augmente les inégalités en haut de la distribution des revenus mais qu’elle crée aussi de la mobilité sociale par les entrants.
L’effet de l’innovation sur l’inégalité globale, mesurée par l’indice de Gini, par exemple, s’annule par ces deux effets contradictoires.
D’un côté, l’inégalité augmente en haut — puisque l’innovation procure des rentes. Naturellement, les rentes d’innovation permettent de monter en haut de la distribution des revenus.
De l’autre, la destruction créatrice génère de la mobilité sociale.
C’est précisément cet aspect qui est très intéressant : l’innovation, source d’inégalité, est aussi une source vertueuse de croissance et de mobilité sociale — sans augmenter les inégalités globales. À titre comparatif, le lobbying et les barrières à l’entrée, par exemple, sont une source mauvaise, réduisant la mobilité sociale et la croissance et augmentant non seulement les inégalités en haut de la distribution, mais les inégalités globales.
Il faut donc commencer par prendre conscience que la rente d’innovation est une bonne rente.
Le défi est de s’assurer qu’elle ne soit pas utilisée pour empêcher de nouvelles innovations.
Pour cela, la politique fiscale est utile mais elle n’est pas le seul outil efficace — la politique de concurrence et la politique de financement des campagnes politiques sont aussi cruciales.
Il est important de s’assurer que les riches n’ont pas un pouvoir exorbitant dans la politique. Ces outils sont essentiels dans le monde schumpétérien dans lequel nous vivons.
Je crois en une fiscalité raisonnablement redistributive. Celle qu’on a en France l’est déjà beaucoup, puisque entre le top 10 % et le bottom 10 %, je crois que c’est 18 sur 1 avant impôts et 3 sur 1 après impôts. Nous payons des impôts de succession que les Suédois ne payent plus depuis longtemps. Nous sommes encore un des pays qui taxe le plus le capital ; nous sommes un pays très redistributif.
Je crois à la taxation progressive.
Je pense que c’est l’un des outils importants pour s’assurer que des gens qui deviennent trop puissants n’empêchent pas les nouveaux arrivants d’avoir une chance. Toutefois, il ne faut pas décourager l’outil de travail, ni l’innovation et la croissance des entreprises. Il faut s’assurer que cette croissance est bien utilisée. Dans le cas inverse, si les startups sont encouragées, mais que dès qu’elles grandissent on leur tombe dessus, elles vont partir.
Lorsqu’on regarde la distribution des âges des grandes entreprises aux États-Unis et en France, on constate que certaines entreprises sont, ici, très enracinées.
Oui — et cela n’est pas bon.
Le danger actuel est de manquer la révolution de l’IA.
En appliquant la taxe Zucman — même si j’aime beaucoup Gabriel — la France restera un pays producteur de fromages mais ne gagnera pas la course à l’IA.
J’adore le camembert, le rocamadour je suis fan — mais c’est aussi le meilleur moyen de passer à côté de la révolution de l’IA. C’est absolument sûr.
Certes, mais en regardant qui sont les riches en France, ces rentes ne semblent pas toujours être vertueuses pour l’innovation. Souvent, elles sont plutôt celles d’un capital issu d’un passé lointain.
En effet, c’est la raison pour laquelle il faut encourager l’usage innovant de la richesse.
Certains souhaitent peut-être utiliser leur fortune une fois qu’ils ont beaucoup innové. Mais s’ils savent d’avance que, dès qu’ils deviendront riches, ils seront pénalisés, ils ne joueront même pas.
Il y a toujours cette tension entre l’ex ante et l’ex post : ex post, bien sûr, on peut toujours exproprier — mais cela crée de mauvaises incitations ex ante.
La concurrence économique joue en partie aujourd’hui le rôle que jouait jadis la menace de guerre.
Philippe Aghion
C’est-à-dire, concrètement ?
Prenons un exemple : même dans la recherche ou dans le cinéma, il faut des investisseurs.
Le réalisateur n’est pas dans le top 0.01 % des plus riches, mais le producteur, lui, l’est.
Si l’on taxe trop les producteurs, on les perd — et on perd avec eux les réalisateurs.
C’est toute la difficulté : les très riches financent souvent l’innovation. Aux États-Unis, beaucoup deviennent venture capitalists. J’ai connu quelqu’un qui avait créé une entreprise très prospère. Après son introduction en bourse, il est devenu très riche, puis venture capitalist, finançant de nouvelles start-ups.
Aurait-il fallu l’empêcher de le devenir ? Tout dépend de ce que l’on fait de son argent : s’il sert à soutenir de nouveaux projets, c’est très différent de quelqu’un qui se contente d’acheter des villas et de ne rien faire. C’est là qu’il faut distinguer le bon grain de l’ivraie — mais ce n’est pas simple.
On le voit bien en France, par exemple avec la niche Dutreil : il y a certes des abus, notamment dans les transmissions patrimoniales, mais cette niche reste nécessaire, car elle permet la continuité des entreprises et donc de l’emploi. Il faut donc apprendre à détecter les usages abusifs. C’est la même chose pour les holdings patrimoniales : certains les utilisent pour acheter un chalet ou un avion privé — ce qui est inacceptable — mais d’autres s’en servent pour structurer des investissements productifs.
En fin de compte, tout se joue dans le détail.
Vous soulevez ici un sujet clef : celui de la réallocation du capital. Aux États-Unis, on a l’impression qu’il y a vraiment une fluidité du marché du capital qui permet de réinvestir assez rapidement. En France et en Europe, généralement, on a souvent un capital qui est bloqué dans des véhicules privés ou défiscalisants — ce qui fait que le capital se réalloue très mal. À partir de vos recherches, quels seraient les bons modèles pour encourager cette réallocation du capital ?
Le bon modèle est avant tout d’encourager l’innovation.
L’épargne ne s’investit pas dans l’innovation chez nous parce qu’il n’y a pas de vrai marché unique pour l’innovation. Or comme l’indique Mario Draghi, un marché unique est nécessaire pour obtenir de bonnes rentes d’innovation. L’Europe, avec la pratique du gold plating où chaque pays européen ajoute ses réglementations, ne favorise pas le marché unique.
La deuxième chose, c’est qu’effectivement, le capital risque est sous-développé. On n’a pas d’investisseurs institutionnels comme aux États-Unis — sauf un peu en Suède — et donc pas de véhicules qui drainent l’épargne vers de l’innovation.
Troisièmement, il n’y a pas d’institutions comme la DARPA qui sont des vecteurs de co-investissement public-privé, qui encouragent aussi des gens qui ont de l’épargne privée à investir parce que l’État participe également.
L’idée que l’État a un rôle à jouer dans l’encouragement à l’innovation — tout comme le secteur privé a un rôle dans l’allocation du capital, fonctionnel ou pas — va au-delà des questions qu’on se pose souvent de redistribution, de questions fiscales, de questions de régulation. Cela soulève une question sur la manière de faire émerger un écosystème financier de l’innovation, qui est sans doute ce qui manque beaucoup en Europe.
En Suède, 2,5 % des impôts vont immédiatement alimenter un fonds de pension. C’est intéressant. Ils ont fait plusieurs choses qui ont permis de développer leur écosystème financier plus que les autres.
Certains pays donnent l’impression de réussir à se sortir de ce piège de stagnation quand d’autres n’y arrivent pas — car les incumbents n’ont pas intérêt à redistribuer ou à changer les règles du jeu et les jeunes innovants sont si impuissants qu’ils sortent du système. Est-ce qu’on sait quelque chose de ce qui fonctionne pour débloquer cette économie politique de l’innovation ?
Je pense que la pression extérieure — la concurrence d’autres pays — est ce qui peut pousser à sortir de ce piège.
L’Europe peut se réveiller parce qu’elle sent que les États-Unis et la Chine nous distancent et que nous sommes menacés par Poutine. L’espoir, c’est que les gens prennent conscience de l’ampleur du problème et de la nécessité d’agir.
Dans l’histoire, la concurrence militaire a souvent poussé au changement. La bataille de Sedan a dans une certaine mesure joué un rôle déterminant dans la naissance des lois Ferry — mais il a fallu des guerres terriblement meurtrières.
La concurrence économique joue en partie aujourd’hui le rôle que jouait jadis la menace de guerre.
Il faut donc espérer que la concurrence entre pays nous pousse à dire : « Je ne veux pas être le dernier de la classe, il faut quand même que je sois présent. »
Et la menace militaire, aujourd’hui, joue de nouveau un rôle important ?
C’est évident. Même s’il ne faut pas négliger que peut jouer, que joue déjà, la concurrence économique entre les pays.
Si l’on pense à la Guerre froide entre l’URSS et les États-Unis, cette concurrence entre les pays a clairement joué en faveur de l’innovation.
C’est le seul moment où l’URSS innovait.
Elle n’avait pas du tout un système poussant à l’innovation — sauf dans la défense à cause de la concurrence avec les États-Unis.
Y a-t-il un risque, qu’une Union européenne trop uniformisée annule ces forces de compétition entre pays membres ?
Non : en uniformisant on augmente la concurrence.
Dans un marché unique, on a beaucoup plus de concurrence puisque les réglementations mettent des barrières à l’entrée. Si nous parvenons à un vrai marché unique en Europe, non seulement nous aurons une taille de marché plus grande — mais nous aurons davantage de concurrence. C’est tout l’intérêt du marché unique : faire d’une pierre deux coups.
Ce que Mario Draghi propose dans son rapport, c’est d’avoir à la fois une taille de marché plus grande — et donc un effet de market size — mais également un effet de concurrence dû à l’absence de barrières réglementaires entre les pays.
Une autre différence majeure par rapport aux États-Unis — qu’on voit particulièrement dans le monde académique — c’est que l’Europe a du mal à attirer une immigration qualifiée. C’est vrai dans le secteur de la recherche, mais aussi dans beaucoup d’autres : les ingénieurs, les data scientists…
La transition en Europe de l’Est aurait pu être notre vivier — mais nous avons manqué le coche.
Les États-Unis ont été beaucoup plus proactifs pour donner des visas de travail à des ressortissants d’anciens pays du bloc soviétique. Washington a tout de suite été très volontaire là où nous étions très frileux sur les visas. De nombreux Russes et Polonais talentueux ont émigré aux États-Unis pensant qu’il y a davantage de moyens et de possibilités.
Un exemple récent a frappé la communauté des économistes : Esther Duflo et Abhijit Banerjee sont récemment partis en Suisse. La géographie de cette immigration qualifiée dans le monde scientifique est-elle en train de changer ?
Il faut des politiques qui attirent les bons chercheurs, en donnant de bons salaires et de bonnes conditions.
Les LabEx étaient une bonne initiative.
Une combinaison d’autonomie et de moyens est nécessaire : avec de l’autonomie et sans salaire, on n’attire personne.
Quelles sont à votre sens les grandes thématiques aujourd’hui les plus innovantes dans le domaine économique et les plus susceptibles de générer de nouveaux agendas de recherche à long terme ?
Je n’ai pas la prétention de dire ce qui va se passer ailleurs, car il y a de nombreux sujets dynamiques. De nombreux champs vont s’ouvrir — de l’IA à l’innovation verte.
Le domaine des réseaux par exemple, sur lequel travaille Matthew O. Jackson, peut être appliqué au développement, à la finance, et à bien d’autres champs.
L’économie industrielle est aussi un domaine très important. Blundell continue de faire une microéconométrie formidable — avec d’autres.
L’économie comportementale est également un domaine très dynamique, sur lequel travaillent David Laibson, Roland Bénabou, et d’autres.
Un consultant américain à Boston me disait un jour : « Notre travail, c’est d’accueillir ici des start-ups qui n’arrivent pas à grandir en France ».
Philippe Aghion
Les études sur les inégalités, évidemment, demeurent essentielles — et il faut les poursuivre.
On dit qu’il est de plus en plus difficile d’avoir de nouvelles idées. Mais je pense qu’on voit du nouveau émerger dans chaque domaine pris isolément. En même temps, on vit un reset : de nouveaux domaines s’imposent. Presque d’une manière « romérienne », on trouve tout le temps de nouvelles lignes qui permettent de remettre l’horloge à zéro. Ce n’est pas exactement comme de la division du travail. Sur chaque ligne en particulier, il y a des rendements décroissants d’innovation — mais il y a toujours de nouvelles lignes qui arrivent.
On observe bien cela en économie.
La théorie des contrats et la théorie des jeux ont eu leurs grandes heures — mais plus aujourd’hui. Pour continuer à filer cette métaphore de l’innovation, elles sont en quelque sorte devenues des General-purpose Technologies, utilisées par tout le monde. Elles ont un futur sans qu’elles soient un domaine actif de recherche.
Le flux de bons papiers en économie ne tarit pas.
Au-delà de l’économie, la population vieillit : les travaux de Jesús Fernández-Villaverde sur la baisse de la fécondité sont assez inquiétants 37. Est-ce que ce vieillissement est susceptible, sur le long terme, de mettre fin au moteur de la croissance ?
Deux choses, là-dessus, sont clefs : premièrement, piloter l’immigration. Zéro migration, ce n’est pas tenable. Il nous faut une politique intelligente pour une immigration choisie, avec un système à points ou autrement.
Deuxièmement, nous perdons des Einstein et des Marie Curie. Comme nous l’avons souligné dans notre travail en Finlande avec Akcigit, Hyytinen, et Toivanen 38, ou Xavier Jaravel pour les États-Unis, de nombreux jeunes sont issus de familles dont les parents ne sont pas capables de leur donner le milieu, le savoir et les aspirations nécessaires pour exceller. Je suis convaincu que nous ne savons pas tirer le meilleur des talents que nous avons.
Une politique d’immigration et une politique éducative intelligentes nous aideront à surmonter ce problème en grande partie. Il faudra mener des politiques ambitieuses pour minimiser les déperditions.
Si vous étiez nommé ministre de l’Économie ou Premier ministre — ou, qui sait ? si vous étiez élu Président de la République — et que vous aviez le droit à une seule mesure pour corriger la croissance en France, que feriez-vous ?
Une seule mesure, c’est très difficile ! Généraliser les LabEx et, d’une même mesure, créer une DARPA française — nous sommes très bons dans la défense.
Je pense que son impact peut être important. Évidemment, il faudrait réformer le système éducatif qui est actuellement très déficient chez nous. Cela serait une politique à part entière, pas une simple mesure.
Tout un programme…
Nous devons faire ce que prévoit Mario Draghi, mais au niveau français. Ou avec quelques pays au sein d’une coalition de volontaires.
Deuxièmement, nous devons mettre en place des investisseurs institutionnels pour drainer l’épargne beaucoup plus vers l’innovation.
Troisièmement, il nous faut des DARPA européennes — peut-être seulement avec quelques pays — pour pousser l’innovation verte et la défense.
C’est un agenda passionnant, qui réoriente l’effort vers l’innovation. Mais n’y a-t-il pas un problème d’échelle ? On se félicite d’avoir Mistral : est-ce parce qu’on a abandonné l’idée d’avoir des Meta ou des Nvidia ?
Les investisseurs institutionnels le savent bien : nous avons beaucoup de start-ups elles ne grandissent pas en France.
Un consultant américain à Boston me disait un jour : « Notre travail, c’est d’accueillir ici des start-ups qui n’arrivent pas à grandir en France ».
Or il faut qu’on permette aux start-ups de grandir en France et en Europe.
C’est pourquoi appliquer la taxe Zucman en exonérant uniquement les startups ne fonctionnerait pas non plus : dès qu’elles s’agrandiront, elles voudront s’en aller.
L’article Philippe Aghion, une trajectoire intellectuelle : grand entretien avec le prix Nobel d’Économie 2025 est apparu en premier sur Le Grand Continent.
30.10.2025 à 11:30
Trump-Xi : dans l’ombre de la trêve de Corée, la guerre des infrastructures continue
En Corée du Sud, Trump et Xi Jinping ont mis en scène la fin du conflit.
En coulisse, l'affrontement profond peut désormais se déployer.
Une pièce de doctrine signée Benjamin Bürbaumer.
L’article Trump-Xi : dans l’ombre de la trêve de Corée, la guerre des infrastructures continue est apparu en premier sur Le Grand Continent.
Texte intégral (4426 mots)
L’affrontement entre la Chine et les États-Unis structure le monde. Le Grand Continent radiographie l’affrontement des capitalismes politiques en repartant des textes et des données clefs — pour nous soutenir, découvrez toutes nos offres d’abonnement
Au moment de déclencher sa guerre commerciale, Donald Trump pensait avoir toutes les « cartes » en main pour mener à bien son projet de prédation du monde. Mais le président américain avait sous-estimé la Chine.
Pour comprendre pourquoi, il faut quitter le terrain des droits de douane, qui ne sont que le décor de la tournée actuelle de Trump en Asie.
Éclipsée par la bruyante guerre commerciale, la bataille — plus discrète — pour la maîtrise de l’innovation est en fait le véritable objectif du voyage de l’administration américaine.
Et pour cause : elle déterminera laquelle des deux superpuissances pourra, à l’avenir, s’approprier les bénéfices extraordinaires et le pouvoir politique extraterritorial découlant de la supériorité technologique mondiale.
Loin d’être un simple sujet sectoriel, la guerre des sanctions technologiques entre la Chine et les États-Unis porte sur le contrôle de l’infrastructure numérique de l’économie mondiale.
Cet affrontement pourrait provoquer un renversement durable des rapports de force globaux.
La position stratégique de l’infrastructure numérique
Pour saisir la centralité des technologies de l’information et de la communication dans le monde contemporain, il est instructif de faire un détour par l’histoire de l’innovation.
Elle nous enseigne que pendant cinquante à soixante ans, un type de technologie — la technologie paradigmatique — se démarque des autres en ce qu’il est capable d’impulser des gains de productivité non seulement, de façon étroite, dans son secteur d’origine mais dans toute l’économie. Pendant la majeure partie du XXe siècle, le pétrole et l’automobile ont irrigué l’ensemble du tissu économique.
Cette histoire indique également que l’épuisement du paradigme techno-économique prévalant ouvre la voie à son remplacement par un autre.
Les changements de paradigme produisent ainsi des opportunités exceptionnelles pouvant permettre aux pays technologiquement en retard de réaliser un grand bond en avant. En effet, le développement technologique étant un processus cumulatif, les retardataires courent toujours derrière les pays précurseurs du moment où l’on reste dans le même paradigme ; mais dès qu’un nouveau paradigme émerge, l’avance en compétences et en savoirs, en ingénierie et en équipements associés, cumulée par les précurseurs lors du paradigme précédent, perd largement de sa valeur. La mise en place d’un nouveau paradigme crée donc une situation très rare : les retardataires peuvent alors se propulser à la frontière des connaissances et espérer dépasser les précurseurs historiques.
La montée en puissance de la Chine coïncide avec un tel moment charnière.
À partir des années 1980 s’installe le nouveau paradigme techno-économique incarné par les technologies de l’information et de la communication.
Après avoir attendu en vain que les firmes étrangères partagent leurs avancées dans le nouveau paradigme avec des firmes domestiques, les autorités chinoises changent radicalement de fusil d’épaule au milieu des années 2000.
En 2006 elles mettent en place le plan de développement de technologies domestiques : plutôt que de miser sur la volatilité du marché, elles ciblent explicitement des technologies prioritaires et mettent en œuvre un encadrement public englobant afin d’assurer une montée en puissance rapide.
Le résultat est spectaculaire.
En vingt ans, la Chine est passée de nain à géant technologique. Outre l’identification des conditions sous lesquelles un retardataire peut se hisser à la frontière technologique, la compréhension de l’histoire de l’innovation comme succession de paradigmes techno-économiques permet d’assimiler la technologie paradigmatique à une infrastructure. Dans cette conception, l’infrastructure dépasse le domaine traditionnel — celui des infrastructures physiques comme les antennes et câbles sous-marins qui jouent un rôle important dans la bataille technologique actuelle — pour comprendre également tout dispositif permettant de faciliter de façon centralisée la réalisation de transactions.
Éclipsée par la bruyante guerre commerciale, la bataille — plus discrète — pour la maîtrise de l’innovation est en fait le véritable objectif du voyage de l’administration américaine.
Benjamin Bürbaumer
En associant la technologie paradigmatique à une infrastructure, l’immensité de l’enjeu de la bataille technologique entre la Chine et les États-Unis devient pleinement visible.
En effet, l’offre et la demande ne se rencontrent pas magiquement dans l’économie mondiale. Cette rencontre présuppose l’existence d’infrastructures qui, du fait de leur nature centralisée, sont autant de goulets d’étranglement possibles.
Or, le contrôle de l’infrastructure offre un triple avantage que la Chine dispute actuellement aux États-Unis dans de multiples domaines, dont le numérique. Premièrement, le contrôle de l’infrastructure numérique est source de bénéfices extraordinaires — la littérature scientifique sur les chaînes globales de valeur en atteste largement 39. Deuxièmement, il est gage d’un pouvoir politique extraterritorial — c’est précisément ce que les sanctions technologiques américaines actuelles contre la Chine visent à exploiter. Enfin, le contrôle de l’infrastructure implique une dimension de durabilité : une fois en place, l’infrastructure façonne les transactions pendant des décennies. L’ampleur des profits extraordinaires et du pouvoir extraterritorial se trouve donc multipliée dans le temps.
Ces trois dimensions du contrôle des infrastructures rendent la bataille du numérique triplement importante.
Enfermer la Chine dans une position de retardataire : le logiciel de la stratégie extraterritoriale de Washington
C’est pour cette raison que, malgré leurs divergences, les présidents américains depuis Barack Obama n’ont jamais supprimé les sanctions technologiques contre la Chine de leur prédécesseur : ils les ont toujours radicalisées.
La constance de Washington répond à une logique simple : priver par un levier extraterritorial les firmes chinoises des technologies clefs pour la conception et la fabrication des puces, afin de les condamner à rester cantonnées au statut de fournisseur bas de gamme.
La Silicon Valley occupant le sommet de la chaîne de valeur du numérique, la démarche semblait à la fois efficace et peu risquée : dans le pire des cas, les entreprises du numérique américaines perdraient quelques fournisseurs en Chine qui seraient facilement substituables par des concurrents implantés dans d’autres pays, en raison de la faible complexité de leur activité. La Chine, quant à elle, serait durablement privée des technologies et composants de pointe, pour lesquels il n’y a pas de substitut facilement disponible.
L’une des dernières décisions de l’administration Obama fut la mise en place d’un groupe de travail chargé de défendre la supériorité américaine en matière de semi-conducteurs. Peu après, les premières sanctions furent annoncées contre ZTE, un équipementier en télécoms et l’une des plus grandes entreprises d’État chinoises. Depuis, l’escalade se poursuit : d’autres firmes chinoises rejoignent rapidement la « liste des entités » du Département du Commerce ; s’y trouvent notamment Huawei, qui rejoint la liste en 2019, ainsi que d’autres acteurs majeurs des semi-conducteurs et de l’intelligence artificielle comme SMIC ou YMTC.
Au total, plusieurs centaines d’entreprises sont aujourd’hui concernées par des restrictions d’exportations de matériel, de composants et de procédures reposant sur des brevets américains. Huawei en pâtit doublement : d’une part, elle n’a plus accès à certains brevets indispensables à la conception de ses puces de pointe ; d’autre part, le taïwanais TSMC — auquel elle a sous-traité la fabrication — ne peut plus produire ses produits avancés sans l’équipement et les technologies fournies par les américaines Applied Materials ou Lam Research.
Alors que la liste se rallonge, les restrictions se rigidifient.
Initialement, seule la production de puces de 7 nanomètres (nm) ou moins — les plus performantes — était concernée. Ce périmètre a été élargi aux puces allant jusqu’à 10 nm en 2020, puis à celles d’au plus 16 nm en 2022.
Par ailleurs, le cas de Huawei illustre une autre facette du pouvoir extraterritorial des États-Unis. Ces derniers ne sanctionnent pas seulement l’entreprise de façon directe, mais ils mènent en parallèle une campagne visant à convaincre d’autres États de l’exclure de leur réseau 5G et à empêcher des entreprises non-américaines de vendre de l’équipement au géant chinois. Dans la même optique, la diplomatie américaine a conclu début 2023 un accord avec les Pays-Bas et le Japon — les principaux producteurs de machines de pointe non-américains — bloquant la vente en Chine du nec plus ultra : la technologie de la lithographie extrême ultraviolet, indispensable à une production efficace des puces de pointe.
Fin 2023, cet accord a été étendu à la technologie de la lithographie ultraviolet profond, soit la deuxième meilleure option en termes de machines de haute précision.
Début 2025, Trump en fit davantage en plaçant des dizaines de nouvelles entreprises chinoises sur la liste et en élargissant le périmètre des logiciels interdits à l’exportation en Chine. Cet été, il a encore renchéri en soumettant l’utilisation sur le sol chinois d’outils conçus aux États-Unis, par des entreprises implantées dans les pays tiers comme la taïwanaise TSMC et les sud-coréennes SK Hynix et Samsung, à une autorisation administrative préalable.
À travers cette multiplication des mesures coercitives, combinée à des politiques de soutien au secteur du numérique domestique — la politique industrielle sous Biden, la politique fiscale sous Trump —, un seul fil rouge apparaît : maintenir la Chine dans une position de retardataire.
La nature oligopolistique du secteur numérique — où les géants de la Silicon Valley, de pair avec des sociétés issues de pays alliés des États-Unis, occupent une position dominante dans les segments essentiels des semi-conducteurs 40 — rend crédible une telle stratégie.
L’ambition américaine de superviser le capitalisme global impliquait de pouvoir déterminer le retard que la Chine pouvait conserver par rapport à la frontière technologique.
Benjamin Bürbaumer
Contournement stratégique et matières critiques : la contre-attaque de Pékin
L’escalade américaine a de quoi interpeller.
Si la Silicon Valley règne parfaitement en maître, à quoi bon constamment élargir les sanctions depuis bientôt dix ans ?
C’est que cette extension continue ne traduit pas seulement une agressivité américaine accrue — elle est surtout l’indice de l’existence de failles.
L’ingéniosité chinoise — bien expliquée par Dan Wang dans Breakneck — montre que le barrage technologique est loin d’être étanche.
Parmi les lignes de fuite, on retrouve la contrebande, le marché secondaire des outils et le recours des entités sanctionnées à leurs filiales non-sanctionnées pour acquérir les biens interdits. Dans une veine similaire, le champion chinois de la fabrication SMIC est, dans une certaine mesure, parvenu à remplacer les activités auparavant déléguées à TSMC.
Cette dynamique puise ses forces dans la formation d’agglomérations de travailleurs hautement qualifiés qu’on ne pouvait initialement trouver qu’au Texas, au Sud de la Californie et au Nord-Est des États-Unis.
Cette montée en puissance — qui s’étend jusqu’aux segments les plus complexes de la conception des semi-conducteurs — est le résultat de la planification technologique, qui s’accélère désormais à coups de subventions renforcées pour faire face aux sanctions.
Plus surprenant encore, du moins à première vue, le capital-risque étranger — et en particulier américain — commence à affluer.
Attirés par des gains sans risque, ces financements privés abondent non pas en dépit mais à cause des mesures d’accompagnement anti-sanction prises par les autorités publiques chinoises. Aujourd’hui le volume de ces fonds est près de trois fois supérieur à ce qu’il était en 2016 41.
Pour toutes ces raisons, Pékin parvient à atténuer l’impact des sanctions américaines. Non sans difficultés et coûts importants, elle tente de transformer en atout ce découplage imposé au sommet de la chaîne de valeur numérique.
En parallèle, face à la dégradation des relations économiques avec les États-Unis, Xi Jinping laissait entendre dès 2019 qu’une riposte sous forme de restrictions d’exportation de terres rares et autres matières stratégiques était à l’étude 42. La Chine est en effet de loin le principal exportateur de ces biens.
Ces capacités d’exportation ne viennent pas tant de réserves exceptionnelles que d’une politique volontariste dans le raffinage et la transformation d’une ressource minière domestique et importée.
Calculée à partir des projets d’extraction et de raffinage actuellement en construction dans le monde, l’avance de la Chine devrait encore augmenter d’ici 2040 43.
Exploitant ce goulet d’étranglement, la Chine introduit en 2023 des restrictions d’exportation concernant le gallium et le germanium, deux matières indispensables à la fabrication de semi-conducteurs, dont elle contrôle respectivement 99 % et 74 % du marché mondial, et met en place une interdiction d’exportation vers les États-Unis un an plus tard. Grâce à sa spécialisation dans les matières stratégiques, Pékin a acquis une position de précurseur dans les technologies d’extraction et de traitement des terres rares. Politisant cette capacité, la République populaire pratique également une interdiction d’exportation de ses connaissances depuis décembre 2023.
Face à l’escalade des droits de douane provoquée par Donald Trump, la Chine introduit des restrictions d’exportation d’autres matières stratégiques comme le tungstène et réagit au Liberation Day avec l’ajout de sept terres rares à la liste des matériaux dont la sortie du territoire national fait l’objet de contrôles administratifs.
Le 9 octobre, elle annonce son intention d’ajouter cinq autres éléments de terres rares à sa liste de restrictions — ce qui impliquerait des contrôles d’exportation sur 12 des 17 terres rares.
Cette dernière annonce intervient juste avant la rencontre entre Donald Trump et Xi Jinping en Corée du Sud.
Pékin sait parfaitement que les restrictions d’exportation de matières stratégiques sont le meilleur levier dont elle dispose dans la guerre commerciale lancée par Washington.
Pendant les négociations commerciales entre les deux puissances à Londres au mois de juin 2025, la Maison-Blanche a même signalé sa disposition à alléger les sanctions technologiques en échange d’une hausse des exportations chinoises de terres rares 44. Ce compromis n’a pas vu le jour. Au contraire, le secrétaire américain au Commerce Howard Lutnick a jeté de l’huile sur le feu en indiquant à la presse, à propos des semi-conducteurs américains autorisés à l’exportation en Chine : « Nous ne leur vendons pas nos meilleurs produits, ni nos deuxièmes meilleurs produits, ni même nos troisièmes meilleurs produits. » 45
Se sentant « insultée », Pékin a réagi en interdisant aux entreprises chinoises du secteur des nouvelles technologies d’acheter des puces Nvidia.
Face à l’ampleur grandissante de ce blocage, les États-Unis tentent de capter d’autres sources de matières stratégiques.
D’une part, les velléités sur le Groenland et l’Ukraine sont fortement motivées par l’accès aux ressources.
D’autre part, Washington a lancé un vaste programme d’investissements censé ouvrir des voies d’approvisionnement non-chinoises.
Après un accord récent de plusieurs milliards avec l’Australie, Trump a profité de sa tournée asiatique pour en signer d’autres portant sur l’exploitation de terres rares avec le Japon, la Malaisie, la Thaïlande, le Vietnam et le Cambodge. En complément, l’État fédéral prend des parts dans des firmes minières et met en place un dispositif de stockage de minéraux stratégiques ainsi qu’un système de prix planchers pour rattraper le retard sur le secteur extractif chinois.
Parmi ces nombreuses initiatives de part et d’autre, aucune ne pointe vers un apaisement conséquent : le contrôle de l’infrastructure numérique mondiale ne se partage pas.
L’ambition contre-hégémonique chinoise implique de mobiliser tous les leviers de sa puissance — de la planification technologique au contrôle des ressources stratégiques.
Benjamin Bürbaumer
L’introuvable désescalade mondiale — et l’introuvable stratégie européenne
Si les États-Unis et la Chine ont été capables — jusqu’ici — d’éviter un déchaînement incontrôlé de la guerre commerciale, force est de constater que la bataille technologique ne cesse de s’intensifier.
Tout en actant le statu quo sur le front tarifaire, Trump a profité de son voyage en Asie pour tenter d’améliorer la position des États-Unis sur le front technologique — et même si Xi Jinping, à l’issue de sa rencontre avec Trump, renonçait à ajouter immédiatement les cinq terres rares annoncées le 9 octobre à sa liste de restrictions, la tendance conflictuelle ne serait pas inversée, mais simplement ralentie.
Car derrière le prétexte du commerce, la guerre pour le contrôle de l’infrastructure numérique mondiale est le vrai sujet de cette rencontre.
Et sur ce front, cette dernière ne produira rien.
Il ne s’agit plus simplement de transformer la circulation des marchandises mais de contrôler durablement les capacités de production en tant que telles — ainsi que les profits et le pouvoir associés.
L’ambition américaine de superviser le capitalisme global impliquait de pouvoir déterminer le retard que la Chine pouvait conserver par rapport à la frontière technologique.
L’ambition contre-hégémonique chinoise implique de mobiliser tous les leviers de sa puissance — de la planification technologique au contrôle des ressources stratégiques.
Dans le bras de fer technologique entre les deux superpuissances, les pays européens risquent de finir écrasés.
Si relativement peu d’entreprises européennes importent directement des matières stratégiques fournies par des exportateurs chinois, elles en importent beaucoup indirectement — en achetant aux géants de la tech américains 46.
Derrière la bataille sino-américaine, un autre contraste encore plus saisissant apparaît en filigrane — qui devrait nous alerter.
D’un côté, la Chine et les États-Unis déploient une panoplie de mesures stratégiques et occupent respectivement la place de leader mondial de l’extraction et de leader des technologies numériques.
De l’autre côté, les pays européens sont dépourvus de capacités d’intervention stratégiques et n’ont pas la puissance capitalistique suffisante pour agir.
C’est de ce blocage — vertigineux — qu’il faut partir pour bâtir une stratégie.
L’article Trump-Xi : dans l’ombre de la trêve de Corée, la guerre des infrastructures continue est apparu en premier sur Le Grand Continent.
24.10.2025 à 19:24
Le Fédéralisme pragmatique
Dans un monde qui se transforme radicalement, l’Europe est à l’arrêt.
Mario Draghi articule un concept pour provoquer le changement, un programme pour débloquer l’Union : le Fédéralisme pragmatique.
L’article Le Fédéralisme pragmatique est apparu en premier sur Le Grand Continent.
Texte intégral (1114 mots)
Ma carrière dans la fonction publique italienne avait débuté par les négociations du traité de Maastricht 47. Depuis, la construction de l’Europe a été au cœur de toutes mes missions, tant sur le plan national — à la tête du Trésor italien puis en tant que président du Conseil — que sur le plan européen à la tête de la Banque centrale européenne.
Or aujourd’hui, les perspectives pour l’Europe n’ont jamais été, d’aussi loin qu’il m’en souvienne, aussi difficiles. Presque tous les principes sur lesquels repose l’Union sont remis en cause.
Nous avions bâti notre prospérité sur l’ouverture et le multilatéralisme — nous sommes aujourd’hui confrontés au protectionnisme et aux actions unilatérales.
Nous avions cru que la diplomatie pouvait être le fondement de notre sécurité — nous assistons aujourd’hui au retour de la puissance militaire comme moyen d’affirmer ses intérêts.
Nous avions promis de montrer la voie en matière de responsabilité climatique — aujourd’hui, les autres se retirent et nous laissent supporter des coûts croissants.
Le monde qui nous entoure a radicalement changé. Et l’Europe peine à réagir.
Cela soulève une question cruciale : pourquoi ne parvenons-nous pas à changer ?
On nous dit souvent que l’Europe se forge dans les crises. Mais quel niveau de gravité doit atteindre une crise pour que nos dirigeants unissent enfin leurs forces et trouvent la volonté politique d’agir ?
Après la grande crise financière et la crise de la dette souveraine, la BCE, grâce notamment à son mandat européen, a évolué vers une institution plus fédérale ; l’union bancaire a également été lancée.
Mais depuis lors, nos défis sont devenus de plus en plus complexes et nécessitent désormais une action commune de la part des États membres.
Ils concernent des domaines tels que la défense, la sécurité énergétique et les technologies de pointe, qui nécessitent une échelle continentale et des investissements partagés.
Et dans certains de ces domaines, notamment la défense et la politique étrangère, un degré plus élevé de légitimité démocratique est nécessaire.
Or depuis de nombreuses années, notre gouvernance n’a pas bougé.
Aujourd’hui, notre confédération européenne n’est tout simplement pas en mesure de répondre à ces besoins.
L’échelle nationale ne suffit plus pour gérer efficacement les défis immenses auxquels nous sommes confrontés. Et même si nous voulions transférer davantage de pouvoirs à l’Europe, ce modèle ne nous offre pas la légitimité démocratique pour le faire.
Ce qui nous arrête n’est pas une contrainte d’ordre juridique liée aux traités.
La contrainte la plus profonde est que, face à ce nouveau monde, nous n’avons pas construit de mandat commun — approuvé par les citoyens — pour ce que nous, Européens, voulons vraiment faire ensemble.
C’est pourquoi l’avenir de l’Europe doit être une voie vers le fédéralisme.
Cela ne tient pas du rêve mais de la nécessité.
Or, aussi souhaitable qu’une véritable fédération puisse être, elle nécessiterait des conditions politiques qui ne sont pas réunies aujourd’hui. Et les défis auxquels nous sommes confrontés sont trop urgents pour attendre qu’elles se présentent.
Le seul chemin possible est celui d’un nouveau fédéralisme pragmatique.
Un fédéralisme basé sur certains domaines clefs, flexible et capable de se projeter et d’agir en dehors des mécanismes plus lents du processus décisionnel de l’Union.
Il serait construit à partir de « coalitions de volontaires » autour d’intérêts stratégiques communs, en reconnaissant que les différentes forces de l’Europe n’exigent pas que tous les pays avancent au même rythme.
Imaginez.
Des pays dotés de secteurs technologiques forts qui s’accordent sur un régime commun permettant à leurs entreprises de se développer rapidement.
Des nations dotées d’industries de défense avancées qui unissent leurs efforts en matière de recherche et développement et financent des marchés publics communs.
Des leaders industriels qui co-investissent dans des secteurs critiques tels que les semi-conducteurs ou dans des infrastructures de réseau qui réduisent les coûts énergétiques.
Ce fédéralisme pragmatique permettrait à ceux qui ont les ambitions les plus grandes d’agir avec la rapidité, l’ampleur et l’intensité des autres puissances mondiales.
Il pourrait par ailleurs contribuer à renouveler l’élan démocratique de l’Europe elle-même.
En effet, l’adhésion exigerait des gouvernements nationaux qu’ils obtiennent un soutien démocratique pour des objectifs communs spécifiques, suscitant ainsi la construction ascendante d’un objectif commun — et non une imposition descendante.
Tous ceux qui souhaitent adhérer pourraient le faire, tandis que ceux qui cherchent à bloquer les progrès ne pourraient plus retenir les autres.
En bref, cela offre une vision pleine de confiance de l’Europe, une vision à laquelle les citoyens peuvent croire.
Une Europe dans laquelle les jeunes voient leur avenir. Une Europe qui refuse d’être piétinée. Une Europe qui agit non par crainte du déclin, mais par fierté de ce qu’elle peut encore accomplir.
C’est la vision que nous devons proposer si nous voulons que l’Europe se renouvelle.
Et je suis convaincu que nous pouvons y parvenir.
L’article Le Fédéralisme pragmatique est apparu en premier sur Le Grand Continent.
23.10.2025 à 18:00
Trump a vassalisé le FMI : coulisses des rencontres de Washington
Une révolution invisible est en cours au cœur des institutions de la finance mondiale.
Depuis plusieurs mois, l’administration de Donald Trump a fait du Fonds monétaire international une arme à son service.
De l’engouement pour les cryptos au front anti-Chine en passant par le sauvetage de l’Argentine, plongée au cœur d’une transformation radicale qui devrait nous alerter.
L’article Trump a vassalisé le FMI : coulisses des rencontres de Washington est apparu en premier sur Le Grand Continent.
Texte intégral (5945 mots)
À Washington, sous les murs épais d’administration d’ordinaire silencieuse, il est en train de se passer quelque chose. Pour comprendre comment s’organise la contre-révolution trumpiste au sein des élites américaines, découvrez l’ensemble de nos publications en vous abonnant à la revue
La semaine dernière se tenaient à Washington les réunions annuelles du FMI. Le moment ne pouvait être mieux choisi pour saisir certaines des tendances sous-jacentes de l’économie mondiale — et les tensions qui secouent les institutions chargées de la coopération internationale en matière de politique économique.
La caractéristique la plus frappante des réunions qui s’achèvent est l’alignement complet du FMI sur l’administration américaine et son programme. C’est une antienne de la gauche radicale que de considérer que le FMI est un instrument de l’impérialisme américain alors que, pendant longtemps, il a été en réalité piloté par les Européens — d’abord formellement pas un directeur du Fonds toujours Américain (en échange de quoi les États-Unis héritait de la Présidence de la Banque Mondiale) et ensuite informellement par le truchement d’alliances bien choisies au sein de son Conseil d’administration qui permettaient de limiter l’influence américaine malgré son veto de fait.
Ce qui se passe depuis l’arrivée de l’administration Trump est d’un autre ordre, notamment car l’institution a été terrifiée que les États-Unis menacent d’en sortir. Cette peur panique de l’abandon provoque un assujettissement historique.
C’est là une corruption morale qui saute aux yeux dès qu’on y prête attention.
Le lieu où elles se sont ouvertes était déjà symptomatique : le Milken Institute. Il porte le nom de son créateur, Mike Milken — d’ailleurs présent sur place pour le lancement des réunions annuelles 48.
En 2025, le grand public a quelque peu oublié qui est Milken. « Légende » de Wall Street qui aurait inspiré à Oliver Stone le personnage de Gordon Gekko, il est surtout l’inventeur des junk bonds, ces « obligations pourries » ayant en partie conduit au krach boursier de 1987. Condamné dans une affaire de délit d’initié, le milliardaire avait été gracié par Donald Trump en 2020. Son retour en majesté cette année par la grâce du FMI donnait le ton.
Du programme d’aide financière à l’Argentine à la confiance aveugle dans les cryptomonnaies et les stablecoins comme avenir de la finance — à un degré qui a surpris même leurs plus fervents adeptes 49 —, l’alignement systématique sur l’agenda MAGA avait une dimension presque suffocante.
Au-delà de cette atmosphère accablante, quelques points concrets sont à retenir.
Un fossé transatlantique grandissant : les cryptomonnaies, les stablecoins et l’avenir de la finance
L’essor des stablecoins et des cryptomonnaies — et leurs conséquences pour le système monétaire international — fut peut-être le sujet de discussion le plus marquant à Washington pendant ces réunions annuelles.
Il n’a pourtant été mentionné qu’en passant dans ses principales publications 50 : on ne trouve dans aucune d’entre elles de référence au GENIUS Act — peut-être la loi américaine la plus importante pour l’avenir de la finance américaine et mondiale. Ce silence est assez remarquable 51.
Il en résulte un double clivage évident : un premier fossé sépare ceux qui considèrent que les systèmes de paiement sont essentiellement des biens publics qui devraient être largement publics — essentiellement la Chine et l’Europe — des autres pays ; un deuxième sépare ceux qui estiment que l’argent et les actifs ne sont pas la même chose et que l’argent devrait rester public : de nouveau, cette préférence singularise en particulier la Chine et l’Europe.
Il y a six mois, l’image marquante des réunions de printemps était celle de la directrice générale Kristalina Georgieva arborant fièrement le pin’s en forme de tronçonneuse que lui avait remis le ministre argentin des Finances de Javier Milei, Federico Sturzenegger.
L’image que l’on retiendra des rencontres de cette année est plutôt celle de la directrice générale prêchant la bonne parole sur les cryptomonnaies et les stablecoins sur la scène principale du FMI, lors d’une table ronde sur l’avenir de la finance 52 avec à ses côtés le puissant président et fondateur de Circle, Jeremy Allaire. Celui-ci n’a jamais reçu la moindre remarque critique concernant, par exemple, les risques de convertibilité des stablecoins ou les problèmes qu’ils posent pour la lutte contre le blanchiment d’argent.
Circle réussit là une opération de relations publiques de premier ordre. L’entreprise était également sponsor premium de la conférence principale de l’Institut de finance internationale à Washington, et un pilier des réunions.
La présence à la table ronde de Jeremy Allaire et la discussion qui s’en est suivie a déconcerté de nombreux banquiers et banquiers centraux européens — qui ont fait part, en coulisse, de leur incrédulité.
Heureusement, d’autres ont fait le travail de critique qui s’imposait.
Le G30, sous la direction de Ken Rogoff, a produit un rapport remarquable sur le passé et l’avenir de la monnaie 53 ; celui-ci offrait des mises en garde précises sur les stablecoins, tout en encourageant à poursuivre le développement des monnaies numériques des banques centrales — ce que l’administration américaine refuse. Avec des arguments similaires, Jean Tirole a lancé un avertissement sévère dans les pages de The Economist 54. La Banque des règlements internationaux a également fait un travail particulièrement remarquable sur la question 55, tirant elle aussi la sonnette d’alarme sur les risques pour la stabilité financière des stablecoins.
C’est là une éventualité dont on aurait pu penser qu’elle inquiéterait le FMI ; mais ce qui apparaît de plus en plus clairement, c’est que le Fonds — ou du moins ses dirigeants — est devenu captif des préférences et du discours politiques des États-Unis.
La réunion du groupe Euro50 à Washington a clairement mis en évidence le fossé transatlantique croissant sur cette question, le gouverneur de la Banque d’Espagne Pablo Hernandez de Cos et le membre du directoire de la BCE Piero Cipollone s’opposant aux stablecoins en Europe, sans toutefois proposer d’alternatives significatives.
Mais les Européens manquent de cohérence. Ils n’assument pas leur désir de limiter sérieusement l’expansion des formes de monnaie émises par le secteur privé en Europe, de peur d’être perçus comme hostiles à l’innovation ; ils sont également réticents à donner à l’euro numérique le rôle dont il aurait besoin pour remplacer les stablecoins et devenir une véritable infrastructure publique et souveraine de paiement de gros et de détail.
En effet, les banques européennes, préoccupées par l’érosion de leur base de dépôts, continuent de faire pression en faveur d’une limite de détention très basse pour les portefeuilles numériques en euros, ce qui limitera sans aucun doute leur capacité à servir de véritable moyen de paiement et de réserve de valeur.
La BCE se trouve donc prise entre le marteau et l’enclume.
Les législateurs européens doivent clarifier l’importance qu’ils veulent accorder à l’euro numérique ainsi que leur volonté de disposer d’un système de paiement pleinement souverain.
L’absence du FMI lors de ces discussions cruciales a été remarquée ; celui-ci craignait de s’aliéner l’administration américaine et ses thuriféraires de la cryptomonnaie. Même la Réserve fédérale, malgré l’immense pression à laquelle elle est soumise, a mieux réussi à mettre en évidence les risques et les dangers du GENIUS Act et de l’expansion des stablecoins — grâce à un discours remarquable prononcé par le gouverneur Michael Barr à Washington lors de la semaine de la fintech 56.
Le FMI est devenu captif des préférences et du discours politiques des États-Unis.
Shahin Vallée
Les déséquilibres mondiaux et la guerre commerciale sino-américaine
Dans notre bilan des réunions des réunions de printemps, nous avions exposé comment la mention des déséquilibres mondiaux avait complètement disparu des rapports du FMI sur les perspectives économiques mondiales ainsi que des déclarations du G20 et du G7.
Cela est en train de changer lentement.
La France a ainsi décidé de placer cette question au premier rang de ses priorités pour sa présidence du G7 l’année prochaine.
Les États-Unis viennent aussi de publier discrètement leurs priorités pour le G20 : la première dont ils font mention touche aux déséquilibres mondiaux — suivis par la croissance de la productivité, l’approvisionnement en énergie, la restructuration de la dette, les matières premières critiques et la gestion de la chaîne d’approvisionnement.
Le FMI n’en parle pas beaucoup plus dans ses dernières perspectives sur l’économie mondiale 57, mais il a publié un rapport sur la question en juillet 2025 58. Si cet exercice a été utile pour mettre en évidence l’évolution des déséquilibres mondiaux et la contribution des politiques nationales de chaque grande économie à ce problème, il n’offre aucune voie politique crédible pour l’avenir et continue de brouiller le débat sur les taux de change. Tout son deuxième chapitre est ainsi une discussion décevante sur le système monétaire international et l’expansion du yuan qui ne mentionne jamais les dévaluations compétitives, ni la façon dont la politique chinoise, et par extension asiatique, en matière de change peut être une source de déséquilibres mondiaux…
Face à une telle apathie du FMI, le risque est réel que les États-Unis tentent de transformer le G7 en un instrument permettant d’intensifier la pression sur la Chine en matière de taux de change et de chaînes d’approvisionnement. Washington a déjà convoqué des réunions d’urgence du G7 pour faire pression sur ses alliés européens et japonais, afin qu’ils renforcent la pression sur le commerce des combustibles fossiles russes par le biais de droits de douane ou de sanctions secondaires.
La pression pourrait bien s’étendre au-delà de la Russie ; les États-Unis pourraient tenter de transformer le G7 en une sorte de club des matières premières critiques, aligné contre la Chine.
Le grand défi pour Washington sera alors d’expliquer à ses pairs du G7 — que la Maison-Blanche vient de passer les six derniers mois à essayer d’intimider — pourquoi ils devraient s’attendre à ce qu’un tel alignement ait des effets positifs. Il faudrait ainsi les convaincre qu’il ne s’agit pas d’un autre accord où ils pourraient ne rien obtenir des États-Unis. Washington dispose peut-être encore d’une influence morale suffisante pour contraindre ses « alliés » à prendre une telle mesure désespérée.
Les réunions annuelles du FMI montrent que la présidence française du G7 devra travailler dur pour éviter que son leadership ne soit détourné au profit d’un agenda entièrement anti-chinois.
À cet effet, le président Macron et le chancelier Merz seraient bien avisés de coordonner leurs voyages à Pékin afin d’éviter que l’échec du sommet Union-Chine de juillet 2025 ne ternisse durablement les relations entre l’Union et la Chine.
Il s’agit probablement du défi multilatéral le plus important de l’année à venir, et l’Europe peut tenter de tracer une voie qui s’éloigne quelque peu de l’obsession actuelle de Washington pour la guerre commerciale.
Un tel projet nécessite une voix européenne plus affirmée que celle qui s’est faite entendre jusqu’à présent — tant du côté de la Commission européenne que des dirigeants des États de l’Union. Le FMI pourrait aussi profiter des présidences américaine et française du G20 et du G7 pour sortir de l’ombre — et de son silence embarrassant.
Quoi qu’il en soit, le Fonds ne pourra pas se cacher trop longtemps : il doit en effet publier d’ici la fin de l’année une « Consultation au titre de l’article IV » 59 pour la Chine et les États-Unis. Ce sera un autre test important pour voir dans quelle mesure l’institution se bat pour rester pertinente et est prête à formuler certaines vérités désagréables à ses principaux actionnaires.
Un nouveau tournant dans la guerre commerciale avec la Chine ?
La question clef est désormais de savoir s’il peut y avoir une discussion sérieuse sur les déséquilibres mondiaux qui ne rejoue pas, sous une forme détournée, la rivalité commerciale et géopolitique actuelle entre les États-Unis et la Chine.
Les dernières semaines suggèrent en effet que nous sommes entrés dans un nouveau chapitre de ce conflit.
En effet, alors que Pékin tente de mettre en place pour les terres rares le type de contrôle des exportations extraterritoriales que Washington a exploité pendant des années, l’administration américaine manque de prise : elle se retrouve à devoir reprocher à la Chine de faire ce que les États-Unis lui font depuis des années.
Après avoir réagi de manière impulsive en menaçant d’imposer des droits de douane de 100 % sur les produits chinois à partir du 1er novembre 2025, le secrétaire au Trésor Scott Bessent tentera d’apaiser quelque peu les tensions cette semaine lorsqu’il rencontrera son homologue, le vice-Premier ministre He Lifeng. Il semble pourtant difficile d’imaginer que la Chine renonce à son désir et à sa capacité d’arsenaliser son contrôle total sur les chaînes d’approvisionnement en terres rares.
La dépendance systémique des États-Unis vis-à-vis des importations chinoises de terres rares et d’aimants est une source fondamentale de vulnérabilité qui ne peut être corrigée rapidement. Le Pentagone travaille sans relâche à la constitution d’un stock de minéraux stratégiques pour l’industrie de la défense, mais ce projet prendra des années à se concrétiser. La dernière vente de cobalt a dû être annulée 60 et les États-Unis ont peu progressé vers un semblant d’autonomie pour garantir l’approvisionnement en matériaux essentiels — non seulement pour l’industrie de la défense, mais aussi pour la course à l’armement dans le domaine de l’électronique et des semi-conducteurs.
Les États-Unis réalisent désormais qu’ils ne peuvent pas affronter la Chine seuls ; ils feront tout leur possible pour présenter un front mondial uni contre celle-ci. Ce sujet est susceptible d’être abordé lors du G7, mais la question clef pour l’Europe, le Japon, le Canada et d’autres pays sera la suivante : qu’ont-ils à y gagner ?
S’il est certes inconfortable de dépendre entièrement des caprices de la Chine pour l’approvisionnement en matières premières essentielles, les « alliés » ont constaté ces derniers mois qu’il n’était pas mieux de dépendre de manière critique des États-Unis. L’administration américaine actuelle semble incapable de proposer un accord raisonnable sur les matières premières critiques, mais elle continue de croire que la force brute et la coercition pourraient suffire.
Les réunions annuelles du FMI montrent que la présidence française du G7 devra travailler dur pour éviter que son leadership ne soit détourné au profit d’un agenda entièrement anti-chinois.
Shahin Vallée
Pourquoi l’Argentine est-elle si importante pour le Trésor américain ?
Au printemps, nous expliquions comment le FMI et son conseil d’administration s’étaient compromis en acceptant un nouveau programme du Fonds pour l’Argentine, à la seule initiative de l’administration américaine et malgré les profondes réserves du personnel et d’un certain nombre de membres du conseil d’administration du FMI.
L’urgence était alors d’assurer la participation des États-Unis aux institutions de Bretton Woods à un moment où l’on craignait grandement à Washington leur départ. Celui-ci aurait fondamentalement remis en cause la légitimité et l’avenir de ces organisations.
Il est désormais clair non seulement que les États-Unis ne quitteront pas le FMI, mais qu’ils utiliseront et abuseront de leur position dominante au sein de l’institution pour poursuivre leurs intérêts géopolitiques. La nomination de Dan Katz 61, proche conseiller de Scott Bessent, au poste de premier directeur général adjoint, en est un exemple frappant. Sa volonté d’isoler et d’exclure la Chine du FMI mettra l’institution en conflit avec le reste des membres et soulèvera des questions fondamentales pour l’Europe et les principaux pays émergents.
L’Argentine est le premier test lors de cette montée croissante et inévitable des tensions.
Il était frappant d’entendre Scott Bessent annoncer le 23 septembre que le Trésor américain allait prolonger une ligne de swap de 20 milliards de dollars — soit la quasi-totalité des ressources immédiatement disponibles du Fonds de stabilisation des échanges —, et encore plus frappant de l’entendre dire : « le succès de l’Argentine revêt une importance systémique, et une Argentine forte et stable qui contribue à ancrer la prospérité de l’hémisphère occidental est dans l’intérêt stratégique des États-Unis. »
L’Argentine n’est pas, sur le plan économique et financier, d’une importance systémique pour les États-Unis, mais c’est le seul pays d’Amérique latine où les États-Unis peuvent essayer d’écarter la Chine. Ironiquement, la moitié des réserves de la Banque centrale argentine sont en fait un swap de la Banque populaire de Chine — ce qui suggère que le Fonds de stabilisation pourrait un jour être remboursé en yuans.
Plus important encore, le président argentin Javier Milei est devenu un allié idéologique essentiel du dispositif trumpiste.
Une défaite en Argentine serait non seulement une défaite stratégique contre la Chine en Amérique du Sud, mais surtout un camouflet qui pourrait nuire à la crédibilité générale de l’équipe de politique économique américaine. Pour Washington, le succès de Buenos Aires ne revêt une importance systémique qu’en ce sens.
Les États-Unis s’engagent de manière inquiétante dans une voie politique vouée à l’échec, parce que le taux de change est surévalué et que les Argentins ne croient pas que le régime de change actuel soit viable, ni la fourchette dans laquelle le taux de change est présentement maintenu — le personnel du FMI n’en est pas davantage convaincu. Les interventions limitées du Trésor américain pourraient alors s’avérer inutiles et s’amenuiser rapidement après les élections législatives argentines du 26 octobre 2025.
Il est désormais évident pour tout le monde que l’administration américaine retarde tout décaissement pour ne rien faire avant les élections ; elle intensifie plutôt ses pressions, avec des rendements en baisse spectaculaire, et utilise des achats de pesos par la Fed — agissant au nom du Trésor — en attendant de voir le résultat des législatives.
Si Milei perd, il est très probable que cette ligne de crédit ait la vie courte. Le soutien de Trump s’affaiblira et le Trésor américain se retirera ; ce dernier aura alors perdu une petite somme sur ses récentes interventions sur le marché des changes et beaucoup de crédibilité.
Si les élections tournent à l’avantage de Milei et s’il parvient à tirer parti de la ligne de swap, il n’est pas certain que cela suffise à stabiliser la situation désastreuse du pays. C’est pour cette raison que le Trésor américain a évoqué un autre prêt de 20 milliards qui pourrait être structuré par le secteur privé.
Il y a toutefois de fortes raisons de penser que ce prêt ne verra pas le jour.
Le Trésor se retrouvera alors face à une série de mauvaises options :
- Forcer la Réserve fédérale à s’impliquer en faisant pression sur elle pour qu’elle accepte une ligne de swap bilatérale avec la Banque centrale d’Argentine. Cela semble peu probable, mais il convient de noter que ce ne serait pas tout à fait sans précédent : en 2008, la Réserve fédérale a en effet mis en place des lignes de swap de liquidités en dollars avec des économies émergentes comme le Brésil, le Mexique, Singapour et la Corée du Sud, afin d’alléger les pressions sur le financement offshore en dollars. Le choix des pays était là aussi largement politique ; seuls Singapour et la Corée du Sud ont utilisé cette ligne.
- Forcer le FMI à accorder encore davantage de financement anticipé à l’Argentine, même si cela n’est pas conforme au programme du Fonds. Un tel choix donnerait lieu à une grande bataille au sein du Conseil d’administration, mais la directrice générale du FMI a déjà cédé et exprimé un soutien si fort qu’il lui sera désormais difficile de faire marche arrière. Reste à voir si l’ensemble des membres céderont aussi facilement et compromettront durablement les règles de prêt et d’accès exceptionnel, élaborées avec soin au fil des ans.
- Enfin, les États-Unis pourraient décider de limiter leurs pertes et de passer à autre chose, d’accepter une forte dévaluation du peso, d’assumer le coût financier des récentes interventions et d’apporter leur soutien à un taux de change plus bas et plus viable. Ce serait une politique judicieuse, mais elle causerait des dommages à l’Argentine et, surtout, au Trésor américain. Cependant, lorsqu’une transaction tourne mal, il vaut mieux accepter rapidement ses pertes et passer à autre chose.
Au total, il est assez frappant que le secrétaire au Trésor américain mette en jeu une grande partie de sa crédibilité personnelle, qu’il a acquise à grand-peine au cours des derniers mois, sur une question aussi insignifiante sur le plan stratégique.
Les conséquences d’un échec pourraient être assez dramatiques pour les Américains dans d’autres négociations qui exigent crédibilité, force et sang-froid.
L’article Trump a vassalisé le FMI : coulisses des rencontres de Washington est apparu en premier sur Le Grand Continent.
23.10.2025 à 06:00
Les stablecoins sont-ils en train de détruire la Banque centrale européenne ?
Faut-il avoir peur des stablecoins ?
Selon la BCE, ils feraient peser des risques existentiels sur la stabilité financière et la souveraineté de l’Union.
Ces nouvelles cryptomonnaies « stables » menacent-elles les portefeuilles des Européens ?
Une étude signée Hubert de Vauplane.
L’article Les stablecoins sont-ils en train de détruire la Banque centrale européenne ? est apparu en premier sur Le Grand Continent.
Texte intégral (9440 mots)
Du gouverneur de la Banque de France à Mario Draghi, la géopolitique ne peut faire l’économie de la monnaie. Pour trouver les bonnes analyses et soutenir une rédaction dynamique en plein développement, abonnez-vous au Grand Continent
Ignorés jusqu’à récemment du public mais aussi des banquiers et des banquiers centraux, les stablecoins sont devenus un sujet d’étude d’une vaste ampleur, que ce soit sous l’angle économique, monétaire ou politique 62.
Les travaux les concernant soulignent tous le rôle majeur de ces nouveaux actifs monétaires comme outil de géopolitique pour de nombreux pays, mais aussi de financement de la dette pour les États-Unis ; ils pointent bien sûr les risques que ces instruments pourraient faire courir à l’économie mondiale.
Ce constat est particulièrement flagrant en ce qui concerne les très nombreux rapports, études et autres documents publiés par la Banque centrale européenne (BCE) qui, depuis qu’elle s’intéresse à ce phénomène, considère que les stablecoins constituent une menace pour la souveraineté monétaire, la stabilité financière et plus largement pour l’économie mondiale 63.
L’attention de la BCE et des autres banques centrales porte pour l’essentiel sur les stablecoins de détail — c’est-à-dire ceux utilisés pour les opérations de paiement courantes — et non les stablecoins dits de gros, utilisés sur les marchés financiers mais surtout sur les plateformes de crypto-actifs 64.
Dans la continuité de cette approche, nous ne traiterons donc ici que des « stablecoins de détail ».
Les interrogations de la BCE sont légitimes compte tenu de son rôle et de ses missions : il est de son devoir de mesurer les impacts potentiels d’une nouvelle technologie liés aux paiements et à la monnaie sur le système monétaire européen, dont elle assure la supervision au titre de la mission confiée par l’article 127 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
La concurrence aux banques centrales
Les questionnements parfois critiques de la BCE sont ceux que la plupart des autres banques centrales et organisations internationales 65 formulent aussi, à l’exception notable toutefois de la Réserve fédérale des États-Unis qui, il est vrai, se trouve dans une position différente du fait du rôle quasi exclusif du dollar comme actif sous-jacent de plus de 99 % des stablecoins émis et circulant dans le monde.
Parmi ces réserves des banques centrales, sont pointés du doigt à la fois les risques sur la souveraineté monétaire — du fait que les émetteurs de stablecoins sont des entreprises privées et non une banque centrale — et le risque macroéconomique lié à la détention de ces stablecoins par les agents économiques, en cas de « ruée vers les guichets » (bank run) quand un émetteur de stablecoins se trouve en situation financière fragile, voire en faillite.
Les banques centrales soulignent aussi que le transfert des dépôts bancaires vers les stablecoins s’accompagne d’un affaiblissement corrélatif de la situation financière des banques, avec des conséquences sur le financement de l’économie.
Bien que cela ne soit pas dit aussi clairement, elles se sentent aussi menacées par la concurrence que ces stablecoins porteraient au projet de création d’une monnaie numérique de banque centrale.
En Europe la BCE s’inquiète ainsi des conséquences de leur utilisation sur le projet d’euro numérique.
Toutes ces interrogations — ou objections — ne sont pas sans fondement. Notons toutefois qu’en Europe, l’essentiel des études effectuées est le plus souvent issu de la BCE elle-même, et plus rarement le cas de travaux de recherches universitaires indépendants 66.
La principale difficulté dans laquelle se trouve la BCE face à ce phénomène est en effet celle d’être à la fois juge et partie. Juge, parce qu’elle est chargée par les traités européens de la promotion du bon fonctionnement des systèmes de paiement, mais aussi de la supervision des banques commerciales au titre du Mécanisme de supervision unique (MSU) ; partie, car elle est selon ces mêmes traités seule en charge avec les banques centrales nationales de la conduite de la politique monétaire et de l’émission de la monnaie fiduciaire.
La BCE se trouve ainsi dans la situation délicate de devoir porter un jugement sur une activité qui peut potentiellement entrer en concurrence avec ses missions.
Cette situation assez unique porte en elle une question riche au plan théorique : une banque centrale jouit-elle d’un rôle monopolistique ou concurrentiel ? Du fait des caractéristiques particulières de la technologie blockchain, ce problème a priori incongru mérite pourtant d’être posé en ces termes 67.
Dans nos sociétés modernes, le rôle d’une banque centrale est double 68 : d’une part, c’est un institut d’émission chargé de frapper la monnaie fiduciaire ; d’autre part, il mène la politique monétaire. Si le premier rôle est celui qui, historiquement, a conduit à la création des banques centrales, le second est beaucoup plus récent.
Ces deux fonctions fondamentales sont-elles menacées par l’apparition des stablecoins et leur essor ? À écouter à tout le moins le discours de la BCE, mais aussi celui que tiennent parfois des institutions internationales comme la Banque des règlements internationaux, le FMI ou le Conseil de stabilité financière, tel semblerait être le cas. Ne faut-il pourtant pas plutôt voir dans ce discours une prudence excessive, et les craintes formulées ne jouent-elles pas le rôle d’épouvantails pour justifier les projets de monnaies numériques de banques centrales ? Ou bien sont-elles au contraire face à un péril qui met en jeu leur raison d’être ?
Les stablecoins face au pouvoir d’émission monétaire
Le pouvoir de frapper monnaie a toujours appartenu au Prince, c’est-à-dire à la personne ou l’institution qui détient le pouvoir politique (auctoritas 69) sur un espace géographique et les personnes qui y vivent. Il lui est à ce point associé que la frappe de la monnaie constitue l’un des attributs de la souveraineté d’un État.
Ce n’est qu’à partir du XIXe siècle que le pouvoir de frapper monnaie est transféré de façon définitive aux banques centrales comme un privilège d’émission. Celles-ci sont d’ailleurs, du point de vue historique, de création assez récente : pour ne citer que les trois premières, la Banque de Suède est créée en 1668, la Banque d’Angleterre en 1694 et la Banque de France en 1800. Ce sont là trois institutions d’abord à capitaux privés, dotées de privilèges régaliens.
Les émissions de stablecoins portent-elles atteinte au pouvoir de battre monnaie ? À première vue, il semblerait que tel soit le cas : avec les stablecoins, une entreprise commerciale, parfois même non régulée par le superviseur bancaire, émet des instruments numériques dont les fonctionnalités s’apparentent à celles de la monnaie 70.
À y regarder de plus près, il faut plutôt distinguer selon les situations que l’on rencontre dans l’Union 71.
Le premier cas de figure est celui des émetteurs de stablecoins qui n’ont pas le statut d’établissements de crédit, mais d’établissements de monnaie électronique (EME) 72. Ceux-ci n’émettent pas de la monnaie, puisqu’ils doivent être garantis par la mise en place d’une réserve 1:1 pour chaque unité monétaire émise, réserve qui est obligatoirement placée auprès d’un établissement de crédit.
La deuxième situation concerne le cas des émetteurs de stablecoins ayant le statut d’établissement de crédit (banque). Ici, les sommes reçues en contrevaleur de l’émission des stablecoins sont assimilables économiquement à des dépôts bancaires, rentrant ainsi dans les différents ratios prudentiels 73 permettant au superviseur bancaire mais aussi à la banque centrale de contrôler le respect de ces ratios et l’évolution de la masse monétaire en circulation.
Autrement dit, ici, les banques émettrices de stablecoins se trouvent dans la même situation que lorsqu’elles émettent de la monnaie scripturale. Ainsi, dans le premier cas (émission de stablecoins par des EME) l’agrégat monétaire M0 (la « masse monétaire banque centrale » 74) n’est pas impactée, contrairement à M1 (M0 + dépôts à vue) 75 ; dans le second cas, si M0 n’est pas impactée non plus, M1 l’est et M3 peut l’être de la même manière que toute création monétaire scripturale 76.
Ce qui est important pour une banque centrale est de contrôler l’évolution de la masse monétaire afin de conduire sa politique monétaire. À cette fin, dès lors que les acteurs privés sont sous pouvoir de supervision, c’est-à-dire agréés comme tel, la Banque centrale dispose des moyens de suivre l’évolution de la masse monétaire, et donc de conduire sa politique monétaire.
Au sein de l’Union, seuls des établissements régulés comme établissements de crédit ou EME peuvent émettre et distribuer des stablecoins. La BCE n’est dès lors pas gênée ni perturbée dans la conduite de sa politique monétaire lorsqu’il s’agit de stablecoins en euros 77.
À ce premier constat quant à un éventuel risque vis-à-vis de la BCE de perte du pouvoir d’émission monétaire, on peut ajouter un élément plus quantitatif soulignant l’absence de risque quant à la stabilité financière au sein de l’Union. En effet, le montant en circulation des stablecoins en euros est encore très faible, autour de 500 millions d’euros. Même si celui-ci venait à représenter l’équivalent en circulation des stablecoins en dollars de l’agrégat monétaire M1 aux États-Unis (18,80 trillions de dollars en juin 2025), soit 1,25 %, cela ne représenterait que 130 milliards d’euros sur un total de 10,8 trillions d’euros de l’agrégat M1 — à comparer aux coussins de liquidité des banques systémiques supervisées par la BCE, s’élevant à 4 950 milliards d’euros.
Autrement dit, au sein de l’Union, les risques d’atteinte à la stabilité financière que peuvent causer les stablecoins en euros sont pour l’instant encore très faibles.
Les revenus tirés du seigneuriage sont-ils affectés par les stablecoins ?
À ce pouvoir monétaire est attachée une prérogative un peu complexe dénommée le seigneuriage ; celui-ci peut être défini comme le pouvoir d’émettre monnaie et d’en tirer les revenus liés.
Il s’agit de l’écart entre la valeur faciale de la monnaie — le chiffre inscrit sur la pièce ou le billet — et son coût de production, nettement inférieur 78.
Une part importante des revenus d’une banque centrale provient du seigneuriage.
À titre d’exemple, imaginons que la BCE émette un million d’euros en billets de 20 euros, en échange d’un million d’euros de réserves de la banque centrale.
La BCE investit ensuite le produit de l’émission des billets de 20 euros dans une obligation d’État générant 2,5 % d’intérêt. Cela rapporte 0,50 € d’intérêt par an pour chaque billet de 20 euros.
Si l’on suppose que le coût total de production du billet est d’environ 0,15 €, alors, compte tenu d’une durée de vie moyenne d’environ 7,5 ans pour un nouveau billet de banque, le coût de production du billet s’élève en moyenne à 0,02 € par an. Si l’on ajoute à cela des frais de distribution moyens d’environ 0,01 € par an, le coût annuel moyen total de la mise en circulation de ce billet et de son remplacement lorsqu’il est usé est d’environ 0,03 €.
Ainsi, la BCE perçoit un revenu net annuel d’environ 0,47 € pour chaque billet de 20 € en circulation, soit, dans cet exemple, un total de 23 500 € pour le million d’euros émis 79.
C’est loin d’être négligeable.
Malheureusement, d’une part, les revenus de seigneuriage tirés de la BCE ne sont pas disponibles facilement, et d’autre part — surtout —, les coûts liés à l’émission de billets en euros ne sont pas détaillés 80.
La Banque d’Angleterre, de son côté, est plus transparente : elle produit tous les ans un rapport sur ces revenus. Ainsi, depuis les trente dernières années, ce sont en moyenne entre 1,5 et 2 milliards de livres qui sont reversés au Trésor de Sa Majesté au seul titre des produits tirés du seigneuriage — sauf depuis la crise de 2008 où ces revenus ne représentent plus en moyenne que 500 millions de livres du fait de la baisse des taux d’intérêt.
Comment connaître les revenus tirés du seigneuriage par la BCE et la Banque de France, et savoir si ceux-ci seraient affectés par l’utilisation de stablecoins ?
Un moyen grossier serait de regarder les dividendes versés par la banque centrale à son actionnaire, c’est-à-dire l’État dans le cas de la Banque de France 81 ; mais au-delà même du fait que le dividende ne permet pas de déterminer la part du seigneuriage, les résultats de la Banque de France et de la BCE sont fortement négatifs depuis 2023 82.
Un autre moyen pour connaître les revenus de seigneuriage serait alors de prendre le bénéfice de la banque centrale, même si celui-ci ne correspond qu’à une partie de ces profits. À ce bénéfice, il faut bien sûr ajouter les impôts payés par la banque centrale à l’État dans lequel elle est établie. Ainsi, pour prendre l’exemple de la Banque de France, celle-ci indique que, de 2015 à 2023, elle a versé 15,5 milliards d’euros de dividendes à l’État et 16,3 milliards au titre de l’impôt sur les sociétés, soit un profit estimé à 31,8 milliards (hors dotation aux provisions et aux réserves). Cela représente 4 milliards d’euros par an en moyenne.
Tout comme le critère du dividende, celui du bénéfice n’est pas pertinent, en particulier quand la banque centrale ne réalise pas de bénéfices mais des pertes ; mais même en cas de bénéfice, celui-ci seul ne permet pas de déterminer les profits tirés du seigneuriage.
En effet, les billets de banque émis et en circulation ne représentent qu’une faible part du passif d’une banque centrale (de l’ordre d’un quart pour l’Eurosystème). Selon la Banque de France, « en plus du seigneuriage, les banques centrales tirent aussi des revenus de leurs réserves en devises et des titres achetés pour soutenir la politique monétaire » 83. Toute la difficulté consiste à isoler ces différents revenus entre eux. Or les actifs des banques centrales ne sont pas isolés ni cantonnés, au contraire : l’ensemble des actifs permet de garantir l’ensemble du passif, tout comme pour une banque commerciale.
Une autre possibilité consisterait à calculer la différence entre la rémunération des actifs acquis en contrepartie de l’émission des billets et le coût de la gestion et de l’entretien de la monnaie fiduciaire (impression, transport, recyclage, …). La Banque de France indique que c’est « l’écart entre le revenu sur le prêt consenti par la Banque centrale nationale à la banque commerciale et le coût de production du billet, qui génère les revenus de seigneuriage » 84. Ainsi, selon la Banque de France, le refinancement bancaire serait la contrepartie de l’émission des billets 85. Cette piste-là ne permet donc pas non plus de connaître avec précision les gains tirés de l’activité de seigneuriage.
Reste une dernière solution — forcément grossière — consistant à calculer la rémunération moyenne des actifs de la banque centrale et d’y appliquer le volume des billets en circulation. Ainsi, les revenus bruts d’intérêts de l’Eurosystème ont été de 67,4 milliards en 2024, ce qui représente un rendement moyen de 1 % sur l’ensemble des actifs et de 1,2 % en excluant l’or 86.
En considérant que les plus et moins-values sur les autres actifs s’annulent avec le temps, tout en excluant l’or, le revenu brut de billets en 2024 s’élèverait donc avec ces hypothèses, à 19 milliards d’euros dont 1,16 milliard pour la France si on attribue à celle-ci la part dans le capital de la BCE (16,4 %). À cela, il convient bien sûr de retirer le coût de l’entretien de la monnaie fiduciaire, coût que les banques centrales ne communiquent pas.
Même si l’on ne parvient pas à déterminer avec précision les gains de l’activité de seigneuriage, il apparaît que ceux-ci sont loin d’être négligeables, même s’ils ne représentent pas l’ensemble des revenus d’une banque centrale. Dans quelle mesure ces revenus de seigneuriage seraient-ils affectés par une montée en puissance des stablecoins ? Autrement dit, une baisse significative des revenus de seigneuriage mettrait-elle en péril les résultats d’une banque centrale ?
Le recul de la monnaie fiduciaire et l’essor des stablecoins
On touche avec ces deux questions à celle, plus large, du « remplacement du cash » : les stablecoins vont-ils prendre la place de la monnaie fiduciaire ?
La réponse n’est pas identique d’une zone économique à une autre.
Dans les économies modernes, la part de la monnaie fiduciaire ne représente plus qu’un pourcentage très faible de la masse monétaire : un peu plus de 10 % dans la zone euro, moins de 5 % en Grande-Bretagne. Si la monnaie fiduciaire continue de représenter environ 43 % des transactions de proximité, elle descend à 20 % en valeur. Cette dernière n’est que de 15 % en Grande-Bretagne — et 1 % en Suède 87.
Paradoxalement, si sa part ne cesse de baisser en valeur, le nombre de billets et de pièces en circulation dans la zone euro ne cesse d’augmenter depuis la création de l’euro, et plus particulièrement depuis la crise du Covid 88. On retrouve le même phénomène avec le dollar américain 89, qui manifeste une thésaurisation sous forme d’espèces.
Doit-on considérer que les stablecoins vont accélérer la baisse de l’usage des pièces et billets dans les paiements de proximité et, par conséquent, l’émission de la monnaie fiduciaire ?
Si la part de la monnaie fiduciaire comme actif monétaire continue de baisser, les revenus des banques centrales peuvent s’en trouver affectés si cela se traduit par une baisse du nombre de billets en circulation. Une utilisation massive des stablecoins comme moyen de paiement, en lieu et place de la monnaie fiduciaire, risquerait de diminuer le besoin de circulation de celle-ci et, corrélativement, de peser sur les revenus des banques centrales.
Si, dans un horizon plus ou moins lointain la monnaie fiduciaire venait à disparaître — ou, à tout le moins, si son usage devenait marginal pour qu’elle soit remplacée par les stablecoins et tout autre mode de paiement numérique —, l’une des deux fonctions d’une banque centrale tendrait à disparaître.
Ce risque n’est toutefois pas nouveau ; les stablecoins ne seraient alors qu’un accélérateur d’un phénomène plus profond : la numérisation de la monnaie via de nouveaux moyens de paiement. Ce n’est donc pas un risque lié aux stablecoins dont il s’agit ici, mais d’un risque plus général de numérisation des moyens de paiement auquel les banques centrales doivent faire face.
La situation des banques centrales est hétérogène de ce point de vue.
Dans les pays à forte inflation et/ou à monnaie faible, le recours aux stablecoins est perçu par la population comme une alternative crédible à l’utilisation de la monnaie légale — qu’elle soit fiduciaire ou électronique. C’est le cas dans des pays aussi différents que le Kenya, la Turquie, le Liban, certains pays d’Amérique du Sud et d’Asie 90. Dans ces pays, les stablecoins jouent tout à la fois le rôle d’actif de réserve et de moyen de paiement dans une devise (le dollar) autre que la monnaie nationale.
Cette substitution des stablecoins à la monnaie fiduciaire légale n’est pas sans poser de nombreux risques pour ces pays, non seulement en termes de perte de souveraineté monétaire, mais aussi de revenus tirés du seigneuriage et, plus généralement, de la stabilité de leur système bancaire 91. Le développement des stablecoins constitue alors clairement une forte menace pour les banques centrales, leurs rôles et missions étant directement impactés par ce phénomène.
La situation est très différente dans les pays dotés d’une devise stable, d’une inflation maîtrisée et d’un système de paiement moderne et efficace comme c’est le cas au sein de l’Union et d’autres pays ; ceux-là ne sont pas menacés par l’arrivée des stablecoins ni leur croissance — la BCE ne l’est donc pas non plus. Il y a un consensus aujourd’hui pour estimer que les paiements de proximité en stablecoins à la place de l’euro (fiduciaire ou scriptural) constituent un risque très faible ; celui-ci ne peut pourtant être totalement écarté, car le jour peut arriver où les grands acteurs du commerce électronique se mettront à privilégier les paiements en stablecoins dollar.
Ainsi, sur la première des deux missions d’une banque centrale qu’est le pouvoir de frapper monnaie, le risque que feraient courir les stablecoins en remplaçant la monnaie fiduciaire dépend de la configuration politique, économique et technique de chaque pays. En Europe, ce risque est très faible.
La conduite de la politique monétaire est-elle affectée par les stablecoins ?
Le deuxième pouvoir d’une banque centrale, celui de déterminer la conduite de la politique monétaire, est-il affecté par la montée en puissance des stablecoins ?
Dans l’histoire monétaire, ce pouvoir de conduite n’a été transféré des États aux banques centrales qu’assez récemment. Un tel transfert se fait dans l’entre-deux-guerres pour certains — les États-Unis par exemple — et à partir des années 1970 pour la majorité.
En France, il faut attendre une loi de 1993 pour que la Banque de France soit désignée comme étant en charge de la politique monétaire. Selon cette loi, « la politique monétaire constitue l’une des composantes de la politique économique, complétant la politique budgétaire et fiscale ainsi que les politiques structurelles, qui sont du domaine de l’État. La politique monétaire est de la responsabilité des banques centrales, qui doivent veiller à la stabilité monétaire et financière pour favoriser la prospérité économique » 92.
Si la politique monétaire a longtemps été l’apanage des gouvernements, c‘est que ceux-ci estimaient qu’il n’était pas possible de conduire une politique budgétaire et économique sans maîtriser la politique monétaire.
Le transfert qu’on observe à partir des années 1970 s’opère justement afin de découpler la politique économique de la politique monétaire, laquelle, surtout depuis la création de la BCE, consiste principalement dans la « stabilité des prix, qui est définie comme une inflation de 2 % à moyen terme » 93.
Ce découplage n’a été possible qu’au nom d’une idée qui s’est peu à peu imposée : l’indépendance de la banque centrale, comme garant d’une politique monétaire non influencée par le pouvoir politique. Le pilotage de la politique monétaire est ainsi effectué par une analyse macroéconomique des facteurs présentant un risque pour la stabilité des prix, et une analyse de l’évolution de la masse monétaire pour déterminer les tendances d’inflation.
Le contrôle de l’évolution de la masse monétaire est donc un facteur essentiel pour une banque centrale.
Une influence négligeable
Dans quelle mesure les stablecoins ont-ils un impact sur la conduite de la politique monétaire ? En vérité, cet impact est faible — voire nul —, que les stablecoins soient émis par des EME ou qu’ils soient le fait des établissements de crédit. Dans les deux cas, les réserves se retrouvent auprès de la BCE.
En effet, tout établissement de crédit agréé au sein de l’Union doit constituer des réserves obligatoires auprès de la banque nationale dont il relève — soit 1 % des passifs à moins de deux ans. Dès lors que les stablecoins sont assimilés à des dépôts pour les besoins de l’agrégat M1, ils sont capturés par cette exigence.
Ce qui pourrait inquiéter une banque centrale est l’émission de stablecoins par un émetteur non supervisé par elle et utilisant sa devise : dans un tel cas, la banque centrale ne connaît pas de façon précise l’évolution de la masse monétaire et pilote à vue. Or, une telle situation n’est pas possible au sein de l’Union européenne, le Règlement européen sur les crypto-actifs (MiCA) obligeant les émetteurs de stablecoins utilisant une devise de l’Union d’être agréés au sein de celle-ci.
Une situation encore plus problématique est celle où un émetteur non supervisé par la banque centrale distribue un stablecoin dans une devise autre — comme c’est le cas dans de nombreux pays d’économie émergentes où les stablecoins en dollar sont utilisés par les agents économiques. Cette situation n’est pas interdite dans le cadre de l’Union européenne, mais le même règlement européen MiCA oblige à ce que les plateformes de crypto-actifs agréées au sein de l’Union s’assurent que l’émetteur de ce stablecoin respecte les règles européennes en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (LCB-FT).
Il n’existe pas d’interdiction formelle d’utiliser des stablecoins en dollars émis par des émetteurs non européens au sein de l’Union, mais les conditions de circulation sont très limitées. C’est ce qui explique que Tether, le stablecoin disposant de la capitalisation boursière la plus importante, n’est aujourd’hui plus accessible dans l’Union européenne : les plateformes de trading européennes ont été obligées de le « délister ».
Comme on le voit, en l’état actuel des choses et sans doute pour encore quelque temps, il n’y a pas de risque pour la BCE d’atteinte à sa politique monétaire via les stablecoins en euro, voire en dollar.
L’indépendance des banques centrales : une exigence récente
Création de la monnaie fiduciaire et conduite de la politique monétaire sont les caractéristiques principales d’une banque centrale aujourd’hui.
À ces deux fonctions a été ajoutée une caractéristique particulière, propre aux banques centrales modernes : leur indépendance par rapport au pouvoir politique et à l’État. Une banque centrale indépendante conduit sereinement une politique monétaire détachée des soubresauts des débats politiques.
Cette indépendance est considérée, surtout au sein de l’Union, comme une garantie du modèle de démocratie parlementaire appliquée au cas monétaire : l’indépendance de la BCE constitue un des piliers du système démocratique, en ce sens que la BCE n’est pas soumise aux aléas de la politique.
Ce modèle d’indépendance est devenu aujourd’hui un standard international, prôné par le FMI 94 ; son application n’est toutefois pas homogène d’un pays à un autre, notamment en raison des liens qui peuvent exister entre la banque centrale et le Trésor public d’un État. Plus ces liens sont lâches ou, mieux encore, inexistants, plus la banque centrale sera considérée comme indépendante et, partant, neutre dans le débat politique — son rôle étant de déterminer la politique monétaire quelle que soit la couleur politique du gouvernement.
Les débats actuels aux États-Unis montrent en quoi la question de l’indépendance est cruciale et au centre du débat politique. Si la critique principale qu’on fait au modèle de fonctionnement des banques centrales est l’absence de légitimité démocratique, tant de l’institution que de sa gouvernance, c’est là précisément leur raison d’être.
Les stablecoins pourraient-ils remettre en cause le rôle des banques centrales ?
Que conclure de ce rapide panorama sur les risques que représenteraient les stablecoins pour une banque centrale ?
Sont-ils de nature à remettre en cause non seulement le pouvoir de création monétaire de la BCE, mais aussi celui de la conduite de la politique monétaire, voire son indépendance ?
Le débat n’est pas récent. On connaît l’opinion de Friedrich von Hayek dans son ouvrage Pour une vraie concurrence des monnaies 95, où celui-ci préconise d’émettre les monnaies non plus par les banques centrales mais par des institutions privées.
L’arrivée de nouvelles technologies comme la blockchain bouleverse certes l’ordre monétaire en vigueur, en faisant de certains actifs numériques des substituts à la monnaie ; mais que ce soit pour la conduite de la politique monétaire ou le pouvoir de création monétaire, il paraît exagéré aujourd’hui de considérer que ces deux fonctions essentielles d’une banque centrale soient menacées par l’essor des stablecoins. Le discours de la BCE sur ce sujet paraît donc exagérément négatif.
La BCE serait plus avisée de se focaliser sur la place du dollar comme monnaie aussi bien dans les paiements de proximité que dans les opérations de règlement sur les marchés financiers, pour s’inquiéter d’une telle situation. La réponse de la BCE face à cette menace réelle devrait alors être de favoriser l’essor des stablecoins en euros, d’autant plus que leur impact sur la stabilité financière reste encore très faible — même dans l’hypothèse d’une circulation équivalente à celle aujourd’hui des stablecoins dollars par rapport à l’agrégat M1.
Si le risque d’utilisation des stablecoins dollars dans les paiements de proximité au sein de l’Union semble à ce jour très théorique, la situation est différente pour les marchés financiers du fait de la numérisation des actifs financiers et du besoin de disposer d’un actif de règlement numérique dans les systèmes de règlement-livraison européens. Si la bataille sur la devise numérique de règlement dans les marchés de crypto-actifs semble aujourd’hui perdue au profit du dollar, celle liée à la transformation radicale des infrastructures de marché traditionnelles — comme les bourses, les dépositaires centraux et les systèmes de règlement-livraison dans leur transformation numérique — reste ouverte.
Le risque pour l’Union est que ces infrastructures utilisent des stablecoins en dollars si aucune autre alternative crédible n’existe ; or, la faiblesse actuelle des stablecoins en euros ne leur permet pas d’être une alternative crédible ; quant à l’euro numérique de gros, il est pour sa part en voie de développement.
Certes, le basculement des infrastructures de marché prendra encore du temps.
Tout dépendra donc de la vitesse de ce mouvement de transformation : à ce moment-là, les acteurs se tourneront vers l’actif de règlement numérique le plus liquide qui puisse être disponible.
La BCE s’est trompée d’enjeu stratégique depuis plusieurs années : elle a pensé que les stablecoins étaient une menace pour la souveraineté monétaire et la politique monétaire européennes, parce qu’elle y voyait d’abord un concurrent à son projet d’euro numérique. Prisonnière de cette vision, elle n’a pas vu que le risque n’est pas le support (stablecoin) mais la devise de référence du support (le dollar).
Cette obsession a fait perdre au moins trois à cinq ans à l’Union pour se doter d’acteurs concurrençant les émissions en dollars par des émissions en euros. Les récentes déclarations du gouverneur de la Banque de France laissent cependant entrevoir une évolution vers plus de réalisme 96.
Il conviendrait d’accompagner le secteur privé dans ses projets d’émission de stablecoins en euros — pour repositionner ses priorités, c’est d’un réel aggiornamento dont la BCE a besoin.
L’article Les stablecoins sont-ils en train de détruire la Banque centrale européenne ? est apparu en premier sur Le Grand Continent.
25.09.2025 à 07:00
« L’Europe a les moyens de la bonne réponse stratégique à la révolution de la monnaie », une conversation avec François Villeroy de Galhau, Gouverneur de la Banque de France
Que fait la zone euro alors que Trump veut prendre la Fed et renverser l’ordre monétaire avec les cryptos ?
Pour le Gouverneur de la Banque de France, la nouvelle politique économique américaine peut créer une opportunité stratégique européenne.
Nous l’avons rencontré.
L’article « L’Europe a les moyens de la bonne réponse stratégique à la révolution de la monnaie », une conversation avec François Villeroy de Galhau, Gouverneur de la Banque de France est apparu en premier sur Le Grand Continent.
Texte intégral (5364 mots)
English version available at this link
Vous revenez d’un voyage en Ukraine et en Moldavie : qu’en retenez-vous ?
Ce « voyage au bout de l’Europe » n’est évidemment pas un déplacement comme les autres.
Aller à Kyiv aujourd’hui, c’est voir une ville magnifique et millénaire, et c’est surtout recevoir une leçon de courage calme : un pays qui se défend fermement, mais aussi qui est au travail et qui tourne.
Chaque nuit, les habitants de Kyiv risquent de subir des alertes — même si la situation est là-bas plus sûre qu’on ne l’imagine à Paris — et chaque matin, ils retournent dans leurs entreprises ou leurs services publics essentiels.
Le pays tient bon avec une résilience impressionnante.
Je l’ai vu à la banque centrale d’Ukraine : mon collègue et ami Andriy Pyshnyy, qui m’avait invité, veille à maintenir des banques qui prêtent et une inflation supportable. Mais bien sûr, la guerre pèse lourdement et depuis trop longtemps sur les hommes, sur le budget et sur la croissance.
Le processus d’élargissement est en cours. Quel rôle la BCE devrait-elle jouer à votre avis ?
L’Ukraine comme la Moldavie font partie de l’Europe, géographiquement et culturellement. Le désir d’Europe s’est peut-être banalisé à l’Ouest, mais il ne fait que grandir là-bas. Les deux pays s’y préparent activement dans leur législation comme dans leurs réformes. La présidente moldave Maia Sandu, que j’ai rencontrée, est un modèle de courage dans sa lutte contre la corruption et les interférences russes.
Comprendre sur place ce que ces Européens vivent, aller leur dire personnellement et physiquement notre amitié, cela compte vraiment pour eux.
Mais la solidarité doit être aussi en actes : comme la BCE, la Banque de France est très engagée dans la coopération avec les deux banques centrales.
83 % des Européens et 79 % des Français soutiennent l’euro, et cette proportion croît alors même que nous avons traversé nombre de crises dont un épisode d’inflation il y a peu.
François Villeroy de Galhau
La question de l’utilisation des avoirs russes gelés revient avec insistance dans le débat, alors que le coût de la guerre pour l’Ukraine s’élèverait désormais à plus de 170 millions de dollars par jour. Quelle est votre position sur ce sujet ?
Le G7 a réussi l’an dernier à mettre en place un nouveau prêt ERA de 50 milliards de dollars à l’Ukraine, assis sur les revenus des avoirs russes. Il y a aujourd’hui des discussions pour amplifier ce succès : je ne veux pas en préjuger, mais nous devons évidemment continuer à soutenir l’Ukraine aussi longtemps que nécessaire dans un combat qui malheureusement dure à cause de l’acharnement russe.
Parmi les paradoxes de la construction européenne des dernières années, on trouve le suivant : l’extrême droite n’a jamais été aussi forte, et pourtant les forces qui demandent la sortie de l’euro n’ont jamais été aussi faibles. Comment l’expliquez-vous ?
L’euro est un succès formidable. Je fais partie de la génération de ceux qui depuis les années 1990 ont œuvré à la création de la monnaie unique. J’étais à Maastricht, et il y avait alors un certain scepticisme. On l’a oublié, mais nombre d’économistes, notamment américains, disaient que cela ne marcherait jamais.
En France, en 1992, l’euro a été approuvé par la plus courte des majorités, avec 51 % des voix.
Il s’agit aujourd’hui d’un véritable plébiscite : 83 % des Européens et 79 % des Français soutiennent l’euro, et cette proportion croît alors même que nous avons traversé nombre de crises dont un épisode d’inflation il y a peu. L’euro a été testé et chaque fois, il s’est renforcé davantage.
Si nous n’avions pas l’euro dans les turbulences du monde actuel, nous serions dans une situation extrêmement difficile. En France comme ailleurs, les taux d’intérêt seraient beaucoup plus élevés ; les tensions intra-européennes seraient aussi plus importantes.
Quelles sont les leçons que vous tirez de cette « conversion » à l’euro ?
Une leçon de confiance et de détermination, dans un contexte où l’on peut avoir l’impression que les projets européens sont voués à l’échec. Une politique européenne, quand elle est menée de manière expliquée, continue et incarnée, devient populaire. J’insiste sur l’incarnation : l’euro, c’est tangible dans la vie des Européens. Comme demain des projets communs sur la défense, l’énergie décarbonée ou l’intelligence artificielle.
L’Europe, c’est une belle idée, mais à incarner en projets concrets.
Il y a encore des pays membres de l’Union qui n’ont pas adhéré à la zone euro — notamment la Pologne et la Tchéquie — est-ce pour vous une source d’inquiétude ?
Lorsque nous avons adopté l’euro, nous étions onze. Aujourd’hui, nous sommes vingt, avec la Croatie depuis 2023 ; nous serons vingt-et-un avec la Bulgarie début 2026. Aucun pays n’est jamais sorti de la zone euro — et on sait que pour la Grèce cela n’a pas été facile. Je pense toutefois qu’ils ne le regrettent pas aujourd’hui.
Il reste cependant sage que l’adoption de l’euro se fasse au rythme de la volonté de chaque pays.
Que faire de cette confiance ? N’avez-vous pas l’impression que l’euro témoigne d’une énergie que le dispositif institutionnel actuel ne sait pas vraiment exploiter ?
En effet, la limite aujourd’hui, c’est que cette souveraineté monétaire n’a pas encore suffisamment débouché sur deux autres aspects décisifs : la souveraineté économique et la souveraineté financière.
Pour prendre un exemple : nous avons en Europe plus d’épargne que les Américains, mais nous l’utilisons beaucoup moins bien pour nos investissements. Nous savons pourtant ce qu’il faut faire : en additionnant les rapports Draghi et Letta, la prescription est extrêmement claire.
Si nous n’avions pas l’euro dans les turbulences du monde actuel, nous serions dans une situation extrêmement difficile.
François Villeroy de Galhau
Cela fait plus d’un an depuis la présentation du rapport Draghi et près d’un an et demi depuis celle du rapport Letta. Quels sont les principaux obstacles à leur mise en œuvre ?
Pourquoi Jacques Delors a-t-il réussi il y a trente ans, avec d’autres, à mettre en place le marché unique, puis la monnaie unique ? Parce qu’il a mis un paquet global sur la table et fixé un calendrier. Sans ce dernier, l’euro n’aurait probablement pas vu le jour.
Nous avons besoin d’une vision d’ensemble et d’une date mobilisatrice ; je crois qu’aucun gouvernement des principaux pays européens ne bloquera un tel projet.
2028 a été suggéré comme date butoir possible pour la mise en œuvre des recommandations du rapport Draghi. Cette échéance semble toutefois peu réaliste, car elle est très proche. Et pourtant, quand on observe l’accélération des transformations à l’échelle internationale, on a l’impression qu’il s’agit d’une date extrêmement lointaine… Comment expliquer ce paradoxe temporel ?
Ces deux critiques opposées montrent que le choix d’une telle date, de l’ordre de deux à trois ans, est sans doute un bon point d’équilibre. Nous avons au moins deux dates symboliques : 2027, soit trente-cinq ans après Maastricht et soixante-dix ans après le Traité de Rome, ou encore 2028, soit trente-cinq ans après le marché unique. Cela ne fait pas une énorme différence, mais ce doit être pendant « les années Trump » : la réaction européenne face au basculement américain. Si les choses se font dans cet horizon-là, ce sera un véritable bond en avant.
Il y a bien sûr des propositions de la Commission aujourd’hui sur la table ; mais elles restent traitées de manière isolée et ne suffisent pas à atteindre « l’alignement » des ambitions qu’avait permis la date mobilisatrice de Delors.
Qu’est-ce que cela signifie ?
Il s’agit d’aligner trois volontés : l’ambition politique ; le travail administratif, qui n’est pas négligeable ; les projets d’investissement des entreprises. Cela avait remarquablement fonctionné avant le 1er janvier 1993 et le marché unique.
Au risque du paradoxe, la nouvelle politique économique américaine peut créer une opportunité européenne. Cette politique risque en effet de jouer dans la durée contre la croissance et l’innovation outre-Atlantique. Certains investissements des entreprises européennes aux États-Unis resteront, mais sans doute moins qu’il y a un an, quelles que soient les annonces ronflantes.
C’est le moment de proposer un contre-projet économique européen. Mais il faut faire vite, beaucoup plus vite ; sinon la fenêtre d’opportunité va se refermer.
La réaction européenne face au basculement américain doit se faire pendant « les années Trump ».
François Villeroy de Galhau
La Commission est aujourd’hui particulièrement forte et la présidence a su concentrer autour d’elle de nombreux leviers. Comment expliquez-vous ce blocage ?
La Commission a su réagir rapidement dans des situations de crise, comme lors de la pandémie de Covid-19 et de l’achat groupé de vaccins, ou lors de l’invasion de l’Ukraine et des paquets de sanctions contre la Russie. Depuis janvier dernier, elle a également agi rapidement dans le domaine de la défense.
Elle doit pourtant maintenant aller plus vite et plus fort sur l’économie, en dépassant la relative dispersion des portefeuilles.
Selon notre dernier sondage, une majorité d’Européens se montre critique à l’égard de l’accord sur les droits de douane conclu avec les États-Unis. Pensez-vous qu’il soit possible de transformer l’humiliation qu’ils disent majoritairement ressentir en une émotion constructive ?
L’accord est ce qu’il est. Il n’est pas enthousiasmant, mais peut-être était-il inévitable.
En revanche, l’essentiel de la réaction européenne doit désormais se concentrer sur autre chose, en interne : le renforcement de notre économie, la mobilisation générale autour de nos atouts. Nous avons le plus grand marché au monde, à égalité avec les États-Unis, et nous disposons de plus d’épargne qu’eux. Nous avons évidemment les talents humains.
Si j’ose dire, c’est l’heure d’être plus américain, ou du moins de faire nôtre une de leurs vertus : la confiance en soi.
Au risque de me répéter, il faut aussi appliquer le principe attribué à Walt Disney : « la différence entre un rêve et un projet, c’est une date de réalisation ».
Avec Donald Trump, on a l’impression de passer du « it’s the economy, stupid » au « it’s geopolitics, stupid ». Les banques centrales doivent-elles s’adapter à ce nouveau mot d’ordre ?
Bien sûr, les banques centrales n’ignorent pas le contexte dans lequel elles évoluent. Envisager divers scénarios — nous l’avions fait par exemple après l’invasion de l’Ukraine — peut faire partie de notre analyse économique. Nous ne sommes pas pour autant des acteurs géopolitiques.
Si on regarde néanmoins ce qui se passe à propos de la monnaie aujourd’hui, nous devons être mobilisés sur un certain nombre de tournants.
La nouvelle politique économique américaine peut créer une opportunité européenne.
François Villeroy de Galhau
La monnaie est à la fois notre cœur de mission, et un objet essentiel de souveraineté.
Elle peut apparaître comme un « bien invisible » : en temps normal, on ne le ressent pas, c’est comme l’air qu’on respire. Pourtant, sa valeur se mesure quand on en est privé, ou en cas de tensions ou de crises.
Il est crucial aujourd’hui de préserver la valeur de ce que les Européens ont construit avec l’euro.
Le dollar occupe une place centrale dans l’imaginaire de puissance d’une partie du mouvement MAGA, en particulier dans l’entourage du président américain. Peut-on réellement concevoir un monde où le dollar serait utilisé comme un simple instrument politique et géopolitique, sans une profonde transformation des ressorts classiques de la politique monétaire ?
Permettez-moi d’élargir la réponse. Nous faisons aujourd’hui face à trois ruptures majeures : une rupture technologique, une rupture économique ou idéologique — une privatisation possible de la monnaie — et une rupture politique — l’attitude américaine.
Tout d’abord, la rupture technologique concerne la tokenisation. Grâce à la blockchain, il est désormais possible d’échanger de façon décentralisée non seulement des flux financiers, mais aussi des informations, des actifs dématérialisés et des contrats juridiques. Ceci simplifie considérablement les transactions. Cette technologie a d’abord été liée aux Bitcoins, qui sont des instruments hautement spéculatifs et dont on peut douter qu’ils aient un potentiel de transformation de l’économie important.
Ce qu’on voit émerger maintenant, c’est un objet moins excitant, mais potentiellement beaucoup plus disruptif : les stablecoins, dont la valeur est adossée à une monnaie souveraine existante. Il s’agit d’un actif tokenisé qui ressemble beaucoup plus à une monnaie classique.
La deuxième rupture est d’ordre économique ou idéologique. Nous l’avions déjà constaté avec le Bitcoin : les émetteurs de cryptos sont décentralisés et tous privés, bien sûr. Cela signifie non seulement qu’il n’y a plus ici la fonction d’émission habituelle des banques centrales, mais aussi que le rôle des banques commerciales, qui constituent le deuxième étage de la création monétaire, peut être remis en cause. À ce jour, les plus grands émetteurs de stablecoins tokenisés sont des non-banques, assez peu régulées, comme Circle ou Tether.
C’est dans ce contexte que survient la troisième rupture, de nature politique : l’administration Trump pousse désormais les deux premières transformations tout en maintenant une continuité avec la politique américaine en ce qui concerne le rôle du dollar.
La monnaie est à la fois notre cœur de mission, et un objet essentiel de souveraineté.
François Villeroy de Galhau
Comment l’expliquez-vous ?
Visiblement, cette administration, plus encore que celles qui l’ont précédée, est très attachée au rôle central du dollar dans le système monétaire international, notamment parce que cela sécurise la demande pour la dette fédérale américaine.
Mais elle y ajoute une sensibilité politique très favorable au mouvement de privatisation et de décentralisation de la monnaie. Un des premiers Executive Orders de Donald Trump, dès le 23 janvier, stipule l’interdiction aux États-Unis de la monnaie de banque centrale numérique dite CBDC (Central Bank Digital Currency). À l’inverse, le président américain promeut les stablecoins émis par des acteurs privés.
L’objectif affiché est de faire des États-Unis le pays de la finance tokenisée. Sur le plan technologique, cette orientation peut se comprendre : aujourd’hui, la plupart des acteurs de la technologie sont américains, et le marché des stablecoins est pour l’instant adossé à 99 % au dollar.
Il y a toutefois des contradictions…
Oui ! Tout en affirmant son attachement au rôle central du dollar, l’administration Trump prend des risques quant à sa valeur et à sa solidité en attaquant l’indépendance de la Fed, en adoptant un budget marqué par des déficits considérables… ou encore en imposant des droits de douane susceptibles d’augmenter l’inflation et de ralentir la croissance.
Assisterons-nous à une perte de centralité du dollar ?
Le dollar reste aujourd’hui naturellement au centre du système, mais ces politiques économiques créent une attente de diversification des investisseurs internationaux car elles peuvent éroder la confiance dans les actifs américains. En sens inverse, la rupture technologique peut augmenter le rôle du dollar.
Se diriger vers un système monétaire plus multipolaire, diversifié sur plusieurs devises, serait plutôt une bonne chose. J’ai cependant une réserve forte : cela ne doit pas conduire à une fragmentation.
Le système monétaire international actuel, avec ses imperfections, a au moins le mérite d’être relativement unifié. S’il reproduisait pour les paiements transfrontaliers la fragmentation par blocs que l’on observe actuellement sur les plans géopolitique et commercial, ce serait un véritable recul.
Au-delà de la fragmentation, la rupture du stablecoin ne représente-t-elle pas un risque pour la souveraineté et pour l’euro ?
Potentiellement, mais nous avons des réponses.
Le risque pour l’Europe, c’est d’être demain confrontée à une quasi-monnaie, le stablecoin en dollars, de nature privée et émise par des acteurs non européens. Ce débat est tout juste naissant pour l’instant ; il est pourtant essentiel pour l’avenir de la souveraineté européenne.
On peut évoquer un lointain parallèle historique, bien sûr imparfait.
Une précédente grande rupture technologique sur la monnaie avait été l’invention du billet de banque, remplaçant l’or et l’argent : c’était déjà une dématérialisation.
L’Angleterre a pris ce tournant dès 1694 avec la création de la Banque d’Angleterre. La France a mis un siècle de plus, avec la création de la Banque de France en 1800, notre pays ayant été freiné par l’échec du système de Law en 1720, entre autres raisons.
Ce siècle de décalage monétaire n’est pas totalement indépendant du retard dans le décollage économique et industriel français par rapport à l’Angleterre. Ce n’est évidemment pas la seule explication. Reste que la bonne monnaie et le rôle de la banque centrale ne sont pas uniquement des sujets de spécialistes ; ils sont absolument centraux pour le développement de l’économie.
Face à ces ruptures, quelle est la réponse de la BCE ?
Nous la construisons activement, avec Christine Lagarde et le Conseil des gouverneurs.
Notre réponse repose sur trois composantes : la régulation, la monnaie numérique de banque centrale, et la possibilité d’une monnaie tokenisée privée européenne.
Sur la régulation, l’Europe dispose d’une avance avec le règlement MiCA, qui encadre depuis 2024 les actifs tokenisés. Les États-Unis viennent seulement d’adopter leur règlement Genius. Il est bienvenu, même s’il nous semble perfectible.
Vient ensuite la monnaie numérique de banque centrale. Alors que celle-ci a été interdite aux États-Unis, c’est notre responsabilité comme Banque centrale européenne d’œuvrer à son développement pour conserver notre souveraineté monétaire, d’autant plus que notre continent compte aujourd’hui moins d’innovateurs privés. C’est le but du projet d’euro numérique pour les paiements de détail, auquel s’ajoute le chantier moins connu de la monnaie numérique « de gros ».
L’urgence la plus pressante concerne en effet les paiements de gros — échanges interbancaires et marchés financiers — avec une première solution dès 2026 dans le cadre du projet Pontes. Quelques années plus tard, le projet Appia, avec un registre unifié sur blockchain, permettra d’échanger l’ensemble des actifs tokenisés : l’Europe veut être ici pionnière dans le monde.
Le risque pour l’Europe, c’est d’être demain confrontée à une quasi-monnaie, le stablecoin en dollars, de nature privée et émise par des acteurs non européens.
François Villeroy de Galhau
L’euro numérique pour le grand public est actuellement débattu au Parlement européen, mais le processus reste trop lent, du fait notamment des résistances de certaines banques privées. C’est à courte vue : elles risquent d’être les premières perdantes en l’absence de solution européenne et en euros.
Sur le plan technologique, le travail est en cours : c’est bien sûr un projet d’ampleur.
Quelle est la troisième composante ?
Elle touche justement aux émetteurs privés. Aux États-Unis, les banques prennent conscience des perspectives qu’ils ouvrent : le marché des stablecoins, aujourd’hui autour de 250 milliards de dollars, pourrait atteindre plusieurs milliers de milliards dans les années à venir.
Si ce développement massif de stablecoins en dollars se confirme, l’Europe et ses banques ne pourront éviter la question d’un étage privé de la monnaie tokenisée. Techniquement, deux instruments existent : des stablecoins en euros et/ou des « dépôts tokenisés ».
Mon propos ici n’est pas de choisir, mais de souligner le risque potentiel si aucune de ces deux solutions n’est développée en Europe.
Depuis toujours, la monnaie est un partenariat public-privé. Malgré les ruptures technologiques et la tokenisation, ces principes restent inchangés : une ancre solide, la monnaie centrale publique, comme fondation d’une monnaie des banques commerciales bien régulée.
L’Europe a justement les moyens de la bonne réponse stratégique à la révolution de la monnaie : elle est plutôt en avance sur les États-Unis en matière de régulation et de monnaie numérique publique, mais elle est en retard sur la monnaie privée.
On comprend que, dans la logique d’une partie de l’administration Trump, il est cohérent de retirer à la Fed l’un de ses leviers majeurs dans le jeu institutionnel américain en renforçant la capacité monétaire d’acteurs privés ; d’autant plus que ceux-ci peuvent être contrôlés, voire devenir une source de revenus privés.
Il y a deux sujets différents : à la « privatisation » potentielle dont nous avons parlé s’ajoutent les attaques sur l’indépendance de la Fed. En apparence, elles ne remettent pas en cause son rôle, mais visent à la subordonner au pouvoir politique.
C’est grave. L’indépendance des banques centrales a été conférée par la démocratie, parce que l’expérience montre qu’une banque centrale indépendante sert les citoyens en permettant de mieux maîtriser l’inflation. En outre, une banque centrale moins indépendante inspire moins confiance aux prêteurs, ce qui fera monter les taux d’intérêt à long terme au lieu de les faire baisser. Attaquer ainsi la Fed, c’est donc aller contre la loi démocratique américaine, et à terme contre l’intérêt économique américain.
L’Europe a les moyens de la bonne réponse stratégique à la révolution de la monnaie.
François Villeroy de Galhau
Vous pensez qu’il n’y a pas d’explication plus strictement idéologique ?
Certains ont peut-être une vision libertarienne selon laquelle il n’est pas nécessaire d’avoir une institution publique pour ancrer la monnaie. Avec un réseau d’émetteurs privés, ce serait la décentralisation qui créerait la confiance.
À l’origine, le Bitcoin reposait sur un vaste réseau de mineurs. Aller au bout de la logique reviendrait à dire que l’on a davantage confiance dans ce réseau anonyme — qu’il soit en Chine ou en Russie — que dans une institution publique.
Ma conviction, évidente, est qu’il s’agirait d’une illusion totale. Un acteur privé est in fine toujours guidé par ses propres intérêts — et on ne peut pas le lui reprocher. Il ne peut pas mieux garantir l’intérêt général qu’une institution décidée par la démocratie. Celle-ci est pour autant toujours perfectible : elle se doit bien sûr d’être à l’écoute des citoyens et de leurs critiques, et de leur rendre des comptes sur ses résultats.
Qu’impliquerait une Fed dirigée par un candidat fidèle à Trump pour la BCE, sachant que les investisseurs et les marchés privilégient une politique monétaire coordonnée — ce qui a été clef durant la pandémie ?
La coopération entre banques centrales est — et j’espère restera — un élément absolument clef.
Je suis président du Conseil de la Banque des règlements internationaux ; on parle peu du dialogue que nous menons, mais il est essentiel pour partager en confiance les informations et les interrogations que nous avons. Ensuite, chacun décide librement et rend compte selon ses règles nationales — ou ses règles européennes pour ce qui touche à notre Conseil des gouverneurs.
Comment voyez-vous le rôle international de l’Euro dans ce contexte ?
Quitte à vous surprendre, cette question n’était pas prévue dans le Traité de Maastricht.
L’objectif était de créer une monnaie solide sur le plan interne, ce qui a été fait avec succès. L’idée était que l’usage international de l’euro dépendait entièrement des choix privés.
Dans les faits, le rôle de l’euro a augmenté progressivement jusqu’à la crise financière, puis il s’est plutôt tassé depuis. C’est désormais devenu un enjeu beaucoup plus important. D’une part, il y a une attente de la part d’un certain nombre d’investisseurs internationaux, et d’autre part, c’est un avantage pour nous.
Par exemple, si une plus grande part du commerce avec le reste du monde était réalisée en euros, on réduirait un facteur de volatilité lié au change.
La BCE paraît très prudente, voire conservatrice, dans l’extension de ses lignes de swap de devises, alors qu’il s’agit d’un instrument que la Chine utilise pour accroître l’utilisation du yuan à l’étranger.
Je ne suis pas d’accord.
La BCE a plusieurs lignes de swap avec des contreparties qu’elle juge suffisamment sûres, et des lignes de refinancement (« repos ») avec nombre de pays d’Europe centrale. D’autres banques centrales peuvent peut-être utiliser l’instrument de façon plus « politique », mais c’est alors prendre de vrais risques financiers. Ceci dit, il y a de réelles possibilités pour élargir nos mécanismes.
Quelles initiatives concrètes pourraient alors être prises pour renforcer le poids géopolitique de l’euro ?
Tout ce que nous ferons pour mobiliser l’épargne, réaliser une union d’épargne et d’investissement ou accroître l’intégration financière, renforcera l’attractivité externe. Plus le marché financier européen sera profond, plus les investisseurs y viendront.
Une autre question, présente depuis longtemps, reviendra certainement : celle d’un actif sûr en euros, au-delà des dettes nationales existantes. Ce n’est pas évident à atteindre, et il y a deux familles de solutions : l’émission de dettes communautaires en euros — cela pourrait commencer par le regroupement des dettes de la Commission, du mécanisme européen de stabilité, voire de la BEI —, ou le regroupement d’une partie des dettes souveraines européennes.
Aucune piste n’est évidente à mettre en œuvre, mais je crois qu’il faudra relancer la réflexion.
Dès que la France plaide pour une dette commune européenne, cela suscite un certain scepticisme autour de la table : le soupçon est que nous voulons transférer notre problème budgétaire national à l’Europe.
François Villeroy de Galhau
Dans un contexte de fortes attentes en matière d’intégration dans le domaine de la défense, voyez-vous la possibilité d’une nouvelle dette commune permettant de franchir une étape ?
Cela correspondrait en effet plutôt à la première piste. Il s’agirait de dire que, sur le modèle du plan NextGenerationEU en réponse au Covid, un endettement commun serait répliqué pour la défense.
Plusieurs propositions ont été faites, comme de créer une telle dette non pour les armements existants, mais pour de nouveaux comme les drones.
Si nous voulons un financement européen, il faut qu’il y ait en face une offre européenne plus intégrée. Et sans doute nouvelle, car c’est l’une des limites actuelles : il y a plus de défense en Europe, mais pas encore plus d’Europe de la défense.
Voyez-vous une volonté de porter un tel projet dans le contexte politique actuel ?
Ce que je peux dire, c’est que la France sera d’autant plus crédible pour défendre ce type d’initiative qu’elle aura résolu son problème d’endettement. Dès que la France plaide pour une dette commune européenne, cela suscite un certain scepticisme autour de la table : le soupçon est que nous voulons transférer notre problème budgétaire national à l’Europe.
Cela ne peut pas être le cas : il est très important de lever ce soupçon.
L’article « L’Europe a les moyens de la bonne réponse stratégique à la révolution de la monnaie », une conversation avec François Villeroy de Galhau, Gouverneur de la Banque de France est apparu en premier sur Le Grand Continent.
19.09.2025 à 15:00
Trump et l’accord TikTok : qu’est-ce que la stratégie « America against America » de Pékin ?
Trump vient-il vraiment de conclure un « deal » avec la Chine ?
Dans la guerre des capitalismes politiques, TikTok n'est pas seulement une bataille clef — c'est un test interne pour l’administration américaine.
En opposant la faction pragmatique à celle qui souhaite un affrontement total, Pékin s'inspire de la doctrine de Wang Huning : jouer l'Amérique contre l'Amérique.
L'analyse d'Alessandro Aresu.
L’article Trump et l’accord TikTok : qu’est-ce que la stratégie « America against America » de Pékin ? est apparu en premier sur Le Grand Continent.
Texte intégral (2325 mots)
L’histoire de TikTok semble sans fin. Alors que nous avions retracé les différentes étapes de cette saga industrielle et politique dans ces pages, après l’annonce en grande pompe d’un accord entre l’administration Trump et la Chine de Xi Jinping sur le rachat des opérations américaines de la plateforme, elle connaît aujourd’hui un nouveau rebondissement.
Mais pour en comprendre la nature, il n’est pas si utile de partir de l’annonce retentissante d’un montage qui devrait prévoir pour la reprise de TikTok aux États-Unis un consortium d’investisseurs américains dont l’omniprésent Oracle de Larry Ellison — qui était déjà un partenaire essentiel du projet — et les fonds Silver Lake et Andreessen Horowitz.
Une archive de la Maison-Blanche livre une clef de lecture bien plus heuristique.
Sur le site Internet de la Présidence américaine, on trouve encore un document de référence — une « doctrine » programmatique intitulée « Trump on China. Putting America First ».
Il a été publié en novembre 2020 par Robert O’Brien, alors conseiller à la sécurité nationale, et peut être consulté librement sur Internet 97.
Dans un style grandiloquent, la dernière page affirme que les écrits qu’il compile — un ensemble assez hétérogène de discours du président Trump, du vice-président de l’époque Mike Pence, de O’Brien lui-même, du directeur du FBI de l’époque Christopher Wray, du secrétaire d’État de l’époque Mike Pompeo, du procureur général de l’époque William Barr et de l’ex-conseiller adjoint à la sécurité nationale Matt Pottinger — représentent pour notre époque et sur la Chine ce que fut le « Long Télégramme » de George Kennan en 1946 pour la doctrine d’endiguement de l’Union soviétique.
Qu’en est-il vraiment ?
D’une part, la Chine de Xi Jinping est un adversaire bien plus redoutable pour Washington que l’Union soviétique pour les États-Unis.
D’autre part, George Kennan — grand connaisseur de la Russie — a vécu 101 ans.
Où se trouvent aujourd’hui les auteurs de ces discours, les bâtisseurs d’un « consensus » sur la Chine ?
La rupture de Mike Pence avec Trump après l’assaut du Capitole est désormais consommée. Wray a démissionné du FBI après les attaques de nombreuses factions trumpiennes — dès 2020, à l’époque où « Trump on China » était publié, Steve Bannon suggérait sa « décapitation » — et a été remplacé par Kash Patel. Pompeo et Barr ne sont plus là. Surtout, le principal rédacteur du document, Robert O’Brien, dans le cadre de ses activités de consultant, peu après avoir soutenu en 2024 que le commerce de semi-conducteurs avancés avec la Chine par des entreprises telles qu’Intel et NVIDIA 98 présentait des risques majeurs, a travaillé en 2025 avec NVIDIA pour encourager de tels échanges — soutenant la thèse de Jensen Huang sur l’importance de l’accès au marché chinois 99.
Force est de le constater : le leadership américain n’a pas construit de consensus sur la Chine.
On perçoit certes vaguement l’émergence aux États-Unis d’une dynamique étonnante qui consiste à « faire comme la Chine » : investir avec des fonds publics dans l’industrie minière ; imiter le « maximalisme industriel » chinois soutenu par le théoricien Lu Feng ; en finir avec les rapports trimestriels — une déclaration choc amplifiée, sans surprise, par les médias chinois 100 — ; licencier ceux qui établissent des statistiques jugées non convaincantes 101.
Les exemples pourraient être bien plus nombreux pour pousser la comparaison et montrer que se déploie aujourd’hui à Washington une tentative de faire basculer le système de capitalisme politique des États-Unis — fondé sur l’élargissement de la notion de sécurité nationale — vers une version plus homogène à celle de la Chine.
L’impossible deal
Outre la longue histoire d’interdictions, de contre-interdictions, de coups et de contre-coups déjà évoquée dans ces pages, c’est dans ce contexte qu’intervient l’annonce sur le rachat américain de TikTok cette semaine.
Les deux adversaires se sont engagés dans un processus qui ressemble à long un photo-op inachevé : une grande poignée de main qui a surtout pour finalité de ne pas trop faire de mal à son adversaire.
Car cette recherche d’un grand accord se poursuit selon une modalité particulière : le report incessant.
TikTok ne peut pas vraiment être interdit — on reporte
La partie chinoise du canal de Panama ne peut pas vraiment être vendue — on reporte.
Chacun a ses « cartes », pour reprendre un terme de Trump — mais dans cette partie de poker, on peut aussi choisir de passer son tour.
Chacun renforce ainsi ses instruments de guerre économique — du pouvoir politique de l’antitrust chinois aux contrôles des exportations — afin de se nuire mutuellement — mais sans trop se faire de mal. Et jamais de manière totalement définitive. Pendant ce temps, les marchandises doivent arriver à destination, même par des voies détournées.
Quels sont alors les éléments structurels qui ressortent de l’annonce d’un deal sur TikTok ?
D’une part — et en particulier dans le cas de TikTok — il ne sera pas facile d’éliminer la tension qui règne aux États-Unis entre les incitations économiques et la sécurité nationale.
C’est même de plus en plus difficile.
Si ByteDance, maison-mère de la plateforme, a des actionnaires et des administrateurs américains et si ces actionnaires peuvent financer la politique des États-Unis, ils auront toujours une incitation à défendre leurs intérêts — et à faire défendre leurs intérêts. Et si la concurrence entre Washington et la Chine n’est pas un sprint, mais un marathon — pour reprendre une image de Jensen Huang —, il faut regarder le temps long.
Pour ByteDance, la part des opérations américaines dans ces comptes annuels n’est finalement pas le facteur qui compte le plus.
Pour comprendre l’avenir de cette entreprise, il faut plutôt s’intéresser aux activités de sa structure de recherche ByteDance Seed : au nombre de chercheurs qu’elle sera en mesure d’attirer, au nombre d’articles qu’elle pourra présenter lors de conférences telles que NeurIPS, à l’évolution des investissements dans la robotique ou encore aux perspectives de conception de puces par des unités internes… 102
La domination future part de TikTok — mais elle se gagne ailleurs.
D’autre part, l’annonce d’un deal aux contours imprécis met en évidence la tension profonde entre deux courants de pensée quant à l’attitude à avoir envers la Chine à Washington : les partisans de la confrontation des modèles et les tenants d’un pragmatisme pro-business 103. Selon ces derniers, il faudrait ainsi abandonner les stéréotypes de supériorité envers la Chine — à tout le moins dans une série de domaines — et envisager également le partage éventuel de la technologie chinoise, par exemple dans les filières industrielles des énergies propres. Pour filer la métaphore trumpiste : si les joueurs ont tous deux de bonnes cartes en main, alors une carte peut être échangée contre une autre pour tenter de se renforcer mutuellement — et évacuer les faiblesses de la mise initiale.
L’Amérique contre l’Amérique
Dès 1991, l’intellectuel chinois le plus influent du premier quart du XXIe siècle, Wang Huning, avait émis une hypothèse : le clivage profond de la société américaine était là pour durer. Du même coup, la tension à l’œuvre au sein de l’administration serait permanente. Les termes pourraient muter ; les mots pourraient changer ; mais une ambivalence profondément ancrée quant à la position à tenir vis-à-vis de Pékin donnerait toujours l’avantage à la Chine.
Le titre de son livre était évocateur : America against America.
Il y a quelques mois seulement, des personnalités comme le Secrétaire d’État Marco Rubio considéraient l’interdiction de TikTok comme un objectif vital pour les États-Unis dans leur lutte existentielle contre le Parti communiste chinois. Bloomberg avait d’ailleurs interprété le choix des « faucons de TikTok » 104 comme une clef de lecture pour comprendre la politique étrangère de Donald Trump.
Ce que pensent ces personnes semble n’avoir que peu d’importance : elles sont devenues les rouages d’un système dans lequel il n’y a clairement rien d’idéologique : par rapport à Pékin, il s’agit essentiellement de faire de la politique de manière à ce que la situation continue à être profitable pour tout le monde. On peut bien sûr enjoliver les choses, mais la réalité est là : savamment dosée, la formule magique de Wang Huning permettra toujours de trouver une manière de tirer son épingle du jeu face à Washington.
Le Vietnam, les Émirats arabes unis, l’Arabie saoudite et d’autres — pour qui le non-alignement est devenu une matrice stratégique — ne s’y trompent pas.
À Pékin, ce mantra paraît puissant — et si entêtant qu’il pourrait finir par recouvrir les problèmes internes de la Chine.
L’article Trump et l’accord TikTok : qu’est-ce que la stratégie « America against America » de Pékin ? est apparu en premier sur Le Grand Continent.