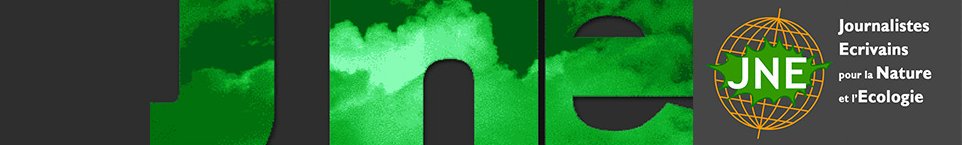Listing des sites et blogs des journalistes & Ecrivains pour la Nature et l'Écologie
Sommes-nous condamnés au silence ? – un webinaire AJE/JNE avec Sophie Lemaître le 21 janvier 2026 à 10 h 30
lsamuel
Invitation Sommes-nous condamnés au silence ? avec Sophie Lemaître, autrice de l’ouvrage Réduire au silence, comment le droit est perverti pour bâillonner médias et ONG. Le mercredi 21 janvier 2026 à 10 h 30 En France et dans le monde, des méthodes d’intimidation inquiétantes ciblent les journalistes. Les actions juridiques se multiplient envers celles & ceux qui nous informent, dans un seul but : les réduire au silence. Tandis que les poursuites bâillons sont privilégiées par les entreprises et les personnalités influentes. Des lois, comme celles contre le terrorisme et le blanchiment d’argent sont détournées de leurs ambitions initiales pour criminaliser certaines initiatives médiatiques. Si elles se banalisent, notre société risque un contrôle accru et un affaiblissement des libertés fondamentales et, probablement, de la préservation de l’environnement. Pour évoquer ces tendances, l’AJE et les JNE convient la juriste Sophie Lemaître, autrice de Réduire au silence, comment le droit est perverti pour bâillonner médias & ONG. La rencontre sera animée par Valéry Laramée de Tannenberg, président de l’AJE. Important : Merci de vous inscrire en cliquant ici. L’article Sommes-nous condamnés au silence ? – un webinaire AJE/JNE avec Sophie Lemaître le 21 janvier 2026 à 10 h 30 est apparu en premier sur Journalistes Écrivains pour la Nature et l'Écologie. (459 mots)
Webinaire AJE et JNE
De telles attaques entravent la qualité de l’information, le débat public, le droit d’informer et celui d’être informé.
Le Montpellier de Francis Hallé – Denis Cheissoux – CO2 Mon Amour – France Inter
lsamuel
En mai 2023, Denis Cheissoux avait consacré son émission CO2 Mon Amour sur France Inter au botaniste Francis Hallé, disparu le 31 décembre dernier. Ce programme a été rediffusé le 3 janvier 2026. Vous pouvez l’écouter en cliquant sur le lien ci-dessous. L’article Le Montpellier de Francis Hallé – Denis Cheissoux – CO2 Mon Amour – France Inter est apparu en premier sur Journalistes Écrivains pour la Nature et l'Écologie. (120 mots)
Une interview de François Terrasson dans le N° 1 de « Reporterre » en 1989
lsamuel
Dans son premier numéro (édition papier) sorti en janvier 1989, Reporterre – partenaire de la rencontre sur la pensée de François Terrasson organisée par les JNE le 8 janvier 2026 – avait publié une interview de ce grand naturaliste. Cliquez ici par la lire en PDF L’article Une interview de François Terrasson dans le N° 1 de « Reporterre » en 1989 est apparu en premier sur Journalistes Écrivains pour la Nature et l'Écologie. (112 mots)
Fabrice Nicolino : deux mots sur Francis Hallé
lsamuel
Nous avons appris avec tristesse le décès à 87 ans du grand botaniste Francis Hallé. L’un de nos adhérents, qui a eu la chance de le rencontrer, lui rend hommage. par Fabrice Nicolino Concernant Francis Hallé, deux mots. Je l’ai rencontré à trois reprises, et je ne suis donc pas, et de loin, un intime. Mais la dernière fois que je l’ai vu, il y a peut-être six ans, nous sommes tombés dans les bras l’un de l’autre, et nous nous sommes embrassés comme du bon pain. Car outre les rencontres, nous nous sommes parlé quelquefois au téléphone. Et je crois pouvoir dire que nous avions fortement sympathisé. J’ai voulu un temps l’entraîner dans un vaste mouvement sur les droits de l’arbre, ce qu’il ne sentait pas vraiment. Je comprends et je pardonne ! En 2007, je suis allé le voir chez lui, à Montpellier, pour le magazine Terre Sauvage. À l’époque, je menais de longs entretiens avec des personnalités de mon choix. Francis s’imposait, Dieu sait. J’extrais de ce texte les quelques phrases ci-dessous. Francis n’était pas seulement un homme. C’était un arbre. C’était un chêne. C’était un menara (surnom malaisien), le plus grand arbre tropical connu. Je pense à lui. Entretien avec Francis Hallé (2007) Je suis entré à l’université, à la Sorbonne, en biologie. Mais un beau jour, ma vie a basculé. À cause d’un pot de fleur. Je ne sais pas qui l’avait mis sur mon balcon et personne ne s’en occupait. Et j’y ai vu pousser une petite plante, qui a ensuite donné des fleurs, puis des fruits. Elle s’est resemée d’elle-même, et l’année d’après, il y en avait toute une population. Quelle impression ! Je me suis dit : si c’était un animal, je devrais le nourrir, lui donner à boire, ramasser ses excréments, supporter ses cris de douleur…et de joie (rires). Et puis, comme un idiot, je me serais attaché à lui, mais il serait mort, ce qui est notre lot à tous, les animaux. Tandis que là, tout était merveilleux. Ce qui m’a frappé le plus, avec les plantes, c’est leur autonomie totale. De quoi avait donc besoin ma plante du balcon ? De la pluie parisienne, et qu’on la laisse tranquille, c’est tout. Terre Sauvage : Et le nom de cette belle inconnue ? Francis Hallé : Sur le coup, je ne le connaissais pas. Je l’ai appris plus tard. Ma vocation pour les animaux s’est arrêtée là. J’ai compris que les plantes étaient bien plus intéressantes. Et après une année de biologie, je me suis spécialisé en botanique, puis en botanique tropicale. Terre Sauvage : Fort bien, mais vous avez oublié le nom de cette plante en route. Francis Hallé : Ah oui, en effet. Il s’agissait d’une Capselle bourse-à-pasteur, que j’ai identifié en ouvrant un livre, une Flore. C’est la même famille que l’Arabidopsis ou le Chou. Les JNE adressent leurs condoléances à la famille et aux proches de Francis Hallé. Photo : Francis Hallé avec Luc Marescot (à dr.) pour son film Poumon vert et tapis rouge © DR L’article Fabrice Nicolino : deux mots sur Francis Hallé est apparu en premier sur Journalistes Écrivains pour la Nature et l'Écologie. Texte intégral (632 mots)
Bon Pote
Actu-Environnement
Amis de la Terre
Aspas
Biodiversité-sous-nos-pieds
Bloom
Canopée
Décroissance (la)
Deep Green Resistance
Déroute des routes
Faîte et Racines
Fracas
F.N.E (AURA)
Greenpeace Fr
JNE
La Relève et la Peste
La Terre
Le Lierre
Le Sauvage
Low-Tech Mag.
Motus & Langue pendue
Mountain Wilderness
Negawatt
Observatoire de l'Anthropocène