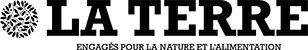Engagés pour la nature et l'alimentation.
LETTRE D’INFORMATION
La Terre
Inscription à la lettre d’information de La Terre
Votre adresse e-mail est utilisée uniquement pour vous envoyer notre lettre d'information et des informations sur les activités de La Terre. Vous pouvez vous désabonner à tout moment grâce au lien de désabonnement figurant dans la lettre d'information.
(117 mots)

POUR UN PROJET AGRICOLE ET ALIMENTAIRE PROGRESSISTE
Fabrice Savel
Au sommaire La Terre n°22, chez les marchands de journaux et par commande en ligne GRAND ENTRETIEN. Camille Étienne en direct de l’Antarctique : « On lutte pour que l’Antarctique reste un endroit préservé ». L’activiste climatique a rejoint Emmanuelle Périé-Bardout et Ghislain Bardout pour une mission d’exploration scientifique dans les eaux de la péninsule Antarctique. DOSSIER. Agriculture industrielle ou paysanne ? Nos propositions pour une transformation sociale et écologique de la production agricole, la souveraineté alimentaire et le droit à l’alimentation. ÉDITORIAL. Le sacrifice des paysans est le sacrifice de nous tous, par Patrick Le Hyaric. INFOGRAPHIES. La France perd 40 000 fermes en trois ans. Panorama de l’agriculture française. EN CHIFFRES. Le dévissage de la balance commerciale agricole et agroalimentaire de la France. ENTRETIEN. “Regardons les agriculteurs en face”. Le Directeur d’AgroToulouse, François Purseigle, appelle à de véritables projets politiques des territoires pour redynamiser l’agriculture au moment où elle confronté à des défis existentiels. CHRONIQUE. Chambres d’agriculture. Représenter toutes les agricultrices et les agriculteurs, par Bénédicte Bonzi. TRIBUNES. L’exploitation agricole familiale est-elle condamnée ? Par Jonathan Dubrulle. REPORTAGE. La Blada. Rendre l’agriculture bio et paysanne viable. Par Lola Keraron. CHRONIQUE. L’aile ou la cuisse, par Olivier Morin, agriculteur de la Brenne. ENTRETIEN. Pour Jocelyne Hacquemand, secrétaire de la Fédération nationale agroalimentaire et forestière CGT, “L’alimentation doit être extraite du carcan de la rentabilité financière”. GRAND REPORTAGE. Le soja à destination de l’Europe menace la savane brésilienne et ses habitants. DE LA TERRE AU MONDE. Tump au Congo. Donald Trump fait feu de tout bois, utilisant la force de frappe impérialiste des États-Unis pour grossir sa propre emprise financière et celle de ses amis et soutiens. Par Lydia Samarbakhsh. CHRONIQUE. La Terre, par Pierre-Louis Basse, écrivain, journaliste. (452 mots)
MERCOSUR. Mme Von Der Leyen doit respecter le vote du Parlement européen
Patrick Le Hyaric
Voici qui démontre avec éclat qu’un mouvement populaire européen des paysans soutenus par l’immense majorité des citoyens peut influer sur des décisions. Le Parlement européen a voté ce mardi 22 janvier une résolution déférant le traité MERCOSUR devant la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) afin de faire vérifier sa conformité avec le droit européen. Une nouvelle fois la présidente de la commission européenne est désavouée alors qu’elle s’est précipitée le 17 janvier dernier au Paraguay pour signer ce texte avec les chefs d’État latino-américains. En principe, l’application du traité est suspendue en attendant l’avis de la cour de justice. Celui-ci peut prendre entre 12 et 18 mois. Le fait que Mme Von der Leyen ait signé le texte sans attendre les votes des députés européens est un nouveau déni de démocratie, un royal mépris des délibérations du parlement européen alors qu’il est co-législateur avec le Conseil européen (chefs d’État et de gouvernements). La majorité du conseil européen avait approuvé le traité MERCOSUR, mais il ne semble pas que Mme Von Der Leyen ait reçu l’autorisation formelle pour une signature avant le vote du Parlement. Nous entrons dans un imbroglio juridique. Il est doublé d’une tentative de coup de force de la part de la Commission, qui envisage une application provisoire du texte. Ne l’acceptons pas. Si tel était le cas, le Parlement européen devrait préparer une motion de censure contre la présidente de la Commission et le Conseil la désavouer. Le traité n’a pas été voté, il ne doit pas être appliqué. Le biais de la fameuse « application provisoire » qui a déjà été utilisé pour le traité avec le Canada doit être réfuté, combattu. Le respect de la démocratie et le texte du traité lui-même nous concerne toutes et tous. Ne laissons pas faire ! * LA FARCE DE LA « GÉOPOLITIQUE » Nul doute que le cercle des dominants et des possédants va continuer de tenter de le grimer en un acte de résistance aux velléités de l’administration américaine. Leur cynisme n’a aucune limite : ce traité – commercial – est en discussion depuis plus d’un quart de siècle, donc bien avant l’avènement de Trump. Il s’agit pour eux de faire taire, par tous les moyens, les résistances à un texte aggravant encore les insécurités sanitaires, environnementales et sociales. Un traité pour les milieux d’affaires Le concept de libre-échange et de « marché ouvert » a peu à voir avec la diplomatie ou avec la coopération entre les nations et les peuples, mais tout à voir avec les affaires. Avec ce traité, il s’agit de lâcher la bride aux grandes sociétés transnationales afin qu’elles exploitent sans limites les hommes et la nature, là où le taux de profit sera le plus élevé, dans le cadre d’une guerre économique sans merci dont les fantassins sont les travailleurs de la terre, des usines et des bureaux, des deux côtés de l’Atlantique. Avec le MERCOSUR, il n’y a en effet que des perdants parmi les travailleurs au Brésil comme en Pologne, en France comme en Argentine. En effet, ce ne sont ni les peuples ni même le gouvernement brésilien qui vendraient les pièces de bœuf que les consommateurs européens vont trouveraient les plats cuisinés, mais des firmes capitalistes brésiliennes, américaines ou européennes qui exporteraient ce bœuf aux hormones, gavés d’un soja OGM cultivé sur la destruction d’immenses surfaces de forêt amazonienne. NOUS SOMMES TOUTES ET TOUS CONCERNÉS Toutes les familles populaires en subiraient les conséquences avec l’insécurité sanitaire et écologique qui en découlerait. Et, ce genre de traité a des conséquences concrètes sur le « pouvoir de vivre » de l’immense majorité. La « concurrence libre » à laquelle se livrent les possédants aboutit toujours à l’abaissement des normes sociales et environnementales, des salaires et des prix agricoles à la production. C’est ce que cache le mot « compétitivité ». Celle-ci aboutit à la réduction des cotisations sociales qui conduit les gouvernements à compresser le niveau des prestations sociales, des remboursements de soins, des pensions et à reculer l’âge de départ en retraite. C’est parce que l’Union européenne n’est conçue que comme un marché ouvert à tous les vents, livrés aux volontés des sociétés transnationales et du capital financier qu’elle est faible, peu écoutée, peu respectée et sa souveraineté bafouée, de plus en plus contestée par les peuples qui la composent. Il ne peut en être autrement quand la présidente de la Commission européenne va signer le traité MERCOSUR sans l’aval du Parlement européen. QUEL BILAN DES TRAITÉS DE LIBRE-ÉCHANGE ? Jamais n’est produit de bilan de ce libéralisme débridé. Pourtant, la création du marché unique en 1992, l’adoption du programme de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) en 1994, le traité de Lisbonne imposé en 2005, la signature de 40 traités de « libre-échanges » ont conduit au fiasco industriel, agricole, numérique, social que nous subissons aujourd’hui. Chacun de ces accords devait, -selon ses promoteurs – promouvoir la croissance et la prospérité des peuples. Résultat ! En vingt ans, l’Europe n’a gagné ni en croissance, ni en indépendance, ni en influence. Toutes les études publiées ces dernières années et les rapports de M. Draghi et d’E. Letta alertent sur le décrochage par rapport aux États-Unis et à la Chine, tandis que la pauvreté ne cesse d’augmenter. Et l’Europe est quasiment absente des technologies du futur – énergies renouvelables, numériques, intelligence artificielle, télécommunications, espace. La réduction des tarifs douaniers, l’abaissement des barrières sanitaires, environnementales n’ont pour objectif que de faciliter la libre circulation du capital, des marchandises et des services, pressurant toujours plus le travail et provoquant l’augmentation des températures sur la planète. Loin des indispensables coopérations à construire avec les nations et peuples d’Amérique Latine, le traité de libre-échange alimentera encore plus,la guerre commerciale au détriment des travailleurs et de l’environnement, là où la Chine par ses achats de produits agricoles et de matières premières a permis de consolider le socle des économies des pays du sous-continent américain. Elle y est la première fournisseuse d’équipements industriels et de produits manufacturés, tandis que la stratégie de D. Trump, au-delà du Venezuela, est de tenter de forcer les Chinois à quitter les lieux. Faire croire qu’en s’inscrivant au centre de cette lutte en utilisant la magie des tarifs douaniers donneraient de la force « géopolitique » à l’Union européenne est une mortelle illusion. Faut-il pour cela sacrifier une partie importante de nos travailleurs-paysans, détruire encore notre tissu rural, saccager la terre et l’eau, compresser encore l’emploi dans les secteurs agroalimentaires, manger de la viande aux hormones, déréguler l’utilisation de pesticides, supporter les modifications climatiques, alors que la Commission européenne elle-même ne projette qu’un taux de croissance de seulement 1 % en dix ans ? Non ! L’URGENCE DE MOBILISER LES TRAVAILLEURS ET LES PEUPLES POUR DES PROJETS DE COOPÉRATION Il est urgent aujourd’hui de proposer un projet de coopération pour le développement humain, la préservation de l’environnement, des co-investissements communs pour de nouvelles industrialisations compatibles avec la préservation du climat et de la biodiversité. Du même pas, il est nécessaire d’élargir les liens avec les paysanneries et les salariés et leurs associations d’Inde, des Philippines, de la Malaisie, de la Thaïlande, de l’Australie et des Émirats arabes unis pour bâtir d’autres projets que les traités de libre-échange en discussions avec leurs États. DIALOGUE ET ALLIANCES ENTRE PEUPLES DU SUD ET DU NORD Au nom de l’intérêt général, humain et environnemental, les organisations progressistes européennes doivent s’attacher à nouer des dialogues et des alliances pour des actions communes avec les citoyennes et citoyens des pays du Sud afin de peser en faveur d’un nouveau type de développement humain durable, de la justice, de la liberté, la fin de la corruption, comme le demande les classes ouvrières et les jeunesses de la génération Z. À nous ici, d’agir pour que l’Union européenne ouvre, sur de nouvelles bases, des dialogues novateurs pour le maintien des aides au développement, d’authentiques coopérations avec les pays du Sud, pour refonder le multilatéralisme, pour faire progresser la paix et le combat contre les dérèglements climatiques en lien avec l’Organisation des Nations unies. C’est à ce prix que la voix d’une Nouvelle Europe sociale, démocratique, écologique, actrice de coopérations au service des peuples et de la paix, ne s’éteindra pas. Dans ces conditions, oui, elle pourrait jouer un rôle positif. Texte intégral (1644 mots)
L’alimentation, grande cause populaire
Fabrice Savel
Un objet du quotidien, tout simple, rond le plus souvent, est le réceptacle d’une lutte des classes globale, féroce. Un objet usuel dans la plupart des foyers. Une assiette, des assiettes que l’on transmet parfois de génération en génération, marquées par l’usure du temps et les souvenirs des repas familiaux. Attablés devant elles, des mangeurs contraints par la faiblesse de leur revenu et leur temps de vie rogné par le travail. Au menu, des produits industriels à bas coût, ultra transformés et marketés pour conformer les goûts et les habitudes alimentaires aux désidératas de l’agrobusiness. Ce combat de classe qui ne dit pas son nom se déroule chaque jour, sous nos yeux, aux heures des repas, dans des assiettes, parfois bien vides, garnies d’aliments qui n’apportent pas les nutriments nécessaires et, de surcroît, sont mauvais pour la santé. En réalité, leur fonction principale est d’engraisser toujours plus les multinationales de l’agroalimentaire, de la grande distribution et leurs actionnaires. D’un côté, celles et ceux qui n’ont que leur travail, leur allocation où leur pension de retraite pour vivre et se nourrir. De l’autre, les firmes mondiales de l’agrobusiness, de la chimie, du machinisme agricole et les cinq mastodontes de la grande distribution (E. Leclerc, Carrefour, Intermarché, Auchan et Coopérative U) qui dominent l‘achat de 80% des produits alimentaires en France. Sans oublier les fantassins de cette guerre du marché mondiale de l’alimentation. Les travailleuses et travailleurs paysans qui n’arrivent pas à vivre de leur travail ainsi que les ouvrières et ouvriers, sous payés et exploités, des usines de l’agroalimentaire et de toute la chaîne de la distribution. Sans oublier les paysans et les travailleurs pauvres de tous les continents, parfois réduit à l’esclavage pour produire des matières premières alimentaires vendues à bas prix ici, en concurrence avec les productions des agriculteurs français et européens. Dans des cargos chargés à bloc, des millions de tonnes de soja produit sur la déforestation de l’Amazonie traversent l’océan pour nourrir du bétail en France et en Europe. Des animaux et des produits carnés font le tour du globe pour satisfaire aux lois d’airain du libre-échange, au mépris total de l’environnement, du bien être animal, de la santé et du travail humain. Ainsi, la réponse à ce besoin primaire, manger, est sous l’emprise du capitalisme financiarisé et mondialisé qui mène partout une guerre économique destructrice des humains, des sociétés, du vivant et de la planète. Et, cette marchandisation outrancière tend à individualiser et standardiser les habitudes alimentaires, les cultures gastronomiques, les rituels du repas, la convivialité, le temps du partage. Pendant que les files d’attentes des distributions alimentaires s’allongent dans notre pays, la faim frappe près de 10% de la population mondiale. Au total, en 2024, plus de 733,4 millions de personnes étaient chroniquement sous-alimentées, soit 36 % de plus qu’il y a dix ans, selon les estimations issue des travaux de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), du Programme alimentaire mondial, du Fonds international de développement agricole (FIDA), de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et de l’Unicef. Des paysans qui n’arrivent plus à vivre de leur travail, la faim qui n’en finit pas de faire des millions de victimes, des produits alimentaires dangereux pour la santé et l’environnement… Sous la férule du capitalisme, aujourd’hui, la faim tue, manger tue. Alors que le Droit à une alimentation adéquate, saine, accessible, de qualité et en quantité suffisante, est établi par les organisations des Nations unies, la plupart des États et des pouvoirs politiques serviles, laissent les mains libres aux tenants de l’agrobusiness. Désormais, la lutte pour la réalisation du droit à l’alimentation est un enjeu populaire mondial pour l’extraire des griffes du marché capitaliste. L’alimentation doit redevenir l’affaire de toutes et tous par l’avènement d’une démocratie alimentaire, du sol à l’assiette, qui garantit partout un droit à l’alimentation, plein et entier. Pour nous, c’est un combat communiste fédérateur de notre temps contre ce capitalisme vorace qui s’engraisse sur l’exploitation de la nature, du travail et des besoins humains, même vitaux. Un combat politique, économique, social, écologique, culturel, civilisationnel. Puisse La Terre être utile à toutes celles et ceux qui s’engagent, à leur façon, à la ville et à la campagne, ici et à travers le monde, dans cette bataille existentielle pour garantir le droit à des aliments choisis, bons pour le goût et la santé, dont la production permette de vivre et de préserver la nature. C’est notre engagement. Texte intégral (847 mots)
🌱 Bon Pote
Actu-Environnement
Amis de la Terre
Aspas
Biodiversité-sous-nos-pieds
🌱 Bloom
Canopée
Décroissance (la)
Deep Green Resistance
Déroute des routes
Faîte et Racines
🌱 Fracas
F.N.E (AURA)
Greenpeace Fr
JNE
La Relève et la Peste
La Terre
Le Lierre
Le Sauvage
Low-Tech Mag.
Motus & Langue pendue
Mountain Wilderness
Negawatt
🌱 Observatoire de l'Anthropocène