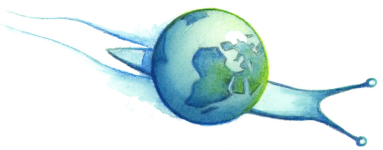Articles intégraux en PDF
la Maison commune de la décroissance
Il faut lire : les lumières sombres, d’Arnaud Miranda
Rédaction
Voici le livre qu’il faut lire en ce début d’année 2026. D’une part, il fournit une contribution claire et précise qui sera utile à tous ceux qui s’interdisent de critiquer tout en restant dans l’ignorance des théories adverses. En ce sens, ce livre prolonge celui de Serge Audier (Néo-libéralismes, une archéologie intellectuelle, 2012, Grasset) et ceux plus récents de Quinn Slobodian (Les globalistes, Une histoire intellectuelle du néolibéralisme, 2018, trad. fr. 2022, Seuil ; Le capitalisme de l’apocalypse, ou le rêve d’un monde sans démocratie, 2023, trad. fr. 2025, Seuil). D’autre part, il devrait intéresser tout particulièrement les décroissants qui discutent de la cohérence théorique et donc stratégique du mouvement de la décroissance. Rien que le titre nous interpelle : car si les « lumières sombres » caractérisent la pensée néoréactionnaire, alors toute critique de celle-ci reviendra de facto à une défense des Lumières. Ce qui est le cas pour la pensée décroissante : conservatrice peut-être, réactionnaire, certainement pas 1. Ce qui implique de ne pas pouvoir enfermer la décroissance dans une critique monolithique des Lumières, et donc de la modernité 2. Gros chantier idéologique à affronter. De façon très claire, Arnaud Miranda nous introduit à la pensée néoréactionnaire par une suite de portraits des principaux protagonistes : Curtis Yarvin (chap.3), Nick Land (chap.4), la galaxie NRx (chap.5), Peter Thiel et Marc Andreesen (chap.6). Ces portraits sont encadrés par une cartographie des droites américaines (chap.1), par une brève histoire de la néoraction (chap.2) et le livre se conclut par une évocation de la situation actuelle (chap.7). 0:00 Présentation de l’ouvrage et d’Arnaud Miranda 1:16 L’importance de prendre les idées politiques au sérieux 4:45 Typologie des penseurs : de l’académie à la tech 7:35 Conservateurs, réactionnaires et libéraux : les distinctions 16:00 Les racines du libertarianisme américain 21:10 Néoconservateurs vs Paléoconservateurs : le point de rupture 26:00 Alt-right, néoréaction et post-libéralisme 33:50 Curtis Yarvin et le concept de formalisme 44:50 La « Cathédrale » et la stratégie du passivisme 56:50 Nick Land et l’accélérationnisme technocapitaliste 1:05:50 Peter Thiel : promoteur et financeur du mouvement 1:15:00 Quelles réponses pour les démocraties ? * Il me semble qu’au-delà du panorama dressé par l’auteur de cette constellation néoréactionnaire, on peut faire ressortir quelques points, en résonance inversée, en dissonance donc, avec la nébuleuse décroissante. * * On pourra trouver dans le livre d’autres listes des composants de la pensée néoréactionnaire ; et à chaque fois, il sera pertinent que la décroissance prenne le contrepied de ces listes. Je ferais juste remarquer une absence dans ces listes : la composante religieuse. Pour Marcel Gaucher, les USA vivraient en ce moment leur « sortie de la religion » ; pourquoi pas. Mais, en tout état de cause, cette absence signifie peut-être que cette pensée néoréactionnaire a totalement intégré la victoire d’un individualisme qui peut aller jusqu’à se débarrasser de tout ce qu’une religion peut apporter de socialisant : c’est à cette aune qu’il faudrait relire le court essai d’Hartmut Rosa, Pourquoi la démocratie a besoin de religion, 2022, trad.fr. 2023, La Découverte. D’autant qu’Arnaud Miranda a raison d’insister tout au long de son livre sur la dimension contre-culturelle de l’utilisation d’internet (p.154) pour assurer la diffusion de cette pensée néoréactionnaire : comme si, dans une société rêvée comme n’étant plus qu’une collection d’individus séparés, le véritable succès des réseaux sociaux consistaient à rendre obsolètes les liens sociaux en général, et donc à ringardiser la religion dont la fonction sociale d’intégration serait has been. Texte intégral (1602 mots)

Notes et références
Renverser les rapports de prédation et d’exploitation pour les abolir
Rédaction
Difficile de se prétendre décroissant sans être aussi anticapitaliste. Mais la réciproque n’est pas vraie : car la décroissance suscite encore beaucoup de réticences chez la plupart des anticapitalistes. Cela en dit long sur le chemin encore à parcourir pour atteindre une « hégémonie culturelle »… Certes le capitalisme est le moteur de la croissance économique, mais il n’en est pas la justification : même les plus arrogants des commentateurs n’osent pas justifier/réfuter une mesure par l’argument « c’est bon/mauvais pour le capitalisme » ; c’est pourquoi ils préfèrent « c’est bon/mauvais pour la croissance ». C’est que le domaine sur lequel la croissance exerce son emprise est d’une tout autre étendue que celui du capitalisme : vous n’entendrez jamais un anticapitaliste défendre le capitalisme de l’amour ou du bonheur, mais vous rencontrerez des objecteurs de croissance vanter la croissance de l’amour, de la poésie (Aurélien Barrau). La conséquence politique est rude : le renversement de la croissance est d’une tout autre envergure que celui du capitalisme. Si le contrôle de la production (et on peut étendre la chaîne de valeur en partant de l’extraction pour aller à toutes les pollutions) était en effet déterminant, on ne peut pas réduire la décroissance à la seule demande de « beaucoup moins d’énergie, moins de matériaux et moins de production globale » (Jason Hickel). L’entretien et le soin de tout ce que la croissance et son moteur capitaliste méprisent et rejettent dans les marges de l’économie doivent devenir l’objectif prioritaire et central. Tous ceux qui souffrent des politiques de croissance, unissez-vous : les défavorisés, les pays pauvres, les générations futures, les vivants non-humains… Sens dessus dessous ! Autrement dit, c’est la relation à la reproduction sociale dans sa plus grande extension qui doit être absolument inversée : là où la sphère de la production économique exploite et domine la nature, toutes les populations subalternes et racisées, il faut renverser la croissance comme régime politique (dont la domination se pare des valeurs du monde de la croissance, comme idéologie — image inversée, disait Marx — au service mystifiant de l’économie). S’il convient alors de reprendre l’objectif d’un « front principal des luttes », ce ne sera plus en restant confiné à la seule sphère de la production économique, au détriment de la sphère de la reproduction sociale. Mais ce sera exactement l’inverse : non seulement, le soin et la subsistance seront les objectifs, mais pas pour les faire croître, seulement pour les maintenir, les conserver. Ce Grand Renversement, social, écologique, démocratique suppose que les « oppositions » cessent de se concurrencer et réussissent à partager un fond politique commun : telle est l’ambition de la MCD, et c’est pour cela que nous organisons mardi prochain un café décroissance (en visioconférence) sur le thème des images qui pourraient permettre de visionner ces convergences. Texte intégral (576 mots)
L’opposition et le Régime de modernité, par Hervé Roussel-Dessartre
Hervé Roussel-Dessartre
Qu’Hervé Roussel-Dessartre soit ici remercié pour nous autoriser à publier sur le site de la MCD son analyse critique (exposée lors d’une intervention en novembre 2025), dont la nouvelle version, en passant de « la gauche » à « l’opposition », a gagné en extension (du domaine de la lutte). Pourquoi s’intéresser à cette notion de « régime de modernité » ? Si on nous demandait de citer 2 auteurs qui inspirent fortement les réflexions de la MCD, nous choisirions Onofrio Romano, pour son concept de « régime de croissance », et Hartmut Rosa, pour sa critique de la « modernité tardive ». La notion de « régime de modernité » entre donc en résonance avec ces auteurs. D’autant qu’Hervé Roussel-Dessartre prend la peine de signaler d’emblée qu’il ne faut pas confondre entre « modernité » et « régime de modernité ». En effet, sans tomber dans la facilité rhétorique, celle qui distinguerait entre une « bonne modernité » (à sauver) et une « mauvaise modernité » (à rejeter), on peut accepter facilement de caractériser la modernité par un double projet : « le projet d’autonomie individuelle et collective… le projet de pseudo-maîtrise pseudo-rationnelle de domination et d’exploitation scientifique et technique de la nature » (Serge Audier (2020), La cité écologique, pour un éco-républicanisme, La Découverte, pages 652-662). En effet, toute opposition à toute forme d’oppression (exploitation, aliénation, domination) est en filiation avec une revendication d’autonomie (C. Castoriadis) qui vient de la modernité. Si nous devions évoquer une piste de discussion, en se demandant s’il doit y avoir une différence entre « régime de croissance » et « régime de modernité », c’est que celui-ci porte sur les « valeurs » (de l’hégémonie) alors que celui-là dirige la critique sur sa « forme ». Si l’on considère, à la suite de Cornelius Castoriadis, que l’imagination peut être créatrice, que c’est par elle qu’une forme de rupture peut advenir, il est important, crucial même, que cette imagination ne s’embourbe pas dans l’imaginaire dominant. Or, tout semble montrer que l’opposition contemporaine n’en suit pas le chemin. L’a-t-elle d’ailleurs jamais pris ? Face au « système », que remet-on effectivement en cause, les uns les autres ? Que met-on derrière la prétention d’être anti-système ? Quel combat mène-t-on véritablement ? Quel objectif poursuit-on vraiment ? A-t-on la même image en tête ? Faute d’approfondir ces questions, aucun projet digne de ce nom n’a émergé ces dernières décennies, l’opposition se contentant de rassembler une collection de revendications hétéroclites, parfois contradictoires, et de… s’opposer. Avec la Renaissance émerge, en Occident, une nouvelle manière de vivre et de concevoir sa destinée dans ce monde. L’individu commence à s’affranchir des tutelles traditionnelles qui pèsent sur son destin. Il ose dire « je ». Le monde social change de centre de gravité : des lois supérieures (le service de Dieu, de l’État, de la famille…), il se tourne vers l’individu et le culte de soi. L’individu devient le but et la norme de toute chose. Des êtres humains se proclament maîtres de leur vie. D’où sortira une certaine conception de l’histoire et des cités. Et d’où découlera encore un transfert de pouvoir : de la terre vers le capital financier, de la campagne vers la ville, de la ferme vers l’usine, d’un monde fondé autour de la protection (de l’âme par le religieux, de la personne par la noblesse guerrière – d’où résultaient des titres sociaux reconnus) à un monde bâti autour du travail et de l’échange des biens (d’où émergera la future hégémonie sociale). J’appelle « Régime de modernité » ce phénomène social global (en Occident). Il se caractérise par l’individualisation, d’une part, le protestantisme et le libéralisme, religion et philosophie politique faisant office de supports idéologiques, d’une autre part, la technique et le capitalisme (la science et l’économie) comme supports matériels, d’une troisième part. La démocratie libérale en est la forme institutionnelle la plus accomplie, la raison et le progrès des idéaux. En prendre pleinement conscience permet de mieux s’interroger sur ce que l’on conteste et souhaite quand on se veut d’opposition. En effet, entre radicalisme à la sauce américaine, revendications individualistes pimentées d’un soupçon de French Theory, luttes de reconnaissance tout autant individualistes, voire combat au profit des droits de l’individu, l’imaginaire de l’opposition contemporaine est totalement prisonnier de ce Régime de modernité et de son individualisation. L’université américaine en élabore le socle idéologique. Laquelle baigne dans une doxa imprégnée de protestantisme, d’individualisation, de liberté de l’individu, soit exactement le volet culturel de l’hégémonie bourgeoise. Hégémonie bourgeoise qui à travers la mondialisation est effectivement devenue hégémonique au point que l’on peut parler de globalisation culturelle. Et c’est cette pensée universitaire mondialisée, active prisonnière de la globalisation libérale, qui alimente la pensée de l’opposition contemporaine. À tel point que celle-ci semble ne même plus savoir ce que peuvent vouloir dire peuple, collectif ou commun. On se prétend de gauche mais on s’appuie allègrement sur les fondamentaux du système. Sans oublier de s’afficher radical. Or, si l’objectif est bien de « changer le système », l’opération à mener ne saurait se réduire à une revendication d’inclusion dans ledit système que l’on prétend vouloir changer. Ou à la misérable ambition d’un « vivre ensemble », au mieux mêlé de « créolisation », quand il s’agit de « faire société ». Pas plus qu’elle ne saurait être seulement une bataille contre le capitalisme, ni même contre toutes formes de domination, ou le remplacement du prolétariat par les laissés-pour-compte dans le catéchisme marxiste. Le périmètre du système à changer est bien plus vaste ! L’opposition doit accepter de se coltiner en priorité notre rapport au Régime de modernité et à sa mythologie. Notons que je parle de Régime de modernité, et non de modernité, pour ne pas réduire celle-ci à cette forme de régime qui s’en est dégagée. C’est pourquoi il est nécessaire de « révolutionner l’opposition », ou plus exactement son imaginaire. Une opposition digne de ce nom doit effectivement avant tout poursuivre un changement radical de société. On ne peut se contenter de l’embourgeoisement (ou de l’inclusion) du prolétariat ou des laissés-pour-compte. D’assumer de la sorte une collaboration libérale inspirée du Parti démocrate américain, loin, très loin de tout projet de rupture. La quête de sens comme la crise écologique n’autorisent plus ces options. Le mode de vie bourgeois, celui de la vie ordinaire, qui a viré au consumérisme, n’est plus ni soutenable ni enviable. La question de la nécessité doit se retrouver au cœur de la réflexion. Celle que l’on doit juguler pour atteindre le domaine de la liberté, selon Marx. Tout comme la question du progrès qui sera à préciser. Aujourd’hui, l’opposition se dit « progressiste ». Mais de quel progrès parle-t-on ? Il faut sortir de l’imaginaire de la croissance, celui qui veut que l’accumulation soit une fin en soi. Qu’il faut travailler plus pour consommer plus. Alors qu’il ne faut travailler que pour vivre ! Vivre en adéquation avec notre part animale, en symbiose avec notre environnement naturel, et dans le respect des équilibres écologiques, psychiques et sociaux. Si l’individualisation est un acquis majeur du Régime de modernité, il n’en reste pas moins que l’intention ne peut être que de le dépasser. D’en sortir « par le haut », toutes et tous, et à égalité, en construisant la société de demain. En s’appuyant, par exemple, sur un slogan comme « Liberté, Égalité, Commun » qui souligne l’équilibre à inventer (au moyen de l’imagination créatrice) entre l’individu (Liberté, Égalité) et le collectif (Commun). Pour la réflexion dans sa totalité, c’est par ici : https://hrousseld.fr/lopposition-et-le-regime-de-modernite/. Version revue et corrigée du billet « La gauche et le Régime de modernité ». Question d’autant plus cruciale qu’à force de globalisation de nos cadres de vie, une partie conséquente de l’opposition en serait plutôt arrivée à épouser les fondamentaux du libéralisme, à embrasser la pensée universitaire libérale dominante, à emboîter le pas au Parti démocrate américain et à son chemin de collaboration. Cette réflexion est une version revue et corrigée de la conférence donnée au Bar Commun (Paris 18) le 20 novembre 2025. * Texte intégral (1785 mots)

Introduction
Partie 1 – Lé régime de modernité
Partie 2 – La globalisation libérale ou l’imaginaire prisonnier
Partie 3 – Révolutionner l’opposition
Conclusion et perspective
Quand l’invisibilisation du capitalisme invisibilise la décroissance
Rédaction
En 1988, Dans ses Commentaires sur la société du spectacle, Guy Debord écrivait : « La Mafia n’est pas étrangère dans ce monde ; elle y est parfaitement chez elle. Au moment du spectaculaire intégré, elle règne en fait comme le modèle de toutes les entreprises commerciales avancées ». Il concluait par ce jugement les quelques paragraphes qu’il venait de consacrer à la Mafia pour repérer « les points de ressemblance avec le capitalisme ». Rien d’étonnant alors à ce que, dans un journal télévisé, un reportage sur la DZ Mafia s’enchaîne avec un sujet sur la dernière provocation de l’actuel roi autoproclamé du deal : un dealer, c’est un entrepreneur, et vice-versa. Et ce qu’ils ont en commun, c’est l’adhésion à la règle d’or du capitalisme : la mutualisation des pertes, la privatisation des profits. Il n’y a donc aucune coïncidence quand on s’aperçoit que rien ne ressemble plus à un « point de deal » que ce que les ultralibéraux actuels nomment des « zones économiques spéciales » (lire à ce sujet de Quinn Slobodian, Le capitalisme de l’apocalypse, 2025, Seuil) : une zone hors du droit commun (« là où la police ne va pas »), sans démocratie (mais à la justice expéditive), totalement hiérarchisée, organisée en vue d’un seul but, l’argent. Mais dans la société du spectacle où le spectaculaire doit fabriquer une image renversée de la réalité (dans laquelle « le vrai est un moment du faux »), cette connivence entre « le monde des affaires » et « les affaires » semble invisibilisée par tous les commentateurs en continu. Rien de plus remarquable en effet que de constater comment leur rhétorique peut enchaîner une diatribe contre le narcotrafic, un reportage sur le Mercosur, un plaidoyer pour la réduction des recettes budgétaires, une visite à Dubaï, une interview d’un « grand patron », une polémique contre la taxe Zucman, une inquiétude sur l’omniprésence de l’IA… mais sans jamais prononcer le terme qui en est la substance commune : le capitalisme. Toutes ces acrobaties pour éviter d’avoir à se confronter à une évidence : c’est que le tour qu’est en train de prendre le monde n’est que le dernier épisode de ce que le capitalisme a toujours fait subir au monde : la domination des puissants. Alors, si en tant que décroissant radical, on en vient à rappeler que, politiquement, la critique du capitalisme ne s’attaque au mieux qu’à la partie émergée de l’iceberg de la croissance, on mesure à quel point aujourd’hui l’enjeu de la décroissance n’existe pas dans le débat public. Toutes ces acrobaties pour invisibiliser (et donc naturaliser) le capitalisme dressent le barrage le plus efficace pour ne jamais poser ce qu’Harmut Rosa nomme la « question sérieuse : la société moderne est-elle donc équivalente à la société capitaliste ? Est-ce que j’entends simplement « capitalisme » lorsque je me réfère à la structure de base de la société moderne ? La réponse est : le capitalisme est un moteur central, mais la stabilisation dynamique s’étend bien au-delà de la sphère économique ». Et c’est ainsi que même la critique la plus radicale du capitalisme ne sera encore qu’une critique tronquée de la croissance, de son économie, de son monde et de son régime politique. Texte intégral (617 mots)
🌱 Bon Pote
Actu-Environnement
Amis de la Terre
Aspas
Biodiversité-sous-nos-pieds
🌱 Bloom
Canopée
Décroissance (la)
Deep Green Resistance
Déroute des routes
Faîte et Racines
🌱 Fracas
F.N.E (AURA)
Greenpeace Fr
JNE
La Relève et la Peste
La Terre
Le Lierre
Le Sauvage
Low-Tech Mag.
Motus & Langue pendue
Mountain Wilderness
Negawatt
🌱 Observatoire de l'Anthropocène