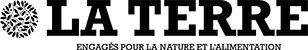Engagés pour la nature et l'alimentation.
Aliments ultratransformés : quels effets sur notre santé et comment réduire notre exposition ?
The Conversation
Par Mathilde Touvier, Directrice de l’Equipe de Recherche en Epidémiologie Nutritionnelle, U1153 Inserm,Inrae, Cnam, Université Sorbonne Paris Nord, Université Paris Cité, Université Paris Cité et Bernard Srour, Chercheur en épidémiologie au CRESS-EREN (INRAE, Inserm, Université Sorbonne Paris Nord, Université Paris Cité), titulaire de la chaire de Professeur Junior INRAE sur les rythmes alimentaires, et coordonnateur du Réseau NACRe (Nutrition Activité physique Cancer Recherche)., Inrae; Inserm Souvent trop sucrés, trop salés et trop caloriques, les aliments ultratransformés contiennent en outre de nombreux additifs, arômes et autres substances résultant de leurs modes de fabrication industriels. Or, les preuves des liens entre leur consommation et divers troubles de santé s’accumulent. Le point sur l’état des connaissances. The Kraft Heinz Company, Mondelez International, Post Holdings, The Coca-Cola Company, PepsiCo, General Mills, Nestlé USA, Kellogg’s, Mars Incorporated et Conagra Brands… au-delà de leur secteur d’activité – l’agroalimentaire – et de leur importance économique, ces dix entreprises partagent désormais un autre point commun : elles sont toutes visées par une procédure judiciaire engagée par la Ville de San Francisco, aux États-Unis. Selon le communiqué de presse publié par les services du procureur de la ville David Chiu, cette plainte est déposée, car Ces sociétés « savai[en]t que [leurs] produits rendaient les gens malades, mais [ont] continué à concevoir et à commercialiser des produits de plus en plus addictifs et nocifs afin de maximiser [leurs] profits ». Cette procédure survient quelques jours après la publication, dans la revue médicale The Lancet, d’un long dossier consacré aux effets des aliments ultratransformés sur la santé. Parmi les travaux présentés figure l’analyse approfondie de la littérature scientifique disponible sur ce sujet que nous avons réalisée. Voici ce qu’il faut savoir des conséquences de la consommation de tels aliments, en tenant compte des connaissances les plus récentes sur le sujet. À l’heure actuelle, en France, on estime qu’en moyenne de 30 à 35 % des calories consommées quotidiennement par les adultes proviennent d’aliments ultratransformés. Cette proportion peut atteindre 60 % au Royaume-Uni et aux États-Unis. Si dans les pays occidentaux, les ventes de ces produits se sont stabilisées (quoiqu’à des niveaux élevés), elles sont en pleine explosion dans les pays à revenu faible et intermédiaire. Comme leur nom l’indique, les aliments ultratransformés sont des aliments, ou des formulations issues d’aliments, qui ont subi des transformations importantes lors de leur élaboration. Ils sont fabriqués de façon industrielle, selon une grande diversité de procédés (chauffage à haute température, hydrogénation, prétraitement par friture, hydrolyse, extrusion, etc.) qui modifient radicalement la matrice alimentaire de départ. Par ailleurs, les aliments ultratransformés sont caractérisés dans leur formulation par la présence de « marqueurs d’ultra-transformation », parmi lesquels les additifs alimentaires destinés à en améliorer l’apparence, le goût ou la texture afin de les rendre plus appétissants et plus attrayants : colorants, émulsifiants, édulcorants, exhausteurs de goût, etc. À l’heure actuelle, 330 additifs alimentaires sont autorisés en France et dans l’Union européenne. En outre, des ingrédients qui ne sont pas concernés par la réglementation sur les additifs alimentaires entrent aussi dans la composition des aliments ultratransformés. Il s’agit par exemple des arômes, des sirops de glucose ou de fructose, des isolats de protéines, etc. En raison des processus de transformation qu’ils subissent, ces aliments peuvent également contenir des composés dits « néoformés », qui n’étaient pas présents au départ, et dont certains peuvent avoir des effets sur la santé. Dernier point, les aliments ultratransformés sont généralement vendus dans des emballages sophistiqués, dans lesquels ils demeurent souvent conservés des jours voire des semaines ou mois. Ils sont aussi parfois réchauffés au four à micro-ondes directement dans leurs barquettes en plastique. De ce fait, ils sont plus susceptibles de contenir des substances provenant desdits emballages. Les procédés possibles et les additifs autorisés pour modifier les aliments sont nombreux. Face à la profusion d’aliments présents dans les rayons de nos magasins, comment savoir si un aliment appartient à la catégorie des « ultratransformés » ? Un bon point de départ pour savoir, en pratique, si un produit entre dans la catégorie des aliments ultratransformés est de se demander s’il contient uniquement des ingrédients que l’on peut trouver traditionnellement dans sa cuisine. Si ce n’est pas le cas (s’il contient par exemple des émulsifiants, ou des huiles hydrogénées, etc.), il y a de fortes chances qu’il s’agisse d’un aliment ultratransformé. Dans le groupe des aliments ultratransformés figurent par exemple les sodas, qu’ils soient sucrés ou édulcorés, les légumes assaisonnés de sauces contenant des additifs alimentaires, les steaks végétaux reconstitués ou les pâtisseries, les confiseries et barres chocolatées avec ajout d’additifs, les nouilles déshydratées instantanées, les yaourts édulcorés… Saucisses et jambons, qui contiennent des nitrites, sont classés comme « aliments ultratransformés », tandis qu’une viande simplement conservée en salaison est considérée comme des « transformée ». De la même façon, les soupes liquides en brique préparées uniquement avec des légumes, des herbes et des épices sont considérées comme des « aliments transformés », alors que les soupes déshydratées, avec ajout d’émulsifiants ou d’arômes sont classées comme « aliments ultratransformés ». Les aliments ultratransformés sont en moyenne plus pauvres en fibres et en vitamines que les autres aliments, tout en étant plus denses en énergie et plus riches en sel, en sucre et en acides gras saturés. En outre, ils pousseraient à manger davantage. De nombreuses études ont également montré que les régimes riches en aliments ultratransformés étaient par ailleurs associés à une plus faible consommation d’aliments nutritionnellement sains et favorables à la santé. Or, on sait depuis longtemps maintenant que les aliments trop sucrés, trop salés, trop riches en graisses saturées ont des impacts délétères sur la santé s’ils sont consommés en trop grande quantité et fréquence. C’est sur cette dimension fondamentale que renseigne le Nutri-Score. Il faut toutefois souligner que le fait d’appartenir à la catégorie « aliments ultratransformés » n’est pas systématiquement synonyme de produits riches en sucres, en acides gras saturés et en sel. En effet, la qualité nutritionnelle et l’ultra-transformation/formulation sont deux dimensions complémentaires, et pas colinéaires. Cependant, depuis quelques années, un nombre croissant de travaux de recherche ont révélé que les aliments ultratransformés ont des effets délétères sur la santé qui ne sont pas uniquement liés à leur qualité nutritionnelle. Afin de faire le point sur l’état des connaissances, nous avons procédé à une revue systématique de la littérature scientifique sur le sujet. Celle-ci nous a permis d’identifier 104 études épidémiologiques prospectives. Ce type d’étude consiste à constituer une cohorte de volontaires dont les consommations alimentaires et le mode de vie sont minutieusement renseignés, puis dont l’état de santé est suivi sur le long terme. Certains des membres de la cohorte développent des maladies, et pas d’autres. Les données collectées permettent d’établir les liens entre leurs expositions alimentaires et le risque de développer telle ou telle pathologie, après prise en compte de facteurs qui peuvent « brouiller » ces associations (ce que les épidémiologistes appellent « facteurs de confusion » : tabagisme, activité physique, consommation d’alcool, etc.). Au total, 92 des 104 études publiées ont observé une association significative entre exposition aux aliments ultratransformés et problèmes de santé. Les 104 études prospectives ont dans un second temps été incluses dans une méta-analyse (autrement dit, une analyse statistique de ces données déjà publiées), afin d’effectuer un résumé chiffré de ces associations. Les résultats obtenus indiquent que la mortalité prématurée toutes causes confondues était l’événement de santé associé à la consommation d’aliments transformés pour lequel la densité de preuve était la plus forte (une vingtaine d’études incluses dans la méta-analyse). Pour le formuler simplement : les gens qui consommaient le plus d’aliments ultratransformés vivaient en général moins longtemps que les autres, toutes choses étant égales par ailleurs en matière d’autres facteurs de risques. Les preuves sont également solides en ce qui concerne l’augmentation de l’incidence de plusieurs pathologies : maladies cardiovasculaires, obésité, diabète de type 2 et dépression ou symptômes dépressifs. La méta-analyse suggérait également une association positive entre la consommation d’aliments ultratransformés et le risque de développer une maladie inflammatoire chronique de l’intestin (quatre études incluses). En ce qui concerne les cancers, notamment le cancer colorectal, les signaux indiquant une corrélation potentielle sont plus faibles. Il faudra donc mener d’autres études pour confirmer ou infirmer le lien. Au-delà de ces études de cohorte, ces dernières années, diverses études dites « interventionnelles » ont été menées. Elles consistent à exposer des volontaires à des aliments ultratransformés et un groupe témoin à des aliments pas ou peu transformés, afin de suivre l’évolution de différents marqueurs biologiques (sur une période courte de deux ou trois semaines, afin de ne pas mettre leur santé en danger). C’est par exemple le cas des travaux menés par Jessica Preston et Romain Barrès, qui ont montré avec leurs collaborateurs que la consommation d’aliments ultratransformés entraînait non seulement une prise de poids plus importante que les aliments non ultratransformés, à calories égales, mais qu’elle perturbait aussi certaines hormones, et était liée à une baisse de la qualité du sperme. Ces résultats suggèrent que ce type de nourriture serait délétère à la fois pour la santé cardiométabolique et pour la santé reproductive. Les résultats de plusieurs essais randomisés contrôlés menés ces dernières années vont dans le même sens. Cinq ont été répertoriés et décrits dans notre article de revue, et d’autres sont en cours. Les aliments ultratransformés impactent donc la santé, et ce, très en amont du développement de maladies chroniques comme le diabète. D’autres travaux expérimentaux, comme ceux de l’équipe de Benoît Chassaing, révèlent que la consommation de certains émulsifiants qui sont aussi des marqueurs d’ultra-transformation perturbe le microbiote. Elle s’accompagne d’une inflammation chronique, et a été associée au développement de cancers colorectaux dans des modèles animaux. Rappelons que la majorité des additifs contenus dans les aliments ultratransformés n’ont pas d’intérêt en matière de sécurité sanitaire des aliments. On parle parfois d’additifs « cosmétiques », ce terme n’ayant pas de valeur réglementaire. Ils servent uniquement à rendre les produits plus appétissants, améliorant leur apparence ou leurs qualités organoleptiques (goût, texture) pour faire en sorte que les consommateurs aient davantage envie de les consommer. Ils permettent aussi de produire à plus bas coût, et d’augmenter les durées de conservation. En 2019, à la suite de l’avis du Haut Conseil de la santé publique, le quatrième programme national nutrition santé (PNNS) introduisait pour la première fois la recommandation officielle de favoriser les aliments pas ou peu transformés et limiter les aliments ultratransformés, tels que définis par la classification NOVA. À l’époque, cette recommandation se fondait sur un nombre relativement restreint de publications, notamment les premières au monde ayant révélé des liens entre aliments ultratransformés et incidence de cancers, maladies cardiovasculaires et diabète de type 2, dans la cohorte française NutriNet-Santé. Il s’agissait donc avant tout d’appliquer le principe de précaution. Aujourd’hui, les choses sont différentes. Les connaissances accumulées grâce aux nombreuses recherches menées ces cinq dernières années dans le monde ont apporté suffisamment de preuves pour confirmer que la consommation d’aliments ultratransformés pose un réel problème de santé publique. Dans le cadre de la cohorte NutriNet-Santé, nous avons, par exemple, désormais publié une douzaine d’articles montrant des liens entre la consommation d’émulsifiants, de nitrites, d’édulcorants ainsi que celle de certains mélanges d’additifs et une incidence plus élevée de certains cancers, maladies cardiovasculaires, d’hypertension et de diabète de type 2. De potentiels « effets cocktails » ont également été suggérés grâce à un design expérimental mis en place par des collègues toxicologues. Des indices collectés lors de travaux toujours en cours suggèrent également que certains colorants et conservateurs pourraient eux aussi s’avérer problématiques. Rappelons en outre qu’en 2023, le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) a classé l’aspartame comme « possiblement cancérigène » pour l’être humain (groupe 2B). Le problème est que nous sommes exposés à de très nombreuses substances. Or, les données scientifiques concernant leurs effets, notamment sur le long terme ou lorsqu’elles sont en mélange, manquent. Par ailleurs, tout le monde ne réagit pas de la même façon, des facteurs individuels entrant en ligne de compte. Il est donc urgent que les pouvoirs publics, sur la base des connaissances scientifiques les plus récentes, s’emparent de la question des aliments ultratransformés. Mais par où commencer ? Comme souvent en nutrition de santé publique, il est nécessaire d’agir à deux niveaux. Au niveau du consommateur, le cinquième programme national nutrition santé, en cours d’élaboration, devrait pousser encore davantage la recommandation de limiter la consommation d’aliments ultratransformés. Il s’agira également de renforcer l’éducation à l’alimentation dès le plus jeune âge (et la formation des enseignants et des professionnels de santé) pour sensibiliser les publics à cette question. En matière d’information des consommateurs, l’étiquetage des denrées alimentaires joue un rôle clé. La première urgence reste de rendre obligatoire le Nutri-Score sur l’ensemble des produits, comme cela est plébiscité par plus de 90 % de la population française, d’après Santé publique France. Les citoyennes et citoyens ont leur rôle à jouer en ce sens, en signant la pétition sur le site de l’Assemblée nationale. À ce sujet, soulignons que des évolutions du logo Nutri-Score sont envisagées pour mieux renseigner les consommateurs, par exemple en entourant de noir le logo lorsqu’il figure sur des aliments appartenant à la catégorie NOVA « ultratransformé ». Un premier essai randomisé mené sur deux groupes de 10 000 personnes a démontré que les utilisateurs confrontés à un tel logo nutritionnel sont nettement plus à même d’identifier si un produit est ultratransformé, mais également que le Nutri-Score est très performant lorsqu’il s’agit de classer les aliments selon leur profil nutritionnel plus ou moins favorable à la santé. Il est également fondamental de ne pas faire porter tout le poids de la prévention sur le choix des consommateurs. Des modifications structurelles de l’offre de nos systèmes alimentaires sont nécessaires. Par exemple, la question de l’interdiction de certains additifs (ou d’une réduction des seuils autorisés), lorsque des signaux épidémiologiques et/ou expérimentaux d’effets délétères s’accumulent, doit être posée dans le cadre de la réévaluation de ces substances par les agences sanitaires. C’est en particulier le cas pour les additifs « cosmétiques » sans bénéfice santé. Au-delà de la réglementation liée à la composition des aliments ultratransformés, les législateurs disposent d’autres leviers pour en limiter la consommation. Il est par exemple possible de réguler leur marketing et de limiter leur publicité, que ce soit à la télévision, dans l’espace public ou lors des événements sportifs, notamment. Ce point est d’autant plus important en ce qui concerne les campagnes qui ciblent les enfants et les adolescents, particulièrement vulnérables au marketing. Des tests d’emballage neutre – bien que menés sur de petits effectifs – l’ont notamment mis en évidence. Autre puissant levier : le prix. À l’instar de ce qui s’est fait dans le domaine de la lutte contre le tabagisme, il pourrait être envisageable de taxer les aliments ultratransformés et ceux avec un Nutri-Score D ou E et, au contraire, de prévoir des systèmes d’incitations économiques pour faire en sorte que les aliments les plus favorables nutritionnellement, pas ou peu ultratransformés, et si possible bio, soient les plus accessibles financièrement et deviennent les choix par défaut. Il s’agit aussi de protéger les espaces d’éducation et de soin en interdisant la vente ou la distribution d’aliments ultratransformés, et en y améliorant l’offre. Il est également fondamental de donner les moyens à la recherche académique publique, indemne de conflits d’intérêt économiques, de conduire des études pour évaluer les effets sur la santé des aliments industriels. Ce qui passe par une amélioration de la transparence en matière de composition de ces produits. À l’heure actuelle, les doses auxquelles les additifs autorisés sont employés par les industriels ne sont pas publiques. Lorsque les scientifiques souhaitent accéder à ces informations, ils n’ont généralement pas d’autre choix que de faire des dosages dans les matrices alimentaires qu’ils étudient. C’est un travail long et coûteux : lors de nos travaux sur la cohorte NutriNet-Santé, nous avons dû réaliser des milliers de dosages. Nous avons aussi bénéficié de l’appui d’associations de consommateurs, comme UFC-Que Choisir. Or, il s’agit d’informations essentielles pour qui étudie les impacts de ces produits sur la santé. Les pouvoirs publics devraient également travailler à améliorer la transparence en matière de composition des aliments ultratransformés, en incitant (ou en contraignant si besoin) les industriels à transmettre les informations sur les doses d’additifs et d’arômes employées, sur les auxiliaires technologiques utilisés, sur la composition des matériaux d’emballages, etc. afin de permettre l’évaluation de leurs impacts sur la santé par la recherche académique. Cette question de la transparence concerne aussi l’emploi d’auxiliaires technologiques. Ces substances, utilisées durant les étapes de transformation industrielle, ne sont pas censées se retrouver dans les produits finis. Elles ne font donc pas l’objet d’une obligation d’étiquetage. Or, un nombre croissant de travaux de recherche révèle qu’en réalité, une fraction de ces auxiliaires technologiques peut se retrouver dans les aliments. C’est par exemple le cas de l’hexane, un solvant neurotoxique utilisé dans l’agro-industrie pour améliorer les rendements d’extraction des graines utilisées pour produire les huiles végétales alimentaires. Le manque de transparence ne se limite pas aux étiquettes des aliments ultratransformés. Il est également important de vérifier que les experts qui travaillent sur ces sujets n’ont pas de liens d’intérêts avec l’industrie. L’expérience nous a appris que lorsque les enjeux économiques sont élevés, le lobbying – voire la fabrique du doute – sont intenses. Ces pratiques ont été bien documentées dans la lutte contre le tabagisme. Or, les aliments ultratransformés génèrent des sommes considérables. Cependant, si élevés que soient ces chiffres, les découvertes scientifiques récentes doivent inciter la puissance publique à prendre des mesures qui feront passer la santé des consommateurs avant les intérêts économiques. Il s’agit là d’une impérieuse nécessité, alors que l’épidémie de maladies chroniques liées à la nutrition s’aggrave, détruit des vies et pèse de plus en plus sur les systèmes de santé. Cet article est republié à partir de The Conversation sous licence Creative Commons. Lire l’article original. Texte intégral (4310 mots)
Qu’appelle-t-on « aliments ultratransformés » ?
Une classification pour indiquer le niveau de transformation
La classification NOVA
Dans les années 2010, le chercheur brésilien Carlos Monteiro et son équipe ont proposé une classification des aliments fondée sur leur degré de transformation. Celle-ci comporte quatre groupes :
Des aliments qui contiennent plus de sucre, plus de sel, plus de gras
Des effets sur la santé avérés, d’autres soupçonnés
Des résultats cohérents avec les travaux expérimentaux
Au-delà du principe de précaution
Quelles mesures prendre ?
Les leviers économiques
Un manque de transparence préjudiciable aux consommateurs
Le poids des enjeux économiques
Enjeux économiques
MERCOSUR : le grand bluff
Patrick Le Hyaric
Sous la pression des mouvements paysans, le Conseil européen a été contraint de reporter au 12 janvier prochain la signature du traité commercial entre l’Union européenne et les pays de la zone MERCOSUR – Brésil, Uruguay, Paraguay, Argentine, auxquels s’ajoute la Bolivie. Cette petite mise en scène cache, une nouvelle fois, le fond d’un texte dont l’unique objectif est de renforcer la spécialisation de l’Amérique latine dans une agriculture industrialisée et « chimisée », le pillage de ses minerais rares et l’ouverture de ses marchés aux industries européennes, en particulier allemandes. Le président de la République française ment lorsqu’il explique qu’il veut changer « la nature du traité ». Les négociations sont closes depuis le 6 décembre 2024. Il a validé le contenu du texte en 2019. En septembre, puis en novembre dernier, il a affirmé à plusieurs reprises que ce texte contenait des « éléments positifs ». Depuis six ans, aucun gouvernement français n’a proposé de modifier le traité ou le mandat de négociation de la Commission européenne. La semaine dernière encore, alors que le Parlement européen votait une résolution pour des « clauses de réciprocité » (ou clauses miroirs), visant notamment à imposer que les normes sanitaires et environnementales des pays du Mercosur soient élevées au niveau de celles de L’Union Européenne, la Commission européenne a torpillée le texte du parlement lors de la réunion de négociation entre le Parlement européen, la Commission et le Conseil dit trilogue. En réalité, ces fameuses « clauses miroirs » consistent, pour la Commission et le Conseil, à abaisser sans cesse les normes sanitaires et environnementales en vigueur au sein de l’UE afin de faciliter « le libre-échange capitaliste », « le libre commerce » et d’aller toujours plus loin dans l’application du principe de « concurrence libre et non faussée », au détriment des travailleurs-producteurs et des citoyens-consommateurs. Ajoutons deux questions politiques majeures : l’anti- démocratie et le service aux transnationales. Antidémocratie : le traité est désormais scindé en deux volets. L’un, portant sur la coopération politique, devrait être soumis au vote des parlements nationaux. L’autre, bien plus important, porte sur le volet « commercial ». Or, comme le commerce international relève, selon les traités européens, de la compétence exclusive de la Commission européenne, il ne sera pas soumis au vote des parlementaires nationaux. Ainsi, un traité discuté de bout en bout à l’abri des regards des peuples n’est même pas soumis à leurs représentants, pour laisser la main aux grandes multinationales. Service aux transnationales : le traité comprend un prétendu « mécanisme de rééquilibrage » qui permet aux grandes sociétés capitalistes de demander des compensations si une mesure prise par l’un des blocs de pays affecte « défavorablement le commerce ». Voilà qui réduit à néant toute clause de sauvegarde ou clause miroir. Ainsi, si l’Union européenne refuse sur son territoire le bœuf aux hormones et aux antibiotiques, ainsi que le soja OGM et traité avec des herbicides interdits, elle devra payer une amende aux sociétés transnationales, y compris européennes, qui pourraient juger que ces normes freinent le commerce et donc leurs profits. Enfin, depuis quelques jours, un argument nouveau est avancé pour culpabiliser celles et ceux qui refusent ce catastrophique traité : il serait nécessaire de le signer, pour compenser la faiblesse de l’UE sur la scène internationale. On peut alors se demander pourquoi l’Union européenne n’a pas travaillé main dans la main avec le président Lula et les pays des « BRICs » lors de la récente conférence sur le climat qui s’est tenue à Belém. On peut également s’interroger sur les raisons pour lesquelles la présidente de la Commission européenne s’est agenouillée devant Trump sur son parcours de golf en Écosse, et pourquoi notre Parlement continue d’exonérer les grandes multinationales du numérique à base nord-américaine de toute fiscalité. En vérité, nous connaissons les raisons : protéger le capitalisme mondialisé et ses oligopoles. L’Union européenne pourrait pourtant se renforcer et jouer un autre rôle « géopolitique » en protégeant une agriculture nourricière et en modernisant considérablement ses capacités industrielles, tout en tenant compte des exigences écologiques et sociales et surtout en cessant de se baigner dans un atlantisme destructeur. C’est un nouveau projet coopératif d’échanges et d’investissement qu’il conviendrait de rechercher avec les pays d’Amérique du Sud. Cela implique d’être lucide sur le grand bluff en cours. Le traité MERCOSUR ne doit pas être signé. Ni en décembre, ni en janvier. Lire aussi : M. Macron maquille sa capitulation sur le MERCOSUR [Image d’illustration créée avec IA] Texte intégral (957 mots)
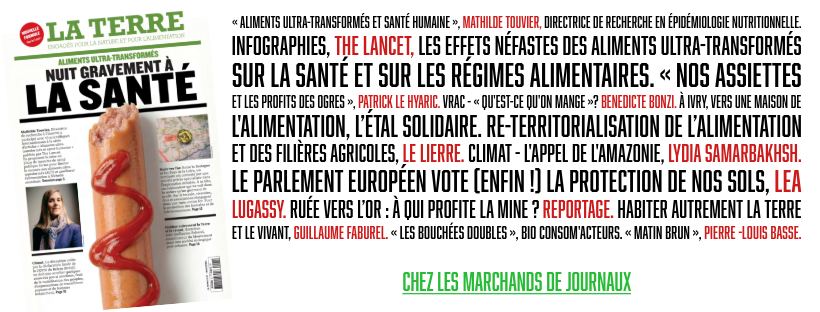
Nos assiettes et les profits des ogres
Fabrice Savel
Sommaire La Terre n°21 DOSSIER. Les aliments ultra-transformés dangereux pour santé engraissent les profits des industriels. ENTRETIEN. Mathilde Touvier, directrice de recherche en épidémiologie nutritionnelle, est co-autrice avec quarante chercheurs internationaux de la série d’articles « Aliments ultra-transformés et santé humaine » publiée par The Lancet. INFOGRAPHIES. Les effets néfastes des aliments ultra-transformés sur la santé et sur les régimes alimentaires. « Nos assiettes et les profits des ogres », l’éditorial de Patrick Le Hyaric. CHEZ LES MARCHANDS DE JOURNAUX ET PAR COMMANDE EN LIGNE EXPÉRIMENTATION. « Qu’est-ce qu’on mange ». VRAC, Vers un Réseau d’Achats en Commun, est une association qui existe depuis 10 ans, son objectif est de montrer que les habitant.e.s des quartiers populaires sont autant préoccupés que le reste de la population par bien se nourrir. Le regard de Bénédicte Bonzi, anthropologue, chercheure indépendante associée au Laboratoire d’Anthropologie du Politique (LAP). INITIATIVE. À Ivry, vers une Maison de l’Alimentation. Depuis bientôt neuf ans à Ivry (94), l’association L’Étal Solidaire organise des ventes de fruits et légumes bio à prix coûtant afin de rendre accessible aux habitants de cette ville de banlieue. DÉBAT. La re-territorialisation de l’alimentation et des filières agricoles est un enjeu stratégique pour faire face aux crises environnementale, climatique, géopolitique, et même démocratique, qui fragilisent aujourd’hui la sécurité alimentaire de la France. Avec l’association Le Lierre. IDÉE. Un agriurbanisme pour une agriculture paysanne. Par Gérard Thomas, Docteur en aménagement de l’espace et urbanisme. CLIMAT. L’appel de l’Amazonie. La presse s’est unanimement fait l’écho des déceptions créées par la déclaration finale de la COP30 de Belem (Brésil). Mais au point d’en occulter les quelques avancées pas si anodines qui sont surtout le fruit de la mobilisation des peuples, d’organisations de travailleurs-paysans et de femmes notamment. Par Lydia Samarbakhsh. BIODIVERSITÉ. Le Parlement Européen vote (enfin !) la protection de nos sols. Par Léa Lugassy, Directrice scientifique & technique chez Pour une Agriculture Du Vivant. REPORTAGE. Ruée vers l’or : à qui profite la mine ? Entre la Bretagne et les Pays de la Loire, un territoire est convoité par une société privée spécialisée dans l’exploration minière. À sa tête, un explorateur qui ne voit dans la nature qu’un gisement de profit. Sur le terrain, riverains, élus et associations s’engagent dans une ruée contre l’or. Pour la protection des humains et de l’environnement. HABITER AUTREMENT LA TERRE ET LE VIVANT. Entretien avec Guillaume Faburel, professeur d’études urbaines et de géographie, coordinateur du Mouvement pour une société écologique post-urbaine. AGROÉCOLOGIE. À l’occasion de ses 20 ans, l’association Bio Consom’acteurs a réuni les textes libres d’une série d’acteurs et d’actrices de la transformation écologique, économique et sociale qui, rassemblés, constituent l’ouvrage « Les Bouchées Doubles ». ACTUALITÉS. « Matin brun ». La chronique de Pierre-Louis Basse, écrivain, journaliste. Texte intégral (633 mots)
Dermatose, Mercosur… On achève bien les vaches
Patrick Le Hyaric
Voir les vaches et les veaux euthanasiés, chargés comme de vulgaires déchets par des camions-grues, installés au coin de l’étable, est une indescriptible tragédie pour les familles paysannes et leur entourage. Entendre, à l’aube, des animaux souffrant, appelant au secours, est un déchirement. L’émotion, le respect dû aux êtres doués de sensibilité, n’auraient jamais dû quitter l’action publique. Cela permettrait de mieux mesurer à quel point ce qui se passe dans les campagnes, avec la propagation de l’épidémie de dermatose nodulaire contagieuse, est un terrible drame. Cette maladie extrêmement dangereuse et contagieuse pour les animaux*, transmise par les piqûres de mouches appelées stomoxes, ne se soigne pas. Déjouant les frontières, elle est passée par le continent africain, où elle a décimé une grande partie du cheptel, puis remontée vers les Balkans, avant de toucher l’Asie puis d’apparaître en Sardaigne et en Lombardie au printemps 2025 avant de pénétrer en France par la Savoie. Comme tout virus, le nationalisme lui est donc totalement étranger. Un virulent virus qui condamne les animaux à de fortes fièvres, et à l’apparition de nodules sur la peau et les muqueuses. Une partie des vaches en meurent. Celles qui réussissent à survivre ont de telles séquelles et souffrances que leur vie devient insupportable. Ces raisons ont conduit le comité national d’orientation de la politique sanitaire animale et végétale sur la base des travaux scientifiques et vétérinaires à mettre en place le protocole actuel d’abattage ciblé donc à euthanasier des élevages entiers dès lors un animal malade y est détecté. Seulement, un troupeau n’est pas un chiffre. Il n’est même pas une image. Il est une création. Il est le résultat d’années, parfois de générations de travail, de soins, d’attentions, de sélection, de complicités aussi dans une osmose singulière entre le travail de l’éleveur et celui des vaches pour produire de la valeur ajoutée et de la nourriture avec le lait et la multitude de produits laitiers. C’est dans cet affect, dans ce travail commun entre l’être humain et l’animal et l‘ampleur des pertes de lignée et de production future, qu’il faut comprendre et mesurer l’irrépressible détresse paysanne qui se manifeste. De telles épizooties réduisent à néant des vies de labeur et de soins, ouvrant le sombre tunnel du découragement et de l’angoisse. Du désespoir souvent. Car la maladie ne se présente pas seule aux portes des difficultés et des souffrances. La dermatose comme les autres maladies qui apparaissent ces dernières années viennent encombrer le carrefour déjà embouteillé par un entremêlement d’enjeux locaux et internationaux : pression à la baisse sur les prix à la production alors que les coûts de production augmentent sans cesse ; concurrence déloyale organisée au sein de l’espace européen, traité de libre-échange qui écrasent notre production ovine, accélération du démantèlement de la production bovine et laitière avec le traité Mercosur, modifications climatiques, insécurité sanitaire, insertion toujours plus grande de la production agricole et alimentaire dans le vaste marché capitaliste mondial ou quelques grandes multinationales de l’agro-industrie et les marchés boursiers font la loi. Ce désarroi ne peut se traiter à coups de gaz lacrymogène contre des rassemblements de paysans choqués et en larmes refusant l’abattage systématique de leurs troupeaux. Il ne se traite pas non plus à coups de petites phrases ministérielles aussi sèches et dépourvues de la moindre empathie envers les travailleurs de la terre asphyxiés par dans un système économique qui marchandise tout en n’ayant que faire de la vie paysanne et de tout le vivant. Heureusement que ces travailleurs-paysans se rassemblent pour se faire entendre, pour partager leur tristesse, mais surtout pour combattre de fatales dépressions et semer des graines d’avenir. Le lien sur les barrages est l’ennemi du désespoir. C’est sur ces barrages paysans qu’il faut être pour s’informer, discuter, soutenir, et projeter avec les intéressés un nouveau modèle de production agricole et alimentaire ne niant rien de la science et de la médecine vétérinaire pour progresser vers la sécurité sanitaire humaine, animale et végétale. Un tel modèle est incompatible avec une orientation agricole tournant le dos à la reconquête de la souveraineté alimentaire et agricole au profit d’une agriculture d’exportation, une agriculture « compétitive » « ce pétrole vert » comme on le dit sous les lambris des bureaux ministériels et dans les bunkers de la commission européenne. C’est cette stratégie qui interdit depuis des mois de vacciner préventivement les 15 millions de bovins de notre pays. La vaccination empêcherait l’exportation. Or, nous n’exportons que 16% de la production française. Autant dire que les autorités ont refusé la vaccination générale à la seule fin de respecter le fameux « marché ouvert où la concurrence est libre ». C’est ubuesque ! On peut concevoir les inconvénients d’une interdiction d’exporter des animaux durant plusieurs mois. Cependant, abattre une partie du cheptel à cause de la maladie interdira de toute façon tout commerce car le cheptel national se réduira. D’autre part, ne serait-il pas utile de procéder à des études permettant des accords bilatéraux notamment avec l’Italie et l’Espagne pays récepteurs de nos exportations, afin de se mettre d’accord sur la santé des animaux et surtout sur les vaccinations massives et préventives dans nos pays ? En effet les traitements partiels en cours, n’immunisent pas contre un risque de réapparition de la maladie compte tenu du réchauffement climatique favorable à la multiplication des mouches vectrices de l’épidémie. Ce n’est donc pas de coupes budgétaires dont a besoin notre pays, mais de colossaux investissements pour des moyens de contrôle et d’anticipation de la circulation de virus mortels, dans la recherche sur de possibles nouvelles épizooties et pour le traitement préventifs des maladies animales et végétales ainsi que leurs implications sur la santé humaine. Les agences de sécurité sanitaire ont besoin d’être dotée de nouveaux moyens face aux risques qui grandissent. L’État doit investir urgemment pour construire un service public de santé animale à partir des centres de recherche existant qu’il conviendrait de renforcer et la mise en place de services publics vétérinaires régionaux chargés des détections, préventions et traitements lorsque cela s’avère nécessaire. Ajoutons que nous n’avons pour l’instant aucune confirmation que nos pays disposent d’un nombre de vaccins suffisants pour traiter tout le cheptel. Il est utile de préciser à ce propos que l’Afrique du Sud, si méprisée par les pays du Nord lorsqu’elle avait pris la tête des pays dit du « Sud global », militant pour une production suffisante et accessible de vaccins contre le Covid 19, est le pays qui aujourd’hui fournit le vaccin très efficace contre la dermatose nodulaire contagieuse (DNC)*. L’Union Européenne devrait se doter d’une banque publique de vaccins. Ce contexte renforce encore la nécessité de ne pas signer le traité Mercosur. Ni aujourd’hui, ni demain. Il appelle aussi à maintenir les crédits de la politique agricole commune (PAC) tout en les réorientant vers le travail et l’agro écologie, ainsi que les financements européens de développement régional. Ces deux postes d’investissement européen sont aujourd’hui menacés au profit de la stratégie militariste européenne. La prise en considération des multiples fonctions du travail paysan doit conduire à agir pour le sortir des entraves de son insertion dans le marché capitaliste mondialisé. Elle oblige à entendre le désarroi, la détresse et les appels au secours. On ne peut accepter sans frémir de compter un suicide de paysan chaque jour qui passe. De nouveaux moyens d’accompagnement, de détection et de soins des dépressions, des crises d’angoisses et des troubles liés à l’anxiété doivent être construits en coopération avec les associations d’aides aux paysans et la mutualité sociale agricole. Un moyen de réduire la pression serait d’engager un vaste plan de désendettement des exploitations agricoles par des renégociations de d’emprunts et des annulations de dettes. Il est temps de diriger nos regards vers les institutions bancaires et financières qui se repaissent du travail paysan. Nous parlons ici de vies croisées humaines et animales. Nous voudrions tracer dans les campagnes des sillons d’espoir, sans Mercosur, ni Dermatose ; sans mépris, ni surexploitation des paysans-travailleurs qui, en lien avec les scientifiques, portent une grande part de l’avenir du vivant. Patrick Le Hyaric 15 décembre 2025 * la dermatose nodulaire contagieuse (DNC) ne présente aucun risque pour les êtres humains. La loi santé animale qui encadre l’action sanitaire des éleveurs européens votés en 2021 la classe en catégorie A, soit comme une maladie à « éradication immédiate ». **Vaccin produit par le laboratoire Sud-Africain Onderstepoort Biological Products (OBP). Image by JackieLou DL from Pixabay Texte intégral (1703 mots)
Faites de La Terre, un nouveau projet pour une alimentation de qualité
Patrick Le Hyaric
Après notre dossier précédent sur les conséquences de la loi Duplomb, le nouveau numéro de La Terre qui paraît dans quelques jours porte en grand les résultats des recherches scientifiques sur la nocivité économique et sanitaire des aliments ultra-transformés dans le cadre d’un modèle agroalimentaire piloté par un capitalisme mondialisé de plus en plus barbare. Nous y valorisons aussi les initiatives pour le droit à l’alimentation et les expériences pour la réduction des déséquilibres et des inégalités territoriales. Chaque semaine qui passe désormais montre la nécessité impérative pour la santé humaine, animale, celle des sols et des eaux de dépasser le capitalisme agro-industriel et agrochimique afin d’inventer un nouveau projet agricole et alimentaire : Traité Mercosur, aliments ultra-transformés, volonté de la commission européenne de ré-autoriser des pesticides et des herbicides qu’elle a bannie il y a déjà des années pour leurs dangerosités, découvertes de PFAS dans les eaux de consommation… Pendant que plusieurs maladies difficilement maîtrisables touchent les troupeaux ovins et bovins. Avec d’autres actrices et acteurs, nous sonnons l’alerte sur ce système qui fait la part belle aux grandes firmes capitalistes qui épuise le travailleur-paysan, les sols qu’il cultive et les animaux qu’il élève. Pris dans ce terrible étau, les corps et les esprits des travailleurs-paysans sont si malmené que la Mutualité sociale agricole et les associations d’aide aux paysans en difficulté estiment que chaque jour se termine par un suicide. La Terre se fixe l’ambition de décrypter les rouages de ce capitalisme déchaîné qui fait régresser la civilisation. La Terre valorise, soutient tout ce qui s’expérimente de nouveau pour contrarier ce système carnassier : expériences coopératives, installations de jeunes agriculteurs à partir de projets participatif, circuits courts, expérimentation de la sécurité sociale de l’alimentation, projets municipaux alimentaires et celles et ceux qui portent une ruralité vivante avec la défense des services publics. Nous vous proposons de participer à ce projet global sur les enjeux de l’information avec la revue papier et la lettre électronique, bimestrielles, de débat et d’action avec le « Forum pour le droit à l’alimentation » et la création du réseau « Nous La Terre ». Il s’agit de créer des groupes locaux en lien avec d’autres forces associatives, politiques ou coopératives pour faire émerger une nouvelle stratégie agricole et alimentaire. « Nous La Terre » vous permettra de construire du lien, d’imaginer des actions progressistes contre les cultivateurs de haine et de division, de nous proposer des sujets d’enquête ou d’en réaliser vous-mêmes et de participer au soutien financier de La Terre. Déjà, de nombreuses lectrices et lecteurs, des amis ont versé un soutien à notre revue au travers du fonds de dotation « Humanité en partage » qui permet de bénéficier d’une réduction d’impôt de 66 %. En versant un don avant le 31 décembre vous devenez membre de l’association « Nous La Terre » et vous bénéficierez d’une déduction d’impôt pour cette année 2025. Une nouvelle rencontre par visio-conférence vous sera proposée dans les premiers jours de janvier prochain. Les enjeux sont capitaux : ruralité vivante et droit à l’alimentation. Texte intégral (746 mots)
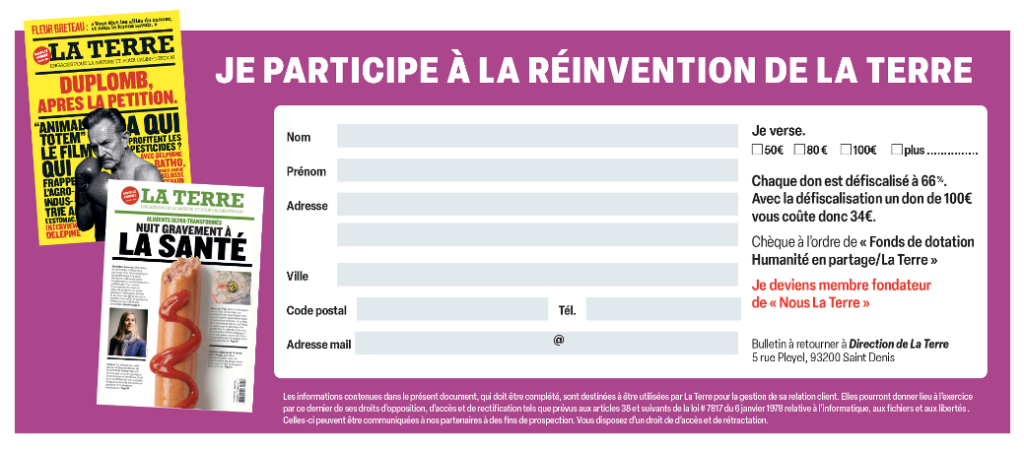
Benoît Delépine. « Ce système prédateur n’est pas récupérable »
Fabrice Savel
De l’aéroport de Beauvais à La Défense, accompagné de sa valise à roulettes, Darius traverse à pied campagnes et banlieues pour mener à bien une mystérieuse mission. Avec Animal Totem, Benoît Delépine signe un conte écologique, touchant, drôle, étonnant et enfin, radical. Un regard sur ce que la nature nous offre de plus beau. Avec une rétine de prédateur, la plus large possible, grâce au cinémascope anamorphosé. Une fable de La Fontaine version western dont la morale n’est jamais moralisatrice. Sortie le 10 décembre. Entretien. Votre film, Animal Totem, nous emmène dans un road trip à pied, sans empreinte carbone, dans les pas de Darius, le personnage principal, au cœur d’une nature grand format. Qu’est-ce qui a déclenché votre écriture de ce conte écologique ? Benoît Delépine : J’habite en Charente depuis maintenant 27 ans avec ma famille dans une ancienne ferme que nous avons restaurée petit à petit. Picard d’origine, je me sens charentais d’adoption. Il y a deux ans, un projet d’implantation d’une usine d’enrobé pour les routes menaçait de s’implanter dans la campagne environnante, en limite de zone Natura 2000. Mais aussi à proximité d’écoles et d’exploitations agricoles en bio. Avec les vents dominants, cela promettait d’emmener toute la pollution dans la vallée de la Charente. C’était vraiment honteux au moment où le gouvernement se gargarisait de l’objectif zéro artificialisation nette en France. Un mobilisation citoyenne locale s’est soulevée avec un collectif dont j’ai fait partie. Pendant cette bataille, j’étais vert de rage et pessimiste car nous redoutions de faire face à un rouleau compresseur tel qu’on peut le voir face à des projets comme l’A 69. Et du coup, dans le même temps, j’ai commencé à écrire le film. Je pensais que même si on perdait, au moins je me vengerais cinématographiquement et symboliquement. Mais, finalement, le bon sens l’a emporté et le projet a été abandonné. Par contre, moi j’étais lancé dans mon film que je ne voulais pas abandonner. J’avais également convaincu les producteurs. Et surtout, j’avais l’accord de l’acteur principal, Samir Guesmi, que je voulais absolument dans le film. C’est lui que je voyais avec ses grandes enjambées et son mélange de force et de douceur. Car je ne voulais pas d’un héros masculiniste, plutôt un pacifiste qui, tout d’un coup, estime que ça va trop loin et décide de passer à l’action. De nombreuses scènes nous placent du point de vue de l’animal. Avec le soin de n’être jamais moralisateur, le film interroge de nombreuses questions de société. C’est une fable de La Fontaine ? Benoît Delépine : C’est à la fois une fable de la Fontaine et à la fois un western, avec un personnage venu d’ailleurs, un peu mystérieux. J’aime les scénarios où l’on ne sait pas où on va, où tout s’explique à rebours… Là, je donne quand même des indices petit à petit. C’est pourquoi je signe « un conte de Benoît Delépine », avec un personnage de gros méchant assez caricatural, encore que… Olivier Rabourdin en acceptant sans hésiter le rôle m’a dit « dans tout conte, il faut un ogre » ! C’est lui qui m’a soufflé le genre de l’histoire. Il joue parfaitement son rôle d’ogre de la fable et c’est vrai que le personnage principal est une sorte de Petit Poucet. Oui, il y a bien une dimension fable avec une forme de morale à la fin. Dans le film, vous n’épargnez pas les grands quartiers d’affaires, les transports polluants et bruyants comme les avions, les grands patrons, la chasse, l’irrigation agricole, les pesticides, les réflexes sécuritaires, le racisme… Alors qu’elle est-elle la morale de cette histoire ? Benoît Delépine : D’abord, peut-être, revenir à une forme de simplicité, de lenteur, de respect et d’écoute de la nature. Mais le plus fort politiquement du film est à la fin. Sans la dévoiler, il y a quelque chose dans ce système prédateur qui n’est pas récupérable et que je voulais dénoncer au bout du compte. Cet été, plus de deux millions de personnes ont signé une pétition contre la réintroduction d’un pesticide contenu dans la loi Duplomb. La maladie et les pesticides sont abordés de façon drôle et sensible dans le film. Cela vient d’où cette sensibilité à vif sur ce sujet ? Directement de ma vie. Je suis fils d’agriculteur. Quand j’étais enfant, souvent, mon père rentrait des champs jaune des pieds à la tête. Je ne sais pas par quelle chance il y a résisté. Mais, oncles, tantes, cousin, mère, beaucoup trop de mes proches sont morts du cancer « en bonne santé », « elle ne fumait pas », « c’est la faute à pas de chance ». Mais je ne blâme pas les agriculteurs. J’ai des grands débats avec mon père qui est encore vivant. Il me dit à chaque fois « N’oublie pas, tu es un fils du glyphosate ». Parce qu’en fait, il s’était endetté pour acheter une ferme de 40 hectares dans l’Aisne. La ferme s’est révélée pourrie de chiendent. Pendant deux ans, il a passé son temps à racler, sarcler, il n’en voyait pas le bout, jusqu’au jour où à la coopérative on lui a dit « il y a un nouveau produit qui vient des Etats-Unis, tu pourrais essayer… » C’est pour ça qu’il me rappelle toujours que sans ça il aurait fait faillite. Je connais toutes ces contradictions. Pas loin de la ferme de mon père, il y avait l’usine Bonduelle. C’est pour ça qu’il faisait des haricots, des petits pois, etc. Il me disait, « tu vois, agriculteur, c’est comme ouvrier d’usine, sauf que c’est toi qui payes les machines ». Je n’ai pas envie de jeter la pierre à ces agriculteurs qui ont des crédits de fou sur le dos. On est face à une espèce de contradiction totale et destructrice. Avec Darius, il y a un second personnage principal, la nature et comme fil conducteur de l’histoire notre rapport à la nature… Benoît Delépine : Et inversement ! C’est pour cela que je voulais absolument avoir le regard des animaux sur l’humain. Pour cela on a trouvé une solution incroyable avec le format du film en cinémascope anamorphosé. Au départ, nous étions parti du cinémascope surtout pour rendre à l’image toute la beauté des paysages de Picardie qui ont jalonné mon enfance. Puis aussi pour la dimension western du film, etc. Mais au bout du compte, j’étais déçu… Jusqu’à ce qu’on enlève la marge de sécurité sur les côtés du format qu’on ne montre jamais parce que les télés n’en veulent pas… On a donc élargi l’image avec cette marge et ça donne une largeur de vue incroyable ! Un peu comme la vision de certains animaux. Et du coup, on a réalisé le film comme ça, avec le courage de mes producteurs. J’en ai joué à fond dans mes cadres, ça donne une ampleur très poétique. Nous avons aussi un deuxième chef opérateur, un jeune, qui ne fait que des films animaliers. Avec son matériel, ses caméras qui vont sous terre où sous l’eau, un drone pour la vision des oiseaux, on a pu tourné les scènes avec le regard animalier… Ça nous change du seul point de vue de l’humain. Texte intégral (1388 mots)
L’âcre goût du grand capital dans nos assiettes
Patrick Le Hyaric
Il m’arrive souvent de répondre à des interlocuteurs déclarant qu’ils ne font pas de politique, que, pourtant la politique se niche jusque dans leur assiette. Nous venons d’en avoir un sinistre aperçu en cette fin du mois de novembre. Il oblige à réfléchir tant il éclaire les choix du pouvoir en faveur du grand capital agro-alimentaire international. Une loi dite « climat » votée en 2021 édictent que le gouvernement devait publier une « Stratégie nationale pour l’alimentation, la nutrition et le climat » (SNANC) au plus tard le 1er juillet 2023. Ce texte à valeur juridique et politique a pour objectif de réorienter les politiques publiques afin d’améliorer la qualité alimentaire et nutritionnelle de la nourriture et d’inscrire le projet agroalimentaire dans la lutte contre le réchauffement climatique. Or, depuis trois ans, de mois en mois, la publication de ce texte a été retardée. Pourtant, il y a urgence. Cent-quatre études prospectives publiées ces dernières années ont démontré la nocivité des « aliments ultra-transformés* ». Le 19 novembre dernier, 43 experts internationaux de la santé et de la nutrition ont publié une série de trois articles documentés dans la revue « The Lancet » qui confirment les effets négatifs des aliments qui nous font de l’œil sur les étals des grands supermarchés après nous avoir alléchés à grand renfort de publicité. Nous parlons ici des céréales, boissons énergisantes, yaourts aromatisés, nuggets, pain de mie, barre chocolatées, sauces diverses, pâtes à tartiner, plats cuisinés etc. Ces aliments ultra transformés qui constituent désormais 80 % de l’offre alimentaire de la grande distribution sont bourrés d’additifs, de conservateurs, d’édulcorants, de colorants, d’émulsifiants et d’arômes divers qui provoquent diabète, accident vasculaire cérébral (avc), cancers, dépression. Les substances ajoutées pour améliorer la conservation, le goût, l’odeur ou la texture des aliments les rendent plus appétissants pour nous rendre plus dépendants. Les scientifiques ont également démontré que de nombreux composés toxiques (furanes, amines hétérocycliques, hydrocarbures aromatiques polycycliques) sont produits à l’occasion de la transformation de la nourriture et des perturbateurs endocriniens comme les phtalates, bisphénols ou PFAS peuvent migrer des emballages vers les aliments**. Pour vendre leurs produits alimentaires industrialisés les trois grands groupes américains Coca-Cola, PepsiCo et Mondelez International n’ont pas hésité à dépenser 13,2 milliards de dollars en alléchante publicité. Cette somme astronomique équivaut à quatre fois le budget de l’Organisation mondiale de la santé. Cette comparaison est d’autant plus pertinente que le lien entre ce que nous mangeons et notre santé est aujourd’hui largement démontrée. C’est dans ce contexte d’accumulation de preuves contre les effets néfastes d’un modèle agricole et alimentaire défini par les choix rapaces du complexe agro-industriel que finalement le gouvernement devait rendre public vendredi 28 novembre sa stratégie nationale pour l’alimentation. Rien de révolutionnaire dans ce texte qui, comme à l’accoutumé demande à chacune et chacun de faire attention, de ne pas laisser trop les enfants devant les publicités diffusées en continue par les écrans et d’autres mesurettes du même type. Rien qui ne puisse contrarier les mastodontes de l’alimentaire comme Nestlé, Unilever, Kraft Heinz, Coca-Cola, Danone et autres qui pratiquent le gavage des actionnaires de dividendes grâce à l’exploitation du travail paysan, celui de millions de salariés prolétarisés et les familles populaires qui doivent se nourrir d’aliments méconnaissables par nos champs et nos étables, éjectés de leurs longues chaînes de production. Ces groupes étaient d’autant plus tranquilles que le programme gouvernemental avait été expurgé d’une recommandation qui existait dans les textes préparés par de précédents gouvernements appelant précisément à « limiter les aliments ultra-transformés ». Juste « limiter ». Mais même cela est trop pour ces grands parasites qui font leur beurre dans nos assiettes. La révélation par la cellule investigation de Radio-France de cette hypocrite biffure a contraint le gouvernement à ne pas rendre public son texte. Soudain la connivence entre le pouvoir et la grande industrie agroalimentaire, représentée par l’Association nationale des industries agroalimentaires(ANIA), a bondie au grand jour, dans un contexte de rejet populaire des politiques gouvernementales. Ce nouveau front ouvert sur un enjeu de santé publique, comme les révélations à propos de la fameuse loi Duplomb a donc contraint à ce nouveau recul de publication. L’affaire est encore aggravée par le fait que le directeur de la communication de l’ANIA a rejoint, comme par hasard, le cabinet du Premier ministre le 21 novembre. Ainsi, les intérêts du grand capital international conduisent le pouvoir à ne pas appliquer la loi pour ne pas freiner sa soif de profit. Les nouveaux petits chefs de guerre contre le droit et les « normes », leurs amis pique-assiettes, et les pillards qui vivent sur le dos des travailleurs et des citoyens consommateurs, n’ont que faire de ce que nous mangeons, de la santé publique et de la nature. Ils provoquent un basculement de civilisation dans lequel l’intérêt général, humain et écologique passe au second plan jusqu’à l’effacer tragiquement des réflexions stratégiques et des politiques publiques, concomitamment à l’acharnement des mandataires du capital à délaisser le secteur public de la santé et à tenter d’offrir la sécurité sociale et les retraites aux assurances privés et aux fonds de pensions. Ne nous trompons pas. Il n’y a ici nulle erreur mais les besoins et la volonté d’un système aussi cohérent que brutal, aussi rapaces qu’inhumain: celui qui fait du paysan travailleur un extracteur de minerais écrasé par les bas prix, les dettes, mis en concurrence avec les autres paysans, extracteurs de minerais des quatre coins de la planète. Les uns et les autres, enchaînés, dépendant d’un tentaculaire complexe agro-industriel mondialisée et de plus en plus concentré , exploitant ses travailleuses et travailleurs, exigeant des traités de libre-échange, la fin des règles et des normes sociales, environnementales, sanitaires, formatant les goûts, décidant des productions, payant de faux articles de presse et de fausses études, prospérant sur l’austérité des collectivités locales ou des hôpitaux pour fournir ses marchandises à bas prix et profitant d’un mode d’organisation d’une société urbanisée, d’une organisation du travail et du temps de travail qui privent les familles populaires du temps pour cuisiner des produits frais et sains. De nouvelles réglementations sont certes indispensables comme les mises en garde sur les emballages, l’interdiction de vente d’aliments ultra transformés dans les écoles et autres collectivités, la réduction de la publicité, la réduction d’un certain nombre d’ingrédients, particulièrement des édulcorants ou les émulsifiants. Mais l’enjeu est plus profond, plus systémique. C’est cette barbarie capitaliste qu’il faut dépasser pour la remplacer par un nouveau projet civilisationnel attentif aux êtres humains, à l’environnement, à l’ensemble du vivant. Dans celui-ci, les travailleuses et les travailleurs de la terre, celles et ceux des industries agroalimentaires, les productrices et producteurs de savoirs et de soins dans les laboratoires et les centres de santé, comme les citoyennes et citoyens consommateurs doivent reprendre le pouvoir sur leur vie, sur leur alimentation et donc sur la production et le travail. Tel est la hauteur de l’enjeu. Ce n’est pas simplement et seulement comme on l’entend une question de « lobbying » sur les gouvernements. Ce qui se joue ici comme ailleurs, c’est la poursuite d’un capitalisme dont le divorce d’avec la civilisation est largement consommé. Ce système qui détruit la nature, met en cause la santé humaine en s’invitant sans autorisation dans nos assiettes et nos verres, se gavant de surcroît de la guerre, doit être urgemment dépassé dans un processus communiste de transformation civilisationnelle. Un combat de haute intensité pour le droit à une alimentation de qualité en quantité suffisante peut ouvrir ce chemin. * Les aliments ultra transformé (AUT) sont catégorisés par la recherche internationale, l’organisation mondiale de la santé, la FAO (Food and agriculture organisation) . Ce sont des aliments contenant des aliments traité technologiquement dans lesquels on a inclut des ingrédients qu’on ne trouve pas dans les foyers comme les émulsifiants, sirop de glucose, arômes, colorants alimentaires, conservateurs. ** extrait de l’étude publiée par « The Lancet ». « Le remplacement des régimes alimentaires traditionnels par des aliments ultra transformés constitue un moteur majeur de l’augmentation mondiale du fardeau des maladies chroniques liées à l’alimentation ». Texte intégral (1548 mots)
Biodiversité alimentaire, microbiote et bien-être : la recherche explore les liens potentiels
The Conversation
Par Émeline Roux, Maître de conférences en biochimie alimentaire et Gaëlle Boudry, Chargée de recherche, responsable d’équipe Institut Numecan, Inrae. Déborah Maurer Nappée (étudiante en master 2 Nutrition et sciences des aliments de l’Université de Rennes) a contribué à la rédaction de cet article. Une alimentation variée en termes de diversité d’espèces végétales consommées est essentielle à la santé pour son apport en fibres et en nutriments. La recherche s’intéresse à cette biodiversité alimentaire qui pourrait aussi se révéler précieuse pour le bien-être mental, notamment par l’entremise du microbiote intestinal. L’industrialisation de l’agriculture et le développement de l’industrie agroalimentaire ont favorisé les monocultures induisant une baisse drastique de la biodiversité alimentaire, depuis le XXe siècle. Actuellement, douze espèces végétales et cinq espèces animales fournissent 75 % des cultures alimentaires mondiales, selon l’organisation non gouvernementale World Wide Fund (WWF). Et trois espèces végétales sont produites majoritairement dans le monde : le maïs, le blé et le riz, malgré une estimation de plus de 7 000 (peut-être même 30 000) espèces végétales comestibles, rappelle l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO). Il est important de différencier la diversité alimentaire qui représente la consommation de grands groupes alimentaires comme les produits laitiers ou les fruits et les légumes… de la biodiversité alimentaire qui prend en compte chaque espèce biologique (animale et végétale) consommée par un individu. Par exemple, si un individu mange des carottes, des poivrons et des artichauts, en termes de diversité alimentaire, un seul groupe – celui des légumes – sera comptabilisé, contre trois espèces en biodiversité alimentaire. Or, tous les légumes n’apportent pas les mêmes nutriments et molécules actives. La biodiversité alimentaire est donc importante pour couvrir tous nos besoins. Une fois ingérés, les aliments impactent notre organisme, et ce, jusqu’au cerveau, notamment via le microbiote intestinal. Le microbiote intestinal représente l’ensemble des microorganismes (bactéries et autres) qui se trouvent dans le tube digestif, en particulier au niveau du côlon. Cela représente un écosystème complexe avec environ 10 000 milliards de microorganismes. Un microbiote sain et équilibré est caractérisé par une grande diversité bactérienne et la présence de certaines espèces bactériennes. L’état de santé ou l’alimentation peuvent moduler la composition de notre microbiote en quelques jours. Par ailleurs, l’impact de l’alimentation pourrait, après plusieurs mois, se répercuter sur le bien-être mental. Parmi les molécules de notre alimentation, qui impactent de façon bénéfique notre microbiote, se trouvent les fibres végétales. Ces longues chaînes glucidiques ne sont pas hydrolysées par les enzymes humaines, mais constituent le substrat principal de bactéries importantes du microbiote. En dégradant les fibres, des métabolites sont produits par certaines bactéries (par exemple, Bifidobacterium, Lactobacillus, des espèces du phylum des Bacillota), dont les acides gras à chaîne courte (AGCC) : acétate, propionate et butyrate. Le butyrate, en particulier, agit sur certains paramètres biologiques et pourrait exercer des effets bénéfiques sur la santé physique et mentale. En effet, le butyrate module la réponse immunitaire par stimulation des cellules immunitaires et exerce une action anti-inflammatoire en augmentant l’expression de certains gènes. Il permet également de diminuer la perméabilité de l’épithélium intestinal et donc de limiter le passage de molécules inflammatoires ou toxiques dans la circulation sanguine. Par ailleurs, certains neurotransmetteurs comme la sérotonine, l’acide gamma-aminobutyrique (GABA) ou la dopamine sont synthétisés à partir de précurseurs apportés par l’alimentation. L’augmentation de la concentration des précurseurs suivants aurait un impact positif sur le cerveau : le tryptophane (présents notamment dans le riz complet, les produits laitiers, les œufs, la viande et le poisson, les fruits à coque…) pour la sérotonine ; le glutamate qui représente 8 à 10 % de la teneur en acides aminés dans l’alimentation humaine, les acides aminés étant les constituants de base des protéines alimentaires (on retrouve le glutamate dans les produits laitiers, graines oléagineuses, viandes et produits de la mer). Il est le précurseur du neurotransmetteur GABA (qui est également directement présent dans le riz brun germé ou les aliments fermentés) ; la tyrosine (présente notamment dans les fromages à pâtes pressées cuites, les graines de soja ou la viande) pour la dopamine. Il est recommandé de consommer de 25 grammes à 38 grammes de fibres quotidiennement, apportées via la consommation de végétaux (cf. tableau ci-après). Or la moyenne française en 2015 était inférieure à 18 grammes d’après une étude de Santé publique France. On soulignera néanmoins que, lorsqu’on souhaite augmenter son apport en fibres, pour éviter les effets indésirables de leur fermentation dans le colon, il est conseillé de les réintroduire progressivement dans son alimentation au cours de plusieurs semaines. Enfin, d’autres nutriments jouant un rôle important sur la santé mentale par une action directe sur le cerveau ont aussi une action indirecte en modulant le microbiote intestinal ou en étant précurseurs de métabolites bactériens ayant un effet au niveau du système nerveux central (qui inclut le cerveau). Ainsi, un ratio équilibré oméga-3/oméga-6 (1 :4) exerce des effets bénéfiques sur le microbiote intestinal. Mais dans l’alimentation occidentale, le ratio est déséquilibré en faveur des oméga-6, ce qui engendre un état inflammatoire. Les aliments les plus riches en oméga-3 sont issus de végétaux terrestres (l’huile de lin, de colza, etc.) et d’animaux marins (les poissons gras comme le saumon, le maquereau, le hareng, la sardine et l’anchois, etc.), explique l’Agence nationale de sécurité sanitaire (Anses). En revanche, l’huile de tournesol et de pépin de raisin sont très riches en oméga-6, participant ainsi au déséquilibre des apports. Une alimentation riche en polyphénols (certaines épices, cacao, baies de couleur foncée, artichauts…) confère également des effets bénéfiques anti-inflammatoires via la modification du profil du microbiote intestinal. Enfin, les vitamines ou minéraux participent aux fonctions de base de l’organisme. Une alimentation biodiversifiée permet un apport complet de tous ces nutriments (cf. les recommandations sur le site de l’Anses et du Programme national nutrition santé [PNNS]). Des données existent sur la teneur moyenne en nutriments de ces aliments et leur saisonnalité (site Ciqual). Cependant, les aliments n’apportent pas tous les mêmes classes de nutriments. Pour donner un exemple concret, un artichaut cuit contient assez de fibres (11 g/100 g) pour satisfaire les besoins journaliers, mais sera pauvre en vitamine C (moins de 0,5 mg/100 g), contrairement au brocoli cuit plus riche en vitamine C (90 mg/100 g), mais assez pauvre en fibre (2,4 g/100 g). Ainsi, la prise en compte de la biodiversité alimentaire est essentielle pour évaluer les apports totaux en ces différents nutriments. Afin d’avoir un bon état de santé physique et mentale, il est recommandé de diversifier les sources alimentaires pour couvrir l’ensemble des besoins. Cependant, la disponibilité en aliments varie selon les saisons. Le tableau ci-dessous présente quelques propositions d’associations d’aliments de saison pour couvrir nos besoins quotidiens en fibres. Exemples d’aliments de saison à consommer pour avoir un apport journalier suffisant en fibres totales (Sources : Ciqual et ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire) A contrario, l’organisme est impacté négativement par d’autres facteurs, comme l’exposome qui représente l’ensemble des expositions environnementales au cours de la vie. Ainsi, les xénobiotiques (par exemple, les pesticides), qui impactent la croissance et le métabolisme des bactéries du microbiote intestinal, qui, en retour, peut bioaccumuler ou modifier chimiquement ces composés. Les aliments issus de l’agriculture biologique contiennent beaucoup moins de xénobiotiques et sont donc recommandés. Enfin, l’utilisation d’ustensiles de cuisine en plastique ou en téflon, entre autres, peut notamment engendrer la libération de perturbateurs endocriniens ou de polluants persistants (comme les substances per- et polyfluroalkylées PFAS) qui vont se bioaccumuler dans les bactéries du microbiote intestinal. De ce fait, il est recommandé de limiter leur utilisation au profit d’autres matériaux alimentaires (inox, verre). Différentes molécules et facteurs impactant le microbiote intestinal et susceptibles d’agir sur le bien-être mental Adopter une alimentation variée est donc essentiel pour couvrir les besoins nutritionnels à l’échelle moléculaire, et cela impacte de manière bénéfique la santé physique mais aussi mentale, notamment via le microbiote. Toutefois, il est important de prendre soin de son alimentation sans tomber dans une anxiété excessive, qui pourrait engendrer des troubles alimentaires et nuire finalement au bien-être global, la notion de plaisir restant essentielle dans l’alimentation. Cet article est republié à partir de The Conversation sous licence Creative Commons. Lire l’article original. Texte intégral (2192 mots)
De l’intérêt de la biodiversité alimentaire pour le microbiote intestinal
Fibres, microbiote, neurotransmetteurs et bien-être mental
De l’intérêt de consommer davantage de fibres végétales
Favoriser aussi un bon ratio oméga-3/oméga-6, vitamines, minéraux, etc.
Quels aliments apportent quelles classes de nutriments ?
L’impact des PFAS, pesticides et perturbateurs endocriniens à ne pas négliger
La cartographie alarmante des services publics dans l’Allier
La Terre
Par Nathalie Calmé Face à la dégradation des services publics dans l’Allier, l’Union Départementale CGT a entrepris une démarche de reconquête. Après un an et demi de travail, elle publie un livret « Des services pour le développement de l’Allier », dans lequel elle dresse un état des lieux sans concession des services du département. Cette cartographie repose sur une démarche minutieuse : « Nous avons croisé les données de l’INSEE avec les retours des syndicats des différentes professions, des agents et des usagers, explique Laurent Indrusiak, secrétaire général de l’UD CGT. Chaque secteur a été passé en revue : effectifs, besoins de la population, évolution des dotations. Le constat est sévère : « Tous les services n’ont cessé de subir des coups de rabot ! » tranche le syndicaliste, mais certains illustrent bien la situation : « Il y a encore dix ou quinze ans, le département comptait une trentaine de points d’accueil des finances publiques. Aujourd’hui, il n’en reste plus que trois : Montluçon, Moulins et Vichy », déplore-t-il. « Des habitants parcourent des dizaines de kilomètres, parfois des centaines, pour un simple renseignement cadastral ou pour payer leurs impôts ». Il en va de même pour la santé : « Nos trois grands hôpitaux connaissent des difficultés financières majeures. Des services entiers ont disparu, obligeant des patients à se rendre jusqu’à Clermont-Ferrand ou Vichy pour se faire soigner. » Pour la mobilité, autre secteur en tension, le bassin de Montluçon paie lourdement les réductions de l’offre ferroviaire. « Relier Montluçon à Paris prend aujourd’hui plus de temps qu’il y a quarante ans, et encore, quand il y a un train ! », ironise-t-il. Quant à la Poste, « des dizaines de bureaux ont fermé et ont été remplacés par des agences postales installées dans des commerces. Le service n’est pas du tout le même ». Pour la CGT, ces fragilisations ne doivent rien au hasard. « C’est très clairement le résultat de choix politiques libérales, depuis le tournant de la rigueur en 1983, qui ont mis en concurrence les territoires, imposé la rentabilité aux hôpitaux, privilégié les grandes lignes ferroviaires au détriment des dessertes locales », dénonce-t-il. Et de poursuivre : « On nous répète que les services publics coûtent trop cher. C’est faux ! Notre rôle est d’expliquer, de déconstruire cette idée reçue. Lorsqu’on montre aux Bourbonnais – parfois victimes de désinformation à travers les grands médias – ce que coûte une privatisation ou ce que signifie une fermeture de service dans leur commune, ils comprennent et adhèrent à cette démonstration ». Face à cette crise, le syndicat avance des solutions claires : « La première mesure, c’est le recrutement massif d’agents. La deuxième, c’est de redonner de vrais moyens financiers aux services publics, en renforçant le rôle des collectivités et des échelons locaux. Cela permettrait de ramener de la proximité dans les décisions et dans l’action. La troisième, c’est d’assumer une politique à rebours de ce qui a été mené depuis des décennies : réinvestir le territoire, rouvrir des services publics (la Poste, les hôpitaux, les gares…) dans les villes moyennes, les quartiers populaires, les campagnes, là où vivent les gens ». Laurent Indrusiak considère que les élus sont des acteurs à part entière : « Eux-aussi subissent dans leurs communes les conséquences de la disparition des services publics. Certains se retrouvent face à leurs contradictions : ils ont parfois soutenu, via leur famille politique, les politiques libérales qui ont fragilisé les services, et constatent ensuite leur disparition sur leur propre territoire. Leur présence à nos réunions permet qu’ils entendent ce que vivent la population et les agents ». La CGT entend également avancer avec les autres organisations syndicales. Des échanges réguliers existent déjà, notamment dans l’Éducation nationale ou sur les finances publiques avec Solidaires. « L’idée, c’est de bâtir des initiatives unitaires, d’élaborer des cahiers revendicatifs communs, interpeller ensemble les élus locaux ou les représentants de l’État » Un autre point central du rapport concerne les collectivités locales. « Elles ont vu leurs dotations baisser en moyenne de 40 % ces dernières années. Alors que la décentralisation devait renforcer la proximité, elle a en réalité abouti à une recentralisation dans les grandes villes. Ce que nous demandons, c’est un vrai redéploiement des moyens là où on les a supprimés » Effectivement la question des financements revient sans cesse. Mais, pour la CGT, ce n’est pas un problème d’argent mais « de politique et de société » . « On nous explique que la France serait au bord de la faillite. Ce n’est pas vrai : notre pays reste la sixième ou septième puissance économique mondiale, souligne-t-il. Chaque année, près de 211 milliards d’euros d’aides publiques sont versés aux entreprises – certains parlent même de 270 milliards. Une partie de ces sommes pourrait être réorientée vers le financement des services publics ». Le livret a été remis au préfet de l’Allier. Il doit servir à faire vivre le débat démocratique, sensibiliser la population et interpeller les décideurs. Ainsi, après deux premières étapes à Bourbon-l’Archambault et Commentry, la CGT va lancer un « village public » itinérant dans les grands bassins de vie du département et dans plusieurs petites commune ; l’objectif étant d’aboutir à l’organisation d’États généraux des services publics dans l’Allier. Le syndicat refuse que l’Allier soit un territoire sacrifié. « Nous ne pouvons pas nous contenter d’être les spectateurs en désarroi d’un département en perte de vitesse, considéré comme un territoire de relégation des métropoles riches et attractives ». Le syndicaliste met en garde contre les dérives politiques que peut engendrer ce sentiment d’abandon. « La désespérance de ces territoires nourrit le terreau du vote d’extrême droite. Nous disons aux habitants : ne vous laissez pas emporter par de fausses solutions qui ne feront qu’accentuer le repli et la diminution de moyens pour le monde du travail ! ». Télécharger le Livret « Des services pour le développement de l’Allier » Texte intégral (1171 mots)
MERCOSUR ou le capitalisme chimiquement pur
Patrick Le Hyaric
Grand spécialiste du double langage, souvent, le président varie. À Belém, jeudi 6 novembre, il considérait « très positif » la possibilité d’aboutir à un accord sur le traité du MERCOSUR. Moins de huit jours plus tard, à Toulouse, devant une délégation de syndicalistes agricoles, il proclame que ce traité, « tel qu’il existe aujourd’hui, recueillera un non-ferme de la France ». Quand faut-il le croire, alors que, déjà, lors de la dernière réunion du Conseil européen, il avait expliqué que « tout allait dans le bon sens » sans préciser lequel ni pour qui ! Il n’est en fait qu’une froide et vulgaire girouette, servile à la violence du vent que souffle un capitalisme mutant mondialisé. Car le traité MERCOSUR est l’une des pierres philosophales du capitalisme chimiquement pur. Il n’est pas un traité de coopération, mais le déploiement d’une première colonne de chars contre nos terroirs et territoires, contre la santé humaine, celle des animaux et des terres, contre le climat et la biodiversité. On ne peut sous-estimer ni les mensonges qui l’entourent pour mieux brouiller les pistes, ni l’ampleur du projet qu’il ordonne. Non seulement ce texte se prépare dans le dos des peuples, mais voici qu’est déployée une charretée d’artifices pour le mettre en œuvre sans l’aval des parlements nationaux. En effet, le projet d’accord a été artificiellement scindé en deux, avec un volet commerce et un volet coopération. Et seul ce second volet doit être soumis aux parlements de chacun des pays de l’Union européenne. Autrement dit, les grandes transnationales qui dominent le commerce mondial ne se verront opposées aucune barrière pour imposer le traité qu’elles réclament à cor et à cri. Quelle est belle la démocratie libérale européenne ! Les pays du MERCOSUR pourraient donc exporter demain vers l’Union européenne du bœuf aux hormones et des poulets aux antibiotiques au détriment de la santé. Il est plus que curieux qu’une disposition inscrite dans le traité UE-Nouvelle Zélande interdisant aux industriels néo-zélandais d’exporter de la viande bovine produite dans des centres d’engraissement industriels (feedlots) ne soit pas reprise dans le MERCOSUR. En effet, il n’y a quasiment pas de tels centres d’engraissement en Nouvelle-Zélande, alors que l’élevage brésilien est basé sur ce modèle de milliers d’animaux qui ne voient jamais ni champs, ni brin d’herbe. Le président de la République veut faire croire qu’il aurait obtenu des mécanismes dits de « sauvegarde » – une clause de sauvegarde qui permet de bloquer les importations en cas de déséquilibres « des marchés » – Il s’agit d’une grosse tromperie ! Il n’a rien obtenu. Ce mécanisme existe déjà dans le texte depuis 2019. Ajoutons que le déclenchement de « la clause de sauvegarde » est si long et si compliquée, qu’elle n’a aucune efficacité. Le ralliement net de l’Élysée au MERCOSUR a une autre raison. S’inscrivant dans le militarisme européen décidé au dernier sommet de l’OTAN, les autorités allemandes ont promis aux dirigeants Français d’acheter les armes produites dans les usines françaises. L’Allemagne se trouve, en effet, prise en tenailles entre d’une part les sanctions contre la Russie qui la privent d’une énergie bon marché et la rendent dépendante à l’achat de pétrole et de gaz américains pour faire fonctionner ses usines, alors que Trump veut, dans un premier temps, de moins en moins de voitures allemandes aux États-Unis, avant de pouvoir liquider les fleurons d’Outre-Rhin. Pour soutenir ses firmes, l’Allemagne veut donc vendre ses voitures aux pays d’Amérique du Sud afin de se donner un peu d’oxygène face à l’offensive des groupes capitalistes nord-américains. Cette dépendance est aussi militaire puisque l’Allemagne achète le matériel américain au détriment des équipements européens, particulièrement français. La transaction porte donc sur l’approbation plus ou moins tacite du traité MERCOSUR par la France, en échanges de la promesse allemande d’achats d’armes supplémentaires produites sur notre territoire national. Sur cette base et à la demande des firmes capitalistes européennes, M. Macron s’engage dans ce processus en maquillant la vérité. Il perdra sur tous les tableaux. Car le gouvernement allemand et bien d’autres continuent et continueront de s’approvisionner en matériel militaire américain. Ce commerce et ces marchandages peu ragoûtants se font contre la santé de toutes et de tous et contre le climat. Car l’autre grand gagnant de ce funeste projet est l’industrie des pesticides, particulièrement la firme Bayer-Monsanto. Le projet d’accord prévoit l’abaissement des droits de douane sur les exportations de produits chimiques depuis l’Union européenne vers l’Amérique Latine, y compris pour les insecticides et pesticides interdits d’utilisation au sein de l’Union européenne. Déjà, le Brésil est le premier utilisateur mondial de pesticides et la seconde destination des produits phytosanitaires interdits dans l’Union européenne. Pire encore. Pour ficeler l’ensemble, le traité comprend un mécanisme juridique dit « de rééquilibrage ». Que signifie juridiquement ce mot ? Cet ajout permet à l’une des parties signataires ou plutôt à leurs multinationales de demander des compensations à l’autre partie si « une mesure prise par l’autre partie affecte défavorablement le commerce ». En vertu de cet article, l’Union européenne ne pourrait pas voter des règles empêchant les importations de produits traités avec tel ou tel pesticide interdit sur nos territoires, sans compenser financièrement les sociétés (y compris européennes) installées au sein du MERCOSUR. En résumé, pouvoir est donné aux multinationales qui exportent à partir de l’Amérique du Sud de combattre nos propres lois à l’aune de leur seul intérêt commercial ou de leurs profits. C’est la légalisation de la perte de souveraineté des États au profit du grand capital. C’est au regard de cet article qu’il faut juger la fausseté de la promesse des fameuses « clauses miroirs », c’est-à-dire le conditionnement de l’accès au « marché » européen au respect des normes sanitaires et de durabilité en vigueur en Europe. Il n’est pas possible d’avoir des « clauses miroirs » quand nos pays doivent accepter des mesures compensatoires au nom du « libre commerce » et de « la libre concurrence ». Ainsi le règlement européen sur « la déforestation importée » (RDUE) qui visait à ralentir la destruction de la forêt amazonienne serait directement menacé par le « mécanisme de rééquilibrage ». Favoriser les importations de soja ou de viande bovine, accéléra encore la déforestation en Amérique Latine et la désertification rurale en Europe. C’est ce que montre une expertise d’INRAE menée par le chercheur Stefan Ambec** à la demande du gouvernement français. Selon ce rapport, le traité entraînera une augmentation du volume annuel de production de viande de 2 % à 4 % impulsant une déforestation de 700 000 ha. Sur cette base, l’expertise évalue que les rejets carbonés induits par cette déforestation passeraient de 121 millions à 471 millions de tonnes de gaz carbonique la progression des rejets carbonés. Le traité MERCOSUR va à l’encontre des orientations des conférences pour le climat. Il est évident que la signature d’un tel accord dont nous venons de voir la gravité des orientations poussera en Europe à un productivisme agricole capitaliste encore renforcé au détriment des paysans-travailleurs rendus esclave des secteurs industriels d’amont et d’aval de la production, ainsi que des banques. Placé au cœur de la guerre économique intra-capitaliste source des grandes tensions géopolitique et militariste mondiale, les travailleurs et les peuples européens et latino-américains ont intérêt à rechercher des voies d’unité pour défendre et améliorer leurs conquis sociaux et des harmonisations sociales et sanitaires positives, pour la préservation du climat, pour le droit à une alimentation de qualité pour toutes et tous. Bref, de grands combats communs doivent être imaginé pour gagner une sécurité humaine globale contre la sécurisation des profits et du capital qui s’accumulent entre quelques mains dans le monde. La mobilisation contre ce texte doit encore gagner en ampleur et en force. Les groupes parlementaires européens le défèrent devant la cour de justice européenne pour tenter de le bloquer. Des actions de sensibilisation et de déconstruction des mensonges qui se répandent sont indispensables. Nous sommes toutes et tous concernés. Patrick Le Hyaric 14 Novembre 2025. * Selon les organisations Public Eye et Unearthed, ** Rapport Ambec de la commission d’évaluation du projet d’accord UE-Mercosur remis le 18 septembre 2020 au Premier ministre M Jean Castex. Texte intégral (1592 mots)
Bon Pote
Actu-Environnement
Amis de la Terre
Aspas
Biodiversité-sous-nos-pieds
Bloom
Canopée
Décroissance (la)
Deep Green Resistance
Déroute des routes
Faîte et Racines
Fracas
F.N.E (AURA)
Greenpeace Fr
JNE
La Relève et la Peste
La Terre
Le Lierre
Le Sauvage
Low-Tech Mag.
Motus & Langue pendue
Mountain Wilderness
Negawatt
Observatoire de l'Anthropocène