24.01.2026 à 18:13
« Chemsex » : quand l’excès tente de faire taire la douleur
Texte intégral (1967 mots)
Les personnes qui pratiquent le « chemsex », en consommant de la 3-MMC et d’autres drogues de synthèse (GHB, GLB, poppers…) pendant les relations sexuelles, prennent des risques pour leur santé physique et leur intégrité psychique. Mais grâce à un accompagnement dans des services de soins, au sein de groupes d’entraide et/ou avec des proches, ils peuvent revenir à une vie pacifiée.
La pratique du « chemsex » connaît un essor exponentiel ces dernières années. Les usagers s’exposent à des dommages psychiques et corporels. Les demandeurs de soins font apparaître une souffrance d’origines variées, parfois traumatiques.
À la psychothérapie doit se conjuguer la prévention.
Le « chemsex », qu’est-ce que c’est ?
Des événements médiatisés ont révélé une pratique déjà bien connue des soignants. Le « chemsex » est la contraction de chemical (« produit chimique », en anglais) et de sex, et correspond à l’usage de cathinones dans des relations sexuelles, souvent pratiquées à plusieurs, avec des inconnus. Les cathinones sont des produits de synthèse, aux propriétés stimulantes, entactogènes – elles amplifient les sensations physiques –, et empathogènes – l’intimité est facilitée.
Souvent, le néophyte le découvre au décours d’une soirée festive, et fait l’expérience d’un plaisir intense, sans limites physiologiques (la fatigue ou la faim). La 3-MMC (3-MéthylMéthCathinone) est la cathinone la plus fréquemment citée dans nos consultations. Elle peut être consommée avec d’autres drogues de synthèse, du GHB, du GBL, ou du poppers. Dans ce nouveau « paradis artificiel », les participants exacerbent leur sensorialité, au sein d’un groupe d’anonymes, conçu comme « safe ».
À l’usage, ces derniers recourent à des applications géolocalisées de type Grindr qui potentialisent leur rencontre un peu partout et instantanément. Les « chemsexeurs » diversifient les modes de prises : en sniff, en plug (par voie rectale), ou en slam (par voie intraveineuse). Slam, signifiant « claquer », a l’effet le plus puissant. Les produits sont faciles d’accès : le darknet (réseau Internet clandestin, ndlr) livre à domicile. La durée des « plans » augmente au gré de l’appétence au produit, de plusieurs heures à plusieurs jours.
Surdosage, arrêts respiratoires et autres risques
Les usagers prennent des risques, par exemple des G-hole, c’est-à-dire des comas liés à du surdosage, des arrêts respiratoires ou encore des oublis de leur PrEP (prophylaxie préexposition), quand ils suivent ce traitement antirétroviral utilisé par des personnes séronégatives exposées au risque de VIH.
Souvent, les chemsexeurs rapportent d’abord le plaisir d’expérimenter une émancipation extatique. Ils la requalifient d’autothérapeutique, lorsque des revers leur apparaissent comme le résultat de ce qu’ils voulaient oublier : des blessures psychiques plus ou moins profondes.
Avec la pratique, ils perdent l’intérêt pour la sexualité sans cathinones, et même avec : seule l’appétence au produit demeure. Certains finissent par consommer seuls chez eux. Ils régressent dans un repli mortifère.
Une automédication dangereuse
Certains chemsexeurs lui attribuent une fonction ordalique. Lorsqu’ils nous sollicitent, ils se remémorent des carences affectives, des violences psychologiques, comme le rejet familial et/ou intériorisé de leur orientation sexuelle ou de leur identité. D’autres, ou parfois les mêmes, y réactualisent des traumas liés à des violences physiques, ou sexuelles. À des degrés divers, ils s’absentent d’eux-mêmes, accentuent leur état dissociatif, dans des relations anonymes avec des psychotropes. La toxicomanie crée parfois une emprise qui libère d’une autre.
Lorsqu’ils ont été abusés jeunes, c’est souvent par quelqu’un ayant eu un ascendant sur eux, quelqu’un qu’ils admiraient et qui les a trahis. Relégués au rang d’objet, ils se sont fait extorquer leur intimité.
À lire aussi : Violences sexuelles : de nouveaux enjeux de santé mentale pour les psy
Ils se sont construits en déshumanisant le plaisir sexuel. Ils se sont asservis à un excès après l’autre pour forcer l’oubli. Certains déplorent s’assujettir à une société de consommation, ou se « chosifier » les uns les autres, comme s’ils donnaient consistance à une injonction néolibérale de performance.
Clivés, ils entretiennent à leur insu des carences affectives. Cela en a amené certains à aimer des personnes les faisant souffrir. Leur enjeu devient de différencier le fait d’aimer, du fait d’aimer souffrir. Enlisés dans la confusion, ils retournent contre eux la violence qu’ils ont subie par une compulsion aux passages à l’acte. Les plus « avancés » s’isolent, se délaissent. Ils s’octroient des états modifiés de conscience pour édulcorer des reviviscences traumatiques, qui leur reviennent lors de leurs descentes.
Traduire en mots les abus qu’ils ont subis les aide à distinguer ce qui relève de leur choix ou de leur instrumentalisation par une contrainte de répétition. S’ils identifient leurs traumas, ils peuvent retrouver l’origine de leur destructivité qu’ils cherchaient sans succès à fuir, et l’intégrer dans leur vie selon d’autres modalités.
Psychothérapie, prévention, contexte sociétal
Quel que soit le degré d’engagement dans le chemsex, il est essentiel avec les demandeurs de soins de réintégrer ce qu’ils vivent dans la réalité commune, de lever leurs clivages, et d’éviter à leurs excès de constituer des traumas secondaires. Entrer dans l’espace thérapeutique, leur permet de reconnaître à un autre la capacité d’entendre les éléments épars de leur histoire. Ils la pensent et pansent les blessures. Les plus démunis d’ancrage ont pour enjeu préalable de se réinscrire dans une relation humanisante, d’y éprouver la détresse auprès d’un autre secourable avec qui interroger l’avenir : pour qui ne s’abandonneraient-ils pas ?
C’est d’un appui bienveillant dont ils ont besoin d’abord pour résorber leur effraction psychique, se réconcilier avec eux-mêmes et élaborer les enjeux tragiques de leur relation à l’amour. Certains ne savent plus comment aimer, ou s’ils en sont capables. Pour d’autres, cela n’a jamais été une expérience hédoniste.
Après s’être expulsés de la vie de la cité, ils reviennent à la vie ordinaire dans un état de grande fragilité. Leur vie affective progresse dans des services de soins, des groupes d’entraide, de proches, qu’ils considèrent comme leur nouvelle famille.
Ce passage est structurant pour leur prise de parole, complémentairement à celle qu’ils déploient auprès du clinicien. Ce dernier les soutient dans leur démarche créatrice ou sublimatoire qu’ils ouvrent souvent spontanément : la reconversion professionnelle, la reprise d’études, l’expression artistique de leur sensibilité. Ils changent de vie pour participer autrement à celle de la cité.
Certes les cathinones se sophistiquent régulièrement et changent de nom pour défier la législation. Mais cela n’est pas aux usagers d’endosser cette responsabilité. La leur est de demander de l’aide. Il y a quelques années, c’est seulement à un stade avancé, qu’ils nous sollicitaient. Aujourd’hui, les campagnes de prévention et le fait de côtoyer les plus expérimentés les rendent alertes plus tôt. La prise en charge s’est diversifiée et démocratisée.
Les chemsexeurs, des témoins d’un mal-être psychique plus gobal ?
À l’heure où l’usage de drogue refait l’objet de représentations régressives dans un climat politique répressif, les usagers continuent de nécessiter des lieux de soin « safe ». Si l’on n’en tient pas compte, on participe à entraver ou à retarder leurs accès aux soins. En craignant d’être discrédités, ils peuvent préférer nier les violences et les revivre alors à l’identique comme une torture sans fin. Pour la proportion d’usagers ayant subi des violences sexuelles, ils peuvent continuer de se meurtrir en prenant sur eux la responsabilité de leur victimisation préalable. Déposer une plainte, thérapeutique, est structurant : le patient relance dans la thérapie le désir de se respecter.
À l’heure où le mal-être psychique des jeunes gens est criant, où l’appétence aux sites « porno », parfois « trash », est perçu comme un refuge, il paraît essentiel d’éclairer et de prévenir le malaise dont les usagers de chemsex témoignent eux aussi. Le cumul de carences, de traumatismes d’enfance et/ou de traitements discriminatoires nécessite des soins humanisants, étayants, par des professionnels soutenus.
Préférer à l’agir le récit de soi, s’ouvrir à l’altérité et aux relations affectives et se réinscrire dans le collectif leur est généralement possible lorsqu’ils ont appris ou réappris à s’aimer eux-mêmes.
Laure Westphal ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
23.01.2026 à 12:07
La « méthode Lecornu » a-t-elle échoué ?
Texte intégral (1933 mots)
Deux motions de censure ont été déposées, le vendredi 23 janvier, en réponse à l’utilisation de l’article 49-3 par Sébastien Lecornu sur la partie recettes du budget. La promesse du premier ministre de ne pas faire usage de cet outil constitutionnel en négociant des compromis avec les groupes parlementaires a été rompue. Pourtant, il ne s’agit pas tant d’un échec de méthode que d’une conséquence d’un vice originel concernant la formation du gouvernement.
Malgré les promesses et les sentiments d’un premier ministre « un peu amer » d’avoir perdu le « pari », d’après ses propres mots, la tentation d’y voir un « échec de la « méthode Lecornu » est grande avec le retour du « 49-3 » sur la scène politique.
Cependant, les trois mois d’examen parlementaire ne soldent pas un échec de méthode, mais bien la conséquence logique d’un vice originel concernant la formation du gouvernement.
Deux raisons qui expliquent cet échec
D’abord, le gouvernement est mal né avec un processus de nomination et de renomination improbable, ne s’appuyant sur aucune majorité gouvernementale, aucune majorité parlementaire, et aucune majorité partisane. Or, ce triptyque détermine la logique institutionnelle majoritaire du régime parlementaire de la Ve République.
Ensuite, conséquemment, le gouvernement aurait dû, comme dans les autres régimes parlementaires lorsqu’aucun parti ne dispose à lui seul d’un nombre de sièges majoritaire à la chambre basse, essayer de s’appuyer sur une coalition. Il n’en a rien été.
À lire aussi : Vu de l’étranger : comment choisir un premier ministre face à une Assemblée divisée ?
Or, en France comme à l’étranger, les compromis ne résultent pas de débats parlementaires dans lesquels des orateurs se convaincraient au terme d’argumentations faisant changer d’avis ceux qui les écoutent. Les compromis se font a priori, avant la nomination du gouvernement, et précisément en contractualisant les réformes, leurs contenus, et leur calendrier. Tous les autres pays (Allemagne, Belgique, Espagne, Pays-Bas, etc.) fonctionnent ainsi. Dans le contexte actuel, l’erreur initiale vient donc de la manière dont le premier ministre a été nommé, plaçant le gouvernement dans une position de faiblesse définitive.
Il n’existe pas de « méthode Lecornu »
Cet épisode budgétaire n’est donc qu’une énième péripétie dérisoire et prévisible, mais qui permet de comprendre certains des dérèglements et des lacunes de la vie politique et institutionnelle française.
Premièrement, il n’existe pas de « méthode Lecornu » : le gouvernement n’a ni dirigé les débats, ni gouverné le contenu du texte dont tous les acteurs disent avoir obtenu gains de cause (sauf LFI et RN), ni eu les moyens de l’ingéniosité du gouvernement Barnier qui s’est appuyé sur le Sénat pour être majoritaire en commission mixte paritaire. Au contraire, il a subi le calendrier, malgré ses tentatives répétées de dramatisation, subi les rivalités inter et intra-partisanes, malgré ses tentatives de dépolitiser le budget « pour la France ». Il a subi, enfin, les jeux parlementaires, malgré son étrange renoncement à l’article 49 alinéa 3 de la Constitution. Difficile d’y voir une nouvelle méthode de gouvernement, tant il s’agit là d’un acte d’impuissance.
Deuxièmement, un gouvernement ne peut pas dépendre d’un consentement renouvelé quotidiennement (« Gouverner, c’est prévoir ») et rempli de lignes rouges des députés et partis. Cela, dans un contexte majoritaire ou non, à un ou plusieurs partis. Les contrats de coalition servent justement à anticiper le contenu de la partition gouvernementale, et laissent au quotidien l’exécution de ce contrat. Ils sont négociés durement, pendant plusieurs mois, allongeant d’autant la période entre les résultats législatifs et la nomination du gouvernement : 18 mois en Belgique (2010), de 7 à 9 mois aux Pays-Bas (2017, 2021), 6 mois en Allemagne (2017), 4 mois en Espagne (2023). Cela n’est pas un problème démocratique mais la prise en compte de la fragmentation parlementaire à minorités multiples. Cela rappelle l’idée élémentaire selon laquelle, dans un régime parlementaire, le gouvernement doit être doté d’une légitimité avant de gouverner et d’exercer sa responsabilité.
Les véritables responsables
Plus largement, cet épisode donne à voir les autres acteurs. Reconnaissons ainsi à Sébastien Lecornu que cette erreur n’est pas la sienne et qu’il importe finalement peu. Qui porte la responsabilité ?
Le président de la République et ses conseillers (ceux-là mêmes qui lui ont soufflé l’idée de dissoudre l’Assemblée nationale) portent la responsabilité de cette erreur. Elle remonte au lendemain des législatives de juillet 2024. Depuis lors, trois premiers ministres se sont succédé, tous nommés selon des calculs politiciens reposant sur des capacités supposées à obtenir l’abstention de LFI ou du RN, puis du PS ou de LR, en cas de motions de censure. Comme dans tous les autres régimes parlementaires, le chef du parti ayant remporté le plus de sièges aurait dû être appelé à tenter de former un gouvernement, puis en cas d’échec, le deuxième, etc. Un premier ministre n’aurait donc dû être nommé qu’après avoir construit une coalition au programme de gouvernement contractualisé, démontrant, de fait, une assise suffisante à l’Assemblée nationale.
Le Parlement, pris au piège par le gouvernement qui a tenté de le responsabiliser pour cacher son impuissance, dans une inversion malvenue des rôles, n’est pas devenu le gouvernement.
L’Assemblée nationale a confirmé que sa capacité à légiférer était compromise (contrairement à ce qu’ont pu affirmer certains commentateurs à propos d’un nouvel « âge d’or » du parlementarisme). On peut expliquer cette incapacité par la subordination de l’Assemblée en tant qu’institution mais aussi par son déclassement politique, lié au manque de poids politique des nouveaux députés depuis 2017.
Le Sénat a montré ses limites constitutionnelles. Autrement dit, la Seconde Chambre, doublement exclue des influences politiques et institutionnelles, n’a pas pu peser sur l’examen du projet de loi de finances et a donc travaillé vainement.
Quels enseignements en tirer ?
Cet épisode apporte des enseignements, de plus en plus flagrants depuis juillet 2024.
1) L’arithmétique de l’Assemblée nationale expose une double impasse. D’une part, le président de la République ne dispose plus d’une majorité parlementaire pour gouverner comme il l’a fait entre 2017 et 2022 : c’est la fin du « présidentialisme majoritaire » qui caractérisait jusqu’alors la Ve République. Mais, d’autre part, aucune majorité alternative ne s’est constituée autour du premier ministre, contrairement aux périodes de cohabitation (1986-1988, 1993-1995, 1997-2002), pour opérer un « retour au texte » de la Constitution – c’est-à-dire une lecture où le premier ministre gouverne effectivement.
Dès lors, toute discussion sur l’inadaptation supposée des règles de l’examen parlementaire des projets de loi de finances est malvenue. Elles attribuent les échecs du gouvernement et de l’Assemblée aux règles de procédure – comme l’a suggéré la présidente de l’Assemblée nationale Braun-Pivet – alors que les causes sont ailleurs. Le changement de procédure n’aurait pas conduit à un résultat différent. Les propositions de réformes (comme celles du Haut-Commissariat au plan) écartent le poids du contexte politique et, pis, relèvent d’une vision techniciste et d’un solutionnisme normatif dépassé.
2) Ni présidentialisme ni « retour au texte » de la Constitution : nous assistons à la fin des modèles connus de la Ve République. Dans ce contexte, les institutions ne sont « bien faites » pour personne (François Mitterrand déclarait en juillet 1981 : « Les institutions n’étaient pas faites à mon intention. Mais, elles sont bien faites pour moi. ») Un changement de texte (qui serait le 26ᵉ…) ou un nouveau mode de scrutin ne changerait ni les votes des Français, ni le populisme, ni le déclin des partis de gouvernement, ni les acteurs politiques. Le contexte de fragmentation appelle un nouveau modèle reposant sur la formation d’un gouvernement de coalition comme à l’étranger – ce que permet le texte de la Constitution aux lectures multiples.
3) Reste aux acteurs politiques à le penser et le mettre en œuvre. Mais, au regard des atermoiements du président de la République depuis 2022, des députés qui ont intériorisé leur incompétence à légiférer (comme l’illustrent les motions de rejet préalable de mai et juin 2025 utilisées pour contourner le débat à l’Assemblée nationale par des majorités de circonstance pourtant favorables aux textes), et des partis et candidats tournés vers la prochaine élection présidentielle comme sous la IVe République vers la prochaine crise institutionnelle, il n’est pas certain qu’ils y arrivent.
La séquence ouverte en 2017 a disrupté le système politique, sans construire. S’appuyant sur les institutions et le fait majoritaire jusqu’en 2022, Emmanuel Macron n’a pas su, depuis, instaurer un mode de fonctionnement adapté à l’absence de majorité. Faute d’avoir pensé un gouvernement par coalition négociée, le pouvoir exécutif s’épuise à chercher des majorités de circonstance et à attendre du Parlement ce qu’il ne peut pas faire. Tant que cette leçon ne sera pas tirée, il n’y aura pas de méthode – Lecornu ou autre. Les institutions en sortent abîmées ; LFI et RN : 25 sièges en 2017, 198 depuis 2024. In fine, la question n’est peut-être plus de savoir qui gouvernera, mais s’il sera encore possible de gouverner.
Thomas Ehrhard ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
22.01.2026 à 16:08
En France, tenir ses promesses électorales ne rapporte rien
Texte intégral (2469 mots)
À chaque élection présidentielle, des promesses sont faites, suscitant l’espoir des citoyens, avant qu’ils ne soient déçus. Or l’analyse des mandats présidentiels entre 1995 et 2022 montre que le respect (ou le non-respect) des promesses de campagne n’a aucun impact mesurable sur la popularité des présidents. La dynamique espoir-déception est systématique. Comment expliquer ce phénomène ?
Dans une démocratie représentative, on s’attend à ce que les citoyens évaluent leurs dirigeants au moins en partie au regard du degré de réalisation de leurs promesses électorales. Cette idée, au cœur de la théorie du mandat démocratique, suppose que les citoyens approuvent davantage les gouvernants qui tiennent parole. Ce mécanisme doit à la fois inciter les élus à respecter leurs engagements et assurer que les élections orientent réellement l’action publique.
Mais en France, il semble grippé : la cote des présidents suit une courbe descendante quasi mécanique, insensible à la mise en œuvre de leurs promesses de campagne. Notre analyse des mandats présidentiels entre 1995 et 2022, croisant données de popularité mensuelle et suivi de 921 promesses électorales, révèle que la réalisation des engagements ne produit aucun effet mesurable sur l’approbation publique.
Une popularité insensible aux promesses tenues
Les exécutifs se tiennent mieux à leur programme que beaucoup ne le pensent : le taux de réalisation (partielle ou complète) atteint près de 60 % en moyenne sur les cinq derniers mandats présidentiels. Emmanuel Macron, lors de son premier quinquennat, affiche un taux de réalisation supérieur à 70 %. François Hollande, Jacques Chirac (deuxième mandat) et Lionel Jospin (premier ministre en cohabitation) suivent de près. Nicolas Sarkozy affiche un taux de réalisation de 54 %, plus faible mais significatif, malgré une crise économique majeure. Jacques Chirac se démarque lors de son premier mandat par une proportion de promesses tenues comparativement faible (30 %). Ce faible taux reflète, d’une part, un désengagement rapide vis-à-vis de sa campagne sur la fracture sociale pour déployer une politique de rigueur budgétaire et, d’autre part, la période de cohabitation qui a fortement limité la capacité d’action du président.
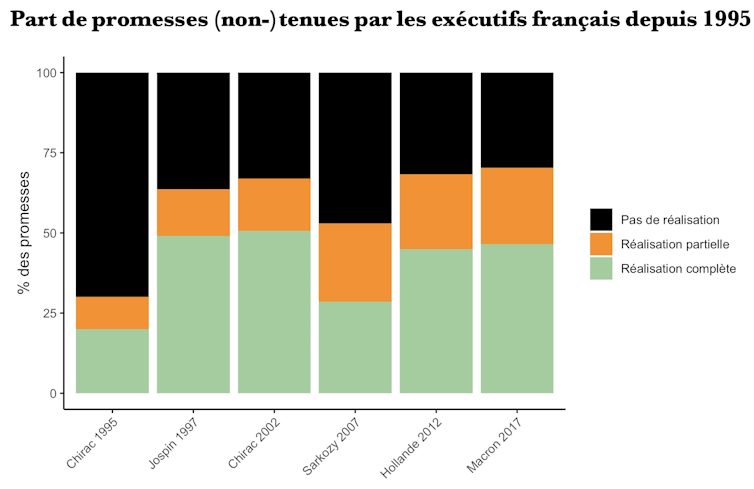
Ces bilans non négligeables ne se traduisent pas dans les sondages : nos analyses ne mettent en évidence aucun effet statistiquement significatif des promesses réalisées sur la popularité présidentielle. Les courbes de popularité font plutôt ressortir une dynamique bien connue : une phase de « lune de miel » postélectorale, suivie d’un déclin régulier, parfois ponctué d’un léger rebond en fin de mandat.
Ce phénomène, appelé « cost of ruling » (ou « coût de gouverner »), reflète une usure du pouvoir que ni les promesses tenues ni les réformes menées à bien ne parviennent à enrayer.
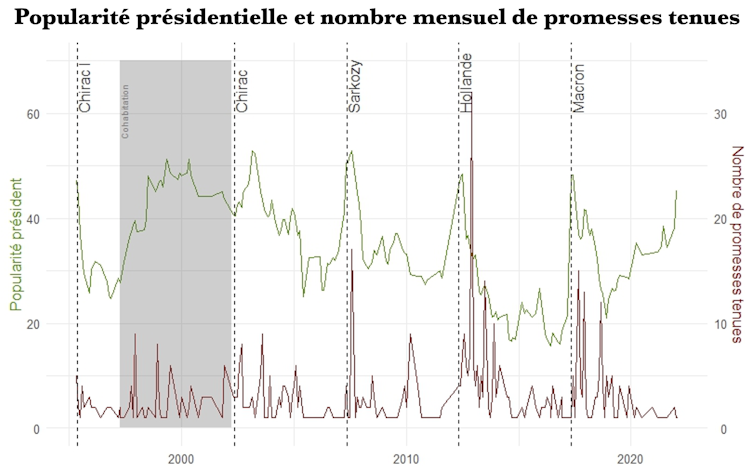
Pourquoi tenir parole ne paie pas
Plusieurs facteurs expliquent ce décalage. D’abord, une certaine méconnaissance des programmes électoraux. Peu d’électeurs les lisent dans le détail ; moins encore suivent précisément leur mise en œuvre.
Les engagements les plus visibles – ceux qui marquent la campagne par leur degré d’ambition – ne sont pas les plus faciles à réaliser. Les promesses tenues, souvent d’ampleur moindre, passent souvent inaperçues, noyées dans le flot de l’actualité ou éclipsées par les polémiques.
La couverture médiatique accentue cette asymétrie. Les promesses rompues font la une, les promesses tenues n’attirent guère l’attention. Les conflits, les revers et les scandales sont plus vendeurs que le travail gouvernemental au long cours sur les promesses de campagne. Cette focalisation sur les échecs alimente une perception négative du pouvoir, même lorsque celui-ci agit conformément à ses engagements.
À cela s’ajoute la manière dont les citoyens interprètent l’action gouvernementale. Tous ne réagissent pas de la même façon à la réalisation d’une promesse. D’une part, les biais cognitifs jouent un rôle majeur : chacun lit l’actualité politique au prisme de ses préférences partisanes, de sa confiance dans les institutions ou de son humeur générale. Les soutiens de l’exécutif en place seront plus disposés à porter ses réalisations à son crédit.
D’autre part, les citoyens n’adhèrent pas tous à la même vision du mandat démocratique. Pour certains, l’élection donne mandat à l’exécutif pour tenir ses promesses ; pour d’autres, ces mesures peuvent rester intrinsèquement contestables, d’autant plus dans un système majoritaire où une partie des voix relève du vote « utile » ou de barrage plutôt que de l’adhésion.
Une promesse tenue suscitera donc souvent l’approbation des partisans, mais crispera les opposants. Ces réactions opposées annulent tout effet net sur la popularité.
Une hyperprésidentialisation contre-productive
Le cas français est particulièrement révélateur. La Ve République confère au président des pouvoirs beaucoup plus forts que dans d’autres régimes. Élu au suffrage universel direct, il concentre les attentes, incarne l’État, définit l’agenda et la ligne gouvernementale. Cette concentration du pouvoir est censée clarifier les responsabilités et lui donner la capacité de mettre en œuvre son programme. Mais elle se retourne contre lui en le rendant responsable de tout ce qui cristallise les insatisfactions et en démultipliant le cost of ruling.
Cette dynamique s’atténue en période de cohabitation, comme entre 1997 et 2002. Le président partage alors le pouvoir avec un premier ministre issu d’une autre majorité, ce qui brouille les responsabilités. Hors cohabitation, le président est seul en première ligne, cible de toutes les critiques et les insatisfactions et son capital politique s’épuise rapidement. En concentrant les attentes autant que les critiques, l’hyperprésidentialisation finit par miner la capacité d’action du président là où elle devait la renforcer.
Un mandat sous tension, un modèle aux abois ?
Cette déconnexion entre promesses et popularité met à mal le modèle du « mandat » démocratique. La présidentielle concentre des attentes immenses : les candidats sont incités à incarner des visions d’alternance très ambitieuses et à promettre des transformations profondes. Sur le papier, cette élection devrait leur donner la légitimité nécessaire pour mettre en œuvre ce programme une fois au pouvoir.
Mais en pratique, ce mandat est fragile. Le capital politique tiré de l’élection s’érode très vite une fois passée la « lune de miel », réduisant les marges de manœuvre de l’exécutif et limitant sa fenêtre pour imprimer sa marque. Cela incite à se précipiter pour faire passer le plus rapidement possible un maximum de réformes, au risque de sembler passer en force. Mais l’exécutif peine à convertir l’élection en capacité durable d’action : ses réalisations n’alimentent ni sa popularité ni le sentiment qu’ont les électeurs d’être représentés. Que les promesses soient tenues ou non, beaucoup ont le sentiment de ne pas avoir été entendus.
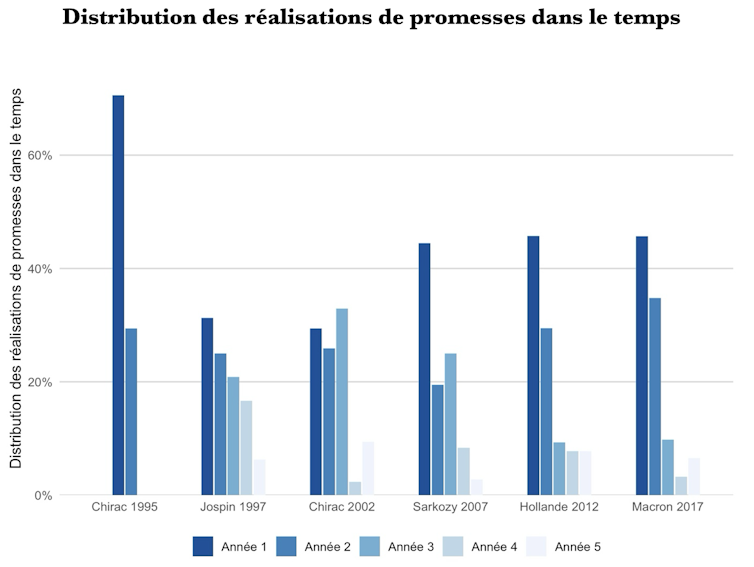
Dans un paysage politique de plus en plus fragmenté et instable, il devient de plus en plus difficile de mettre en œuvre son programme (les promesses sont rarement réalisées au-delà de la deuxième année de mandat) et la frustration suscitée au regard des espoirs nourris par chaque élection présidentielle risque de se renforcer encore. Restaurer le lien entre élections, promesses et action publique suppose de sortir d’un modèle où le président est censé tout promettre, tout décider et tout assumer seul.
Il est temps de réfléchir à une forme de gouvernement plus collégial, où les responsabilités sont partagées et où un spectre plus inclusif de sensibilités peut s’exprimer. Une telle évolution permettrait non seulement de mieux répartir le crédit des accomplissements – les promesses tenues –, mais aussi le prix des défaites, dont l’inévitable coût de gouverner.
Cet article est tiré de l'ouvrage «French Democracy in Distress. Challenges and Opportunities in French Politics» (Palgrave Macmillan, 2025), sous la direction de Nonna Mayer et Frédéric Gonthier. Une conférence autour de cette publication est organisée à Sciences Po le jeudi 29 janvier 2026 à partir de 17h.
Isabelle Guinaudeau a reçu des financements de l'Agence nationale de la recherche (Projet ANR- 13-JSH1-0002-01, PARTIPOL, 2014-2018).
Emiliano Grossman ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
21.01.2026 à 16:23
Derrière le sans-abrisme, la face cachée du mal-logement
Texte intégral (2154 mots)
Ce 22 janvier, une Nuit de la solidarité est organisée à Paris et dans d’autres villes françaises – une forme d’opération citoyenne de décompte des personnes dormant dans la rue. Celle-ci ne doit pas occulter ce que les travaux de recherche montrent depuis une quarantaine d’années : à la figure bien connue du sans-abri s’ajoutent d’autres formes moins visibles de précarité résidentielle et de mal-logement.
Aujourd’hui, de plus en plus de personnes sont exclues du logement ordinaire. Les derniers chiffres dont on dispose datent de 2012 et indiquent que le nombre de personnes sans domicile a augmenté de 50 % entre 2001 et 2012 : à cette date, 81 000 adultes, accompagnés de 31 000 enfants étaient sans domicile dans les agglomérations d’au moins 20 000 habitants de France hexagonale. L’enquête Sans Domicile menée par l’Insee en 2025 est en cours d’exploitation et permettra d’actualiser ces chiffres, mais tout laisse penser que la situation s’est encore dégradée, comme en témoignent nos observations de terrain.
D’après l’Insee, une personne est considérée comme sans domicile si elle a dormi la nuit précédente dans un lieu non prévu pour l’habitation (elle est alors « sans-abri »), ou si elle est prise en charge par un organisme fournissant « un hébergement gratuit ou à faible participation » (hôtel ou logement payé par une association, chambre ou dortoir dans un hébergement collectif, etc.). Ainsi, le sans-abrisme est-il la forme extrême du sans-domicilisme qui s’inscrit lui-même dans la myriade des formes du mal-logement.
Au-delà de ces personnes sans domicile, d’autres vivent dans des caravanes installées dans des campings, dans des squats, chez des tiers, des camions aménagés, des logements insalubres, etc., autant de situations résidentielles précaires qui échappent aux radars de la société et sont peu relayées dans les médias.
Ainsi, la Fondation pour le logement des défavorisés estime dans son rapport de 2025 que près de 4 millions de personnes sont touchées en France par toutes ces formes de mal-logement, la plupart des indicateurs de mal-logement s’étant dégradés.
À la figure bien connue du sans-abri dormant dans la rue s’ajoutent donc d’autres formes moins repérables de précarité résidentielle.
À l’approche de la Nuit de la solidarité organisée chaque année à Paris et dans d’autres villes françaises, il n’est pas inutile de rappeler ce que soulignent les travaux de recherche sur le sujet depuis une quarantaine d’années : le sans-abrisme n’est que la partie émergée de l’iceberg.
Si les opérations de décompte des personnes vivant dans des lieux non prévus pour l’habitation, et notamment la rue, sont importantes pour sensibiliser les citoyennes et citoyens, elles ne permettent d’obtenir que des estimations très approximatives du sans-abrisme et masquent une problématique plus vaste qui ne se réduit pas à ces situations extrêmes, comme on peut le lire dans ce rapport (pp. 42-52).
Les visages cachés de l’exclusion du logement
À la figure ancienne et un peu caricaturale du clochard – un homme seul, blanc, sans emploi et marginalisé – s’ajoutent d’autres visages : travailleurs et travailleuses précaires, femmes, parfois accompagnées d’enfants, personnes âgées percevant de petites retraites, personnes discriminées en raison de leur orientation sexuelle, étudiantes et étudiants, jeunes sortant de l’Aide sociale à l’enfance ou encore populations issues de l’immigration…
Ces différents types de personnes ont toujours été plus ou moins présentes parmi les populations en difficulté, mais l’augmentation générale de la précarité et la pénurie de logements accessibles les ont encore fragilisées. Plus de 2,7 millions de ménages étaient en attente d’un logement social en 2024. Dans le même temps, seulement 259 000 logements ont été mis en chantier en 2024, dont 82 000 logements sociaux financés.
Si certaines figures du sans-abrisme sont extrêmement visibles, comme les migrantes et migrants dont les campements sont régulièrement montrés dans les médias, d’autres formes d’exclusion sont plus discrètes.
C’est le cas par exemple des personnes en emploi, victimes de l’élargissement de la crise du logement, qui se replient vers les structures d’hébergement institutionnel faute de pouvoir se loger malgré leurs revenus réguliers.
En 2012, près d’un quart des sans-domicile occupaient un emploi. Ce phénomène fait peu de bruit alors même que ces personnes occupent souvent des métiers essentiels au fonctionnement de la société.
De même, les femmes sans domicile sont moins repérables dans l’espace public que leurs homologues masculins, car elles ne ressemblent pas à la figure classique du sans-domicile fixe (SDF). Quand elles y sont présentes, elles ne s’y installent pas et sont beaucoup plus mobiles par crainte d’y subir des violences : elles sont donc très largement sous-estimées dans les opérations de décompte.
À lire aussi : Femmes SDF : de plus en plus nombreuses et pourtant invisibles
Les enquêtes « Sans domicile » montrent qu’entre 2001 et 2012, le nombre de femmes francophones sans domicile a augmenté de 45 %, passant de 17 150 en 2001 à 24 930 femmes en 2012.
Solutions court-termistes
Face à cette précarité résidentielle croissante, quelles solutions apportent les pouvoirs publics ?
L’augmentation du financement de l’hébergement d’urgence qui procure un abri temporaire dans des haltes de nuit ou à l’hôtel apporte certes une solution rapide aux sans-abri qui, du point de vue des édiles, nuisent à l’image des villes, mais ne résout en rien les problèmes de ces personnes.
À lire aussi : Où dormir quand on n’a pas de domicile ?
Reléguant les plus précaires aux marges des villes ou dans des hébergements sans intimité où il est impossible de s’installer dans la durée, ces politiques court-termistes, focalisées sur l’urgence sociale, se doublent de formes de répression (expulsion, arrêtés anti-mendicité, mobiliers urbains inhospitaliers) qui contribuent à la précarisation et à l’invisibilisation des populations étiquetées comme « indésirables ».
L’augmentation massive des expulsions avec le concours de la force publique en 2024, l’hébergement des sans-domicile dans des hôtels de plus en plus éloignés des centres des agglomérations et peu accessibles en transports en commun, ou le déplacement des sans-abri de Paris pendant les Jeux olympiques de 2024 en témoignent.
Prises en charge discontinues
Des changements politiques profonds sont pourtant nécessaires pour résoudre la question de l’exclusion du logement en s’attaquant à ses causes structurelles. Une politique ambitieuse de production et de promotion du logement social à bas niveaux de loyers est indispensable pour permettre aux ménages modestes de se loger sans passer par le long parcours de l’hébergement institutionnel.
La prévention des expulsions doit également être favorisée, de même que la régulation des prix du marché immobilier.
Il est aussi nécessaire d’assurer une meilleure continuité de la prise en charge dans les diverses institutions d’aide. Les populations particulièrement fragiles, qui cumulent les difficultés, connaissent des séjours précoces en institutions, répétés et multiples, de l’aide sociale à l’enfance (en 2012, 23 % des utilisateurs des services d’aide aux sans-domicile nés en France avaient été placés dans leur enfance, alors que cette proportion était seulement de l’ordre de 2 % à 3 % dans la population générale) aux dispositifs d’insertion par le travail, en passant dans certains cas par l’hôpital psychiatrique, les cures de désintoxication ou la prison.
Or, ces prises en charge souvent discontinues n’apportent pas de solutions durables en termes de logement, d’emploi ou de santé. Elles alimentent par ailleurs un sentiment de rejet qui favorise le non-recours au droit : les personnes sont éligibles à des prestations sociales et à des aides mais ne les sollicitent pas ou plus.
Pour ces personnes les plus désocialisées, la politique du logement d’abord (« Housing first ») ou « Chez soi d’abord » en France), qui consiste à donner accès au logement sans condition et à proposer un accompagnement social et sanitaire, donne des résultats probants mais, faute de logements disponibles, elle n’est pas suffisamment mise en œuvre.
Appréhender le problème dans sa globalité
Il faut enfin s’attaquer aux politiques migratoires qui produisent le sans-domicilisme. Les politiques publiques en matière d’accueil des étrangers étant de plus en plus restrictives et les dispositifs spécifiques saturés, migrantes et migrants se retrouvent sans solution de logement. La part d’étrangers parmi la population sans-domicile a ainsi fortement augmenté, passant de 38 % en 2001 à 53 % en 2012.
Résoudre la question de l’exclusion liée au logement en France comme dans de nombreux pays passe autant par des réformes de la politique du logement que par des actions dans le secteur social, de l’emploi et de la politique migratoire. Le sans-domicilisme est un révélateur des inégalités sociales croissantes dans la société et des processus d’exclusion qui la traversent. Trouver une solution à ce problème majeur, nécessite plus que jamais de l’appréhender dans sa globalité, sans se limiter à ses symptômes les plus visibles.
Pascale Dietrich-Ragon et Marie Loison-Leruste ont codirigé l’ouvrage la Face cachée du mal-logement. Enquête en marge du logement ordinaire, paru aux éditions de l’Ined en septembre 2025.
Marie Loison-Leruste est membre de l'association Au Tambour!.
Pascale Dietrich ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
20.01.2026 à 16:57
Où va la démocratie française ?
Texte intégral (2229 mots)
Depuis la dissolution de juin 2024, le système politique français semble grippé et la confiance des Français dans les institutions politiques s’érode. Pourtant, la recherche montre que les citoyens ne rejettent pas la démocratie en tant que telle, ils rejettent un système politique qui ne fonctionne plus comme une démocratie.
La France s’est installée dans une zone de turbulences démocratiques durables. Effondrement des partis de gouvernement, poussée de la droite radicale populiste et fragmentation de l’Assemblée nationale nourrissent depuis quelques décennies l’idée d’une démocratie structurellement déstabilisée. La séquence électorale de 2024, marquée par des élections européennes triomphales pour le Rassemblement national (RN), la dissolution surprise de l’Assemblée nationale et l’aggravation de la crise du fait majoritaire, a amplifié ce diagnostic d’une démocratie fragilisée.
Ces turbulences masquent pourtant un paradoxe : si la confiance des Françaises et des Français dans les institutions politiques s’érode, leur attachement aux valeurs démocratiques demeure très solide. Contrastant avec un discours répandu, les recherches que nous avons menées avec 23 autres chercheurs mettent en évidence que les Français ne sont pas fatigués de la démocratie mais d’un système politique qui, à leurs yeux, ne fonctionne plus comme une démocratie.
Une démocratie toujours plébiscitée mais jugée dysfonctionnelle
Les enquêtes internationales sont sans ambiguïté. Selon la dernière vague de l’« Enquête sur les valeurs des Européens » (2018), plus de 90 % des Français considèrent la démocratie comme un bon régime politique. Un soutien comparable à celui observé dans la plupart des démocraties européennes, et largement devant le soutien à une alternative technocratique ou à un gouvernement autoritaire. De la même manière, une large majorité estime qu’il est essentiel de vivre dans un pays gouverné démocratiquement, avec une note moyenne de 8,6 sur une échelle allant de 1 pour « pas important du tout » à 10 pour « absolument important ».
Les Françaises et les Français sont nettement plus sévères quand il s’agit d’évaluer le fonctionnement de leur démocratie. Quand on leur demande à quel point la France est gouvernée démocratiquement, ils la situent à 6,4 sur une échelle où 1 indique « pas du tout démocratique » et 10 « complètement démocratique ». Cela conduit à un niveau de satisfaction dans la démocratie très modeste, de l’ordre de 5,2 selon l’« Enquête sociale européenne » de 2020. Le même décalage entre adhésion et insatisfaction démocratique apparaît dans la plupart des autres pays européens.
Une fatigue démocratique « par le haut »
La crise actuelle ne traduit donc pas un rejet des valeurs démocratiques, mais une remise en cause d’un système institutionnel perçu comme n’étant plus en phase avec ces valeurs. Loin d’une fatigue démocratique « par le bas », c’est-à-dire parmi les citoyens, il s’agit plutôt d’une fatigue démocratique « par le haut », c’est-à-dire d’un processus dans lequel les pratiques de gouvernement contribuent à effriter la confiance des citoyens.
Le constat est désormais bien documenté dans la littérature comparative : les démocraties libérales s’affaissent moins sous l’effet d’une désaffection populaire ou d’un déficit de performances économiques et sociales que par des choix politiques, des logiques partisanes et des contournements institutionnels opérés par les élites au pouvoir. En France, plusieurs évolutions ont alimenté cette dynamique.
La centralisation extrême de la Ve République a progressivement transformé un exécutif fort en un exécutif hypertrophié, marginalisant le Parlement et affaiblissant les espaces de médiation censés coproduire la confiance démocratique : partis politiques, syndicats, corps intermédiaires… Les usages répétés de l’article 49.3, les négociations difficiles avec les partenaires sociaux ou encore les conventions citoyennes dont les recommandations ont été partiellement ou totalement écartées, ont renforcé l’idée que les dispositifs participatifs et délibératifs, supposés remédier aux dysfonctionnements de la démocratie électorale, restent largement symboliques.
Cette rigidification des pratiques de gouvernement s’est accompagnée d’une répression plus visible des mobilisations sociales. Des travaux récents, ainsi que la défenseure des droits, ont attiré l’attention sur la normalisation de dispositifs d’exception, l’extension du maintien de l’ordre judiciaire et administratif, et l’usage accru de qualifications pénales restrictives. De la gestion du mouvement des gilets jaunes à celle des mobilisations contre la réforme des retraites, la protestation, pourtant pilier historique de la vie politique française, s’est vue de plus en plus disqualifiée voire criminalisée. Ces évolutions ont aujourd’hui réduit la capacité de la société civile à influencer durablement l’agenda politique.
Des aspirations démocratiques qui se déplacent
Face à la fermeture des canaux conventionnels, les aspirations démocratiques se déplacent vers des formes d’expression plus faiblement institutionnalisées : blocages, actions locales, pétitions, mobilisations numériques. Celles-ci traduisent un désir persistant de participation à la fabrique des choix publics.
Par ailleurs, les Françaises et Français sont maximalistes en matière de démocratie : ils adhèrent massivement aux piliers électoraux et constitutionnels du régime libéral, mais aussi à la dimension sociale de la démocratie, qui suppose l’égalité réelle et la protection contre l’arbitraire économique. On constate également un fort soutien à une souveraineté populaire plus directe, qui va de pair avec l’attrait pour des formes de démocratie sans intermédiaires. Les citoyens ordinaires tirés au sort ou les experts sont perçus comme capables de prendre des décisions rationnelles et rapides, transcendant les divisions politiques.
Les données du baromètre de la Commission nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH) 2023 confirment ce soutien élevé aux réformes démocratiques. Le référendum recueille notamment une adhésion majoritaire, en particulier parmi les citoyens qui se sentent exclus de la représentation politique. Les électeurs du Rassemblement national, souvent décrits comme antidémocratiques, ne font pas exception à cette logique. Une part importante d’entre eux soutient des dispositifs de démocratie directe ou délibérative. Paradoxalement, ce parti qui valorise l’ordre et l’autorité ne trouve pas ses meilleurs soutiens chez les personnes en faveur d’un « dirigeant fort qui n’a à se préoccuper ni du Parlement ni des élections », mais chez celles qui souhaiteraient plutôt que « des citoyens tirés au sort décident ce qui leur paraît le meilleur pour le pays ». L’idée selon laquelle l’électorat de droite radicale populiste serait par principe hostile à la démocratie ne résiste pas à l’examen empirique.
Une démocratie sociale en berne
Le décalage entre valeurs démocratiques et fonctionnement institutionnel s’enracine dans les inégalités sociales. La précarité économique, les faibles niveaux de revenus et de diplômes comme les discriminations raciales s’accompagnent d’un sentiment aigu de ne pas compter politiquement. Le score EPICES, qui mesure la précarité sociale individuelle, est fortement associé à l’abstention répétée. Les minorités racisées comme les classes populaires vivent la représentation comme distante, parfois hostile, et développent un rapport à la fois utilitaire et méfiant à la politique.
Les institutions de l’État social – école, logement, justice, services publics – constituent des lieux centraux où les citoyens font l’expérience concrète et émotionnelle de la démocratie. Or, sous l’effet de contraintes budgétaires et de réformes structurelles de long terme, ces institutions ont vu leur capacité protectrice se recomposer ; ce qui alimente un sentiment d’abandon et d’injustice. Sans un socle minimal de justice sociale, l’égalité politique formelle et l’État de droit peinent à produire de la légitimité durable.
La France est-elle alors en voie de basculer dans l’autocratisation ? En comparaison européenne, l’attachement à la démocratie est élevé. La participation record aux législatives anticipées de 2024 – plus de 66 %, soit près de vingt points de plus qu’en 2022 – rappelle aussi que les citoyens peuvent se mobiliser lorsque l’enjeu est perçu comme décisif. Enfin, il faut voir dans l’attrait des Français pour différentes formes de démocratie le signe d’une culture démocratique mature et exigeante, qui entend combiner pluralisme, efficacité, inclusion et capacité décisionnelle. Cela représente une opportunité pour l’action publique pour réinventer les règles du jeu démocratique en mêlant plusieurs façons de décider.
Que faire ?
Dans ces conditions, la réponse aux turbulences actuelles ne peut se limiter à des ajustements techniques. Elle suppose une refondation du lien politique.
Les assemblées citoyennes dotées de pouvoirs réels, les référendums d’initiative citoyenne encadrés, les budgets participatifs décisionnels ou les dispositifs délibératifs sur les politiques complexes sont des instruments éprouvés et bénéficiant, on l’a vu, d’un soutien populaire significatif.
En définitive, la France se trouve à un carrefour. Une voie mène à la poursuite de la centralisation technocratique, à la déresponsabilisation des élites et à la tentation illibérale. L’autre ouvre sur un nouvel horizon démocratique, où la participation citoyenne produit de véritables décisions.
Le choix appartient moins aux citoyens, dont l’attachement aux valeurs démocratiques ne faiblit pas, qu’aux responsables politiques, aujourd’hui appelés à réformer un système perçu comme verrouillé. Les Français ne sont pas fatigués de la démocratie. Ils sont fatigués d’une démocratie inachevée, car vécue comme défaillante et confisquée.
Cet article est tiré de l'ouvrage « French Democracy in Distress. Challenges and Opportunities in French Politics » (Palgrave Macmillan, 2025), sous la direction de Nonna Mayer et Frédéric Gonthier. Une conférence autour de cette publication est organisée à Sciences Po le jeudi 29 janvier 2026 à partir de 17h.
Frédéric Gonthier a reçu des financements du programme Horizon Europe n°1010952237: TRUEDEM—Trust in European Democracies.
Nonna Mayer ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
16.01.2026 à 15:56
Quand les plateformes numériques fragmentent la société pour maximiser leurs profits
Texte intégral (1289 mots)
La violence, les exagérations, la diffusion de fake news et les mensonges sont les bienvenus sur les plateformes numériques. Il s’agit de maximiser la visibilité des contenus et, ainsi, les profits des Big Tech. Soutenus par Donald Trump, les milliardaires qui détiennent les plateformes refusent tout contrôle au nom de la liberté d’expression.
Jamais dans l’histoire un si petit groupe d’entreprises n’avait réussi à s’immiscer dans les relations des individus à une telle échelle – celle du monde. Les fameuses « Big Tech » sont devenues des médiateurs actifs des relations sociales grâce aux technologies numériques. Or il n’est pas inutile de rappeler que les médiateurs ne sont pas neutres. Les Big Tech influencent les opinions en modulant l’attention et en produisant des réactions chez leurs millions d’utilisateurs.
Au sein des réseaux sociaux et de leurs variantes, leurs contrôleurs opèrent en capturant les données de chaque mouvement, de chaque clic, en somme, des actions qui permettent à leurs algorithmes d’extraire des modèles de comportement, des informations fondamentales pour alimenter les réseaux neuronaux artificiels qui proposeront des contenus dans le but de prévoir nos désirs et nos besoins afin de prédire nos actions. Cela peut se résumer par l’expression « monétisation totale de la vie sociale ».
Fonctionnant de manière invisible pour leurs utilisateurs, ces plateformes ont concentré les budgets publicitaires de presque toutes les sociétés, à partir de la gestion algorithmique des regards et de l’attention. D’où leur logique fondée sur la spectacularisation de tout.
Pour ces plateformes, une bonne information est celle qui génère de l’engagement, celle qui est spectaculaire, celle qui permet de monétiser les interactions. L’engagement que les Big Tech prétendaient avoir envers la qualité de l’information n’était que rhétorique. Le nombre de clics, les réplications, les attaques mutuelles, les exagérations, les mensonges et la diffusion de fake news sont les bienvenus sur les plateformes des Big Tech.
Liberté asymétrique
Récemment, avec le retour de Donald Trump à la Maison Blanche, Musk a pris la tête de la lutte contre la réglementation des plateformes. Pour ce faire, il diffuse l’idée que réglementer équivaut à censurer. La notion de liberté de Musk est fondée sur la force.
Alors que la liberté démocratique repose sur la symétrie, c’est-à-dire sur le droit égal de tous et toutes à être libres, la proposition de liberté de l’extrême droite se traduit par des asymétries. Le puissant n’est libre que s’il peut exercer tout son pouvoir. Le milliardaire n’est libre que s’il peut utiliser sans limites tout ce que sa richesse lui permet. Cette conception s’apparente à une légitimation de la violence, loin de l’idée que chacun a le même droit de s’exprimer.
Sur les plateformes, ce n’est pas la liberté d’expression qui prévaut. C’est le pouvoir de l’argent qui règne. La monétisation de toutes les relations dans une architecture informationnelle verticale, limitée et extrêmement surveillée par ses propriétaires. La gestion totalement opaque des réseaux sociaux en ligne est assurée par des systèmes algorithmiques qui appliquent les règles et les lois de leurs propriétaires. Cette exécution est totalement arbitraire, décidée de manière monocratique par la direction de ces entreprises, modifiée sans préavis, sans débat, sans considération pour leurs utilisateurs, en suivant uniquement deux logiques : celle de leur rentabilité et celle de favoriser l’expansion du pouvoir de leur vision du monde.
Qui croit que les systèmes algorithmiques de la plateforme d’Elon Musk seront neutres dans les conflits entre l’extrême droite et les forces démocratiques de certains pays ? Qui pense que les plateformes du groupe Meta ne favoriseront pas les discours des groupes qui partagent des idées de Trump ? Qui croit que ces structures ne sont pas ploutocratiques, que l’argent n’y fait pas la loi ?
Les élites rompent avec la démocratie
L’un des grands leaders d’extrême droite des Big Tech, Peter Thiel, affirmait déjà en 2009 :
« Je ne crois plus que la liberté et la démocratie soient compatibles. »
Face au manque de perspectives catastrophique du système capitaliste, une grande partie des élites défendant les solutions néolibérales ont rompu avec la démocratie et adhéré au réactionnarisme, c’est-à-dire aux solutions de l’extrême droite. Si nous ne comprenons pas cela, nous ne serons pas en mesure de défendre la démocratie. Le philosophe Michel Foucault nous a suggéré que le pouvoir est aussi une stratégie. Fondamentalement, la destruction du débat rationnel fondé sur les faits est devenue la principale stratégie de l’extrême droite. La lutte contre la réalité, contre l’information factuelle, contre la science, est liée à une stratégie visant à propager de la confusion intellectuelle et à autoriser la violence grâce à une fausse idée de la liberté.
Dans ce contexte, il est bon de rappeler la perspective du sociologue Georg Simmel, qui nous enseignait que le conflit est un élément inhérent et nécessaire à la vie sociale. Le conflit et la coopération sont complémentaires dans la vie sociale. Mais Simmel avertissait qu’il existe des situations dans lesquelles l’absence de formes sociales régulatrices, le rejet absolu de l’autre, la fragmentation de la société sans canaux de médiation sont destructrices et extrêmement dangereuses.
Simmel n’a pas connu le monde hyperconnecté d’aujourd’hui, où les gens sont constamment exposés à des vagues de désinformation et de discours haineux modulés par des systèmes algorithmiques afin de maximiser l’extraction d’argent et la destruction des droits. Mais en travaillant à partir de ses analyses, nous constatons qu’il est indispensable de réglementer ces oligopoles géants et de garantir la qualité et l’intégrité de l’information.
Sérgio Amadeu da Silveira ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
15.01.2026 à 15:59
Streaming de jeux vidéo : femmes, LGBTQIA+ et personnes racisées face à la cyberviolence
Texte intégral (2015 mots)

La cyberviolence est omniprésente dans le domaine du streaming – en particulier de jeux vidéo – et touche particulièrement les personnes minorisées, au point d’infléchir carrières et pratiques. Quels mécanismes sont à l’œuvre ? À l’heure où la visibilité se paie cher, comment rendre ces espaces numériques plus vivables ?
Depuis le milieu des années 2010, l’intérêt porté par la recherche et par le grand public s’est progressivement déplacé des « effets des jeux vidéo violents » ou des jeux vidéo « qui rendent violents » à la place de la violence ordinaire dans les interactions entre membres d’une situation de jeu. Parmi les terrains de la cyberviolence, la diffusion en direct de sessions de jeux vidéo (streaming) est fortement concernée.
Cette violence s’observe entre les joueurs et joueuses, au cours des parties en ligne, mais également de la part du public qui peut participer activement à travers l’interface de discussion (chat). Selon une récente étude de l’ADL Center for Technology and Society, plus du trois quarts des joueurs adultes aux États-Unis ont subi une forme de cyberviolence, allant de l’insulte en ligne au harcèlement.
Le streaming prend aujourd’hui des formes variées et se déploie sur une pluralité de plateformes, dont Twitch, YouTube ou Kick. Twitch demeure la plus utilisée : en 2024, elle représentait environ 61 % du total des heures de visionnage live dans le secteur de la webdiffusion.
Dans nos travaux, nous nous intéressons aux violences que subissent les streameurs et streameuses de jeux vidéo, un phénomène encore largement sous-estimé malgré ses effets concrets sur les pratiques et la carrière des vidéastes.
Les personnes minorisées tenues à l’écart
La cyberviolence touche durement Twitch, un « environnement communicationnel » où la personne qui diffuse est placée dans une « position exposée », livrée aux regards et aux prises de parole – parfois peu amènes – d’un large public. Le streaming fonctionne comme un régime de visibilité qui valorise l’« authenticité », la « proximité », l’humour et la « spontanéité ». Il se caractérise par une forte dimension spectatorielle et spectaculaire, qui cristallise la cyberviolence.
D’une part, les comportements violents surgissent de manière cyclique dans les environnements multijoueurs et les chats : les provocations et la toxicité entre les joueurs et joueuses sont monnaie courante, la violence peut même être encouragée par les streameurs et streameuses. D’autre part, le public peut se comporter en perturbateur intentionnel et faire dérailler la performance de la webdiffusion par des propos inappropriés, voire violents, publiés dans le chat, surtout quand ces propos deviennent collectifs et prennent la forme de « raids haineux ».
Comme en témoignait, en 2023, une vidéaste de Suisse romande déplorant la banalité et la violence de ces actes de harcèlement :
« On reçoit des compliments, des propositions sexuelles, mais aussi des menaces de mort. »
Ces agressions semblent même encouragées par le modèle économique des plateformes, dans la mesure où elles suscitent des controverses qui permettent d’augmenter le nombre de vues, mais aussi d’abonnés (followers) et de dons monétaires de leur part.
Les micro-agressions s’y accumulent de telle sorte qu’elles peuvent créer un environnement hostile et excluant pour les personnes minorisées qui s’adonnent à l’activité de webdiffusion. Par « groupes minorisés », on désigne notamment les femmes, les personnes racisées ou encore les personnes LGBTQIA+, qui sont statistiquement très exposées aux attaques : 49 % des femmes, 42 % des personnes noires et 39 % des personnes LGBTQIA+ déclarent avoir été harcelées en ligne sur la base de leur identité, tandis que 82 % des victimes de violences sexistes ou sexuelles sont des femmes ou des filles.
Une brutalisation croissante
Dans le contexte de la culture vidéoludique, historiquement façonnée par la masculinité hégémonique toxique et geek, la position exposée des streameurs et streameuses est loin de garantir aux personnes minorisées la légitimité accrue qu’elle confère aux joueurs (blancs et) masculins.
Cette visibilité fonctionne de manière différenciée : si elle tend à renforcer la crédibilité des hommes, elle offre en revanche davantage de prises aux critiques et aux attaques visant celles et ceux qui n’appartiennent pas à cette catégorie, les exposant à la surveillance de leurs comportements en jeu, à la mise en cause de leur légitimité et à du cyberharcèlement, ce qui rend leur maintien dans les environnements en ligne comparable à une course d’obstacles.
Participant à part entière à la dynamique de la webdiffusion, que ce soit par le soutien ou la moquerie, mais aussi l’insulte, le public contribue à la présence systémique de comportements sexistes, racistes, et parfois à l’humiliation constante de streameurs et streameuses. Ce dernier point s’est tristement et fatalement illustré avec le décès en direct du streameur Jean Pormanove en août 2025 sur Kick, une plateforme critiquée pour la faiblesse de son système de modération. Ici, les encouragements du public ont conduit au pire, poussant les personnes humiliant Jean Pormanove à poursuivre leurs sévices des jours durant.
Les recherches les plus récentes semblent indiquer ainsi une brutalisation croissante dans les usages quotidiens du Web, caractérisée par un double processus de banalisation et de légitimation de la violence dans les espaces (publics) numériques.
Une régulation déficiente, des stratégies d’adaptation épuisantes
Les règles de modération sur les plateformes de streaming oscillent entre approches réactives punitives – fondées sur la sanction a posteriori et, dans les cas les plus extrêmes, le bannissement définitif – et approches proactives, qui visent à prévenir les comportements offensants.
Sur Twitch, la régulation consiste essentiellement à punir les fauteurs de troubles. Elle s’exerce, d’une part, de manière centralisée, via des algorithmes et des lignes de conduite générales. Ces règles peuvent mener à la suppression de contenus, une suspension temporaire ou un bannissement, mais leur application dépend largement des signalements et du travail de modérateurs et modératrices bénévoles. D’autre part, la régulation s’opère de manière décentralisée par l’entremise des streameurs et streameuses (qui disposent d’un pouvoir discrétionnaire sur leur chaîne) et de leurs équipes. Son efficacité est limitée puisqu’elle repose aussi en grande partie sur le travail gratuit des modérateurs et modératrices qui font face à des offenses massives et continues.
Dans ce contexte, les streameurs et streameuses subissant des agressions entreprennent de nombreux efforts pour se préserver en essayant de « recadrer » les membres de leur audience qui les agressent. Nous avons étudié à ce propos le cas de l’expulsion d’un spectateur sexiste par une streameuse amatrice, et celui d’un streameur à succès qui, confronté à des sous-entendus racistes et par ailleurs harcelé en dehors de la plateforme, a fini par renoncer à son activité. D’autres travaux montrent que, face à l’absence de communication et de soutien technique de Twitch, certains streameurs et streameuses s’organisent en réseau pour partager des outils et des stratégies permettant de gérer le public pendant les attaques et d’apporter un soutien émotionnel à leurs pairs.
Ces exemples témoignent d’un important travail de sensibilisation du public, souvent épuisant, entrepris par les streameurs et streameuses_minorisés pour pallier le manque de régulation offert par les plateformes qui hébergent leur activité. Ce travail, destiné à rendre moins acceptables les actes de cyberviolence, est encore insuffisamment étudié à ce jour.
Accompagner les streameurs et streameuses dans leur travail de régulation
La recherche pourrait venir prêter main-forte aux acteurs et actrices du streaming dans leur effort crucial pour favoriser une dynamique saine des interactions avec le public. Mobiliser le savoir expérientiel des joueurs et des joueuses, des modérateurs et des modératrices est essentiel pour comprendre comment les streameurs et streameuses peuvent transformer, au quotidien, un environnement parfois hostile en espace viable.
Dans cette optique, une démarche participative associant chercheurs et communautés vidéoludiques permettrait d’identifier des moyens de réparer l’offense et de formaliser des dispositifs de régulation plus inclusifs que les outils techniques existants. À l’heure où la cyberviolence pousse nombre de personnes minorisées à abandonner leur activité de streaming, il est urgent de débrutaliser les pratiques vidéoludiques.
Les auteurs ne travaillent pas, ne conseillent pas, ne possèdent pas de parts, ne reçoivent pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'ont déclaré aucune autre affiliation que leur organisme de recherche.
14.01.2026 à 12:25
Débats sur les rythmes scolaires : la discrète fin de la « guerre du caté »
Texte intégral (1976 mots)
Au fil des décennies, les débats sur les rythmes scolaires reviennent et se ressemblent souvent. Mais il y a des exceptions. Lors de la dernière Convention sur les temps de l’enfant (juin-novembre 2025), les voix de l’Église catholique ne se sont pas fait entendre comme par le passé où on est allé jusqu’à parler de « guerre du caté ». Que nous dit la fin des tensions autour du mercredi matin dans les emplois du temps scolaires ?
La récente Convention citoyenne sur les temps de l’enfant (juin-novembre 2025) a rappelé la difficulté d’adapter les plannings scolaires aux rythmes biologiques des élèves. D’autres enjeux, économiques par exemple (notamment dans les débats sur les calendriers de vacances), s’entremêlent avec cet objectif.
Si l’on pourrait faire remonter au moins à la fin du XIXe siècle les observations des médecins dénonçant l’emploi du temps trop chargé des lycéens, c’est à partir des années 1960 que le débat concernant les rythmes scolaires est devenu récurrent. Dans la préface qu’il rédige pour le livre du Dr Guy Vermeil la Fatigue à l’école (1976), le Pr Robert Debré regrette que le souci de l’enfant « soit quelque peu effacé par des revendications professionnelles et l’égoïsme des adultes ».
Les chronobiologistes, dont la discipline se développe au CNRS dans les années 1970, abondent dans le même sens. Rien de neuf sous le soleil, par conséquent ? Si. Un élément du débat encore présent dans les années 1970-1980 a disparu. Cet élément, c’est la question de l’instruction religieuse et de son positionnement le mercredi. Et sa disparition est significative des évolutions de la société.
Libérer ou non le mercredi matin : un enjeu des rapports entre l’Église et l’État ?
Rappelons que la loi du 28 mars 1882 a prévu que « les écoles primaires publiques vaqueront un jour par semaine, en outre du dimanche, afin de permettre aux parents de faire donner, s’ils le désirent, à leurs enfants, l’instruction religieuse, en dehors des édifices scolaires ».
En 1972, pour rééquilibrer la semaine scolaire, après que les cours du samedi après-midi ont été supprimés dans le primaire par l’arrêté du 7 août 1969, l’arrêté du 12 mai substitue le mercredi libéré au jeudi libéré ; mais le principe reste le même. Cependant, le ministère de l’éducation nationale commence à envisager d’offrir aux écoles la possibilité de déplacer le cours du samedi matin au mercredi matin (circulaire du 12 mai 1972).
Même si les autorités religieuses devraient être consultées, l’épiscopat s’inquiète rapidement, et la circulaire du 23 mai 1979 rappelle qu’en principe, dans l’enseignement primaire, « la journée entière du mercredi doit obligatoirement être dégagée de toute activité scolaire, les neuf demi-journées de travail se répartissant nécessairement sur les autres jours de la semaine ».
Dans l’enseignement secondaire, toute modification dans l’organisation de la semaine devrait également avoir l’aval des autorités religieuses (circulaire du 19 décembre 1979). Cependant, après l’alternance politique de 1981, la question du transfert est reposée. En décembre 1984, Jean-Pierre Chevènement, ministre de l’éducation nationale, envisage de réformer les rythmes scolaires hebdomadaires, en donnant la possibilité aux écoles primaires de libérer le samedi matin.
La décision serait décentralisée au niveau des écoles ou des groupes d’écoles, après que les autorités académiques se seraient assurées d’un consensus suffisant, comprenant les autorités religieuses. Mais Mgr Jean Vilnet, président de la conférence des évêques de France, et Mgr Albert Decourtray, vice-président, reçus par François Mitterrand le 10 janvier 1985, expliquent au président de la République que, à leurs yeux, il n’est pas question que l’éventuel aménagement des rythmes scolaires compromette l’organisation de la catéchèse en France. Et le 12 février, Mgr Vilnet envoie une lettre au ministre pour l’informer que l’épiscopat entend que soit respecté le cadre défini par la loi de 1882 :
« Toute modification à la répartition des jours scolaires qui briserait l’organisation actuelle de la catéchèse, le mercredi matin, ne pourrait que compromettre les rapports de l’Église et de l’État dans notre pays. Ce que, je pense, vous et moi ne souhaitons pas. »
C’est ce que les journalistes ont appelé la « guerre du caté ».
Transférer les cours du samedi au mercredi : une demande des familles
La question est gelée pendant la période de la cohabitation (1986-1988), mais le retour des socialistes au pouvoir, en 1988, a pour effet de relancer le projet d’autoriser les transferts de cours du samedi au mercredi. L’épiscopat s’empresse de réagir. Les cardinaux Jean-Marie Lustiger et Albert Decourtray sont reçus, le 3 avril 1990, respectivement par le ministre de l’éducation nationale Lionel Jospin et par le premier ministre Michel Rocard.
Résultat : le 31 mai 1990, à Montauban, Lionel Jospin déclare ne pas vouloir imposer de changement brutal et affirme que la liberté dans l’organisation de la semaine scolaire « doit absolument s’accompagner de garanties nationales, notamment pour la catéchèse ». Des négociations ont lieu au ministère. La question du réaménagement du rythme de la semaine est large, mais « on ne parlait que du catéchisme », se souvient Catherine Moisan, chargée du dossier. Finalement, le décret du 22 avril 1991 retient les dispositions suivantes :
« Lorsque […] le conseil d’école souhaite adopter une organisation du temps scolaire qui déroge aux règles fixées par arrêté ministériel, il transmet son projet à l’inspecteur d’académie [qui] ne l’adopte que s’il ne porte pas atteinte à l’exercice de la liberté de l’instruction religieuse. »
Il est remarquable que ce ne soit pas le respect du rythme biologique des enfants qui ait motivé les projets de transfert, mais la demande des parents.
Au cours des Trente Glorieuses, l’importance des activités de loisir s’est accrue. Les parents peuvent désirer pratiquer ces activités avec leurs enfants le samedi, jour où ils sont de moins en moins nombreux à travailler. Dans les grandes villes, ce phénomène est d’autant plus marqué que les activités de loisir sont nombreuses et peuvent se trouver éloignées. De fait, le problème du samedi matin se pose avant tout en milieu urbain.
Un second facteur réside dans les mutations de la famille. De nombreux parents estiment important pour la vie familiale et l’équilibre affectif des enfants de pouvoir vivre pleinement ensemble pendant le week-end. L’augmentation du nombre des divorces joue dans le même sens : pour des raisons à la fois pratiques et affectives, les pères divorcés ayant la garde de leurs enfants un week-end sur deux sont désireux de prendre en charge leurs enfants dès le vendredi soir.
Par ailleurs, les parents qui travaillent préfèrent emmener leur enfant à l’école le mercredi plutôt que le samedi, où ils peuvent souhaiter faire la grasse matinée. L’accroissement du taux d’activité féminin, qui a été très marqué à partir des années 1960, représente un autre facteur : pour une femme qui travaille, il n’est pas toujours facile de trouver une solution de garde pendant toute la journée du mercredi. Aussi la libération du mercredi pour les enfants explique le fait que de nombreuses femmes sont contraintes de demander à travailler à temps partiel.
C’est donc essentiellement des parents que vient la demande de transfert : celle-ci n’est pas envisagée pour des raisons pédagogiques, mais pour faire face à la demande sociale.
Semaine de 4 jours et sécularisation de la société ?
Si les cours du samedi matin sont transférées le mercredi matin, la loi de 1882 n’est-elle pas respectée, puisque le samedi est entièrement libéré ? C’est ce que confirmera une décision de la Cour administrative d’appel de Lyon, le 18 septembre 2007. Mais dans les années 1970-1980, l’épiscopat ne voit pas les choses ainsi.
À ses yeux, les attraits du week-end complet sont irrésistibles pour que l’on puisse espérer, en dehors de parents de forte conviction, que les familles consentent à consacrer une partie des heures à l’instruction religieuse. Quant à placer le catéchisme le mercredi après-midi, ce n’est pas plus réaliste, alors que les enfants sont très sollicités par toutes sortes d’activités culturelles et sportives. Certes, de moins en moins d’enfants vont au catéchisme. Mais pour l’épiscopat, n’y eût-il que quelques cas, ce serait le principe de la liberté religieuse qui serait en jeu.
Admettant que l’évolution vers la libération du samedi est un phénomène de société difficile à combattre, il propose toutefois une solution : la semaine de quatre jours, la réduction de l’horaire hebdomadaire devant être compensée par l’allongement de l’année scolaire. Il fait observer que cette solution est de toute façon souhaitable pour alléger la semaine des enfants. Les oppositions corporatistes (instituteurs) et économiques (tourisme) ne doivent pas primer.
Si cette solution est permise par le décret du 22 avril 1991, elle n’a pas été généralisée. De toute façon, en 2008, les cours du samedi matin ont été supprimés dans les écoles primaires. En 2012, Vincent Peillon décide de remodeler les rythmes scolaires et de placer des cours le mercredi. Cette fois, pas de tempête : l’épiscopat ne réagit pas. Pas plus qu’il n’a réagi à la récente proposition de la Convention citoyenne sur les temps de l’enfant de passer de la semaine d’enseignement de quatre jours, à laquelle sont revenues depuis 2017 la plupart des écoles, à une semaine d’enseignements sur cinq jours, du lundi au vendredi.
Ce silence est révélateur de la conscience d’une perte d’influence dans l’opinion et dans une population française de plus en plus diverse.
Yves Verneuil ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
13.01.2026 à 15:58
L’IA peut-elle rendre la justice ?
Texte intégral (2415 mots)

Dans plusieurs pays, dont la France, la justice expérimente l’usage de l’intelligence artificielle. Quelle serait la légitimité d’une décision de justice rendue par un algorithme ? Serait-elle plus dissuasive ? Des chercheurs ont testé la perception d’une punition selon qu’elle émane d’un juge humain ou d’une IA.
L’idée de confier à des systèmes d’intelligence artificielle (IA) des décisions de justice ne relève plus de la science-fiction : au Canada, on expérimente des médiateurs automatisés ; en Chine, des tribunaux s’appuient sur l’IA ; en Malaisie, des tests de condamnations assistées par algorithmes sont en cours. Ces outils ne se limitent pas à un rôle d’assistance : dans certains contextes, ils influencent directement la sévérité des peines prononcées.
Au Québec, par exemple, une « cour virtuelle » résout déjà de nombreux petits litiges commerciaux. Il suffit de se connecter, d’indiquer les faits et un algorithme propose les issues financières les plus probables, offrant ainsi une solution extrajudiciaire et un dédommagement. Environ 68 % des dossiers sont réglés ainsi, en quelques semaines, ce qui évite les envois recommandés et le recours au juge de proximité. Certains États des États-Unis ont également recours au jugement fondé sur les données probantes (« evidence‑based sentencing »), qui s’appuie sur un algorithme capable d’estimer la durée optimale de la peine à infliger à un condamné, en cherchant à réduire au maximum la probabilité de récidive.
En France, plusieurs expériences sont en cours pour tester et intégrer de plus en plus l’IA dans le fonctionnement quotidien des juridictions, sachant que le ministère de la justice prévoit une charte pour un usage responsable de l’IA. Des applications concrètes sont déjà plus ou moins avancées – par exemple avec un système d’occultation automatique des données sensibles dans les décisions de justice, même si la vérification humaine reste indispensable ou des outils d’aide à la qualification pénale. Autre exemple, la réorganisation du tribunal de commerce de Paris mobilise l’IA avec l’ambition d’améliorer le traitement des litiges et libérer du temps pour les juges consulaires, notamment en plaçant les affaires ou en vérifiant les injonctions de payer. Dernière preuve en date de cet engouement, le ministère de la Justice s’est récemment doté d’une direction stratégique dédiée à l’intelligence artificielle.
À mesure que ces systèmes se déploient, de nombreuses questions surgissent. Par exemple, la justice repose beaucoup sur la confiance accordée au système. La légitimité conférée à l’IA en matière de décision de justice est donc cruciale. Autre point : l’un des rôles essentiels du droit pénal est de décourager les comportements hors-la-loi. Une amende pour stationnement sauvage, une peine de prison pour un délit grave : l’idée est qu’une sanction connue, proportionnée et prévisible empêche de franchir la ligne rouge, au moins pour une partie importante de la population. Cela amène à se demander si les sanctions prononcées par un algorithme paraissent plus, ou moins, dissuasives que celles d’un juge en chair et en os.
Pourquoi l’IA inspire la crainte… et parfois une certaine fascination
Concernant la légitimité de l’IA, ses partisans (comme des entreprises de la legal tech, des réformateurs au sein des institutions publiques ou certains chercheurs) avancent plusieurs arguments. Contrairement à un juge humain, susceptible d’être influencé par la fatigue, l’ordre des dossiers, ses valeurs ou même l’apparence d’un prévenu, l’algorithme se veut impartial. Son verdict repose sur des critères prédéfinis, sans états d’âme.
Cette impartialité accroît la prévisibilité des sanctions : un même acte conduit à une même peine, ce qui réduit les disparités entre décisions. Or, une sanction claire et attendue pourrait envoyer un signal plus fort aux citoyens et prévenir davantage les infractions. En outre, l’IA promet une justice plus rapide en automatisant certaines opérations comme la recherche documentaire, l’analyse ou l’aide à la rédaction : la célérité des sanctions, qui pourrait en découler, est bien connue pour jouer un rôle central dans leur efficacité dissuasive. Plusieurs experts reconnaissent que les IA permettent d’accélérer l’action de la justice.
Enfin, si elles sont conçues de manière transparente et sur des données non biaisées, les décisions automatisées peuvent réduire les discriminations qui minent parfois les décisions de justice, comme celles liées à l’âge ou au genre. Par exemple, le chercheur Daniel Chen, explique que les IA pourraient permettre de corriger les biais des juges humains. Dans cette perspective, l’IA est alors présentée par divers acteurs (start-up de la legal tech, réformateurs pro-IA, experts) comme ayant la capacité de renforcer le sentiment de justice et, par ricochet, la force dissuasive des peines.
Quand la sanction devient trop « froide »
Mais la médaille a son revers. L’IA apprend essentiellement des données issues de jugements humains. Or, ces données peuvent être biaisées. Au lieu de corriger les injustices du passé, on risque de les ancrer, et ce dans un système encore plus opaque, difficile à contester, typique des armes de destruction mathématique (des algorithmes opaques, à grande échelle, qui prennent des décisions impactant gravement la vie de millions d’individus, tout en étant injustes car ils reproduisent et amplifient les inégalités sociales).
Et surtout, la justice, ce n’est pas qu’un calcul. Les juges incarnent une autorité morale. Leur rôle n’est pas seulement d’appliquer la loi, mais de porter un message à l’échelle de la société : dire publiquement ce qui est inacceptable, reconnaître la souffrance des victimes, condamner un comportement en termes éthiques. Cette dimension symbolique est particulièrement importante pour les crimes graves, où l’attente n’est pas seulement la sanction mais aussi l’expression collective d’un rejet moral. Or, l’IA ne peut transmettre ce message. Dans ces cas, elle pourrait être perçue comme moins légitime et donc moins dissuasive.
De plus, les juges ont une certaine latitude pour individualiser les peines, c’est-à-dire pour ajuster les peines en fonction d’éléments variés, souvent qualitatifs et subjectifs (personnalité du prévenu, circonstances et spécificités de l’infraction), difficiles à formaliser et à intégrer dans un système décisionnel relevant d’une IA.
Petits délits, actes criminels : l’IA et les juges à l’épreuve
Une expérience que nous avons conduite en France, en 2023, sur plus de 200 participants a cherché à tester si la perception d’une même punition varie selon qu’elle émane d’un juge humain ou d’une IA. Sur la base de scénarios d’infractions identiques et de sanctions identiques, les participants ont été affectés aléatoirement soit au cas où la décision avait été rendue par un juge humain, soit au cas où elle avait été rendue par une IA. Dans le cas banal d’une personne négligente laissant les excréments de son chien sur le trottoir, la même sanction apparaissait plus dissuasive si elle venait… d’une IA. Facile à juger, cette infraction mineure semble se prêter à un traitement algorithmique, clair et rapide. Mais dans le cas d’un incendie criminel, la sanction par l’IA n’était pas jugée plus dissuasive que celle d’un juge. Comme si, face à une faute lourde, l’autorité morale d’un magistrat restait indispensable.
Bien entendu, notre étude est une modélisation simplifiée de la réalité, dans un cadre épuré, qui passe sous silence de nombreux paramètres. Par exemple, un contrevenant potentiel ne connaît pas toujours la sanction encourue au moment où il envisage de passer à l’acte. Néanmoins, les études montrent que les individus ont une idée de ce qu’ils encourent en s’engageant dans certains comportements et qu’ils révisent leurs croyances en fonction de leurs propres expériences ou de celles vécues par d’autres.
Faut-il en conclure qu’il vaut mieux confier les délits mineurs aux machines et les crimes graves aux humains ? Pas forcément. Cependant, l’expérience révèle un point clé : nous n’attendons pas la même chose d’une sanction selon la gravité de l’infraction.
Peut-être que l’avenir de la justice réside non pas dans un remplacement, mais dans une alliance, dans l’exploitation intelligente d’une complémentarité. Les juges assurent une multitude de fonctions qui ne pourraient être effectuées par un algorithme. Ils représentent notamment une figure d’autorité humaine, garante d’un principe de justice démocratique et soucieuse du bien-être de la société, qui dépasse la simple répression pour représenter la volonté générale et garantir l’équilibre social. Entre autres missions, ils incarnent la société, interprètent les zones grises et sont chargés de transmettre le message moral de la sanction. L’IA pourrait les épauler en contribuant à renforcer la prise en compte automatisée de certains critères jugés préalablement pertinents. Elle pourrait augmenter la rapidité de la prise de décision et assurer une forme de cohérence des jugements en évitant des écarts trop importants entre sanctions pour une infraction similaire.
Une question de confiance
Derrière cette révolution judiciaire, il y a une question plus large : à qui faisons-nous confiance ? Si l’opinion perçoit l’algorithme comme une boîte noire, reproduisant les biais avec une froideur implacable, c’est l’autorité des systèmes juridique et judiciaire qui risque de vaciller.
La justice n’est pas seulement affaire de règles, c’est aussi une scène où la société dit ses valeurs. Tant que les algorithmes ne pourront pas endosser ce rôle symbolique, leurs sentences ne pourront pas remplacer celles énoncées par les juges. Mais s’ils sont conçus avec transparence, rigueur et contrôle humain, ces algorithmes pourraient rendre la justice plus prévisible, et potentiellement, plus dissuasive. Encore faut-il ne jamais oublier qu’au bout d’une ligne de code, ce n’est pas une donnée abstraite qui est jugée, mais un être humain bien réel.
Les auteurs ne travaillent pas, ne conseillent pas, ne possèdent pas de parts, ne reçoivent pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'ont déclaré aucune autre affiliation que leur organisme de recherche.
13.01.2026 à 15:57
« La normalisation du RN pourrait passer par l’effacement de Marine Le Pen »
Texte intégral (1688 mots)
Le procès en appel dans l’affaire des assistants parlementaires européens du Front national (Rassemblement national, depuis 2018) a débuté ce mardi 13 janvier à Paris. En première instance, Marine Le Pen avait été condamnée à quatre ans d’emprisonnement pour détournement de fonds publics. Une peine d’inéligibilité de cinq ans avait également été prononcée, compromettant sa candidature à la présidentielle de 2027. Avant le jugement en appel, on constate un affaiblissement politique de Marine Le Pen et une montée en puissance de Jordan Bardella. Quelles sont les perspectives pour le RN à moins de deux ans de la présidentielle ? Entretien avec le politiste Luc Rouban.
The Conversation : Faisant appel de sa condamnation en première instance, Marine Le Pen joue son avenir politique. Elle pourrait être définitivement empêchée de candidater à la présidentielle de 2027. Comment analysez-vous sa position face au tribunal ?
Luc Rouban : On ne peut pas, bien sûr, anticiper le jugement, mais Marine Le Pen semble prisonnière d’une situation inextricable : en première instance, sa stratégie a consisté à délégitimer les juges sur le mode « Vous n’avez pas à intervenir dans cette affaire qui est politique, vous êtes en train de tuer la démocratie, etc. » Cette stratégie n’a pas fonctionné et on ne voit pas pourquoi elle fonctionnerait en appel. Changera-t-elle de stratégie en jouant l’amende honorable ? En plaidant l’erreur et la bonne foi ? Cela reviendrait à avouer des délits très graves et à révéler une hypocrisie qui ne pourrait que lui nuire. Je ne vois pas de bonne solution la concernant.
Marine Le Pen a opposé les juges et la démocratie, lors de son premier procès. Vous considérez au contraire que celui-ci, comme celui de Nicolas Sarkozy qui a conduit à son incarcération (pour le financement libyen de sa campagne présidentielle de 2007), est un signe de maturité démocratique.
L. R. : Effectivement, les condamnations de Marine Le Pen et de Nicolas Sarkozy signalent un changement d’époque dans le rapport des Français au politique. L’emprisonnement de Nicolas Sarkozy ou la condamnation de Marine Le Pen ont suscité des contestations de la part de leurs soutiens directs et de la droite en général mais, au fond, elles n’ont pas choqué la majorité des Français. Un sondage de l’institut Verian montre que la stratégie de dénonciation de la justice n’a pas fonctionné : la moitié des personnes interrogées considèrent que Marine Le Pen a été « traitée comme n’importe quel justiciable » et seulement un tiers des personnes interrogées (soit sa base électorale) considèrent qu’elle a été « traitée plus sévèrement pour des raisons politiques ». Ces deux condamnations marquent la fin des privilèges du personnel politique vis-à-vis de la justice. Comme si nous entrions enfin dans une forme de modernité au moment où les élus ne sont plus crédités d’une autorité telle que les citoyens les autorisent à déroger au droit commun. La politique est devenue une activité professionnelle comme une autre, soumise à des réglementations et à des lois et elle passe progressivement d’une fonction d’autorité, qui autorisait la légitimation d’une règle du jeu à deux vitesses, à une fonction de service.
Pour ma part, je considère que la réaffirmation de l’État de droit est tout à fait indispensable et légitime en France. Notre système démocratique est très fragilisé, bien plus que dans d’autres pays européens. Le niveau de confiance des citoyens envers la classe politique et dans la justice est très bas et il doit être restauré. Cela passe notamment par le fait que la justice s’applique à des personnalités qui abusent des fonds publics et pas uniquement à des caissières de supermarché qui se font licencier et sont poursuivies au pénal pour le vol d’une barre chocolatée.
Depuis sa condamnation en première instance Marine Le Pen chute dans les sondages et semble de moins en moins en capacité de porter une dynamique pour le RN…
L. R. : Marine Le Pen s’est présentée comme porteuse de justice et d’équité. Elle fait partie de ceux qui avaient applaudi au moment de la loi Sapin 2, votée à l’unanimité en 2016 à la suite de l’affaire Cahuzac. Or la voilà jugée pour détournement de fonds européens au profit de son parti.
Elle paie donc le prix de ses contradictions, mais aussi de sa stratégie de normalisation destinée à sortir le RN du giron de l’ancien FN de son père, Jean-Marie Le Pen. C’est elle qui a demandé aux députés de se conduire correctement à l’Assemblée nationale, qu’il n’y ait pas de provocations, de phrases antisémites ou racistes de la part des candidats aux différentes élections. Or ce processus de normalisation est en train de se retourner contre elle avec ce procès. Elle est la victime de sa propre stratégie qui la condamne, soit à rester dans la périphérie et l’imprécation, soit à jouer le jeu de la normalité jusqu’au bout. Dans les deux cas, son avenir politique est compromis.
On peut même penser que la délepénisation du RN va désormais passer par l’élimination politique de Marine Le Pen. En effet, ne plus avoir la marque « Le Pen » à la tête du parti pourrait arranger nombre de dirigeants du RN. Pour avoir une chance de gagner en 2027, ce parti doit étendre son électorat aux couches moyennes supérieures diplômées, et cela passera possiblement par un effacement de Marine Le Pen.
Jordan Bardella semble auréolé d’une forte dynamique médiatique et sondagière. Il a même été placé en tête au second tour de la présidentielle par une enquête : selon le baromètre Odoxa, il recueillerait 53 % des voix face à Édouard Philippe, 58 % face à Raphaël Glucksmann, 56 % face à Gabriel Attal et 74 % face à Jean-Luc Mélenchon… Comment analysez-vous ces sondages ? Quels sont les atouts et les faiblesses du président du RN ?
L. R. : Jordan Bardella ne s’appelle pas Le Pen : c’est désormais un atout au sein du RN. Par là, il peut déjà incarner un moment de rupture et de renouveau pour le parti qui aspire à devenir un parti de droite radicale et non plus d’extrême droite, mais aussi un parti plus libéral sur le plan économique. Ce nouveau RN correspondrait assez bien à une culture trumpiste qui fait son chemin en France. Il permettrait notamment de rallier des électeurs Les Républicains (LR) et Reconquête.
Concernant les sondages qui placent Bardella très haut, il faut commencer par dire que cela est bien logique. Si la peine de Marine Le Pen est confirmée en appel, ce qui est anticipé par beaucoup, Bardella devient le représentant du parti dominant, donc il se retrouve « naturellement » en tête. Ensuite, il faut rester prudent avec ces chiffres car l’échéance est lointaine. Reste la grande question : Bardella tiendra-t-il le choc d’une campagne présidentielle ?
On s’interroge sur la crédibilité personnelle de cet homme âgé de 30 ans. Il ne faut pas oublier que les Français recherchent dans une élection présidentielle une forme d’excellence intellectuelle (même s’ils sont souvent déçus ensuite). La course à l’Élysée est une compétition très élitiste et tous les candidats ou présidents qui se sont succédé jusqu’à présent étaient des personnes qui avaient un haut niveau d’études, des ressources culturelles et sociales importantes sans même parler de leur long parcours politique. Ce n’est pas le cas de Jordan Bardella, qui par ailleurs, n’a aucune expérience de terrain, de gestion publique et aucune expérience professionnelle en dehors de la politique.
Ensuite, tout dépendra de qui lui fera face au second tour. S’il s’agit d’un Édouard Philippe, par exemple, maire du Havre, ancien premier ministre, énarque et homme qui connaît bien les rouages de l’État, Bardella pourra-t-il tenir le choc d’un débat du second tour ? On a bien vu que Marine Le Pen n’a pas pu faire face à Emmanuel Macron en 2017. Elle ne connaissait pas les dossiers européens, elle se perdait dans ses fiches… Bardella fera-t-il mieux ? S’il échoue, il sera certainement remplacé au sein d’un RN où d’autres se préparent.
Propos recueillis par David Bornstein.
*Luc Rouban est l’auteur de_ la Société contre la politique_ (2026), aux Presses de Sciences Po.
Luc Rouban ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
13.01.2026 à 15:45
Enquête qualitative sur la diaspora malgache en France
Texte intégral (2629 mots)

Forte de près de 170 000 personnes, cette communauté est pourtant peu connue en France. Une enquête permet de mieux comprendre la perception de l’appartenance à la diaspora malgache ainsi que la diversité des relations entre les membres.
La diaspora malgache est l’une des principales diasporas d’Afrique subsaharienne en France. Les dernières estimations, datant de 2015, font état de 170 000 personnes, ce qui la place au même niveau que les diasporas malienne et sénégalaise. Malgré son importance numérique et son rôle important lors des récentes manifestations de la Gen Z à Madagascar, notamment à travers une mobilisation soutenue sur le réseau social Facebook, cette communauté est peu visible. Elle fait notamment l’objet de peu d’études si on la compare aux autres diasporas préalablement citées.
Une communauté peu connue
On peut faire remonter la première présence malgache en France hexagonale à la moitié du XIXᵉ siècle avec la venue de deux étudiants malgaches inscrits en faculté de médecine. Par la suite, d’autres étudiants, principalement issus des classes bourgeoises proches du pouvoir colonial, suivront le même chemin (études de médecine et de théologie). Cependant, comme le précise Chantal Crenn dans son livre Entre Tananarive et Bordeaux. Les migrations malgaches en France, il est difficile de parler de première vague tant le nombre est faible.
Il faut attendre la Première Guerre mondiale pour observer la première vague importante avec l’arrivée de 40 000 hommes, puis une deuxième vague avec la Seconde Guerre mondiale. Après 1947, la venue de Malgaches en métropole est principalement le fait d’étudiants issus de la bourgeoisie des Hautes Terres. Dans les années 1975-1980, les difficultés économiques et politiques de la Grande île vont pousser une partie des étudiants à venir étudier en France métropolitaine et certains à y rester.
Cet article se propose de combler en partie ces lacunes en analysant les résultats de l’enquête qualitative « Perception et réseaux de la diaspora malgache en France », réalisée dans le cadre du projet de recherche TADY entre janvier 2025 et décembre 2025, regroupant 25 entretiens réalisés avec des membres de la diaspora malgache en France (France hexagonale et La Réunion) et à Madagascar.
Dans le cadre de ces entretiens, deux thématiques principales ont été abordées : d’une part, la perception de l’appartenance à la diaspora malgache ; d’autre part, la diversité des relations entre les membres de la diaspora en France, ainsi que les relations entre cette communauté et Madagascar.
Les résultats développés dans cet article n’engagent pas l’ensemble de l’équipe de recherche du projet TADY mais les seuls auteurs de l’enquête « Perception et réseaux de la diaspora malgache en France ». Cependant, les travaux ont bénéficié d’interactions porteuses au sein du projet TADY et les auteurs remercient à ce titre l’ensemble des membres du projet. Nous renvoyons également les lecteurs au rapport « La diaspora malagasy en France et dans le monde : une communauté invisible ? ». Le projet TADY est composé de différents volets proposant à la fois une analyse qualitative et quantitative de la diaspora malgache. Dans cet article, nous nous concentrons sur les résultats des enquêtes qualitatives. S’agissant des enquêtes quantitatives, celles-ci permettront d’améliorer les connaissances sur la taille et les caractéristiques de cette diaspora.
Définitions endogènes de la diaspora malgache
L’analyse des entretiens de notre enquête ne permet pas d’identifier une définition commune et uniforme à l’ensemble des membres de la diaspora.
Cela rejoint la littérature scientifique sur les diasporas et souligne la nécessité de ne pas adopter une définition trop restrictive des groupes diasporiques. Dans les faits, nous identifions plusieurs visions avancées par les personnes enquêtées, qui peuvent être cumulatives ou non.
Premièrement, une vision identitaire et culturelle met en lumière une série d’arguments en lien avec le fait d’être natif de Madagascar ; d’avoir un attachement identitaire et culturel ; ou encore d’avoir la nationalité malgache (sans forcément avoir un attachement particulier à la culture malgache ou au pays). Ainsi, plusieurs entretiens soulignent que l’appartenance à la diaspora malgache renvoie au fait d’être né à Madagascar puis d’avoir migré, ou encore d’avoir la nationalité et de vivre dans un autre pays que Madagascar.
« La diaspora pour moi, c’est être natif du pays tout en étant parti du pays. »
Cette définition est pour certaines personnes une condition essentielle de l’appartenance au groupe diasporique. D’autres ont une vision plus large et considèrent que l’appartenance à la diaspora malgache est davantage liée aux pratiques culturelles, surtout au fait de parler le malgache.
« Quelqu’un de deuxième génération peut être considéré comme de la diaspora, mais cela dépend de l’éducation. Si les deux parents sont nés à Madagascar, et si les parents entretiennent la langue avec leurs enfants. Dans ce cas, oui. Sinon, les enfants peuvent avoir un rejet. Cette adoption passe par la langue mais aussi la culture, l’adoption du pays. »
Deuxièmement, une vision réticulaire et communautaire, avec deux représentations.
La première (représentation plus individuelle) renvoie au fait d’être en relation avec les membres de la diaspora et/ou d’être en relation avec Madagascar.
« Pour moi, la diaspora c’est toute personne qui a une relation avec Madagascar – que la personne soit malgache ou mariée à un Malgache ou née en France mais enfant de Malgache. Voilà, donc dès qu’il y a une relation avec quelqu’un qui vient de Madagascar ou qui est malgache, qu’il soit né ou pas à Madagascar, pour moi, ça constitue totalement la diaspora. »
La deuxième représentation organisationnelle et communautaire (moins fréquente) qualifie la diaspora comme étant toute forme d’action collective et d’organisation (formelle ou non) qui œuvre pour l’intérêt des Malgaches en France ou à Madagascar.
« Selon moi, la diaspora malgache, c’est la communauté de Malgaches à l’étranger qui se retrouvent par leur origine […] et qui se réunissent selon leurs centres d’intérêt (sportif, religion commune, ou un aspect culturel, etc.). »
Comme nous le verrons dans la suite de l’article, cette dimension réticulaire prend une place importante.
La structuration de la diaspora malgache en France
L’analyse des récits nous permet également d’identifier une dimension centrale de la diaspora : celle de la complexité et de la diversité des relations entre diaspora et Madagascar, d’une part, et entre les membres de la diaspora, d’autre part.
Premièrement, l’ensemble des témoignages soulignent l’importance des relations d’entraide entre les membres de la diaspora et Madagascar.
D’abord, les soutiens sont pour la plupart intrafamiliaux et peuvent être plus ou moins réguliers. Ils peuvent intervenir pendant un événement ponctuel (mariage, enterrement, baptême, maladie) ou bien plus régulièrement (transfert mensuel, paiement de frais de scolarité, etc.).
« Chaque fois que mes parents avaient besoin, ou avaient un pépin à Madagascar, il fallait dépanner. Ils n’avaient personne sur qui compter à part moi. Donc on part, on ne se rend pas forcément compte, mais il y a une responsabilité derrière. »
Ces logiques d’entraide s’apparentent souvent à de véritables mécanismes de protection sociale s’inscrivant dans une stratégie familiale construite autour de la migration.
D’autres témoignages relatent des processus d’entraide qui dépassent le simple cercle intrafamilial. À l’échelle de la famille élargie, de nombreuses initiatives sont développées dans le village d’origine des parents ou, plus largement, dans le lieu d’origine de la famille à Madagascar. Les mécanismes d’entraide sous-tendent de nombreux processus de négociation et des échanges complexes. Les écarts économiques et les perceptions de ces écarts renforcent la complexité de ces relations.
De nombreux témoignages soulignent la complexité des réseaux d’entraide entre la diaspora et Madagascar :
« Quand on envoie de l’argent là-bas, comme c’est un pays pauvre, ma famille a des voisins, les voisins savent que la famille de France envoie de l’argent, alors des fois quand on envoie de l’argent, on nourrit tout un voisinage. Donc des fois ma famille en demande un peu plus. C’est en allant là-bas que je l’ai vu et je l’ai vécu. »
Ainsi, les mécanismes d’entraide intrafamiliaux réguliers (entre enfants en France et parents à Madagascar par exemple) sont souvent le pilier de tout un système de redistribution impliquant de nombreuses personnes à Madagascar et en France.
Ensuite, au-delà de la logique de l’aide privée, plusieurs répondants soulignent la nécessité ressentie d’œuvrer directement pour Madagascar. Ils expriment leur sentiment de devoir moral impérieux, souvent cultivé au sein de la famille, à réinvestir leurs compétences acquises en France pour le développement de Madagascar.
Cette position, ancrée dans leur vision propre des enjeux du développement à l’île, se décline entre s’investir via l’aide au développement ou via le secteur privé, dans une perspective critique de l’aide. Dans les deux cas, toutefois, cette volonté de mobiliser ses compétences pour Madagascar entre en tension avec les opportunités limitées sur le marché du travail local, que ce soit en termes d’accès à l’emploi ou en termes de traitement salarial, en lien avec les écarts rapportés par plusieurs répondants entre conditions salariales des expatriés et conditions salariales des personnels nationaux. Les personnes malgaches venues étudier en France craignent de recevoir un salaire local alors que leur niveau de compétence est validé par un diplôme international.
Toutefois, malgré le manque d’opportunités de retour à Madagascar, la participation de la diaspora au développement du pays est bien réelle et prend notamment la forme de ressources immatérielles à travers le transfert d’opinions et d’idées qui peuvent influencer voire façonner celles des membres de la famille et plus largement l’opinion publique et dont le principal support et espace d’expression est Facebook, le réseau social le plus utilisé par les Malgaches.
Plusieurs enquêtés affirment s’informer régulièrement sur la situation du pays et certains prennent le temps de discuter les actualités avec leurs proches à Madagascar.
Par ailleurs, les influenceurs et lanceurs d’alerte sur Facebook basés en Europe, qui bénéficient d’une grande popularité en France comme à Madagascar, ont joué un rôle important dans le mouvement de la Gen Z.
Deuxièmement, l’analyse des récits permet également de caractériser la diversité des réseaux diasporiques en France selon les personnes.
Certaines se trouvent dans des réseaux exclusivement structurés autour de la famille proche et n’ont que peu de relations avec le reste de la diaspora malgache en France.
« En tant que personne faisant partie de la diaspora, je n’ai pas beaucoup échangé avec d’autres personnes de la diaspora, à part la famille. J’ai une définition très personnelle et très restreinte, je ne connais pas d’associations ou autre, je n’en ai jamais fait partie. »
Ces personnes peuvent par ailleurs maintenir des relations avec les membres de la famille présents à Madagascar. Tandis que d’autres, et ce à des niveaux variables, sont insérées dans des associations sportives, culturelles ou religieuses. Les organisations cultuelles malgaches occupent une place centrale dans la structuration des réseaux diasporiques. Au-delà de la fonction cultuelle, les Églises chrétiennes malgaches, dont les deux plus importantes et présentes dans les grandes villes françaises sont l’Église protestante malgache en France et le réseau des communautés catholiques malgaches de France, assurent souvent un rôle déterminant d’accueil et d’intégration des nouveaux arrivants (recherche d’emploi et de logement, conseil administratif), et favorisent également le maintien d’un lien fréquent et fort avec la communauté malgache.
« Sans la communauté malgache, je ne sais pas trop comment j’aurais pu m’en sortir à mon arrivée en France. C’est complètement grâce à la communauté malgache que j’ai pu m’en sortir, parce que ne serait-ce qu’avoir des amis, avoir des gens qui aident, par rapport à tout ce qui est administratif… parce qu’arriver en France sans rien connaître du tout, c’est très compliqué. […] Tout a été facilité par cette communauté malgache. La communauté de l’Église m’a permis de ne pas trop perdre mes repères et de ne pas être perdu totalement après mon arrivée en France. »
En conclusion, les principaux résultats de l’enquête soulignent la complexité des structures des réseaux diasporiques. Cette dernière s’explique non seulement par la diversité des représentations que la diaspora a d’elle-même mais aussi par la multitude des formes d’interaction qu’elle entretient avec Madagascar.
Cet article a été co-écrit avec Sarah M’Roivili.
Léo Delpy a reçu des financements du projet Tady.
Claire Gondard-Delcroix a reçu des financements du projet Tady.
Tantely Andrianantoandro et Tsiry Andrianampiarivo ne travaillent pas, ne conseillent pas, ne possèdent pas de parts, ne reçoivent pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'ont déclaré aucune autre affiliation que leur poste universitaire.
11.01.2026 à 15:41
Quand les IA cadrent l’information et façonnent notre vision du monde
Texte intégral (1938 mots)

Les grands modèles de langage façonnent notre perception de l’information, au-delà de l’exactitude ou inexactitude des faits présentés. Dans cette optique, comprendre et corriger les biais de l’intelligence artificielle est crucial pour préserver une information fiable et équilibrée.
La décision de Meta de mettre fin à son programme de fact-checking aux États-Unis a suscité une vague de critiques dans les milieux de la technologie et des médias (NDT : En France, le programme est maintenu). En jeu, les conséquences d’une pareille décision en termes de confiance et de fiabilité du paysage informationnel numérique, en particulier lorsque des plates-formes guidées par le seul profit sont en grande partie laissées à elles-mêmes pour se réguler.
Ce que ce débat a largement négligé, toutefois, c’est qu’aujourd’hui les grands modèles de langage d’intelligence artificielle (IA) sont de plus en plus utilisés pour rédiger des résumés d’actualité, des titres et des contenus qui captent votre attention bien avant que les mécanismes traditionnels de modération des contenus puissent intervenir.
Le problème ne se limite pas à des cas évidents de désinformation ou de contenus préjudiciables qui passeraient entre les mailles du filet en l’absence de modération. Ce qui se joue dans l’ombre, c’est comment des informations factuellement justes peuvent être sélectionnées, présentées et valorisées de façon à orienter la perception du public.
En générant les informations que les chatbots et assistants virtuels présentent à leurs utilisateurs, les grands modèles de langage (LLM) influencent progressivement la manière dont les individus se forgent une opinion. Ces modèles sont désormais également intégrés aux sites d’information, aux plates-formes de réseaux sociaux et aux services de recherche, devenant ainsi la principale porte d’accès à l’information.
Des études montrent que ces grands modèles de langage font bien plus que simplement transmettre de l’information. Leurs réponses peuvent mettre subtilement en avant certains points de vue tout en en minimisant d’autres, souvent à l’insu des utilisateurs.
Biais de communication
Mon collègue, l’informaticien Stefan Schmid, et moi-même, chercheur en droit et politiques des technologies, montrons dans un article à paraître dans la revue Communications of the ACM que les grands modèles de langage présentent un biais de communication. Nous constatons qu’ils peuvent avoir tendance à mettre en avant certaines perspectives tout en en omettant ou en atténuant d’autres. Un tel biais est susceptible d’influencer la manière dont les utilisateurs pensent ou ressentent les choses, indépendamment du fait que l’information présentée soit vraie ou fausse.
Les recherches empiriques menées ces dernières années ont permis de constituer des jeux de données de référence qui mettent en relation les productions des modèles avec les positions des partis avant et pendant les élections. Elles révèlent des variations dans la manière dont les grands modèles de langage actuels traitent ces contenus publics. Le simple choix de la persona (l’identité fictive implicitement assignée au modèle) ou du contexte dans la requête suffit à faire glisser subtilement les modèles actuels vers certaines positions, sans que la justesse factuelle des informations soit remise en cause.
Ces glissements révèlent l’émergence d’une forme de pilotage fondée sur la persona : la tendance d’un modèle à aligner son ton et ses priorités sur ce qu’il perçoit comme les attentes de l’utilisateur. Ainsi, lorsqu’un utilisateur se présente comme militant écologiste et un autre comme chef d’entreprise, un modèle peut répondre à une même question sur une nouvelle loi climatique en mettant l’accent sur des préoccupations différentes, tout en restant factuellement exact dans les deux cas. Les critiques pourront par exemple porter, pour l’un, sur le fait que la loi n’aille pas assez loin dans la promotion des bénéfices environnementaux, et pour l’autre, sur les contraintes réglementaires et les coûts de mise en conformité qu’elle impose.
Un tel alignement peut facilement être interprété comme une forme de flatterie. Ce phénomène est appelé « sycophancy » (NDT : Si en français, le sycophante est un délateur, en anglais il désigne un flatteur fourbe), les modèles disant en pratique aux utilisateurs ce qu’ils ont envie d’entendre. Mais si la « sycophancy » est un symptôme de l’interaction entre l’utilisateur et le modèle, le biais de communication est plus profond encore. Il reflète des déséquilibres dans la conception et le développement de ces systèmes, dans les jeux de données dont ils sont issus et dans les incitations qui orientent leur perfectionnement. Lorsqu’une poignée de développeurs dominent le marché des grands modèles de langage et que leurs systèmes présentent systématiquement certains points de vue sous un jour plus favorable que d’autres, de légères différences de comportement peuvent se transformer, à grande échelle, en distorsions significatives de la communication publique.
Ce que la régulation peut – et ne peut pas – faire
Les sociétés contemporaines s’appuient de plus en plus sur les grands modèles de langage comme interface principale entre les individus et l’information. Partout dans le monde, les gouvernements ont lancé des politiques pour répondre aux préoccupations liées aux biais de l’IA. L’Union européenne, par exemple, avec l’AI Act et le règlement européen sur les services numériques, cherche à imposer davantage de transparence et de responsabilité. Mais aucun de ces textes n’est conçu pour traiter la question plus subtile du biais de communication dans les réponses produites par l’IA.
Les partisans de la régulation de l’IA invoquent souvent l’objectif d’une IA neutre, mais une neutralité véritable est le plus souvent hors d’atteinte. Les systèmes d’IA reflètent les biais inscrits dans leurs données, leur entraînement et leur conception, et les tentatives pour réguler ces biais aboutissent fréquemment à remplacer une forme de biais par une autre.
Et le biais de communication ne se limite pas à l’exactitude : il concerne la production et le cadrage des contenus. Imaginons que l’on interroge un système d’IA sur un texte législatif controversé. La réponse du modèle est façonnée non seulement par les faits, mais aussi par la manière dont ces faits sont présentés, par les sources mises en avant, ainsi que par le ton et le point de vue adoptés.
Cela signifie que la racine du problème des biais ne réside pas seulement dans la correction de données d’entraînement biaisées ou de sorties déséquilibrées, mais aussi dans les structures de marché qui orientent la conception des technologies. Lorsque seuls quelques grands modèles de langage (LLM) contrôlent l’accès à l’information, le risque de biais de communication s’accroît. Une atténuation efficace des biais suppose donc de préserver la concurrence, de renforcer la responsabilité portée par les utilisateurs et tout en restant ouvert aux différentes conceptions et offres de LLM du côté du régulateur.
La plupart des réglementations actuelles visent soit à interdire des contenus préjudiciables après le déploiement des technologies, soit à contraindre les entreprises à réaliser des audits avant leur mise sur le marché. Notre analyse montre que si les contrôles en amont et la supervision a posteriori peuvent permettre d’identifier les erreurs les plus manifestes, ils sont souvent moins efficaces pour traiter les biais de communication subtils qui émergent au fil des interactions avec les utilisateurs.
Aller au-delà de la régulation de l’IA
Il est tentant de croire que la régulation peut éliminer l’ensemble des biais des systèmes d’IA. Dans certains cas, ces politiques peuvent être utiles, mais elles échouent le plus souvent à traiter un problème plus profond : les incitations qui déterminent les technologies chargées de communiquer l’information au public.
Nos travaux montrent qu’une solution plus durable réside dans le renforcement de la concurrence, de la transparence et d’une participation effective des utilisateurs, afin de permettre aux citoyens de jouer un rôle actif dans la manière dont les entreprises conçoivent, testent et déploient les grands modèles de langage.
Ces orientations sont essentielles car, in fine, l’IA n’influencera pas seulement les informations que nous recherchons et l’actualité que nous consommons au quotidien : elle jouera aussi un rôle déterminant dans la façon dont nous imaginons la société de demain.
Adrian Kuenzler ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
08.01.2026 à 17:21
Loi de finances spéciale : une entorse à la Constitution ?
Texte intégral (2006 mots)
Une nouvelle loi de finances spéciale a été adoptée par le Parlement, le 23 décembre 2025. Or ce choix politique est contestable d’un point de vue juridique. En cas de blocage dans l’examen du budget, la Constitution prévoit un recours à l’article 49-3 ou une mise en œuvre du budget par ordonnances. On ne peut appeler à la défense de l’État de droit face à des dérives autoritaires et contourner la Constitution quand il s’agit d’adopter le budget.
L’adoption du budget est un moment crucial, car elle conditionne le financement de l’action publique pour l’année suivante. Dans une démocratie représentative, il appartient en principe au Parlement d’adopter chaque année le budget, que le gouvernement est ensuite autorisé à exécuter.
En France, la Constitution encadre strictement cette procédure afin d’éviter toute paralysie de l’État. Les délais d’examen sont volontairement contraints (40 jours pour l’Assemblée nationale, 20 jours pour le Sénat) et, en cas de blocage, le gouvernement peut soit recourir à l’article 49 alinéa 3, soit mettre en œuvre le budget par ordonnances si le Parlement ne s’est pas prononcé dans un délai de 70 jours. Tout est donc fait pour éviter un « shutdown » à l’américaine, même si, formellement, ce dernier ne peut être catégoriquement exclu en cas de rejet définitif du Parlement d’une loi de finances, y compris spéciale.
Or, depuis la dissolution de 2024, une Assemblée nationale profondément divisée empêche l’adoption du budget avant le 31 décembre. Pour assurer la continuité de l’État, une loi de finances spéciale en 2024 avait déjà été adoptée, en attendant l’adoption tardive de la loi de finances en février 2025. Les mêmes causes produisant les mêmes effets, une nouvelle loi de finances spéciale a été adoptée pour 2025.
Cette solution est souvent présentée comme un mal nécessaire. La loi de finances spéciale a d’ailleurs été adoptée à l’unanimité (avec des abstentions) par l’Assemblée nationale en 2024 et en 2025. Pourtant, cette nécessité n’est pas juridique. Aucun texte juridique n’oblige le gouvernement à déposer une loi de finances spéciale. Au contraire, un respect scrupuleux de la Constitution plaiderait plutôt en faveur du recours aux ordonnances, expressément prévues pour ce type de situation. Si cette option est écartée, ce n’est donc pas pour des raisons juridiques mais pour des raisons politiques.
Derrière ce débat technique se cache une question simple : peut-on, au nom de la recherche d’un consensus politique au sein du Parlement, s’affranchir de la Constitution ?
Une loi de finances spéciale… spéciale
La Constitution prévoit qu’une loi spéciale n’est possible que si le projet de loi de finances n’a pas été déposé « en temps utile » (article 47 alinéa 4 de la Constitution).
Qu’est-ce qu’un dépôt en « temps utile » ? On peut raisonnablement avancer que le projet sera déposé en temps utile lorsqu’il laissera 70 jours au Parlement pour examiner le texte (et, éventuellement, 8 jours au juge constitutionnel pour rendre sa décision), soit le délai au bout duquel le gouvernement pourra mettre en vigueur le projet de loi de finances par ordonnances.
Depuis que le gouvernement a déposé le projet le 14 octobre 2025 à l’Assemblée, le délai de 70 jours court jusqu’au 23 décembre, auquel s’ajoutent 8 jours pour le Conseil constitutionnel, portant la date limite au 31 décembre. Ainsi, le gouvernement a déposé le projet de loi de finances en temps utile. Notons que, dans le cadre de l’examen du projet de loi de finances précédent, le délai de 70 jours avait même été atteint avant le 23 décembre.
Dès lors, les lois de finances spéciales depuis la dissolution de 2024 ne correspondent à aucune hypothèse prévue par la Constitution. Il s’agit de lois de finances sui generis, autrement dit de lois de finances spéciales… spéciales.
Un remède constitutionnel ou un pouvoir inconstitutionnel ?
Ni la Constitution ni les règles budgétaires ne prévoient formellement l’existence de ces lois de finances spéciales adoptées par le Parlement. La question est donc simple : sur quoi le gouvernement fonde-t-il sa compétence pour déposer ces textes ? L’enjeu est important : le principe même d’un État de droit repose sur la nécessité que les gouvernants exercent un pouvoir prévu par le droit, notamment par une Constitution.
La réponse tient à un précédent ancien, datant de 1979. Cette année-là, le Conseil constitutionnel avait admis, de manière exceptionnelle, une loi de finances sui generis après avoir censuré la loi de finances initiale, le 24 décembre, pour un vice de forme. L’État se retrouvait alors sans budget à quelques jours du 1er janvier. Face à cette urgence extrême, le Conseil constitutionnel avait validé une loi de finances spéciale, non prévue par les textes en vigueur, au nom d’un impératif supérieur : garantir la continuité de la vie nationale.
C’est ce précédent que le gouvernement invoque aujourd’hui, comme il l’avait déjà fait pour la loi de finances spéciale de 2024. Au regard des enjeux en présence (lever l’impôt et garantir le fonctionnement des services publics pour maintenir une vie nationale), le Conseil constitutionnel pourrait ne pas s’opposer au raisonnement du gouvernement en cas d’éventuelle saisine de l’opposition.
On notera que le précédent de 1979 était plus facilement transposable à la configuration de 2024 qu’à celle de 2025. En 2024, le renversement du gouvernement Barnier était une circonstance empêchant l’adoption du budget avant le 1er janvier.
En 2025, à la différence de 2024, il n’y a aucune circonstance exceptionnelle empêchant matériellement le Parlement de se prononcer sur le budget. La loi de finances spéciales 2025 était simplement justifiée par le probable rejet du projet de loi de finances. Le gouvernement adopte ainsi une lecture extensive du précédent jurisprudentiel de 1979 en affirmant dans l’exposé des motifs de la loi de finances spéciale 2025 qu’il lui appartient « de déposer un projet de loi spéciale lorsqu’il apparaît qu’une loi de finances ne pourra pas être promulguée avant le début du prochain exercice budgétaire »). Ce n’est pas ce que le Conseil constitutionnel a dit dans sa décision de 1979. D’un instrument exceptionnel, la loi de finances spéciale est transformée en pratique courante. Le gouvernement fragilise indiscutablement l’équilibre constitutionnel.
L’exclusion de l’ordonnance budgétaire : compromis politique et détournement de la Constitution
Cet équilibre est d’autant plus fragilisé que le gouvernement écarte une solution pourtant expressément prévue par la Constitution : le recours à l’ordonnance prévu à l’article 47 alinéa 3. Ce mécanisme, conçu dès 1958, permet au gouvernement de mettre en vigueur lui-même le projet de loi de finances si le Parlement ne s’est pas prononcé dans le délai de 70 jours. Cet outil s’inscrit pleinement dans la logique d’un parlementarisme rationalisé, qui garantit avant tout la continuité de l’action gouvernementale.
Certes, le recours à cette ordonnance est une faculté et non une obligation pour le gouvernement. En outre, la procédure est brutale à l’encontre d’un régime parlementaire dès lors qu’elle écarte le Parlement de l’adoption du budget. Pour autant, cette procédure a été prévue en 1958 précisément pour cela en présence d’un Parlement miné par des désaccords partisans. Si l’instabilité au Parlement était telle qu’elle entraînerait de manière certaine le rejet définitif de tout texte financier (y compris une loi de finances spéciale), l’ordonnance serait-elle toujours aussi décriée alors qu’elle serait le seul et unique moyen d’éviter un shutdown ?
En recourant à des lois de finances spéciales juridiquement fragiles et en écartant des ordonnances politiquement contestées mais juridiquement solides, le gouvernement fait primer le consensus politique sur l’autorité de la Constitution. Serait-ce la peur d’une crise politique en général ou celle plus particulière d’être renversé par l’Assemblée nationale en représailles d’un recours aux ordonnances ? On ne peut malheureusement exclure ces considérations opportunistes, qui contribuent à une défiance à l’égard de la vie publique.
Opportunisme ou pas, le débat sur la loi de finances spéciale ne se résume pas à une querelle de juristes. Il révèle une tension plus profonde entre les accommodements de la pratique des acteurs politiques et le respect de l’autorité de la Constitution.
Rappelons, de ce point de vue, que la Constitution est un tout. Elle garantit le respect des droits et libertés, mais encadre également le fonctionnement des pouvoirs publics et, par conséquent, les conditions d’adoption du budget. On ne peut appeler à la préservation, voire au renforcement, de l’autorité de la Constitution quand il s’agit de défendre l’État de droit face à des dérives autoritaires, et, en même temps, contourner la Constitution quand il s’agit d’adopter le budget. Derrière le vernis de la technique juridique se profile une conception alarmante que les gouvernants peuvent avoir de la Constitution.
Respecter le Parlement est une exigence démocratique. Mais affaiblir la Constitution au nom de cet objectif revient à fragiliser l’ensemble de l’édifice institutionnel. À vouloir trop éviter le choc politique, on pourrait provoquer une secousse constitutionnelle durable.
Jeremy Martinez ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
07.01.2026 à 17:58
François Mitterrand, impossible héros de la gauche ?
Texte intégral (2974 mots)
François Mitterrand disparaissait il y a trente ans, le 8 janvier 1996. Premier président de gauche sous la Vᵉ République (de 1981 à 1995), il reste omniprésent dans l’imaginaire français, comme en témoignent de nombreux films ou livres qui lui sont régulièrement consacrés. Malgré d’importantes réformes (abolition de la peine de mort, retraite à 60 ans, RMI…), son legs politique est complexe à assumer à gauche, le parcours de l’homme étant entaché de zones sombres (Vichy, le colonialisme) et d’un soupçon permanent d’insincérité ou de trahison des idéaux qui l’ont porté au pouvoir (rupture avec le capitalisme). Quels sont les apports récents de la recherche à ce sujet ?
En 2016, le centenaire de la naissance de François Mitterrand et les vingt ans de sa disparition avaient donné lieu à de nombreuses commémorations et publications. Dix ans plus tard, de nouvelles recherches ont revisité l’histoire mitterrandienne en s’appuyant notamment sur des sources inédites publiées, à l’image des Lettres à Anne et du Journal pour Anne (2016), ou déposées en archives. Outre sa place croissante dans la littérature scientifique, François Mitterrand s’est aussi installé dans le paysage fictionnel français, dans le Promeneur du Champ-de-Mars (2005), les Saveurs du palais (2012), l’Inconnu de la Grande Arche (2025), dans les séries Bardot (2023) et Tapie (2023), ou, actuellement dans Mitterrand confidentiel, diffusée sur France 2. À travers ces récits, auxquels s’ajoutent des témoignages comme le documentaire écrit par sa fille Mazarine, François Mitterrand, une autre vie possible (2025) , cette figure de la politique française du second vingtième siècle peuple toujours puissamment les imaginaires de nos contemporains. Si sa biographie est désormais bien connue, son héritage, sans cesse réinterrogé, demeure marqué par une forte charge polémique et émotionnelle qui fait obstacle à une héroïsation partisane.
En effet, dans le panthéon de la gauche socialiste, on compte Jean Jaurès (1859-1914), Léon Blum (1872-1950), et, de manière moins évidente, François Mitterrand. Jean Jaurès est célébré comme le grand pacifiste internationaliste, le socialiste républicain, le défenseur des ouvriers de Carmaux. Léon Blum, c’est le choix de l’exercice du pouvoir en démocratie, le Front populaire et ses conquêtes, le combat contre l’antisémitisme et contre Vichy. François Mitterrand est le socialiste qui a le plus longtemps exercé le pouvoir en France : quatorze ans à l’Elysée. Mais la complexité de son parcours l’empêche d’incarner le héros de gauche « idéal ». S’il a longtemps œuvré à contrôler le récit de son parcours, la fin de son dernier septennat et de sa vie est marquée par des révélations tant privées (sa maladie, sa fille cachée) que politiques – notamment la publication d’Une jeunesse française, par Pierre Péan, en 1994, qui révèle à beaucoup son passé durant la Seconde Guerre mondiale.
Trois dossiers principaux – la Seconde Guerre mondiale, la politique (néo)coloniale de la France en Afrique et le rapport au capitalisme – font, selon nous, obstacle à un rapport apaisé de la gauche à François Mitterrand.
Mitterrand et la Seconde Guerre mondiale
Le premier sujet problématique concerne les rôles que François Mitterrand joua durant la période vichyste : la photographie prise avec Pétain le 15 octobre 1942, sa décoration de la francisque en avril 1943, sa relation avec René Bousquet notamment agitent encore régulièrement la sphère éditoriale et médiatique, alors même que l’essentiel des faits est connu de longue date.

Né dans la bourgeoisie charentaise en 1916, François Mitterrand s’engage, étudiant, en politique dans la droite ultraconservatrice de la ligue des Croix-de-Feu du colonel de La Rocque. Mobilisé en 1940, fait prisonnier, il s’évade d’Allemagne, trouve un emploi par ses réseaux familiaux dans l’administration de Vichy, adhère à la Révolution nationale sans être antisémite. Puis il entre progressivement en résistance en 1943 par patriotisme anti-allemand et bascule totalement dans la Résistance en novembre 1943. À la Libération, il s’ancre progressivement et définitivement à gauche.
Beaucoup de ces éléments étaient connus de ses contemporains. L’historienne Noëlline Castagnez a montré que, dès les années 1950, les bancs de droite de l’Assemblée nationale bruissent de l’insulte « francisque Mitterrand » et que durant la campagne présidentielle de 1965, c’est de Gaulle lui-même qui choisit de ne pas se servir de cet élément pour ne pas affaiblir le mythe de la France résistante ou la Ve République. À côté des réécritures ou « recompositions » de Mitterrand lui-même, l’histoire des oublis et (re)découvertes de son passage par Vichy est donc aussi celle des arbitrages de ses alliés et adversaires.
Le choc de la publication d’Une jeunesse française, du journaliste Pierre Péan, en 1994, sera particulièrement fort pour les jeunes socialistes, percevant leur parti comme un rempart homogène contre l’extrême droite depuis les années 1930, élevés dans le mythe résistancialiste selon le terme d’Henry Rousso, et découvrant progressivement, comme l’opinion, l’existence de « vichysto-résistants ».
Ce passé mitterrandien est toujours entouré d’un halo sulfureux, car certains y voient le « péché originel » d’un homme dont le parcours militant est perçu comme insincère, structuré seulement par son ambition.
Mitterrand et le colonialisme
Le rôle de François Mitterrand dans la politique coloniale puis néocoloniale française est un deuxième obstacle mémoriel majeur à la pleine revendication de son héritage à gauche. Cet aspect de sa vie politique a, en effet, fait l’objet d’une percée historiographique et éditoriale dans les années 2024-2025 (avec les travaux d’Anne-Laure Ollivier et Frédéric Turpin, de Thomas Deltombe, de Pascal Blanchard et Nicolas Bancel). Si, à l’issue de ces travaux, de réelles nouveautés ont été mises en lumière, à l’image d’un récit de voyage en Afrique subsaharienne tenu par Mitterrand entre janvier et février 1950, et que nous avons édité, l’essentiel était connu pour qui s’intéressait à la question.
À lire aussi : François Mitterrand, à l’origine du déclin de l’influence postcoloniale de la France en Afrique ?
François Mitterrand avait notamment été ministre de la France d’outre-mer en 1950 et ministre de l’intérieur en 1954, c’est à ce titre qu’il déclare que « l’Algérie, c’est la France », formule alors plutôt consensuelle parmi les forces de gouvernement (et non slogan des ultras de l’Algérie française), puis garde des Sceaux en 1956-1957. Sa dureté à ce poste a notamment été mise en lumière par Benjamin Stora et François Malye en 2010.
L’actualité éditoriale mitterrandienne à ce sujet s’explique par la vivacité des questions mémorielles postcoloniales et par les avancées historiennes sur le rôle la France en Afrique, et notamment la remise en 2021 du rapport de la Commission Duclert sur « La France, le Rwanda et le génocide des Tutsi (1990-1994) ». Ministre colonial de 1950, leader d’un parti anticolonial en 1971, président du discours tiers-mondiste dit de Cancún en 1981 et chef d’État en responsabilité au moment du génocide des Tutsis en 1994 : le parcours de François Mitterrand peut être réduit par des militants déçus ou par des opposants à celui d’un homme fondamentalement de droite passé de colonial à néocolonial.
Les historiens, eux, tentent de contextualiser chacune de ces séquences et en soulignent les continuités de manière plus fine : en 1950, dans un monde politique où la décolonisation est une option très marginale, même à gauche, Mitterrand est un colonial réformiste et progressiste. Comme nous l’avons montré en 1971, il endosse assez peu le programme tiers-mondiste du PS, porté par des experts issus de la gauche chrétienne qui n’ont jamais totalement eu son attention. Ses grilles de lecture et alliances forgées à l’époque coloniale perdurent alors discrètement, sans que ce soit un sujet pour la majorité de l'électorat de gauche : le rapport des candidats au passé colonial français ne fut pas un enjeu de la campagne présidentielle de 1981.
Mitterrand et le capitalisme
Un troisième dossier nourrit négativement son bilan et alimente à gauche son procès en traîtrise : c’est celui de l’absence de rupture avec le capitalisme. C’est en effet sur cette idée forte, centrale dans la doctrine socialiste, qu’il conquiert la tête du PS, proclamant à la tribune du congrès d’Épinay en 1971 : « Celui qui n’accepte pas la rupture […] avec la société capitaliste, celui-là, je le dis, il ne peut pas être adhérent du Parti socialiste. »
Or à cette promesse, qui contribue à l’union de la gauche (1972-1977) et porte l’espoir et le vote de beaucoup à gauche en mai 1981, répond l’annonce très dramatisée du « tournant de la rigueur », le 21 mars 1983. À cette date, le franc est dévalué pour la troisième fois par les socialistes et maintenu dans le système monétaire européen (SME). Ce choix mitterrandien est vécu par certains comme celui de la raison et de l’Europe. Pour d’autres, il signe, par-delà le refus d’une « autre politique » monétaire, la fin du volontarisme social et économique socialiste, le triomphe « des marchés » et celui de l’Europe libérale. L’adoption du traité de Maastricht par référendum à une courte majorité, en septembre 1992, en dépit du fort engagement personnel de François Mitterrand, confirme cette prééminence européenne et libérale du cap présidentiel pour les déçus de 1983. Si la réalité économique et la chronologie de ce « tournant » ont été relativisées par les historiens, à l’instar de Frédéric Bozo qui dans un ouvrage récent revient sur cette « névrose nationale », ce moment reste particulièrement douloureux dans l’histoire de la gauche.
Si le bilan mitterrandien existe, par-delà 1983, (on songe par exemple à la création du revenu minimum d’insertion en 1988), le traumatisme ressenti à l’annonce du « tournant » introduit de fait une fracture qui sépare, d’une part, les grandes mesures de 1981-1982 (on citera pêle-mêle l’abolition de la peine de mort, les nationalisations, la 5ᵉ semaine de congés payés, la semaine de 39 heures, la décentralisation, la retraite à 60 ans, la réforme de l’audiovisuel, les lois Auroux) et, d’autre part, la rigueur, les cohabitations et un second septennat plus marquant sur le plan diplomatique qu’intérieur. À un temps « socialiste » s’opposerait ainsi un temps plus « gaullo-mitterrandiste », qui l’éloigne de la filiation de Jaurès et de Blum.
Le troisième président préféré des Français
En 2026, la peur du retour au pouvoir de l’extrême droite, la polarisation par celle-ci du débat public sur les questions postcoloniales, migratoires et identitaires, l’aggravation continue des crises économiques, politiques, européennes sont des enjeux face auxquels l’héritage mitterrandien ne semble pas le plus univoque et efficace pour la gauche et les socialistes contemporains. La dynamique d’« union de la gauche » qui a porté Mitterrand au pouvoir, au détriment de ses partenaires, n’offre pas non plus de modèle réactivable, au contraire du plus lointain et aussi plus fantasmé « front populaire ».
En 2021, un sondage Ifop classait François Mitterrand troisième président de la République préféré des Français. En tête du classement, de Gaulle, héros national et seul président à avoir fondé une famille politique se revendiquant de manière pérenne de son héritage. En second, le gaulliste Jacques Chirac, qu’une vague de nostalgie avait érigé dès les années 2010 en icône « swag » (stylé, cool), et dont la disparition en 2019 avait suscité une forte émotion. François Mitterrand arrivait cependant largement en tête parmi les sympathisants de gauche.
À l’image de la panthéonisation en 2025 de Robert Badinter, son ami et ministre, qui consacre une part de l’héritage socialiste et humaniste de 1981, on peut ainsi supposer que la mémoire militante, comme la mémoire nationale, continuera à exercer sur le bilan mitterrandien ce « droit d’inventaire » – revendiqué par Lionel Jospin dès 1995 et par François Hollande en 2009 – en sélectionnant ce qui peut, aujourd’hui encore, être rassembleur.
Judith Bonnin est l’autrice, avec Pierre-Emmanuel Guigo, de Mitterrand, à paraître le 13 janvier 2026 aux PUF_.
Judith Bonnin est experte pour la Fondation Jean-Jaurès, qui a financé la publication de sa thèse. Elle est membre du conseil scientifique de l'Institut François Mitterrand.
06.01.2026 à 16:54
Pourquoi les femmes font-elles moins de vélo que les hommes ?
Texte intégral (2350 mots)

En France, comme dans la grande majorité des pays du globe, les femmes pédalent moins que les hommes. Comment l’expliquer ?
Selon une enquête de 2023, en France, 11 % des femmes adultes affirment ne pas savoir faire du vélo et 38 % déclarent une faible maîtrise, contre respectivement 5 % et 23 % des hommes. Elles ne sont que 25 % à en faire au moins une fois par semaine, contre 38 % des hommes. Et la tendance s’observe pour les principales formes d’usage.
De plus, les cyclistes hommes parcourent en moyenne des distances plus importantes. Malgré une féminisation progressive, les femmes ne représentent que 12,8 % des licencié·es de la fédération française de cyclisme et seulement 7 % des pratiquant·es en compétition. Plus clivée encore, l’activité professionnelle de livraison à vélo ne compte quasiment que des hommes.
Le recours au vélo à assistance électrique (VAE) est davantage paritaire (47 % de femmes). Toutefois l’accès à cette technologie est très inégalitaire entre les femmes. Les moins dotées en termes de revenu sont peu enclines à en bénéficier.
Par ailleurs, les femmes sont plus susceptibles de ne posséder aucun vélo ou d’utiliser un modèle d’entrée de gamme. Comme c’est le cas des groupes sociaux les plus pauvres, elles se déplacent davantage à pied et en transport en commun (TC). Les parts des différents modes de déplacement–marche, TC et vélo – sont respectivement de 25,8 %, 14 % et 1,5 % pour les femmes, contre 21,5 %, 11,2 % et 4 % pour les hommes.
Des socialisations corporelles, sportives et spatiales très genrées
Ces constats s’expliquent notamment par le fait que le vélo est une activité d’extérieur qui (en France) reste fortement associée à un sport masculin nécessitant des efforts intenses, à un mode de déplacement individuel dangereux, au tourisme, à l’aventure ainsi qu’à un objet mécanique autoréparable.
Or, à travers leur socialisation (ensemble des processus par lesquels la société façonne les individus), les femmes sont généralement moins incitées à investir l’espace public, à se déplacer seules, à s’aventurer, à s’adonner à des activités mécaniques, à fournir des efforts physiques intenses (d’autant plus en compétition) et à prendre des risques corporels.
Ce processus est particulièrement prégnant durant l’adolescence, période marquée par un durcissement des assignations de genre (injonctions à devenir une fille féminine ou un garçon masculin). Ce constat est d’autant plus préoccupant que la pratique du vélo pendant l’adolescence conditionne fortement la probabilité d’en refaire plus tard.
« En 4e, c’est là qu’elle s’est sentie plus, enfin, qu’elle est devenue une femme, une jeune femme quoi, enfin elle a eu ses trucs […] Et elle s’est sentie grande quoi ! Maquillage, tout ça, et c’est vrai que là, le vélo, elle en a plus trop fait, mais ses copines en faisaient plus de toute façon », Véronique, 42 ans, éducatrice petite enfance.
À l’âge adulte, les femmes sont davantage amenées à effectuer des chaînes de déplacement complexes (succession de trajets correspondant à différents motifs : travail, école, médecin, courses, etc.) découlant de leurs plus grandes responsabilités domestiques (notamment le transport d’enfants, de personnes âgées ou malades). Au même titre que les problèmes de santé ainsi que les changements de lieu de résidence ou d’emploi, l’arrivée d’enfant(s) les conduit plus souvent à arrêter le vélo que ce n’est le cas pour les hommes.
Leur usage du vélo est également plus souvent freiné par la peur de l’accident, la vitesse et le volume du trafic, les montées et longues distances, un manque de confiance en leurs capacités physiques, et la crainte de problèmes mécaniques. Elles sont aussi plus susceptibles de réduire ou d’abandonner leur pratique du vélo à la suite d’un accident ou d’une chute.
Des inégalités entre les femmes elles-mêmes
Par ailleurs, moins compétentes pour réparer leur vélo, moins en mesure de recourir à un ou une professionnel·le (en raison de moindres ressources économiques) et moins souvent équipées d’un vélo de remplacement, elles sont plus exposées à un abandon de pratique en cas d’avarie.
Ces freins concernent moins les femmes des classes dominantes vivant en milieu urbain dense, où les dimensions écologique, sanitaire et pratique du vélo sont particulièrement valorisées, et où les aménagements sont plus sécurisés, continus, directs, connectés et lisibles.
À l’inverse, les femmes de milieu populaire – notamment lorsqu’elles sont issues de cultures non occidentales dans lesquelles l’usage du vélo est l’apanage des hommes – sont fortement susceptibles de ne jamais avoir appris à faire du vélo ou d’avoir arrêté avant l’âge adulte. Elles sont davantage concernées par les tâches domestiques ainsi que par un manque de ressources financières, de modèles d’identification, de connaissances des bienfaits du vélo, et d’accès au réseau cyclable.
L’influence déterminante de l’environnement familial et des pairs
La dimension genrée des socialisations cyclistes repose sur toutes les instances et agents de socialisation, à commencer par l’environnement familial et ce, dès le plus jeune âge. Les filles sont moins incitées à sortir, à explorer, à se dépenser et à prendre des risques que les garçons. En particulier au moment de la puberté, elles se font plus souvent accompagner ou interdire de pratiquer. Elles sont davantage retenues dans la sphère domestique et dissuadées de se déplacer seules.
Cela est moins marqué dans les milieux fortement dotés en capital culturel, où les femmes sont généralement plus enclines à s’approprier le vélo comme un outil libérateur du sentiment de vulnérabilité dans l’espace public (parce que permettant d’aller plus vite qu’à pied et de ne pas se sentir confinées). Mais cette forme d’appropriation peut favoriser un sentiment de dépendance au vélo (perçu comme plus rassurant que la marche et les transports en commun) limitant en définitive leurs alternatives. Parce que les sociabilités demeurent très homosexuées (entre personnes du même sexe), l’influence des pairs tend aussi à favoriser la reproduction des inégalités de genre, notamment dans le cadre de pratiques sportives.
Le rôle majeur des institutions sportives et médiatiques
Le monde du sport de compétition joue également un rôle important dans la sexuation des socialisations cyclistes. La recherche en physiologie de l’exercice montre qu’en raison d’une meilleure résistance à la fatigue et d’une meilleure utilisation des graisses comme énergie, les femmes disposent d’avantages non négligeables pour les épreuves sportives d’ultra-endurance extrêmes (supérieures à 6 heures de course).
Pourtant, la non-confrontation directe entre femme(s) et homme(s) reste la norme des courses de cyclisme sur route les plus médiatisées, dont les distances règlementaires sont environ deux fois inférieures pour les femmes. Les institutions et les médias naturalisent ainsi une supposée incapacité des femmes à rivaliser avec les hommes, érigeant pour les filles des modèles infériorisés.
Les injonctions genrées véhiculées par les objets
L’influence des vélos n’est pas à négliger. Dès le plus jeune âge, ils constituent des supports de socialisation genrée. Ceux adressés aux filles sont davantage équipés d’éléments renvoyant aux tâches domestiques et à la fonction maternelle (béquille, panier, siège poupon, etc.). D’autres objets favorisent le clivage. Nombreuses sont les femmes qui évitent le vélo afin de préserver leur maquillage ou leur tenue féminine (robe, jupe, talons).
D’autres freins tiennent au port de vêtements religieux (hijab, niqab, etc.), à l’usage de protections hygiéniques ou encore à la croyance que la selle pourrait compromettre la virginité (en particulier chez les moins dotées en capital culturel).
Les inégalités d’accès à l’espace public
Si le vélo est essentiellement étudié, conçu, vendu, pratiqué, promu, enseigné et réparé par des hommes, il est aussi pratiqué dans des espaces notamment façonnés et occupés par des hommes. Or, comme la cour d’école, qui constitue un support clé des socialisations spatiales genrées durant l’enfance, l’espace public n’est pas neutre.
Quel que soit leur mode de déplacement, les femmes sont davantage confrontées au harcèlement et aux agressions sexuelles de rue. Les stratégies qu’elles adoptent (se vêtir d’une tenue moins « féminine », se faire accompagner, feindre d’être accompagnée, faire des détours, éviter certains horaires, se munir d’une arme, renoncer, etc.) augmentent leur charge mentale, limitent leurs opportunités et conduisent parfois à l’abandon définitif du vélo.
Le vélo n’est pas forcément libérateur
Soulignons enfin que l’adoption du vélo (de même que le recours à des outils ménagers ou à la voiture) n’est pas forcément libératrice pour les femmes. Lorsqu’il permet d’aller plus vite (notamment en milieu dense), le vélo devient souvent un outil d’optimisation du temps. Ainsi, il peut contribuer à intensifier le travail domestique des femmes. C’est le cas lorsque, au lieu d’être réinvesti en loisir, le temps gagné est consacré à de nouvelles tâches.
Ainsi, il ne suffit pas d’inciter les femmes à faire du vélo pour tendre vers plus d’égalité. Une politique vélo qui poursuivrait cet objectif devrait tenter d’agir conjointement sur l’ensemble des instances et agents de socialisation (famille, pairs, institutions, médias, rue, objets, religion, etc.). C’est l’ensemble de nos structures sociales qu’il faudrait repenser.
David Sayagh est l’auteur de Sociologie du vélo, aux éditions La Découverte, 2025.
David Sayagh ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
05.01.2026 à 17:48
Comment les États autoritaires orientent les débats pour saper nos démocraties
Texte intégral (1429 mots)
Au-delà des « fake news » les États autoritaires utilisent une stratégie subtile pour discréditer les démocraties en manipulant l’information et les débats. Les réseaux sociaux et les médias en ligne sont utilisés pour exagérer les difficultés de nos régimes, pour nourrir la colère et pour imposer un récit alternatif.
Lorsque nous parlons de désinformation – la diffusion intentionnelle d’informations trompeuses – nous imaginons généralement des mensonges flagrants et des fake news propagés par des gouvernements étrangers. Parfois, l’objectif est d’influencer les électeurs lors d’élections, parfois de semer la confusion en période de crise.
Mais il s’agit là d’une vision grossière de la réalité. En fait, des pays autoritaires, tels que la Russie et, de plus en plus, la Chine, sont engagés dans des projets plus ambitieux visant à déformer la réalité politique. Ces pays cherchent à saper l’image des démocraties occidentales, tout en se présentant – eux-mêmes et leurs partenaires autoritaires – comme des modèles à suivre.
La construction de cette réalité politique inclut l’usage de mensonges flagrants, mais le récit repose le plus souvent sur une manipulation de l’information bien plus insidieuse. Les faits positifs sont mis en avant de manière disproportionnée, tandis que ceux qui dérangent sont ignorés ou sortis de leur contexte, afin qu’ils paraissent davantage conformes aux objectifs du narrateur.
Le Kremlin utilise depuis longtemps des médias financés par l’État, des médias relais ou des bots pour diffuser un flux constant de récits – articles de presse, tweets, vidéos ou publications sur les réseaux sociaux – conçus pour attiser les clivages politiques dans les sociétés démocratiques. Des rapports montrent que ces récits peuvent atteindre des publics bien au-delà de leurs plates-formes russes d’origine. Ils sont répétés, sans le savoir (ou parfois en toute connaissance de cause), par des médias locaux ou nationaux, des commentateurs ou des internautes.
Un motif récurrent consiste à présenter les sociétés démocratiques sous le jour le plus obscur possible. Il s’agit d’exagérer la criminalité, la corruption et le désordre social, de mettre en avant des protestations publiques, la stagnation économique ou l’instabilité gouvernementale. Le message sous-jacent est que la démocratie ne fonctionne pas et mène au chaos.
Certains récits visent à discréditer les valeurs progressistes des sociétés occidentales. Elles tournent en dérision les évolutions sociales progressistes comme les droits des personnes LGBTQIA+ ou le multiculturalisme, en les présentant comme absurdes ou ridicules.
D’autres s’appuient sur des problématiques bien réelles, mais les cadrent de manière à amplifier les sentiments de discrimination et de victimisation. Dans les États baltes, par exemple, les médias russes mettent fréquemment en avant les persécutions supposées des russophones, en suggérant qu’ils sont traités comme des citoyens de seconde zone, tout en ignorant d’autres points de vue.
Si l’on observe la « manosphère » en ligne – en pleine expansion – ce mécanisme est bien à l’œuvre, avec des messages qui renforcent un sentiment collectif de victimisation des hommes, et qui visent à alimenter les tensions et la défiance.
Une alternative autoritaire
Ces types de récits, qui présentent les sociétés occidentales comme dysfonctionnelles, sont utilisés depuis longtemps par le Kremlin pour nuire à l’image de la démocratie. Cependant, on observe de plus en plus la collaboration de la Russie et de la Chine dans l’espace médiatique mondial en ligne afin de présenter conjointement le monde autoritaire comme une alternative stable fondée sur des principes solides.
Ainsi, la Russie comme la Chine critiquent « l’ordre international » fondé sur des règles libérales et des normes politiques qui a émergé après la Seconde Guerre mondiale. Elles considèrent cet ordre comme occidentalocentré et souhaitent remodeler l’ordre mondial à leur avantage.
La coopération militaire et économique fait partie de leurs efforts pour remettre en cause cet ordre, mais les médias et les espaces numériques jouent également un rôle important. Les deux États, par exemple, diffusent fréquemment des récits qui présentent les pays occidentaux comme des puissances néocoloniales.
Un autre thème récurrent est celui de démocraties dépeintes comme des acteurs hypocrites, prêchant l’égalité et l’équité sans les mettre en pratique. Les récits évoquant le manque d’unité au sein des alliances occidentales telles que l’OTAN ou l’Union européenne (UE) sont également constants dans les narrations russes et chinoises. À l’inverse, la Russie et la Chine sont présentées comme des pays rationnels et raisonnables, cherchant à protéger d’autres nations, plus vulnérables, de l’exploitation occidentale.
Pourquoi ces récits sont-ils efficaces ?
Ces récits semblent trouver un écho particulier auprès des publics des pays en développement. Cela s’explique souvent par le fait qu’ils contiennent un noyau de vérité. Les narrateurs de ces récits peuvent s’appuyer sur des problèmes réels, tels que les inégalités, les erreurs de politique étrangère ou les doubles standards. Incontestablement, de nombreux pays occidentaux sont confrontés à des tensions liées au coût de la vie et la politique étrangère n’est pas toujours cohérente. Les souvenirs du passé colonial rendent les accusations de néocolonialisme crédibles.
C’est souvent la manière dont une histoire est racontée qui induit en erreur. Des détails sont omis ou sortis de leur contexte. Des informations spéculatives sont présentées comme des faits. Il s’agit de créer une version déformée de la vérité.
Les récits sont souvent façonnés pour déclencher colère, choc, peur ou ressentiment. Par exemple, dans le contexte de la guerre en Ukraine, la désinformation peut suggérer que nos gouvernements nous trahissent en s’impliquant dans des guerres étrangères, ou que les citoyens ordinaires paient le prix des ambitions d’une élite corrompue.
Ces récits sont nourris de sensationnalisme, faisant l’impasse sur la nuance au profit de l’impact émotionnel. Cela assure leur amplification sur les réseaux sociaux.
La vérité peut être complexe et, parfois, ennuyeuse. En exploitant notre attirance pour le sensationnel, la Russie et la Chine peuvent progressivement distiller une image où la démocratie est dépeinte comme inefficace et chaotique, et où elles-mêmes incarnent une perspective d’avenir plus juste et plus fonctionnelle.
Finalement, la désinformation contemporaine relève moins du mensonge pur et simple que d’une construction subtile de vision du monde. Avec le temps, cette transformation silencieuse peut aller bien au-delà de l’impact d’une simple fake news, et nous amener à douter de la démocratie elle-même.
Aiden Hoyle ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
04.01.2026 à 17:25
Pourquoi les politiques n’écoutent-ils pas les citoyens ordinaires ?
Texte intégral (2011 mots)
L'année 2025 a notamment été marquée par le débat sur la taxe Zucman, rejetée par les députés mais plébiscitée par une très large majorité de Français. Cette décision révèle, de façon spectaculaire, la déconnexion entre les décisions politiques et l’opinion des citoyens. Ce phénomène, étudié par la science politique, est au cœur de la crise démocratique. Comment y remédier ?
Les sondages sont sans appel : une large majorité de Français, 86 % selon une enquête Ifop, se déclare en faveur d’une taxation des plus riches. Pourtant, l’Assemblée nationale a rejeté en octobre la taxe Zucman : 228 députés ont voté contre l’amendement visant à taxer les patrimoines supérieurs à 100 millions d’euros, tandis que 172 députés ont voté pour. La déconnexion entre opinion publique et décision politique n’est pas nouvelle. D’autres exemples illustrent ce phénomène, comme la réforme des retraites, rejetée par une majorité de Français, ou l’interdiction de la corrida, soutenue par la population mais rejetée par les députés. Comment expliquer que des mesures massivement soutenue par la population puissent être rejetées par leurs représentants ?
Quand les politiques écoutent (ou pas) l’opinion publique
La connexion entre opinion publique et décision politique a fait l’objet de nombreux travaux en science politique. Ces recherches, qui étudient la capacité du système représentatif à répondre aux intérêts et préférences des citoyens, montrent que si l’opinion publique peut influencer les décisions politiques, ce n’est pas toujours le cas. Pour de nombreux enjeux, il existe une déconnexion entre la volonté populaire et les décisions prises par les gouvernants, qu’ils soient de gauche ou de droite.
Plusieurs facteurs peuvent expliquer ces écarts. D’abord, la capacité des gouvernants à suivre l’opinion peut dépendre du contexte économique : en période de contraintes budgétaires, les marges de manœuvre se réduisent et certaines décisions peuvent ne pas refléter totalement les préférences des citoyens. Ensuite, les représentants sont plus à l’écoute sur les sujets très médiatisés et peu techniques du fait de leur importance dans le débat public. Plusieurs recherches soulignent aussi un déficit récent de représentation sur les enjeux économiques. Du fait de la montée des sujets culturels (immigration, sécurité, identité) dans le débat et des contraintes externes sur l’économie (crises, intégration européenne), les gouvernants parviennent à mieux écouter l’opinion sur les sujets culturels, devenus des marqueurs de la vie politique. Enfin, le contexte politique : dans un environnement parlementaire fragmenté, les difficultés à négocier entre partis peuvent entraver la traduction de l’opinion publique en décisions.
Représentation politique et inégalités économiques
Un autre facteur expliquant la déconnexion entre opinion publique et décision politique est celui des inégalités de représentation. En effet, lorsque les citoyens les plus riches et les plus pauvres s’opposent sur une politique publique, ce sont les préférences des plus aisés qui l’emportent. Les travaux du politiste américain Martin Gilens ont révélé cette tendance : une politique publique a plus de chances d’être adoptée si elle est soutenue par les citoyens fortunés que par les citoyens modestes. Ces résultats ont été confirmées dans plusieurs pays européens : les décisions politiques reflètent davantage les positions des citoyens à revenu élevé.
L’exemple de la taxe Zucman illustre parfaitement cette dynamique. Si une majorité de Français la soutient, il est probable que la fraction de la population la plus fortunée, directement impactés financièrement par une telle taxe, s’y oppose.
À lire aussi : L’affrontement sur la taxe Zucman : une lutte de classe ?
Si de nombreuses études ont mesuré ces inégalités dans les décisions politiques, d’autres se sont particulièrement intéressé aux élus, analysant leurs positions et la façon dont ils perçoivent l’opinion publique. Des inégalités sont aussi présentes à ce niveau. En effet, les élus ont des préférences politiques plus proches de celles des électeurs les plus riches, et leur lecture de l’opinion publique est biaisée en faveur des plus fortunés.
Les déterminants des inégalités de représentation politique
Trois facteurs principaux expliquent ces inégalités de représentation. Le premier est le profil socio-économique des élus : ils sont massivement issus des classes sociales supérieures. À l’Assemblée nationale, 67 % des députés sont issues des catégories cadres et professions intellectuelles supérieures, contre 11 % dans la population française. Ces élus partagent avec les citoyens les plus riches des valeurs et intérêts communs, ce qui les rend plus sensibles à leurs besoins. C’est ce que j’ai montré dans une étude menée sur les parlementaires suisses : les perceptions de l’opinion publique des députés issus de milieux favorisés s’alignent plus fortement avec les préférences des citoyens les plus riches.
Le deuxième facteur concerne les inégalités d’expression politique : tous les citoyens n’ont pas la même voix dans l’espace politique. Les plus aisés disposent d’un poids politique supérieur : ils votent davantage, contactent plus souvent les parlementaires, et peuvent apporter un soutien direct en faisant des dons aux partis politiques. À l’inverse, les citoyens modestes participent moins à la vie politique et ont moins de poids sur le succès électoral des partis politiques. Les élus ont donc moins d’intérêt à écouter et traduire leurs préférences en décisions.
Ces inégalités se reflètent aussi au niveau des groupes d’intérêts exerçant des activités de lobbying : les groupes représentant des intérêts privés et sectoriels (entreprises, associations professionnelles) disposent de plus de ressources que les associations citoyennes ou les ONG pour influencer les décisions politiques. Concernant la taxe Zucman, il est évident que les lobbies patronaux (Medef et Afep) ont mobilisé leurs réseaux pour orienter le débat public et la décision parlementaire. Les liens personnels entre responsables politiques (dont le premier ministre Sébastien Lecornu) et grands patrons, facilitent aussi cette influence, offrant à ces derniers un accès direct pour défendre leurs intérêts.
Enfin, l’idéologie compte : les élus de droite représentent davantage les préférences des citoyens les plus riches et surestiment leur poids dans la population, comme je l’ai montré dans une étude portant sur les parlementaires de quatre pays européens. Cependant, si les élus de gauche ont des positions moins biaisées, des inégalités persistent. Pourquoi ? D’abord parce que l’origine sociale joue à gauche comme à droite : la majorité des parlementaires de gauche viennent aussi des catégories supérieures, ce qui les rend plus sensibles aux intérêts des citoyens privilégiés. Ensuite, même lorsqu’ils sont idéologiquement proches des citoyens défavorisés, les élus de gauche au pouvoir se heurtent à des contraintes structures (mondialisation, règles européennes) qui réduisent leur marge de manœuvre.
Inégalités de représentation : comment répondre au problème ?
Si le droit de vote est universel, garantissant une égalité formelle, l’égalité réelle est loin d’être acquise : les citoyens les moins favorisés pèsent moins dans les décisions politiques, questionnant le caractère démocratique de notre modèle de représentation.
Les citoyens les moins bien représentés font moins confiance aux institutions représentatives. Le problème n’est pas qu’une politique publique isolée diverge de l’opinion publique : c’est la récurrence du phénomène qui pose question et le biais systématique envers une partie de la population qui pose question. Lorsque, sur plusieurs politiques publiques, le système représentatif n’est pas sensible à l’opinion et qu’une partie de l’électorat voit systématiquement ses préférences ignorées, la légitimité du système représentatif pourrait s’en trouver fragilisée.
Plusieurs pistes sont envisageables pour réduire ces inégalités. D’abord, améliorer la représentativité sociale des élus permettrait d’élargir la diversité des perspectives discutées au Parlement, mieux prendre en compte les citoyens les moins privilégiés, et permettre à ces derniers de mieux s’identifier avec le personnel politique. Ensuite, multiplier les échanges entre parlementaires et citoyens, via la présence en circonscription et les forums délibératifs, faciliterait la transmission de la diversité des opinions vers le système politique. Renforcer les organisations de la société civile et syndicats permettrait aussi de contrebalancer le poids des groupes d’intérêts privés. Enfin, des réformes comme le vote obligatoire ou l’encadrement des dons politiques inciterait les élus à considérer tous les citoyens, et pas seulement les plus privilégiés.
Awenig Marié est fondateur et membre de l'association Datan.
03.01.2026 à 12:03
En France, presque tout le monde est fonctionnaire sans le savoir
Texte intégral (2760 mots)

Une grande partie des activités économiques dépendent de financements publics en France. La frontière entre public et privé s’efface. 25 et 30 millions de personnes ont un revenu qui dépend directement de l’État. Alors, les Français et Françaises seraient-ils tous fonctionnaires ?
On continue volontiers d’opposer les fonctionnaires, censés vivre de l’impôt, et les salariés du privé, qui relèveraient de l’économie réelle.
Pourtant, si l’on parle non plus des statuts, mais des flux d’argent public, le paysage change nettement. Une proportion importante des revenus considérés comme privés dépend en réalité de décisions publiques : remboursements d’assurance maladie, aides agricoles, marchés publics, subventions culturelles, crédits d’impôt, garanties accordées au secteur financier, contrats financés par l’État ou par les collectivités.
Selon les données de l’INSEE, 30,9 millions d’actifs travaillent pour le privé.
La fonction publique, au sens strict, rassemble environ 5,8 millions d’agents en 2023, soit près d’un emploi sur cinq. Si l’on ajoute les salariés du monde associatif, les professions libérales de santé, certains salariés du bâtiment et des travaux publics (BTP), les agriculteurs financés par la Politique agricole commune (PAC), les secteurs régulés comme l’énergie ou encore les services financiers adossés à la dette publique, on arrive rapidement à plusieurs dizaines de millions de personnes dont les revenus dépendent, directement ou plus indirectement, de financements publics.
L’objectif ici n’est pas d’être exhaustif. Presque tous les secteurs, à des degrés divers, s’appuient sur des mécanismes publics. Mais certains offrent des exemples particulièrement documentés. Cet article se concentre sur quelques cas emblématiques.
Secteurs dépendants de l’État
Il est utile de visualiser l’ensemble du paysage économique français à travers un tableau synthétique. Celui-ci montre comment se répartissent, secteur par secteur, les personnes vivant (directement ou indirectement) de fonds publics – et celles dont l’activité relève réellement d’un marché privé pur.
Nous avons utilisé les données de l’Insee – Fonction publique et emploi, l’Insee – Population active, l’INJEP – Emploi associatif, du ministère de la Culture – Chiffres clés culture, de la direction de l’Animation de la recherche, des Études et des Statistiques (DARES) – Chômage indemnisé, de France Travail, du ministère de l’Économie – Commande publique, MSA, du ministère de l’Agriculture et de la PAC, de la Fédération bancaire française, de France Assureurs, de l’UNÉDIC – Assurance chômage, de la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES) – Retraites et France Digitale.
Le tableau ci-dessus n’inclut pas les 6 à 7 millions d’adultes inactifs non répertoriés dans ces catégories (personnes vivant du revenu du ménage, du patrimoine, ou en inactivité hors dispositifs sociaux). Cela explique l’écart avec la population adulte totale.
L’État structure le marché privé
L’idée d’un secteur autonome, évoluant hors de l’État, ne résiste pas longtemps à l’analyse. Dans de nombreux métiers, les revenus dépendent de tarifs publics, de mécanismes de remboursement, de subventions, de régulations ou encore de commandes publiques.
Plusieurs travaux d’économie publique de Mariana Mazzucato, de Michel Aglietta ou encore de Pierre-Noël Giraud ont montré combien les États structurent les marchés, souvent davantage qu’on ne le reconnaît dans le débat public.
Cette question de l’imbrication entre décisions publiques et activités privées traverse également mes propres travaux sur la figure de l’entrepreneur, qu’il s’agisse d’analyser comment les politiques publiques structurent les comportements de marché ou d’examiner l’effet des cadres réglementaires sur l’allocation des ressources.
L’État, premier client du pays
Une façon d’être dépendant de l’État, c’est tout simplement la commande publique. Autrement dit, tous les contrats payés par l’État, les mairies, les départements, les hôpitaux, les boîtes publiques comme la SNCF ou la RATP, et même par l’Union européenne.
Selon les données officielles du ministère de l’Économie, ces marchés pèsent presque 8 % du PIB. Ce poids est significatif à l’échelle de l’économie nationale. Concrètement, les marchés publics pèsent 80 milliards d’euros par an, les concessions, comme celle des autoroutes, représentent 120 milliards d’euros par an.
Historiquement, cette dépendance s’explique par le rôle central de l’État, depuis les années 1960, dans le financement et la planification des grands équipements collectifs comme les autoroutes, les chemins de fer, les hôpitaux ou les infrastructures énergétiques.
Ces projets nécessitent des investissements lourds et peu compatibles avec un financement purement privé. Dans les travaux publics, la dépendance à la commande publique est bien documentée. Selon la Fédération nationale des Travaux publics, les maîtres d’ouvrage privés ne représentent qu’un peu plus de 14 milliards d’euros, soit environ un tiers du chiffre d’affaires du secteur. Le reste provenant principalement de clients publics.
Les professionnels de santé, prestataires de service public
Plusieurs professions libérales exercent dans des cadres où l’État intervient fortement : tarifs, remboursements, implantation… Le cœur de leur activité est façonné par des décisions publiques. Ces professionnels sont prestataires d’un service public puisqu’ils fournissent une mission reconnue comme d’intérêt général, financée et régulée par l’État.
C’est particulièrement visible dans le domaine de la santé. Les médecins, infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes ou pharmaciens, tirent l’essentiel de leurs revenus de l’assurance maladie obligatoire. Les tarifs sont fixés ou négociés au niveau national et les revalorisations dépendent de décisions gouvernementales.
Certaines rémunérations supplémentaires sont liées à des objectifs de santé publique. Par exemple, le dispositif Rémunération sur objectifs de santé publique (ROSP) valorise la prévention, le suivi des pathologies chroniques ou la vaccination.
La justice, une mission de service public
Les acteurs de justice, comme les notaires, les huissiers, les avocats ou les greffiers, travaillent eux aussi dans un cadre largement défini par la puissance publique.
Les tarifs qu’ils appliquent sont fixés par arrêté ministériel. Par exemple, l’acte authentique des notaires leur donne un monopole prévu par la loi. L’installation n’est pas totalement libre non plus. L’État encadre l’ouverture des offices, après l’avis de l’Autorité de la concurrence, ce qui crée une forme de numerus clausus sans le nommer.
À lire aussi : Quand le cynisme mine l’engagement dans la fonction publique…
Ces professions libérales exercent une mission de service public régulé, plutôt qu’un métier purement concurrentiel.
La start-up nation n’existe pas sans l’État
Même les start-up, qu’on présente souvent comme très indépendantes, bénéficient de nombreux dispositifs publics. Le crédit d’impôt recherche (CIR) réduit le coût des dépenses de recherche et développement (R&D). Il constitue l’un des leviers fiscaux les plus utilisés par les jeunes entreprises technologiques.
De son côté, Bpifrance intervient sous plusieurs formes, comme les garanties de prêts, les co-financements ou les avances remboursables. Elles permettent aux entreprises de lever des fonds ou d’amorcer leur activité dans des conditions qu’elles n’auraient pas obtenues seules.
Les programmes comme France 2030 ou les appels à projets sectoriels complètent cet ensemble, en orientant des financements vers des secteurs jugés stratégiques : petits réacteurs modulaires (SMR), hydrogène vert, véhicules électriques, etc.
Ces soutiens jouent un rôle stabilisateur évident.
Les exploitations agricoles subventionnées
Dans beaucoup d’exploitations agricoles, les aides publiques, qu’elles viennent de la politique agricole commune (PAC) ou de dispositifs nationaux, pèsent lourd dans l’équilibre économique. Les chiffres de l’Insee l’attestent : en 2021, les subventions d’exploitation représentaient en moyenne 38 % de l’excédent brut d’exploitation des fermes qui en bénéficient.
De 2010 à 2022, les aides directes ont couvert jusqu’à 74 % du revenu moyen des exploitations, toutes spécialités confondues.
Certaines filières, comme les grandes cultures ou l’élevage bovin, sont encore plus sensibles à ces soutiens. Sans cet argent, elles seraient dans une situation économique très fragile, comme le confirment plusieurs analyses de l’Insee. L’agriculture française avance donc, selon les années et les filières, quelque part entre marché et subvention, avec des équilibres qui ne reposent jamais entièrement sur les prix de vente.
La culture cofinancée par la puissance publique
D’après le ministère de la Culture, on parle d’environ 739 800 emplois dans le secteur. Une bonne partie de ces emplois existe grâce aux financements publics : théâtres, opéras, musées, festivals, institutions patrimoniales, écoles d’art, associations subventionnées, etc.
Par exemple, le cinéma français fonctionne en grande partie dans un cadre financé ou cofinancé par la puissance publique. Le Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC) publie chaque année le montant des aides versées. En 2023, elles atteindraient 715 millions d’euros pour l’ensemble du secteur – production, distribution, exploitation. À cela s’ajoutent les crédits d’impôt cinéma, les financements des régions, et les obligations imposées aux diffuseurs (chaînes, plates-formes), devant consacrer une part de leur chiffre d’affaires à la création.
Dans les métiers du spectacle – un ensemble qui inclut le spectacle vivant mais aussi le cinéma et l’audiovisuel –, le mécanisme central est celui de l’intermittence. Il s’agit d’un régime d’assurance-chômage adapté aux artistes et techniciens qui alternent périodes d’emploi et de non-emploi. Ce système permet de lisser les revenus et, en pratique, mutualise le risque financier lié à l’irrégularité des projets artistiques – ce que rappelle régulièrement l’Unédic dans ses rapports.
La presse aidée
La presse écrite bénéficie elle aussi d’un ensemble d’aides publiques : subventions directes, TVA réduite à 2,1 %, et dispositifs spécifiques pour soutenir la diffusion. Depuis la loi Bichet de 1947, l’État veille à ce que la diffusion de la presse reste pluraliste et accessible sur tout le territoire. L’objectif est simple : éviter qu’un marché trop étroit ou trop concentré ne fragilise l’indépendance des titres. Les rapports publics consacrés aux aides à la presse rappellent régulièrement ce rôle structurant.
Selon le ministère de la Culture, ces aides à la presse représentent 21,4 % du chiffre d’affaires du secteur en 2021. Les rapports publics sur ces aides soulignent que, sans ce soutien, la situation financière de ces journaux serait encore plus dégradée, avec un risque accru de disparition de certains titres.
25 millions de Français et Françaises ont un revenu dépendant de l’État
Si on regarde uniquement les actifs et qu’on additionne tous les métiers qui dépendent peu ou beaucoup de décisions publiques – fonctionnaires, professions conventionnées, agriculture aidée, secteurs régulés, marchés publics, culture subventionnée, associations, start-up soutenues –, 25 et 30 millions de personnes ont un revenu qui dépend directement de l’État, d’une façon ou d’une autre.
Jérôme Baray ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
01.01.2026 à 13:12
Ces présidents de la République qui ont démissionné. Avec quelles conséquences ?
Texte intégral (1842 mots)
Lors de ses vœux pour 2026, le président de la République Emmanuel Macron a affirmé qu’il irait au bout de son mandat. Pourtant, de nombreuses personnalités appellent à sa démission, que souhaite d’ailleurs une large majorité de Français. Qui sont les présidents de la République qui ont renoncé au pouvoir au cours de l’histoire française ? Avec quelles conséquences ?
Les demandes de destitution (émanant de La France insoumise [LFI]) ou de démission d’Emmanuel Macron (formulée par Édouard Philippe, le Rassemblement national [RN] et certains élus Les Républicains [LR]) se sont multipliées depuis la dissolution de juin 2024.
Dans l’histoire de notre République, aucun président n’a été destitué par le Parlement. En revanche, neuf présidents de la République ont démissionné : Adolphe Thiers en 1873, Mac-Mahon en 1879, Jules Grévy en 1887, Jean Casimir-Perier en 1895, Paul Deschanel en 1920, Alexandre Millerand en 1924, Albert Lebrun en 1940, René Coty en 1959 et Charles de Gaulle en 1969. Les crises politiques qui ont présidé à ces décisions irrémédiables posent la question de la stabilité du régime lorsque la tête de l’exécutif tombe : la Ve République survivrait-elle à la démission d’Emmanuel Macron ?
Thiers écarté par les monarchistes
Adolphe Thiers est élu président de la République par les parlementaires le 31 août 1871, comme le veulent les institutions de la IIIe République. Sans Constitution, Thiers est chargé de négocier la paix avec l’ennemi allemand (la guerre franco-prussienne vient de se terminer) afin qu’il quitte le territoire. Mais l’Assemblée nationale, élue en février 1871, est majoritairement monarchiste : elle veut tout faire pour éviter l’installation d’un régime républicain. C’est dans un climat tendu que les relations entre Thiers et l’Assemblée nationale se dégradent au printemps 1873. Une crise politique s’ouvre le 24 mai, lorsque le duc de Broglie prend la tête de la fronde monarchiste : Thiers, désavoué, renonce à présider. Même si la décision lui appartient, le président Thiers a donc été poussé vers la sortie et le vote parlementaire s’apparenterait à une destitution officieuse.
Cette crise de jeunesse du nouveau régime installe une vraie culture de régime parlementaire dans lequel le législatif a le dernier mot sur le pouvoir exécutif. La conséquence est l’affaiblissement de la fonction présidentielle, propre à « inaugurer les chrysanthèmes ».
Grévy et le scandale des médailles
Jules Grévy est le seul des présidents en fonction qui est contraint de démissionner, le 2 décembre 1887. Son gendre, Daniel Wilson est à la tête d’un trafic lucratif de médailles républicaines et notamment celle de la Légion d’honneur.
La police et la presse d’opposition s’emparent du scandale qu’exploitent alors Georges Clemenceau et Jules Ferry contre Grévy.
Casimir-Perier, Deschanel et Millerand : renoncer pour l’honneur
Deux chefs de l’État renoncent volontairement (démission) à leurs fonctions alors que rien, dans le contexte, ne l’exigeait.
En 1895, Jean Casimir-Perier rédige une lettre de renoncement pour des raisons politiques et personnelles : il évoque la faiblesse institutionnelle du chef de l’État, isolé dans son palais, sans réels pouvoirs de décisions. Il reproche au gouvernement de ne pas assez le consulter en matière de politique étrangère et de défense. Il critique surtout l’attitude de Charles Dupuy, son président du Conseil avec qui la mésentente est bien réelle. Son malaise est aussi lié au contexte de l’affaire Dreyfus avec un climat politique tendu et de profondes divisions de la société française. Il écrit dans sa lettre de démission : « Je refuse d’être une ombre, une potiche inutile. »
En 1920, Paul Deschanel est malade et ne peut continuer son mandat alors qu’il venait d’être élu président six mois plus tôt : sa dégringolade du train en pleine nuit marque sa faiblesse physique et donc institutionnelle. Ne pouvant plus être crédible, il démissionne.
Le troisième renoncement est celui d’Alexandre Millerrand, en juin 1924 : le président, jugé trop présent dans le jeu politique, reçoit des pressions importantes de la part des partis républicains modérés et ceux de la gauche. Le risque de dérive « présidentialiste » provoque la méfiance de la gauche qui gagne les législatives sous l’appellation du « Cartel des gauches ». Son refus de nommer le principal chef de cette alliance, Édouard Herriot à la présidence du Conseil est perçu comme un déni de démocratie. La Chambre des députés, hostile à Millerand, demande sa démission, qui aura lieu le 11 juin 1924.
Lebrun et Coty : l’avènement d’un nouveau régime
Deux autres chefs de l’État quittent l’Élysée dans des circonstances exceptionnelles puisque leurs départs marquent un changement de régime.
Albert Lebrun est pris dans la tourmente de l’été 1940. Élu en 1932, il ne peut affronter la déflagration de l’invasion allemande et la défaite française reconnue lors de la signature de l’armistice par le maréchal Pétain le 22 juin 1940. Alors qu’une petite partie de la classe politique ne veut perdre le régime républicain, beaucoup se rangent à l’avis d’offrir le pouvoir au vainqueur de Verdun le 10 juillet 1940. Le vote des pleins pouvoirs à Pétain par la représentation parlementaire met fin aux fonctions présidentielles d’Albert Lebrun, laissant Pétain devenir chef de l’État français.
René Coty connaît un sort similaire en 1958. Difficilement élu par le Parlement en 1953, il réussit à s’imposer comme un élément de stabilité dans la vie politique très tourmentée de la IVe République (23 gouvernements en douze ans). Mais la crise algérienne gangrène l’équilibre politique fragile, avec un point d’orgue en 1958 lorsque le Comité de salut public d’Alger appelle le général de Gaulle à la rescousse face aux nationalistes algériens du Front de libération nationationale (FLN). Le 1er juin, le président Coty décide de nommer à la présidence du Conseil le « plus illustre des Français ». Alors que la nouvelle Constitution s’écrit et que de Gaulle prépare la transition, Coty achève son mandat le 8 janvier 1959, laissant advenir le nouveau régime républicain et, à sa tête, le général, élu en décembre 1958.
De Gaulle et le renoncement pour l’honneur
La démission du général de Gaulle, en avril 1969, laisse l’image d’un homme capable d’abandonner le pouvoir avec dignité. Après l’épisode de Mai-68, de Gaulle, âgé de 79 ans, est affaibli physiquement et politiquement. Les jeunes jugent la société trop conservatrice et beaucoup constatent que le président ne comprend plus son pays. Le non cinglant (52,4 %) au référendum d’avril 1969 le conduit à démissionner le 28 avril. On retient l’image du général et de son épouse se promenant sur les plages d’Irlande, laissant à penser la profonde tristesse qui étreint le général, divorcé de son cher « vieux pays ».
Le départ du Général ne remet pas cependant en cause le fonctionnement des institutions parce que sa succession était prévue, lui-même ayant accepté sa candidature à l’Élysée après sa démission en avril 1969 (même si les bons rapports entre les deux hommes avaient été brouillés par les évènements de Mai-68). Parmi de nombreux héritiers putatifs, plus près du général (Michel Debré, Jacques Chaban-Delmas), Georges Pompidou s’impose comme le meilleur. Pierre Messmer en 2006 en témoigne :
« En avril 1969, il lui écrit qu’il approuve sa candidature à l’Élysée et qu’il espère son succès ; en juin, il le félicite pour son élection. Cela suffit à trancher le débat, il me semble. »
Un président qui dépasse (toujours) ses fonctions
La Constitution de la Ve République fut conçue pour mettre un terme au « régime des partis », dénoncé par de Gaulle. Les pouvoirs étendus du président en font la clé de voûte d’institutions stables et son « corps politique » ne peut défaillir sans mettre en péril le régime selon les politistes Marcel Morabito et Marlène Coulomb-Gully.
Pourtant, les démissions présidentielles qui ont jalonné notre histoire n’ont pas toujours été des moments de fragilisation du régime. Ce sont surtout les conditions dans lesquelles cette décision est prise qui dictent l’intensité d’une éventuelle crise politique ou institutionnelle, nourrissant l’inquiétude d’une opinion publique qui n’apprécie guère de voir le chef de l’État vaciller.
Thierry Truel ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
23.12.2025 à 16:54
Comment pictogrammes et émojis traitent la question du genre
Texte intégral (2662 mots)

Pensés pour être universels, les pictogrammes racontent une histoire moins neutre qu’il n’y paraît. Au fil des normes et des usages, la figure de l’homme s’est silencieusement imposée. Comment cette évidence graphique s’est-elle construite ? Du côté des émojis, une sous-catégorie du système iconique, la situation est moins androcentrique – et ce n’est pas seulement parce qu’ils sont apparus plus récemment. Comment s’en inspirer pour rendre les pictogrammes plus représentatifs de l’ensemble de la société ?
Ils recouvrent nos écrans, ponctuent nos correspondances et investissent l’espace public : les pictogrammes. Conçus pour exprimer des concepts simples, immédiatement déchiffrables, ils sont utilisés dans le but de « communiquer des informations nécessaires indépendamment de toute langue ». Pour autant ils ne sont pas neutres. Ils peuvent être les vecteurs d’androcentrisme graphique. L’androcentrisme désigne une propension à considérer « l’humain » ou « le générique » par le prisme exclusif du masculin.
Cette forme de stéréotype de genre appliqué aux pictogrammes apparaît dans la littérature scientifique, tout particulièrement dans les recherches des trente dernières années. Cette période correspond à une époque d’intensification des échanges internationaux qui s’est traduite par une circulation accrue de normes visuelles. D’autre part, elle coïncide avec une phase de démocratisation des outils informatiques qui a entraîné une multiplication des pictogrammes.
Les transports publics les exploitent, notamment pour communiquer des informations intelligibles rapidement. C’est justement à l’occasion de travaux menés dans la filière ferroviaire et destinés à évaluer la compréhension de messages pictographiques que j’ai supposé l’existence de stéréotypes dans ce milieu. Pour comprendre comment se diffusent ces biais, il était cependant nécessaire d’élargir le champ d’étude à un domaine mieux documenté : le genre.
Mon analyse porte sur les environnements où les pictogrammes sont les plus nombreux, les plus exposés et les plus fréquemment utilisés – les hôpitaux et la signalisation routière (l’un des premiers secteurs à avoir fait l’objet d’une normalisation et dont les codes tiennent toujours lieu de modèles en matière de signalétique).
Ces pictogrammes qui nous guident… et perpétuent des stéréotypes
Les transports, terrain propice à l’iconographie, n’ont pas échappé à la diffusion de stéréotypes de genre, aujourd’hui encore ancrés dans les standards. Une étude récente portant sur 227 pictogrammes routiers provenant de plusieurs pays a ainsi mis en évidence une prédominance de figures masculines sur les profils féminins et neutres.
Comme je l’avais observé dans le monde ferroviaire, ce déséquilibre varie selon le type de panneaux. Ceux qui évoquent des passages d’enfants, comptent davantage d’images féminines, comparés aux passages piétons ou travaux, qui représentent quasi exclusivement des hommes. Lorsqu’il apparaît, le féminin se limite généralement à des icônes de fillette accompagnée. Un seul (sur 227) la montre indépendante.

Point de référence, le système de signalisation routière voit ses biais reproduits dans d’autres univers visuels. Dans les espaces publics, par exemple les aéroports, cette tendance se confirme avec une nuance. Les femmes ne sont pas totalement absentes mais semblent confinées à des fonctions d’assistance (ex. prendre soin d’un bébé). Dès qu’elles sont associées à un ou plusieurs hommes, elles sont renvoyées au second plan (ou matérialisées dans des proportions plus réduites).
Cette récurrence invite à interroger les mécanismes mêmes de production des pictogrammes et plus précisément les banques d’illustrations mises à disposition par les organismes de normalisation. Dans beaucoup d’entre elles, les femmes sont peu présentes ou cantonnées à des rôles subalternes. Par exemple, la norme ISO 7010, qui régit la conception des symboles de sécurité, fait principalement appel à des figures masculines.
Il en est de même dans le secteur du handicap, où les icônes sont majoritairement composées d’hommes (ex. 89 % sur un échantillon de 40, dont 28 personnages) alors que les femmes constituent 56 % des personnes en situation de handicap âgées de 16 ans ou plus et vivant à domicile.
Au-delà des lieux publics, les tableaux de bord électroniques (ex. grues, machines de production, hôpitaux) ont largement participé à la propagation des stéréotypes de genre dans la pictographie. Le domaine médical en est un exemple. Des symboles sont couramment employés pour désigner l’activation de commandes, chez les professionnels (ex. moniteurs de signes vitaux) comme chez les patients (ex. télécommandes de chevet).
Dans une étude menée en 2019 et couvrant 8 pays, 56 appareils d’appel de soignants ont été comparés. Parmi eux, 37 recouraient à des figures féminines pour illustrer le concept d’assistance. Neuf étaient neutres et dix sans illustration. Une telle distribution suggère une association automatique entre la femme et la notion d’assistance, et par extension une orientation genrée du processus de codage iconographique.

Les émojis : un modèle de gouvernance distinct
Le numérique n’échappe pas à cette logique même si des progrès sont notables.
Ainsi, dans une étude menée en 1997 et portant sur 14 000 cliparts (représentations simplifiées d’un concept, d’un objet, d’une personne, d’une situation) les femmes ne constituaient que 4 % des items, souvent secrétaires ou infirmières.
Si les améliorations restent globalement limitées, des transformations positives se dessinent dans une autre branche proche des pictogrammes, plus populaire : les émojis.
En 2016, le consortium Unicode, chargé de normaliser l’encodage du texte et des symboles, a entrepris une révision de son système en faveur de la diversité. Onze nouveaux émojis décrivant des femmes en activité (ex. programmeuses, scientifiques) sont venus s’ajouter à la féminisation de 33 items existants (ex. espionnes, surfeuses). Des sociétés comme Google ont introduit des figures féminines dans des rôles valorisés (ex. scientifique, médecin).
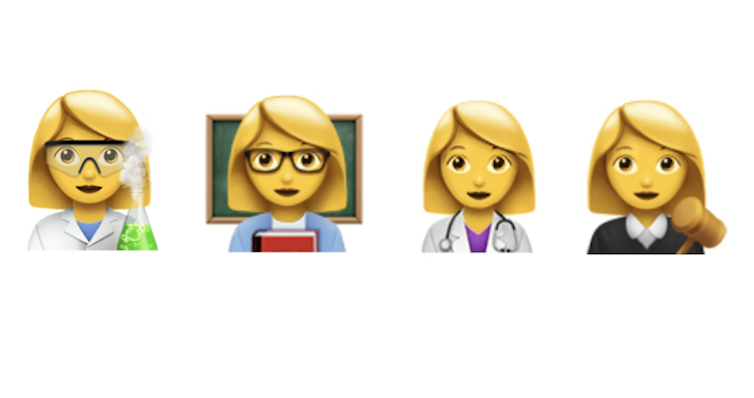
Ces trajectoires distinctes entre pictogrammes et émojis pourraient en partie s’expliquer par leurs modèles de gouvernance. Du côté des pictogrammes, celui-ci est dispersé : certaines normes sectorielles (ISO, par exemple) coexistent avec de vastes banques de symboles libres (notamment Noun Project), sans qu’aucune instance unique ne fixe définitivement les usages. Du côté des émojis, il est plus centralisé. Une forme de standardisation est assurée par le Consortium Unicode, une organisation soutenue par des entreprises technologiques (dont Google), qui reconnaissent son autorité et contribuent ainsi à renforcer son rôle dans l’uniformisation des caractères numériques.
En clair, les émojis suivraient un processus formalisé de propositions et de standardisation qui rend possible l’introduction de modificateurs (ex. genre). À l’inverse, la construction des pictogrammes, en particulier dans le monde logiciel, serait atomisée entre une multitude de systèmes graphiques qui ne bénéficient d’aucun effort collectif comparable.
Et après ? Rendre les pictogrammes réellement universels
Les démarches entreprises dans le contexte des émojis laissent entrevoir plusieurs axes d’amélioration pour les pictogrammes. Ainsi, une approche de création empirique et standardisée serait susceptible de limiter les effets de l’androcentrisme graphique.
Empirique d’abord : s’appuyer sur des méthodes et outils scientifiques permettrait de mesurer de manière quantitative l’ampleur des biais et d’estimer leur impact sur le public dans le but de définir des lignes directrices respectueuses de l’égalité.
Standardisée ensuite : en combinant les recommandations d’organisations reconnues (ex. Unicode), les travaux d’instituts de normalisation (ex. ISO) et les initiatives individuelles (ex : designers indépendants), la diversité des représentations se trouveraient renforcées.
En tant que signe visuel simple, intelligible de tous et omniprésent, le pictogramme contribue à propager une certaine forme d’androcentrisme. De fait, pour s’assurer qu’elle réponde à sa promesse d’universalité et éviter qu’elle ne véhicule des stéréotypes, la communication pictographique implique un questionnement du prisme masculin « par défaut ». Cette étape suppose l’établissement concerté de nouveaux référentiels, couplé à une évaluation continue des normes de conception.
Cet article est publié dans le cadre de la Fête de la science (qui a eu lieu du 3 au 13 octobre 2025), dont The Conversation France est partenaire. Cette nouvelle édition porte sur la thématique « Intelligence(s) ». Retrouvez tous les événements de votre région sur le site Fetedelascience.fr.
Jonathan Groff ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
22.12.2025 à 17:44
Que deviennent les gares rurales quand les trains disparaissent ?
Texte intégral (2371 mots)
En France, les fermetures de gares ou de lignes ferroviaires sont légion dans les espaces ruraux. Pourtant, ces dernières années, certaines petites gares retrouvent une nouvelle vie en se transformant en épicerie, en pôle santé ou encore en bureau. Pour quel bilan ?
Le 31 août 2025, la fermeture de la ligne ferroviaire Guéret–Busseau–Felletin a suscité de vives émotions. Ce cas est loin d’être isolé. En février 2025, ce sont 200 personnes qui se sont ainsi réunies en gare d’Ussel (Corrèze) afin de manifester pour la réouverture de la ligne ferroviaire à l’appel de la CGT-Cheminots de Tulle-Ussel.
Bien que les années s’écoulent depuis les fermetures, les territoires gardent un attachement fort au train et continuent de se mobiliser pour son retour. L’une des raisons tient à la rareté des transports en commun. Huit actifs sur dix habitant les espaces peu denses déclarent ne pas disposer d’alternatives à la voiture. Cet attachement a permis la naissance de plusieurs projets de valorisation de petites gares, comme celles d’Aumont-Aubrac, Sèvremoine ou encore Hennebont.
Des projets de recherches sont aujourd’hui menés pour penser à l’avenir des petites lignes ferroviaires. C’est le cas du projet du train léger innovant (TELLi), qui vise à développer un matériel roulant adapté à ces lignes. Le Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement (Cerema), partenaire de ce projet, mène des recherches en sciences sociales afin de déterminer les conditions de réussite des systèmes ferroviaires légers.
Ma thèse s’intéresse aux petites gares rurales, point d’entrée du réseau ferroviaire. L’une des hypothèses défendues : les expérimentations locales d’aménagement participent au renforcement du lien entre le territoire et le train.
Petites lignes, grandes difficultés
Cela fait plusieurs années que ces petites lignes ferroviaires sont sur la sellette, menacées par des limitations drastiques de vitesse ou par l’arrêt total des circulations. Mais comment ce réseau ferroviaire secondaire, qui maille finement le territoire, a peu à peu été délaissé ?
Cette situation s’explique par la forte concurrence de l’automobile qui a réduit de façon significative la fréquentation de certaines lignes. Faute d’alternatives crédibles, 80 % des déplacements dans ces territoires s’effectuent aujourd’hui en voiture. L’entretien de ce réseau ferroviaire secondaire étant devenu trop coûteux, la politique de l’opérateur SNCF a privilégié les investissements sur le réseau dit structurant, ainsi que sur les lignes à grandes vitesses.
Les petites lignes ferroviaires représentent 7 600 kilomètres du réseau ferroviaire national. Le rapport élaboré par le préfet François Philizot estime que 40 % de ce réseau de proximité est menacé faute d’entretien. Ce même rapport estime les investissements nécessaires au maintien de ces lignes ferroviaires à 7,6 milliards d’euros d’ici à 2028.
Le vieillissement de ces lignes, faute d’investissements, entraîne une dégradation du service plus ou moins importante. Dans les territoires ruraux, 70 % des petites lignes ferroviaires accueillent moins de 20 circulations par jour. Or comme le rappelle le maire de Felletin, dont la ligne a été fermée cette année en raison de la vétusté de l’infrastructure, « c’est le service qui fait la fréquentation, et non l’inverse ».
Transformer une gare en épicerie, c’est possible
Les territoires refusent de voir disparaître leurs gares ; ils se les réapproprient et les transforment en réponse aux besoins locaux.
Depuis 2023, la gare d’Aumont-Aubrac en Lozère a été transformée en épicerie, nommée Le Re’peyre. Le bâtiment de la gare, fermé aux voyageurs depuis 2015, a retrouvé un second souffle. Des produits artisanaux et locaux y sont en vente, contribuant à un commerce éthique porté par les initiateurs du projet.
Cette transformation de la gare en épicerie est permise par le programme Place de la gare de SNCF Gares & Connexions (filiale de SNCF Réseau). Celui-ci favorise l’implantation de nouvelles activités et services par de la location au sein de plusieurs gares. L’objectif principal est de permettre l’occupation de locaux vides en gare, en leur donnant une nouvelle fonction et ainsi éviter leur dégradation.

D’autres projets ont vu le jour. La gare de La Roche-en-Brenil (Côte-d’Or) a été transformée en un pôle santé, ou celle de la ville de Briouze (Orne) en tiers-lieu.
Ces projets favorisent le développement d’activités économiques dans des lieux bénéficiant naturellement de visibilité. Ils participent à la redynamisation à l’échelle des quartiers de gare, en attirant une clientèle diversifiée au-delà des seuls voyageurs. La gare se retrouve davantage intégrée dans la vie communautaire grâce aux échanges et aux interactions qui se créent entre voyageurs et autres usagers.
Co-construction avec les habitants de projet en gare
Au-delà de la simple réaffectation des bâtiments, certains projets menés dans des gares rurales choisissent de donner une dimension participative en associant usagers du train et citoyens dans le processus.

C’est le cas de la gare de Sèvremoine (Maine-et-Loire), propriété de la commune qui a décidé de la moderniser en repensant les espaces publics environnants. Pour le bâtiment de gare, il a été souhaité d’y créer de nouveaux équipements favorisant l’animation sociale entre habitants et associations.
À lire aussi : Le train survivra-t-il au réchauffement climatique ?
Quatre concertations citoyennes ont permis le recueil des besoins des habitants avant le lancement d’un appel d’offres. Le projet Open Gare proposé par deux habitantes de la commune a été retenu. Ce tiers-lieu, axé sur la transition écologique et sociale, propose plusieurs services, tels qu’un service de restauration, un espace de travail partagé et une boutique d’artisans locaux.
Tout au long du projet, des réunions ont été organisées pour informer et recueillir les retours des citoyens. Gouverné par une coopérative d’intérêt collectif et l’association Open Gare, ce lieu co-construit ouvrira ses portes dès 2027, après une période de travaux.
Des acteurs associatifs qui prennent la casquette SNCF
Certaines initiatives vont encore plus loin en intégrant l’ensemble du quartier.
C’est ce que montre l’exemple de l’association Départ imminent pour l’Hôtel de la Gare à Hennebont (Morbihan), qui a réhabilité le bâtiment de l’Hôtel de la Gare, situé à quelques pas de la gare elle-même. L’objectif : revitaliser de la gare et de son quartier.

Cette association occupe également le bâtiment voyageur grâce au programme programme Place de la gare. Désormais, il est possible de retrouver divers services tels que des bureaux, des logements en location, un café et un atelier. L’association, désormais devenue la société coopérative d’intérêt collectif Tavarn Ty Gar assure l’accueil et les services aux voyageurs au rez-de-chaussée de la gare. Une expérimentation de plus qui souligne le dynamisme de ces territoires et de ses habitants.
Burcin Yilmazer a reçu des financements du Gouvernement dans le cadre du plan France 2030 opéré par l'ADEME
22.12.2025 à 17:42
Comment rendre nos discussions politiques en famille moins conflictuelles ?
Texte intégral (2183 mots)

Pendant les fêtes de fin d’année, les échanges se crispent souvent sur des questions politiques. Des recherches en psychologie et en sciences politiques éclairent les mécanismes qui alimentent ces conflits et ceux qui permettent de les désamorcer.
Nombreux sont ceux qui redoutent les discussions de famille sur les sujets politiques : écologie, immigration, conflit israélo-palestinien, relations entre les sexes et les générations… Celles-ci sont souvent tendues, et peuvent créer de l’autocensure ou du ressentiment.
Des recherches en psychologie et en sciences politiques, de nature aussi bien qualitative qu’expérimentale, offrent un éclairage sur les mécanismes qui causent ces tensions. Elles identifient également de bonnes pratiques susceptibles de faire de nos discussions politiques des lieux d’apprentissage et d’échange plus cordiaux et respectueux, tout en permettant l’influence idéologique et sans nier la légitimité des désaccords politiques.
La tendance à présumer de mauvaises intentions
Notre esprit est configuré pour surdétecter l’hostilité chez autrui – un mécanisme qui a vraisemblablement protégé nos ancêtres dans leurs environnements évolutionnaires, mais qui nous induit souvent en erreur aujourd’hui. En surdétectant l’hostilité, nous nous prémunissons du risque de maltraitance, mais nous risquons de présupposer de l’agressivité quand elle est absente.
Or, dans nos sociétés modernes et démocratiques, riches et condamnant largement la violence verbale et physique, la plupart de nos concitoyens n’ont qu’exceptionnellement des intentions négatives. L’un des effets psychologiques majeurs d’un environnement social plus riche et moins violent est en effet la diminution de l’impulsivité et de l’agressivité individuelle.
Les citoyens peuvent, bien sûr, être en désaccord politique vivace, et légitime, sur ce qu’il convient de faire pour rendre la société meilleure. Et la société est indéniablement parcourue de rapports de pouvoir et d’inégalités entre groupes. Mais la plupart des citoyens souhaitent des changements qu’ils pensent sincèrement susceptibles d’améliorer la société. L’impression qu’un interlocuteur est hostile ou stupide provient souvent de la distance entre ses croyances et les nôtres, acquise auprès de sources médiatiques et de fréquentations sociales très différentes, plutôt que de défaillances morales fondamentales.
Les pièges rhétoriques qui empoisonnent les échanges
Les travaux philosophiques sur l’argumentation ont identifié de longue date plusieurs procédés rhétoriques, souvent inconscients, qui empoisonnent facilement nos échanges. Comme mettent en garde les chercheurs Peter Boghossian et James Lindsay dans leur livre How to Have Impossible Conversations (2019), deux d’entre eux apparaissent particulièrement souvent dans les discussions politiques.
L’« homme de paille » (ou strawman) consiste à caricaturer la position de l’autre pour la rendre facile à contrer. Les recherches montrent que ce procédé est un produit naturel de notre esprit en contexte de désaccords moraux et qu’il empêche d’entrer réellement en dialogue.
L’interlocuteur perçoit, à raison, une absence d’effort pour comprendre ce qu’il dit dans toute sa finesse, ce qui génère une impression d’être pris pour un idiot. Il en résulte une impression de fermeture à son point de vue, de mépris pour son intelligence, qui retire toute marge de manœuvre pour la persuader.
À l’inverse, la pratique de « l’homme d’acier » ou steel man
– reformuler la position de l’interlocuteur de la manière la plus charitable possible, dans des termes dans lesquels la personne se reconnaît – permet de signaler son respect. Il est très rare que le discours idéologique soit en déconnexion totale avec les faits (fake news mises à part). La construction d’un steel man force chaque interlocuteur à adopter un minimum la perspective de l’autre, ce qui enrichit la compréhension mutuelle et produit une impression de bienveillance.
De même, notre tendance à poser de « faux dilemmes » apparaît souvent contre-productive. Ces derniers réduisent des questions nécessairement complexes à deux alternatives simplistes, mutuellement exclusives : soit nous acceptons une immigration incontrôlée, soit nous vivons dans une république raciste ; soit c’est la culture, soit c’est la biologie qui explique les différences psychologiques entre les sexes, etc.
La tendance à réduire une question sociale complexe à un faux dilemme constitue presque un réflexe lorsqu’on possède de fortes convictions morales sur le sujet. Cela amène les personnes à se comporter comme si elles avaient un message à délivrer, qu’elles affirmeront avec rigidité jusqu’à ce qu’elles aient le sentiment d’avoir été « entendues » – quitte à dénier toute nuance et toute validité aux observations pertinentes du point de vue opposé.
L’importance de reconnaître les extrémistes dans son propre camp
Les recherches qualitatives et expérimentales sur la négotiation et la résolution de conflit – dialogues intercommunautaires entre Israéliens et Palestiniens – suggèrent qu’un enjeu important pour susciter la confiance dans les situations conflictuelles est de paraître rationnel et autonome par rapport à son « camp » politique.
La reconnaissance du fait que dans son propre camp aussi, certaines personnes défendent des positions excessives, commettent des violences verbales ou physiques, ou nient certains faits scientifiques, constitue un signal d’autonomie. Cette attitude démontre qu’on n’est pas totalement aveuglé par la loyauté partisane, établit plus de confiance et peut ouvrir des voies d’influence.
Les bénéfices d’une posture d’apprentissage
La pratique de l’enquête de terrain ethnographique montre que même face à quelqu’un dont les idées nous indignent ou nous inspirent l’incrédulité (croyants en la théorie de la Terre plate), il est possible d’apprendre, avec empathie, sur sa vision du monde.
De même, il est utile d’envisager son partenaire de discussion politique comme le membre intéressant d’une tribu lointaine, qui mérite le respect, plutôt que comme le soutien d’un parti politique que l’on est tenté de mépriser.
Garder ses inférences sous contrôle
Les travaux sur la pragmatique linguistique montrent que les discussions politiques sont faites d’échanges de répliques au sujet desquelles les participants font des inférences (tirent des conclusions à partir de ce qu’ils entendent) qui vont souvent au-delà du sens que les locuteurs ont réellement voulu donner à leurs phrases. Cette pratique consistant à inférer ce que la personne serait en train de dire à partir de ce qu’elle a littéralement dit nous sert à compenser le caractère inévitablement vague de la parole.
Le problème est que ces inférences sont souvent biaisées par des stéréotypes qui négligent les subtilités des opinions individuelles, et par la peur d’entendre quelqu’un dire des choses dont on craint qu’elles aient des conséquences « dangereuses ».
Ces inférences peuvent alors conduire à « accuser » nos interlocuteurs de défendre des positions qu’ils n’ont jamais défendues ni même pensées, simplement parce que leurs phrases ressemblent à des opinions qui nous effraient. Par exemple :
« Les discriminations systémiques sont partout » : cet énoncé peut être perçu comme relevant d’une idéologie de gauche radicale, ce qui irritera nombre de personnes de droite. Mais il peut aussi simplement constater que certaines inégalités persistent au-delà des intentions individuelles, sans imputer de culpabilité collective ni nier les progrès réalisés.
« La sécurité doit redevenir une priorité » : ce type d’énoncé peut être associé, à gauche, à des positions sécuritaires, autoritaires ou à une stigmatisation des minorités. Mais il peut aussi exprimer une préoccupation légitime pour les victimes de criminalité dans certains quartiers, sans impliquer de solutions répressives disproportionnées.
Les motivations sociales au-delà de la recherche de vérité
Il importe aussi de garder en tête que nos discussions politiques sont influencées par des motivations sociales, souvent inconscientes, comme paraître moral et bien informé pour se donner une bonne image, et mobiliser les autres autour de nos causes.
Le problème est que ces préoccupations, bien qu’adaptatives dans nos cercles sociaux, nous poussent souvent vers l’exagération et la mauvaise foi. Par exemple, l’exagération d’une menace sociale – impact de l’immigration, imminence du changement climatique – ou le déni d’un progrès – déclin du sexisme, de la pauvreté – peuvent permettre de signaler sa loyauté envers un « camp » politique et de mobiliser l’engagement autour de soi.
Mais lorsque notre audience n’est pas politiquement alignée, exagération et mauvaise foi peuvent faire passer les membres de son propre camp politique comme refusant la nuance sur des sujets complexes. Cela peut endommager le lien de confiance avec ses interlocuteurs, et retire alors toute perspective d’influence.
Ces principes de base qui, lorsqu’ils sont appliqués, peuvent permettre aux discussions politiques de devenir des lieux d’influence et d’apprentissage plutôt que de confrontation stérile entre des thèses caricaturales. Sans non plus nier la légitimité de nos différences d’opinions.
Antoine Marie ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
21.12.2025 à 11:31
Budget 2026 : les conséquences de l’échec de la commission mixte paritaire et du choix de la loi spéciale
Texte intégral (2182 mots)
L’échec de la commission mixte paritaire sur le projet de loi de finances pour 2026 place le gouvernement face à un choix délicat. Le premier ministre entend déposer un projet de loi spéciale, comme en décembre 2024, après le renversement du gouvernement de Michel Barnier. Ce choix soulève d’importantes questions de conformité constitutionnelle et de portée juridique. Décryptage.
Après l’échec de la commission mixte paritaire (CMP), vendredi 19 décembre, qui n’est pas parvenue à proposer un texte de compromis, le premier ministre se retrouvait avec trois options : donner le dernier mot à l'Assemblée nationale et tenter de forcer l’adoption par l’article 49 alinéa 3 de la Constitution, attendre l’expiration du délai de soixante-dix jours pour mettre en œuvre le projet de loi de finances (PLF) par ordonnance, ou déposer un projet de loi spéciale. C’est cette dernière voie qui a été choisie. Pourquoi ? Et est-ce conforme au droit ?
Les trois options qui s’offraient au premier ministre
L’option de l’article 49 alinéa 3 de la Constitution
Cette option pouvait être écartée assez facilement. D’abord, le premier ministre Sébastien Lecornu l’avait lui-même écartée en début de procédure. Ensuite, c’est une voie très risquée. C’est celle qui a fait chuter le gouvernement de Michel Barnier, le 4 décembre 2024, sur l’adoption du projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025. Certes, contrairement à Michel Barnier, Sébastien Lecornu est parvenu à obtenir le vote du PLFSS 2026. Mais, au regard des débats tendus sur le projet de loi de finances, le premier ministre prendrait un très grand risque en recourant à cette procédure. De toute façon, en cas de renversement, il aurait été contraint, en tant que premier ministre démissionnaire, de procéder exactement comme l’a fait Michel Barnier en décembre 2024, c’est-à-dire de déposer un projet de loi spéciale.
L’option d’une mise en œuvre du projet par ordonnance
L’article 47 alinéa 3 de la Constitution prévoit que « si le Parlement ne s’est pas prononcé dans un délai de soixante-dix jours, les dispositions du projet peuvent être mises en vigueur par ordonnance ». Le PLF a été déposé à l’Assemblée nationale le 14 octobre 2025. La fin de la période de soixante-dix jours calendaires est le 23 décembre, à minuit. En conséquence, si le Parlement « ne s’est pas prononcé », et seulement dans ce cas (ce qui exclut un rejet du PLF), le gouvernement peut se passer du Parlement complètement. Cela signifie que l’État fonctionnerait en 2026 sur la seule base du projet initial du gouvernement, en retenant éventuellement les amendements votés par les deux assemblées (ce point a prêté à discussion entre spécialistes. A priori, rien n’empêche le gouvernement d’admettre des amendements votés par les deux assemblées).
La possibilité d’une mise en œuvre par ordonnance dépend donc de deux conditions : l’écoulement du délai de soixante-dix jours et l’absence de rejet définitif par l’Assemblée nationale.
Cependant, comme pour l’article 49 alinéa 3, Sébastien Lecornu a annoncé qu’il n’aurait pas recours aux ordonnances. Cette position, qui peut être critiquée dans la mesure où un premier ministre se prive ainsi de pouvoirs que la Constitution lui donne, a une certaine logique, puisque les deux procédures s’apparentent à un passage en force. En effet, dans les deux cas, le PLF est mis en œuvre sans vote formel du Parlement. Dans le premier, il est considéré comme adopté sauf si une motion de censure est votée ; dans le second, le PLF est mis en œuvre par ordonnance sans que le Parlement n’ait pu se prononcer.
Sébastien Lecornu privilégie donc la concertation et l’approbation du Parlement, en excluant tout passage en force. Le vote positif du projet de loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS) le conforte dans cette direction. Après l’échec de la commission mixte paritaire, le premier ministre choisit donc de déposer un projet de loi spéciale.
L’option de la loi spéciale
Sans l’épisode mouvementé de 2024, cette option paraîtrait extraordinaire puisque deux situations seulement avaient donné lieu à des lois de finances spéciales.
En 1962, après le renversement de son gouvernement, le premier ministre Georges Pompidou avait fait adopter, le 22 décembre 1962, un projet de loi de finances partiel comportant la seule première partie du PLF. Un autre projet de loi de finances spéciale comportant la deuxième partie avait été adopté le 26 janvier 1963.
La deuxième situation s’est produite en 1979. Par une décision du 24 décembre 1979, le Conseil constitutionnel a invalidé le PLF 1980 pourtant adopté par le Parlement. Pris au dépourvu, le gouvernement s’est alors inspiré des textes existants en faisant adopter une loi spéciale, le 27 décembre 1979. Saisi une nouvelle fois, le Conseil constitutionnel avait validé ce choix en constatant que, comme les textes n’avaient pas prévu cette situation, « il appartenait, de toute évidence, au Parlement et au gouvernement, dans la sphère de leurs compétences respectives, de prendre toutes les mesures d’ordre financier nécessaires pour assurer la continuité de la vie nationale ; qu’ils devaient, pour ce faire, s’inspirer des règles prévues, en cas de dépôt tardif du projet de loi de finances, par la Constitution et par l’ordonnance portant loi organique, en ce qui concerne tant les ressources que la répartition des crédits et des autorisations relatifs aux services votés » (décision du 29 décembre 1979).
En 2024, après le renversement du gouvernement Barnier, le président de la République Emmanuel Macron avait annoncé le dépôt d’un projet de loi de finances spéciale. Après un vote à l’unanimité par les députés et les sénateurs, la loi spéciale a été promulguée onze jours avant la fin de l’année (20 décembre 2024).
En décembre 2025, si la situation est comparable, elle présente tout de même quelques différences.
Les conditions sont-elles remplies pour le dépôt d’un projet de loi de finances spéciale ?
L’article 47 de la Constitution et l’article 45 de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) posent chacun une condition pour une loi de finances spéciale. Aucune des deux n’est remplie par Sébastien Lecornu.
La condition de l’absence de dépôt « en temps utile » du PLF
L’article 47 alinéa 4 de la Constitution, qui prévoit la possibilité d’une loi de finances spéciale, pose la condition de l’absence d’un dépôt « en temps utile de la loi de finances pour être promulguée avant le début de l’exercice » (le 1er janvier 2026). Cela renvoie à la situation dans laquelle le PLF a été déposé avec un retard tel que le Parlement n’a pas pu disposer du temps d’examen prévu par la Constitution, c’est-à-dire soixante-dix jours. Or, si Sébastien Lecornu a déposé le PLF en retard, le 14 octobre 2025, le Parlement a bien, théoriquement, disposé de soixante-dix jours calendaires, le délai s’achevant le 23 décembre à minuit. En conséquence, la condition n’est pas remplie pour déposer un projet de loi spéciale (ce point a été confirmé par le rapporteur de la commission des finances de l’Assemblée nationale dans son rapport sur le projet de loi spécial de 2024).
Qu’à cela ne tienne, le premier ministre le fera quand même, comme Michel Barnier en décembre 2024. Cette petite entorse de la Constitution semble implicitement assumée par le gouvernement. Il faut dire que, pour respecter la lettre du texte, le premier ministre devrait retirer le PLF qui est à l’Assemblée, en redéposer un autre, constater que le dépôt n’a pas été fait en temps utile et déposer un projet de loi spécial. En 2024, Michel Barnier ne le pouvait pas, car étant démissionnaire, il n’en avait pas le pouvoir. En 2025, Sébastien Lecornu en a le pouvoir, mais le temps presse et, surtout, cela revient au même.
La condition d’un dépôt du projet de loi spéciale avant le 19 décembre
L’article 45 de la LOLF prévoit que le projet de loi de finances spéciale doit être déposé avant le 19 décembre. Or, l’échec de la commission mixte paritaire est intervenu le 19 décembre, justement. Pour déposer un projet de loi spéciale, le gouvernement doit d’abord recueillir l’avis du Conseil d’État puis l’arrêter en Conseil des ministres.
Sébastien Lecornu, même en allant très vite, n’est pas en mesure de respecter ce délai. Le dépôt intervient donc avec quelques jours de retard. Est-ce problématique ? La LOLF n’est pas respectée, mais de peu. Ce n’est problématique que si le Conseil constitutionnel est saisi et que s’il applique strictement la règle du 19 décembre. Il y a des raisons pour le premier ministre de ne pas être inquiet. En décembre 2024, le projet de loi spéciale avait été adopté à l’unanimité et le Conseil n’avait pas été saisi.
Même si le Conseil est saisi en 2025, il est fort probable qu’au regard de sa jurisprudence antérieure il considère que le premier ministre a bien tout mis en œuvre pour assurer la continuité de la vie nationale et, par surcroît, avec l’aval du Parlement.
Le contenu de la loi spéciale
En 1979, le gouvernement s’était contenté de prévoir le strict minimum prévu par l’article 47 alinéa 4 de la Constitution, c’est-à-dire la perception des impôts existants. En décembre 2025, le gouvernement s’est montré plus audacieux.
Partant du principe que la Constitution se contente de prévoir ce contenu obligatoire, il a considéré que d’autres dispositions pouvaient être ajoutées. Le Conseil d’État a confirmé cette lecture dans son avis sur le projet de loi spéciale de 2024. La loi spéciale de 2024 comportait quatre articles. Le premier portait sur la perception des impôts existants. Le deuxième prévoyait le prélèvement sur recettes au profit des collectivités territoriales. Le troisième portait autorisation pour le gouvernement d’emprunter. Le quatrième a permis aux organismes de sécurité sociale de percevoir leurs ressources non permanentes.
En 2025, le gouvernement est parvenu à faire adopter le PLFSS. Par conséquent, il n’a pas besoin de prévoir le quatrième article. Comme il n’y a pas de raison qu’il en prévoit d’autres, le projet comportera sans doute les trois premiers articles.
Le Parlement devrait rapidement voter le projet de loi spéciale. Si, comme en 2024, il le fait à l’unanimité, il n’y aura vraisemblablement pas de saisine du Conseil constitutionnel.
Le 1er janvier 2026, le gouvernement fonctionnera avec le minimum, comme début 2025. Il restera alors à faire à adopter par le Parlement un PLF complet. François Bayrou y était parvenu, le 5 février 2025. La voie du compromis choisie par Sébastien Lecornu lui permettra-t-elle de le faire comme ce fut le cas pour le PLFSS ?
Alexandre Guigue est membre de membre de la Société française de finances publiques, association reconnue d'utilité publique réunissant universitaires et praticiens des finances publiques.
17.12.2025 à 16:07
La France qui se dépeuple, la France qui croît : état des lieux démographique
Texte intégral (2022 mots)

Si l’accent a été mis cet été sur la fin observée de la croissance démographique naturelle en France, tous les territoires ne sont pas touchés de la même façon. Un rapide tour de France nous montre que les dynamiques restent très variées.
En juillet 2025, les médias se sont emparés d’un chiffre choquant : le solde naturel de la France (la différence entre le nombre de décès et le nombre de naissances) était négatif depuis douze mois, marquant l’arrêt de la croissance naturelle du pays. La croissance démographique de la France repose désormais sur le solde migratoire (différence entre les entrées et les sorties du territoire).
Ce phénomène, nouveau à l’échelle nationale, touche en fait de nombreuses communes, voire départements, depuis longtemps, notamment dans les zones rurales.
En France, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, la croissance démographique a toujours été positive grâce à un solde naturel et un solde migratoire positifs. Depuis quelques mois, le solde naturel est désormais négatif à l’échelle nationale, mais le solde migratoire reste suffisant pour assurer encore la continuité de la croissance démographique du pays.
La région parisienne boostée par les naissances, l’Occitanie par les migrations
Lorsque les soldes naturel et migratoire sont positifs, la population augmente, c’est le cas aujourd’hui des grandes métropoles, de certains espaces frontaliers (avec la Suisse, l’Allemagne, le Luxembourg), mais aussi localement à La Réunion et en Guyane.
La croissance peut parfois être portée uniquement par un solde naturel positif même si le solde migratoire est négatif. On retrouve ces dynamiques dans les mêmes lieux que ceux que nous venons de citer : localement à La Réunion (par exemple, à Saint-Denis) ou en Guyane (à Saint-Laurent-du-Maroni) ou encore dans une moitié de l’Île-de-France, la commune de Lyon (Rhône), etc.
On peut enfin avoir une croissance démographique liée à un solde migratoire positif (les personnes viennent d’autres territoires français, voire internationaux), malgré un solde naturel négatif. C’est le cas de la façade atlantique, du sud de la Nouvelle-Aquitaine, de l’Occitanie, de la région PACA et de la Corse.
A contrario, la décroissance peut être due à des soldes naturels négatifs malgré des soldes migratoires positifs. C’est le cas d’une bonne partie des espaces ruraux du centre de la France jusqu’au sud du Massif central et même jusqu’aux Pyrénées. La moitié nord de la France, à l’exception des zones dynamiques précédemment citées, se trouve dans une situation où le solde migratoire négatif entraîne une baisse de la population, parfois couplée à un solde naturel négatif qui accentue encore ces tendances. La situation de la Guadeloupe et de la Martinique est d’ailleurs similaire.
L’oubli des campagnes
Les chiffres globaux cachent donc une diversité locale souvent laissée de côté. Ainsi, une partie de la France perd de la population de manière régulière depuis plus de cinquante ans et, pour certains lieux, depuis la fin du XIXᵉ siècle.
Le cas du département de la Creuse est l’exemple le plus marquant. Le département a connu son pic de population en 1886, avec presque 285 000 habitants. Depuis, il s’est littéralement vidé. Il a d’abord été victime de l’exode rural, mais, depuis 1975, le solde migratoire est positif. C’est donc depuis lors la panne de la dynamique naturelle qui explique la décroissance démographique de la Creuse. Le solde naturel atteint en effet presque - 1 % par an désormais (un record en France). On y dénombre deux fois et demie plus de décès que de naissances, et l’année 2024 a été marquée par seulement 713 naissances, deux fois moins que dans les années 1970.
Quid de la « renaissance rurale » ?
On a pourtant souvent entendu parler depuis les années 1990 d’une « renaissance rurale ». À l’échelle nationale, c’est effectivement le cas : sous l’influence de l’étalement urbain et l’accélération des déplacements, les campagnes les plus proches des villes, et particulièrement des plus grandes, ont connu une croissance démographique régulière, qui continue. Mais il s’agit en fait surtout d’un effet de débordement des populations urbaines sur les territoires environnant, facilité par le développement des transports (l’automobile en premier lieu).
Les tenants de cette « renaissance rurale » n’ont pas voulu voir la réalité des nombres. Alors que les indicateurs de croissance étaient globalement positifs, le dépeuplement d’une partie du territoire, souvent déjà peu dense, perdurait. En outre, une partie de ces migrations sont le fait de personnes en retraite, ce qui ne peut qu’apporter une dynamisation temporaire de la démographie locale (il n’y a pas de relance de la natalité).
Une récente étude, proposée par les géographes Guillaume Le Roux et Pierre Pistre, montre néanmoins une accélération des dynamiques migratoires au profit des espaces ruraux, à la suite du confinement de 2020. Cependant ces migrations restent modestes et concernent surtout les populations les plus aisées, qui sont aussi les plus âgées.
Des villes qui perdent aussi en population
La baisse de la population touche aussi des villes, et pas des moindres. Elle est souvent liée à l’émigration, mais cela peut-être aussi lié à la baisse de leur dynamique naturelle, ou encore à l’accumulation des deux facteurs.
Dans le premier cas, la baisse de population liée à l’émigration, on trouve plus de 90 villes de plus de 20 000 habitants, dont 27 centres urbains de plus de 50 000 habitants, allant de Bondy, Arles et Sartrouville pour les plus petites, jusqu’à Grenoble, Le Havre, Reims et surtout Paris. Pour la capitale, la dynamique affecte la commune intra-muros : la banlieue et les espaces périurbains d’Île-de-France connaissent des dynamiques variées. L’ensemble de la région Île-de-France reste en croissance grâce à sa dynamique naturelle.
Dans le second cas, la baisse de population liée à la dynamique naturelle, on ne trouve que 13 villes de plus de 20 000 habitants, parmi lesquelles figurent Hyères et Cannes. Une trentaine de villes de 10 à 20 000 habitants sont également concernées, partout en France : cela impacte aussi bien le Sud (Saint-Cyr-sur-Mer, Roquebrune-Cap-Martin…) que le centre (Le Puy-en-Velay, Saint-Amand-les-Eaux…), l’Ouest (Cognac, Thouars, La Flèche, Douarnenez, etc.) ou l’est de la France (Autun, Bischwiller, Freyming-Merlebach…).
Le dernier cas, la baisse de population liée à une décroissance totale (les deux soldes sont négatifs) touche, quant à elle, 74 villes de plus de 10 000 habitants, dont 27 villes de plus de 20 000 habitants, les plus grandes étant : Cherbourg, Bourges, La-Seyne-sur-Mer, et Saint-Quentin.
De la nécessité de penser local
La fin de la croissance naturelle observée à l’échelle nationale est donc un cas de figure déjà connu localement, ce qui peut paraître nouveau est donc déjà expérimenté dans de nombreux endroits. Les dynamiques observées doivent être différenciées aussi bien en termes de taille démographique des territoires concernés que de localisation régionale, ou encore en fonction des profils des habitants concernés. De manière générale, les espaces métropolitains enregistrent plus de naissances que de décès, notamment parce que leur structure par âge est plus jeune. Les populations étudiante et active tendent à rejoindre les villes (ou à y rester), alors que les personnes retraitées partent plus facilement s’installer sur la façade atlantique et dans la moitié sud de la France.
La prise en compte des dynamiques locales dans leur diversité géographique est nécessaire : les besoins ne seront pas les mêmes dans les années à venir dans une petite commune rurale en décroissance en Champagne ou dans une commune en croissance de la banlieue lyonnaise. La décroissance liée à la migration n’a pas les mêmes ressorts que celle liée au solde naturel négatif.
Les conséquences de ces différentes dynamiques ne seront pas non plus les mêmes, que l’on songe par exemple aux besoins d’équipements publics : quid des services au profit de la jeunesse lorsque le solde naturel devient négatif ? La migration concerne-t-elle des jeunes actives diplômées ou des couples de retraités ? Car le profil des migrations a des effets très différents : lorsque de jeunes femmes partent pour les études et ne reviennent pas, c’est la natalité future qui s’en trouve affectée ; lorsque des retraités quittent le territoire, c’est à la fois une perte de revenu local et une moindre charge future pour les services de santé et d’aide à la personne ; lorsque des actifs s’en vont, c’est la ressource en main-d’œuvre qui se réduit. Autant de situations qui se combinent et appellent des réponses locales, adaptées et innovantes.
Il n’y a pas une France en décroissance, mais des variétés de situations. C’est sans aucun doute là qu’est le plus grand défi : penser l’adaptation localement dans un pays dont les discours et l’action politiques sont toujours pensés de manière trop globale.
Sébastien Oliveau ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
17.12.2025 à 12:22
La fraternité, une valeur qui rassemble ou qui exclut ? Retour sur une histoire et ses ambiguïtés
Texte intégral (2320 mots)
Terme clé de la devise républicaine, trônant aux frontons de toutes les mairies, la fraternité est un terme traversé d’ambivalences qu’éclaire l’histoire. Plus que comme un principe, moral ou politique, ne faudrait-il pas plutôt l’envisager comme une métaphore ? Avec les possibilités et les limites que cela suppose, elle apparaît alors pour ce qu’elle est : une image puissante, à mettre au service d’une lutte.
La fraternité trouve une place particulière dans l’imaginaire français. Terme clé de la devise républicaine, trônant aux frontons de toutes les mairies, elle apparaît universelle et comme hors du temps. Pourtant, cette valeur a bien une histoire, tumultueuse s’il en est, et même une actualité.
En 2018, les institutions de la République française se sont prononcées deux fois sur la fraternité. D’un côté, le Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes (HCE) a publié un avis relatif à la révision constitutionnelle. Ce texte fait écho aux conclusions de la chercheuse Réjane Sénac, laquelle était également présidente de la Commission parité du HCE, en affirmant que « le terme de fraternité dit, non pas la neutralité républicaine, mais l’exclusion historique et légale des femmes de la communauté politique ».
Le HCE recommandait par conséquent d’envisager des alternatives comme « solidarité » ou « adelphité », ce dernier terme désignant les enfants d’un même parent, sans distinction de genre. La fraternité, c’est la bande de frères – sans les sœurs.
De l’autre, par suite de l’affaire Cédric Herrou, poursuivi pour avoir aidé quelques deux cents personnes migrantes à traverser la frontière entre l’Italie et la France, le Conseil constitutionnel a déclaré que « la fraternité est un principe à valeur constitutionnelle », ce qui lui confère un poids juridique. Il revient donc au législateur d’arbitrer « entre le principe de fraternité et la sauvegarde de l’ordre public ».
La fraternité ouvrait soudain une brèche juridique pour un internationalisme de terrain – aussi longtemps, du moins, qu’on n’accuserait pas celui-ci de troubler l’ordre.
Les ambiguïtés historiques de la fraternité
La fraternité, qui avait fini par faire partie des meubles de la République, se retrouvait par deux fois au cœur des débats constitutionnels ; tour à tour soupçonnée et consacrée. Cette ambivalence n’est pas accidentelle. Célébrée par l’ensemble du spectre politique, la fraternité n’est que rarement définie, si bien qu’on en ignore le plus souvent l’extension (qui est un frère et selon quel critère ?) et la signification (à quoi engage cette relation fraternelle ?). L’appel à la fraternité, vague et sans objet, est aussi unanime qu’inconséquent.
Les manques et les ambiguïtés de la fraternité ne sont pas nouveaux. Si la fraternité a été une valeur importante dans la rhétorique des sans-culottes en 1789, elle trouve son point d’orgue dans le Printemps des peuples, en 1848, qui mit fin à la monarchie de Juillet en France et fit trembler les couronnes réactionnaires de l’Europe. Cette notion de fraternité permettait aussi bien d’imaginer la nation, conçue comme une bande de frères, que les relations pacifiques entre les nations.
Pourtant, dès 1848, on pourrait accuser la fraternité d’illusion, d’exclusion et d’infantilisation. À la communauté des frères s’opposent ces figures négatives que sont, respectivement, les faux frères, les non-frères et les petits frères.
Les deux premières critiques sont bien connues. Selon Marx et Engels, la fraternité serait une illusion qui ne dure qu’un temps, c’est-à-dire aussi longtemps que les intérêts matériels des différentes classes s’alignent. Elle serait également une exclusion, car, malgré son universalisme affiché, elle exclut les non-frères. Ainsi les femmes, qui étaient sur les barricades, se sont vu refuser le droit de vote dit « universel ». Les frères ne reconnurent pas leurs sœurs en République.
La dernière critique dénonce l’intégration hiérarchisée, comme lors de l’abolition de l’esclavage dans les anciennes colonies. Afin de faire appliquer la décision du Gouvernement provisoire, Sarda Garriga, nouveau gouverneur de La Réunion, accosta sur l’île en octobre. Son discours, face à une société coloniale divisée, en appelait à l’unité fraternelle :
« Dieu vous a créés frères […] Si ceux qu’une triste classification avaient constitués les maîtres doivent apporter un esprit de fraternité […] dans leurs rapports avec leurs anciens serviteurs […] n’oubliez pas, vous frères qui allez être les nouveaux élus de la cité, que vous avez une grande dette à payer à cette société dans laquelle vous êtes près d’entrer. »
On attendit la fin de la récolte de la canne pour concrétiser l’abolition, le 20 décembre 1848. « Tous égaux devant la loi, vous n’avez autour de vous que des frères », commença Sarda Garriga, avant de prévenir :
« La colonie est pauvre : beaucoup de propriétaires ne pourront peut-être pas payer le salaire convenu qu’après la récolte. Vous attendrez ce moment avec patience. Vous prouverez ainsi que le sentiment de fraternité, recommandé par la République à ses enfants, est dans votre cœur. »
Au nom de la fraternité, on avait mis fin à l’esclavage. Au nom de la fraternité toujours, on imposait maintenant aux personnes anciennement réduites en esclavage de continuer à travailler dans les exploitations coloniales afin de maintenir l’ordre de la société coloniale.
La fraternité comme métaphore
Dès son apogée en 1848, la fraternité avait été mise aussi bien au service de la révolution que de la réaction, de l’exploitation que de la libération. Son ambivalence n’est donc pas accidentelle mais tient à sa nature. On fait souvent de la fraternité une valeur qui devrait guider notre action. Or, la fraternité n’est pas tant un principe, moral ou politique, qu’une image.
Comme l’a bien vu l’historien Benedict Anderson, dès que la communauté atteint une certaine taille, nous ne pouvons plus nous la représenter exactement d’où le recours à une image (la nation est « une bande de frères »). Cette image est donc nécessairement inadéquate (à strictement parler, la nation « n’est pas » une bande de frères), ce qui est la définition classique de la métaphore.

Une image ne se comprend qu’en lien avec un imaginaire donné, c’est-à-dire ancré dans un contexte culturel. Si l’image peut traverser les époques et les géographies, comme c’est le cas de la métaphore fraternelle, l’imaginaire, lui, est situé historiquement et socialement.
L’inadéquation métaphorique de l’image à la chose ne doit pas être pensée comme un manque ou un raté. La métaphore permet notamment de rendre la communauté imaginable. Surtout, elle va connoter la chose (la nation est « quelque chose comme » une bande de frères) et la charger affectivement (la nation est « notre » bande de frères). Les images contribuent à susciter un attachement viscéral à cette communauté de hasard qu’est la nation.
Sororité, adelphité, fraternité
L’image fraternelle est-elle encore d’actualité ? On peut être tenté de se tourner vers d’autres images familiales, comme la sororité, qui consacre la relation entre toutes les femmes, mais rien que les femmes, ou l’adelphité, qui évoque le lien entre les enfants d’un même parent, sans distinction de genre.
Quoique la sororité soit une image particulièrement puissante aujourd’hui, elle n’est pas exempte des ambiguïtés qui traversaient la fraternité. L’universalisme féminin de la sororité produit également une illusion d’unité qui invisibilise les relations de domination de race et de classe au sein de la communauté des sœurs. Comme il y a des petits frères, il y a de petites sœurs. Par ailleurs, la sororité manque de clarté quant à son extension et sa signification : s’étend-elle à toutes, y compris au groupe féministe d’extrême droite Némésis, à Marine Le Pen ou à Giorgia Meloni et, si tel est le cas, qu’implique-t-elle exactement ?

L’adelphité, de son côté, si elle permet d’échapper à la binarité du genre, ne résonne guère pour l’heure en dehors des cercles militants, ce qui limite sa charge affective.
Les métaphores n’offrent pas de boussole politique ou morale. Dès lors, que faire de la fraternité ? Deux voies sont déjà ouvertes. Soit on peut l’abandonner en faveur d’autres images jugées plus prometteuses, comme la sororité ou l’adelphité ; soit faire avec, notamment du fait de son ancrage si particulier dans l’imaginaire républicain français. Si ces deux options prennent des directions différentes, elles relèvent toutes deux d’une même « pragmatique de l’image ». Penser la fraternité ne devrait pas en faire un fétiche, mais nous conduire à appréhender sa puissance affective afin de mettre cette métaphore, parmi d’autres, au service de nos luttes.
Le programme ACCESS ERC dans le cadre duquel Arthur Duhé poursuit ses recherches sur les images fraternelles dans les discours nationalistes, antinationalistes et internationalistes, de 1789 aux années 1970, est soutenu par l’Agence nationale de la recherche (ANR), qui finance en France la recherche sur projet. L’ANR a pour mission de soutenir et de promouvoir le développement de recherches fondamentales et finalisées dans toutes les disciplines, et de renforcer le dialogue entre science et société. Pour en savoir plus, consultez le site de l’ANR.
Arthur Duhé a reçu des financements de l'ANR et en recevra du FNRS (2027-2030).
