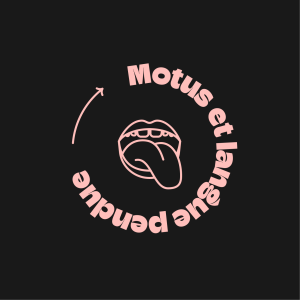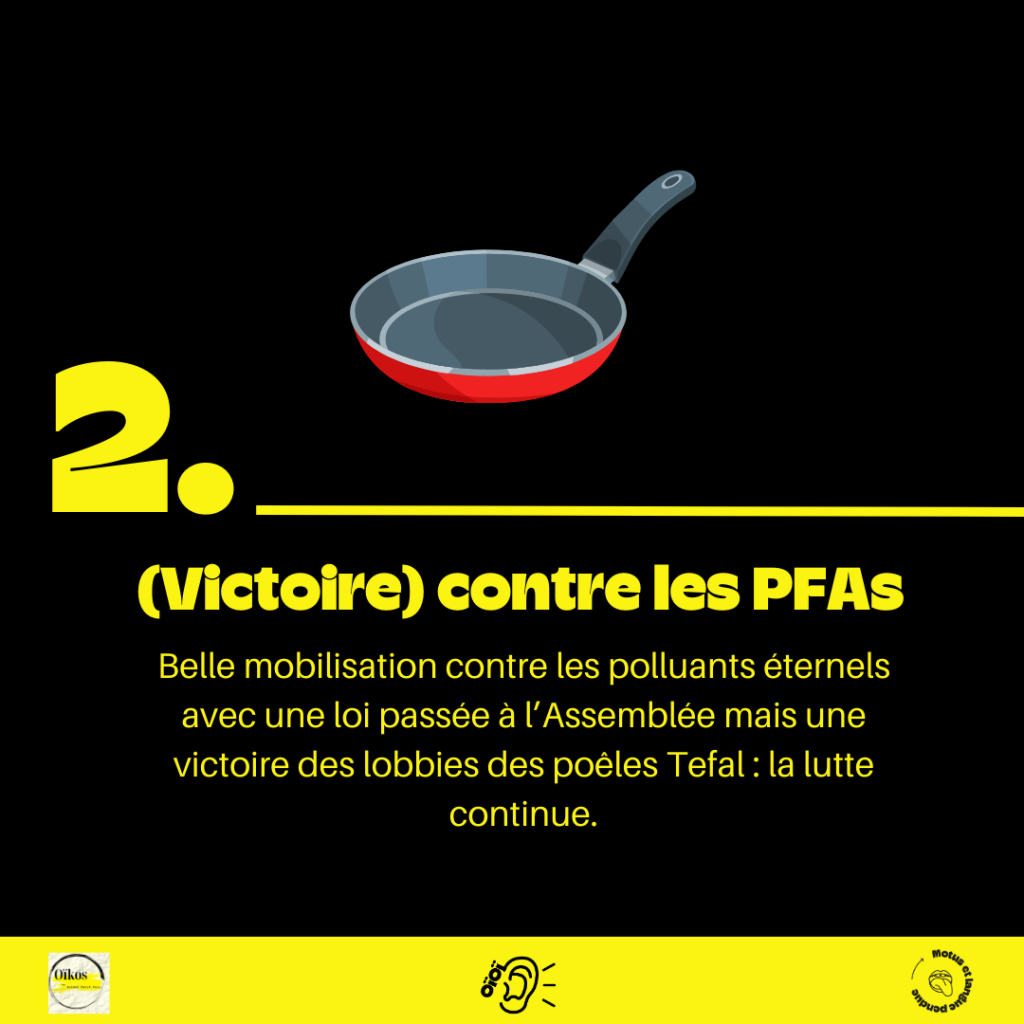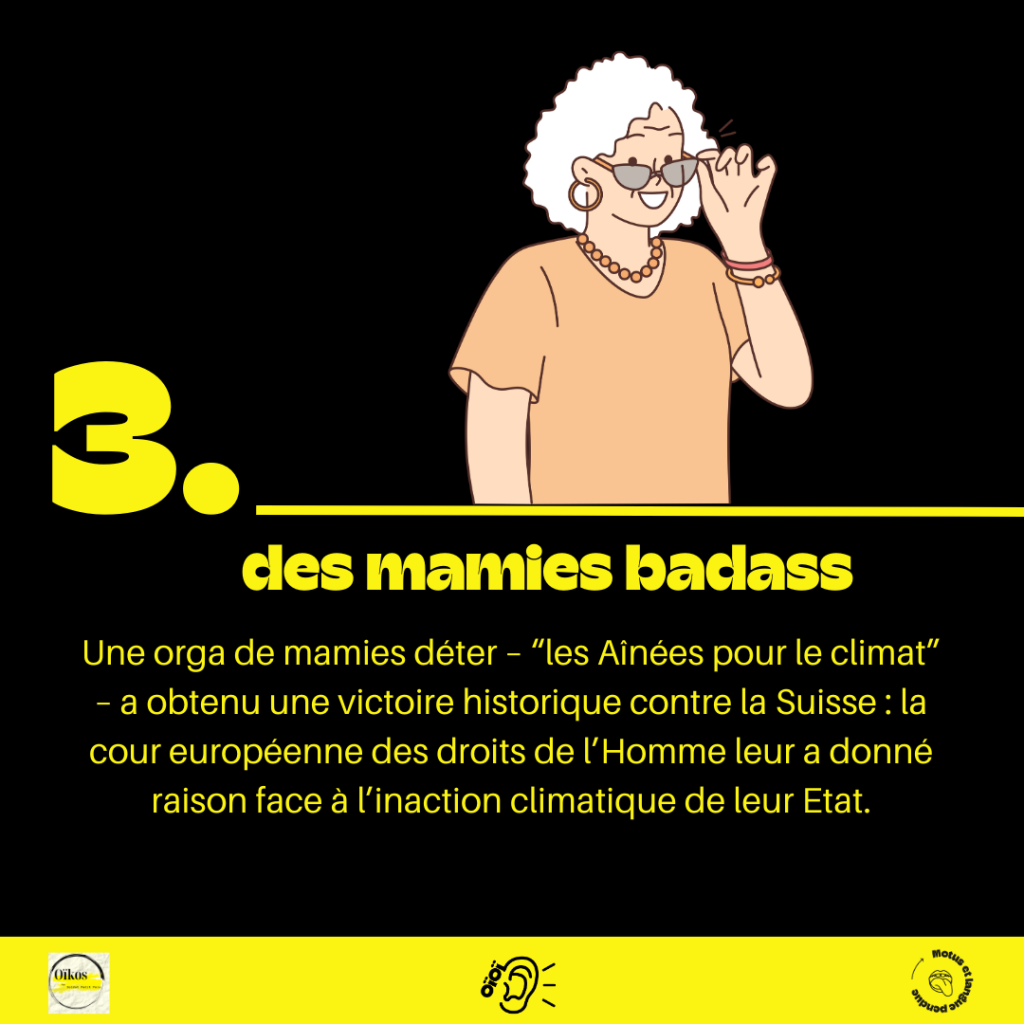Motus & Langue Pendue - Un journal intime de la société, avec des contenus situés quelque part entre l’art, la discussion entre potes et le journalisme.
Texte intégral (874 mots)
Propos de Gabriel Mazzolini recueillis par Charlotte Giorgi

À l’occasion du lancement de notre livre Si vous êtes calmes vous faites partie du problème (disponible uniquement sur Ulule en précommandes pendant le mois de mai 2024), nous avons interrogé différentes personnalités pas calmes qui nous inspirent au quotidien par leurs idées et leurs actions. Pour cette deuxième semaine de notre campagne de préventes, Gabriel Mazzolini, activiste écolo est notre invité.





Texte intégral (560 mots)
Soldat Petit Pois

« Stop à la consommation ! Vive le manque ! Pourquoi ces slogans sont-ils martelés à la fois par des écologistes et des pétroliers ? Voici l’histoire cachée d’un compagnonnage souterrain : depuis cinquante ans, les milieux économiques instrumentalisent une fraction de l’écologie politique, profitant de la confusion entre sobriété et austérité.
À l’heure où le changement climatique s’aggrave, l’écologie doit s’affranchir de ces instrumentalisations. Cette analyse inédite en fournit les clés. »
Voilà ce que vous pouvez lire au dos d’un livre qui a été l’une de mes lectures préférées de cette année. Ce livre il s’appelle « L’ère de la pénurie, capitalisme de rentes, sabotages et limites planétaires » et il est signé Vincent Ortiz, que j’ai le plaisir de recevoir aujourd’hui sur Oïkos pour vous expliquer tout ce schmilblik. Ce qu’il y a à comprendre, c’est que bien du monde a aujourd’hui a intérêt à parler de crise écolo, contrairement à ce qu’on croit. Et que d’autres ont intérêt à opérer une vraie transition, mais ne sont pas celleux qu’on croit, et n’utiliseraient pas forcément les mêmes mots. Si ça ne vous éclaire pas beaucoup pour l’instant, je vous invite vraiment à rester écouter cet épisode avec nous, çar je vous promets que vous allez comprendre l’arnaque dans laquelle on est bel et bien en train de s’enfoncer alors que l’écologie est réappropriée de tous les côtés, et qu’on a l’impression de progresser quand on patauge dans la semoule.
Vincent est docteur en économie et rédac chef de l’excellent média Le Vent Se Lève, un média d’opinion indépendant qui a pour ambition de faire vivre le débat intellectuel et de travailler à la refondation de la pensée progressiste.
C’est exactement ce que Vincent s’est attelé à faire à mon micro pendant que je lui posais mes questions bêtes, pour être sûre de tout traduire avec nos mots et que les pensées et stratégies complexes puissent être accessibles à un maximum de personnes.
Texte intégral (1108 mots)
Propos d’Alexia Soyeux, recueillis par Charlotte Giorgi

À l’occasion du lancement de notre livre Si vous êtes calmes vous faites partie du problème (disponible uniquement sur Ulule en précommandes pendant le mois de mai 2024), nous avons interrogé différentes personnalités pas calmes qui nous inspirent au quotidien par leurs idées et leurs actions. Pour la première semaine de notre campagne de préventes, Alexia Soyeux est notre invitée.







Lire plus (239 mots)
Par Charlotte Giorgi

1 an et 1 mois tout pile après la manif de Sainte-Soline qui aura durablement traumatisé les militant·es écolos, Charlotte Giorgi revient sur les leçons tirées pour les mouvements sociaux français, au micro de notre podcast Vacarme des Jours.
Texte intégral (505 mots)
Par Soldat Petit Pois

Vous le savez le but d’Oïkos, c’est de recevoir au micro des gens qui incarnent l’écologie dans le paysage politique et militant, de mille manières différentes. Mon invitée du jour a une parole un peu différente de celles des copains activistes qui se tiennent le plus possible éloigné des institutions. Valérie a co-fondé Green Lobby, et dans cette entreprise on parle aussi bien de « KPI » que de bifurcation écologie et sociale, de « disrupter les marchés » que de changer le système, et aussi bien aux ONG qu’aux commissions parlementaires. Pendant toute sa carrière, économiste et juriste de formation, Valérie a utilisé le système pour le détricoter. De l’Assemblée à la commission européenne, de cabinets ministériels au WWF en passant par la ville de Paris, elle maîtrise le langage politique et institutionnel qui nous fait parfois défaut. Elle connaît le public et le privé, et les subtilités des rapports de force au coeur du pouvoir. Et, comme le loup au milieu de la bergerie, elle compte bien mettre ce qu’elle a appris au service de l’écologie, en se fondant au milieu des dominant·es, sans angélisme ni moralisme, mais bien en poussant, grâce à Green Lobby, la politique au sens noble du terme.
_
Nous soutenir
Motus & Langue : https://motusetlanguependue.fr ; sur Instagram @motuslemedia & sur LinkedIn Motus le média
Pour nous contacter: oikoslepodcast@gmail.com
Green Lobby : https://greenlobby.org/
Texte intégral (593 mots)
Par Soldat Petit Pois
Dans notre format OïOï, retrouvez toutes les deux semaines en podcast, les dernières actualités écolos. Cette semaine au programme…
Lire plus (453 mots)
Par Soldat Petit Pois

Je suis ravie de vous retrouver dans un nouvel épisode d’Oïkos aujourd’hui pour causer d’un gros sujet.
Parce que bon, ok on n’a plus de retraites, on n’a plus de chômage, on n’a plus de système de santé, et malgré tout ça on est quand même en déficit, mais attendez y’a quand même un truc qu’on a… C’est les JO!
J’arrête là la blague, parce qu’en vrai c’est plus que pas marrant. Les JO, c’est quasiment une catastrophe. En plus d’être des jeux de riches, loin de l’image populaire qu’on tente d’en donner, ce sont aussi des jeux qui saccagent sur leur passage la vie de pauvres. Des espaces naturels, des logements, une certaine image de la ville et de nos vies ensemble. Si vous pensez que ce n’est que passager et qu’il suffira de partir en vacances pour éviter les bouchons dans les transports parisiens, détrompez-vous. L’impact des jeux pourrait bien durer, et ricocher sur nos combats à nous. C’est ce que va vous expliquer Ana, du collectif Saccage 2024, dans cet épisode. Sur leur site on peut lire :
« Nous nous opposons aux saccages écologiques et sociaux que provoquent les Jeux Olympiques de Paris en 2024. Nous, habitant-e-s de Seine-Saint-Denis et de ses alentours, associations et collectifs, sommes rassemblé-e-s pour défendre les espaces que l’on habite, où l’on se rencontre, on tisse des liens, on s’entraide et on s’amuse. »
Bonne écoute de ce nouvel épisode d’Oïkos, notre podcast écolo!
Lire plus (261 mots)
Par Charlotte Giorgi

Charlotte a fait partie des gauchistes qui a trouvé qu’Hugo Clément faisait une très mauvaise compromission en allant débattre chez les fachos de Valeurs Actuelles.
Elle fait aussi partie de celleux qui trouve que Victoire Tuaillon a fait un très bon compromis en allant débattre chez Finkielkraut.
Peut-être parce qu’elle affectionne Victoire Tuaillon. Ou alors, peut-êtreparce que la question « faut-il débattre avec les réacs » n’est pas si « vite répondue » que ça…
On en parle dans le dernier épisode de notre podcast Vacarme des Jours, dispo sur toutes les plateformes.
Bonne écoute!
Lire plus (242 mots)
Par Soldat Petit Pois

À l’occasion du Podcasthon, un rassemblement de plusieurs centaines de podcasts qui consacrent un épisode à l’association de leur choix pour inciter au don, je vous parle de résistance palestinienne, parce que ce qui s’y joue a tout à voir avec l’écologie...
Faire un don : https://urgence-palestine.com/
Texte intégral (595 mots)
Dans notre format OïOï, retrouvez toutes les deux semaines en podcast, les dernières actualités écolos. Aujourd’hui au programme…
Reporterre
Bon Pote
Actu-Environnement
Amis de la Terre
Aspas
Biodiversité-sous-nos-pieds
Bloom
Canopée
Décroissance (la)
Deep Green Resistance
Déroute des routes
Faîte et Racines
Fracas
France Nature Environnement AR-A
Greenpeace Fr
JNE
La Relève et la Peste
La Terre
Le Sauvage
Limite
Low-Tech Mag.
Motus & Langue pendue
Mountain Wilderness
Negawatt
Observatoire de l'Anthropocène
Présages
Terrestres
Reclaim Finance
Réseau Action Climat
Résilience Montagne
SOS Forêt France
Stop Croisières