09.12.2025 à 21:45
« La gauche s’est-elle perdue ? » avec Nathalie Heinich, François Bégaudeau et Aude Lancelin

Lire plus (138 mots)
Dans le dixième épisode de l’Explication, Aude Lancelin et François Bégaudeau ont reçu le 9 novembre, la sociologue Nathalie Heinich. Une figure intellectuelle passée de Pierre Bourdieu à Pierre Nora, qui prend régulièrement position sur les sujets brûlants du débat public. Contre le mariage pour tous, contre le néo-féminisme, contre l’islamo-gauchisme, contre le wokisme, Nathalie Heinich prend parti, signe des tribunes, lance des observatoires. En 2025, elle publie aux éditions Gallimard « Penser contre son camp », un essai dans lequel elle revendique la liberté de s’opposer aux idées du milieu progressiste dont elle se revendique pourtant encore. Ses prises de position, souvent situées à contre-courant de la gauche dite « radicale », sont au cœur d’un échange franc pour tenter de se comprendre
05.12.2025 à 12:34
Lauren Bastide : « La solitude, nouvelle conquête des femmes »

Texte intégral (2283 mots)
Les femmes seules ont le droit d’être heureuses clame haut et fort Lauren Bastide dans Enfin seule (Allary éditions). Encore faut-il qu’elles puissent se départir des peurs – celles d’être une mauvaise fille, d’être célibataire, de devenir folle…- qui leur ont été inculquées au fil des siècles. Dans une invite à ses sœurs en solitude, car le livre est aussi celui de sa propre histoire, l’essayiste les déboulonne une à une, et plaide pour « l’enfinsolitude« , néologisme désignant la cohabitation sereine avec soi-même.

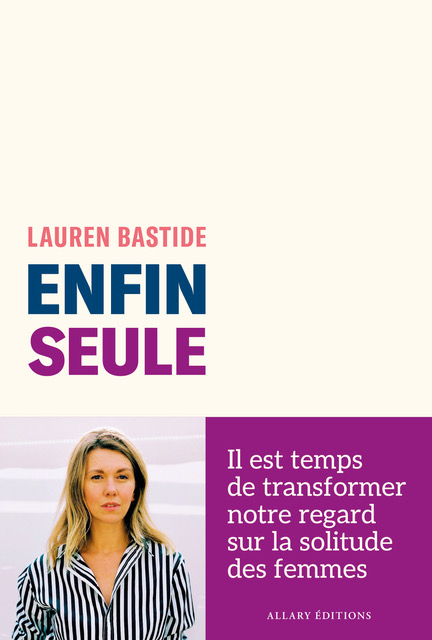
À quoi les mots « femme seule » renvoient-ils ?
On parle tout d’abord d’une réalité massive. En France aujourd’hui, 11 millions de personnes vivent seules. Parmi elles, 6 millions sont des femmes. Or, et c’est l’une des raisons pour lesquelles j’ai écrit ce livre, il existe un décalage entre cette réalité et ses représentations, lesquelles continuent de renvoyer la solitude des femmes à une forme d’échec convoquant immédiatement l’imaginaire de la célibataire malheureuse attendant le prince charmant. Le temps est venu d’éradiquer ces représentations.
La définition du féminin par l’intime n’explique-t-elle pas leur persistance ?
Aux femmes, la sphère intime, aux hommes, la sphère publique, c’est en effet la fracture originelle. Tous les ressorts sexistes reposent sur l’injonction à la reproduction et au soin, mais aussi sur une privation de l’espace public, renvoyées aux femmes. Quand on tape « homme seul » dans un moteur de recherche, on va trouver quantité d’articles vantant la solitude d’artistes, d’explorateurs, de scientifiques. Peu importe qu’ils soient mariés ou qu’ils aient des enfants. Ils sont dans leur bulle créative, cela, en soi, suffit à affirmer qu’ils sont seuls. C’est très intéressant. On ne parvient pas encore à imaginer que les femmes seules peuvent aussi être occupées à tisser du lien avec le monde et à créer des choses plus grandes qu’elles.
Quid des droits qui aujourd’hui sont pourtant les mêmes pour tous ?
Bien sûr, mais les droits sont récents, tandis que les représentations sont ancrées dans les mentalités depuis des siècles. C’est pour cela du reste que les références historiques sont nombreuses dans le livre. Il me semblait intéressant de mettre les choses en perspective. On a parfois tendance à oublier que les droits pour une femme d’avoir un compte en banque, d’être propriétaire de sa maison, de travailler, de gagner sa vie, ou encore de divorcer, n’ont que quelques décennies. Il est bon, de même, de rappeler que l’imaginaire de la vieille fille et la construction de la femme au foyer comme idéal féminin, ne sont pas si lointains. Aujourd’hui, les femmes ont une opportunité historique à saisir. Elles ont, comme jamais, le droit d’être seules comme elles l’entendent. Pour autant, la menace n’a pas disparu. Dans l’imaginaire et les discours de l’extrême droite, l’envie de naturaliser les femmes n’est jamais loin. Nous devons être extrêmement vigilantes.
Le premier enjeu de « l’enfinsolitude », cette solitude sereine, que vous appelez de vos vœux, n’est-il pas celui de l’égalité ?
L’égalité sur le plan matériel est en effet le premier enjeu. On pense immédiatement à Virginia Woolf qui dans Une chambre à soi écrit que pour qu’une femme puisse penser par elle-même, il faut qu’elle ait un lieu à elle et un revenu de 500 livres par an, ce qui représente environ 41.000 euros contemporains. Aujourd’hui, faute d’autonomie financière, beaucoup de femmes ne peuvent quitter un foyer où elles sont malheureuses. Cet aspect matériel ne peut être éludé. Mais je pense qu’il existe aussi une dimension psychique. C’est ce que révèlent les travaux de la sociologue Erika Flahault. Beaucoup de femmes sont autonomes, elles ont un travail, une maison, et n’ont plus ou pas l’obligation de prendre soin d’autres, et pourtant, elles peinent à se créer leur propre espace. C’est la chambre en soi autant que la chambre à soi qu’il faut arriver à construire.


Pour revenir à l’histoire, pouvez-vous nous parler de cette étonnante pionnière du féminisme qu’était Gabrielle Suchon ?
C’est une femme incroyable. Elle a publié en 1700 un ouvrage intitulé Du célibat volontaire, ou La vie sans engagement. Au 17ème siècle, pour les femmes appartenant à la petite bourgeoisie, ce qui était son cas, il n’y avait que deux options : le mariage forcé ou le couvent. Elle a préféré être envoyée au couvent. Mais à la quarantaine, elle s’en est échappée. La légende veut qu’elle soit allée trouver le pape en personne pour se faire relever de ses vœux. Elle a passé ensuite le reste de sa vie à écrire et à s’instruire dans la campagne près de Dijon. Et elle a donc écrit ce texte que l’on pourrait qualifier de pamphlet, mais qui, en même temps, est très calme et rationnel, ce qui le rend particulièrement touchant. Elle dit voyez comme je suis utile à ma communauté, certes je ne suis pas bonne sœur, je ne suis pas mère, mais je donne des cours de catéchisme, j’aide des bonnes œuvres, j’instruis, j’écris des textes, laissez moi vivre ma vie. Elle construit un argumentaire logique et implacable dans lequel elle démontre ce que Simone de Beauvoir dénoncera deux siècles et demi plus tard, à savoir qu’il n’y a aucune raison biologique de penser qu’une femme est moins capable d’écrire, de penser, et de s’instruire. Ce qui est un peu triste en revanche, c’est que ce texte a été publié à l’époque avec le cachet du roi. Cela montre qu’elle ne faisait pas peur. Personne ne voyait la subversion et la révolution politique qu’elle était en train de suggérer.
Ce chemin vers « l’enfinsolitude », c’est aussi le vôtre. La maison, et dans son sillage « la cabane », dont vous faites l’éloge, y occupent une place de choix. Quelle est cette maison rêvée ?
En commençant l’écriture de ce livre, je ne pensais pas passer autant de temps à réfléchir à la maison. Pourtant, il n’y a rien de plus logique puisque j’observe la solitude résidentielle et que j’habite moi-même seule. Historiquement, la maison est un lieu décrié dans les combats féministes. Dans les années 70, les féministes dénonçaient à juste titre l’enfermement domestique dans lequel les femmes se trouvaient. Mais aujourd’hui, la maison est aussi lieu où on va s’émanciper et apprendre à vivre seule. On ne peut donc pas complètement se départir des gestes du quotidien domestique. Il y au contraire une nécessité à les regarder différemment et à leur redonner une sorte de noblesse. Je cite des exemples tirés de la littérature avec entre autres des textes d’Annie Ernaux, de Maya Angelou, de Joan Didion. Ces femmes cuisinent, font le ménage, et en même temps, ces gestes s’insèrent dans leur pensée, leurs émotions, leur vécu.
Et la cabane ?
Je voulais réinventer ce concept de maison pour en faire quelque chose de plus ouvert, la cabane donc, qui n’est pas un lieu que l’on ferme à double tour, mais un lieu où on laisse entrer les amis, l’imaginaire, la nature. C’était aussi une façon de retourner vers l’enfance. J’ai eu ce déclic en voyant un jour une petite fille jouer chez moi et faire ce geste qu’enfant je faisais moi-même d’étendre un drap entre deux chaises et de se mettre en dessous avec son gouter et sa bande dessinée. J’ai compris que ce geste était existentiel. C’est celui d’avoir le droit d’être dans sa bulle et de se dérober au regard adulte. Il me semble que c’est cette cabane qu’il faut réussir à construire plutôt que cet idéal du foyer composé de la famille nucléaire qui au fond est plutôt un siège de violences pour les femmes et les enfants.
Vous avez longtemps pensé que la solitude était à la fois une cachette mais aussi une punition – avec en creux, cette idée de la folie associée, aussi, à la femme seule – puis vous avez compris qu’être seule, c’était se soigner. Pouvez-vous nous expliquer ?
Camille Claudel, Sylvia Plath, Virginia Woolf, Zelda Fitzgerald… on ne compte pas le nombre de femmes célèbres assignées à la folie parce qu’elles voulaient écrire, créer et être seule dans leur atelier. Je pense que j’ai été imbibée de cela. J’avais l’impression qu’il fallait que je me cache, et que ce besoin de me dérober au regard de l’autre était pathologique et révélait un dysfonctionnement. Or, en faisant des recherches, j’ai vu que la solitude, quand elle était choisie, pouvait être une possibilité de rencontre apaisée avec soi-même. Il y a cette très belle phrase célèbre d’Hannah Arendt que je cite dans le livre : « Quand je suis seule, je ne suis pas seule, nous sommes deux, parce que je me parle à moi-même ». Il est d’autant plus important pour les femmes de créer cet espace de dialogue avec un soi authentique qu’elles sont encouragées – notamment à partir de l’adolescence, la psychologue et philosophe Carol Gilligan le dit très bien – à effacer leur voix authentique au profit d’une voix sociale conforme aux attentes patriarcales.
Cette solitude-là est le contraire de l’isolement. Vous écrivez qu’elle renouvelle, régénère le lien aux autres…
« L’enfinsolitude » est un ancrage dans le monde. Elle donne la possibilité de s’ouvrir aux autres de façon beaucoup plus saine, mature, et joyeuse que dans les relations de dépendance. Aujourd’hui, cette faculté d’être seule et de m’auto-suffire sur le plan émotionnel et affectif me permet de nouer des relations amoureuses et amicales évidentes et fructueuses.
Propos recueillis par Anne-Sophie Barreau
Lauren Bastide a créé le podcast féministe « La Poudre » (2016-2023) dans lequel elle faisait place aux voix des femmes (écrivaines, artistes, chercheuses, militantes). Elle anime aujourd’hui le podcast « Folie Douce » sur la santé mentale. Elle est l’autrice de: « Présentes » (Allary Éditions 2020) et « Futur.es » (Allary Éditions 2022)
04.12.2025 à 16:34
L’affaire Jean de la Rochebrochard : une omerta médiatique

Texte intégral (1398 mots)
Depuis l’affaire Weinstein fin 2017, naissance du mouvement Me Too, de nombreux médias et journalistes montent volontiers au créneau dès qu’il s’agit de documenter et de dénoncer les violences sexuelles et sexistes. Il n’en est que plus surprenant d’assister à une omerta spectaculaire depuis la publication de l’enquête exclusive de QG, jeudi 20 novembre 2025, dévoilant les témoignages de victimes présumées de Jean de la Rochebrochard, figure influente de la Tech française et proche collaborateur de Xavier Niel.
En 15 jours, aucun journaliste, aucune agence de presse, aucun média, qu’il soit généraliste ou familier de l’écosystème des start-ups, n’a donné le moindre écho à cette enquête qui révèle pourtant de graves accusations et même une plainte pour viol déposée en 2024. Le managing partner de Kima Ventures, le fonds d’investissement de Xavier Niel, qui finance de très nombreuses structures à hauteur de centaines de milliers d’euros, a pourtant été entendu par la police le 4 novembre dernier à ce sujet, ainsi que nous l’avons révélé. Jean de la Rochebrochard avait longuement répondu à nos questions envoyées dans le cadre du contradictoire.

Ces informations exclusives ont au demeurant été directement transmises aux rédactions susceptibles d’y consacrer un travail approfondi, tant le sujet relève de l’intérêt général. De nombreux pôles d’enquêtes spécialisés dans les violences sexistes et sexuelles ont ainsi été informés de l’existence de ces témoignages. Quelques journalistes nous ont même contactés après la publication, certains surpris, d’autres nullement étonnés. Mais à l’heure où nous écrivons, aucun d’entre eux n’a publié la moindre ligne à ce sujet. Selon nos informations, un grand média national enquêtant depuis des mois de certaines des accusations visant Jean de la Rochebrochard, n’avait pas été jusqu’à sortir un article au motif qu’aucune plainte n’avait encore été déposée. Ce même titre de presse demeure discret à ce jour malgré la parution de nos informations.
Fort heureusement, plusieurs associations féministes engagées dans la lutte contre les violences faites aux femmes et certains comptes très populaires ont diffusé ces révélations sur leurs réseaux sociaux, parmi lesquels la Fondation des Femmes, via sa présidente Anne-Cécile Mailfert, NousToutes ou encore Balance Ta Start-up, qui travaille à la libération de la parole dans ce milieu très masculin.
S’agissant d’un personnage aussi puissant dans l’écosystème de la Tech, proche collaborateur de la 7ème fortune de France, comment expliquer dès lors un tel désintérêt des médias d’information ? Tous les mois des affaires touchant des personnalités dotées d’une influence bien moindre, sont pourtant révélées par ces mêmes rédactions, parfois même hors de l’existence de toute plainte. Une telle rétention d’information est-elle à relier au poids de l’empire de Xavier Niel dans la presse ?
On le sait, ce dernier investit en effet massivement dans le secteur de l’information. Il est actionnaire à titre individuel du groupe Le Monde comprenant Le Monde, Le Nouvel Obs, Télérama, Courrier International et La Vie, mais aussi de journaux d’investigation comme l’Informé. Le fondateur de Free détient également des parts dans Le HuffPost et Nice-Matin, et a investi des centaines de milliers d’euros aux débuts de Mediapart (il ne figure plus parmi les actionnaires du titre en 2025), Brut, ou Les Jours. Du côté de la télévision, il a cofondé en 2015, avec Matthieu Pigasse et Pierre-Antoine Capton, le groupe Mediawan, producteur de nombreuses émissions à l’instar de C à Vous sur France 5 ou Hot Ones sur Canal +.
Outre ses nombreuses participations financières, Xavier Niel alimente notoirement tout un réseau de médias en informations exclusives, ouvrant la voie à une certaine dépendance informationnelle. L’homme d’affaires bénéficie aussi, en termes d’image, de sa relation avec Delphine Arnault, PDG de Christian Dior, la fille de Bernard Arnault avec laquelle il forme un « couple de pouvoir » particulièrement influent. Involontairement ou non, ce rayonnement peut inciter certaines rédactions à l’auto-censure. Le groupe LVMH, propriété de Bernard Arnault, pèse en effet lourdement sur les budgets publicitaires d’une presse nationale en grande difficulté comme le démontrait L’Informé, le 15 novembre 2024. Nous savons, de source sûre, que l’affaire « Jean de la Rochebrochard » a ainsi été refusée par un média national, dont la publicité LVMH assure la viabilité économique, la direction craignant de perdre des budgets, à cause de la relation familiale entre les deux milliardaires.
Face à la gravité des accusations portées, il était légitime de s’attendre à ce que les révélations de QG soient reprises par nos confrères et consoeurs, y compris dans des médias proches du patron de presse qui finance Jean de la Rochebrochard, puisque cela leur permettait de les relayer sans prendre le risque d’enquêter eux-mêmes.

Pendant que l’enquête de QG circule dans de nombreuses boucles, reprise et commentée par l’ensemble du réseau de la Tech, et que de nombreux acteurs du milieu s’étonnent de son faible écho médiatique, l’investisseur poursuit ses activités. Jean de la Rochebrochard donne encore des conférences aux Etats-Unis et se met en scène à Saint-Barthélémy, non sans aplomb, dans un silence médiatique complet qui ne laisse pas de sidérer. Xavier Niel, lui, ne s’est toujours pas exprimé.
Louison Lecourt
02.12.2025 à 22:52
« La France à la veille du jugement dernier » avec Emmanuel Todd et Aude Lancelin
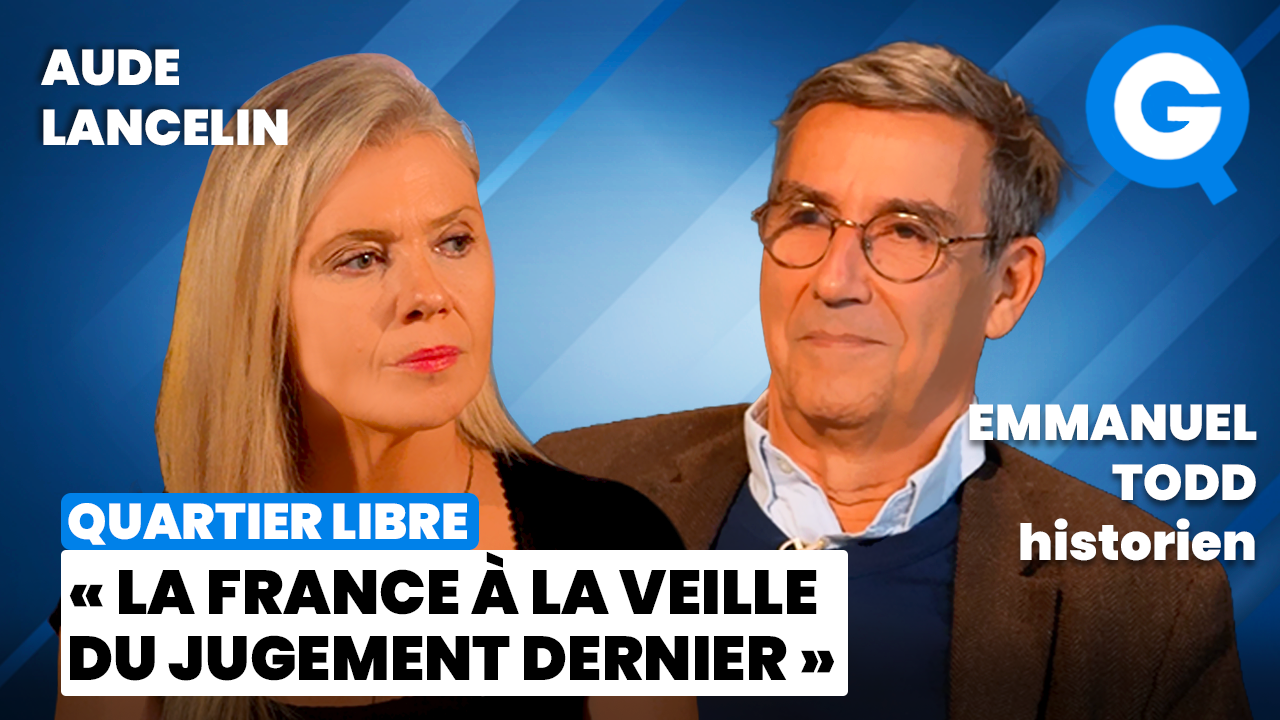
Lire plus (160 mots)
Avec la complicité du pouvoir et de ses oppositions politiques, notre pays est entré en état de décomposition terminale. Perte de souveraineté à tous égards, déclassement international, gérontocratie irresponsable qui verbalise même désormais l’idée de « perdre ses enfants » dans des guerres ingagnables à l’échelle monstrueuse, nous approchons du point où nous ne pourrons plus nous raconter d’histoires sur nous-même. Quand et comment éclatera cette bulle d’irréalité qui nous conduit au désastre dans tous les domaines ?
Pour évoquer la situation critique qui se précise pour la France, Aude Lancelin a reçu Emmanuel Todd pour un long entretien le mardi 2 décembre en direct. Historien, démographe, auteur de nombreux best-sellers, parmi lesquels « La Défaite de l’Occident » (Gallimard) et figure du débat d’idées français traduite dans le monde entier.
26.11.2025 à 23:43
« Macron : la stratégie du chaos » avec Aude Lancelin, Marc Endeweld et Harold Bernat

Lire plus (166 mots)
Dans ce clair-obscur où surgissent les monstres, Emmanuel Macron, fils légitime de Nicolas Sarkozy le multirécidiviste condamné et de François Hollande, héritier d’un socialisme zombie, trouve toute sa place. Alors que la France perd les clés de son destin, nous assistons au spectacle affligeant d’une fin de régime prête à tout, jusqu’au chantage à la guerre contre une puissance nucléaire. Affaiblie par les choix délétères d’une élite indigne, la France est piégée dans les nouveaux affrontements géopolitiques, tandis que les Français subissent les manipulations macronistes — un piège national dans celui, plus vaste encore, d’une mondialisation qui n’a plus rien d’heureuse.
Pour en parler, Aude Lancelin et Harold Bernat ont reçu le 26 novembre Marc Endeweld, journaliste d’investigation reconnu. Ils ont évoqué ensemble la stratégie du chaos d’un Macron en bout de course.
24.11.2025 à 21:20
« L’histoire face à la police des opinions » avec Olivier Le Cour Grandmaison et Aude Lancelin
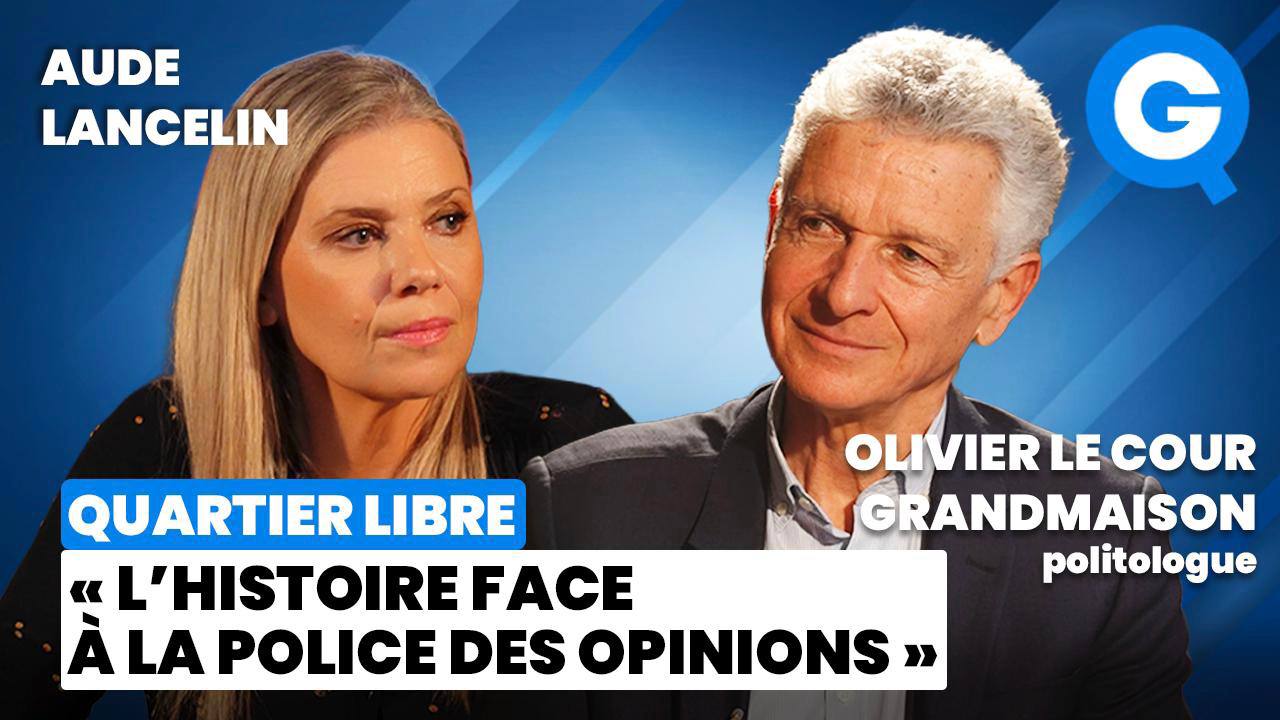
Lire plus (165 mots)
Le grand blacklash réactionnaire à l’œuvre en France depuis plus d’une vingtaine d’années se poursuit à un rythme effréné : glorification d’un passé français présenté comme émancipateur pour les peuples colonisés, appel au sursaut moral des « honnêtes gens », et chasses aux sorcières lancées contre des chercheurs, intellectuels et journalistes rétifs à ces discours régressifs, relayés abondamment par les médias d’extrême droite. Pour en parler, Aude Lancelin a reçu lundi 24 novembre Olivier Le Cour Grandmaison, enseignant en sciences politiques et philosophie à l’université Paris-Saclay. Il publie cet automne « La fabrique du roman national-républicain » (Amsterdam) et « Oradour coloniaux français » (LLL), inspiré par l’éviction violente de Jean-Michel Aphatie de RTL pour avoir rappelé des vérités incontestables sur les massacres commis par l’armée française lors de la conquête de l’Algérie.
20.11.2025 à 12:24
Me Too dans la Tech: l’enquête exclusive

Texte intégral (4968 mots)
« Quand j’ai entendu parler de la plainte pour viol, j’ai eu les poils qui se sont dressés, témoigne Nora* en s’effleurant le bras dans ce café du Marais. Car je pense avoir évité ça de peu. »
Le 7 juin dernier, cette entrepreneuse d’une trentaine d’années, a accepté de livrer son témoignage à QG. Après avoir appris l’existence d’une plainte pour viol, elle parvient à mettre des mots sur le harcèlement sexuel qu’elle affirme avoir subi de la part de Jean de la Rochebrochard, l’une des figures les plus influentes de la Tech française. Sur le moment, elle n’en a parlé qu’à son petit ami par message, une conversation que QG a pu consulter. Depuis, elle s’en est ouverte à d’autres.
Jean de la Rochebrochard est, depuis 2015, le managing partner de Kima Ventures, le fonds d’investissement (capital-risque) de la 7ème plus grande fortune de France, Xavier Niel. C’est l’un des fonds français les plus actifs dans le domaine. Très présent sur les réseaux sociaux, et toujours entre plusieurs voyages d’affaires à Londres ou New York, Jean de la Rochebrochard s’affiche régulièrement, jovial, dans une villa idyllique à Bormes-les-Mimosas ou en pleine séance de sport, tout en vantant sa force de travail exceptionnelle.
Un branding parfaitement maîtrisé : le « family guy », père proche de sa famille nombreuse, et coach de vie entrepreneuriale devenu une figure très médiatisée de la Tech française. Il est la personne à voir et à convaincre pour tout acteur de la start-up Nation de passage à Paris. Toutefois, derrière cette image « d’homme parfait » se dessinent des zones d’ombre.
« J’étais de plus en plus stressée, tant au niveau professionnel que personnel »
« C’était il y a un an et demi », se lance Nora*, dans le brouhaha matinal du café. Elle commence à échanger pour des raisons professionnelles avec Jean de la Rochebrochard, alors codirecteur du fonds d’investissement New Wave, acquis depuis octobre 2024 par Xavier Niel.

Un mois plus tard, changement de ton, celle-ci reçoit divers textos et messages WhatsApp de plus en plus familiers et insistants que QG a pu consulter. Nora évoque aussi des photographies de plus en plus explicites. Notamment l’une d’entre elles, quelque peu ambigüe : un selfie montre ainsi le quadragénaire portant des lunettes de soleil réfléchissantes dont le reflet aurait laissé deviner sa nudité. « J’étais de plus en plus stressée, tant au niveau professionnel que personnel, se souvient Nora. Lui était de plus en plus flirty (dragueur). » Alors qu’il est en déplacement à Paris, il lui propose d’aller boire un verre dans le bar du grand hôtel où il séjourne afin d’échanger sur leur collaboration. Une invitation qu’elle accepte.
Un business angel pas tout à fait angélique
Et là, la situation dérape. Nora raconte qu’il lui aurait lancé, bravache : « Il faut que j’aille faire mon check-in, tu m’accompagnes ? » Elle trouve cette proposition déjà suspecte à ce stade, lui étant sur place depuis au moins trois heures, affirme-t-elle. Mais gros enjeu financier oblige, elle ne peut pas risquer de perdre un rendez-vous d’affaires avec Jean de la Rochebrochard et accepte de le suivre.

Elle relate ensuite que le célèbre business angel aurait prétendu devoir se rendre dans sa chambre d’hôtel pour y déposer son sac, tout en l’y conviant. La jeune entrepreneuse se retrouve face à un dilemme. Refuser impliquerait de le soupçonner d’être mal intentionné et risquerait de mettre un terme à leur relation professionnelle, nous raconte-t-elle. Lit défait et caleçon en guise de décoration. Incommodée et inquiète, elle l’attend près de la porte. « Il est alors venu précipitamment vers moi. J’ai mis mes deux mains en avant pour créer de la distance. Il me les a attrapées, confie Nora, interdite au moment des faits. J’étais contre le mur. Il m’a regardée dans les yeux et m’a dit “Just us”. J’ai eu si peur, c’était vraiment un creepy feeling (sensation glauque, oppressante, NDLR). »
Elle aurait alors feint de ne pas comprendre la situation pour sortir dès que possible de la pièce. Ce dernier finit par accepter de quitter la chambre. Dans le couloir, la jeune femme parvient à le photographier de dos à deux reprises, pour garder une trace de ce moment qu’elle ressent comme anormal. QG a pu consulter ces photos. Une fois dans l’ascenseur, il serait resté entreprenant et l’aurait même prise dans ses bras, raconte Nora.
Des rendez-vous d’affaires dans une chambre d’hôtel
Ils finissent, malgré cet événement inapproprié, par mener le fameux rendez-vous professionnel au bar, durant environ quarante-cinq minutes. « J’étais complètement en pilote automatique, livre-t-elle. Je voulais juste rentrer chez moi. » Spirale sans fin, il aurait insisté pour la raccompagner. « Rentrée, j’ai ressenti un immense soulagement » souffle-t-elle. Après cet épisode, Jean de La Rochebrochard aurait continué à lui adresser des avances par messages, tout en lui demandant de ne pas ébruiter cette rencontre auprès des personnes qu’ils connaissaient tous deux.
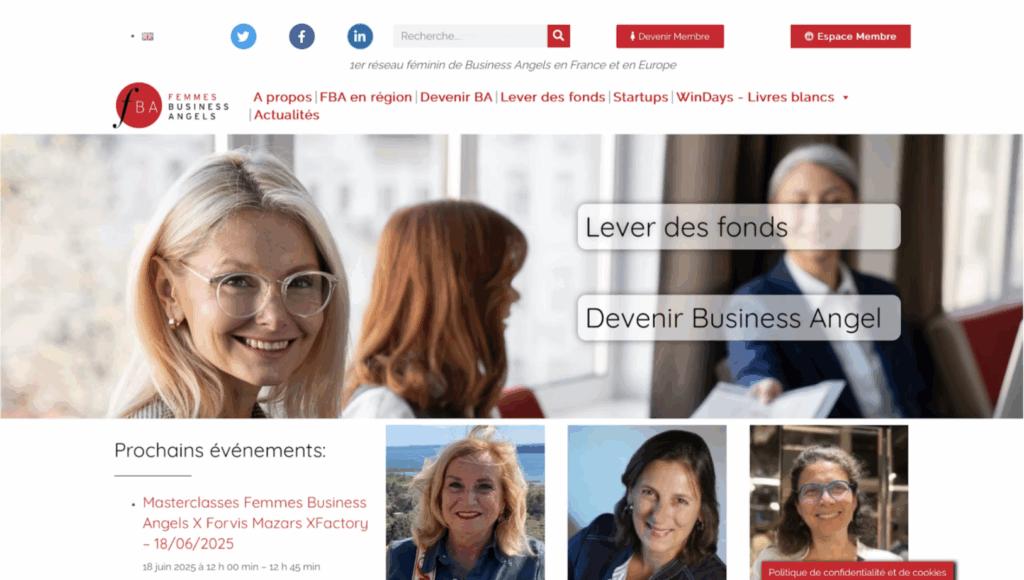
Au moins deux autres femmes racontent avoir été attirées de la même manière dans la chambre d’hôtel de Jean de La Rochebrochard, alors qu’un simple rendez-vous professionnel était initialement prévu.
Clémence*, investisseuse dans une autre structure que lui, affirme avoir été invitée dans son hôtel, dans le sud de la France, en 2020, pour prendre un verre. QG a pu consulter les messages attestant de cette invitation, mentionnant le nom de l’établissement. Selon le témoignage de la femme d’affaires diplômée des grandes écoles, il lui aurait ensuite proposé de monter avec lui dans sa chambre afin de recharger son téléphone. Mal à l’aise, car ils se connaissaient très peu, elle assure que, cette fois, rien ne se serait produit et qu’il ne serait pas allé au-delà de cette invitation déconcertante.
« J’étais dans un état de grande vulnérabilité dans ma vie »
En décembre 2022, des faits extrêmement graves se seraient en revanche déroulés. « J’étais dans un état de grande vulnérabilité dans ma vie », confie Juliette * à QG en revenant sur cette période difficile de sa vie. Jeune entrepreneuse, elle se serait vue proposer à plusieurs reprises de « pitcher » son projet à l’hôtel par Jean de La Rochebrochard. Deux fois directement dans sa chambre.
Juliette accuse l’investisseur de lui avoir imposé une relation sexuelle lors du dernier rendez-vous « d’affaires » prétendu. Deux ans plus tard, en octobre 2024, l’entrepreneuse décide de porter plainte pour viol. La jeune femme, que nous avons rencontrée à Paris, ne souhaite pas s’exprimer à visage découvert, « tant que l’enquête est en cours ». Jean de la Rochebrochard a été convoqué par la police le 4 novembre 2025 dans le cadre de cette plainte. D’après nos informations, plusieurs autres personnalités sont actuellement entendues par la police. Nous avons pu nous entretenir avec certaines d’entre elles.
« Quand j’ai entendu parler de la plainte pour viol, j’ai eu les poils qui se sont dressés, mime Nora en s’effleurant le bras. Car je pense avoir évité cela de peu. La différence, je pense, c’est que j’ai un réseau important, je connais du monde, ça rendait sans doute la situation plus dangereuse pour lui. » L’entrepreneuse affirme avoir eu à cet instant, la confirmation que ce qu’elle avait vécu n’était pas un cas isolé, alors qu’elle repensait souvent à ces événements « traumatisants ».
« Bon père de famille », « mentor »… ses proches se déclarent très surpris
Pourtant, Jean de la Rochebrochard cultive une image familiale chaleureuse. Nous avons pu rencontrer son ex-femme, avec qui il a partagé vingt ans de sa vie et eu trois enfants. Leur relation s’est achevée à l’été 2024. Surprise par les témoignages relatés, elle livre une autre vision de l’homme : « Il était très romantique. Il s’est toujours très bien occupé des enfants. Il n’a jamais fait preuve de violence dans l’intimité, ni eu de comportements inappropriés. » *
Certains dans le monde de la Tech tombent également des nues. Florent *, ancien collaborateur de Jean de la Rochebrochard, souligne avoir été très étonné lorsqu’il a été mis au courant. Entendu par l’officier de police judiciaire en charge de l’enquête pour viol, il affirme auprès de QG avoir livré la version suivante: « J’ai travaillé avec Jean pendant plusieurs années et ça m’a choqué, surtout venant du “mec parfait”. C’est ma compagne qui a conseillé à Juliette *, l’une de nos meilleures amies, de porter plainte. Il n’y avait pas de doute pour nous. »
« Il se démerde pour isoler les femmes et ensuite il leur met la pression »
D’après les témoignages que nous avons pu recueillir, le business angel utiliserait la même stratégie à chaque occasion. Des entrepreneuses se verraient invitées dans un bar d’hôtel sous le prétexte d’un meeting professionnel. Et là, le même scénario inquiétant se mettrait en place. Tantôt un sac à déposer, tantôt un téléphone à recharger. « Il se démerde pour isoler les femmes dans sa chambre et ensuite il leur met la pression » affirme Mathias* , véritable célébrité dans le monde entrepreneurial depuis une dizaine d’années. Il poursuit : « J’en avais parlé sur les réseaux sociaux, sans mentionner son nom, mais pour alerter sur sa manière d’agir. » Mathias précise que son objectif était d’inciter les femmes à parler, et de leur montrer qu’elles n’étaient pas seules à avoir potentiellement subi ce qu’il décrit comme un « mode opératoire ».
Le professionnel de la Tech maintient que trois autres femmes (averties d’une enquête journalistique en cours, elles n’ont pas encore souhaité s’exprimer, NDLR) se seraient confiées à lui sur des comportements insistants et dépassant largement le cadre professionnel, de la part de Jean de la Rochebrochard. « Elles ont peur, car il est trop puissant, justifie Mathias. Elles ne veulent pas être blacklistées dans le milieu, c’est comme ça qu’il s’en sort ». Son influence est en effet considérable dans l’écosystème des start-ups.
Une influence immense dans la Tech
« Pour les gens qui se lancent dans l’entrepreneuriat, c’est le Graal d’obtenir un rendez-vous avec Xavier et Jean, raconte Clémence, également actrice dans ce domaine. Ils sont idolâtrés, notamment par ceux qui ne connaissent pas encore bien ce monde. » Chaque année, ce dernier investit, avec l’argent de Xavier Niel, dans une centaine de start-ups. Les enveloppes, comprises entre 100.000 et 200.000 euros pour chacune d’entre elles, sont vitales pour les boîtes qui se lancent. Il a notamment investi dans des sociétés innovantes et des applications populaires chez les jeunes telles que Bereal, Alan, Payfit ou encore Mistral IA.
Le « Père Noël » de la Tech, c’est ainsi que les entrepreneurs avec lesquels nous avons échangé décrivent le personnage. Une influence qu’il doit bien sûr à sa grande proximité avec le milliardaire Xavier Niel. L’hebdomadaire Challenges (propriété des milliardaires Claude Perdriel et Bernard Arnault, beau-père de Xavier Niel, NDLR) affirmait même en mai 2025 que si le PDG d’Iliad devait se présenter un jour aux présidentielles, rumeur de candidature qui demeure insistante, Jean de la Rochebrochard serait son « directeur de campagne ».
Le fondateur de Free mis au courant
Un lien qui perdure, alors même que Xavier Niel aurait été alerté de l’attitude de son protégé par certains collaborateurs. Selon nos informations, Rémy *, membre d’un groupe de presse dont Xavier Niel est actionnaire, s’est entretenu avec « X » à l’été 2024 après avoir recueilli le témoignage de Nora. QG a pu consulter la discussion Whatsapp entre Rémy et Nora.
« Of course. I’m sorry you had to go through this shit. It should never happen » (Bien sûr. Je suis désolé que tu aies dû vivre cette merde. Cela n’aurait jamais dû arriver, NDLR)
Nora l’interroge ultérieurement sur l’issue de la discussion et le quadragénaire lui répond : “I don’t think I was very impactful tbh and it was part of a larger conversation” (Je ne pense pas avoir eu beaucoup d’impact, pour être honnête et cela faisait partie d’une conversation plus large, NDLR)
Contacté par notre média, Rémy, qui travaille toujours au sein du groupe de presse, explique : « J’ai fait remonter à Xavier le fait que des histoires circulaient après le départ de Jean de La Rochebrochard du fond New Wave, sans mentionner l’histoire de Nora pour protéger son anonymat. » Selon lui, Xavier Niel aurait indiqué être au fait des « rumeurs Me Too (la plainte pour viol, n’avait pas encore été déposée, NDLR) », tout en précisant qu’il « gérait la situation ». À l’heure où nous publions, Jean de La Rochebrochard semble conserver toute la confiance du milliardaire et occupe toujours les mêmes fonctions au sein de Kima Ventures.
Un proche de la famille Trump aurait averti Xavier Niel
Autre lanceur d’alerte, ni plus ni moins que le beau-frère de Ivanka Trump, fille de Donald Trump. Xavier Niel s’est en effet rapproché de l’entourage du président des Etats-Unis en s’associant il y a près de trois ans à la société Thrive Capital, fondée par le businessman Joshua Kushner. Toujours proches, d’après nos informations, les deux hommes d’affaires ont dîné ensemble ce 5 novembre 2025 à Paris.

Xavier Niel avait même reçu une invitation pour la cérémonie d’investiture de Donald Trump en raison de cette proximité, ainsi que le révélait le Canard Enchaîné le 16 janvier 2025. Il n’y assistera pas, contrairement à sa compagne Delphine Arnault, fille du PDG de LVMH. Selon nos sources, en 2024 Joshua Kushner aurait également eu l’élan d’alerter Xavier Niel en apprenant les accusations dont Jean de la Rochebrochard faisait l’objet. Mais une fois encore, rien ne se passe. Contacté, Joshua Kushner n’a pas répondu aux sollicitations de QG. « Xavier est très attaché aux personnes avec qui il travaille, affirme l’ex-femme de Jean de la Rochebrochard. Je ne pense pas qu’il se séparerait de Jean comme ça.» *
« Putain, on en est là » se défend l’investisseur
Dans le podcast Off the Record de Silicon Carne, en date du 25 novembre 2024, Jean de la Rochebrochard s’exprime pour la première fois sur les accusations dont il est l’objet : « Moi, je me suis battu contre ça, les rumeurs de Me Too et de harcèlement, c’était aberrant. » Il poursuit : « La première semaine, t’es choqué, qu’on ose venir t’attaquer là-dessus, en te disant “putain, on en est là. On va essayer de te discréditer publiquement et on veut détruire ta vie.” C’était l’attaque la plus brutale à laquelle j’ai dû faire face », conclut-il.
A cette époque, il affronte de nombreux problèmes. Sans lien avec ces accusations, il se sépare houleusement avec son associée Pia d’Iribarne, qui dirigeait le fonds d’investissement New Wave dans lequel il était actionnaire minoritaire. Tout ce déballage public est l’occasion de constater le très important soutien dont il bénéficie sur les réseaux sociaux, comme en témoignent les nombreuses publications mentionnant son pseudo « 2lr » que nous avons pu consulter : « Full support Jean » ou encore « The Outpouring of love and support clearly demonstrates that at the end, good people ALWAYS win. 2lr » (« Le déferlement d’amour et de soutien démontre clairement que, à la fin, les bonnes personnes gagnent toujours. 2lr », NDLR).
Une vitrine publique extrêmement soignée
La popularité du personnage, et l’aura dont il jouit, rendent la situation très délicate pour ses accusatrices. Nora raconte ainsi même avoir été victime de discrédit de la part de Jean de la Rochebrochard après “l’affaire” de la chambre d’hôtel : « Il s’est vengé, quand cette histoire a commencé à circuler, en disant que je n’étais pas une personne de confiance, que je n’étais pas professionnelle, afin de discréditer par avance tout ce que je pouvais dire sur lui. » Une personnalité de la Tech nous confirme que Jean de la Rochebrochard a tenu des propos dénigrants sur Nora en sa présence.

Il soigne, par ailleurs, son vecteur principal de communication, Instagram, relayant ses passages dans les nombreuses émissions où il est invité, mais aussi ses exploits sportifs (« Jour -3 avant les championnats du monde IRONMAN »), ses conseils en développement personnel (« Si t’échoues, il faut rebondir »), ou encore ses leçons de stratégie marketing (« Ce que ton client veut, ce n’est pas toujours ce dont il a besoin. »). Très détendu, au bord de sa piscine, il y dispense aussi des recommandations pour trier les bons et les mauvais collaborateurs, indiquant lesquels mériteraient d’être mis à la porte. « Sundays are for emails, existential crises… and cleaning up your org (Le dimanche, c’est le jour des e-mails, des crises existentielles… et du nettoyage de ton organisation, NDLR ) ».
L’investisseur nie en bloc
Contacté par notre média, Jean de la Rochebrochard conteste formellement les accusations contenues dans cette enquête. Il affirme n’avoir jamais organisé de rendez-vous professionnel dans sa chambre d’hôtel ni envoyé des messages déplacés à plusieurs entrepreneuses. Il reconnaît l’existence d’une relation sexuelle avec Juliette en décembre 2022, mais affirme que celle-ci était consentie. Il ajoute ne pas avoir sollicité d’avocat dans le cadre de la plainte pour viol. L’investisseur voit la main de son ancienne partenaire en affaires, Pia d’Iribarne, derrière ces multiples accusations: « (Celles-ci) s’inscrivent dans la continuité d’une dynamique de discrédit engagée à mon encontre depuis le conflit professionnel lié à la séparation avec mon ex-associée. »
Contactée à ce sujet par QG, Pia d’Iribarne affirme : « Je n’ai personnellement jamais eu de problème de cet ordre avec Jean. Son départ de New Wave en 2024 n’avait aucun lien avec ces sujets (liés à Me Too, NDLR), dont j’ignorais l’existence à l’époque. J’ai tourné cette page et je suis concentrée sur l’avenir. » Juliette assure, par ailleurs, n’avoir jamais été conseillée ou influencée par cette dernière dans sa démarche de porter plainte. Les femmes qui ont témoigné dans le cadre de cette enquête n’appartiennent pas à la même entreprise, et vivent dans des pays différents, rien ne permet d’affirmer qu’une concertation a eu lieu entre elles.
Répondant à nos questions, Jean de la Rochebrochard confirme par ailleurs que le fondateur de Free est au courant de la plainte dont il est l’objet : « Monsieur Xavier Niel, ainsi que l’ensemble de mes collaboratrices et collaborateurs, sont pleinement informés de ces accusations. » Aujourd’hui encore, l’homme mène une vie d’investisseur et de sportif paisible, partageant son temps entre sa base arrière à Bormes-les-Mimosas, et ses voyages à Paris, Londres ou New York. Pour butiner le Niel, il ne faut pas que l’abeille reste à la ruche.
Louison Lecourt
* Les prénoms ont été modifiés
*L’ex-compagne de Jean de la Rochebrochard a souhaité apporter des précisions à ses propos rapportés dans l’article. Elle écrit ce 21 novembre à QG : “Jean de la Rochebrochard n’a jamais fait preuve de violence ni envers moi, ni envers les enfants, ni nos amis. Je n’ai jamais constaté de comportements inappropriés envers aucun entrepreneur.se ou investisseur.e invité à la maison.” Puis ajoute : “Je ne pense pas que Xavier Niel se séparerait de Jean sur de simples rumeurs.“
Backstage
Cette enquête exclusive, à lire sur QG, média indépendant en ligne, est le fruit d’un long travail d’investigation. Pendant plusieurs mois, nous avons interrogé de nombreux témoins, dont l’anonymat a été préservé, notamment par crainte d’être blacklistés dans l’écosystème de la Tech. Nous disposons de messages écrits et de photos qui corroborent les témoignages.
À la demande de Juliette, nous avons choisi de maintenir pour le moment confidentiel son témoignage au sujet du viol qu’elle affirme avoir subi. Nous avons néanmoins pu nous entretenir longuement avec elle à Paris. Nous avons également interrogé des personnes de l’entourage professionnel de Jean de la Rochebrochard, proche ou lointain, qui affirment ne pas avoir été informées des accusations évoquées dans cet article. D’autres ont refusé de s’exprimer.
Conformément aux règles déontologiques de notre métier, nous avons contacté Jean de La Rochebrochard et Xavier Niel, lundi 17 novembre 2025, afin de leur donner la possibilité de faire connaître leur position avant la publication de l’article. Jean de la Rochebrochard nous a adressé une réponse ce même jour en contestant formellement les accusations relatées dans cet article. Xavier Niel, n’a quant à lui, pas encore répondu à notre sollicitation.
- GÉNÉRALISTES
- Alternatives Eco.✝
- L'Autre Quotidien
- Le Canard Enchaîné
- La Croix
- Le Figaro
- France 24
- France-Culture
- FTVI
- HuffPost
- L'Humanité
- LCP / Public Senat
- Le Media
- La Tribune
- EUROPE ‧ RUSSIE
- Courrier Europe Centrale
- Desk-Russie
- Euractiv
- Euronews
- Toute l'Europe
- Afrique du Nord ‧ Proche-Orient
- Haaretz
- Info Asie
- Inkyfada
- Jeune Afrique
- Kurdistan au féminin
- L'Orient - Le Jour
- Orient XXI
- Rojava I.C
- INTERNATIONAL
- CADTM
- Courrier International
- Equaltimes
- Global Voices
- I.R.I.S
- The New-York Times
- OSINT ‧ INVESTIGATION
- OFF Investigation
- OpenFacto°
- Bellingcat
- Disclose
- Global.Inv.Journalism
- MÉDIAS D'OPINION
- Au Poste
- Cause Commune
- CrimethInc.
- Hors-Serie
- L'Insoumission
- Là-bas si j'y suis
- Les Jours
- LVSL
- Politis
- Quartier Général
- Rapports de force
- Reflets
- Reseau Bastille
- StreetPress
- OBSERVATOIRES
- Armements
- Acrimed
- Catastrophes naturelles
- Conspis
- Culture
- Curation IA
- Extrême-droite
- Human Rights Watch
- Inégalités
- Information
- Internet actu ✝
- Justice fiscale
- Liberté de création
- Multinationales
- Situationnisme
- Sondages
- Street-Médics
- Routes de la Soie
