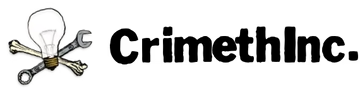
29.09.2025 à 23:33
Dans le sillage de la révolution, un nouveau Népal émerge : En luttant contre la corruption, la « génération Z » développe une conscience politique
CrimethInc. Ex-Workers Collective
Texte intégral (4165 mots)

Exacerbée par les violences policières, une vague de protestations au Népal s’est transformée en une insurrection spontanée qui a culminé le 9 septembre 2025 avec le renversement du gouvernement. Pour faire suite à notre entretien avec Black Book Distro de Katmandou, nous avons cherché à mieux comprendre le contexte qui a conduit à la révolution et les formes qu’elle a prises auprès d’une journaliste népalaise actuellement basée au Portugal, Ira Regmi.
Le 8 septembre 2025, le Népal a connu une révolution lorsque des milliers de jeunes, principalement issus de la génération Z, sont descendu·es dans la rue pour manifester. Cette action collective a été réprimée brutalement par l’État, entraînant un massacre de manifestant·es et d’étudiant·es vêtu·es de leur uniforme scolaire et issu·es de la classe ouvrière. Le bilan actuel s’élève à 74 morts, dont trois policiers et environ 10 personnes incarcérées.
La cause plus large du mouvement trouvait ses racines dans l’opposition à la corruption ; elle peut être comprise comme l’aboutissement des mouvements « Enough is Enough » (Ça suffit / Trop c’est trop) menés par les jeunes en 2019. Le catalyseur immédiat de cette action est apparu quand des militant·es de la génération Z ont lancé une campagne sur les réseaux sociaux dénonçant la consommation somptuaire des enfants des élites politiques, arguant que ce mode de vie était subventionné par les fonds publics. Le hashtag #Nepobaby a rapidement gagnée en popularité sur les plateformes numériques et la censure qui s’en est suivie de la part du gouvernement, en bloquant notamment 26 plateformes de réseaux sociaux, a provoqué des manifestations généralisées. Seules cinq plateformes autorisées sont restées accessibles : Viber, TikTok, Nimbuzz, WeTalk et Popo Live. Les créateurs et créatrices de contenu ont signalé que TikTok et d’autres plateformes supprimaient activement toutes critiques anti-gouvernementales. Cette répression a intensifié la prise de conscience, poussant les organisatrices et organisateurs à exploiter d’autres canaux de communication et à contourner la censure étatique en utilisant des VPN, accélérant ainsi la mobilisation au-delà de la capacité du régime à la réprimer.
Dans un acte solennel qui a marqué le début de la justice révolutionnaire, le gouvernement provisoire nouvellement formé, dirigé par le Premier ministre Sushila Karki, a officiellement déclaré que les manifestant·es tombé·es pendant les manifestations étaient à présent des martyrs de cette lutte. L’État a rendu hommage aux défunt·es lors d’une cérémonie officielle et nationale de crémation et a proclamé le 17 septembre comme étant une journée de deuil national. Leur sang a sanctionné la naissance d’un nouveau Népal, et leur mémoire inspirera à jamais les transformations révolutionnaires à travers le monde. Cependant, le peuple a clairement fait savoir que les commémorations à elles seules ne suffisaient pas et que la responsabilité de l’État dans les violences perpétrées restait non négociable.
Le mouvement de la génération Z au Népal représente d’une part une rupture fondamentale avec l’accord politique post-2006 qui gouvernait le pays depuis l’abolition officielle de la monarchie et d’autre part, incarne une opposition majeure face aux fondements structurels de la corruption institutionnelle au Népal.
Cet article examine les conditions matérielles qui ont conduit à cette mobilisation massive et s’interroge sur les questions constitutionnelles, politiques et sociales qu’elle a soulevées. Des explications détaillées sur le déroulement exact des événements sont également disponibles dans les récits de journalistes indépendant·es et de créatrices et créateurs de contenu sur les réseaux sociaux.

Photo de Sulav Shrestha
Violence d’État, réponse révolutionnaire et le capital pris pour cible
Comme toujours, la violence est venue de l’État. Le gouvernement a exacerbé les manifestations pacifiques par une répression brutale, tirant sans discernement sur la foule, tirant à balles réelles directement dans la tête ou la poitrine de jeunes vêtu·es de leur uniforme scolaire. Cette brutalité, qui a causé le plus grand nombre de morts en une seule journée de manifestation au Népal, n’était pas un cas isolé. Elle représentait la violence systématique par laquelle l’État népalais a maintenu son pouvoir ces dernières années, réprimant régulièrement toute forme de dissidence par la force létale.
Le lendemain, la colère accumulée par la population s’est manifestée sous la forme d’actions directes contre les symboles et les infrastructures du pouvoir et du capital. Les manifestant·es ont pris pour cible les institutions publiques, notamment le Parlement, les bâtiments administratifs du gouvernement, la Banque centrale et la Cour suprême. Les domiciles et entreprises des élites politiques et économiques ont également été visés de manière ciblée. La vallée de Katmandou s’est revêtue d’une épaisse fumée noire lorsque les manifestant·es ont donné libre cours à leur rage révolutionnaire, incarnant le slogan « brûlons tout » et transformant ainsi l’horizon de la capitale en une véritable carte postale aux allures de défi.
Parmi les entreprises visées, le groupe Choudhary, NCELL et la chaîne de supermarchés Bhatbhateni ont subi des dommages importants, avec notamment 12 des 24 magasins Bhatbhateni qui ont été entièrement détruits. Les magnats des affaires ont rapidement publié des déclarations soulignant leur résilience, mais il est à noter qu’ils n’ont fait preuve d’aucune introspection significative quant aux raisons pour lesquelles ils ont été spécifiquement pris pour cible par la colère populaire.
Le ciblage généralisé de la classe millionnaire népalaise, associé aux objections libérales contre la destruction de biens, montre l’importance d’une analyse anticapitaliste radicale dans le cadre de ce soulèvement historique. Les industriels pris pour cible par les masses d’individus sont clairement identifiés et exposés comme étant les ennemis de classe de la jeunesse révolutionnaire, car leur richesse repose sur l’exploitation et la corruption. La dynastie des Choudhary est accusée d’avoir dissimulé des actifs dans des paradis fiscaux au Panama, d’avoir orchestré des fraudes à l’assurance et d’avoir illégalement saisi des usines appartenant à l’État. De même, Min Bahadur Gurung, propriétaire de l’empire Bhatbhateni, a participé au vol de terres publiques et s’est rendu coupable d’une fraude à la TVA d’un montant total avoisinant les 1 milliard de roupies népalaises. NCELL a été impliqué dans le plus grand scandale de fraude fiscale et de blanchiment d’argent du pays. L’imbrication entre le capital privé et l’appareil politique corrompu du Népal, où la richesse achète la politique et la protection, exige un examen critique implacable, tout comme l’immoralité fondamentale d’une telle accumulation obscène de richesses.
Si des provocateurs contre-révolutionnaires ont sans aucun doute participé à ces événements et méritent une analyse et une enquête rigoureuses, une grande partie des destructions de biens publics et privés résultait d’une véritable indignation populaire. Les demandes urgentes d’apaisement après la démission du Premier ministre étaient critiques, d’autant plus que des preuves concluantes confirment désormais que des factions violentes pro-monarchistes et du parti traditionaliste ont délibérément provoqué la plupart des troubles pendant la seconde moitié de la journée du 9 septembre.
Cependant, nous avons également été témoins d’une inquiétude bourgeoise indéniable face aux dégâts matériels, ce qui témoigne du caractère classiste de ces critiques. La tendance libérale à assimiler la destruction de la propriété capitaliste à des violences contre les personnes constitue une profonde méconnaissance de la pratique révolutionnaire et masque le véritable nature des violences commises contre le peuple népalais.

Photo de Sulav Shrestha
Le spectre de la corruption
Comme l’écrit le journaliste indépendant Pranay Rana dans son bulletin d’information Kalam Weekly, « la campagne reflétait une frustration plus généralisée à l’égard du statu quo » et trouvait son origine dans la nature systémique de la corruption publique au Népal. Parmi les principaux exemples de scandales de corruption, on peut citer l’enregistrement frauduleux de citoyen·nes népalais·es en tant que réfugié·es bhoutanais pour leur réinstallation dans un pays tiers, les irrégularités dans l’attribution de contrats pour la construction de l’aéroport international de Pokhara, le transfert systématique de terres publiques à des entités privées et le scandale de la distribution d’électricité, dans le cadre duquel les autorités ont fourni une alimentation électrique ininterrompue à des intérêts commerciaux tout en soumettant le population à des coupures de courant pouvant aller jusqu’à 18 heures par jour.
Mais la question de la corruption ne se limitait pas seulement aux scandales impliquant des personnalités politiques de premier plan. La corruption imprègne la société civile à travers la normalisation des pots-de-vin dans tous les milieux professionnels et la distribution systématique des nominations institutionnelles, allant des postes ministériels aux postes au sein des rectorats d’université, sur la base de réseaux de favoritisme plutôt que du mérite. Ces conditions ont entraîné une profonde aliénation parmi les individus. Dans les sphères professionnelles, industrielles et bureaucratiques du Népal, la corruption érode la société comme la rouille ronge le métal.
L’ancienne administration dirigée par KP Oli a encore accéléré cette aliénation en affichant des tendances de plus en plus autoritaires, masquées par une rhétorique hypernationaliste. Pendant ce temps, les soi-disant partis d’opposition se sont entendus avec les partis au pouvoir pour mettre en place un système de gouvernance à présidence tournante, un arrangement cynique dans lequel ils ont convenu de se partager à tour de rôle le pouvoir exécutif du pays, vidant ainsi de son sens toute prétention à la démocratie.

Photo de Sulav Shrestha
La pratique révolutionnaire face à la crise constitutionnelle
La tension entre le constitutionnalisme bourgeois et la nécessité révolutionnaire est apparue comme la contradiction centrale de cette lutte. Une génération d’activistes, principalement composées d’adolescent·es et de jeunes adultes d’une vingtaine d’années, a été confrontée à de profondes questions constitutionnelles en l’espace de quelques jours, tandis que les juristes établis ont largement rejeté les impératifs révolutionnaires comme étant fondamentalement inconstitutionnels.
La Constitution népalaise, elle-même issue d’un mouvement de masse, bien que mené par des partis politiques, représente la cristallisation d’un compromis politique qui a établi un ordre démocratique formel. Cependant, ce cadre constitutionnel trahit l’imagination limitée de ses architectes, qui étaient pour la plupart des membres des partis politiques traditionnels ainsi qu’une élite intellectuelle qui n’avait peut-être jamais envisagé (ou avait bien imaginé et voulu éviter à tout prix) un scénario dans lequel la légitimité populaire pourrait se détourner de leur pouvoir. Par conséquent, le document ne prévoit pas de modalités pour la mise en place de gouvernements par intérim lorsque les conditions politiques l’exigent. Cette absence structurelle révèle que la fonction première de la Constitution était de réguler la concurrence entre les élites plutôt que de faciliter une véritable souveraineté populaire.
L’une des causes fondamentales de cette révolution a été l’érosion totale de la confiance dans les pouvoirs exécutif et législatif. Or, toute voie strictement constitutionnelle, telle que définie par les élites juridiques, impliquerait nécessairement le pouvoir législatif, c’est-à-dire l’institution même dont la dissolution était l’une des principales revendications révolutionnaires. Telle qu’elle est rédigée, la Constitution donne la priorité aux tentatives de formation d’un gouvernement au sein du Parlement existant, en combinant certaines des étapes suivantes : 1) Plus de 50% des parlementaires soutiennent la dissolution, 2) Soit une session parlementaire formelle, soit l’exécutif recommande la dissolution au président. La réalité empirique a toutefois rendu ces voies impossibles. Le pouvoir exécutif et la plupart des 275 membres du Parlement étaient impliqués dans des formes d’exploitation et de corruption systématique, liés par leur loyauté de classe à l’establishement politique parasitaire que les individus avaient renversé à juste titre.
En conséquence, le mouvement a avancé une interprétation de la légitimité constitutionnelle qui remettait en cause le monopole de la classe dirigeante sur sa signification, donnant aux individus les pouvoir de mettre en place un gouvernement intérimaire tout en dissolvant le Parlement. De jeunes juristes ont correctement identifié plusieurs voies d’interprétation permettant de mettre en place un gouvernement intérimaire sans abandonner complétement la Constitution. Ils et elles ont rappelé aux individus et aux avocat·es chevronné·es que la Constitution existe pour servir le peuple et non l’enfermer dans un système corrompu.
Le travail opportun d’éducation publique et de sensibilisation mené par l’avocat Ojjaswi Bhattarai, en collaboration avec un groupe d’autres jeunes universitaires et d’influenceuses et influenceurs sur Internet, a permis au mouvement de maintenir la continuité constitutionnelle. Ils et elles ont défendu ces interprétations en invoquant une doctrine qui permet de rendre temporairement inopérantes (ou « éclipsées ») certaines parties spécifiques d’une constitution lorsque des circonstances extraordinaires rendent leur application normale impossible. Ils et elles ont également fait valoir que, puisque la révolution reflétait sans ambiguïté la volonté collective des individus, cette volonté pouvait prévaloir sur d’autres impératifs juridiques formels. Il ne fait aucun doute que le mouvement a clairement démontré le mandat populaire en faveur de la formation d’un gouvernement intérimaire et de la dissolution du Parlement, fondant ainsi sa réinterprétation constitutionnelle sur une véritable légitimité démocratique.

Des écolier·ères passent devant les restes calcinés d’un bus à Katmandou le 15 septembre 2025, jour de la réouverture des écoles. Photo de Narendra Shrestha.
Expérimentations démocratiques et la lutte pour le contrôle du discours
Ces discussions juridiques et stratégiques se sont principalement déroulées dans des espaces numériques, donnant lieu à des formes sans précédent de pratique démocratique. Plus de 120 000 jeunes népalais se sont mobilisés via Discord pour désigner collectivement le candidat au poste de Premier ministre par intérim – une expérience radicale de démocratie directe dans laquelle les individus ont créé de nouvelles formes d’organisation au-delà des contraintes des structures politiques bourgeoises. Après la nomination de Sushila Karki, des collectifs de jeunes ont organisé des réunions publiques afin de tracer la voie à suivre.
À l’heure actuelle, plusieurs groupes s’unissent pour formuler un programme révolutionnaire officiel assorti de revendications concrètes et des moyens nécessaires pour mettre en place de nouvelles institutions responsables qui servent véritablement les intérêts des individus. Il existe également des groupes anarchistes qui s’efforcent de renforcer la solidarité au sein de la gauche népalaise et s’engagent à s’organiser en dehors des normes hiérarchiques traditionnelles.
Cette expérimentation démocratique via les plateformes numériques a posé des défis, même pour les révolutionnaires, notamment concernant la surveillance étatique, la répression numérique, l’infiltration et la tendance de ces plateformes à devenir des machines de propagande qui détournent la volonté exprimée par le peuple. Cet exercice a constitué une rupture si fondamentale avec les normes démocratiques libérales que les participant·es ont naturellement connu une certaine désorientation au départ.
De plus, comme le soulignent les rédacteurs et rédactrices de la newsletter Cold Takes by Boju Bajai, les médias traditionnels ont eu beaucoup de mal à interpréter ces événements, car de nombreux journalistes chevronné·es ne connaissaient même pas les bases de plateformes numériques telles que Discord. Alors que Kantipur TV continuait à diffuser ses programmes malgré l’incendie de son siège social, les conglomérats médiatiques ont également révélé leur caractère de classe en continuant à couvrir des formations politiques obsolètes, sans comprendre que les conditions matérielles du discours avaient fondamentalement changé du jour au lendemain.
Un contraste est apparu entre la conscience révolutionnaire qui se développait chez les jeunes sur Discord et Instagram et les tendances réformistes qui prévalaient sur des plateformes telles que Facebook et Twitter. La bourgeoisie et les générations plus âgées, qui avaient monopolisé le discours politique pendant des décennies, ont été déconcertées par cette transformation, incapables de comprendre que leur hégémonie sur l’expression politique avait été définitivement brisée.
Dans le même temps, si cette révolution numérique a amplifié les voix des jeunes, auparavant marginalisées, elle a également été source d’exclusion, laissant de côté les générations plus âgées et celles qui n’ont pas accès à la technologie.

Un garçon regarde une fresque murale réalisée par les artistes Riddhi Sagar et Somic Shrestha, représentant la chaussure blanche de Prakash Bohara, 28 ans, abattu lors des manifestations au Népal. Photo de Skanda Gautam et Sahana Vajracharya.
L’inclusion radicale signifie classe, caste et genre
Si ce mouvement révolutionnaire a représenté une rupture significative dans l’ordre politique, des éducatrices et éducateurs et autres militant·es tels qu’Ujjwala Maharjan, Anjali Shah et Tasha Lhozam ont souligné qu’il restait incomplet tant qu’il ne s’attaquait pas aux contradictions fondamentales liées à la caste, à la classe sociale et au genre qui structurent la société népalaise.
Critiquer la corruption sans remettre en question l’immoralité inhérente à l’accumulation du capital revient à confondre les symptômes avec la maladie. La classe politique actuellement critiquée pour son népotisme et sa corruption a inévitablement tenté de blanchir sa fortune obscène en la présentant comme légitimement acquise, avec l’aide de l’économie orthodoxe bourgeoise. Cette manœuvre contre-révolutionnaire ne peut réussir que si le mouvement révolutionnaire ne parvient pas à affronter la vérité dérangeante selon laquelle de nombreuses aspirations au sein de ses propres rangs restent contaminées par les fantasmes capitalistes d’avancement individuel dans les structures existantes. Sans une critique du capitalisme lui-même, ce moment révolutionnaire risque de sombrer dans un simple réformisme.
Une conscience véritablement révolutionnaire doit synthétiser l’anticapitalisme et l’opposition militante aux hiérarchies de castes et à l’asservissement patriarcal, tout en défendant une perspective abolitionniste. Nous ne devons jamais oublier que parmi les défunts figuraient des jeunes incarcérés dont la mort aux mains des forces de l’État alors qu’ils tentaient d’échapper à des conditions de détention brutales constitue un meurtre de classe. Le concept même de centres de détention pour mineurs représente l’individualisation des problèmes sociaux. Le crime lui-même doit être compris non pas comme un échec moral individuel, mais comme le résultat prévisible des conditions matérielles créées par les relations sociales. La volonté de réhabiliter les institutions de violence étatique – illustrée par celles et ceux qui se sont empressé·es de restaurer les infrastructures policières – révèle une contamination idéologique persistante issue de la politique de respectabilité. L’humanisme révolutionnaire exige l’abolition, et non la réforme, de ces institutions carcérales.
Enfin, la prolifération spontanée de drapeaux trans et queer sur le serveur Discord a révélé le caractère progressiste latent du mouvement. Ce mouvement, bien qu’il présente un front uni, contient en son sein des expériences matérielles diverses : peuples autochtones, communautés opprimées par le système des castes et minorités sexuelles dont les formes spécifiques d’exploitation doivent être articulées dans un programme révolutionnaire cohérent. Les éléments historiquement privilégiés du mouvement – les jeunes cisgenres, hétérosexuels, masculins et issus des castes supérieures – doivent s’engager dans une autocritique implacable concernant leurs privilèges accumulés. Ce n’est que grâce à ce processus qu’une avant-garde anticapitaliste intersectionnelle pourra émerger de ce moment historique de radicalisation massive.
Les prochaines élections exigent que le peuple népalais se rallie derrière un parti non traditionnel qui défend véritablement la vision révolutionnaire de la génération Z et s’oppose directement à l’appareil politique en place. Ce n’est qu’en obtenant la majorité parlementaire que les jeunes pourront se libérer d’un paysage politique corrompu. Si cette majorité n’est pas atteinte, le Népal risque de rester sous la domination de la même classe dirigeante pendant encore plusieurs décennies.
24.09.2025 à 00:08
ICE hors de l’Illinois, ICE hors de nos vies : Un compte-rendu sur les blocages au centre de détention de Broadview
CrimethInc. Ex-Workers Collective
Texte intégral (4977 mots)

Après des efforts désordonnés pour réprimer les immigrants à Los Angeles, l’administration Trump a annoncé que Chicago serait la prochaine cible des attaques concentrées de l’agence américaine de contrôle de l’immigration et des douanes (ICE). Cette opération dite « blitz » se heurte déjà à une résistance. En juin 2025, des milliers de personnes sont descendues dans les rues de Chicago en solidarité avec la résistance en cours à Los Angeles ; dans le même temps, des manifestant·es de Seattle à Chicago ont tenté de bloquer les agents de l’ICE lorsqu’ils se sont présentés pour kidnapper des personnes lors d’audiences au tribunal. Aujourd’hui, les habitant·es de la région de Chicago cherchent à mener des actions stratégiques aux différents points névralgiques des opérations de l’ICE. Dans ce compte-rendu, les participant·es aux blocages visant un centre de détention de l’ICE près de Chicago racontent leurs expériences et partagent leurs premières conclusions.
Aux premières heures du 19 septembre, des personnes se sont rassemblées devant le centre de détention de l’ICE de Broadview, dans l’État de l’Illinois, une banlieue située à l’ouest de Chicago. Nous nous sommes réuni·es bien avant les mobilisations annoncées publiquement pour 7h du matin et plus tard dans la soirée, dans l’espoir d’intercepter les agents fédéraux en train de transporter dans leurs véhicules des personnes arrêtées et enlevées dans tout le Midwest.
Le centre de détention de Broadview contient environ 150 prisonnier·ères constamment ; il sert de plaque tournante pour les activités de l’ICE dans toute la région du Midwest. Les centres de détention de l’ICE de plus grande capacité sont illégaux dans l’Illinois, ce qui fait de cet endroit un goulet d’étranglement logistique pour le transport des prisonnier·ères. Les ressources fédérales allouées à ce centre ayant explosé pour satisfaire le désire de violence xénophobe des politicien·nes d’extrême droite, Broadview est devenu rapidement une infrastructure de plus en plus importante et essentielle dans la région.
Lorsque les manifestations ont commencé à Broadview, les petits groupes d’individus avaient initialement tendance à se livrer à des actes spectaculaires et auto-sacrificiels, consistant généralement à s’asseoir devant les fourgons de l’ICE qui quittaient le centre de détention, pour être ensuite évacués de force par la police de Broadview. À mesure que les reportages et images de chaque action se diffusaient et que la confiance dans l’efficacité de la résistance non-violente s’estompait, les mobilisations ont changé de forme : l’objectif principal de l’action est passé du sacrifice à la résistance. L’ICE a commencé à brutaliser et arrêter les manifestant·es à sa guise et les tentatives de bloquer les fourgons ont échoué ; en réponse, les foules d’individus matinales ont troqué leurs masques N-95 contre des équipements et tenues de black bloc et ont choisi de suivre les agents plutôt que de simplement s’asseoir devant le centre.
Il est claire qu’une approche plus proactive était nécessaire. Les efforts déployés le vendredi 19 septembre en ont été le résultat.

« Les agents de l’ICE sont la véritable menace ! »
Vendredi matin
Depuis plus d’une dizaine d’années, tous les vendredis à 7h du matin, des bus transportent les détenu·es du centre de Broadview vers l’aéroport international Gary/Chicago dans l’Indiana et, plus récemment, vers d’autres centres de détention du Midwest. L’établissement a réagi aux premiers actes de désobéissance civile télévisés en transférant les détenu·es de plus en plus tôt.
Nous nous sommes donc, nous aussi, réveillé·es plus tôt. Le 19 septembre, vers 4h30, une vingtaine de manifestant·es se sont rassemblé·es près du centre. Certain·es étaient vêtu·es de noir, d’autres portaient des vêtements plus classiques. Contrairement à la désobéissance civile sacrificielle des semaines précédentes, la plupart des personnes (à l’exception d’une prétendante au Congrès et de son équipe de presse) ont décidé de focaliser leur action sur le fait de se tenir debout devant un véhicule lorsque ce dernier entrait ou sortait du centre de détention afin de le bloquer. Ce changement de stratégie a permis à la petite foule de se déplacer comme l’eau.

Un agent de l’ICE se rendant à son travail au petit matin s’éloigne rapidement des manifestant·es.
Le premier fourgon qui a tenté de quitter Broadview a dû rebrousser chemin, car la plupart des personnes présentes l’ont encerclé pendant que trois autres se sont assises dans l’allée. L’énergie ambiante était palpable, et les personnes présentes ont suivi de près tous les agents qui quittaient les lieux, interpellant ceux qui se rendaient dans un parking voisin où se trouvaient des fourgons sérigraphiés de l’ICE, des voitures banalisées et des véhicules personnels des agents.
Pris au dépourvu par les lève-tôt, les agents étaient affolés, certains sprintant du parking jusqu’aux portes d’entrée du centre de Broadview. En réponse aux hués, ils se sont regroupés par groupes de trois ou plus pour se rendre ensemble et à pied jusqu’au centre. Certains ont enfilé leur équipement avant d’entrer. Cette lâcheté mérite d’être soulignée.

Un groupe de mercenaires entre dans le centre de détention.
L’enthousiasme des participant·es mantinaux·ales a donné le ton pour le reste de la journée. Alors que le soleil commençait à se lever, les agents à l’intérieur du bâtiment ont repris là où ils s’étaient arrêtés la semaine précédente. Vêtus d’équipements tactiques, certains se sont regroupés sur le toit, d’autres derrière le portail d’entrée.
Bloqués par la foule, les agents de l’ICE ont commencé à conduire leurs véhicules sur le trottoir pour contourner les manifestant·es. Il n’y avait tout simplement pas assez de monde, ni assez de préparation technique, pour bloquer ou arrêter les voitures à ce moment-là. La première arrestation de la matinée a eu lieu vers 6h, lorsqu’un fourgon essayant de quitter le centre a de nouveau été bloqué par des manifestant·es. Cette fois-ci, six agents des forces spéciales équipés de pistolets lanceurs de balles au poivre et d’un lanceur de gaz lacrymogène se sont précipités hors de l’enceinte. Ils ont attrapé les personnes au sol et les ont traînées plus loin ; une femme a été violemment jetée au sol et une autre personne a été traînée sur l’asphalte par deux agents avant d’être attrapée et transportée à l’intérieur du centre.
Alors que les agents reculaient vers le portail, l’un d’eux a tiré plusieurs balles au poivre sur les personnes qui se trouvaient dans l’allée. Les agents de l’équipe d’intervention spéciale (SRT) ont continué tout au long de la matinée à se précipiter pour escorter les véhicules qui entraient et sortaient du centre de détention.
Vendredi après-midi
Entre 7h et midi, l’ambiance des deux côtés de la clôture du centre a changé. Alors que de plus en plus de gardes entraient dans l’enceinte avec leur équipement et des seaux remplis de munitions, des tendances distinctes se sont manifestées au sein de la foule présente devant le centre de détention. Certains groupes chantaient, tandis que d’autres s’énervaient de plus en plus en voyant les manifestant·es se faire tirer dessus à plusieurs reprises avec des balles au poivre ou en se faisant traîner de force à l’intérieur du bâtiment. D’autres encore aidaient des familles à prendre contact avec leurs proches détenus dans le centre.
Les agents du SRT ont lancé des gaz lacrymogènes sur la foule pour la première fois aux alentours de midi, lors d’un affrontement au sujet de la sortie de fourgons. Les agents ont tiré des grenades lacrymogènes et des balles au poivre sur la foule avant de ramener de force un homme avec eux dans le centre. Peu d’individus étaient préparé·es à ces munitions chimiques et la foule a fini par se disperser dans la rue, tandis que certain·es aidaient des manifestant·es à se rincer les yeux et mettaient leur·es camarades les plus touché·es en sécurité. Dans l’après-midi, la foule présente à l’extérieur du centre de détention a diminué en nombre, les personnes se regroupant plus loin et attendant le début de la deuxième manifestation annoncée publiquement.

Des agents fédéraux appréhendent un manifestant à Broadview dans l’après-midi.
Vendredi soir
Une deuxième manifestation était prévue à 19h. Les images d’individus arrêtés et visés par des gaz lacrymogènes avaient fait le tour des médias et galvanisé de nombreuses personnes qui ne s’étaient pas encore rendues à Broadview.
Vendredi soir, des personnes ont rejoint le petit groupe d’individus qui restait après les manifestations de la journée. Tout au long de la soirée, deux ou trois agents sont restés sur le toit du centre, tirant par intermittence des balles au poivre sur les manifestant·es présent·es dans la rue. Vers 19h, alors que les manifestant·es se rassemblaient, une trentaine d’agents du SRT se sont regroupés derrière les grilles du centre de détention. Les manifestant·es leur ont demandé de libérer les centaines de personnes détenues à l’intérieur, ainsi que les manifestant·es arrêté·es plus tôt dans la journée.

Après une confrontation avec des manifestant·es devant l’entrée du bâtiment, Gregory Bovino, qui a dirigé l’invasion de Los Angeles par l’ICE, intervient avec des agents et tente de repousser la foule.
Après 19h, des boucliers sont arrivés. Une douzaine de militant·es les ont récupérés, mais la majorité de la foule est restée à distance. Reflétant peut-être la tendance de la semaine précédente où des actes symboliques avaient été menés par un petit nombre de personnes, il y avait un vide important entre le petit groupe d’individus à l’avant et les personnes qui observaient à l’arrière en maintenant leur distance, et il n’y avait aucune réelle compréhension organique de la nécessité pour les individus de participer activement à l’action derrière la ligne de front. Les personnes formant la ligne de boucliers ont commencé à interpeller la foule et à lui faire des signes, demandant aux journalistes de s’écarter et à tou·tes les autres participant·es de se regrouper pour prêter main-forte.
Les agents sont sortis en force vers 19h30. Les individus constituant la première ligne ont repoussé les premières vagues de munitions, affrontant un barrage de gaz lacrymogène, de balles au poivre et de grenades assourdissantes. Mais ils et elles ont été contraint·es de battre en retraite en raison de la combinaison des munitions dites « moins létales » des agents et de la désintégration de la foule derrière eux. Cela était compréhensible : tout le monde ne dispose pas d’équipement de protection, et même celles et ceux d’entre nous qui portaient des masques à gaz ont ressenti les effets du gaz. La plupart des individus présents dans la foule ne se soutenaient pas mutuellement ni ne soutenaient la ligne de boucliers.

Un mur de boucliers bloque les munitions anti-émeutes dans la nuit du vendredi 19 septembre.
La ligne de front ne peut pas être seulement composée d’un groupe de « spécialistes » qui agit seul tandis que les autres se contentent de documenter ou d’observer l’action. La spécialisation des compétences pertinentes, allant des techniques pour se laver les yeux suite aux attaques liées au gaz lacrymogène au soutien envers les prisonnier·ères, isolent les militant·es lorsque la pression monte. Une ligne de front bien organisée intègre les rôles offensifs avec le soutien nécessaire pour maintenir la résistance et mener à bien les objectifs fixés.
Mais alors que le fossé entre les « militant·es » perçu·es comme tel·les qui composent les premières lignes de l’action et les autres individus situés à l’arrière continue d’entraver une défense efficace, la tendance croissante à la résistance se situe bien au-delà. Nous voulons fermer Broadview, pas seulement symboliquement, mais complètement. La stratégie du spectacle repose sur l’idée que la brutalité répétée envers nos camarades finira par persuader ceux qui enlèvent nos voisin·es de cesser leurs opérations. Mais à mesure que les individus sont témoins de ces enlèvements et font l’expérience de la brutalité des « forces de l’ordre », beaucoup abandonnent progressivement cette approche. Certain·es pour qui la violence d’État était auparavant un concept abstrait, se retournent contre les mercenaires qu’ils et elles voient debout sur le toit du centre de Broadview, mercenaires qui les regardent à travers la lunette d’une arme et choisissent d’appuyer sur la gâchette.

Contrôle des foules
Les agents de l’ICE se sont révélés brutaux mais peu intelligents. À plusieurs reprises, ils semblaient perdus, fonçant dans la foule de manifestant·es avant de battre en retraite tout aussi rapidement. Malgré des conditions favorables, ils ne savaient pas comment nasser les manifestant·es. Lorsque les agents s’approchaient des manifestant·es, ils rompaient souvent les rangs et ne formaient plus qu’une seule ligne peu compacte. Utilisant des pistolets lanceurs de balles au poivre, ils tiraient de manière sporadique et aléatoire, souvent sans cible précise.
Les agents ont souvent reculé face aux manifestant·es, semblant ébranlés même par des slogans et chants peu convaincants. De même, les agents du SRT ont généralement évité de s’approcher trop près des manifestant·es et ce, malgré leur avantage significatif. Que ce soit par flemme, par confusion ou les deux, ils ont même hésité à arrêter celles et ceux qui tentaient activement d’empêcher les véhicules de sortir du centre de détention.
Ce n’est qu’une hypothèse, mais il faut rappeler que le centre est relativement petit, qu’il est utilisé en permanence et qu’il ne peut accueillir qu’environ 150 prisonnier·ères à la fois. Compte tenu de l’opération Midway Blitz et d’autres activités de l’ICE à Chicago et ses environs, il est probable que l’établissement fonctionne déjà à pleine capacité. Ceci, ajouté à leur manque apparent d’expérience en matière de contrôle des foules, a peut-être influencé la manière dont les agents de l’ICE et du SRT ont interagi avec les manifestant·es.

Une grenade assourdissante explose alors que les agents fédéraux attaquent le mur de boucliers.
Devenir proactif·ive
Si le courage dont nous sommes témoins vise à échapper à des affrontements de « spécialistes » et répétitifs avec des forces étatiques toujours mieux équipées, il faudra renoncer au spectacle médiatique pour mener des actions plus proactives contre les infrastructures de déportation. Nous devons définir ce que signifierait une victoire sur les agents et les installations de l’État et articuler la lutte pour la libération qui sous-tend le passage à une confrontation plus généralisée avec les représentant·es de l’État et du capital. Agir à cette échelle nécessite d’aller au-delà d’un groupe d’activistes spécialistes (sans parler des politicien·nes en herbe moins louables et plus clairement carriéristes) pour établir des relations avec celles et ceux qui vivent autour du centre de détention et, plus largement, avec tou·tes celles et ceux dont l’instinct est déjà de protéger les personnes contre l’ICE.
Partout dans le pays, les individus ont spontanément pris des mesures intelligentes et opportunes contre les raids de l’ICE dans leurs quartiers, agissant avant même que les militant·es spécialistes et les ONG n’arrivent pour les exhorter à se limiter à documenter les événements ou à témoigner. Plutôt que de compter sur des réseaux d’intervention rapide qui arrivent rarement à temps, compte tenu de la rapidité des raids, des actions plus proactives pourraient consister à cibler localement les différents points de passage névralgiques de la machine à expulser tels que Broadview ou, comme à Los Angeles, à mettre en place des centres de défense communautaires dans les zones sensibles où l’activité fédérale est intense. Toute stratégie efficace anti-ICE dépendra des actions des habitant·es qui choisissent d’intervenir directement dans leur quartier. Bien que les médias aient minimisé bon nombre de ces événements, les affrontements à Broadview ne sont possibles que grâce au courage de celles et ceux qui ont chassé l’ICE hors de leurs quartiers à Los Angeles, Chicago et partout ailleurs dans le pays.

Une fois le mur de boucliers dispersé, les manifestant·es restant·es avancent pour affronter les agents devant le portail du centre de détention.
Nous avons également besoin d’un développement tactique rapide. Étant donné que la police de Chicago a régulièrement recours à la stratégie de nasse, à la collaboration avec les organisateur·rices d’événements politiques et, lorsqu’elle le juge nécessaire, aux matraques, les habitant·es de Chicago sont moins bien équipé·es pour faire face aux gaz lacrymogènes que ne l’étaient les manifestant·es de Los Angeles. La situation évolue rapidement mais nous en tirons des leçons très importantes.
Nous avons constaté une ouverture d’esprit croissante en termes de tactiques. Au cours de la première phase de luttes contre l’ICE, des barricades plus ou moins solides ont été utilisées pour bloquer les quais de chargement d’un tribunal de l’immigration du centre-ville, retardant ainsi les expulsions prévues de plusieurs années. Pendant les actions à Broadview, empêcher les arrestations est devenu la norme, les boucliers sont désormais largement acceptés, l’utilisation d’équipements de protection tels que des masques respiratoires et des lunettes de protection est devenue courante, et les manifestant·es commencent à renvoyer les grenades lacrymogènes en direction des agents de l’ICE. Ces évolutions ne sont pas nécessairement liées à des engagements politiques particuliers ; nous voyons encore des personnes qui sont prêtes à retenir des agents de l’ICE ou à bloquer des véhicules, mais qui qui continuent malgré cela d’appeler chimériquement la police pour signaler les activités de l’ICE.
Les ONG et autres organisations cherchant à recruter
L’émergence d’une activité autonome visant à mettre fin aux expulsions montre qu’il est possible de sortir du cadre classique des longues marches qui ne mènent à rien organisées par les organisations traditionnelles cherchant à recruter, mais aussi de l’accent mis par les ONG sur l’aide juridique après que les arrestations en vue d’expulser les personnes concernées aient déjà eu lieu. Cette activité autonome s’est développée en grande partie parce que les ONG ont abandonné des lieux et des luttes clés.
La Coalition de l’Illinois pour les droits des immigrants et des réfugiés et les Communautés organisées contre les expulsions, les deux principales organisations à but non lucratif qui dominent la lutte contre les expulsions à Chicago, n’ont pas pris de mesures contre les expulsions répétées qui ont eu lieu au tribunal de l’immigration au début de l’été 2025, tandis que des groupes autonomes sont intervenus pour monter des barricades sur les quais de chargement, coordonner des campagnes téléphoniques, interpeller la direction, distribuer des tracts aux autres occupants du bâtiment et apporter leur soutien aux personnes qui comparaissaient devant le tribunal. Ces actions ont entraîné la fermeture du tribunal à plusieurs reprises, repoussant les audiences de plusieurs années, et ont finalement contraint la direction du bâtiment à révoquer l’accès de l’ICE à ses quais de chargement, mettant ainsi fin aux kidnappings à cet endroit. Cela ne se serait pas produit si les manifestant·es autonomes n’avaient pas bloqué le flux commercial entrant et sortant du bâtiment.
Au-delà des appels et des pétitions, les ONG ont également renoncé à toute action autour de Broadview. C’est l’un des facteurs qui a permis aux actions des semaines précédentes d’avoir lieu.

Un parapluie sert de protection improvisée pendant les affrontements.
Tensions internes
Lorsque les individus se sont mobilisés pour la première fois contre le centre de détention de Broadview il y a quelques semaines de cela, celui-ci n’avait pratiquement pas attiré l’attention du public, et certain·es se sont donc concentré·es sur la stratégie médiatique. Cela a provoqué des tensions, entre les infuenceur·euses des réseaux sociaux qui conseillaient de disperser la foule et les nuées de journalistes qui empêchaient les libérations et isolaient celles et ceux qui tentaient de protéger les militant·es visé·es par les arrestations. Celles et ceux qui ont le plus impliqué la presse et l’opinion publique dans leur activité ont fini par laisser cette attention entraver leur approche stratégique. S’il est clair que nous devons tenir compte de l’attention de la presse et du public dans nos mouvements, nous ne devons jamais compromettre l’objectif le plus prometteur du moment : chasser l’ICE partout.
Si les manifestant·es ont prouvé qu’ils et elles pouvaient rassembler et constituer une masse critique, ils et elles ont parfois limité leur propre efficacité. Dans les semaines qui ont précédé le 19 septembre, les messages concernant les efforts visant à fermer Broadview ont été repris par toute une série de personnes et d’organisations qui, présumant qu’elles savaient mieux que quiconque, ont utilisé des notions telles que « sécurité » et « visibilité » pour discipliner les manifestant·es à leur propre avantage. En partant du principe que le seul objectif envisageable de ces manifestations était de dire la vérité au pouvoir, plutôt que de fermer Broadview, les individus n’étaient pas préparés aux affrontements qui ont suivi. Dans la nuit du 19 septembre, alors que « fermer le centre » signifiait prendre de sérieux risques, celait signifiait aussi qu’il n’y avait pas de deuxième ligne pour soutenir le mur de boucliers. Sans soutien, la ligne de front ne pouvait pas tenir, ce qui a donné aux unités SRT l’occasion de traquer les manifestant·es dispersé·es.
Néanmoins, grâce à des manifestations régulières et à la couverture médiatique, les habitant·es des zones voisines ont commencé à se mobiliser. Sans financement ni soutien d’aucune organisation ou coalition de renom, la lutte pour fermer le centre de détention de Braodview repose sur le courage de personnes ordinaires.

Le parapluie d’un·e manifestant·e montre les effets des balles au poivre.
Le fiasco de la fermeture
Au moment où cet article était rédigé, une série de fuites provenant du département de la sécurité intérieure (DHS) suggérait que le centre de détention de Broadview était temporairement fermé. Une situation similaire s’était produite auparavant au centre de détention de Delaney Hall, dans le New Jersey, après que des manifestant·es l’aient bloqué et finalement envahi, mais ce site avait repris ses activités quelques mois plus tard avec des mesures de sécurité renforcées.
Cependant, à la suite d’un scandale public impliquant une secrétaire adjointe du DHS et des déclarations enthousiastes de victoire de la part d’organisations qui n’avaient pas été particulièrement visibles sur le terrain, il a été officiellement confirmé que le centre de détention de Broadview resterait ouvert. Depuis le matin du 23 septembre, le centre de détention est bloqué par de hautes clôtures métalliques, vraisemblablement pour empêcher les manifestant·es d’accéder à ses portes d’entrée et de sortie, et les affrontements se poursuivent à l’extérieur. Les bus que nous avons vus quitter les lieux pour se rendre à l’aéroport de Gary/Chicago transportaient des détenu·es qui avaient été contraint·es de signer des documents d’auto-expulsion.
D’une part, nous savions depuis un certain temps que le centre de détention avait atteint sa capacité maximale. Il s’agit d’un bâtiment relativement petit avec un nombre limité de lits, ce qui en fait un point vulnérable pour l’ensemble du dispositif d’expulsion dans l’Illinois et les États voisins. D’autre part, la succession confuse d’événements qui a abouti au maintien de l’activité du centre de détention suggère un désordre interne. Cela correspond aux informations que nous avons recueilles à l’intérieur même du centre, selon lesquelles bon nombre des mercenaires impliqués travaillent ensemble pour la première fois, souvent dans des buts et objectifs contradictoires.
Il est possible qu’à un certain niveau de la bureaucratie de l’ICE et du DHS, la décision ait été prise d’éviter une situation du type Delaney Hall et d’améliorer la sécurité, mais les hauts responsables ont rejeté cette suggestion et insisté pour que le centre reste en service. Quoi qu’il en soit, il est clair que, d’une certaine manière, ce que nous faisons fonctionne. Cela crée des situations stressantes et chaotiques pour nos ennemis, ce qui conduit à des conflits internes. Le seuil d’efforts nécessaires pour réussir est peut-être plus bas que nous le pensions, et nos ennemis plus craintifs que nous l’avions prévu. Dans le même temps, la bureaucratie fédérale, lente et incompétente, est régulièrement confrontée à des conflits internes de ce type, et nous devrions chercher à en tirer parti.
ICE hors de nos vies !

Le combat n’est pas terminé ! Continuons d’avancer et abattons les murs !
23.09.2025 à 00:10
Des anarchistes népalais sur le renversement du gouvernement : Entretien avec Black Book Distro
CrimethInc. Ex-Workers Collective
Texte intégral (4103 mots)

Au Népal, un mouvement de protestation début septembre 2025 s’est transformé en une insurrection spontanée en réponse à la violence policière, aboutissant à l’incendie du parlement et d’une série de bureaux gouvernementaux, de commissariats, de sièges de partis et de manoirs de politiciens. En un jour et demi, le Premier ministre Khadga Prasad Oli a pris la fuite et le gouvernement s’est effondré. Mais renverser un gouvernement n’est que la première étape d’une lutte beaucoup plus longue ; dans cette agitation, les monarchistes, les néolibéraux et les antiautoritaires se disputent pour déterminer l’avenir du Népal. Pour mieux comprendre le contexte de l’insurrection et les dynamiques qui en découlent, nous avons interviewé Black Book Distro, un collectif anarchiste qui fait tourner une bibliothèque à Katmandou.
L’insurrection au Népal fait partie d’une série de soulèvements qui ont balayé l’Asie ces dernières années. Nous pouvons remonter la piste des événements à 2022, et le renversement du président du Sri Lanka, en a suivi le soulèvement de 2024 au Bangladesh et celui en Indonésie en août 2025, sans parler de la guerre civile en cours au Myanmar. Depuis la chute du gouvernement népalais, d’immenses manifestations ont également éclaté aux Philippines. Cette série d’actions et de mobilisations répondent aux difficultés économiques généralisées et à l’échec des promesses des politiciens.
La complicité des partis communistes institutionnels dans le massacre qui a catalysé le soulèvement devrait rappeler à tous les révolutionnaires en herbe qu’il est impossible de résoudre les problèmes du capitalisme simplement en utilisant la violence de l’État—même si vous avez « communiste » au nom de votre parti. Les impasses que le capitalisme crée pour les gens exigent des changements radicaux. On ne peut pas régler indifiniment les problèmes avec des flics et des réformes négociées dans les couloirs du pouvoir.
De même, cette insurrection devrait faire réfléchir les politicien-nes et les polices du monde entier qui imaginent qu’ils peuvent piller et terroriser en toute impunité. Aujourd’hui, l’argent qu’ils obtiennent peut les protéger des conséquences de leurs actes—mais demain, tout est possible.
Aucune de ces révoltes n’a encore atteint tous ses objectifs, mais alors que les gens du monde entier luttent contre l’oligarchie et la répression étatique, chacune d’elles offre des leçons.

Comme l’a dit un commentaire sur Bluesky : Juste un jeune homme portant la peau de l’ennemi.
Parlez-nous de vous. Qui êtes-vous et que faites-vous ?
Nous sommes Black Book Distro, un collectif et une bibliothèque anarchiste basé à Katmandou, au Népal, dédié à la politisation par l’éducation sur l’histoire de la gauche ainsi qu’un engagement actif dans les luttes et mouvements populaires qui nous semblent alignés avec nos objectifs (la protestation de Gen Z, le mouvement Meter Byaj,1 mouvement Guthi.2 Nous vous parlons en tant que mouvement anarchiste sous la répression d’un régime communiste défaillant et d’un Congrés corrompu.

La Black Book Distro propose des lectures et du matériel en anglais durant un festival anarchiste au Népal.
Pouvez-vous nous donner un bref aperçu des mouvements sociaux et des luttes au Népal au cours de la dernière décennie ou des deux dernières années. Quelles ont été les principales préoccupations à l’origine des soulevments populaires ?
Suite à la révolution maoïste,3 le Népal a connu des vagues de bouleversements sociaux, économiques, géographiques et politiques. Les principaux problèmes se situent autour de la discrimination rampante des castes, une épidémie mortelle de trafic de travailleurs migrants alimentée par le manque d’opportunités chez eux, des conflits frontaliers routiniers avec nos voisins dotés d’armes nucléaires, et une corruption politique si intense qu’elle a permis aux monarichistes partout dans le pays de faire un retour en force terrifiant.
Les mouvements populaires pour le changement ont inclus la lutte madhesh pour les droits et la dignité,4 des manifestations contre la corruption à l’époque du COVID sous la bannière « Enough Is Enough » , des belligérences nationalistes sur des zones frontalières comme Lipulekh,5 Des grèves de la faim du Docteur KC pour améliorer les infrastructures sanitaires,6 les résistances aux investisseurs parasites, et la défense des terres communales appartenant au peuple Newar. Ces luttes sont motivées par un tissu social complexe encore empreint par le patriarcat, la caste et la religion, au milieu des efforts constitutionnels vers la représentation, la liberté d’expression, la liberté économique et le fédéralisme.
Le Congrès, les partis maoïstes et marxistes-léninistes, ainsi que des factions royalistes sont les principales organisations politiques. En dessous de cela se trouvent des groupes de jeunes autonomes, des espaces gauchistes et des groupes communautaires autochtones. Historiquement parlant, la plupart des manifestations ont été dirigées ou influencées par les grands partis politiques, bien que les initiatives spontanées de la jeunesse et de la base aient agi de manière de plus en plus indépendante (y compris le récent « soulèvement de la génération Z »).

« Des balles réelles ont été utilisé aujoud’hui sur la foule. On était devant, on a vu des gens se faire tuer ».
Comment comprenez-vous les objectifs des participants de la base dans ce soulèvement ? Y a-t-il plusieurs courants avec des objectifs différents ou contradictoires ?
Le mouvement actuel « Gen Z » a ses racines dans le mouvement « Enough Is Enough » mené par des jeunes en 2019, qui se concentrait sur la justice sociale et les questions environnementales au milieu de la mauvaise gestion des revenus pendant la crise du COVID-19. Ce soulèvement initial consistait en plusieurs groupes autonomes soutenus par des citoyens ordinaires, des libéraux et des gens issus de l’extrême gauche, sans direction centrale. Depuis lors, le gouvernement n’a cessé d’intensifier sa surveillance en ligne et ses répressions totalitaires sur la jeunesse, alimentant le mouvement pour devenir ce qu’il est aujourd’hui. Leurs principales revendications sont plus de liberté d’expression, des mesures de lutte contre la corruption et la mise en place d’un gouvernement dont le rayon d’action sera hors de la main mise des différents partis corrompus.
La fusillade mortelle de manifestant-es pacifiques, y compris des étudiant-es inspirés par la philosophie de la série animée « One Piece », a déclenché une indignation générale.

Des manifestants au Népal exibent le drapeau pirate de « One Piece », devenu un symbole de la révolte indonésienne.
L’insurrection a été décentralisée et spontanée, culminant dans l’incendie du parlement et de la plupart des bureaux gouvernementaux, des maisons de politiciens, des commissariats de police et des sièges de partis, provoquant la chute du gouvernement en moins de 35 heures. Divers courants existent au sein du mouvement : les monarchistes cherchant à restaurer le roi sur le trône, les centristes visent quant à eux de à gagner en influence au sein d’un nouveau gouvernement néolibéral, et les radicaux d’extrême gauche poussent pour un fédéralisme authentique, la laïcité et la participation inclusive des communautés marginalisées. Cette multiplicité d’objectifs reflète les aspirations et tensions complexes au sein du mouvement.
Comme nous le comprenons ici de très loin, les communistes au Népal ont mené un mouvement de résistance pendant de nombreuses années avant de prendre le pouvoir en 2006. Nous avons l’impression que les conflits internes au sein du mouvement révolutionnaire dans son ensemble ont abouti à une série de compromis entre les communistes et la classe dirigeante népalaise. Comment ces compromis ont-ils affecté la société népalaise, en particulier les mouvements de la base plus radicale qui a participé à la lutte populaire, ainsi que les syndicats et d’autres groupes ?
Le succès de l’insurrection maoïste reposait sur son opposition aux vestiges du système « Panchayat », une structure agricole féodale d’oppression par des élites de la caste supérieure alliées à la monarchie sur l’ensemble de la population, qui avait été officiellement abolie en 1990. Cependant, une fois au pouvoir, de nombreux dirigeants maoïstes ont compromis leurs objectifs révolutionnaires pour maintenir le contrôle, en adoptant progressivement des pratiques capitalistes qui reflètent le même système d’oppression qu’ils prétendent avoir détruit. Ces compromis ont sapé leur crédibilité auprès des masses, et les maoïstes sont maintenant largement considérés comme des politiciens corrompus plutôt que comme des révolutionnaires.
Pendant ce temps, les violations des droits de l’homme par les forces militaires et policières ont été généralisées, et la justice reste insaisissable pour les victimes de toutes parts. L’image ternie des politiques de gauche a donné de l’espace au mouvement monarchiste ; même le récent mouvement Gen-Z a intentionnellement interdit aux partis politiques et aux syndicats de participer, craingant que ces entités imposent des programmes égoïstes. En même temps que ça a protégé l’intégrité du mouvement, cela a rendu plus difficile l’organisation pour les gauchistes plus anciens. Heureusement, le mouvement anarchiste émerge tranquillement, avec une acceptation croissante, malgré certaines idées fausses assimilant l’anarchisme au chaos.

Une voiture de police calcinée est abandonée sur la place Patan Durbar le 9 septembre 2025.
Comment la coalition au pouvoir a-t-elle émergé ? Comment comprenez-vous la différence entre les deux partis communistes, et quel est le rôle du Parti du Congrès dans la coalition au pouvoir ?
La coalition au pouvoir a émergé pour obtenir une majorité parlementaire dans un système multipartite fragmenté après la guerre. Les deux partis communistes ont adopté la corruption et les pratiques capitalistes, l’UML [le Parti communiste du Népal (Marxiste unifié–léniniste)] étant actuellement le plus organisé des deux. En raison de leur utilisation abusive des idéologies communistes et des histoires de corruption, le mouvement communiste perd rapidement du terrain, et les membres du parti sont souvent moqués lorsqu’ils revendiquent des identités communistes. Le Parti du Congrès, avec son rôle historique dans la « fin officielle » du régime Rana et du système Panchayat, reste la principale force néolibérale du gouvernement. En 2008, les maoïstes et les marxistes-léninistes se sont alliés pour voter contre le Parti du Congrès, et en 2024, le Congrès et les marxistes-léninistes se sont alliés pour voter contre les maoïstes. Bien que les différences idéologiques les aient autrefois divisés, ces distinctions ont presque complètement disparu aux yeux du peuple.
L’Inde et la Chine appartiennent toutes deux au puissant bloc industriel et commercial connu sous le nom de BRICS. Comment cela affecte-t-il les gens ordinaires au Népal ? Quels groupes aspirent à capitaliser sur le renversement du gouvernement népalais ?
L’impact de l’adhésion aux BRICS sur les Népalais n’est pas encore clair, avec des cercles politiques et intellectuels divisés. Certains considèrent les BRICS comme un moyen de réduire l’hégémonie américaine, tandis que d’autres y voient une extension de l’influence autoritaire chinoise. Le gouvernement népalais a suivi prudemment l’évolution de la relation entre l’Inde et la Chine et n’a pas encore décidé s’il devait participer aux BRICS.
Il reste incertain de savoir quels groupes bénéficieront finalement de la chute du gouvernement, mais aucune décision politique au Népal n’est prise sans l’implication de l’agence de renseignement indienne RAW [Research and Analysis Wing]. La CIA [Central Intelligence Agency] joue probablement aussi un rôle, conformément à son histoire dans les révolutions mondiales. Les principaux dangers incluent des factions royalistes susceptibles de prendre le pouvoir avec le soutien des Indiens, poussées par la politique nationaliste hindoue extrémiste, et la résurgence d’anciennes élites politiques sans changement substantiel. Alors qu’un coup d’État militaire était une menace réelle, il n’a heureusement pas eu lieu.

Le 9 septembre 2025, le parlement est en flammes.
Le Népal étant un pays enclavé avec une dépendance sociale et économique vis-à-vis de l’Inde, les investissements chinois ont quelque peu changé, avec l’ouverture d’autoroutes reliant le Népal. Pendant que la Chine et l’Inde aiguisent leur rivalité, le Népal, contrairement à d’autres nations partageant la frontière avec les géants géographiques, devient une arène de contrôle et d’équilibre…
Les deux puissances ont jusqu’à présent évité un conflit ouvert, transformant le Népal en une zone d’équilibrage géopolitique. Le Népal, géographiquement piégé entre ces deux géants nucléaires, a des options limitées pour résister à leur bras de fer sans fin. Le blocus du carburant imposé par l’Inde après le tremblement de terre de 2015 était clairement un coup de force lié au mouvement madhesi, que l’Inde a soutenu officieusement. La Chine exerce une influence en exhortant le gouvernement népalais à contrôler les manifestations liées au Tibet. Les liens culturels et l’ouverture des frontières renforcent l’influence de l’Inde, tandis que les investissements chinois, tels que les projets d’autoroutes dans le cadre de l’initiative « la Ceinture et la Route », sont largement accueillis par la population comme des opportunités d’indépendance économique vis-à-vis de l’Inde.
De nombreux obesrvateurs occidentaux examinent la relation du Népal avec la Chine et l’Inde—qui sont tous deux des partenaires commerciaux des États-Unis et d’Israël, bien que la Chine soit perçue comme un antagoniste géopolitique des États-Unis — et concluent que les insurrections au Népal et en Indonésie doivent être soutenues par la CIA et aboutir à des révolutions de couleur conçues pour installer des dictatures alignées sur l’Occident. Qu’est-ce que voud en pensez ?
Bien que l’influence étrangère de l’Inde, de la Chine et des États-Unis soit indéniable, réduire le soulèvement à une révolution de couleur soutenue par la CIA écarte la colère authentique et les sacrifices du peuple népalais. Des millions de personnes se sont mobilisées pour brûler les bâtiments du parlement, les bureaux gouvernementaux et les maisons des dirigeants politiques—non pas parce que des organisations étrangères ou nationales leur ont dit de le faire, mais à cause de décennies d’échec gouvernemental et de corruption. Étiqueter ce mouvement comme une révolution de couleur sape notre solidarité avec des mouvements populaires similaires à travers le monde. Des militants du Bangladesh, d’Indonésie et du Sri Lanka célèbrent les luttes de chacun sans les considérer comme des complots étrangers. C’est un soulèvement populaire né de l’injustice vécue. Si ces soulèvements sont des révolutions de couleur, alors des mouvements mondiaux puissants comme le Printemps arabe et Black Lives Matter le sont aussi. Il est temps pour les observateurs occidentaux de soutenir ces luttes plutôt que de les délégitimer.
Quels liens voyez-vous, le cas échéant, entre le soulèvement au Népal et les soulèvements précédents au Sri Lanka, au Bangladesh et en Indonésie ? De quelles manières ceux-ci ont-ils nourri l’imagination populaire qui a aidé à produire cette révolte ? Quelles sont les différences entre le contexte népalais et ces autres contextes ?
Les soulèvements partagent des points communs évidents, notamment la corruption généralisée, l’exclusion, le pouvoir enraciné détenu par des familles népotistes, la censure gouvernementale et une forte ingérence étrangère. Le Sri Lanka, l’Indonésie et le Népal ont chacun des histoires de mouvements communistes et d’éventuels échecs liés à ces histoires. Un lien intéressant entre le Népal et l’Indonésie est la présence de mouvements antiautoriatires actifs et l’influence culturelle de l’anime « One Piece », qui symbolise pour les jeunes des deux pays leur lutte contre l’autoritarisme.
La principale différence est que le mouvement communiste népalais a réussi à prendre le pouvoir mais s’est ensuite corrompu et a abandonné ses promesses, alimentant la désillusion populaire, alors qu’en Indonésie et au Sri Lanka, le gouvernement communiste n’a pas réussi à prendre le pouvoir.
Sur la base de votre expérience récente au Népal, avez-vous des conseils pour les personnes qui participent à la résistance populaire dans d’autres parties du monde ?
Une résistance efficace doit combiner l’éducation organisée, l’agitation et la préparation à une insurrection de masse spontanée. Préparer les gens à pousser les mouvements sociétaux dans la bonne direction est essentiel, en particulier pour gérer les vides de pouvoir créés lorsqu’un gouvernement s’effondre, qui sont souvent saisis par des forces capitalistes visant à restaurer l’ordre ancien. Les anciennes élites essaieront de reprendre le pouvoir, mais la population révolutionnaire au Népal a démontré un refus féroce, détruisant les infrastructures et affrontant physiquement les dirigeants.
Cependant, ce soulèvement n’était pas entièrement préparé pour ce qui se passera ensuite. Jusqu’à présent, nos efforts se sont concentrés principalement sur l’éducation et les manifestations, sans envisager de structures post-effondrement. Notre conseil aux camarades du monde entier est de se préparer non seulement à la révolte, mais aussi à des structures non hiérarchiques et à la reconstruction sociétale une fois que les régimes tombent.
Que font les anarchistes et les groupes anti-autoritaires au Népal ? Quelles choses concrètes pouvons-nous faire pour soutenir les efforts anarchistes et globalement anti-autoritaires au Népal ?
Des groupes au Népal organisent des ateliers, des discussions, des projections, des expositions, des soirée musicales, ainsi que des actions directes dans la rue. La majorité de nos collectifs anarchistes croient en une organisation sans hiérarchie, favorisant des conversations ouvertes même avec les communistes radicaux qui recherchent véritablement des sociétés égalitaires. Nous croyons que la solidarité au sein du mouvement de gauche est essentielle, donc nous jugeons par les actions plutôt que par l’idéologie seule. Pour soutenir ces efforts, nous exhortons à sensibiliser le public aux violations continues des droits humains, y compris la mort d’au moins 72 manifestants, dont beaucoup de jeunes, tués pour avoir exigé la fin de la corruption et du totalitarisme. Les responsables doivent être confrontés et la justice doit être faite sans délai.

Un message du 13 septembre 2025 : « Ceux qui collaborent avec la police. Vous oubliez qu’ils ont tué nos enfants. Ceux qui disent que le vandalisme, la destruction par le feu, le pillage sont injustes. Vous oubliez que c’est le résultat d’une colère collective qui était contre ce régime depuis plus de 40 ans. Que c’est le résultat de l’enfer capitaliste où les gens ne peuvent plus rếver tant ils sont bombardés par les publicités. Pensez-vous que l’élite de Katmandou était là pour piller à Bhatbhatani (la plus grande chaîne de magasins au Népal) ? Non, c’était des gens de la classe ouvrière et de la classe moyenne. Pensez-vous que Bhatbhatani ai perdu beaucoup d’argent ? Ils ont une assurance. L’hôtel Hilton a une assurance. Les parents des enfants décédés ont-ils une assurance de millions de roupies ?
Translation courtesy of la Grappe.
-
Meter-byaj est une forme de prêt avec des taux d’intérêt exorbitants. Un mouvement est né en opposition a cette mesure dans les années précédentes. ↩
-
En juin 2019, des milliers de personnes ont pris la rue pour protester contre la mise en place d’une taxe visant à nationaliser et capitaliser sur des fondations religieuses et communautaires. Connu comme “guthi,” ce système pour entrenir les temples, les services publics et l’organisation de festivals est enracinée dans la communauté Newar indigène de la vallée de Katmandou. ↩
-
La guerre civile a pris fin en 2006. ↩
-
Un mouvement pour les droits de Madhesis Tharus, les musulmans, et les groupes Janjati au Nepal, avec des vagues d’activités en 2007, 2008, et 2015. ↩
-
Lipulekh est un passsage dans l’Himalaya sur la frontière entre l’Inde et le Tibet sous contôle chinois. Le gouvernement népalais réclame des territoires au sud de ce passage, qui est sous le contrôle de l’Inde depuis la domination coloniale anglaise. ↩
-
Chirurgien et medecin activiste, le Dr. Govinda KC a mené 23 grèves de la faim pour demander des réformes. ↩
- GÉNÉRALISTES
- Basta
- Blast
- L'Autre Quotidien
- Alternatives Eco.
- Le Canard Enchaîné
- La Croix
- Le Figaro
- France 24
- France-Culture
- FTVI
- HuffPost
- L'Humanité
- LCP / Public Senat
- Le Media
- Le Monde
- Libération
- Mediapart
- La Tribune
- EUROPE ‧ RUSSIE
- Courrier Europe Centrale
- Desk-Russie
- Euractiv
- Euronews
- Toute l'Europe
- Afrique du Nord ‧ Proche-Orient
- Haaretz
- Info Asie
- Inkyfada
- Jeune Afrique
- Kurdistan au féminin
- L'Orient - Le Jour
- Orient XXI
- Rojava I.C
- INTERNATIONAL
- CADTM
- Courrier International
- Equaltimes
- Global Voices
- I.R.I.S
- The New-York Times
- OSINT ‧ INVESTIGATION
- OFF Investigation
- OpenFacto°
- Bellingcat
- Disclose
- Global.Inv.Journalism
- MÉDIAS D'OPINION
- AOC
- Au Poste
- Cause Commune
- CrimethInc.
- Hors-Serie
- L'Insoumission
- Là-bas si j'y suis
- Les Jours
- LVSL
- Médias Libres
- Politis
- Quartier Général
- Rapports de force
- Reflets
- Reseau Bastille
- Rézo
- StreetPress
- OBSERVATOIRES
- Armements
- Acrimed
- Catastrophes naturelles
- Conspis
- Culture
- Curation IA
- Extrême-droite
- Human Rights
- Inégalités
- Information
- Internet actu ✝
- Justice fiscale
- Liberté de création
- Multinationales
- Situationnisme
- Sondages
- Street-Médics
- Routes de la Soie