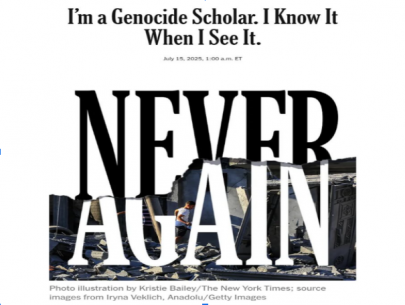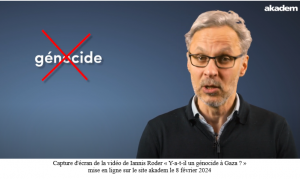15.09.2025 à 18:11
Perquisitions contre l’Union Juive Française pour la Paix De l’antisémitisme qui vient.
Persécuter des personnes juives parce qu’elles combattent un génocide, ça ne vous rappelle rien ? Non. En tout cas, pas si vous êtes un acteur officiel de la lutte contre l’antisémitisme en France. L’annonce de la perquisition au domicile d’un membre de l’UJFP , pour un texte publié sur leur site et concernant les massacres en Palestine n’a déclenché aucune réaction particulière, pas plus que la fermeture de leur compte bancaire qui a précédé. C’est normal : la propagande israélienne et la propagande française ont fabriqué une définition très particulière de l’antisémitisme qui a totalement détruit le travail de pédagogie sur la nature de l’antisémitisme européen. L’histoire de l’extermination des Juifs d’Europe et ses prémices a été dévoyée. Jusqu’ici, l’antisémitisme était considéré comme le fait de s’en prendre à des Juifs parce que Juifs. Naturellement, cela pouvait également concerner des sionistes ou des Israéliens. Par exemple, un rabbin qui se fait agresser en pleine rue, c’est antisémite, qu’il soit sioniste ou antisioniste. Mais aujourd’hui la définition étatique et médiatique est à la fois plus restreinte et plus large. Plus large parce que toute prise de position contre l’État d’Israël est de l’antisémitisme. Il n’y a pas à nuancer : seuls ceux qui ne remettent en cause que le gouvernement actuel, et sans prononcer le mot génocide, sont exonérés de cette accusation. Plus restreinte parce que l’antisémitisme ne serait plus que cela. Exit les principaux schémas antisémites européens, dont ceux qui permettent de frapper l’UJFP mais ont également permis la persécution d’État par le passé. Quels sont-ils ? Le Juif apatride : dans le temps génocidaire occidental contre les Palestiniens, le bon Juif est nationaliste. Doublement. Il doit prêter allégeance à Israël mais également au pays occidental dans lequel il vit. Le Juif non sioniste et critique de l’État — donc de la France — est considéré au mieux comme ne pouvant être victime d’antisémitisme, au pire comme faux Juif. Ce dernier cas concerne tout particulièrement l’UJFP : très régulièrement, des fascistes ricanent en exigeant de leur part des « certificats de judaïté » sur les réseaux. Dans les procès, parmi tous les soutiens des Palestiniens présents, ils sont systématiquement la cible de moqueries et d’injures tels que « Juifs de service », et tout spécialement ceux qui portent la kippa. Et ce, de la part de parties civiles Israël qui collaborent avec l’extrême droite française et prennent un soin tout particulier à ne montrer aucun signe visible de leur foi ou de leur identité, comme s’il fallait être plus blanc que les blancs. Sauf lorsqu’il s’agit de prendre la parole pour défendre Israël. Le Juif immigrationniste : Le Juif, ferment de l’affaiblissement de la nation. Le Juif antisioniste est caricaturé comme faible et soumis aux musulmans. Dans le cadre de l’idéologie de la guerre des civilisations, il est désigné comme double traître à la nation : il affaiblit la colonie, Israël, et la métropole, en l’occurrence la France. Sa seule existence est une menace pour l’Occident car il est également… Le Juif complotiste et mondialiste. La perquisition contre l’UJFP a été précédée de la fermeture de son compte bancaire, mesure inédite contre une organisation juive depuis la Seconde Guerre mondiale et liée à son soutien financier à des organisations humanitaires présentes en Palestine. C’est ici évidemment la réactivation du mythe du Juif riche et comploteur qui œuvre pour la victoire mondiale du métissage et le remplacement de la race blanche supposée, même en Occident. Théorie défendue par le parti d’Orban en Hongrie mais aussi par une partie des soutiens de Donald Trump. Actuellement aux États-Unis, un nouveau mouvement Old Glory Club composé de suprémacistes blancs de la haute société (militaires, membres de l’administration des États, hauts fonctionnaires, avocats, juges) propage de nouveau cette thèse et appelle au boycott des commerces et des entreprises supposées appartenir à des Juifs. C’est très loin de la réalité française ? Seulement en apparence. À l’intérieur du mouvement de solidarité avec la Palestine, où se côtoient de nombreuses organisations de gauche et d’extrême gauche, l’UJFP est ciblée par une répression spécifique depuis le début du génocide. Ce n’est pas étonnant : l’antisémitisme et l’islamophobie s’alimentent mutuellement. La loi « Séparatisme » était quasi explicitement fondée sur les thèses maurrassiennes élaborées pour les Juifs au départ. Les références de Darmanin à la politique antisémite napoléonienne annonçaient la suite. Tout comme le fait de définir l’antisémitisme de manière étatique et totalement autoritaire. La suite est une forme d’antisémitisme d’État. Naturellement, cette conclusion suscitera des ricanements incrédules. Exactement les mêmes que suscitait la dénonciation du danger soralien, du conspirationnisme et du négationnisme montant au milieu des années 2000. Le propre des phases antisémites européennes depuis la Seconde Guerre mondiale est toujours d’être accueillies avec incrédulité au départ. Tout simplement parce que la France est la championne du monde de la bonne conscience non fondée. Cela fait presque 80 ans que les Français sont certains que leurs grands-parents et arrière-grands-parents ont sauvé des Juifs. Tous. À chaque fois que l’antisémitisme revient dans ce pays, c’est un détail de l’histoire et toujours la faute de mauvais Juifs. Celui de la période qui s’ouvre sera l’Antisioniste. Si c’est la racaille, évidemment nous en sommes, once again. Solidarité avec nos camarades de l’UJFP. Texte intégral 1194 mots
Les camarades de l’UJFP sont attaqués parce qu’ils sont visiblement aux côtés de toutes les luttes de l’immigration musulmane. La Palestine, mais aussi les luttes pour les droits des réfugiés. Et ce, dans un Occident qui assume de nouveau la déportation massive des Autres comme projet de société.
Un parti comme Reconquête tient ouvertement des thèses négationnistes sur Vichy et Pétain, qui aurait sauvé des Juifs.
28.07.2025 à 16:51
Face à l’islamophobie, le temps de l’union est venu.
L’heure est très grave et c’est bien le moins qu’on puisse dire. L’Islam et les musulmans de France sont visés et ciblés par les moyens de l’État ; et c’est bien leur attachement à la religion stricto sensu qui dérange la ligue politico-médiatique et non un quelconque réel ou supposé extrémisme dans la pratique de l’islam. Il n’y pas non plus la moindre preuve ou un quelconque signe de laxisme et non-respect par ces musulmans des lois ou valeurs de la République. Inutile donc de tourner autour du pot et tergiverser à nommer les choses comme il se doit. Par ailleurs, « Mal nommer les choses c’est rajouter au désordre du Monde » disait Camus. Et Dieu sait que certains d’entre nous continuent encore aujourd’hui à se voiler la face et ne pas se décider à reconnaitre une réalité : il y a bien une islamophobie d’État en France ; structurelle et non conjoncturelle ; systémique et non isolée ou épisodique. Le masque de « la lutte contre « le radicalisme », « le djihadisme », « l’intégrisme », « le salafisme »… et autres ismes qui était la couverture ces vingt dernières années ; ce masque-là est désormais tombé. Le fait que l’État -je dis bien l’État-, ne s’embarrasse plus d’aucune contradiction ni d’aucun paradoxe, pour qu’en moins de quatre ans (2021-2025), accuse un pan entier des musulmans français, hier de « séparatisme » et aujourd’hui « d’entrsime » : cela est la meilleure preuve d’une attitude plutôt obsessionnelle, qui n’a rien de rationnel, faut-il le souligner. Le dernier communiqué de l’Élysée (du lundi 7 juillet) qui fait suite à, tenez-vous bien, un Conseil de défense et de sécurité national (CDSN), consacré à la lutte contre l’islamisme et aux phénomènes de séparatisme et d’entrisme, prévoit une nouvelle loi pour la rentrée en automne. Les cinq grands aspects de celle-ci sont d’ores et déjà connus. Mais que dis-je en fait ? Réellement, ces cinq « futures lois » sont déjà connues, et mises en œuvre depuis quelques petites années : gels des avoirs des individus et associations et/ou fermetures de comptes ; dissolution d’associations ; fermetures de locaux ; sans oublier le fermeture des maisons d’éditions et la censure de certains livres existants depuis des siècles. Que faut-il faire, alors ? Que doit-on faire et dans quel but précisément le ferons nous ? Je tiens donc à le dire haut et fort -en mon nom en le vôtre si vous le permettez !-, Nous les musulmans de France, sommes surtout victimes de notre léthargie, de notre évitement à faire face à notre responsabilité collective. Nous ne sommes ni victimes ni coupables de ce qui nous est arrivé ou arrive encore ; mais nous en sommes entièrement responsables ! Oui ! Nous en sommes pleinement responsables. Soyons francs et sincères envers nous-mêmes. Nous, acteurs ( soi-disant ou réellement) agissant pour les intérêts des musulmans et défendant leurs droits, pouvons-nous ignorer que cette accusation d’« entrisme » était plus ou moins prévisible ? Notamment après la loi sur le séparatisme votée en août 2021 ? Comment avons-nous réagi à cette dernière loi ? Qu’avons-nous entrepris comme actions pendant le débat sur cette loi ? Qu’avons-nous fait après le vote de celle-ci ? Pas grand-chose, fort hélas ! voilà ce qui fait de nous des responsables (quand ce n’est pas tout fait des complices) de ce qui nous arrive. Mes chers frères et sœurs ! Nul ne peut en douter, la France est un pays de droits ! Un pays de libertés ! Mais ni les droits ni les libertés ne sont offerts à qui que ce soit sur un plateau en argent. Il faut revendiquer ses droits, et les préserver ; il faut défendre ses libertés et ne rien lâcher. voilà le seul moyen, et l’unique chemin sans lesquels la dignité et la respectabilité ne seront que des vœux pieux, pour ne pas dire des chimères. Cette mise au point étant faite, voici donc mes propositions . D’ores et déjà et avant la rentrée en septembre, nous devons non seulement réagir en conséquence des défis que nous impose l’agenda macroniste ; mais ce que nous devons entreprendre doit être INEDIT. Et par inédit, j’entends qu’il doit sortir de l’ordinaire : Des actions jamais entreprises dans leur ampleur, leur caractère ou leur manière. Il faut surprendre et marquer les esprits habitués à deviner nos actions molles, peu conséquentes et surtout empreintes d’émotivité réactionnelle : 1. Des procès historiques contre les mesures de l’État. Exemple face à la prévisible fermeture de l’IESH da Château Chinon et la dissolution de sa structure, engager un procès avec 5 cinq avocats au minimum. Ça sera un procès inédit dans sa forme. Le signal sera très fort et le procès servira de leçon et, son délibéré, je l’espère de jurisprudence. 2. Sensibiliser les maisons d’éditions et les grands libraires musulmans (et quand bien même nous ne pouvons les convaincre tous à se joindre à l’action, une douzaine suffit largement) à constituer une équipe de 7 à 10 avocats (ça coûtera entre 40k€ et 60k€, et ça vaut le coup) pour défendre la liberté d’expression, la liberté de Culte et la liberté d’édition. Rappelons qu’en France, depuis 1937, aucune maison d’édition n’a été réprimée et/ou fermée. Alors qu’en moins de quatre ans, nous en sommes à 5 ou 6 éditeurs musulmans, administrativement et politiquement fermés, sans la moindre décision de justice. Ce scandale qui se déroule dans le pays de Voltaire, Hugo, et de « je suis Charlie » qu’il soit rappelé au passage, est une honte sans noms. L’histoire retiendra que la France, pays de la déclaration des droits de l’homme, des maisons d’éditions musulmanes sont fermées par le pouvoir exécutif dans un silence total des défenseurs de la LIBERTÉ D’EXPRESSION ! 3. Mettre en place rapidement un collectif inter associatif de défense des droits des musulmans. Un collectif n’a pas besoin d’être déclaré à la préfecture, ni même d’avoir des statuts officiels. Ce C.IA.D.D.M doit avoir un discours nouveau adapté au contexte actuel : À la fois RESPONSABLE, DIGNE, et TRĖS ENGAGÉ. Un témoignage pour clore cette courte tribune : Ces derniers mois, j’ai croisé de nombreux concitoyens et concitoyennes musulmans, qui m’ont fait part de leur soutien et surtout fierté quant à ma réaction suite à la perquisition que moi et ma famille avions subie ; ils m’ont surtout expliqué combien ils ont éprouvé de la fierté et l’assurance de voir enfin, pour la première fois un imam porter plainte contre l’État. Paris, Juillet 2025 Texte intégral 1472 mots
Quand on pointe cette islamophobie systémique, il n’est pas du tout question d’une quelconque sorte de victimisation ; et encore moins de culpabilisation. Cette dernière, (la culpabilité sans jugement ni procès), faut-il le souligner, nombreux sont ceux qui, au sein de la ligue politico-médiatique, cherchent à nous la faire ressentir, et souhaiteraient par conséquent que nous adoptions un langage contrit.
Effectivement, j’ai porté plainte contre l’exécutif au gouvernement incarné par son représentant, le préfet du 91. Être citoyen français, c’est l’être à part entière et n’admettre jamais qu’on viole mon domicile sous un prétexte fallacieux. Le procès aura lieu le lundi 15 septembre 2025 à 09h30 à Paris.
PS et NB : Il va sans dire que ces propositions n’ont aucun sens et n’auront aucun effet, si nous n’avons pas le courage -chacun d’entre nous, s’entend- de se faire violence s’il le faut et trouver la force et la conviction profonde de changer son logiciel, notamment par rapport aux devoirs et obligation canoniques, devoirs et obligations morales, citoyennes et politiques d’être unis et faire corps avec tous les musulmans de France, sans partisanisme aucun. Les musulmans sont trop divisés en France. Leurs efforts seront sans le moindre effet sans une convergence, coordination et union sincère.
L’union fait la force et la désunion nous rend tous faibles et vulnérables.
Fraternellement, Noureddine AOUSSAT
24.07.2025 à 10:04
« Il est curieux de constater que seule la vérité peut nous choquer. C’est peut-être aussi une remarque pleine d’espoir, car cela implique que nous sommes capables de reconnaître la vérité. Un jour viendra, espérons-le, où le choc de la reconnaissance sera une joie et non un traumatisme, une libération et non une contrainte : car il est absolument et éternellement vrai que tous les hommes sont frères, et que ce qui arrive à l’un d’entre nous arrive à tous. » – James Baldwin. Il y a quelques jours, le 15 juillet 2025, l’historien israélien Omer Bartov, spécialiste de la destruction des populations juives d’Europe, professeur en études des génocides à l’université Brown aux Etats-Unis, a publié une tribune très précise dans le New York Times intitulée « Je suis un spécialiste des génocides. Je sais reconnaître un génocide quand j’en vois un». Ce n’est pas sa première prise de parole publique sur le caractère génocide de la guerre d’annihilation que livre l’État d’Israël dans la bande de Gaza. Dès le mois de novembre 2023, un mois après le massacre du 7 octobre où 700 personnes de la population civile israélienne ont été assassinées parmi les 1200 victimes de l’opération du Hamas, Omer Bartov écrivait dans le même journal, déjà inquiet des premiers signes avant-coureurs du risque génocide : « En tant qu’historien spécialiste des génocides, je pense qu’il n’existe aucune preuve qu’un génocide soit actuellement en cours à Gaza, même s’il est très probable que des crimes de guerre, voire des crimes contre l’humanité, sont commis. Cela signifie deux choses importantes : premièrement, nous devons définir ce dont nous sommes témoins, et deuxièmement, nous avons la possibilité d’arrêter la situation avant qu’elle ne s’aggrave. L’histoire nous enseigne qu’il est essentiel d’alerter sur le risque de génocide avant qu’il ne se produise, plutôt que de le condamner après coup. Je pense que nous avons encore le temps d’agir. (…) Il est temps que les dirigeants et les éminents chercheurs des institutions consacrées à la recherche et à la commémoration de l’Holocauste mettent publiquement en garde contre les discours empreints de rage et de vengeance qui déshumanisent la population de Gaza et appellent à son extermination. (..) J’exhorte des institutions aussi vénérables que le Musée mémorial de l’Holocauste des États-Unis à Washington, D.C., et Yad Vashem à Jérusalem à intervenir dès maintenant et à se placer en première ligne pour dénoncer les crimes de guerre, les crimes contre l’humanité, le nettoyage ethnique et le crime des crimes, le génocide. » Il n’en a rien été. Son appel pourtant précoce auprès des institutions mentionnées non seulement n’a pas été entendu mais, à l’inverse, Yad Vashem, par la voix du président de son comité directeur, Dani Dayan, a participé à la légitimation et à la justification de la guerre de Gaza en niant que des crimes génocides s’y déroulaient ou même pourraient s’y dérouler : « Parler de génocide à Gaza est une falsification de la vérité », déclarait-il. Shira Klein dans un article du Journal of Genocide Research publié en janvier 2025 qui décrit le clivage de plus en plus prononcé entre les spécialistes de la Shoah sur la question de Palestine et sur la question d’Israël, remarquait de son côté : « Plusieurs institutions de recherche sur l’Holocauste, dont les plus connues, se sont jointes au chœur des défenseurs d’Israël ou sont restées silencieuses. (…) Yad Vashem a pris la tête de la défense de l’attaque israélienne contre Gaza, ce qui n’est pas surprenant, compte tenu du fait qu’il s’agit d’une institution publique, mais aussi que son président, Dani Dayan, est un colon et ancien président du « Conseil Yesha », la fédération des municipalités juives de Cisjordanie.» C’est ainsi qu’Omer Bartov ne pouvait faire hier que le triste constat suivant : « À ce jour, seuls quelques spécialistes de l’Holocauste, et aucune institution dédiée à la recherche et à la commémoration de celui-ci, ont mis en garde contre le fait qu’Israël pourrait être accusé de crimes de guerre, de crimes contre l’humanité, de nettoyage ethnique ou de génocide. Ce silence a tourné en dérision le slogan « Plus jamais ça », transformant sa signification d’affirmation de la résistance à l’inhumanité où qu’elle se produise en excuse, voire en carte blanche pour détruire autrui en invoquant son propre passé de victime. » Qu’en est-il en France ? L’institution équivalente en France à Yad Vashem en Israël ou au Musée mémorial de l’Holocauste aux Etats-Unis évoqués par Omer Bartov est le Mémorial de la Shoah à Paris, dirigé par Jacques Fredj. C’est une institution précieuse qui effectue un travail indispensable, pas seulement dans son volet mémoriel et commémoratif, mais aussi en raison de son fonds d’archives (le Centre de Documentation Juive Contemporaine), de sa revue (la Revue d’Histoire de la Shoah), de ses actions de formations auprès d’un public enseignant pour transmettre le mieux possible l’Histoire de la destruction des Juifs d’Europe et des génocides auprès des jeunes générations. Le Mémorial de la Shoah est aussi un lieu de réflexion sur l’histoire comparée des autres génocides, notamment de trois grands crimes génocides officiellement labellisés, celui des Arméniens perpétré par l’Empire ottoman, celui des Roms et Sinti perpétré par le régime nazi, celui des Tutsi perpétré par le pouvoir hutu au Rwanda. Depuis 2005, la politique et la stratégie du Mémorial de la Shoah sont bien d’ouvrir la réflexion de cette institution à cette histoire comparée des génocides et de sensibiliser à la question de la prévention des crimes génocides. Avec la limite suivante : le Mémorial de la Shoah ne fait pas d’histoire immédiate, elle n’envisage le crime génocide que lorsque ceux-ci font unanimité au regard des historiens et de leur reconnaissance officielle. Et cette limite entre en forte contradiction avec la mission de prévention des crimes génocides que revendique pourtant cette institution, que cela se passe dans les territoires palestiniens ou ailleurs comme pour le peuple ouïghour dans le Xinjiang en Chine. Vous serez donc bien en peine de trouver le moindre communiqué du Mémorial de la Shoah ne serait-ce que pour s’inquiéter de la possibilité qu’un crime génocide se déroule ou non à Gaza et dans les territoires occupés de Cisjordanie. Silence radio. Pourtant, en janvier 2024, alors que des signes inquiétants de risque génocide apparaissent déjà pendant la guerre de Gaza, avec une proportion majoritaire de femmes et d’enfants tués, Jacques Fredj accorde un entretien à la veille de la Journée Internationale de la mémoire des génocides et de la prévention des crimes contre l’humanité. Il est repris notamment dans un média israélien francophone, où il vante à juste titre les actions menées au sein de son institution pour développer « une histoire comparée des génocides ». Il déclare notamment : « Si on veut faire de la prévention, il faut replacer la Shoah dans un contexte plus long de l’histoire des génocides (…). On va parler de l’ensemble des procédures génocidaires parce qu’il n’y a pas de concurrence des mémoires, mais des spécificités propres à chaque génocide » . Quand il en a l’occasion, Jacques Fredj martèle avec raison ce discours en faveur d’une histoire comparée des génocides et rappelle la nécessité de prévenir les crimes génocides quand on peut déceler « des procédures génocidaires », ou un risque de crime génocide. On peut en trouver un exemple développé dans l’épisode n° 166 du podcast natif Vlan! réalisé par Grégory Pouy en mars 2021, intitulé « Comprendre le phénomène des génocides pour les éviter, avec Jacques Fredj » Au moment même où un mécanisme génocide se déroule à Gaza et en Cisjordanie, qui inquiète toute la planète, pas un mot n’est prononcé par Jacques Fredj sur la situation à Gaza alors que c’est l’actualité tragique du moment en terme de risque et de prévention des crimes génocides. Les savants africanistes n’ont pris que quelques semaines pour alerter sur le risque génocide au Rwanda. Comment se fait-il qu’il soit si difficile et si long d’alerter sur le risque génocide dans la bande de Gaza et en Cisjordanie ? Ce silence du Mémorial de la Shoah rejoint donc celui de Yad Vashem ou du Musée mémorial de l’Holocauste des États-Unis car ces instances, en étant profondément liées à l’État d’Israël, sont incapables d’envisager que cet État, comme d’autres, peut enclencher lui aussi un phénomène génocide. Mais ce silence, déjà contestable en soi pour une institution engagée dans l’histoire comparée des génocides et dans la prévention des risques de crime génocide est-il total ? Pas tout à fait… En effet, le responsable des formations au Mémorial de la Shoah, l’enseignant d’histoire et essayiste Iannis Roder qui participe très activement au débat public en son nom propre sur l’antisémitisme en France, et spécialement à l’école, invité régulier des émissions télévisuelles pour y donner son expertise, a pris part au débat public pour qualifier ou non de « génocide » les crimes commis à Gaza par l’armée israélienne. Contributeur prolifique sur le média culturel akadem, pour lequel il est conférencier, il délivre en février 2024 sous la forme d’une vidéo des arguments pour le moins curieux afin de nier le caractère génocide des massacres de civils ainsi que le terme de « nettoyage ethnique », sur un ton lourdement didactique et simpliste comme s’il s’adressait à des élèves de collège. Cinq mois après le déclenchement de la guerre d’annihilation et de destruction de Gaza, tous les poncifs usés jusqu’à la corde reprenant les éléments de langage de la propagande de l’armée et du gouvernement israélien, matraqués en continu dans les médias occidentaux, sont présents dans son argumentaire. Il prend la précaution de nuancer à la marge pour donner assez maladroitement un aspect de neutralité et d’impartialité à son exposition biaisée de faits avérés tout en se démarquant du gouvernement de Netanyahou dont il dit que les déclarations génocidaires des ministres les plus suprémacistes sont faites en leur nom propre. Il fait comme si elles n’engageaient pas l’ensemble du gouvernement. Le Premier Ministre Benjamin Netanyahou n’a jamais démis de leurs fonctions les membres les plus virulents du gouvernement, ceux qui n’ont eu de cesse d’inciter non pas à l’objectif de guerre affiché, la destruction de Hamas et la libération des otages, mais bien à la destruction des Palestiniens. C’est un ressort classique de la politique de Netanyahou de laisser ses ministres faire des discours d’appel à la haine pour passer lui-même pour un modéré. Sharon en son temps utilisait la même ficelle grossière. Il en va aussi de l’argument démographique développé par Iannis Roder pour exprimer l’idée que des victimes collatérales sont regrettables mais inévitables, sans prendre la peine d’expliquer que la population gazaouie est soumise à un blocus depuis juin 2007, ni que les frappes par drones ou missiles ainsi que les éliminations ciblées de combattants du Hamas obéissent à des ratios et à des règles militaires rendant licites les pertes civiles et la mort de dizaines de civils pour un combattant du Hamas, ni que des snipers tirent indistinctement sur n’importe quelle silhouette humaine aux abords des hôpitaux, ni que la majorité des victimes de la « guerre au terrorisme » sont déjà à ce moment des femmes et des enfants. Iannis Roder soutient aussi que l’armée israélienne présentée comme l’armée la plus morale du monde avertit préventivement la population qu’elle va procéder à des frappes sur des zones habitées transformées en zones de guerre, ce qui serait le signe selon lui que ces opérations ne peuvent être des crimes génocides. Ces informations dites préventives délivrées à la population civile gazaouie n’ont en fait jamais empêché leurs massacres. Elles n’ont jamais concerné les populations civiles autrement que pour organiser leurs déplacements forcés et répétés, par centaines de milliers. Elles ont en revanche été toujours un cache-sexe du permis de tuer indistinctement, destinées essentiellement à l’opinion publique mondiale pour convaincre qu’Israël respecte le droit international et le jus in bello. Iannis Roder élude aussi complètement dans sa présentation le fait que cette guerre d’anéantissement se déroule sans témoins extérieurs, les médias internationaux étant interdits d’accéder au théâtre de guerre, le fait aussi que l’armée israélienne a tué à ce jour près de 250 journalistes et photo-reporters gazaouis présents sur place alors que c’est un marqueur très fort de la volonté de dissimuler les crimes perpétrés. Il déforme la réalité du contenu de la décision rendue par la Cour Internationale de Justice (CIJ) le 26 janvier 2024 dans la saisine déposée par l’Afrique du Sud. Iannis Roder déclare que la CIJ a dénié tout caractère génocide à la conduite de la guerre menée à Gaza, alors qu’à ce stade de la procédure la CIJ affirme simplement qu’elle n’est pas tenue de statuer sur ce point mais qu’elle confirme le risque du crime génocide en ordonnant 6 mesures conservatoires à l’encontre de l’Etat d’Israël pour prévenir le génocide, résumés ici par Amnesty International. Autre élément de langage euphémisé employé par Iannis Roder tiré directement de la propagande israélienne : les multiples déplacements forcés de population dans la bande de Gaza pour détruire méthodiquement le bâti et les infrastructures de base est présenté de manière très caractéristique comme une « fuite » . C’est exactement le terme ancré profondément dans le récit national israélien qui avait déjà été utilisé en 1948 lorsque les déplacements forcés et l’expulsion de centaines de milliers de palestiniens accompagnés de la destruction de centaines de villages avaient été présentés comme une « fuite » organisée à l’appel de Nasser. Cette « fuite » ne sera examinée en profondeur et remise en cause par des historiens israéliens aussi bien sionistes (Benny Morris) qu’antisionistes (Ilan Pappé) qu’à partir de la fin des années 1980, le premier considérant que les massacres des civils sont liés aux circonstances ordinaires des guerres, le second qu’ils font partie d’une stratégie préméditée de la terreur visant à expulser les Palestiniens par la violence. Iannis Roder s’emploie donc à humaniser une armée israélienne qui se livre à un crime génocide plutôt que d’humaniser les victimes civiles palestiniennes. Est-il utile de rappeler que Iannis Roder a été l’un des co-auteurs des « Territoires perdus de la République », coordonné par Georges Bensoussan qui a lui-même longtemps travaillé au Mémorial de la Shoah ? Le titre de cet ouvrage est devenu une expression commune dans le langage politique courant. Ce livre bricolé et pipeauté a eu une importance considérable dans la mesure où il a été repris par toute la classe politique de la gauche réformiste jusqu’à l’extrême-droite pour fabriquer en le surdimensionnant l’idée d’un « antisémitisme des banlieues » générique et islamique. Il a été notamment décisif lors de la campagne présidentielle de 2007 quand Nicolas Sarkozy a orienté sa campagne sur le thème de l’insécurité et a capté une grande partie de l’électorat des Juifs de France sur le thème de l’incapacité de la gauche à lutter contre l’antisémitisme, alors que cet électorat était majoritairement et traditionnellement acquis jusque-là à la gauche républicaine modérée, lointain héritage de la Révolution et du dreyfusisme. Ce livre a alimenté la xénophobie et l’islamophobie, dans les suites désastreuses en Occident de l’après 11 septembre et de la Seconde intifada. Il a aussi participé de manière pionnière au dévoiement de la notion de laïcité. Il est devenu une boîte à outils dirigée spécifiquement et indistinctement à l’encontre des populations africano-musulmanes en France assimilées à des barbares et devenues les représentantes d’un « antisémitisme atavique [que l’] on tête avec le lait de sa mère » , selon la formule prononcée par Georges Bensoussan lors d’une émission sur France Culture en 2015. Ce dérapage verbal a entraîné son limogeage sans préavis du Mémorial de la Shoah où il avait la même responsabilité des formations que Iannis Roder exerce aujourd’hui, dans une belle continuité, ainsi que la fonction de rédacteur en chef de la « Revue d’histoire de la Shoah ». Georges Bensoussan avait été relaxé des plaintes pour incitation à la haine raciale sous le motif que sa formule était une simple figure de rhétorique, une métaphore. Non. Les catachrèses sont idéologiques. Elles sont les préalables et les justifications des pires crimes à venir. Elles font partie d’un langage ordinaire d’endoctrinement tel qu’Otto Klemperer l’avait lucidement décrit dans « LTI la langue du IIIe Reich ». C’est le langage désormais de LQI, la Lingua Quartii Imperii, la Langue du Quatrième Empire occidental fascisto-trumpiste, en cours de construction dans les démocraties européennes qui se refusent toujours de sanctionner Israël. Les euphémisations de Iannis Roder appartiennent au même ordre de discours, quand bien même elles sont formulées d’une manière plus prudente, moins passionnée, qui les rendent d’autant plus dangereuses. Ces procédés rhétoriques préparent le conditionnement des esprits et l’acceptation d’une vision du monde où l’instrumentalisation politique de l’antisémitisme le dévoie et le renforce. L’actuel ministre de la Défense du gouvernement Netanyahou Israël Katz avait utilisé exactement la même image en 2019 lorsqu’il avait déclaré que les Polonais « allaitent l’antisémitisme avec le lait de leur mère » (c’est en fait la reprise d’une formule célèbre prononcée en 1989 par Yitzhak Shamir alors Premier ministre d’Israël) et les avaient accusés de tous nourrir un antisémitisme « inné », congénital et héréditaire. Georges Bensoussan et Iannis Roder partagent un même soutien inconditionnel à Israël quelles que soient les circonstances : ils ne parlent pas au nom du Mémorial de la Shoah mais le fait d’y travailler ou d’y avoir travaillé leur permet et leur a permis de se prévaloir de cette instance pour légitimer et asseoir leur discours. Le Mémorial de la Shoah n’a produit aucun communiqué pour se désolidariser des propos de Iannis Roder, quand il explique pédagogiquement et autoritairement que la guerre de Gaza n’est pas un crime génocide. Ce qui relie aussi les discours des deux hommes, c’est la faillite intellectuelle d’une certaine gauche. Georges Bensoussan dans le versant ancien du souverainisme de gauche et du chevènementisme qui a glissé progressivement vers la droite ; Iannis Rodder dans le versant réactualisé de la gauche autoritaire, longtemps incarnée par Manuel Valls quand il était au Parti Socialiste, et qui a glissé elle aussi progressivement vers la droite, voire l’extrême-droite (Les militants de Riposte laïque ou du Printemps Républicain comptent bon nombre de personnes initialement de ces deux gauches) en devenant macron-compatible voire lepéno-compatible. *** Pour terminer et situer d’où j’écris. J’ai rencontré Georges Bensoussan en ayant participé à la toute première Université d’été de l’enseignement de la Shoah qu’il avait organisée et coordonnée en 2002 au sein du Mémorial de la Shoah, à une époque où cet enseignement dans les collèges et lycées était particulièrement défaillant, à une période où les enseignants d’histoire ne faisaient pas vraiment de différence auprès de leurs élèves entre les camps de concentration et les camps de mise à mort industrielle, à un moment où ils ne savaient pas clairement ce qu’avaient été les Einsatzgruppen et ce qu’on a appelé la « Shoah par fusillade » en Ukraine, Lituanie et Lettonie. Ces formations permettaient aux enseignants du secondaire de réactualiser leurs connaissances en les tenant informés du renouvellement de l’historiographie. Je ne pense pas que sa place était dans un prétoire malgré les horreurs qu’il a débitées, pas plus que cela n’aurait dû être la place de François Burgat récemment, nous en reparlerons dans la deuxième partie de cette série feuilletonnée consacrée au silence timoré des historiens qui travaillent au sein de l’université et des instances de recherche publiques en France. Il n’est jamais très sain dans une démocratie de poursuivre judiciairement des historiens ou des chercheurs, de les accuser sommairement d’incitation à la haine raciale ou d’apologie du terrorisme. Je puis témoigner que Georges Bensoussan effectuait un travail remarquable au Mémorial de la Shoah, même si je ne partageais pas du tout ses options à propos de l’Etat d’Israël, à propos de son sionisme de gauche incarné par le mouvement La Paix Maintenant, à propos du mirage de la solution à deux États (une « mascarade » selon l’expression du journaliste le plus haï en Israël, Gideon Levy), qui a entraîné la faillite totale de la gauche sioniste en Israël et ouvert un boulevard au fascisme israélien actuel en participant notamment à des gouvernements de coalition qui ne cherchaient qu’à retarder les négociations pour continuer à coloniser la Cisjordanie. Ses livres de vulgarisation (Auschwitz en héritage) comme ses livres plus savants (son Histoire politique et intellectuelle du sionisme, par exemple ) restent des outils précieux à partir desquels il est possible de comprendre bien des éléments historiques même quand on n’en partage pas toute la philosophie. Il avait eu aussi la gentillesse de m’ouvrir en pleine Seconde Intifada son carnet d’adresse en Israël pour me permettre de rencontrer des interlocuteurs formidables, sans que je lui cache que je me rendrais aussi dans les territoires occupés de Gaza et de Cisjordanie au sein d’un collectif EduFIP (Education France-Israël-Palestine), monté avec quelques enseignants pour à la fois améliorer l’enseignement du conflit israélo-palestinien dans les établissements secondaires en France et travailler directement avec des enseignants israéliens (indifféremment Israéliens juifs et « Palestiniens de 1948 » expression qui désigne la minorité palestinienne vivant en Israël et qui représente 20% de la population totale) et des enseignants palestiniens des territoires occupés. Aussi n’ai-je pas participé à la curée qui a eu lieu à son encontre dans certains collectifs d’enseignants d’histoire comme le groupe Aggiornamento autour de Laurence de Cock. Pas plus que que la manière dont il a été mis à la porte du Mémorial de la Shoah ne semble juste. En un certain sens, le Mémorial de la Shoah a perpétué et imité par cette éviction le mépris que les élites ashkénazes ont longtemps porté, et portent sans doute encore, aux Juifs de Méditerranée séfarades en Israël. [La semaine prochaine, deuxième volet de l’enquête : Le silence timoré du côté des universités et instances de recherche publiques françaises] Texte intégral 4758 mots
[1] Le silence loquace du Mémorial de la Shoah