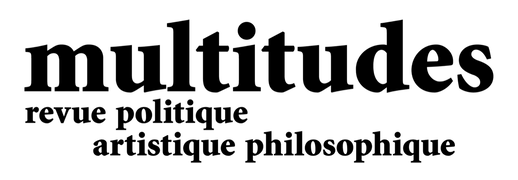25.09.2025 à 11:31
Care Une puissance de contestation
Care
Une puissance de contestation
Et si les objections (françaises) au care aidaient à mieux comprendre sa centralité pour penser les inégalités globales, l’exploitation conjuguée des ressources humaines et naturelles, et la crise socio-environnementale ?
Care
A Force for Protest
What if (French) objections to the notion of care helped us to better understand its centrality in thinking about global inequalities, the combined exploitation of human and natural resources, and the socio-environmental crisis?
L’article Care <br>Une puissance de contestation est apparu en premier sur multitudes.
La revue Multitudes a depuis des décennies mené deux combats féministes en parallèle, celui du genre et celui du care qu’elle a très tôt introduit en France, quelques années après la publication de deux ouvrages devenus classiques, Le souci des autres (Patricia Paperman et Sandra Laugier, 2006) et Qu’est-ce que le care ? (2009) avec une Majeure historique en 2009, Politiques du care (Sandra Laugier et Pascale Molinier, no 37‑38). En revendiquant de manière pionnière une éthique hétérodoxe, la revue proposait aussi un féminisme alternatif et radical. Le mot care, courant en anglais, est à la fois un verbe qui signifie « s’occuper de », « faire attention », « prendre soin », « se soucier de » et un substantif qui pourrait selon les contextes être rendu en français par soin, attention, sollicitude. Le care a ainsi introduit des enjeux éthiques dans le politique, en fragilisant le lien apparemment évident entre une éthique de la justice et le libéralisme politique. La Majeure Politiques du care, au-delà du changement de paradigme induit en philosophie morale par l’éthique du care, voulait en affirmer la portée politique. Car celle-ci apparaît en second plan lorsqu’on théorise le care en relation avec le patriarcat, ou lorsqu’on le définit à partir des activités domestiques ou salariées qui répondent aux besoins et aux dépendances, un travail inégalement distribué entre les hommes et les femmes, entre les femmes riches et les femmes pauvres. Il s’agissait dans cette Majeure d’attirer l’attention sur un domaine de l’activité humaine qui est négligé, sur les injustices créées par la méconnaissance et la dévalorisation des professions qui y sont liées et sur les déséquilibres mondiaux dans la circulation du care. La migration et la circulation des femmes employées dans ces professions sont à la source de transferts de fonds constituant la provenance majeure de financements dans certains pays en voie de développement. Le care se transforme rapidement en marchandise mondialisée. Carol Gilligan et Joan Tronto, auteures culte publiées et traduites dans cette Majeure de 2009, ont été les premières productrices d’une critique radicale de la théorie de la justice de John Rawls, qui jusqu’ici n’avait eu affaire qu’à des critiques modérées et assez « internes » au champ de la philosophie d’inspiration libérale. La première traduction française de Gilligan n’avait guère eu d’écho médiatique ni académique, ayant été d’emblée qualifiée d’« essentialiste », accusation qui revient régulièrement – y compris dans des contributions féministes de Multitudes ! La loi sur la parité de 1999 a été l’un des enjeux stratégiques de la « troisième vague du féminisme », avec l’émergence de nouvelles questions liées au genre, allant au-delà de l’égalité des droits, et liées à la politisation des questions sexuelles (PACS, prostitution, travail domestique). La troisième vague du féminisme en France a été portée par la « rupture épistémologique » introduite par les féministes dans les sciences sociales : en montrant la subordination des femmes et la minorisation de leurs pratiques, de leurs pensées, de leur place dans l’histoire des sociétés, ces épistémologies « situées » ont révélé les biais par lesquels une recherche apparemment neutre traduit en réalité le point de vue et les intérêts des groupes socialement les plus puissants. Solidaires de ce mouvement, les éthiques du care s’affirment contextualistes et se singularisent des éthiques libérales qui valorisent une prétendue impartialité, en mettant l’accent sur la vulnérabilité plutôt que sur l’autonomie. La perspective du care vise ainsi à faire résonner des voix socialement étouffées, au premier rang desquelles celles des femmes. Le champ du care est donc avant tout celui d’une revanche de l’expérience vécue des femmes enfermées dans la sphère privée et dont l’existence a été associée à des valeurs tenues pour insignifiantes, les activités invisibilisées et mésestimées, associées à des corvées dont les femmes devaient avant tout se « libérer ». Cette vision repoussoir du travail domestique n’a pas aidé à son partage avec les hommes, mais plutôt à sa délégation à d’autres femmes quand cela était économiquement possible (Pascale Molinier, « Des féministes et de leurs femmes de ménage : entre réciprocité du care et souhait de dépersonnalisation », no 37‑38, 2009). Les inégalités entre femmes et plus précisément, la mise d’une masse de femmes au « service » de la libération des femmes privilégiées est un tabou du féminisme que le concept de care a contribué à révéler. L’émergence des éthiques du care doit aussi être pensée dans le contexte des revendications du Black Feminism. Dans les années 1980, les féministes africaines-américaines, asiatiques et chicanas dont les voix commencent à se faire entendre, reprochent au féminisme « majoritaire » d’avoir pris pour sujet exclusif les femmes blanches des classes favorisées, d’avoir universalisé leur situation. Le Black Feminism contraint à repenser la domination de genre sans l’isoler d’autres rapports de pouvoir incluant la classe sociale et la race. Le concept de care fait alors précisément voir comment les femmes blanches ont pu conquérir des privilèges partiels, en bénéficiant du travail invisible et peu rémunéré d’autres femmes et d’hommes éventuellement racisé·es. Ainsi, l’éthique du care s’est aussi inscrite au sein de Multitudes dans le champ émergent de l’intersectionnalité, dont les premiers textes traduits paraissent en France également dans les années 2000. Bien qu’initialement contesté, le choix de Multitudes de garder le terme « care » finit par se généraliser pour préserver la double dimension de l’affect et du travail.
On a reproché à l’éthique du care, et en particulier à Gilligan de ne pas être féministe, en durcissant, voire essentialisant la distinction femme/homme, en lui donnant un contenu moral : les femmes représenteraient l’attention à autrui et au proche, et les hommes emblématiseraient l’autonomie et l’impartialité ; en somme, aux femmes le privé, aux hommes la vie publique. En appuyant l’importance – à la fois sociale, morale, politique – des qualités d’attention à autrui et des activités de souci aux autres, l’éthique du care serait alors la reprise ou la confirmation des stéréotypes de genre. Considérer l’importance sociale, morale et politique du care oblige à faire référence aux « femmes », l’une des catégories auxquelles le travail du care a été principalement assigné. Or parler des femmes serait faire usage d’une catégorie « suspecte », suspicion s’étendant à toute théorie qui en assume l’existence. « À cet égard, toutes les théories féministes deviennent suspectes, hormis celles qui récusent la possibilité d’une large entreprise théorique de libération » (Joan Tronto, Un monde vulnérable). Pourtant, le mot « femme » ne désigne pas une essence, mais une situation, historiquement et socialement définie, et c’est justement ce que nous apprend le féminisme, depuis ses versions phénoménologiques (Simone de Beauvoir, Iris Young) jusqu’à ses versions intersectionnelles qui mettent l’accent sur les différences entre femmes. Cette objection au care est caractéristique d’une tendance du milieu politique voire académique français, qui consiste à faire appel à un « bon » féminisme, légitime, républicain, contre des versions perçues comme dégradées ou excessives (ou woke, voir Wokisme). Cet antiféminisme de fond, teinté de misogynie, a frappé de plein fouet l’éthique du care, accusée de véhiculer une image « nunuche » de la féminité. On aura compris que l’éthique du care touche à un point névralgique des rapports de genre en France, où un discours universaliste constitue l’obstacle à l’amélioration de la situation (sociale, politique, morale) des femmes, et donc à un universel véritable (comme y appellent Christine Delphy et Anne Querrien). Ces critiques ferment les yeux sur la puissance de contestation de l’exploitation de femmes pauvres par la perspective du care et donc, sur leur propre classisme. Les analyses du care sont donc politiques. Elles ont permis, par leur présentation dans Multitudes, de donner forme à des questions qui ne trouvaient pas leur place dans le débat public et d’infléchir la définition de ce qui compte : analyses de la prostitution (« Prenons soin des putes », no 48, 2012), du capitalisme émotionnel (Pascale Molinier et Sandra Laugier, Mineure no 52, 2013), du care dans le Covid, du revenu universel, de l’avortement (« Une affaire de femmes… et de démocratie », Anne Querrien, Mathieu Corteel & Sandra Laugier, no 95, 2024). La description du care a fait apparaître dans le champ moral et politique des voix subalternes jusqu’alors disqualifiées : les voix de toutes les personnes qui réalisent majoritairement le travail de care dans la sphère domestique et dans les institutions de soin. Toutes ces personnes qui réalisent un travail indispensable et vital sont mal payées, mal considérées, leurs besoins ignorés, leurs savoirs et savoir-faire rabaissés et déniés. Ces revendications ont été clairement analysées et exprimées dans plusieurs contributions du volume de Multitudes signé Cora Novirus (no 80, 2020) au moment de la crise Covid, ainsi que dans l’article de Nathalie Blanc, Sandra Laugier, Pascale Molinier & Anne Querrien, « Pour un environnementalisme ordinaire : femmes et ressources en temps de crise » (publié sur le site de Multitudes en juillet 20201) qui fut certainement la première théorisation de l’importance des contributions des femmes dans les crises écosystémiques à venir après la crise Covid. L’environnementalisme ordinaire, grassroot, composé de modes de vie et de mobilisations individuelles et collectives qui structurent la production de l’environnement ordinaire est d’abord le fait des femmes dont le rôle est crucial dans cette sphère domestique et écologique. La déconsidération, qui s’est accentuée depuis, de l’environnement ordinaire, banal et difficilement médiatisable, est liée à la dévalorisation du travail de care dans le maintien des formes de vie au quotidien. La perspective du care a donc permis très tôt de capter des préoccupations sociales qui sont devenues saillantes, dans une période d’abandon des services publics pourvoyeurs de care. Le care s’est révélé un outil puissant pour penser les inégalités globales, la circulation mondiale des femmes et l’exploitation conjuguée des ressources humaines et naturelles des pays pauvres, et donc la crise environnementale. Si le care a bénéficié des luttes féministes, il a aussi accompagné et soutenu la diffusion des recherches sur le genre, les sexualités et l’écoféminisme (voir les travaux Catherine Larrère). L’éthique du care visait dans les années 1980 à renouveler le féminisme par une prise de conscience des inégalités entre femmes. Mais elle reste ancrée dans le féminisme, et c’est ce que rappelle, désagréablement, le mot – notamment à ceux et celles qui veulent oublier qu’ils sont dépendants du care pour leur autonomie. C’est pour ces raisons que la voix différente portée régulièrement par Multitudes reste notre actualité. 1Publié sous le titre « La crise révèle les failles du genre dans l’environnementalisme : comment valorisons-nous les environnements quotidiens ? » dans la revue The nature of cities, juillet 2020. L’article Care <br>Une puissance de contestation est apparu en premier sur multitudes. Texte intégral 2475 mots
Ce que révèle le care
Ce que le care n’est pas
Le care pour un environnementalisme ordinaire
25.09.2025 à 11:30
Cartographier Multitudes, une revue aux géographies plurielles
Cartographier
Multitudes, une revue aux géographies plurielles
Et si la cartographie des strates et des saillances caractérisant le rapport d’une revue à ses diverses géographies pouvait dessiner les contours d’une mondialisation en train de se faire ?
Mapping
Multitudes, A Journal with Multiple Geographies
What if mapping the layers and salient features characterizing a journal’s relationship to its various geographies could outline the contours of globalization as it unfolds?
L’article Cartographier <br>Multitudes, une revue aux géographies plurielles est apparu en premier sur multitudes.
Ces vingt-cinq dernières années, la face du monde a énormément changé, même si sa géographie n’a pas grandement muté, si ce n’est la création de quelques pays, dont le plus récent est le Soudan du Sud, et quelques centimètres de déplacements des plaques tectoniques. Cette année Multitudes fête son vingt-cinquième anniversaire, la revue a donc une histoire, pour autant a-t-elle une géographie, ou plutôt des géographies ? Quand on regarde les 99 derniers numéros, on est obligé de constater qu’effectivement Multitudes possède un ensemble de géographies imaginaires se dessinant au gré des numéros et montrant comment elle se situe dans le monde, et surtout ce qu’elle en voit. Alors que les réunions de rédaction se tiennent principalement à Paris, le collectif de rédaction est rhizomatique et situé dans d’autres villes de France ou d’autres pays, les discussions étant permises, entre autres, grâce à des mailing-list et des dispositifs de visioconférences. De plus, indépendamment de l’ancrage territorial, ce sont de multiples affiliations culturelles, acquises par les histoires personnelles de chacun et chacune, ou par des expériences académiques et professionnelles qui viennent remplir les pages des numéros de la revue de perspectives géographiquement hors de France. Ce multiperspectivisme a des incidences concrètes, dessinant une carte du monde que l’on pourrait s’amuser à reprendre, tels des cartographes du dimanche, en coloriant des fonds de cartes au gré des sujets abordés dans nos numéros. Multitudes ne se définit en aucun cas par une défense absolutiste des frontières étatiques, comme le montre le numéro 97 questionnant plutôt leurs ambiguïtés et leurs préférant le concept de « lisière » plus trouble, ou le no 70 qui interroge sur la manière de sauter à pied joint sur et hors des lignes. Néanmoins, la division westphalienne permet de dresser certains tropismes géographiques de la revue et de constater quels sont les pays ou les régions du monde focalisant son attention. Bien que la rubrique À chaud permette de balayer un ensemble de situations géopolitiques à travers le monde au gré de l’actualité des vingt-cinq dernières années, c’est dans les dossiers des Majeures et des Mineures que l’on constate davantage quel monde la revue tente d’habiter. Sans prétendre à l’exhaustivité, les 99 numéros laissent entrevoir au moins quatre géographies principales de Multitudes qui ne cessent de se reconfigurer, et qui restent ouvertes à d’autres analyses et recoupements. 1) La première géographie historique de Multitudes est européenne, c’est dans cet espace culturel (qui n’est pas seulement géographique) que la revue s’est constituée. Il ne s’agit pas seulement de parler d’une « culture » commune, dont la rhétorique ne permet pas de rendre compte de la multitude des cultures et des pratiques, mais plutôt de défendre un projet politique post-national : le fédéralisme européen. Bien que la revue ne cache pas ses critiques face à la politique des institutions européennes, c’est un projet perçu tant politiquement qu’économiquement (Euro, les illusions souveraines, Mineure no 62) qui est analysé, et souvent défendu. Alors que les nationalistes mortifères hors de l’Europe et en son sein vont bon train et tentent de déstabiliser le projet européen en menant des guerres à ses frontières ou en minant de l’intérieur ses institutions, infusant un poison tentant de nous faire douter de la possibilité même d’une émancipation postnationale, il nous faut aujourd’hui, peut-être plus que jamais, toujours plus d’Europe. Ainsi, on pourra consulter, entre autres, les numéros : 3, 14, 19, 74, 95 (ainsi qu’un ensemble de « À chaud » qu’il serait trop long d’énumérer) de la revue afin de constater que le premier port d’attache de la revue est l’Europe fédérale. 2) Si cette première géographie est une géographie politique, Multitudes dialogue également avec la géographie physique qu’elle réinterprète à travers un cadre différent, influencé en autres par les travaux de Bruno Latour ou de Lynn Margulis et sa conception de Gaïa (no 93). La géographie de l’espace vivant est considérée comme cette mince « zone critique » où la vie a émergé et qui, plutôt que de considérer la toute-puissance humaine, s’intéresse davantage à la manière dont nous faisons partie d’un écosystème en lien avec les autres espèces vivantes non-humaines, qu’elles soient animales ou végétales, mais également avec les forces terrestres et technologiques. C’est ainsi l’idée d’une planéarité (no 85), en opposition avec la conception économique de la mondialisation, qui est mise en avant et qui nourrit les réflexions de la revue sur un certain nombre de thématiques comme les Communs (no 41, 45, 93), le Territoire (no 86), ou encore, l’Effondrement (no 76). 3) Une troisième géographie de Multitudes est mouvante, ou plus précisément migrante. C’est une géographie humaine, celle qui s’intéresse non pas aux constructions politiques ou aux caractéristiques géologiques, mais aux êtres humains habitant et traversant les territoires. Les espaces d’entre-deux, mais aussi les expériences de migration sont abordés par la revue qui s’interroge sur la condition des personnes migrantes et sur les politiques d’accueil, ou plutôt de non-accueil européen. L’étude des mouvements de populations, ou la démographie, ne sont alors pas pensés hors-sol mais au plus près des vécus migratoires. On peut ainsi se référer aux no 49, 64, 97 ou encore 19 de la revue. 4) Enfin, une dernière géographie de Multitudes est urbaine. Les questions d’urbanisme ont été centrales pour le collectif de rédaction qui a appuyé la réalisation d’un ensemble de numéros sur ce sujet. La thématique fait l’objet d’une Mineure dès 2004 avec le numéro 17 intitulé Ville : fractures et mouvements. Suivront ensuite d’autres numéros questionnant les subjectivités construites par la vie urbaine à travers le monde (no 33), quand d’autres ont vu dans la ville l’espace (micro-)politique des multitudes (no 31, 43, 45) cristallisant les mutations de la mondialisation tout en laissant place à des lieux de résistance politique comme l’ont montré les mouvements des places après la crise économique de 2008. Parallèlement à ces différentes géographies, Multitudes a dédié des numéros à deux continents (en plus de l’Europe), le continent africain (no 53, 69, 76) et le continent américain, avec un focus sur les Amériques hispanophones et lusophones (no 35, 56, 81). On peut se demander ce que la dynamique continentale apporte en plus à l’analyse tant ces continents sont divers et tant Multitudes a aussi pris le temps de faire des numéros sur des pays en particulier comme le Brésil (no 56), le Chili (no 91), le Japon (no 13), le Liban (no 90), la Colombie (no 40), l’Inde (no 75) ou encore, la Chine (no 54). L’Iran est le seul pays ayant fait l’objet de deux numéros (no 43 et 83), ce qui résonne tout particulièrement avec la situation actuelle, car au moment où nous écrivons ces lignes, l’Iran est entrée dans un conflit de haute intensité avec Israël et les États-Unis. D’autres numéros ont naturellement, dans la suite de la géographie urbaine de Multitudes, été consacrés à des villes singulières comme Le Caire (no 60), Khinshasa (no 81) ou encore Fukushima (no 48). Bien qu’on ne puisse pas demander à une revue de s’intéresser à tous les pays ou les espaces possibles – on pourrait d’ailleurs se questionner sur l’intérêt tant scientifique que politique d’un tel atlas à la Bouvard et Pécuchet, on peut néanmoins s’interroger sur les absences révélées en creux par ce rapide état des lieux. On peut constater par exemple une faible représentation des pays d’Asie du sud-est et centrale, de l’Océanie, et des pays slaves. On peut aussi se demander si d’autres États feront l’objet d’un numéro tant ils semblent concentrer aujourd’hui une géopolitique mondiale cruciale à analyser à l’instar, par exemple, de Taïwan, de l’Ukraine, de la Palestine, voire du Groenland ou du Soudan. De manière plus générale, on peut s’interroger sur l’absence d’intérêt pour des structures géographiques postnationales hors de l’Union européenne de la part de la revue. Si l’Union européenne est originale par sa structure, on aurait pu aussi s’interroger sur les alliances stratégiques qui se jouent à l’échelle internationale aujourd’hui. Que reste-t-il d’une possible gouvernance mondiale de l’ONU au moment où la réélection de Donald Trump piétine les principes les plus fondamentaux du droit international et plus largement l’ordre mondial (certes fait d’un ensemble chaotique de désordres) tel qu’il fonctionnait depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale ? Une reconfiguration du monde se joue aujourd’hui et laisse entrevoir un ensemble de ce qu’on appelle en géopolitique des « unholly alliances » (alliances impies, contre-nature) à étudier tant le contexte international nous oblige à changer nos cadres de pensée. Des institutions et des projets (géo)politiques exigent aujourd’hui une analyse approfondie, que l’on pense aux BRICS+ qui fera l’objet d’un prochain numéro de la revue, aux Nouvelles routes de la soie chinoises ou de la Nouvelle route des épices indienne, qui sont en train de former une certaine géographie du monde concurrençant directement le commerce et les valeurs démocratiques du projet européen. Analyser ces projets et ces institutions permettrait de comprendre un ensemble de dynamiques transnationales, mais également nationales, à travers lesquelles résonnent les questions de guerres informationnelles et commerciales, de post et de néocolonialisme, ainsi que l’émiettement des principes démocratiques. Dans le monde de plus en plus fragmenté dans lequel nous vivons, pris en étau entre les délires scabreux et guerriers de Donald Trump, et les projets anti-démocratiques de régimes autoritaires, il nous faut de plus en plus défendre la politique européenne comme une troisième voie de régulation, de protection des libertés fondamentales, et de garantie du principe démocratique d’autogouvernement. La démocratie et une Europe ouverte comme géographie de survie de la revue à l’ère de la reconfiguration de l’ordre international. L’article Cartographier <br>Multitudes, une revue aux géographies plurielles est apparu en premier sur multitudes. Texte intégral 2149 mots
Géographies croisées des multitudes : politique, physique, humaine, urbaine
Saillances et creux des géographies de Multitudes à l’ère de la reconfiguration de l’ordre mondial
25.09.2025 à 11:28
Communs Les paradoxes du /des commun(s)
Communs
Les paradoxes du /des commun(s)
Et si l’on réécrivait l’histoire des communs en complémentant l’étymologie du munus, qui lie par le devoir d’une charge, avec celle du mitra, qui libère par le don sans attente de retour ?
Commons
The Paradoxes of the Common(s)
What if we rewrote the history of the commons by supplementing the etymology of munus, which binds through the duty of a charge, with that of mitra, which liberates through giving without expecting any return?
L’article Communs <br>Les paradoxes du /des commun(s) est apparu en premier sur multitudes.
Qu’avons-nous en commun ? Avec qui, ou avec quoi ? Le commun, est-ce quelque chose que l’on « a » ou que l’on « est » ? Est-il un objet, un bien, un espace partagé – ou bien notre manière d’habiter le monde, de s’y rapporter ensemble ? Ce que nous considérons comme le plus propre et le plus intime, à commencer par nos noms propres et nos affects, n’est-il pas déjà façonné par un monde partagé, par une trame sociale antérieure à toute subjectivité individuelle ? Le commun est-il déjà donné ou se construit-il ? A-t-il besoin d’une loi, d’une institution, ou d’une action pour exister, d’un « oui » aux arrivants et aux étrangers, ou bien s’impose-t-il, de manière archi-politique, dans notre simple être-ensemble ? Faut-il le mettre en commun pour qu’il advienne ? Et qu’est-ce qui fonde alors cette mise en commun : une action collective, un contrat, un devoir éthique, l’amitié ou une condition ontologique ? Qu’en est-il de son rapport avec ses proches dérivés : communauté, communication, communisme ? Et dans des acceptions si larges que peut prendre le commun, que désigne-t-il encore ? C’est précisément cette polysémie, cette fluctuation féconde, du terme « commun » que la revue Multitudes a interrogée à sa façon dès ses débuts à travers différents registres métaphysique, écologique, esthétique, numérique et politique. Si le mot semble irriguer tous les grands concepts du politique, on observe pourtant, dès les années 1990, une tentative de le renouveler, de le redéfinir ou d’en faire une boussole critique face aux mutations contemporaines du capital et à l’érosion du social. Le concept de « multitude », tel que théorisé par Michael Hardt et Antonio Negri, s’inscrit dans la profusion conceptuelle de l’époque post-communiste visant à renouveler notre appareil théorique hérité du vieux marxisme, à la hauteur des transformations du monde globalisé. Il n’en est pas moins une déclinaison du commun ou, inversement, le commun peut être saisi comme une modalité d’expression de la multitude : un ensemble non déterminé et ouvert d’associations possibles, une composition hétérogène de singularités qui se relient, se délient, se reconfigurent autrement, dans un mouvement rhizomatique producteur de commun. Si la réflexion sur le commun remonte à la pensée politique antique – celle de la cité grecque – c’est bien à partir des années 1990 qu’un regain d’intérêt s’opère, stimulé par plusieurs dynamiques majeures. En premier lieu, la montée en puissance de l’idéologie propriétaire a contribué à la privatisation progressive des communs : terres, eaux, forêt, savoirs, infrastructures, espace numérique, santé, espace urbain, éducation et services publics. Face à cette dépossession généralisée, le commun se présente alors comme le point d’ancrage d’une contre-offensive théorique et politique. La renaissance de la réflexion sur le commun s’inscrit aussi dans l’ère post-communiste. La chute du communisme réel a conduit toute une génération de philosophes – Jean-Luc Nancy, Giorgio Agamben, Roberto Esposito, entre autres – à réhabiliter le commun, ou plutôt à sauver le commun du communisme, à travers une pensée renouvelée de la communauté définie comme au-delà ou en deçà des projets politiques. À cette dynamique historique s’ajoute un enjeu plus vital encore : la prise de conscience croissante de la crise écologique. Celle-ci a mis en lumière non seulement la nature terrestre Enfin, le développement d’internet a révélé une nouvelle forme de commun : celui de la connaissance partagée, de l’intelligence collective, des infrastructures numériques. Si les plateformes ont massivement mis des « enclosures1 » sur ces ressources depuis les années 2000, l’émergence des logiques open source, des creative commons, des logiciels libres et des licences ouvertes a montré qu’un autre usage du numérique reste possible. Il ne s’agit pas ici seulement du flou disciplinaire qui entoure la notion de commun, mais bien de son ambivalence constitutive, qui impose, à chaque tentative de renouvellement conceptuel, une vigilance critique pour ne pas glisser vers le comme-un, cette forme d’unification qui efface la pluralité au sein du commun2. Autrement dit, le commun comporte un risque inhérent : celui de son retournement en une essence figée, une chose, une identité close, bref, une réification, dont le communautarisme est une des conséquences. C’est que le commun est à double tranchant : il peut ouvrir les possibles, ouvrir l’avenir, mais il peut aussi devenir le vecteur de nouvelles clôtures, de frontières rigides qui annulent les devenirs. Il inclut autant qu’il exclut : il ne « revient » à personne et peut pourtant devenir le propre d’un collectif particulier. Pour ne pas sombrer dans de telles impasses, il est essentiel de penser le commun à partir de ses tensions internes. Cela signifie accueillir ses apories, assumer ses divisions constitutives, et reconnaître la nécessité de se rapporter à son dehors – à ce qui lui échappe : l’inassimilable, l’incommunicable, le non-commun. Appréhender le commun à partir de cette ambivalence – cette mobilité qui le rend insaisissable – a des implications majeures dans chacun des domaines où il est théorisé et mis en œuvre. Nous ne pourrons ici qu’en esquisser quelques figures. L’une des veines que la revue Multitudes a explorées est celle des « communs », entendu au sens large comme non seulement les ressources naturelles et les biens communs, mais aussi comme tout ce qui se produit socialement, y compris le travail social lui-même. La production est devenue « commune3 », et c’est la coopération sociale qui est productrice de la valeur. Dans ce prolongement, le capitalisme cognitif, développé par Yann Moulier Boutang, met l’accent sur le travail immatériel, l’intelligence collective, la circulation du savoir, les biens communs informationnels et le travail de coordination des cerveaux réunis en réseaux au moyen d’ordinateurs qui font à leur tour l’objet de la capture par le capitalisme des plateformes dont l’Intelligence artificielle est une des avatars les plus récents. À partir d’une inspiration proudhonienne de la « force collective » comme source véritable de la valeur, il s’agit de proposer alors toute une série de stratégies de réappropriation des communs, notamment à travers l’idée du revenu contributif qui sert à redistribuer la richesse socialement produite entre les travailleurs cognitifs. Mais ces thèses, aussi fécondes soient-elles, occultent souvent le travail non-productif ou ce qui échappe à toute valeur-travail. Georges Bataille l’appelait la dépense improductive qui part en fumée et ne laisse personne et aucune instance la mesurer et la capturer. Sous cet angle, le commun se perd, il se dissipe. Il est difficile à saisir car fait de multiples associations imprévisibles et hétérogènes, incalculables, et inappropriables. Un tel commun ne peut advenir qu’en entretenant une tension constante avec ce qui résiste à toute opération économique. Il est ce paradoxe du Heim (foyer, patrie, maison) hanté par l’Unheimlichkeit (l’inquiétante étrangeté). Ce prisme suppose d’aborder le commun à partir de ses marges inutiles, à travers ceux et celles qui ne contribuent (apparemment) d’aucune manière à la production de la richesse collective, les désœuvrés, les fous sans intelligence exploitable, les assistés, les migrants qui ne compensent aucun manque démographique dans les sociétés européennes vieillissantes, les étrangers inassimilables, les indomesticables, ceux et celles qui nous « remplacent » mais qui ne nous ressemblent pas, et qui ne servent même pas de miroir à la lutte pour la reconnaissance des Européens, ceux et celles qui ne parlent pas notre langue, les parasites, les nuisibles, les virus, les populations offlines, les langues et les idiomes non-numérisés et non-codifiables, enfin, tous ces êtres ou formes de vie qui ne « servent » à rien et ne peuvent être intégrés dans aucun foyer, et pourtant interrogent l’énigme du commun qui est aussi le lieu de résistance à toute forme de capture. C’est aussi à un « reste » non-productif que renvoie, d’une manière très différente, la notion de « communs négatifs4 ». Ces communs négatifs désignent des infrastructures de grande échelle dont dépendent nos modes de vie mais qui ravagent nos milieux de vies futures, telles que les centrales à charbon, les déchets miniers ou radioactifs, et en général les héritages indésirables du progrès industriel dont personne ne veut. Cependant, le terme « négatif » est mobilisé ici à contre-courant de ses significations chargées dans l’histoire de la philosophie. Car, pour ne s’appuyer que sur Hegel, le négatif est la condition de possibilité du commun. Sans ce travail du négatif, le commun risquerait de se refermer sur lui-même et de sombrer dans une immanence mortelle. En ce sens, comme l’a affirmé Bruno Latour dans le numéro 45 de la revue, « il n’y a pas de monde commun » donné d’avance. Le commun n’émerge qu’à travers des ruptures, des discontinuités, des cassures – c’est-à-dire à travers un rapport conflictuel avec ce qui est donné. Il ne peut jamais être totalement institué, capturé ou fixé. C’est pourquoi toute gouvernance des communs doit prendre en compte leur ingouvernabilité intrinsèque. Le négatif devient affirmatif et producteur du ou des commun(s). C’est à partir de l’inappropriable qu’il est possible de se réapproprier le ou les commun(s). C’est cet excès qui fait que, dès que l’on a l’impression de réaliser ou de capturer le commun dans une institution ou dans un dispositif politique ou économique quelconque, il se dérobe et s’échappe vers un ailleurs lointain. Ce paradoxe est déjà inscrit dans l’étymologie. Le terme latin munus, à la racine de « commun » (co-munus), renvoie à une charge partagée, à un échange originaire, à un système de dons et de contre-dons qui lie chaque individu aux autres. Il suppose une dette, un devoir, un engagement réciproque. Mais cette logique du munus se complique lorsqu’on la met en regard de sa racine indo-européenne, mei, qui est à l’origine d’un terme important, mitra. Or mitra signifie « amitié », « alliance », « contrat », mais sans contenir l’idée de dette ou de contrepartie. Mitra désigne un don radical, hors calcul, comme celui du soleil – une des significations du terme indo-européen – qui donne sans jamais recevoir et n’attend rien en contrepartie5. Dès lors, il s’agit peut-être de penser le commun entre ces deux régimes : entre le munus, qui lie par le devoir, et le mitra, qui libère par le don sans attente. Entre l’obligation partagée et la gratuité radicale. C’est dans cette tension – entre calcul et excès, entre institution et fuite, entre dette et donation pure – que le commun peut trouver sa puissance la plus radicale. 1Voir le texte de Yann Moulier Boutang, « De quoi l’intelligence artificielle est-elle le nom ? » Multitudes no 96 (2024). 2Voir à ce sujet le dossier : Du commun au comme-un, Multitudes no 45 (2011). 3Voir le texte de Judith Revel et d’Antonio Negri, « Inventer le commun des hommes », Multitudes no 31 (2007). 4Voir la Majeure Communs négatifs, Multitudes no 93 (2023). 5Voir Robert Turcan, Mithra et le Mithraisme, Paris, Belles Lettres, 1993. L’article Communs <br>Les paradoxes du /des commun(s) est apparu en premier sur multitudes. Texte intégral 2664 mots
Une renaissance polysémique et une ambivalence constitutive
de l’humain et sa fragilité vis-à-vis des conditions matérielles de son existence, mais aussi le caractère inévitablement commun de son destin. La pandémie de Covid-19, à cet égard, n’était qu’un épisode, qui a dévoilé brutalement le commun biologique, ou plutôt la communauté des êtres vivants, dans toute son ampleur mondialisée et avec tous les liens imprévisibles qu’elle engendre. L’inquiétante étrangeté des « communs »
Le munus divisé