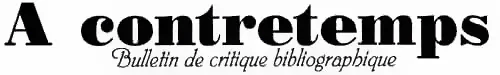07.12.2025 à 21:42
Un Marx antimarxiste
■ MICHAEL LÖWY et PAUL GUILLIBERT MARX NARODNIK Les populistes russes, le communisme et l'avenir de la révolution L'échappée, « Versus », 128 p. « En tout cas, ce que je sais, c'est que je ne suis pas marxiste. » Karl Marx Jusqu'à un temps récent, l'historiographie marxiste prêta peu d'intérêt au Marx de la dernière période, et plus particulièrement à cet épisode peu connu jusqu'à il y a peu des échanges épistolaires qu'il maintint, à partir de mars 1881, avec la militante (…)
- Recensions et études critiquesTexte intégral (3569 mots)

■ MICHAEL LÖWY et PAUL GUILLIBERT
MARX NARODNIK
Les populistes russes, le communisme et l'avenir de la révolution
L'échappée, « Versus », 128 p.
« En tout cas, ce que je sais, c'est que je ne suis pas marxiste. »
Karl Marx
Jusqu'à un temps récent, l'historiographie marxiste prêta peu d'intérêt au Marx de la dernière période, et plus particulièrement à cet épisode peu connu jusqu'à il y a peu [1] des échanges épistolaires qu'il maintint, à partir de mars 1881, avec la militante révolutionnaire Vera Zassoulitch (1849-1919) et, plus largement, avec des populistes russes convaincus, comme Piotr Lavrov (1823-1900) et Nikolaï Danielson (1844-1918), qu'il existait, dans une perspective de voie russe au socialisme, une articulation possible, sans passer par le stade capitaliste, entre certaines structures traditionnelles de la société – la commune rurale (le mir ouobchtchina, particulièrement – et la construction d'une société ainsi préservée des maux, supposément transitoires, inhérents à toute société fondée sur l'accumulation du capital. Cette vive curiosité que l'auteur du Capital manifesta pour l'argumentaire populiste – qui contrariait, à l'évidence les lois nécessairement intangibles dont le marxisme scholastique dominant s'était fait l'écho invariant – ne pouvait être interprétée, au mieux, par ses principales figures que comme une lubie de vieil homme. Ce serait ignorer qu'avant de vieillir, Marx apprit en 1869 – au prix d'un gros effort mais en seulement quelques mois – la langue russe pour accéder aux écrits populistes. En 1870, German Lopatine (1845-1918) lui fit découvrir les écrits de Nikolaï Tchernychevski (1828-1889) – dont Capital et travail et son fameux Que faire ?. Sans oublier qu'à la même époque, il cultivait de forts liens d'amitié avec Elisabeth Dmitrieff (1851-1910 ou 1918), l'une des rédactrices du journal populiste Narodnaïe Delo (« La Cause du peuple »).
À lire l'ouvrage de Löwy et Guillibert, on saisit l'intérêt constant que, pendant cette décennie, Marx accorda à la Russie, et plus précisément à sa structure agraire, à la forme de sa propriété communale et au rôle que la paysannerie pourrait être amenée à y jouer dans un processus révolutionnaire à venir. Pour ce faire, il s'adonna, les annotant scrupuleusement, à la lecture pointilleuse d'une quantité colossale d'ouvrages et entretint une correspondance soutenue avec certains de leurs auteurs à qui il manifestait, par ailleurs, le plus souvent sa sympathie et son soutien. La tâche était si prenante pour Marx que son duettiste Engels – aux dires de Paul Lafargue [2], le gendre de Marx – s'en trouva fort contrarié : « J'aurais plaisir à jeter au feu les publications russes sur la situation de l'agriculture qui depuis des années t'empêchent de terminer Le Capital. » On sent bien que le duo ne joue plus la même partition. Pourtant, Marx a tenté – et pour partie réussi – à faire partager à Engels, qui manifesta également de fortes sympathies pour les populistes, son intérêt pour la question russe, mais pas les nouvelles pistes de réflexion sur lesquelles elle ouvrait – et moins encore la révélation qu'elle induisit chez lui et qu'il résumera ainsi, dans une lettre du 25 mars 1868 à son alter ego : « « Les gens sont tout surpris de trouver dans le plus ancien le plus moderne. » Si rupture il y a avec le marxisme doctrinaire, elle est bien là.
Tout laisse à penser, comme l'avança déjà Maximilien Rubel en son temps, que la lecture du livre de l'anthropologue Lewis Morgan – Ancient Society, or Researches in the Lines of Human Progress from Savagery, through barbarism, to Civilization (1877) –, sans doute l'une des dernières lectures de Marx, joua un rôle essentiel dans ce qu'on peut qualifier, en reprenant l'expression de Pierre Dardot et Christian Laval, d' « inflexion “anthropologique” de la conception du communisme » [3] chez Marx. Pour L. Morgan, qui fut en quelque sorte le réintroducteur de la figure cyclique de l'histoire, qui s'était perdue au XIXe siècle, et de l'idée, majeure dans ce tournant marxien, que de ce qui survit du passé – en Russie, la « commune rurale », par exemple –, il ne faut aucunement faire table rase, mais base d'une régénération en s'appuyant sur sa potentialité révolutionnaire. De cette idée, elle-même révolutionnaire par rapport au corpus de ce Capital jamais achevé, car inachevable, Marx, le vieux Marx, finalement aussi décoiffant que le fut le jeune Marx des Thèses sur Feuerbach de 1845, en arrive à la conclusion, somme toute radicale, que la perspective évolutionniste fondée sur la maturité des forces productives comme condition du passage au communisme n'est plus opératoire. Autrement dit qu'il faut tout recommencer à penser dans une perspective anthropologique. Dit par lui, cela s'exprime ainsi : « Il faudrait tout reprendre depuis le début. [4] » Après l'expérience communarde de 1871, donc, et à la lumière de ce que lui révèlent l'expérience populiste russe et la lecture, à tous points de vue et au sens propre bouleversante, de Lewis Morgan.
Le 16 février 1881, Vera Zassoulitch écrit à Marx en insistant sur le fait que, pour tout révolutionnaire russe, le destin de la commune rurale est central et elle dénonce ceux qui se disent « Marcsistes » (sic) – « vos disciples par excellence » [5], ajoute-t-elle – et, en s'inspirant de lui, la condamnent au dépérissement puisque « c'est Marx qui le dit ». Elle veut donc connaître sa position. Après quatre brouillons, Marx lui répondra. Avec justesse et à propos, Löwy et Guillibert notent que ces quatre pièces [6] et la lettre de Marx à Zassoulitch « constituent l'un des corpus inédits les plus influents sur les traditions hétérodoxes du marxisme ». Ce qui est incontestable. D'où le pieux oubli où elles ont été longtemps confinées par le marxisme scholastique, de peur, sans doute, qu'elles n'entament sa réputation d'infaillibilité. Le marxologue Maximilien Rubel (1905-1996) rattachait cet oubli à une « conspiration du silence ». L'historien Theodor Shanin (1930-2020) au fait que certains marxistes plus marxistes que Marx n'hésitèrent pas à le censurer. Deux points qui, de fait, ne s'opposent pas. Silence, il y eut bien, et long.
La lettre à Vera Zassoulitch – et plus encore ses quatre brouillons – « attestent, nous disent Löwy et Guillibert, de la très grande proximité de Marx avec les positions populistes », d'une part, et corroborent, de l'autre, une nette rupture dans la pensée de Marx puisque « la critique du présent capitaliste y est [désormais] menée au nom d'un passé prémoderne qui préfigure, à certains égards, l'avenir émancipé de l'humanité ». Sa missive précise ainsi que « les analyses du Capital ne s'appliquent qu'à l'Europe occidentale » (Löwy-Guillibert) et qu' « on ne peut pas écarter l'hypothèse que la commune rurale puisse devenir le point de départ de la “régénération sociale” de la Russie » – une expression qui renvoie, en fait, au socialisme (Löwy-Guillibert). Elle rejette, par ailleurs, ses prétendus disciples (« marxistes ») russes qui, écrit Marx, lui sont tout à fait inconnus, contrairement aux Russes avec qui il maintient des rapports personnels et qui « entretiennent, à ce que j'en sache, des vues tout à fait opposées » (Marx). On pense ici aux deux proches des narodniki (populistes russes) que sont Lavrov – soucieux de trouver des points de convergence entre Marx et Bakounine (1814-1876) – et Danielson.
« La Russie – note Marx dans le premier brouillon de sa lettre à Vera Zassoulitch – est le seul pays européen où la “commune agricole” s'est maintenue à une échelle nationale jusqu'aujourd'hui. Elle n'est pas la proie d'une conquête étrangère à l'instar des Indes orientales. Elle ne vit pas non plus isolée du monde moderne. » En d'autres termes, c'est une chance pour la révolution à venir. Rappelons que, en parallèle de la découverte de cette problématique spécifique de la « commune rurale » et de ses potentialités, Marx est plongé dans la lecture de Lewis Morgan et qu'elle joue un rôle décisif dans l'élargissement de son analyse. Le prouve cette phrase d'essence morganienne évidente où il souligne que la crise du capitalisme peut créer les conditions d'un « retour de la société moderne à une forme supérieure du type le plus archaïque : la production et l'appropriation collectives » [7]. On comprend que l'orthodoxie marxiste se soit demandé quelle mouche avait donc pu piquer le prophète pour qu'il la mît dans un tel embarras et décida d'ignorer cette distorsion analytique. Ainsi Plekhanov, originellement populiste et futur dirigeant menchevik, versa dans l'anti-populisme et la pure scholastique marxiste évolutionniste. Lénine (1870-1924), qui lui-même avait perdu un frère dans l'aventure populiste et pour qui la paysannerie ne pouvait devenir révolutionnaire qu'en se prolétarisant, défendra la même ligne en assurant que « le capitalisme agraire en Russie [était] une force progressiste considérable » [8] Quant à Trotski (1879-1940), très proche des narodniki durant sa jeunesse, en qui il voyait non sans raison des « romantiques », il rallia lui-aussi le dogme, même à contrecœur. Enfin, Rosa Luxemburg (1871-1919), qu'on aurait pu penser moins dogmatique dans son jugement, valida la position d'Engels, à savoir que la « commune rurale » relevait de « l'anachronisme historique » [9]. On notera au passage, comme le soulignent Löwy et Guillibert, que, quand Marx, en faisant de la « commune rurale » le point de départ d'un « autre chemin » possible vers le socialisme qui ne passerait pas automatiquement par la phase capitaliste, ses disciples lui répondent par la réaffirmation du dogme au prétexte qu'on ne touche pas aux Saintes Écritures du Capital.
C'est en quoi ce cas de figure se révèle tout à fait singulier. Pensant contre lui-même – et pour le dire autrement contre l'idéologie mécaniste qu'est déjà devenu le marxisme –, le dernier Marx ne parvient plus à se faire entendre dans son propre camp. Il dérange, en somme. Comme dérangea le jeune Marx conquérant quand il démolissait allègrement certaines réputations acquises et les vanités de leurs auteurs. Mais là le lâchage est réel et finalement général chez ses supposés partisans. Autrement dit, la doctrine a triomphé. Elle sera assumée, de manière instrumentale, par la social-démocratie et, mécaniquement, par le marxisme-léninisme. Avec toutes les conséquences que l'on connaît.
On pourrait donc penser que le vieux Marx se fourvoya en s'engageant dans ce virage théorique des dernières années. Sur la question de savoir s'il eut tort ou raison, Löwy et Guillibert indiquent que, si la révolution russe fut de contenu assurément plus prolétarien que paysan, les paysans y jouèrent un rôle essentiel et que, comme en attestèrent certains anarchistes, les traditions communautaires – comme le nota le subtil observateur Pierre Pascal [10] (1890-1983) – exercèrent indubitablement une certaine influence dans la formation des soviets, opinion partagée par l'historien Moshe Lewin (1921-2010). Par ailleurs, comme exprimé par les auteurs, le dernier Marx avait sûrement vu juste en évoquant « la possibilité que la révolution commence d'abord dans des pays périphériques, moins industrialisés, aux forces productives capitalistes encore limitées, comportant des formes sociales “archaïques”, avant qu'elles n'atteignent le centre ».
Très opportun, par ailleurs, est le rapprochement que Löwy et Guillibert opèrent entre les thèses du dernier Marx et celles, encore mal connues aujourd'hui, que, à l'autre bout du monde, défendit le grand penseur marxiste péruvien José Carlos Mariátegui (1894-1930), fondateur en 1926 de la revue Amauta. Pour lui, aucune perspective de réelle émancipation sociale n'était possible qui ne s'appuyât sur la vitalité des « traditions communautaires de la paysannerie andine » et sur son passé « communiste inca ». Comme en écho aux aspirations des narodniki et, sans probablement les connaître, aux intuitions du dernier Marx.
En ces temps maudits où le capitalisme nous conduit vers le pire – effondrement généralisé et guerres –, dire que ces intuitions sont toujours d'actualité est une évidence. Elles doivent nourrir toute perspective révolutionnaire soucieuse de ne pas reproduire les erreurs du passé. Et, pour ce faire, rien ne nous paraît plus utile que de citer, en hommage à son œuvre d'éclaireur, cet extrait du pionnier marxien que fut Maximilien Rubel : « Nulle part et à aucun moment, nous ne voyons apparaître dans ces réflexions la moindre allusion à la nécessité d'un appareil politique tout-puissant qui se substituerait à l'active spontanéité des paysans russes pour les mener sur le chemin de la libération, ou d'un parti dispensateur de cette libération. [11] »
Partant de cette citation, on peut avancer, en dernière hypothèse, que là est peut-être la cause de l'accueil pour le moins hostile que les marxistes partidaires et dogmatiques – au contraire de quelques hétérodoxes – réservèrent aux derniers textes de Marx.
Freddy GOMEZ

[1] À quelques exceptions notables près, dont, entre autres, celle de Maximilien Rubel – marxien et non marxiste – qui lui consacra, en premier (Rivière, 1957), des pages particulièrement inspirées [pp. 340-351 de la réédition Klincksieck, 2016] dans son Karl Marx, essai de biographie intellectuelle, ouvrage préfacé par Louis Janover, à celle de Pierre Dardot et Christian Laval, auteurs de Marx, prénom : Karl – Gallimard, Essais, 2012 – où cette question est abordée [pp. 657-672] dans un continuum historique allant de l'expérience de la Commune de Paris jusqu'à celle des populistes russes, dont l'effet aurait été, chez Marx, d'opérer une sorte de « sortie de route » fondée sur un désir de s'émanciper d'anciennes certitudes. Cette volonté, il l'exprima lui-même ainsi à son ami populiste Nikolaï Danielson, traducteur en russe du Livre I du Capital : « Il faudrait tout reprendre complètement. »
[2] Paul Lafargue, « Friedrich Engels. Souvenirs personnels », in Souvenirs sur Marx et Engels, Éditions en langues étrangères, Moscou, 1953, p. 93.
[3] Pierre Dardot et Christian Laval, Marx, prénom : Karl, op. cit., p. 665.
[4] Lettres de Marx à Danielson du 13 juin 1871 et du 13 décembre 1881. Le passage est cité par Michael R. Krätke dans « Le dernier Marx et le Capital », Actuel Marx, 2005/1, n° 37, PUF, 2005.
[5] On notera, cela dit, que, deux ans plus tard – en 1883 – Vera Zassoulitch, adhérera au premier groupe marxiste russe – « Libération du travail » – fondé par Plekhanov (1856-1918), qu'elle fera partie de l'équipe de rédaction de l'Iskra et qu'elle ralliera les mencheviks par opposition radicale et virulente aux thèses de Lénine.
[6] Elles seront retrouvées en 1911 dans les papiers de son gendre Paul Lafargue. Quant à la lettre envoyée à Vera Zassoulitch, elle sera découverte dans les papiers du marxiste russe Pavel Axelrod (1850-1928) et publiée, en 1923, par l'archiviste et historien Boris Nikolaïevski (1887-1966).
[7] Voir Kolja Lindner et les Éditions de l'Asymétrie, Le Dernier Marx, 2019, p. 272.
[8] Lénine, Œuvres III, Le Développement du capitalisme en Russie, Éditions du progrès, Moscou/Éditions sociales, Paris, 1969, p. 14.
[9] Rosa Luxemburg, L'Accumulation du capital, Œuvres complètes, tome V, Agone, Marseille/Smolny, Toulouse, 2019, p. 278.
[10] « Le mir a rebondi avec la révolution, non seulement il n'est pas mort, mais il a repris vie, il a ressuscité là où il avait, semble-t-il, disparu, et depuis il fonctionne autrement. […] Il a suffi que la pression gouvernementale disparaisse pour que la commune se ravive. Il y avait des terres à partager, des décisions à prendre, un ordre social à rétablir : l'assemblée communale se trouvait toute prête à jouer ce rôle. » (Pierre Pascal, Civilisation paysanne en Russie, Lausanne, L'Âge d'homme, 1969, p. 31.
[11] Maximilien Rubel, Karl Marx, essai de biographie intellectuelle, op. cit., p. 349.
30.11.2025 à 22:50
Le chat dans un jeu de quilles
■ Floréal CUADRADO DU RIFIFI CHEZ LES ARISTOS Ou le crépuscule du Syndicat CGT du Livre parisien Le Lys Bleu Éditions, 2025, 498 p. Dix ans après son Comme un chat – recensé ici – sous-titré « Souvenirs turbulents d'un anarchiste – faussaire à ses heures – vers la fin du vingtième siècle », Floréal Cuadrado, toujours dans le registre du souvenir, remet le couvert sur une période postérieure de sa vie, celle où, par un étrange concours de circonstances, l'anar anti-syndicaliste qu'il était (…)
- Recensions et études critiquesTexte intégral (2358 mots)

■ Floréal CUADRADO
DU RIFIFI CHEZ LES ARISTOS
Ou le crépuscule du Syndicat CGT du Livre parisien
Le Lys Bleu Éditions, 2025, 498 p.
Dix ans après son Comme un chat – recensé ici – sous-titré « Souvenirs turbulents d'un anarchiste – faussaire à ses heures – vers la fin du vingtième siècle », Floréal Cuadrado, toujours dans le registre du souvenir, remet le couvert sur une période postérieure de sa vie, celle où, par un étrange concours de circonstances, l'anar anti-syndicaliste qu'il était se trouva propulsé, d'étape en étape, à la tête du très singulier Syndicat des correcteurs, et ce en un moment historique particulièrement complexe. Dans les années 1990, en effet, le Syndicat CGT du Livre parisien – « l'aristocratie de la classe ouvrière », comme on le qualifiait au vu des conquis sociaux qu'elle avait à son palmarès – entra dans un conflit interne de haute intensité où, derrière une opposition radicale entre défenseurs des syndicats de métier et de leur autonomie et partisans avoués de leur fusion en un syndicat unique d'industrie, s'affrontaient, certes, deux lignes stratégiques opposées depuis longtemps, mais aussi, ce qui n'étonnera personne, des intérêts de pouvoir contradictoires.
Que le lecteur se rassure, l'intention n'est pas d'entrer, ici, dans le détail des coups tordus, des bassesses avérées et des tenaces rancœurs que cette guerre intra-syndicale activa, mais il convient, pour la clarté, d'en révéler quelques éléments. Par son histoire, par la place tout à fait singulière qu'il occupait au sein du Comité intersyndical du Livre parisien (CILP), le Syndicat des correcteurs, héritier d'une longue tradition syndicaliste révolutionnaire – celle de la glorieuse CGT des origines – faisait figure de défenseur tenace des syndicats de métier et de leur autonomie. C'est ainsi que, lorsque, à l'automne 1997, les sections des imprimeurs-rotativistes (force de frappe du Syndicat du Livre) et des Messageries (Paris Diffusion Presse – PDP – et Routage, expédition, communication – REC) choisirent, contre les diktats de leur direction, la voie de la dissidence en risquant par là-même d'être déconfédérées, le Syndicat des correcteurs, à la demande des dissidents et fidèle à sa tradition de solidarité, leur accorda, à titre transitoire, d'être hébergés par ses soins.
Faire mémoire
Il est clair que ce récit aura peu de lecteurs hormis ceux d'un petit cercle de happy fews [1] d'une époque radicalement close. Au demeurant, il est probable que le spadassin Floréal Cuadrado s'en foute. Ce qui l'intéresse et le motive (c'était déjà vrai dans Comme un chat, c'est de faire mémoire de tranches de vie ou d'aventures existentielles et politiques qui l'ont confronté à un collectif contradictoire en motivant, en son for intérieur, des implications assumées. Il y a du jeu là-dedans comme il y a un côté vachard dans le jugement de certains camarades, des mises en perspective contestables, des surinterprétations discutables. Ce n'est pas là un livre d'histoire, mais de témoignage, une plongée dans les entrailles d'un paritarisme – de négociation ou de confrontation – où, entre représentants du Livre et patrons de presse, les accords se signaient à la bonne franquette sur le coin de table d'un luxueux restaurant parisien ou à la faveur (ou défaveur) d'un rapport de forces brut, voire sauvage, instauré par le Syndicat du livre, comme du temps de la longue lutte (1975-1977) contre Émilien Amaury, patron du Parisien libéré qui s'était mis en tête de se passer des ouvriers du Livre. Sous la plume acérée et volubile de Cuadrado, rien ne nous est épargné des mécanismes de collaboration, parfois limites il faut bien en convenir, car non exempts d'une certaine corruption, que ce paritarisme induisait presque naturellement.
Dans ce jeu de quilles, le « chat » apprend vite. Il est vrai que le bonhomme manifeste – son expérience d'activiste et son premier volume de souvenirs en attestent – un certain goût pour l'aventure, voire l'aventurisme. Ainsi, débarquant, comme représentant du Syndicat des correcteurs, dans le saint des saints du Livre – le Comité intersyndical du Livre parisien (CILP) – il n'en mène pas large mais ne le montre pas. Sa réputation n'est pas déjà faite, mais son profil est pour le moins atypique. Il ne vient pas du syndicalisme, mais de l'illégalisme. Comme, par ailleurs, il est probable que les Renseignements généraux aient organisé des fuites du côté des instances patronales et syndicales, on le regarde comme une bête curieuse – et d'autant plus inquiétante qu'il a du sang ibère dans les veines et quelques appétences pour la provocation. Mais bon, le CILP est une grand-messe où l'on n'intervient pas à tort et à travers. Il prend donc des notes pour se mettre à niveau, ce qui ne tardera pas.
C'est plutôt à l'intérieur de la confrérie – le Syndicat des correcteurs, celui auquel appartinrent (excusez du peu !) Pierre Monatte, Marcel Body, Nicolas Lazarevitch, Victor Serge, Louis Lecoin, Benjamin Péret ou May Picqueray – que son secrétaire affrontera une opposition confuse, mais déterminée à le faire chuter. La question du pourquoi cette hostilité, Floréal Cuadrado l'aborde dans le détail, mais sans viser toujours juste. À la manœuvre, il discerne, en son sein, un conglomérat aux contours flous allant de quelques ralliés au syndicat unique d'industrie – finalement rares –, de quelques aspirants à la direction des affaires jouant misérablement de ce conflit pour y parvenir et d'un « marais » plus attentiste qu'interventionniste. Factuellement juste, cette explication omet pourtant l'essentiel, à savoir la nette perte de substance militante du Syndicat des correcteurs depuis que, à partir des années 1980, il s'est mis, par obligation plus que par choix, dans une situation de subordination à d'autres intérêts que les siens propres en matière de recrutement [2]. Cette époque, Floréal Cuadrado ne l'évoque pas, ce qui est bien normal après tout si l'on admet que notre « chat » avait alors des occupations probablement plus exaltantes que celles relevant d'une quotidienne gestion des affaires syndicales. De l'avoir connue pourtant, cette époque, il aurait constaté que ce qui, de génération en génération, avait fait la singularité du Syndicat des correcteurs, à savoir sa capacité à se pérenniser sans jamais renier sa filiation syndicaliste révolutionnaire originelle et les méthodes qu'il préconisait, était en train de changer avec le passage du temps. Certains virent dans ce moment de modernisation informatique l'occasion de s'appuyer sur les projets patronaux pour favoriser une professionnalisation du syndicat et, du même coup, une normalisation de ses méthodes. D'autres, moins acquis aux avantages supposés de la mutation et plus portés au militantisme de base n'oubliaient jamais de rappeler aux nouveaux que leurs conditions de travail, ils les devaient surtout aux anciens, qui les avaient arrachées de haute lutte. Et que, la roue tournant, il faudrait bien qu'ils s'y mettent un jour pour ne pas tout perdre.
Vieille garde et jeune troupe
À diverses reprises, Floréal Cuadrado insiste sur l'importance qu'eut dans le Syndicat des correcteurs ce qu'il appelle la « vieille garde » qui formait une sorte d'assemblée des sages dont l'avis était précieux pour éviter les bourdes. Chacun de ces « sages » avait exercé, à différentes périodes de sa vie militante, des responsabilités syndicales. Ils connaissaient, tous, les statuts du syndicat sur le bout des doigts. Ils avaient une culture des luttes et des conflits internes au Livre qui pouvait être très précieuse en cas de besoin. J'ai souvenir qu'il n'était pas rare, dans les assemblées générales syndicales, auxquelles les retraités participaient, qu'un « sage » prenne la parole pour offrir une porte de sortie à un débat qui, faute de références et de repères tangibles, risquait de s'enliser. Cette transmission opérait naturellement, au gré du quotidien de la vie syndicale. C'est à partir des années 1980, désastreuse époque, qu'elle commença à s'effriter et qu'apparurent les premiers signes d'une évidente mutation d'imaginaire chez nombre de nouveaux adhérents finalement acquis à l'idée que le statut d'ouvrier du Livre était moins enviable – dans l'ordre symbolique, s'entend – que celui de journaliste. Dans ce processus, il est certain que les nouvelles formes de recrutement et de formation jouèrent un rôle non négligeable dans le formatage de nouvelles aspirations. Ainsi, il n'était pas rare, j'en fus témoin, de voir débarquer au bureau de placement syndical des gens ayant vu leur formation validée par l'école et cherchant du boulot, qui n'avait pas la moindre idée de ce que pouvait être un syndicat et à quoi il pouvait bien servir.
Quinze ans plus tard, à l'époque où se situe le « rififi » que Floréal Cuadrado nous narre dans le moindre détail, c'est sans doute encore une fois – la dernière probablement – que la « vieille garde » joua son rôle de vigie en éclairant le conflit en cours de son savoir et en encourageant son secrétaire à ne pas déroger aux principes des syndicats de métier et de leur autonomie de fonctionnement. C'est en ce sens qu'elle approuva la proposition qui fut faite aux dissidents du Syndicat général du Livre de les héberger le temps nécessaire au règlement de leur conflit interne. Quant aux affiliés du Syndicat des correcteurs, ils naviguèrent pour beaucoup à la godille, sans idées bien arrêtées sur le conflit en cours et les enjeux stratégiques qui le sous-tendaient. Les coups tordus internes vinrent d'ailleurs. D'une hybride fraction apparemment moderniste du syndicat qui, peu instruite de son histoire et incapable de s'en inspirer, était prête, par opportunisme, à profiter de ce conflit pour en finir avec les « archaïsmes » d'une Vieille Cause qui leur semblait peu porteuse pour réaliser leurs plans de carrière. Elle fut battue, c'est sûr, et plutôt largement, cette fraction hétéroclite, mais son juridisme foireux, son manque de courage, sa manière de défaire des réputations et la constance qu'elle mit à salir des engagements, dont ceux de Floréal Cuadrado, marquèrent indubitablement un moment inédit dans l'histoire du Syndicat des correcteurs : celui où une conjuration de médiocres et d'arrivistes rate sa cible, mais atteint l'image même de l'organisation qui, faute de vigilance et d'implication, l'a laissée prospérer. Autrement dit, elle révèle que ce syndicat à bien des égards exemplaire n'était plus ce qu'il avait été.
C'est en quoi Du rififi chez les aristos dresse un portrait étayé sur un moment d'histoire agité du Syndicat CGT du Livre parisien et ses répercussions au sein du Syndicat des correcteurs. Ses détracteurs y verront surtout un autoportrait complaisant de son auteur en Commandeur, mais il serait étonnant qu'ils lui répondent. Hier comme aujourd'hui, ils ont toujours eu la mémoire courte.
Freddy GOMEZ

[1] Presque trente ans après le conflit évoqué dans cet ouvrage, le Syndicat CGT du Livre parisien n'est plus que l'ombre de lui-même et le « syndicat » des correcteurs est devenu « section » du Syndicat général du livre et de la communication (SGLCE).
[2] Coforma, première école de formation du syndicat, fut fondée en 1978. Vingt ans plus tard, elle fut remplacée par Formacom. Auparavant, on devenait correcteur syndiqué sur passage d'un test – particulièrement vicelard – du Syndicat des correcteurs. Une fois admis au test, l'impétrant bénéficiait des pistes du bureau de placement syndical pour trouver du boulot. Ce n'est que sur présentation de six feuilles de paye et le parrainage de deux correcteurs syndiqués à jour de leurs cotisations, que l'admission était soumise au vote d'une assemblée générale statutaire du syndicat.
23.11.2025 à 18:35
La vie contre les aménageurs
■ Jean-Marc GHITTI LA TERRE CONFISQUÉE Critique de l'aménagement du territoire La Lenteur, 2025, 160 p. Ces derniers mois j'ai arpenté des territoires. Le défi était de raconter des lieux difficilement racontables : une usine de purification d'uranium sise à Narbonne (Aude) et un fleuve asséché des Pyrénées-Orientales : l'Agly . Ces deux espaces géographiques sont intimement liés à notre crépusculaire modernité. Pour l'usine atomique, construite sur une nappe phréatique, y'a pas photo ; (…)
- Recensions et études critiquesTexte intégral (2576 mots)

■ Jean-Marc GHITTI
LA TERRE CONFISQUÉE
Critique de l'aménagement du territoire
La Lenteur, 2025, 160 p.
Ces derniers mois j'ai arpenté des territoires. Le défi était de raconter des lieux difficilement racontables : une usine de purification d'uranium sise à Narbonne (Aude) et un fleuve asséché des Pyrénées-Orientales : l'Agly [1]. Ces deux espaces géographiques sont intimement liés à notre crépusculaire modernité. Pour l'usine atomique, construite sur une nappe phréatique, y'a pas photo ; quant au fleuve, il suffit de corréler son état critique à l'effondrement des précipitations dans les Pyrénées-Orientales – et de rappeler qu'une des incidences du chaos climatique est de flinguer le cycle de l'eau.
Pour décrire l'usine et le fleuve, j'ai fait des portraits de gens vivant dans leur environnement. Au fil des échanges, un invariant est apparu : les riverains de l'usine ou du fleuve n'ont aucune maîtrise du territoire qu'ils habitent. Ils subissent : une menace difficile à cartographier, une parole publique discréditée, une injonction à faire preuve de résilience car seule la résilience contiendrait une promesse d'adaptation à la catastrophe – nucléaire ou écologique – en cours.
Habiter un territoire, c'est habiter un concept car le territoire est une revendication permanente : de ses habitants qui croient le peupler, des politiques qui en font une marque promotionnelle, de l'Europe qui les met en concurrence, des aménageurs qui sont avant tout les agents de la modernisation, mot creux et commode pour désigner notre déracinement perpétuel en vue de nous arrimer aux artefacts de la société industrielle.
Perversion dialectique : le territoire fixe tout en expropriant les gens qui vivent sur son sol. De fait, le territoire est une accoutumance forcée : aux pollutions, au dépérissement, à la laideur, à l'impuissance collective, à un futur bouché. Le territoire est la nature sous cloche maintenue fonctionnelle grâce à une ingénierie pondue par une technocratie au faîte de sa puissance. Par exemple, si le fleuve Agly coule encore certains mois de l'année, c'est grâce à des lâchés d'eau faits depuis un barrage ; laissé à son état naturel, ce fleuve âgé de plusieurs millions d'années ne serait plus que caillasses blanches. Bref, la modernité maintient en vie d'une main ce qu'elle tue de l'autre. Le territoire est une unité de soins palliatifs.
J'en étais là de mes sombres ruminations lorsque le bouquin de Jean-Marc Ghitti m'est arrivé par la poste. C'est une évidence : on ne sait jamais ce que renferme un livre avant de l'avoir lu. Celui-ci plus que tout autre : avec son titre énigmatique et sa couverture illustrée par le cul d'un grumier, La Terre confisquée est un objet étrange dont le sous-titre – Critique de l'aménagement du territoire –, sous une apparente austérité et technicité, n'annonce rien de la richesse et de l'acuité de la pensée de son auteur. Professeur de philo à la retraite, Jean-Marc Ghitti vit en Haute-Loire, pays de forêts, de scieries et donc de grumiers. Respectant la tradition philosophique, son enquête part d'un étonnement : celle d'une route nationale vide (la RN 88 reliant Lyon à Toulouse) durant un confinement de 2020. Une route sans trafic c'est comme un corps désapé : alors que tout se dévoile, une nouvelle chape de mystère se forme, nimbant la nudité. Un mystère que va questionner et creuser le philosophe dans une passionnante « enquête philosophique ». Au début du XIXe siècle et ce pendant des décennies, la RN 88 épousait encore le relief tortueux du Massif central. Elle en suivait les courbes et les déclivités. La main bitumeuse de l'homme s'adossait encore au relief de la nature. Puis, à la faveur des progrès de l'ingénierie routière, le rapport de forces s'est inversé. À la manière d'une gigantesque défonceuse, la RN s'est faite ligne droite : elle a imposé son tracé de balafre à un paysage devenu modelable. « Mais qu'y a-t-il derrière ce combat de la route contre la montagne ? », se demande alors Jean-Marc Ghitti.
Isolés ensemble
Pour faire parler l'énigme, l'auteur fait feu de tout bois. La Terre confisquée conjugue histoire (ancienne et contemporaine), théorie critique, sémiologie, philosophie, sociologie. Jean-Marc Ghitti puise aux meilleures sources : l'École de Francfort, Illich, Marcuse, Debord – Debord qui a précisément consacré son chapitre VII de La Société du Spectacle [2] à « l'aménagement du territoire », chapitre bref mais clé dans lequel il insiste (thèse 172) sur cette analyse majeure qu'après nous avoir isolés, l'urbanisme nous a réunis en tant qu' « individus isolés ensemble ». Cette idée n'est pas simplement un motif romantique destiné à illustrer le sentiment d'isolement dans l'anonymat des foules, elle est aussi un axe politique permettant de comprendre notre désagrégation sociale, et donc notre impuissance à faire peuple. À cette coupure des uns avec les autres s'en ajoute une autre, majeure aussi : celle avec notre environnement, transformé en un décor flottant. « Sur l'autoroute ou dans le train, note Ghitti, je vois la nature comme un spectacle qui défile, un film. » Simulacre ou marchandise, c'est pareil, le paysage se consomme au gré de déplacements où tout n'est que vitesse et délire ubiquitaire. Être partout et nulle part à la fois. Ballotté au gré d'une signalétique indiquant ici un « bourg de caractère », ailleurs les vestiges d'un oppidum préromain, le nomadisme du citoyen-monade n'est plus qu'un flux savamment cadré au milieu d'autres flux marchands.
« Le capitalisme produit la ville en image, il produit la campagne en paysage, il produit, depuis peu, la Terre entière numérisée : je peux faire la visite des lieux les plus lointains en restant dans mon fauteuil, plaid sur les genoux », écrit Ghitti. Et pendant que le double de notre planète se numérise par la magie du pixel, la vraie voit ses équilibres écologiques s'effondrer dans une indifférence affolante. Pendant que la Terre se glace en une « planète géopolitique », les possibilités de simplement l'habiter pour y mener une vie à hauteur humaine se contractent dangereusement.
Penser notre présente condition peut provoquer son lot de vapeurs angoissées et de vertiges. Penser le sol qui se dérobe, les éléments empoisonnés, le futur soudain plombé : voilà un privilège dont on se serait bien passé. Mais si tout n'est plus que simulacre, pire serait notre sort si on y rajoutait des œillères. Né à Saint-Étienne, Jean-Marc Ghitti connaît la puissance du vert : couleur de l'espoir et du renouveau. On se marre comme on peut ; Ghitti, lui, bosse et remonte le temps. Il a envie de comprendre d'où nous vient cette maniaquerie géographique consistant à cadastrer et parcelliser la nature – car, sans ce premier pécher originel, pas de mise en coupe réglée de notre biotope. Il se pourrait que la société industrielle s'enracine dans la très vieille histoire, celle remontant à la Rome antique où l'imperium (la puissance régalienne) aurait accouché de la notion de territoire vue comme « réalité géo-administrative », soit l' « inscription du pouvoir sur le sol terrestre ». Dès le départ, le territoire est la marque administrative de l'empire. Le philosophe explique : « C'est par l'aménagement des villes et des routes, urbes ed viae, que le territoire s'invente, au cœur du système impérial, comme une réalité nouvelle promise à un long avenir. »
La Chrétienté et la période médiévale opèrent un virage à 180° : la seule maison des Hommes étant le royaume de Dieu, le territoire promu par l'imperium passe au second plan. Camarade lecteur, souviens-toi : dans La Fin de la mégamachine – en ligne ici –, Fabian Scheidler avait déjà pointé le Moyen Âge comme période de relâchement de la pression économico-politique sur les humains et la nature. Mais le « territoire » reprend du poil de la bête à la faveur de la création des États-nations et de la fièvre rationaliste du XIXe siècle.
Du côté de la critique anti-industrielle, quelque chose coince avec l'héritage des Lumières et de la raison. Si l'esprit critique et la possibilité de penser par soi-même ont gagné en force et en autonomie, nous délestant du poids abrutissant des religions, ce fut au prix d'une autre aliénation : celle visant à remettre les clés de notre destin commun aux mains du clergé du Progrès. La nature insatiable du Capital n'en demandait pas tant qui trouva dans la technocratie naissante (soit l'alliance de la science et de la politique) un point d'ancrage définitif faisant des communautés humaines un vivier de forces vives à encaserner dans ses manufactures et de la nature un stock de matières à extraire. Le capitalisme industriel accouchait alors d'un ordre politique où vivre dans une relative symbiose avec la nature devint un arc-boutement d'un autre temps. Les premiers trains furent mis sur rail pour transporter des marchandises, puis on eut l'idée d'y faire circuler les gens. Pour le Capital, les priorités ont toujours été claires.
Le monde rétrécissait ; notre capacité à comprendre « ce que la politique fait à la Terre » aussi. L'enchantement quittait les forêts, les rivières, les aurores boréales et les vols de grues pour le magnétisme vicié de lendemains farcis de promesses. Désormais, le présent se conjuguerait au futur dont les bourgeons annonçaient les fruits d'une interminable Croissance. Fantasme d'une vie désentravée – déterritorialisée ? Même pas, puisque désormais les « territoires » nous cernaient. « Tout processus de développement atteint, à un certain moment, son point de bascule à partir d'où ce qui était croissance devient corruption, énonce Jean-Marc Ghitti. Par conséquent, il n'y a pas de croissance infinie : un développement qui se poursuit indéfiniment s'inverse de lui-même en une dégénérescence. »
Contre la raison organisatrice
Vivons-nous une époque de dégénérescence ? L'auteur de La Terre confisquée est allé chercher des éléments de réponse du côté d'Adorno et d'Horkheimer. Dans un bref mais essentiel chapitre intitulé Le retournement de la raison de dévoilement en une raison technocratique, Ghitti nous rappelle cette trouvaille mise à jour par les deux philosophes de l'École de Francfort : si la raison est recherche de vérité, il ne faut pas oublier que la vérité fait souvent peur. C'est ainsi que la raison peut louvoyer pour ne pas heurter, voiler ses intentions tout en dévoilant la vérité. Stratégie ? Jeu de dupe ? Peu importe au fond : la raison ne se comprend qu'à la lumière de ses usages pas toujours neutres ou avouables. Citons copieusement le philosophe : « Historiquement, les deux philosophes [Adorno et Horkheimer] situent au XIXe siècle cette inversion d'une raison émancipatrice des Lumières en une raison scientifique au service du pouvoir : dès le règne de Napoléon, disent-ils, mais c'est le positivisme du philosophe Auguste Comte qui parachèvera ce retournement. “L'adaptation au pouvoir du progrès implique le progrès du pouvoir” », lit-on dans La Dialectique de la Raison. Et les auteurs vont même jusqu'à parler de “malédiction” à propos de ce retournement d'une rationalité en une autre. Le mal, en l'occurrence, tient à ce que la raison cesse d'être démystificatrice et critique : elle devient principalement organisatrice. »
Une raison qui organise, on sait ce que ça donne : l'administration de la vie sous toutes ses coutures. Soit notre mise en ressources humaines. Auquel cas les routes ne sont plus construites pour relier les hommes entre eux mais pour les mener d'un point A à un point B en un temps toujours plus record. Ghitti parle de « soumission des hommes aux puissances du rationnel » ; de son côté, Carole Delga, cheffe BTP de l'Occitanie, thatchérise : « Il n'y a pas d'alternative »… à l'A69.
« Pour entraver la réduction de la Terre à ses territoires et la réduction de l'existence à ses fonctions dans le corps global, une philosophie critique est indispensable, énonce l'auteur de La Terre confisquée. Il faut éclaircir les évolutions historiques qui ont tourné les choses en ce sens. À ne pas le faire résolument, l'écologie contemporaine souffre souvent d'incohérence. » Avant de postuler un peu plus loin : « Il n'est jamais judicieux d'adopter le langage et le système de représentation de ceux qu'on veut combattre. » Ici se niche un enjeu de taille : ne pas singer la langue de l'ennemi au risque de rester les éternels débiteurs d'abstractions mathématiques et les dindons de politiques de compensation écologique.
Le premier territoire à libérer est mental : ainsi se réamorcera la pompe de nos imaginaires et de notre capacité à peupler la Terre autrement que comme des bipèdes en voie de dématérialisation.
Sébastien NAVARRO