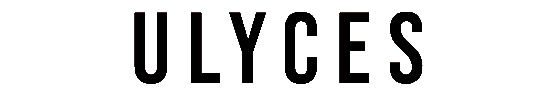17.04.2023 à 14:55
La Troisième Guerre mondiale va-t-elle commencer à Taïwan ?
Ulyces
14 mars 2022. Le ministère de la Défense taïwanais est en alerte. La matinée vient à peine de s’achever, et déjà, treize avions militaires chinois ont pénétré la zone d’identification de défense aérienne de l’île. Taïwan est coutumière de ces démonstrations de force. La petite île, qui porte aussi le nom de République de Chine […]
L’article La Troisième Guerre mondiale va-t-elle commencer à Taïwan ? est apparu en premier sur Ulyces.
Texte intégral (3628 mots)
14 mars 2022. Le ministère de la Défense taïwanais est en alerte. La matinée vient à peine de s’achever, et déjà, treize avions militaires chinois ont pénétré la zone d’identification de défense aérienne de l’île. Taïwan est coutumière de ces démonstrations de force. La petite île, qui porte aussi le nom de République de Chine (RDC) depuis que s’y sont installés des dissidents chinois en exil en 1949, souhaite que son indépendance soit reconnue mondialement. Mais la République populaire de Chine (RPC) la voit toujours comme l’une de ses provinces. Taïwan n’a pourtant jamais été gouvernée par sa grande voisine, ce qui fait dire à quelques États membres de l’ONU – 14 sur 192 – qu’elle est un État indépendant – avec son propre gouvernement, ses frontières et sa souveraineté.
Chaque jour ou presque, le site du ministère égrène le type et le nombre d’avions envoyés par le gouvernement chinois pour tester son espace aérien. Pour faire face à toute éventualité, les appareils qui y entrent doivent être rapidement identifiés, localisés et contrôlés. Mais depuis deux ans, la Chine met une telle pression – 969 violations comptabilisées pour la seule année 2021, selon une base de données de l’AFP ; du jamais-vu – que le matin même, un avion taïwanais s’est abîmé en mer de Chine lors d’un entraînement de défense. C’est le sixième depuis 2020… Si l’accident n’a pas fait de victime, deux autres pilotes ont péri par le passé, et trois n’ont jamais été retrouvés.

Des avions de chasse chinois en plein entraînement
Crédits : China Military Online
Ces incidents font craindre une escalade dans le conflit entre la République populaire de Chine et Taïwan. D’autant que les principaux intervenants ne semblent pas disposés à faire la moindre concession. « Il n’y a qu’une seule Chine dans le monde, et Taïwan est une partie inaliénable de son territoire », a ainsi tenu à rappeler Zhao Lijian, l’un des porte-paroles du ministère des Affaires étrangères chinois, en conférence de presse dans l’après-midi du 14 mars. Il s’est ensuite adressé aux États-Unis, principaux soutiens de l’île : « Nous avertissons formellement le gouvernement américain : jouer la “carte de Taïwan”, c’est comme jouer avec le feu. »
La menace fait écho à l’engagement formulé par Joe Biden, le 21 octobre 2021, de défendre l’île militairement s’il le fallait. Un engagement renouvelé et réaffirmé le 23 mai 2022 lors d’une visite au Japon, pendant laquelle le président américain a déclaré que les États-Unis « seraient forcés d’engager la force militaire si la Chine venait à envahir Taïwan ». La situation politique entre la Chine et Taïwan crée dans l’esprit des observateurs un parallèle avec la situation actuelle en Ukraine, où la guerre lancée par la Russie de Vladimir Poutine fait rage, depuis le 24 février dernier. L’invasion du voisin russe pourrait inspirer à la Chine des velléités guerrières. De quoi réveiller la crainte d’un possible conflit généralisé.
Instabilité
Taïwan a une histoire complexe. L’île a connu de nombreux changements successifs de gouvernance. Colonisée par les Espagnols dès 1626, la “Belle Île” est passée aux mains des Néerlandais, puis des Chinois de la dynastie Qing, avant d’être finalement cédée à l’empire du Japon, en 1895. Défaits en 1945, les Japonais remettent Taïwan à l’ONU, qui confie à son tour la stabilisation de l’île à la République de Chine (RDC) gouvernant le continent voisin à l’époque. En 1949, la victoire des communistes de Mao Zedong et la création de la République populaire de Chine (RPC) transforment le statut de l’île : deux millions de dissidents de la RDC s’y réfugient, rejoignant les populations natives ; et s’en emparent.
Le soutien des États-Unis date de cette période : en 1950, la guerre de Corée les décide à protéger l’île d’un possible débarquement communiste, en interposant leur flotte. Les américains continuent de reconnaître le régime en place comme étant le seul légitime jusqu’en 1979, date à laquelle ils transfèrent leur ambassade à Pékin et retirent leurs forces de Taïwan. En contrepartie, le Congrès américain vote le Taiwan Relations Act, une loi délibérément ambiguë visant à empêcher une déclaration d’indépendance unilatérale de Taïwan, ou au contraire, une annexion de l’île par la Chine. Bien qu’elle ne garantisse pas l’intervention militaire américaine en représailles d’une invasion, elle autorise Washington à fournir à l’île des moyens de se défendre contre une réunification forcée.

Vue aérienne de l’île de Taïwan et des côtes chinoises
Crédits : Gallo Images
Xi Jinping, arrivé au pouvoir en 2013, a rendu plus agressive la posture de la Chine vis-à-vis de Taïwan. Comme Vladimir Poutine, il a la volonté farouche de restaurer la grandeur d’un ancien empire qui aurait été dépossédé de ses terres. Par la force, s’il le faut. Dans son discours à la nation russe du 21 février, annonciateur de l’invasion en Ukraine à venir, le chef du Kremlin a d’ailleurs commencé son allocution par des mots très proches de ceux qu’emploie régulièrement le gouvernement chinois : « Pour la Russie, l’Ukraine n’est pas seulement un pays voisin, c’est une partie indivisible de notre histoire, de notre culture, de notre espace spirituel. »

Le président chinois Xi Jinping
Crédits : OMS
Avec une différence notable, qui a gêné la Chine lors de sa déclaration de soutien à la Russie, face à l’Occident : en fin de discours, Vladimir Poutine a reconnu l’indépendance et la souveraineté des États sécessionnistes ukrainiens de Donetsk et de Louhansk, alors même que la République populaire s’oppose, elle, à l’indépendance taïwanaise. Cette nuance contraint Pékin à endosser un rôle d’équilibriste, au lendemain de l’offensive lancée par Poutine. Le gouvernement chinois refuse de parler d’invasion et souligne sa « compréhension » des inquiétudes russes pour leur sécurité territoriale. Mais il se garde bien de soutenir l’intervention. « La Chine s’est volontairement mise en retrait pour analyser la gestion russe de l’opération et la réponse des Occidentaux », résume Marc Julienne, chercheur et responsable des activités Chine à l’Institut français des relations internationales (IFRI). « Elle a été surprise du soutien massif à l’Ukraine et des mesures de rétorsion très fortes contre la Russie, mais cela lui permet d’anticiper de futures sanctions financières en cas de reprise armée de Taïwan. » Autrement dit, ses objectifs vis-à-vis de l’île restent inchangés.
Rôle essentiel
Car au-delà des prétentions géographiques et historiques, Taïwan, comme l’Ukraine, a une réelle importance stratégique et économique. Ce n’est pas un hasard si les deux territoires cristallisent les tensions entre le “bloc de l’Est”, mené par la Chine et la Russie, et le “bloc de l’Ouest”, dirigé par les États-Unis, adversaire commun des deux superpuissances. L’Ukraine est un couloir naturel entre l’Eurasie et l’Europe de l’Ouest. Elle offre un accès privilégié à la mer Noire et permet au gaz russe d’être acheminé vers l’Ouest par gazoduc. Et si Taïwan semble n’être qu’un petit territoire perdu en mer de Chine méridionale, l’île est bien plus que cela.
« Dans le bassin Indo-Pacifique, Taïwan est fondamental », souligne Yann Roche, président de l’Observatoire de géopolitique de la Chaire Raoul-Dandurand, à Montréal. « C’est la clé pour sortir du littoral chinois en évitant les territoires des alliés des États-Unis. » Dans cette zone géographique qui comprend l’océan Indien et la partie occidentale de l’océan Pacifique, le géant asiatique est en effet bien seul. Au Sud, les Philippines, l’Indonésie et la Malaisie bloquent le passage. À l’Est, le Japon et la Corée du Sud, alliés traditionnels de Washington, occupent l’espace. Cette “première chaîne d’îles” l’empêche de patrouiller dans l’océan Pacifique et de menacer les côtes américaines de ses sous-marins nucléaires. Pour la Chine comme pour les États-Unis, Taïwan fait donc figure de passage géo-stratégique essentiel.
Le petit État a d’autres atouts. Économiquement, c’est l’une des plus grandes puissances d’Asie. C’est surtout le principal producteur de semiconducteurs – des composants électroniques – dans le monde, et de loin. L’île fabrique environ 70 % de ces puces indispensables à la production de tout objet électronique, des smartphones au matériel médical. Le marché est prospère ; il représentait 583 milliards de dollars (environ 530 milliards d’euros) en 2021, selon l’entreprise américaine de conseil et de recherche Gartner. Au point que certains pays d’Europe – Allemagne et France en tête – sont entrés en discussion avec Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), la plus importante fonderie de semiconducteurs de l’île, pour que celle-ci implante des usines sur le vieux continent.
Les États-Unis aussi s’intéressent de près à ce secteur de l’industrie taïwanaise. Car le marché peut provoquer des fluctuations économiques importantes dans les domaines technologiques. Dès 2020, un ralentissement de la production dû à la pandémie de Covid-19 avait entraîné une pénurie des puces. La fabrication de certains produits, comme les cartes graphiques ou les voitures, avait été réduite ou stoppée, et leurs prix s’étaient envolés. Un levier de pression très utile que la Chine perdrait si l’indépendance de l’île, couplée à un rapprochement des États-Unis et de l’Europe, était actée. À l’évidence, Xi Jinping est résolu à récupérer ces avantages, lui qui appelle régulièrement à la « réunification complète de la patrie ». Quitte à ce qu’en mer de Chine méridionale, la tension reste à son comble.
Conflit international
« Seul un engagement militaire massif des États-Unis pourrait, en cas de guerre, sauver l’île », juge Jean-Pierre Cabestan, auteur du livre « Demain la Chine, guerre ou paix ? » Mais de l’autre côté de l’océan Pacifique, le colosse américain a perdu de sa superbe. Les interventions successives à l’étranger – comme en Irak ou en Afghanistan –, souvent impopulaires et ratées, ont écorné son image aux yeux du monde. « Le passé a prouvé que malgré leur impressionnante puissance militaire, il restait difficile pour les États-Unis de gagner des guerres terrestres », analyse Yann Roche. Et le mandat de Donald Trump à Washington a amplifié la volonté, chez les Républicains notamment, « d’arrêter d’être les protecteurs du monde aux frais de la nation. » Le pays de l’Oncle Sam semble douter, et ses prises de positions timorées lors de l’invasion de l’Ukraine ne sont pas pour rassurer ses alliés. Il n’est pas dit que Joe Biden arrive à un consensus total du Congrès en faveur d’une option militaire, si le conflit à Taïwan dégénérait.
Pour autant, l’actuel locataire de la Maison-Blanche continue d’assurer Tsai Ing-wen, la présidente taïwanaise, du soutien de son pays. Depuis sa promesse du 21 octobre de défendre l’île militairement face à la Chine, sa position et son discours n’ont pas changé. Ils ont même été renforcés par la récente déclaration du 23 mai, lors de sa visite au Japon. La crise ukrainienne a même raffermi les liens entre Washington et Taipei, confirmant l’allié américain dans son rôle de plus important soutien de l’île à l’international. En Europe, le discours du président n’avait pas été le même. Biden avait assuré, dès le début de l’attaque russe, ne pas vouloir faire intervenir son armée. Du moins, tant que Poutine « ne s’installe pas dans les pays de l’OTAN ». Preuve s’il en est que l’intérêt stratégique des États-Unis se trouve ailleurs.
Et raison de plus, pour la Chine, de s’agacer de cette alliance. Elle exprime fréquemment « son vif mécontentement » pour ce qu’elle considère être « de l’ingérence dans ses affaires intérieures ». Au point de multiplier les passages de ses porte-avions dans les eaux du détroit de Taïwan, qui sépare l’île de la Chine continentale. Le jeu est risqué pour les deux camps : en mer de Chine méridionale, les américains mènent eux aussi des « Opérations pour la liberté de la navigation », les Fonops (Freedom of navigation Operations). Leurs navires de guerre parcourent la zone maritime, s’appliquant à « exercer et faire respecter les droits et libertés de navigation à l’échelle mondiale », comme le rappelle le département d’État nord-américain. À force d’intimidation et de provocations de part et d’autre, le risque d’accrochages ou d’affrontements accidentels augmente.

Un navire de guerre américain dans le détroit de Taiwan
Crédits : US Navy
Le début d’un conflit plus étendu, aussi. « Si les deux superpuissances mondiales venaient à s’engager militairement, de nombreux pays suivraient », pressent Marc Julienne. À commencer par le Japon et l’Australie, membres du Quad, une alliance militaire dont les États-Unis et l’Inde font aussi partie ; ou la Corée du Sud. Le Premier ministre australien, Scott Morrison, a abordé frontalement le sujet, le 3 mars, au sortir d’une de leurs réunions virtuelles : « On ne peut pas autoriser que ce qui se passe en Ukraine puisse un jour se produire dans l’Indo-Pacifique. » Dans l’hypothèse d’un conflit, la réponse sera internationale.
Dans ces conditions, il paraît peu probable que Pékin lance une opération militaire à Taïwan dans l’immédiat. La Chine a peu d’alliés, le plus important d’entre eux étant déjà sur le front de guerre en Ukraine. Difficile d’imaginer l’Iran, le Pakistan ou la Corée du Nord peser dans une guerre qui serait mondiale, même si les deux derniers possèdent l’arme nucléaire et que Pyongyang a repris ses tirs de missiles balistiques intercontinentaux le 24 mars dernier – une première depuis 2017. Et ces partenariats sont encore loin des alliances américaines, qui impliquent des clauses de défense mutuelle, et des accords de bases et de manœuvres militaires conjointes. Elle-même manque de ravitailleurs en vol et de bateaux amphibies pour transporter ses véhicules militaires.
Mais la Chine se prépare, elle modernise et renforce son armée. Tout au long des années 2000, elle n’a eu de cesse d’augmenter son budget de la défense – près de 10 % supplémentaires chaque année, en moyenne, comptabilise le géopolitologue Pascal Le Pautremat dans la Revue Défense Nationale. Ce qui a fait dire au général Mark Milley, chef d’État-Major des armées américaines, lors de son audition au Congrès du 17 juin 2021, qu’il tablait sur une fin des préparations chinoises à l’horizon 2027-2035. « Le ministre de la Défense taïwanais, Chiu Kuo-cheng, prévoit même une possibilité d’invasion “totale” de l’île d’ici 2025 », acquiesce Marc Julienne, avant de s’exclamer : « En terme d’horizon stratégique, autant dire que c’est demain. » D’ici là, il est fort probable que la Russie aura fini sa campagne ukrainienne, dont on se rappellera peut-être, qui sait, qu’elle a été le premier acte du basculement du monde vers une troisième grande guerre.
Couverture : Reuters
L’article La Troisième Guerre mondiale va-t-elle commencer à Taïwan ? est apparu en premier sur Ulyces.
22.03.2023 à 13:14
Tragédies en série et folie meurtrière : la vérité sur la malédiction des Power Rangers
Pablo Oger
Samedi dernier, Jason David Frank, pratiquant d’arts martiaux et « force verte » de la série Power Rangers, est retrouvé sans vie à son domicile. L’enquête suggère un suicide. « Il était une source d’inspiration pour tant de personnes. Sa présence nous manquera énormément. C’est si triste de perdre un autre membre de notre famille de […]
L’article Tragédies en série et folie meurtrière : la vérité sur la malédiction des Power Rangers est apparu en premier sur Ulyces.
Texte intégral (2937 mots)
Samedi dernier, Jason David Frank, pratiquant d’arts martiaux et « force verte » de la série Power Rangers, est retrouvé sans vie à son domicile. L’enquête suggère un suicide. « Il était une source d’inspiration pour tant de personnes. Sa présence nous manquera énormément. C’est si triste de perdre un autre membre de notre famille de Rangers », a déclaré Walter Jones, qui jouait le rôle du Ranger noir dans la série. Ce n’est malheureusement pas la première fois que le casting de Power Rangers perd l’un de ses membres.
Dans la nuit du 3 septembre 2001, sur l’autoroute séparant San Francisco de Los Angeles, les roues d’une voiture heurtent le gravier le long de la route. La conductrice perd soudainement le contrôle et le véhicule fait un violent écart, fonçant droit dans la paroi rocheuse qui borde l’autoroute. Après plusieurs tonneaux, la voiture traverse la chaussée, finissant sa course contre un second mur de pierre. À son bord, trois jeunes femmes se trouvent dans un état critique. Deux d’entre elles sont sauvées par les secouristes, mais Thuy Trang, 27 ans, meurt avant d’arriver à l’hôpital.
Quelques années avant sa mort tragique, l’Américaine originaire du Vietnam débutait sa carrière d’actrice. Et pour son premier rôle important, elle incarnait Trini Kwan, la Ranger jaune de la série originale Mighty Morphin Power Rangers. À ses funérailles, les autres Rangers sont venus lui rendre hommage.

Thuy Trang jouait Trini Kwan, la Ranger jaune
Crédits : Power Rangers Tempestade Ninja
« Je me souviens que Thuy était toujours blessée sur le plateau », racontait plus tard le Ranger vert Jason David Frank. « Elle se donnait à fond, alors parfois il lui arrivait des bricoles. Je me souviens qu’on a souvent dû la porter à cause de ses blessures. Elle était toujours positive et donnait le meilleur d’elle-même. »
Ensemble dès le jour du casting, les deux jeunes acteurs s’entendaient à merveille. Mais Jason n’a pas pu assister aux funérailles de son amie, car il s’occupait encore des affaires de son grand frère Erik Frank, décédé lui aussi quelques mois plus tôt. Ce dernier avait failli décrocher le rôle du Ranger doré. Ces deux disparitions ne représentent qu’une fraction des tragédies qui ont frappé les acteurs de la série. Ce qui fait murmurer à Internet qu’ils ont été les victimes d’une bien étrange malédiction : la malédiction des Power Rangers.
Série noire
Peu de gens le savent, mais Erik Frank a fait ses débuts dans la franchise derrière la caméra. Il est ensuite passé sous les projecteurs, pour devenir le frère perdu du personnage de Tommy Trueheart, interprété par son petit frère dans la série originale, puis dans Power Rangers : Zeo. L’essai avait été concluant, et Erik aurait dû rejoindre le casting permanent pour de futures saisons. Malheureusement, il a succombé à une maladie le 16 avril 2001 à l’âge de 29 ans, sans que son frère Jason ne souhaite donner plus de précisions. La nouvelle a bouleversé les fans de la série, qui espéraient voir le duo réuni à nouveau. Des années plus tard, l’acteur soulignait encore le manque laissé par la tragédie, dans sa vie comme dans l’univers des Power Rangers.
Le 25 mai 2017, Jason a cru à son tour que sa fin était venue. Alors qu’il participait à la Comic-Con de Phoenix, l’acteur a été la cible d’un homme en tenue de Punisher, le justicier ultra-violent de l’univers Marvel. L’assaillant était armé d’un fusil à pompe, de trois pistolets, de shurikens et d’un couteau de combat. Il a finalement été maîtrisé par la police avant d’avoir pu approcher le Ranger vert. Sur son téléphone, le suspect avait un rappel pour le jour-même indiquant : « Tuer JDF. »

Jason David Frank, le Ranger vert
Quatre ans plus tard, Jason David Frank se porte bien. Sa carrière d’acteur a beau être au point mort, à l’exception du tournage du fanfilm Legend of the White Dragon, il a au moins la vie sauve. Au vu du nombre de malheurs qui se sont abattues sur la saga télévisée, ce n’est pas rien.
Ainsi le 11 mai 2019, l’acteur Pua Magasiva s’est suicidé dans une chambre d’hôtel de Wellington. Ses fans sous le choc ont alors appris la dure vérité sur le Ranger rouge de Power Rangers Ninja Storm. La veuve de Pua a révélé toute l’horreur de sa relation abusive avec l’acteur, aboutissant à une agression brutale contre elle la nuit de sa mort.
Alors que les réseaux sociaux du couple laissaient penser qu’ils vivaient une romance digne d’un conte de fées, elle et sa fille vivaient dans la peur de la violence et des abus émotionnels. Elle a déclaré avoir été victime à trois reprises de commotions cérébrales sous les coups du Ranger, qui aurait aussi menacé de faire du mal à sa fille Laylah. Quelques minutes avant sa mort, l’acteur l’a attaquée dans une rage ivre, lui a cogné la tête contre une table et l’a laissée inconsciente et en sang. Lorsqu’elle a repris connaissance, Pua était mort.

Pua Magasiva, ancien Ranger rouge
D’autres acteurs de la série ont pour leur part succombé à des maladies à un jeune âge. Dix-neuf ans plus tôt, en 2000, Bob Manahan, qui était au casting des quatre premières séries, est mort d’une crise cardiaque. La voix de Zordon, le mentor des Rangers, s’est pour sa part éteinte à l’âge de 44 ans. Son collègue Bob PapenBrook, qui disait les répliques de Rito Revolto, un des super-vilains, est quant à lui décédé d’une maladie pulmonaire chronique en mars 2006, à tout juste 50 ans. Quelques mois plus tard, c’était le tour d’Edward Albert. Après avoir tenu le rôle M. Collins dans Time Force, il est décédé à 55 ans d’un cancer du poumon. Et la liste est encore longue.
L’acteur Richard Genelle est mort deux ans après à l’âge de 47 ans. Le comédien qui incarnait Ernie, un allié des Power Rangers jusque dans la troisième série, a succombé à une crise cardiaque le 3 décembre 2008. Puis, quatre ans après sa première apparition en tant que Ranger blanc, ce fut au tour de Peta Rutter d’apprendre qu’elle avait une tumeur au cerveau. Elle s’est alors rapidement affaiblie, et a fini par perdre son combat le 20 juin 2010. Elle n’avait que 51 ans.
Ces trop nombreuses coïncidences tragiques ont ancré dans la tête d’une partie des fans que la franchise était victime d’une malédiction. Sa manifestation la plus effroyable (et grotesque) est sans conteste l’affaire du Power Ranger rouge.
Red Is Dead
Mais avant d’en venir à l’histoire macabre du Ranger rouge, notons qu’un autre acteur aperçu dans la série originale a été impliqué dans une sordide histoire. Lorsqu’il avait 14 ans, en 1994, Skylar Julius Deleon est apparu dans l’épisode « Seconde Chance ». Puis au début des années 2000, l’ancien enfant acteur est l’auteur d’une série de meurtres horribles. Aujourd’hui âgé de 41 ans, il est emprisonné dans le couloir de la mort, condamné à l’injection létale.
En 2009, il avait été arrêté pour le double homicide de Thomas et Jackie Hawks. Cherchant à acquérir un yacht, il est entré en contact avec le couple. Pour les convaincre de sa bonne foi, il leur a même présenté sa femme et sa fille d’un an. Lors d’une sortie suivante, l’acteur et deux complices ont maîtrisé le couple et les ont forcés à céder la propriété du bateau. Ils ont ensuite attaché le vieux couple à l’ancre, avant de les jeter dans l’océan Pacifique. Leurs corps n’ont jamais été retrouvés.
Skylar a également été reconnu coupable du meurtre de John Jarvi, en 2003. Il avait rencontré l’homme en prison, après avoir été arrêté pour cambriolage. Mais pour ne pas lui rembourser les 50 000 dollars qu’il lui avait empruntés, il a décidé de l’égorger et de laisser son corps au bord d’une route mexicaine. Un triple homicide sans lien avec la série, sinon sa brève apparition dans le show des années plus tôt. Ce n’est pas le cas de Ricardo Medina.
L’acteur Ricardo Medina Jr., qui a joué le Ranger rouge dans plusieurs séries Power Rangers, s’est lui aussi rendu coupable d’un meurtre violent. Le soir du Nouvel An 2015, il a brutalement assassiné son colocataire avec une réplique de l’épée de Conan le Barbare. L’acteur a d’abord affirmé qu’il avait agi en état de légitime défense. Mais il a finalement accepté de plaider coupable d’homicide volontaire plutôt que de risquer une condamnation à perpétuité.

Ricardo Medina Jr. dans son rôle de Ranger rouge
Crédits : Power Rangers Wild Force
Selon la police, Medina et sa petite amie étaient dans leur chambre quand Joshua Sutter est entré de force. L’acteur l’a alors poignardé avec la lame qu’il gardait derrière sa porte. Mais la version du comédien n’a pas semblé assez convaincante. « Il a choisi de tuer mon frère au lieu des nombreuses options que toutes les personnes rationnelles auraient prises », a déclaré la sœur de Sutter, devant le tribunal. « Il a choisi de tuer pour prendre une vie. »
Coïncidence macabre, les épées étaient l’arme de choix du personnage de Medina dans Power Rangers Samurai, de 2010 à 2012. Ricardo Medina Jr. a finalement écopé de six ans de prison et devrait être libéré cette année.
La rançon d’être un Ranger
Selon toute probabilité, cette collection de drames est totalement fortuite et ils sont si divers que leurs causes le sont aussi. Mais ils attirent l’œil sur un univers professionnel ultra-exigent et plein de désillusions, qui a pu favoriser certaines tragédies. Car être un Power Ranger n’est pas qu’une partie de plaisir, et l’implication demandée aux acteurs est pointée du doigt. Pour intégrer le show, les Rangers se devaient d’être des athlètes accomplis, ainsi que des experts des arts martiaux. Et il leur a fallu garder cette forme physique des années durant.
Il n’était d’ailleurs pas rare que des acteurs se blessent, à l’image de Thuy Trang. Selon certains témoignages, les conditions de travail étaient parfois à la limite de l’acceptable, et le rythme infernal. « Je rentrais à la maison et je tombais de sommeil, donc je ne retournais pas les appels manqués et certaines personnes ont pensé que j’avais changé », confie le Ranger noir Walter Emanuel Jones. La première saison de la série originale comprenait à elle seule 60 épisodes. Une première année de tournage dont Austin St. John se souvient parfaitement.
« Nous avons tellement enchaîné la première année. Du lundi au vendredi, tournage. Il faisait encore nuit quand on commençait, et il faisait nuit quand on finissait. Le samedi, on était appelés pour faire la voix off. Le dimanche, j’étais généralement si fatigué que j’allais juste à la salle pour m’entraîner, puis je rentrais chez moi pour me détendre. Je ne suis pas sorti pendant près d’un an. Nous avons finalement eu une semaine de congé pour Noël. J’ai dormi une journée entière pour essayer de retrouver mon énergie. À 19 ans, tu ne devrais pas avoir à faire ça ! »
En plus de leurs journées surchargées, les jeunes acteurs se sont soudain retrouvés sous les projecteurs. La première génération de Rangers n’y était absolument pas préparée. « Nous n’avions vraiment aucune idée de ce qui allait se passer », révèle le Ranger bleu David Yost. La première fois qu’Austin St. John est rentré dans un centre commercial, il a même dû être évacué par la sécurité. Cette soudaine célébrité n’a pas simplifié la vie des comédiens, ajoutant une forte pression sur leurs épaules. « Je l’ai trouvé incroyablement écrasante », se rappelle pour sa part Amy Jo Johnson, la Ranger rose.

Amy Jo Johnson, la Ranger rose originale
Être un Power Ranger n’était donc pas une partie de plaisir, mais poursuivre une carrière d’acteur après ça était encore plus complexe. Parmi ceux et celles qui s’y sont essayés, très peu ont réussi à sortir du lot. Walter Jones a bien fait quelques apparitions dans des séries à succès, mais toujours pour des rôles mineurs. Pour la plupart des Rangers, la fin de leur rôle dans la série était synonyme de fin de carrière. Il est possible que toucher son rêve du bout des doigts, puis se le voir refuser, ait pu créer de la frustration chez certains membres du casting.
Sans compter que toutes ces années de dévouement n’ont pas payé. Les acteurs gagnaient si peu que, même pendant qu’ils travaillaient, Austin et Walter (les Rangers rouge et noir) partageaient un appartement avec plusieurs cascadeurs. « C’était un show non-syndiqué », raconte le premier leader de la troupe. De fait, aucun des acteurs ne touchait la moindre compensation pour le merchandising de la série, qui était estimé à environ un milliard de dollars.
Au milieu de la deuxième saison, les conditions étaient telles que la moitié des Rangers a décidé de quitter la série. Amy Jo Johnson a par la suite regretté qu’elle et les autres membres du casting ne se soient pas joints aux démissionnaires. Tous ensemble, ils auraient sans doute obtenu de meilleurs contrats, et abouti à un résultat différent.
Malgré tous ces déboires, la franchise continue de se réinventer, et une nouvelle génération de Rangers a vu le jour avec la série Dino Fury, sortie en février. Quant aux acteurs passés, ils continuent d’endosser leur rôle pour participer à des rassemblements de fans. Des admirateurs du monde entier leur envoient encore des lettres pour les remercier d’avoir été une source d’inspiration. « Leurs histoires m’ont montré combien Power Rangers a aidé des enfants qui avaient juste besoin de se sentir en sécurité. C’est vraiment cool d’en avoir fait partie », confie l’ex Ranger rose. Même sans malédiction, devenir un Power Ranger aura inévitablement changé la vie de ces acteurs.
Couverture :
L’article Tragédies en série et folie meurtrière : la vérité sur la malédiction des Power Rangers est apparu en premier sur Ulyces.
03.11.2022 à 18:00
Comment Migos a marqué la pop culture
Nicolas Prouillac
Takeoff est mort à 28 ans. C’est avec cette information que les fans et acteurs du milieu du rap se sont réveillés mardi matin, choqués et émus par la nouvelle. « Plus rien n’a de sens. Plus rien du tout. », a tweeté le réalisateur Cole Bennett, qui a travaillé avec Takeoff sur plusieurs clips. […]
L’article Comment Migos a marqué la pop culture est apparu en premier sur Ulyces.
Texte intégral (5469 mots)
Takeoff est mort à 28 ans. C’est avec cette information que les fans et acteurs du milieu du rap se sont réveillés mardi matin, choqués et émus par la nouvelle. « Plus rien n’a de sens. Plus rien du tout. », a tweeté le réalisateur Cole Bennett, qui a travaillé avec Takeoff sur plusieurs clips.
De son vrai nom, Kirshnik Khari Ball, Takeoff a été assassiné au 810 Billiards & Bowling, au 1201 San Jacinto Street, à Houston, lors d’une soirée privée organisée le soir d’Halloween. Une altercation a éclaté entre Quavo et un individu non identifié à propos d’une partie de dés. « À 2 h 34 du matin, des officiers ont reçu un appel pour une fusillade en cours », raconte le chef de la police de Houston Troy Finner. Si Quavo n’a pas été blessé, Takeoff a pris deux balles perdues, dont une dans la tête qui a causé sa mort. « J’ai reçu de nombreux appels de Houston et de l’extérieur et tout le monde m’a dit que c’était un super garçon, qu’il était pacifique. Quel grand artiste. », ajoute Finner.
Un grand artiste en effet qui a marqué le monde de la musique et la pop culture accompagné de son oncle Quavo et de son cousin Offset. Retour sur le phénomène Migos, de son ascension à sa chute.
Le temps semble suspendu dans les montagnes de Santa Monica en cet après-midi de printemps. La température avoisine les 25°C sous le soleil californien, et pas un nuage ne vient encombrer l’azur où planent des buses en quête de gourmandises à se mettre sous le bec. En contrebas, Calabasas somnole. C’est l’heure de la sieste dans les collines arides qui servent d’enclave à The Oaks, la résidence surveillée la plus hype d’Amérique. Drake, Kanye West, J-Lo et la famille Kardashian y ont tous élu domicile, se cloîtrant dans d’exubérantes villas où s’entassent voitures de sport et piscines turquoise. C’est aussi là que vit Justin Bieber, dans une hacienda de plus de 800 m² située le long du bien nommé Prado del Grandioso. 
Juste de l’autre côté de la route, dans une villa toute en colonnes et fresques d’inspiration Renaissance, on ne dort pas. La brise porte la rumeur de basses puissantes et d’un refrain entêtant, qui sourdent de l’intérieur de la demeure baroque. « Versace, Versace, Versace… Versace, Versace, Versace… »
Les rappeurs de Migos sont ici pour tourner le clip d’un morceau qui deviendra rapidement iconique, après que Drake en fera un remix au mois de mai 2013 et qu’il servira d’hymne aux défilés de la maison de haute couture italienne. Mais pour l’heure, nous sommes le 9 avril et Drake est loin d’ici, accaparé par l’enregistrement de son album Nothing Was the Same. Quavo et Takeoff répètent un plan inspiré de La Cène, accompagnés du producteur du morceau Zaytoven.
Pour « Versace », le réalisateur Gabriel Hart, autoproclamé « The Video God », a vu les choses en grand. « On ne pouvait pas faire un clip de tier-quar pour parler de Versace », raconte-t-il. « La mode a fait un come-back en force dans le hip-hop, grâce à la jeune génération. » C’est pourquoi le groupe a fait le voyage depuis Atlanta, en Géorgie, pour passer une journée dans le décor de rêve qu’offre le havre ultra-sécurisé des icônes de la pop culture américaine. Pour remplir ses cadres de délices, Hart entasse devant la caméra une vingtaine de mannequins de l’agence NEXT, de magnifiques ensembles et parures Versace, des liasses de billets, des bouteilles de vodka fluorescentes importées de France, et un guépard… pour le panache.
Sorti en septembre de la même année, le clip fait un carton – il compte plus de 20 millions de vues sur YouTube – et marque le début de l’ascension de Migos vers le succès. La propriétaire de la villa, dont la ressemblance avec Donatella Versace frappe le réalisateur, fait une brève apparition dans le clip : l’illusion fonctionne et la presse s’emballe. « Pourquoi on ne pourrait pas vivre dans des châteaux et être acceptés par tout le monde ? » interroge Gabriel Hart. « Moi je dis qu’on peut. »
En 2013 déjà, c’était une question de culture – de cross plutôt que de clash. Aux critiques qui s’en sont pris à Miley Cyrus pour s’être appropriée la culture trap avec son album Bangerz, produit par le beatmaker d’Atlanta Mike WiLL Made-It, le vidéaste répond qu’il n’a que respect pour leur travail. Son clip lui rend hommage durant la séquence « Hannah Montana ». Depuis « Versace » jusqu’à la sortie de leur album Culture le 27 janvier dernier, l’univers de Migos n’a cessé d’infiltrer la culture contemporaine.
Mais pour y parvenir, le trio n’a fait aucune concession à la pop mainstream. En 2016, ils ont trôné au sommet du Hot 100 de Billboard avec « Bad and Boujee », pur produit de la culture trap d’Atlanta qu’ils ont réussi à globaliser.
Nawf
Quavo (Quavious Keyate Marshal), Takeoff (Kirshnik Khari Ball) et Offset (Kiari Kendrell Cephus) ont tous les trois grandi à Lawrenceville, une banlieue du comté de Gwinett située à 30 minutes au nord-est d’Atlanta. Une zone qu’on appelle généralement le Northside – le Nawf, dans l’argot du trio. Migos est une affaire de famille : Quavo est l’oncle de Takeoff, et Offset est le cousin de Quavo. Petits, ils passaient tout leur temps ensemble, à l’école comme en dehors, vivant sous le même toit chez la mère de Quavo. Ils l’appellent tous les trois maman. À l’adolescence, deux éléments déterminants viennent se greffer à la situation initiale : la drogue et le rap.
Dans les années 1990, le trafic de drogue se répand comme la peste dans les rues de la métropole d’Atlanta. Pour y faire face, la police locale crée en 1995 une unité spéciale baptisée Atlanta HIDTA, pour High Intensity Drug Trafficking Area, « zone de trafic de drogue à haute intensité ». Les organisations criminelles mexicaines sévissent dans les banlieues pauvres de la ville, profitant d’une vague d’immigration latino-américaine dans la région. Ils trafiquent la marijuana, la cocaïne, la méthamphétamine et l’héroïne par kilos dans les quartiers, installant leurs stocks, leurs points de vente et leurs réseaux dans les zones résidentielles ou industrielles les plus touchées par la misère. Les maisons abandonnées y sont légion et servent de camp de base aux dealers, qui les appellent les bandos (pour abandoned houses).
Ils dealent le jour, jamment la nuit, et se débarrassent de leur premier blase en 2010 pour se rebaptiser Migos.
Quand le trio commence à rapper en 2009, concoctant ses premiers sons dans le sous-sol de la maison de mama, le groupe se fait appeler The Polo Club. « Il y avait plein de clubs de polo à Atlanta quand on était gamins », se souvient Offset. Lui et Quavo ont 18 ans à l’époque – Takeoff a trois ans de moins qu’eux – et veulent devenir des hustlers : brasser du cash en dealant pour collectionner les filles et les belles voitures. Pour la musique comme pour la drogue, il faut commencer au bas de l’échelle. Mais dans les deux milieux, les perspectives d’avenir sont étincelantes pour qui réussit dans la région : la deuxième moitié des années 2000 sourit aux rappeurs comme aux trafiquants d’Atlanta.
D’après la DEA, les autorités ont fait main basse sur environ 70 millions de dollars liés au trafic de drogue à Atlanta en 2008 et davantage l’année suivante, surpassant toutes les autres grandes métropoles du pays. « Dans le comté de Gwinnett, les trafiquants de drogue peuvent se fondre dans le décor », explique à l’époque le procureur local Danny Porter à CNN. « Nous devons mettre en place de nouvelles tactiques pour combattre la présence de ces organisations » – à savoir les cartels mexicains de Sinaloa et du Golfe. Ils remplissent le vide laissé par une autre organisation criminelle d’Atlanta, la Black Mafia Family (BMF), qui s’était lancée dans l’industrie du hip-hop pour couvrir ses activités illégales d’un paravent doré.
Lorsqu’il est arrêté en 2008, son fondateur, Demetrius « Big Meech » Flenory, est déjà une légende urbaine. Une autre légende est en marche tandis que The Polo Club fait ses premiers pas : Gucci Mane en est à son sixième album studio et définit le son trap, le beatmaker emblématique Zaytoven à ses côtés. Les trois ados ont des exemples pour guider leurs pas, du temps et l’envie de percer d’une manière ou d’une autre. Ils dealent le jour, jamment la nuit, et se débarrassent de leur premier blase en 2010 pour se rebaptiser Migos.
« On a grandi dans un quartier avec une grande communauté latino », explique Offset. « “Migos”, c’est le nom qu’on donne aux dealers du Northside », poursuit Quavo. Contraction d’amigos, le terme est employé au sein des réseaux hispaniques installés dans le comté de Gwinnett, « de la même façon qu’entre potes on s’appelle “nigga” ». Le trio aménage peu à peu le sous-sol en studio bricolé : ils téléchargent un logiciel de musique gratuit sur Yahoo et enregistrent leurs deux premières mixtapes avec de l’équipement acheté grâce à l’argent du deal.
Grâce au bouche-à-oreille, leur morceau « Bando » parvient aux oreilles de Zaytoven, qui voit immédiatement leur potentiel sur ce beat inspiré de ses propres compositions. « J’ai fini par tomber par hasard sur Quavo dans les loges VIP d’une émission de radio à laquelle je participais. Il m’a marché sur le pied », raconte-t-il en riant. « Quand j’ai levé les yeux pour voir qui c’était, j’ai reconnu le jeune rappeur de la vidéo. Je lui ai dit que je les cherchais et il m’a répondu qu’eux aussi ! Dès qu’ils demandaient à quelqu’un de leur faire un beat, ils disaient qu’ils voulaient que ça sonne “comme du Zaytoven”. »
Le lendemain, le groupe est invité à enregistrer chez Zay, qui les branche par la suite avec deux poids lourds du milieu : Pierre « Pee » Thomas, le fondateur de Quality Control Music et Kevin « Coach K » Lee, l’ancien manager de Gucci Mane et Young Jeezy.
« Je n’avais jamais entendu un style pareil », se rappelle Pee. Mais ce qui a véritablement décidé Coach K à signer le trio, c’est que les hipsters d’ATL les adulaient déjà, comme il l’a confié à Noisey. « J’ai demandé à ces types : “Vous connaissez Migos ?” Et ils m’ont répondu : “Grave ! ‘Bando’ !” Quand j’ai entendu ces mecs qui veulent toujours être les premiers à écouter le truc le plus frais me dire ça, je les ai signés immédiatement. » Commence alors l’enregistrement de la mixtape qui les fait décoller, Y.R.N. (Young Rich Niggas). Elle sort en juin 2013 sur Quality Control et contient le single « Versace ».
« C’était trois fois rien », se souvient Zaytoven quand on l’interroge sur la naissance du morceau. « Je l’ai composé en pleine journée, parmi d’autres. Quand je l’ai envoyé à Migos, ça a fonctionné – leur flow a changé l’histoire du rap », affirme-t-il. À tel point que Drake insiste pour le remixer à la première écoute, imitant le flow en triplets caractéristique du groupe.
Quand le rappeur n°1 mondial leur fait l’honneur de poser sur leur morceau, leur adressant un big-up au passage, Quavo, Takeoff et Zaytoven sont fous de joie. Offset, pour sa part, n’a pas l’occasion d’écouter le résultat. Au moment où la version de Drake apparaît sur la Toile, il est en prison.
Shooters
Le 9 avril 2013, pendant que Quavo et Takeoff boivent du champagne avec des mannequins dans une villa californienne, Kiari Cephus (alias Offset) n’est pas de la partie. Depuis le mois de février, il est incarcéré à la prison du comté de Dekalb, en périphérie d’Atlanta. En octobre 2011, alors âgé de 20 ans, Kiari est arrêté pour vol de voiture et condamné à deux ans de sursis avec mise à l’épreuve. C’est pour avoir violé cette condition qu’il est placé en détention. Il est libéré le mardi 15 octobre 2013, aux environs de 15 heures.
Après une profonde inspiration, Kiari tourne le dos aux bâtiments gris de la prison et remonte l’allée jusqu’à la voiture qui l’attend. À l’intérieur, Coach K et ses deux complices l’accueillent chaleureusement. « Bon, qu’est-ce qu’on fait ? Tu veux faire un tour au mall ? » lui demande le manager en lui tendant une liasse de billets en guise de bienvenue. Kiari secoue la tête. « Nan, je veux aller au studio. »
Sur le trajet, Quavo et Takeoff le briefent : ils lui racontent à nouveau Drake, la sortie du clip il y a quinze jours et le succès phénoménal qu’ils rencontrent. Mais Quavo leur demande de garder la tête froide. « Une chose après l’autre », professe-t-il. « On ne peut pas se satisfaire de ça. On est monté sur le ring, maintenant on redescend et on se remet au travail pour le prochain match. » Les autres acquiescent. Ils prévoient déjà d’enregistrer la suite de YRN. Mais se tenir loin des ennuis n’est pas au programme pour Migos, dont le parcours est semé d’éclats de violence.
En mars 2014, alors que le trio est dans un van sur l’autoroute 95 après un concert à Miami, ils échangent des coups de feu avec des assaillants se trouvant à bord d’un autre véhicule. Un de leurs fans est blessé, les tireurs disparaissent. Trois mois plus tard, dans la nuit du 11 juin, un nouveau drame survient après un concert du groupe, dans leur comté natal. À l’extérieur d’un motel où Quavo, Takeoff et Offset font la fête avec leurs potes et leurs fans, deux hommes font irruption armés de pistolets. Ils tirent sans sommation, visant Migos d’après les témoignages.
Aucun membre du groupe n’est touché, mais un spectateur innocent du nom de Paris Brown est tué. Les tireurs prennent la fuite, la scène ne dure que quelques secondes. Plus tard, la police localisera l’un des deux tireurs présumés, qui se donnera la mort au cours de son affrontement avec les forces de l’ordre. Cette tragédie aurait été causée par la rivalité entre Migos et un autre groupe local, 2G. Par la suite, le trio ne se déplace plus sans un service de sécurité armé – assuré notamment par leur compère rappeur Skippa Da Flippa, avec qui ils ont inventé le dab.
~
Cette protection rapprochée leur vaut de nouveaux ennuis un an plus tard, le 18 avril 2015. Ce soir-là, Migos donne un concert à l’université de Géorgie du Sud, à Statesboro. Le show a débuté depuis un quart d’heure quand un manager sort des coulisses et demande au DJ de couper la musique. Pendant qu’ils étaient sur scène, des policiers ont fouillé les véhicules du groupe et de leur équipe (une quinzaine de personnes en tout). Ils ont découvert à bord de la drogue et des armes en quantité. Or, aux yeux de la loi géorgienne, détenir une arme chargée sur le site d’une école est un délit grave. Les jeux sont faits et tout le monde est conduit au poste.
Quavo, Takeoff et les autres passent deux nuits en détention avant d’être libérés sous caution. Kiari ayant déjà été condamné par le passé, il est directement envoyé prison. Coach K contacte alors Charles Mittelstadt, un enquêteur privé au service de la défense, qui rouvre les affaires dans l’espoir de déterrer des vérités qui n’ont pas encore été exposées. Ancien expert en sécurité, Mittelstadt est à la croisée du privé et de l’avocat, et sa clientèle compte de nombreux rappeurs, parmi lesquels Gucci Mane, T.I. et Rick Ross. Il se rappelle clairement de l’affaire.
« Les policiers qui ont procédé à leur arrestation faisaient partie de l’unité de lutte anti-criminalité du bureau du shérif de Statesboro », explique-t-il. « Ils ont raconté qu’une “odeur de cannabis” les avaient décidés à procéder à la fouille des véhicules du groupe. » Mais Mittelstadt affirme que les autorités ne disposaient pas de mandat pour inspecter ces véhicules, et qu’il est « plutôt inhabituel » de placer en détention plus d’une dizaine de personnes sans mener d’enquête pour déterminer à quels individus appartiennent la drogue et les armes en question. « Les policiers ont sciemment choisi de ne pas le faire », dit-il.

Charles Mittelstadt et Offset à sa sortie de prison
Crédits : Charles Mittelstadt
Si son intervention a permis de faire sortir rapidement 12 des 13 personnes arrêtées, Kiari a dû se résoudre à retourner derrière les barreaux. Pour limiter la casse et espérer sortir avant 2016, il a fallu qu’il accepte de reconnaître en partie sa culpabilité. « Il a reconnu s’être trouvé sur les lieux. Ça a suffi au juge, qui avait juste besoin d’un coupable », se désole Charles Mittelstadt. Moins d’un mois après sa mise en détention à la prison du comté de Bulloch, Kiari est accusé d’agression sur un autre détenu et du déclenchement d’une émeute. Plusieurs médias rapportent qu’il aurait asséné des coups de pieds à la tête du plaignant, mais son défenseur donne une toute autre version des faits.
« On voit clairement sur les bandes des vidéos de surveillance qu’aucune émeute n’éclate », met-il au clair. « Ce qu’il se passe, c’est que cet autre détenu crie quelque chose à Kiari depuis sa cellule, qui le met en colère. » D’après le récit de Mittelstadt, le rappeur se lève d’un bond et se dirige vers la cellule du détenu. « On ne voit pas ce qu’il se passe dans la cellule, mais Kiari n’y reste que quelques secondes avant d’en sortir. C’est tout. » Quoi qu’il se soit réellement passé à l’intérieur, Kiari Cephus passe 233 jours à l’ombre avant d’être libéré de prison. Ce laps de temps nuit sévèrement au groupe, à l’extérieur.
Privés d’Offset, le duo ne peut enregistrer de nouveaux morceaux ou d’album en tant que Migos, et les salles de concert rechignent à programmer les deux tiers du trio. Lorsqu’elles le font, la paye est considérablement revue à la baisse. Enfin, le 4 décembre 2016, Kiari retrouve une seconde fois la liberté. Cette fois, il est convaincu qu’il n’y retournera pas. Il compare sa mésaventure au récit biblique de Salomon. « C’était un roi qui avait tout, et il a tout perdu… mais il avait encore la foi », a-t-il confié d’un regard pénétré aux caméras à sa sortie de prison. « Et Dieu l’a béni en lui accordant dix fois plus de richesses. En prison, comme Salomon, je me suis tourné vers les Saintes Écritures. »
Une chose est certaine, c’est qu’après cette épreuve, Migos allait connaître une gloire sans précédent.
C U L T U R E
Au soir du 8 janvier 2017, en direct sur NBC, Donald Glover est récompensé par deux Golden Globes pour sa série Atlanta. Sacré meilleur acteur et auteur de la meilleure série musicale ou comique, il monte sur scène à deux reprises pour prononcer quelques tirades de remerciements émus. Acteur, auteur principal et producteur du show, Donald Glover était jusqu’ici plus réputé pour sa carrière de rappeur, chanteur et compositeur, sous le nom de Childish Gambino.
Originaire de Géorgie, il ne fait pas de mystère sur son amour du Dirty South et de la trap. Dans le troisième épisode d’Atlanta, qui ne compte pour l’instant qu’une saison, Migos fait une apparition remarquée. Ils y incarnent un trio de trafiquants de drogue terrifiants, tout droit sorti de leur lyrics. Le soir de la cérémonie, Glover ne les oublie pas dans son discours.
« Je tiens vraiment à remercier Migos – pas parce qu’ils jouent dans la série, mais pour avoir fait “Bad and Boujee”. C’est le meilleur morceau de tous les temps », dit-il avec le plus grand sérieux. Lors de la conférence de presse qui suit, une journaliste l’interroge sur cette déclaration, qui a fait se lever quelques sourcils dans l’assistance.
« Parce que je pense qu’ils sont les Beatles de cette génération et qu’on ne les respecte pas assez », réplique-t-il avec un grand sourire. « Et honnêtement ce morceau est juste incroyable… il n’y a pas de meilleure chanson pour baiser. » Rires dans l’assistance.
« Ce que pense les gens nous importe », dit Offset. « C’est ce que ça m’a fait quand j’ai entendu Donald Glover dire ça. On l’aime pour ce qu’il a dit. Pour avoir été sincère. » Le public américain, lui, ne s’y est pas trompé : le lendemain après-midi, « Bad and Boujee » passe en tête du classement Billboard. Le morceau détrône un autre hit venu d’Atlanta, « Black Beatles », de Rae Sremmurd, produit par Mike WiLL Made-it et featuring Gucci Mane. Mais si ce tube fait des concessions mélodiques évidentes à la pop mainstream (une constante avec Mike Will, qui a aussi signé « Formation » de Beyoncé), le succès fulgurant de « Bad and Boujee » surprend tant le morceau est peu accrocheur en apparence. Sur une production éthérée de Metro Boomin, sans hook appuyé, le trio égrène ses lyrics avec une relative monotonie. « On a réussi en mode trap, pas en mode pop », se gargarise Quavo.
Le clip du morceau, sorti le 31 octobre dernier, totalise plus de 200 millions de vues sur YouTube. Dix fois plus que pour « Versace ». Un braquage réussi. « J’ai rencontré les Migos pour la première fois en mai 2016 », raconte Dapo « Daps » Fagbenle, le réalisateur du clip. « On tournait la vidéo de “Bad Intentions”, le morceau de Niykee Heaton sur lequel ils sont en featuring. » Le tournage a lieu à Los Angeles, où vit Daps, qui a également co-signé les images de « King Kunta » pour Kendrick Lamar.
Entre deux prises, le trio lui dit qu’ils devraient travailler ensemble. Il accepte sans trop y croire, persuadé qu’il s’agit de paroles en l’air, comme c’est souvent le cas à Hollywood. Mais le mois suivant, tandis que le groupe est en Europe pour une série de concerts et que Daps est de passage à Londres, Coach K le contacte pour qu’il réalise les clips qui accompagneront le prochain album du groupe. Après une première collaboration réussie sur « Cocoon » dans un manoir de la capitale anglaise, ils réitèrent l’expérience sur « Bad and Boujee ».
Tandis que les clips de « Deadz » et « What The Price » paraîtront bientôt (Daps a filmé les deux durant la première semaine de février), leur travail le plus significatif est le clip de « T-Shirt », posté sur YouTube le 6 janvier dernier. « Quand ils m’ont demandé de faire “T-Shirt”, Quavo avait une petite idée de ce qu’il voulait », raconte Daps. « Il avait envie de quelque chose de glacé et d’old school. Il voulait porter des fourrures. »

Crédits : Migos/Daps/YouTube
Des images de The Revenant lui sont venues en tête et Daps a eu l’idée de tourner en pleine nature, dans un paysage enneigé. Il a commencé à songer à des endroits comme l’Alaska. Après quelques recherches sur Google, il est tombé par hasard sur Lake Tahoe, le plus grand lac alpin d’Amérique du Nord, situé à cheval entre la Californie et le Nevada. Plus tard ce jour-là, en tournage, il a reçu ce qu’il interprète comme un signe du destin.
« Une fille est venue me parler, sortie de nulle part. Quand je lui ai demandé d’où elle venait, elle m’a répondu “Lake Tahoe”. » Après qu’il lui a raconté son histoire, elle a proposé de le mettre en contact avec sa famille là-bas. En décembre 2016, Daps a fait le voyage depuis Los Angeles jusqu’à Lake Tahoe, et Migos d’Atlanta. Un jour de tournage sous des températures glaciales a suffi pour mettre les images en boîte. « C’est un clip très méta », commente son auteur.
L’idée de base sonne comme une blague : des artistes de trap incarnant des trappeurs, qui marchandent des peaux comme ils dealeraient de la drogue. Mais à bien y réfléchir, c’est un écho puissant du propos qui se dégage de l’album. La culture de Migos est par essence américaine. Leur succès et la viralité de leurs gimmicks et de leur gestuelle en ont fait le nouveau mètre-étalon de la pop culture.
« Je pense qu’ils [Migos] sont les Beatles de cette génération », avait déclaré Childish Gambino lors d’un discours aux Golden Globe Awards en 2017. Migos a atteint les sommets mais peine depuis à revenir au top. Leur musique a été peu à peu éclipsée par l’ambition de ses membres de poursuivre des opportunités en dehors de la musique. Offset est également devenu un spectacle pour les tabloïds nationaux dû à sa relation avec Cardi B, et l’ancienne romance de Quavo avec l’artiste Saweetie a également été un sujet chaud sur les réseaux.
Le mois dernier, Takeoff et Quavo avaient même évoqué la possibilité de poursuivre leur carrière sans Offset. « J’ai juste l’impression que nous voulons voir notre carrière en tant que duo, tu vois ce que je veux dire ? ». A déclaré Quavo au micro du podcast « Big Facts » le 4 octobre dernier. Avec le décès de Takeoff, c’est donc l’existence même du groupe qui est remise en question. Un aspect qui semble bien secondaire par rapport à la tragédie. Rest in peace Takeoff.
Couverture : Migos (Takeoff, Quavo et Offset).
L’article Comment Migos a marqué la pop culture est apparu en premier sur Ulyces.
10.10.2022 à 00:00
Une soirée avec Prince Waly au début de sa carrière
Nicolas Prouillac
On trace la route sur le booster noir d’Ilyes, sillonnant entre les voitures sous les rayons obliques du soleil couchant, qui étire les ombres et coiffe d’or les silhouettes des passants. Les vapeurs d’essence et l’air du soir nous giflent le visage ; direction Montreuil. Dans ma tête tournent en boucle les premières mesures de « Lost […]
L’article Une soirée avec Prince Waly au début de sa carrière est apparu en premier sur Ulyces.
Texte intégral (8255 mots)
On trace la route sur le booster noir d’Ilyes, sillonnant entre les voitures sous les rayons obliques du soleil couchant, qui étire les ombres et coiffe d’or les silhouettes des passants. Les vapeurs d’essence et l’air du soir nous giflent le visage ; direction Montreuil. Dans ma tête tournent en boucle les premières mesures de « Lost in Thought », qui me ramènent plus d’une décennie en arrière. J’ai quinze piges et je découvre dans la collection de disques d’un aîné l’album-phare de Funkdoobiest.
Douze ans plus tard, les deux rappeurs de Big Budha Cheez raniment la mélodie, gardée intacte dans les replis de ma mémoire, au détour d’une interview glanée sur la Toile. Quelques jours plus tôt, Ilyes me faisait découvrir les MC’s montreuillois à travers le clip de « M.City Citizen », escapade visuelle et sonore tout droit venue des années 1990, distillant ses références avec générosité et sens du détail. Rendez-vous était pris quelques heures plus tard, et nous voici à présent à deux rues de leur QG. Rapide détour par l’épicerie du coin. Pack de douze embarqué ; direction l’Albatros.
Nous y retrouvons Clifto Cream, le réalisateur des clips du duo, qui nous invite à le suivre jusqu’à leur local. Dans la cour, table et barbecue semblent imprégnés du souvenir d’innombrables veillées. Clifto nous ouvre les portes de son fief. Dans la pièce enfumée, où s’entassent en désordre matos et bibelots en tous genres, Fiasko Proximo nous accueille. « Prince » Waly, l’autre MC du groupe, ne tarde pas à nous rejoindre, le temps de faire la route depuis son taf jusqu’au refuge. Tous trois se réjouissent de voir qu’Ilyes shoote en argentique et non au reflex numérique, qui cadre mal avec l’univers granuleux de Big Budha Cheez. Clifto nous montre dans la foulée le caméscope VHS Panasonic dont il s’est servi pour filmer « M.City », puis nous sortons nous attabler.
Décapsuleur, cendrier, enregistreur enclenché.
À l’ancienne
Comment le groupe est né ?
« Prince » Waly : C’était au collège. On était potes avec Fiasko et on partageait les mêmes centres d’intérêts. Je connaissais déjà Lunatic et tout ça, mais Fiasko m’a fait découvrir X-Men et ça a percuté. On s’est mis à faire du son, à écrire des textes, et comme tout le monde au début ce n’était pas vraiment sérieux. Et puis on s’est perdu de vue un moment, on s’est retrouvé et depuis on taffe les trucs ensemble.
Vous avez grandi à Montreuil tous les trois ?
Waly : Ouais, à Montreuil.
« Le premier projet qu’on a sorti, on a passé tout l’été à le faire. » — Fiasko Proximo
Fiasko Proximo : Enfin moi j’étais dans le XXe plus jeune, quand on est venu à Montreuil je devais avoir neuf ou dix ans. Je faisais déjà un peu de son avant de rencontrer Waly. Après, comme on était grave potes au collège, on s’est dit que ce serait cool qu’on monte un truc. Et puis comme il a dit, on s’est perdu de vue. Lui est parti dans un autre lycée, moi aussi. Le groupe s’est vraiment créé peut-être un an ou deux ans plus tard. Clifto Cream : Et le collectif Exepoq est né à partir du moment où on a pris un local ici, à l’Albatros. C’était pas là, c’était un peu plus loin là-haut. On était tous potes mais on faisait tous nos trucs dans notre coin, dans nos arts différent – parce qu’il y a aussi un photographe dans le collectif. À un moment donné, on s’est réuni et on s’est dit qu’il fallait faire quelque chose tous ensemble. Fiasko : Mais les mecs qui ont lancé l’idée, c’est Clif’ et Spootnik. Clif’, qui était déjà dans l’image, et Spoot’, qui faisait du son. Waly et moi quand on était plus petits, on enregistrait déjà chez Spoot’, mais dans sa chambre, à la Cité de l’Espoir.
Et l’Albatros, c’est quoi exactement ?
Waly : C’est un atelier d’artistes. Clifto : Le but, c’est de rassembler des gens qui font un tas de choses différentes, et de bosser ensemble. T’as des mecs qui font du théâtre, beaucoup de studios – qui sont tous assez différents les uns des autres –, pas mal d’expos, des peintres… Waly : Et même de la poterie. Clifto : Quand on est arrivé ici, on était un peu les seuls jeunes. On descendait des quartiers qu’il fallait pas approcher, en quelque sorte, on était un peu dans notre coin. Et puis on a changé de local pour celui dans lequel on se trouve actuellement. On a commencé à rencontrer les anciens, parce qu’ici il y a pas mal de gens qui sont là et qui exercent dans leur art depuis très longtemps. Après, d’autres locataires sont arrivés : il y a eu GVS – Grande Ville Studio, dont fait partie Jazzy Bazz –, Dixon est là aussi… ça fait des connexions et c’est un lieu où tu peux t’enfermer pendant un mois sans sortir. Fiasko : On l’a fait. (Ils rient.) Le premier projet qu’on a sorti, en CD, on a passé tout l’été à le faire. On faisait 16h-3h du matin, on allait dormir, on achetait des chips et du coca à côté et on revenait là. Mais c’était là-haut dans notre précédent local. Waly : Et là-haut il faisait super chaud, le soleil tape bien sur la fenêtre. Fiasko : Ouais, il faisait 40° à l’ombre. Ça, c’était en 2010. Et comme a dit Clif’, ce lieu a vraiment un truc qui fait que tu peux ne pas en sortir pendant super longtemps. Aujourd’hui, on le fait plus, mais on l’a fait longtemps. Waly : C’est notre résidence secondaire. (Ils rient.) Clifto : J’ai pris le local à la base pour pouvoir bricoler et peindre ailleurs que chez moi, parce que ma mère n’en pouvait plus ! J’ai pris un petit truc et au final j’ai ramené tous mes potes, donc on se posait et c’est devenu après notre studio, notre QG. C’était vraiment petit, ça faisait le tiers de celui-ci et on était dix dedans. Fiasko : Voire plus certains soirs, dix c’était le minimum. Clifto : Ouais, c’était violent.
Vous êtes arrivés comment dans le rap ?

Un plan du clip de « Budha Cheez » a été tourné ici
Crédits : Ilyes Griyeb
Waly : Moi par mes grands frères. Depuis tout petit – je devais avoir huit ans. Dès que j’ai pu vraiment comprendre ce que ça racontait, quoi. Mes grands-frères baignaient dedans, ma grande sœur aussi. Mon grand-frère écoutait Lunatic. Je me rappelle du premier son de Lunatic, c’était « La Lettre ». J’étais petit, mais je me rappelle d’une phrase qui m’a marqué, quand Booba fait : « Quand je sors, ramène-moi une petite pute, bête, sans but / Je la ferai crier du bout de ma longue bite. » (Les deux autres éclatent de rire.) Et cette phrase, encore aujourd’hui, elle me tue ! Fiasko : Quand tu écoutes un bon son qui te marque, tu te dis automatiquement : « Ah ouais, eux ils sont trop chauds, il faut que je fasse la même chose, voire mieux. » Franchement, si j’étais tombé sur un son de rock chaud, aujourd’hui je serais rockeur. Mais bon, ça n’a pas été le cas. Maintenant – du moins avec Waly parce que Clif’ est plus vieux –, on était petits dans les années 1990. Donc ça nous a plus marqués que ceux qui aujourd’hui ont trente ou quarante ans, qui par exemple écoutaient Pink Floyd quand ils étaient gosses, et qui ont été marqués par ça. Du coup, on a commencé à écrire nos premiers textes… et après, le jour où les gens te disent : « Ah ouais, mais en fait c’est pas mal ce que tu fais », tu te dis que tu peux faire les choses sérieusement.
Quels sont les groupes qui ont fait naître cette envie ?
Clifto : Je crois que le groupe qui nous réunit à cette table, en tout cas artistiquement, c’est les X-Men. Même pour moi dans l’image, ça a toujours été une référence. Waly : Et côté américain, moi c’est plus le côté new-yorkais. Le côté sombre de Mobb Deep. En venant ici, j’écoutais ça. Même si on nous dit souvent que ça ne se ressent pas dans nos sons. Peut-être dans les instrus, mais dans les textes beaucoup moins. Donc tout ce qui est Mobb Deep, Sam Sneed… Fiasko : Si je ne devais en citer qu’un, ce serait le Wu-Tang. Pour moi, c’est le groupe précurseur. Après, comme dit Waly, Mobb Deep c’est du putain de lourd. On se retrouve plus dans ce qu’ils font parce qu’ils sont deux, comme nous. Mais niveau français, c’est sans aucun doute les X-Men. Time Bomb, La Cliqua… tout ce qu’on a vraiment rôdé en fait. Waly : Ils écrivent des textes où déjà, mine de rien, il y a pas mal d’humour ; c’est important. Et puis c’est plein de références culturelles assez pointues. Après bien sûr, on vit avec notre temps, on s’adapte. Moi, j’écoute aussi un petit peu plus 50 Cent, The Game… Deux hommes font irruption dans la cour, bouteille à la main et sourire aux lèvres, intrigués par notre présence. On échange des poignées de main. Clifto : Dixon, c’est une des personnes qui a un studio ici. C’est celui qui a mixé le son de « M.City Citizen » ! Dixon Mandrake ! Dixon : On veut pas vous déranger.
Pas de souci.
Dixon : J’ai vu Moussa par la fenêtre… Waly : T’inquiète, je vais venir te voir après. Dixon et son compère s’éloignent et sont bientôt rejoints par Ilyes, qui converse un moment avec eux avant de les prendre en photo.
D’où viennent vos blases et le nom du groupe ?
Waly : Alors ça, ça a été une galère. Parce qu’au début, ce n’était pas du tout Big Budha Cheez. Le premier, c’était Recto Verso. On a cherché plein de noms. Et moi j’ai eu un tas de blases. J’ai dû en avoir une dizaine. Fiasko : Moi, j’ai toujours été Fiasko Proximo, ça n’a jamais changé. Proximo ça vient de Gladiator. Et comme j’ai toujours kiffé les noms composés, je trouvais que « Fiasko » sonnait bien avec « Proximo ». C’est pas compliqué, c’est vraiment tout pourri, il n’y a pas de signification personnelle. (On éclate tous de rire.) Recto Verso, c’est le premier nom qu’on a eu tous les deux. Mais après, avec Ma Routine roule à M.City, notre premier EP, on a voulu changer car nous aussi nous avions changé. Le temps qu’on avait fait avec Recto Verso était révolu. Et puis on en est venu à Big Budha Cheez parce que… Waly : C’était surtout un jeu de mot, tu te rappelles ? Fiasko : Ouais, c’était le jeu de mot avec les bouddhas, on aime bien cette influence un peu spirituelle, asiatique.
Et c’est un nom de weed.
Waly : (Ils rient.) Voilà, c’est un nom de weed aussi. Mais ça, c’est vraiment un hasard parce que nous trois, on ne fume pas. L’afflux des souvenirs révèle peu à peu la complicité qui lie le groupe. Leur simplicité et le plaisir qu’ils prennent à évoquer le passé devant un étranger sont communicatifs. L’air se rafraîchit à mesure que le jour décline.
Pourquoi ce son très typé années 1990 ?
Clifto : Ce qui est marrant en fait… enfin je laisserai les autres préciser pour le son, mais en règle générale, quand on fait un truc, on ne cherche pas obligatoirement à faire « un truc qui sonne années 1990 ». On a commencé par le bricolage. On s’est vraiment basé sur de la matière, au début. De la pellicule pour l’image, de la bande pour le son ; ce qui nous permettait de bricoler, de faire nos trucs à nous, avec un vrai grain, sachant qu’on n’avait pas de moyens. Et en fait après, c’est devenu une identité forte. Mais ça n’a jamais été une réflexion qu’on s’est faite. Waly : Exactement, ce n’est pas calculé, ça nous vient naturellement. Dans la vidéo comme pour le son. On compose – Fiasko fait les instrus quand on écrit les textes – et ça sort naturellement. Quand on pose, ça donne ça. Par exemple, avec mon gars Myth Syzer, on a bossé sur un son qui sonne assez nouvelle génération.

Clifto Cream et sa caméra Super 8
Crédits : Ilyes Griyeb
Fiasko : En fait le truc, c’est qu’on a une identité forte c’est vrai, mais entre nous. Si demain l’un de nous va faire quelque chose avec quelqu’un d’autre, l’identité change. C’est un mélange, comme avec « Clean Shoes ». Et moi si demain j’allais faire un son avec un autre mec qui n’est pas de notre collectif, ce serait pareil. Ce qu’il faut comprendre, c’est que notre identité s’est aussi construite avec le manque d’argent. Le truc, c’est que nous quand on pose sur bande ou quand on filme en VHS, le coût n’est pas le même, parce qu’on n’avait pas de moyens au début. Au lieu d’aller se taper des studios à 800 ou 1200 euros la journée, on avait une bande, une table de mixage et on savait que notre son allait être fait comme ça. On avait un micro, on posait. One shot, on recommençait pas trente fois. Et Clif’ c’était pareil, la VHS pour « M.City Citizen », c’est une question de prix, parce qu’on n’avait pas les moyens de se mettre une Red – même si on n’en voulait pas, mais on n’avait pas les moyens. Je suis frappé par l’utilisation du terme « Red ». Il désigne un célèbre fabriquant de caméras numériques dont les produits sont très prisés par l’industrie hollywoodienne et ne connaissent pas de déclinaisons grand public.
Vous n’avez pas été tentés par le home studio numérique, comme beaucoup ?
Clifto : Non, parce qu’en fait, on a commencé à une époque où ça avait été déjà fait. Maintenant, quand tu veux créer un studio, c’est un peu chacun pour sa gueule avec les moyens du bord. Nous, on s’est placé sur une méthode de travail vraiment à l’ancienne, avec du matériel qu’on récupérait à droite à gauche. On avait la volonté de récupérer un patrimoine. Mais du coup, c’est aussi un compromis sur les moyens, sur l’époque, sur l’endroit… C’est la conjonction de tout ça. Je pense qu’on ne s’est jamais dit les choses consciemment… la seule fois où c’est arrivé, c’est quand on a eu des retours de gens sur notre travail, comme là avec toi. C’est un mélange entre les moyens du bord, nos inspirations, et puis le fait de partir de zéro, comme à une certaine époque où les gens partaient vraiment de zéro. Fiasko : Et puis il y a un truc qu’il ne faut pas oublier, c’est que le fait qu’on marche comme ça apporte plein de trucs qu’on ne retrouve plus aujourd’hui. Par exemple dans le son, le fait d’enregistrer à bandes fait que quand on enregistre un son, on ne le fait pas quatre fois. On prend le truc sur le moment, c’est du one shot, on ne fait pas de drop. On sait quand se placer avec nos souffles, donc sur scène on assume nos textes. Y a pas 36 000 solutions. Ça nous a apporté plein de choses de ce genre. C’était pareil en vidéo, on ne recommençait pas quinze fois parce que même si c’est moins cher que le numérique, ça coûte un billet quand même.
Il y a peu de rappeurs qui n’utilisent pas le drop aujourd’hui.
Fiasko : Le truc, c’est que le drop est venu vachement avec le numérique. Quand ils ont eu les moyens de le faire, le fait de ne pas perdre du souffle, de pouvoir enchaîner super vite et tout… après, il y a des mecs comme Busta Rhymes, qui eux à l’époque arrivaient à le faire naturellement parce qu’ils n’avaient pas le choix. Clifto : Ouais, des fois le côté pratique est un piège. Pour résumer, je pense qu’on ne réfléchit pas au fait d’être à l’ancienne ou pas, mais par contre c’est vrai qu’on s’est dit ça clairement : notre méthode de travail est basée sur ce qui se faisait à l’ancienne. C’est-à-dire faire avec ce qu’il y a sur le moment, sans passer par trop de réflexion, et faire les choses comme on les sent sur de la bande, sur de la pellicule, sur de la VHS, sur scène : sur quelque chose de palpable, tout le temps. Fiasko : On est arrivé à un moment où le phénomène « à l’ancienne » est ressorti d’un coup. Mais nous, ça fait longtemps qu’on fait ça, même avant son apparition. Aujourd’hui, il y a peut-être une vidéo de nous qui a plus tourné que les autres parce qu’elle est sortie à ce moment-là, mais on a toujours été comme ça. Faut pas croire qu’on surfe sur une vague, ce n’est pas ça du tout.
On sent une vraie sincérité chez vous effectivement, et en même temps quand on voit le clip de « M.City Citizen », c’est très travaillé. Esthétiquement d’une part, mais aussi dans le son. Comment vous avez construit ça ?
Waly : Au niveau du son, c’est vraiment la bande. Fiasko : Il y a un truc avec la bande que tu vas retrouver dans le rap à l’ancienne, mais pas seulement, parce qu’au début des années 1990, c’était déjà un truc qui disparaissait – on passait sur de la bande numérique, c’était encore autre chose. Nous, on enregistre vraiment sur de la bande analogique et c’est plus un truc que tu vas retrouver dans les influences rock ou soul des années 1970 ou 1980, c’est ce qu’on recherche. Le grain vient de là. Avec la bande, ce n’est que du signal analogique, ça ne sonne pas pareil. Aujourd’hui, quand tu fais un son sur ordi, tu poses ta voix et l’ingé va la nettoyer au max, pour pas que tu aies de crépitements, etc. Nous, c’est tout le contraire qu’on recherche. Y a un peu de souffle ? C’est parfait, hop, ça passe dedans, après on réduit un peu, ça fait augmenter les aigus, les graves sont plutôt stylés, et voilà. Et dans la vidéo, tu peux ressentir la même chose, c’est un peu les mêmes codes. Mais ce qu’on faisait au début, côté son, c’est qu’on prenait le micro, on mettait un préampli analogique et on enregistrait directement sur la bande. C’était vraiment très crade, parce que tu n’avais pas de filtre, tu n’avais pas de reverb, ça passait directement sur la bande. Waly : Sur le deuxième EP, avec DJ Med Fleed, on a fait Épouser un tas d’oseille et Kidnapper le président comme ça. Fiasko : Il n’y a pas eu d’ordi, ce n’était que de l’analogique. Après, moi j’ai une MPC 2000, ça me permet d’envoyer mes beats directement sur les bandes. Après le truc, c’est qu’aujourd’hui, si tu ne veux vraiment faire que de l’analogique, il faut gagner des millions. Parce que ça coûte très cher et que ça devient très rare. Donc on n’est pas débile non plus, on sait qu’on est en 2014 et qu’il faut qu’on avance avec notre temps. On utilise l’ordi, on n’a pas boycotté ça. Clifto : Et puis même au-delà du fait d’utiliser un ordi ou pas, la finalité aujourd’hui ça reste quand même Internet. C’est le support numérique ultime, donc on est obligé de numériser de toute façon, que ce soit la vidéo ou le son. Fiasko : Mais ça reste vraiment la dernière étape. Nous, à la limite, quand c’est distribué sur Internet, on n’est plus là. On est déjà sur d’autres trucs. Après, Marine, notre chargée de communication, ou Jo, notre manager, prennent le relais sur ces points-là. Pour la vidéo, c’est un peu la même chose, sauf que c’est Clif’ qui fait tout de A à Z… personnellement je suis un peu plus en retrait. Clif’ et Waly vont plus se mettre en relation à ce niveau-là. Clifto : En règle générale, on construit les clips à deux. Waly : À la base c’est vraiment Clif’, ensuite ça module avec moi. Si j’ai indubitablement affaire à des artistes, l’enthousiasme avec lequel Fiasko, Waly et Clifto me décrivent leurs méthodes de travail et les techniques employées me donne l’impression d’être face à des artisans. Fiers et maîtres de leur ouvrage à toutes les étapes de sa fabrication, ils observent néanmoins une distance respectable avec son exploitation – ce n’est pas leur travail.
La découverte de la VHS
Comment avez-vous réalisé le clip de « M.City Citizen » ?
Clifto : Alors en fait, on avait essuyé un échec… (Ils rient.) Parce qu’évidemment, quand tu te lances dans le Graal sacré de l’analogique, tu reçois des gros coups d’épée énervés. On avait tourné un clip en Super 8, qu’on a tout simplement raté. Fiasko : Les images étaient voilées. Clifto : On avait mis un petit investissement dedans, qui était super important pour nous à l’époque. C’était fait en Super 8, parce qu’à la base on voulait vraiment bosser l’image sur pellicule, direct. Et à ce moment-là, on ne savait pas comment travailler notre image, on avait un peu étudié le truc et c’était vraiment très compliqué. On a tourné un été, on a attendu quelques mois et c’est au moment de la numérisation chez le mec, dans le XIe arrondissement, qu’on a vu que c’était raté… C’est l’inconvénient de tout ce qui est argentique, tu as ton rendu après. Il faut savoir qu’on est vraiment autodidactes, on n’a jamais fait d’école ni rien. Donc on s’en est aperçu après et là, on s’est retrouvé en décembre 2012. Fiasko : Là on a réfléchi, on a vraiment posé le truc à plat et on s’est dit : « Merde, dans quoi on se lance ? » Je crois que c’est là qu’on a eu les plus gros doutes, parce que c’était vraiment ce qu’on voulait faire, mais comme disait Clifto, on a tout appris sur le tas…

Waly et Fiasko
Crédits : Ilyes Griyeb
Clifto : On était en plein questionnement et là, une réponse est tombée du ciel qui tient en trois lettres… la VHS. (Ils éclatent de rire.) Ça a été un bon compromis – qui d’après moi a été un peu trop utilisé aujourd’hui, parce que justement ça a vraiment participé au fait que des mecs veulent faire « un truc années 1990 ». Fiasko : Ce qu’au début on ne cherchait pas à faire du tout, car pour le dire très simplement, un mec qui voulait faire un clip en VHS, il lui suffisait d’aller sur Ebay et il en trouvait une à quinze euros. Nous, c’était vraiment parce qu’on n’avait pas les moyens de recommencer avec la pellicule. On savait que si on se refaisait niquer avec ça, c’était cuit pour nous. Et la VHS, comme a dit Clifto, on s’est dit que c’était mortel : un truc qui nous coûterait peu d’argent et avec lequel en même temps on pourrait s’éclater. Mais au début, la vérité c’est que j’y connaissais pas grand chose… Clifto : Bah en fait, même moi. La première fois que j’ai utilisé la VHS officiellement, c’était pour un teaser qu’on avait fait et ça nous a vraiment plu. Après, j’ai fait un clip pour Jazzy Bazz en VHS et ça a confirmé que c’était possible. C’était assez compliqué à utiliser, mais ça faisait aussi partie de l’intérêt du truc. Donc on l’a réutilisée pour « M.City Citizen », et là pour le coup on a vraiment exploité toutes les facettes de la VHS. Dans des coins, dehors, sur fond vert, avec de la lumière – parce que la lumière bave énormément sur la VHS, ça nous intéressait beaucoup… En fait, on a tout donné en VHS sur ce clip-là. Parce qu’à l’époque, on n’avait pas vraiment l’intention de continuer comme ça. On ne voulait faire qu’un truc en VHS, mais après c’est devenu le problème du compromis : ça a un côté pratique et t’as pas des sous tout de suite le mois d’après, donc tu réutilises. Fiasko : Mais si tu regardes bien, c’est le seul clip qu’on a fait en VHS avec Big Budha Cheez, et je sais pas si on en refera d’autres. « M.City Citizen » était en VHS, mais après on a fait « Budha Cheez » en pellicule 16 mm, et le dernier qu’on a sorti, « Itinéraire d’un G », c’est de la pellicule et du photomontage. On veut toujours évoluer. La nuit est tombée à présent et nos visages ne sont plus éclairés que par les flashs de l’appareil photo et la lampe à détecteur de mouvements, fixée au mur de parpaings nus qui borde la cour.
Donc vous avez tourné « M.City Citizen » en autodidactes. Pourtant, je le trouve particulièrement méticuleux, en termes de découpage, de cadrage, de lumière, de direction artistique et jusque dans vos attitudes…
Clifto : Bah en fait, mine de rien, c’est un travail qui s’étale sur plusieurs années, même si ça s’est fait assez naturellement.
Et pendant tout ce processus, de quoi vous êtes-vous inspirés ? Qu’est-ce qui vous a imprégnés ?
Fiasko : Miami Vice. Waly : Ouais, on regarde un tas de séries et un tas de films. Fiasko : Non, je rigole, c’était pas Miami Vice… Waly : Si, si, un petit peu. Fiasko : Franchement, je vais te dire la vérité, peut-être que tu trouves ça super précis, mais c’est vraiment le côté bandant de travailler avec de la pellicule ou d’enregistrer sur bande comme nous. Nous personnellement, on n’a rien calculé. Alors comme disait Clif’, c’est peut-être casse-couilles de ne pas avoir ton rendu tout de suite, mais c’est le truc qui fait que quand tu l’as, t’as des surprises de ouf ! Et nous c’était pareil dans le son : « M.City Citizen » ne devait pas du tout sonner comme ça à la base. Ce qui s’est passé, c’est que j’ai fait une prod’ que j’avais sortie en une piste, dont la basse était beaucoup trop forte, mais on avait déjà posé les voix. Avec Dixon, qui est là, on a complètement refait l’instru, de A à Z, et on a posé le nouveau rendu sur les voix. C’était le même BPM, rien n’avait changé, mais c’est devenu tout à fait autre chose. Après, on l’a clippé et tout… mais s’il y a un truc important à saisir, c’est qu’on laisse la place à la surprise. Waly : Après, on fait gaffe quand même, parce qu’avant ça on a quand même essuyé pas mal d’échecs. On avait fait deux-trois clips en pellicule, et dès qu’on recevait les images il y avait un souci. Du coup, on s’est dit que cette fois-ci on allait essayer de faire un truc carré, il y avait de l’organisation.
Comment l’avez-vous écrit ?
Clifto : On a fait un story-board. Waly : On écrit tout à l’avance, ensuite on découpe les parties et on les filme. C’est étalonné sur plusieurs journées. Fiasko : Eux deux, ils écrivent les trucs principaux et ensuite, tout ça, c’est un grand micmac de ce que tu veux faire. On savait qu’on voulait tourner dans une bagnole décapotable sur l’autoroute, ça c’était l’idée de Clif’. Waly : Il y a de la surprise mais rien n’est vraiment laissé au hasard. De la paire de lunettes jusqu’à la caisse, on sait ce qu’on veut. Clifto : Et dans tout ça, il y a une forte influence cinématographique de cette époque. Waly : Et des séries HBO. Clifto : Bah en fait, quand on a fait le clip de « M.City Citizen », on sortait d’une grosse période The Wire et Oz. On avait tous le cerveau bien imprégné. Ça c’est aussi un truc qui regroupe pas mal le collectif, des influences non seulement musicales mais aussi cinématographiques.
Vous avez tout découvert ensemble ?
Waly : Oz, c’est Fiasko qui me l’a faite découvrir. Fiasko : Je suis le premier à l’avoir vue, ensuite je l’ai passée à Waly. The Wire, c’est Clif’ qui me l’a montrée. Waly : Moi c’est mon grand-frère. Et il y a Sopranos aussi, évidemment… Et puis en ce moment il y a Game of Thrones. Fiasko : Ouais, bientôt on va faire un clip…
…avec des dragons ?
On éclate de rire. Clifto : Faut faire gaffe à ce que vous guettez les gars, niveau budget on est limité. Fiasko : Bientôt on va se regarder La Cage aux folles, on va être vert. (Nouveaux éclats de rire.)
En tout cas, ces références communes, ça crée un vrai univers, cohérent de bout en bout.
Waly : Ouais, c’est comme M.City par exemple. On sait pas si c’est Montreuil City ou si c’est vraiment M. City. Comme dans Oz, il y a une partie de la prison qui s’appelle Emerald City, mais qu’ils appellent Em City aussi. On a essayé de créer un monde.
Patience et persévérance
Ça m’a frappé en voyant vos clips, on a beau connaître Paris et Montreuil, on se croirait à L.A. ou New York à certains moments.
Clifto : Oui, parce que le grain donne un truc auquel on n’a pas été habitué en France. Bien sûr, je ne parle pas du cinéma. Mais on est habitué à des images trop propres, avec toutes les conneries qui passent à la télé, parce qu’on n’aime pas prendre de risques. Dès que tu passes ce cap, tu as l’impression d’être ailleurs. Après, je parle pour nous, on n’est pas les seuls à avoir un délire comme ça, mais les gens qui l’ont aussi ne font pas obligatoirement partie de notre culture musicale ou de notre milieu. Nous on vient de Montreuil, de quartiers populaires, et c’est vrai que les mecs hallucinent à chaque fois. Au début, quand on a commencé, ils comprenaient pas. « C’est quoi votre délire ? Pourquoi vous achetez pas un 5D ? » Et en fait, au final, une fois que tu imposes ton truc, ça se démocratise même dans ces milieux-là. Il y en a de plus en plus qui font ce qu’on fait, mais pas naturellement. Clifto met le doigt sur ce qui me fascine : ces trois-là ont grandi dans un quartier populaire et n’ont pas fait d’école pour apprendre ce qu’ils savent et faire ce qu’ils font. Pas à pas et à l’instinct, Clifto, Fiasko et Waly ont redécouvert par eux-mêmes et apprivoisé les règles de l’écriture cinématographique, de toutes les étapes de la confection d’un film et de l’enregistrement analogique, pour produire une œuvre qui leur ressemble.
Comment s’est passée la réception ?
Waly : Il y a eu beaucoup de bons retours, mais heureusement aussi des critiques. S’il n’y avait que du bon, ce ne serait pas normal. La réflexion qui revient souvent, c’est surtout : « On est en 2014, faut arrêter les mecs. »

Fiasko Proximo
Crédits : Ilyes Griyeb
Clifto : Mais la façon dont on a fait le clip et dont a été fait le morceau, c’est aussi une forme de discours ; c’est-à-dire qu’il faut s’attendre à une réponse. Et même quand elle est négative, elle peut être intéressante. Fiasko : Oui, il faut un débat. Il faut que les gens commencent à en discuter. Waly : Quand elle est argumentée, la critique est bonne à prendre, qu’elle soit bonne ou mauvaise. Mais je ne comprends pas ce « on est en 2014 ». Clifto : L’évolution, c’est un truc qui obsède les gens. Ils ne comprennent pas ce retour en arrière, pour eux on n’a pas respecté l’évolution. « Y a des mecs qui se sont faits chier à construire un 7D, pourquoi vous l’avez pas acheté ? » Fiasko : Ça c’était un message de Canon, ils nous ont envoyé un mail. (On éclate de rire.)
Vous avez d’abord sorti un EP trois titres, puis douze, tout cela disponible gratuitement sur Internet ; vous avez réalisé des clips, vous avez fait quelques concerts l’année dernière… mais vous ne vous sentez pas prêts à sortir un album.
Fiasko et Waly : Non, toujours pas.
Quelle est la différence entre ce que vous avez accompli jusqu’à présent et un album ?
Fiasko : L’album, ce n’est pas vraiment une question d’argent, de clips, ou de… Waly : Un peu, quand même. Fiasko : Bien sûr, si demain on sort un album, on le vendra. Mais pour ça, je pense qu’il faut pas mal de maturité. Les gens aujourd’hui sortent des CD comme ça, et la plupart passent à la trappe parce qu’ils se lancent dans un truc qui les bouffe, ça va trop vite pour eux. Nous, justement, ce n’est pas du tout ce qu’on a envie de faire. On veut se laisser le temps, on n’a pas de pression de production parce qu’on est totalement indépendants, et visuellement on ne fait que s’améliorer. Donc à partir du moment où on sortira un album, ce n’est pas qu’on sera au top parce qu’on peut toujours progresser, mais on aura atteint le moment d’une certitude. On n’est pas encore dans l’optique de se dire : « Demain, on s’enferme pendant quatre mois dans un studio. » Clifto : Il y a aussi une volonté, inconsciemment quand on discute – on n’en a jamais parlé, là je vais dire un truc… Fiasko : Tu prends un risque. Clifto me confiera plus tard que c’était sa première interview. À nouveau, je sens le plaisir qu’ils ont à parler de leur travail à un étranger qui s’y intéresse, comme un artisan d’ordinaire peu bavard saisit l’occasion pour exprimer la raison et la forme de son geste. Clifto : Le truc, c’est qu’il y a vraiment une volonté d’imposer le fait que ça reste un acte artistique, qu’importe la forme que ça prend. Que ce soit le live – car c’est quand même quand tu vois l’art en vrai que tu le ressens vraiment – ou tout ce dont on parlait tout à l’heure : le délire du physique, le délire du vrai. Que ce soit un maxi, un projet, un EP ou un véritable album, on veut pouvoir dire que ce qu’on fait est une œuvre avant tout. Fiasko : En fin de compte pour nous, ça n’a pas vraiment d’importance parce que notre but final, c’est de se retrouver sur une putain de scène et de faire kiffer les gens. Si on fait des trois titres ou des douze titres, c’est pour qu’on nous appelle et qu’on nous dise : « Vous voulez pas venir kicker ? » Notre priorité, c’est le live. Après c’est bête à dire, mais tout ce qu’on va faire en studio… ça nous pète pas les couilles, mais ce n’est pas là qu’on trouve le plus de kiff. Avant un concert, tu nous verrais… on est les mecs les plus heureux du monde ! On arrive, on est content. L’année dernière, on a fait une scène à Toulouse, c’était la première fois qu’on sortait d’Île-de-France, franchement c’était magnifique. Waly : Ouais, c’était top.
Vous bossez tous à côté ?
Waly : On bosse à côté, ouais. On n’en vit pas encore, un jour on espère.
Il y a des producteurs qui se sont intéressés à vous après les clips et la scène ?
Fiasko : Non, on n’a pas eu de prod’. Ce qu’il y a de bien, c’est que les gens comprennent qu’il y a un petit délire où on est inaccessible. Si les gens ne se sont pas présentés pour nous dire : « Je peux vous faire signer ça, ça et ça », c’est parce qu’ils savaient très bien qu’on aurait refusé. Donc il y a surtout des mecs qui se sont proposés de nous aider.

« Prince » Waly, après l’entretien
Crédits : Ilyes Griyeb
Clifto : Beaucoup d’artistes sont venus nous voir pour partager des choses. On a même un photographe dans le collectif qui lui-même a fait des trucs par rapport au projet. C’est lui qui a pris la photo de la pochette Budha Cheez / Med Fleed, et lui aussi bosse en argentique. Donc on a plus eu des retours d’artistes, des connexions. Fiasko : Après on a fait un feat. avec Jazzy Bazz. Et maintenant quand on arrive à des concerts, on voit qu’on a un peu de notoriété, et elle est plutôt bonne. Waly : C’est ça, c’est important aussi. Parce que faire un album, le vendre et que ça ne se vende pas, ça fait quand même un peu mal… Un EP, on peut te le faire en deux mois, un album ça demande plus de temps et d’investissement. Clifto : Pour faire un parallèle, le mec qui se sape, qui devient beau gosse et tout, il n’a pas envie d’aller direct dans une soirée discuter avec trente mille meufs pour s’apercevoir que ça ne marche pas, parce que pour lui c’est vraiment une consécration. Nous, on a bossé ça depuis longtemps, on attend d’acquérir une force, d’avoir quelque chose de solide à proposer – parce que l’idée d’un album, c’est vraiment d’être un projet commercial. Fiasko : Et puis on en est encore à un stade où on fait de la recherche, ce n’est pas encore ce qu’on veut. Tous les trucs qu’on a sortis, même les clips, c’est de la recherche. La preuve, c’est qu’on rate encore plein de choses.
Qu’est-ce que vous avez raté ?
Clifto : Au niveau des clips, ça n’a jamais été comme on le voulait à la base. Fiasko : Même « M.City Citizen ». Clifto : C’est le clip le plus proche de ce qu’on voulait. Fiasko : Ouais, alors que « Budha Cheez », quand on a reçu les rushs… (Les deux autres partent d’un rire amer.) Celui-là il a fait très très mal. Clifto : On a failli tous déménager dans un pays lointain. Fiasko : Ce qu’il faut savoir, c’est qu’on a fait un premier clip pour « Budha Cheez » entièrement en 16 mm, qui nous a coûté une blinde. Tout ça pour s’apercevoir quand on a reçu les rushs que c’était tout voilé, il n’y avait aucune image… Mais on a eu quand même des couilles parce que le truc c’est qu’après ce clip-là, on a refait un clip en 16 mm direct. Et là, on s’est dit qu’il fallait pas qu’on fasse la même erreur. Bon, c’était un peu mieux mais c’était pas encore ça. Déjà, on a eu des images. Mais tu vois, ce n’est pas encore abouti, c’est pour ça qu’on attend pour sortir un truc. Même du point de vue du son, on est tout le temps en recherche.
Du coup en ce moment vous travaillez sur quoi ?
Waly : On a un projet avec un gars à nous qui s’appelle Maleek Jays. C’est un mec qui a grandi aux États-Unis, à Washington je crois, et qui vit en France. On a un EP avec lui en préparation. Fiasko : Là, on est plus basés sur des feats qu’on devait faire avec des gens. Parce que pendant longtemps on a été focalisé sur nos trucs et on ne prenait pas les feats, on mettait un peu ça de côté. Mais vu qu’on est un peu dans une période creuse… Waly : Ça fait plaisir aussi, hein. Clifto : D’un côté, on bosse sur le collectif, on a vraiment ressoudé Exepoq ; et en même temps on bosse aussi avec d’autres gens parce qu’on a fait des rencontres. Mais bon, après on est ensemble quoi qu’il arrive. La vie fait que de toute façon on est ensemble. On habite presque tous dans la même rue. Fiasko : (Il ironise, à l’attention de Waly.) Enfin plus maintenant. À une certaine époque. Y en a qui ont réussi, qui ont percé. Y en a qui ont leur appart’ de 25 m², qui ont niqué tout le monde, qui ont pris les droits Sacem et qui se sont tirés avec. (Clifto est mort de rire.) Non, je rigole… Ah et puis un dernier truc, on n’en a pas parlé et on aurait dû le dire avant, c’est que dans « Budha Cheez », il y a moi et Waly, mais il y a quand même une autre personne importante, c’est Papa Lex, le chanteur. C’est ça aussi qui démarque le contenu, musicalement. Il a une culture de ouf et c’est un peu paradoxal, parce que lui a un peu plus de cinquante ans. Il faisait du rock, avant. On s’est trouvé et ça a été le déclic.
Et vous, vous avez quel âge ?
Fiasko : On a vingt-deux ans.

Big Budha Cheez
Crédits : Ilyes Griyeb
Couverture : Le QG du groupe à l’Albatros, par Ilyes Griyeb.
L’article Une soirée avec Prince Waly au début de sa carrière est apparu en premier sur Ulyces.
14.07.2022 à 00:00
L’odieux divorce de Donald et Ivana Trump
whodunit
Mar-a-Lago « Nous avons une vieille coutume ici à Mar-a-Lago », annonça Donald Trump lors d’un dîner dans son palais d’hiver de 118 pièces à Palm Beach. « Notre tradition consiste à faire un tour de table après dîner et à se présenter les uns aux autres. » Trump paraissait agité ce soir-là, pressé de voir le dîner […]
L’article L’odieux divorce de Donald et Ivana Trump est apparu en premier sur Ulyces.
Texte intégral (15648 mots)
Mar-a-Lago
« Nous avons une vieille coutume ici à Mar-a-Lago », annonça Donald Trump lors d’un dîner dans son palais d’hiver de 118 pièces à Palm Beach. « Notre tradition consiste à faire un tour de table après dîner et à se présenter les uns aux autres. » Trump paraissait agité ce soir-là, pressé de voir le dîner se terminer pour pouvoir aller se coucher. « Vieille habitude ? Il n’a la maison de madame Post que depuis quelques mois. Franchement ! Je rentre à la maison », murmura un habitant de Palm Beach à son amie. « Oh, reste », dit-elle. « Ça va être drôle. »
C’était au printemps 1986. Donald et Ivana Trump étaient assis chacun à une extrémité de leur longue table Sheraton, dans l’ancienne salle à manger de Marjorie Merriweather. Leur attitude était impériale, comme s’ils étaient un roi et une reine. Ils étaient alors au plus haut de leur réussite, au summum de leur gloire. Trump apparaissait dans les journaux télévisés, offrant ses services pour négocier avec les Russes. On disait qu’il allait peut-être se présenter aux élections présidentielles. Ivana avait eu tellement de publicité qu’elle offrait maintenant aux journalistes venus l’interviewer un dossier de presse avec des vidéos assurant sa promotion. Le prestige des Trump avait atteint une telle ampleur dans la ville sacrée de New York que tout semblait possible. Il faisait doux ce soir-là à Palm Beach ; Ivana portait une robe bustier. L’air transportait des effluves de laurier-rose et de bougainvillier, mêlées à la légère odeur d’humidité qui collait à la vieille maison.
À sa décharge, Trump n’avait pas tenté de donner dans le style classique de Palm Beach avec blazer bleu marine et pantalon en lin. Il portait souvent un costume à table et sa seule concession à la mode locale était d’arborer une cravate rose ou des chaussures pâles. Ivana servait toujours les plats préférés de son mari lors des dîners ; ce soir-là les invités eurent donc droit à du bœuf avec des pommes de terre. Le faux Tiepolo peint au plafond du temps de madame Post était resté dans la salle à manger, mais un immense saladier argenté trônait maintenant au centre de la table, rempli de fruits en plastique. Comme toujours avec les Trump, il s’agissait de business. C’était leur but commun, ce qui les liait.
Depuis quelques années, ils semblaient ne jamais partager la moindre intimité en public. Ils étaient devenus moins un mari et une femme que deux ambassadeurs de deux différents pays, ayant chacun leur agenda. Les Trump n’avaient acheté Mar-a-Lago que quelques mois auparavant mais ils étaient déjà devenus la curiosité de Palm Beach. En face de chez eux se trouvait le Bath and Tennis Club, « The B and T » comme l’appelaient les habitants du coin, et on disait que les Trump n’avaient pas encore été invités à s’y joindre.
« Foutaises ! Ils me baisent les pieds à Palm Beach », me disait Trump quatre ans plus tard. « Ces faux-culs ! Le club m’a contacté pour savoir s’ils pouvaient utiliser un morceau de ma plage pour étendre leur surface d’installation de cabanons ! J’ai dit : “Bien sûr !” Vous pensez qu’ils m’auraient dit non si j’avais demandé à être membre ? Je ne m’inscris pas à ce club parce qu’ils refusent les noirs et les juifs. » Comme si Mar-a-Lago et le yacht Princess des Trump étaient les propriétés de Gatsby le Magnifique, les invitations étaient très prisées. Les snobs locaux adoraient se délecter d’anecdotes sur les Trump. Mais là ! Embarrasser leurs invités en leur faisant prendre la parole, comme s’ils étaient à une convention de vente !
Quand ce fut au tour d’Ivana de se présenter, elle se leva prestement. « Je suis mariée au plus merveilleux des époux. Il est si généreux et intelligent. Nous avons tant de chance d’avoir cette vie. » Elle le fixa désespérément mais il ne dit rien en retour. Il semblait fatigué d’écouter les louanges sans fin d’Ivana et son attitude assujettie avait l’air de l’exaspérer. Peut-être avait-il envie de quelque chose d’excitant, d’une dispute. Peut-être aussi qu’il se lassait de ce jeu de posture publique. « Bon, j’ai fini », dit-il avant le dessert, jetant sa serviette sur la table avant de quitter la pièce. Palm Beach était l’idée d’Ivana Trump.
Longtemps auparavant, Donald lui avait crié : « Je ne veux rien de tout ce à quoi tu aspires socialement. Si c’est ça qui te rend heureuse, change de mari ! » Mais elle n’avait pas du tout l’intention de faire ça car Ivana, comme Donald, vivait dans un fantasme. Elle savait que dans la vie d’un Trump, tout et tout le monde semblait avoir un prix, ou pouvait être utile dans le futur. Ivana avait appris à ignorer Donald quand il disait à des amis proches durant les premières années de leur mariage : « Pourquoi est-ce que je lui achèterais de beaux bijoux ou tableaux ? Pourquoi lui offrir des actifs négociables ? »
Elle était sortie d’Europe de l’Est en s’endurcissant et en étant très disciplinée, et elle avait travaillé ses talents en observant son époux, le maître des manipulateurs. Elle avait appris la langue commune dans un monde où tout le monde semblait utiliser tout le monde dans une course au pouvoir sans répits. Comment aurait-elle pu savoir qu’on pouvait vivre autrement ? De plus, elle disait souvent à ses amies que malgré la cruauté dont Donald pouvait faire preuve, elle était très amoureuse de lui.
Ce soir-là, Ivana avait réussi à inviter l’éditeur du journal local, The Shiny Sheet. Comme d’habitude, les invitations que Donald avait lancées pour ce weekend étaient des rétributions, car il faisait confiance à très peu de gens. Il avait fait venir l’un de ses chefs de construction, le maire de West Palm Beach, et l’ancien gouverneur de New York, Hugh Carey, qui, à l’époque où il dirigeait l’État sous le surnom de « Society Carey » grâce à de grosses donations de Trump, avait joué un rôle clé dans ses premiers succès. Depuis des années, Ivana semblait avoir étudié le comportement public des familles royales. Ses amies appelaient ça « le syndrome du couple impérial d’Ivana », et elles se moquaient gentiment d’elle sur ce point car elles savaient qu’Ivana, comme Donald, s’inventait et se réinventait constamment.
Quand elle était arrivée à New York, la première fois, elle portait des coiffures casques élaborées et des robes de satin bouffantes, très Hollywood. L’image qu’elle avait de la riche américaine lui venait sûrement des films quelle avait vus étant enfant. À ce stade, Ivana avait déjà passé des années dans les salons les plus raffinés de New York sans toutefois avoir saisi les vraies manières des gens riches, l’art de la subtilité. À la place, elle avait adopté une allure royale et rempli ses maisons du genre d’ornements de laiton qu’on trouve dans les palais d’Europe de l’Est. Elle avait pris l’habitude de saluer ses amis de tout petits gestes de la main, comme s’il lui fallait conserver son énergie. Lors de ses propres galas de charités, elle insistait pour qu’elle et Donald reçoivent les invités en ligne. Elle portait des talons pointus et ne s’enfonçait jamais dans l’herbe. Toujours sous contrôle.
Ce soir de printemps, un escadron de domestiques attendait dehors pour accueillir les invités, comme on l’aurait fait à Cliveden dans l’entre-deux guerres. La plupart des employés, cependant, n’étaient pas des permanents de Mar-a-Lago ; c’étaient des traiteurs locaux et des gardiens de parking embauchés pour la soirée. En plus de la peinture de plafond de la salle à manger, Ivana avait gardé les vieux canapés à franges et les poufs marocains exactement à leur place, donnant ainsi l’impression de s’essayer aussi à la personnalité de madame Post.
L’un des rares signes du goût des nouveaux propriétaires résidait dans la présences de dizaines de cadres argentés répartis sur les nombreuses dessertes. Les cadres ne contenaient pas de photo de famille mais des couvertures de magazines. Chaque couverture affichait le visage de Donald Trump. Quand l’avion des Trump atterrissait à Palm Beach, il y avait en général deux voitures qui attendaient. La première, une Rolls-Royce, pour les adultes, et la seconde, un break, pour les enfants, les nourrices et un garde du corps. Parfois, des agents de sûreté ouvraient la voie pour accélérer le passage du cortège des Trump. Cela demandait beaucoup de planification et de coordination, mais l’effort était crucial pour ce qu’Ivana essayait d’accomplir. « Dans 50 ans, Donald et moi seront considérés comme une vieille famille, comme les Vanderbilt », dit-elle un jour à l’écrivain Dominick Dunne.
Ivana
En avril 1990, alors que son empire était à deux doigts de s’effondrer, Trump s’isola dans un petit appartement dans un des bas étages de la Trump Tower. Il s’allongeait sur son lit, fixant le plafond, parlant toute la nuit au téléphone. Les Trump s’étaient séparés. Ivana resta en haut, dans le triplex familial aux sols d’onyx beige et au salon à bas-plafond décoré de fresques dans le style de Michel-Ange. Les fresques avaient occasionné l’une de leurs disputes les plus fréquentes : Ivana voulait des chérubins, Donald préférait des guerriers. Ce sont les guerriers qui avaient remporté la bataille. « En terme de qualité, ce travail aurait tout à fait sa place au plafond de la chapelle Sixtine », disait Trump à propos de la peinture.
Cet avril-là, Ivana commença à dire à ses amis qu’elle s’inquiétait pour la santé mentale de Donald. Elle avait été complètement humiliée par Donald lorsqu’il s’était affiché publiquement avec Marla Maples. « Comment peux-tu dire que tu nous aimes ! Tu ne t’aimes même pas toi-même. Tu n’aimes que ton argent », aurait dit à son père Donald junior, âgé de 12 ans, d’après des amis d’Ivana. « Quel genre de fils ai-je engendré ? » aurait demandé Mary, la mère de Trump, à Ivana. Aussi improbable que cela puisse paraître, Ivana était à présent considérée comme une héroïne des tabloïds, et sa popularité augmentait dans une proportion inverse de celle du nouveau dégoût qu’éprouvait la ville changeante pour son mari. « Ivana est maintenant une déesse des médias au même titre que Lady Di, Madonna et Elizabeth Taylor », rapporta Liz Smith.
Plusieurs mois auparavant, Ivana avait subi de la chirurgie esthétique auprès d’un médecin californien. Elle était sortie de là méconnaissable aux yeux de ses amis et peut-être même de ses enfants, aussi fraîche et innocente que la petite Heidi sans ses montagnes suisses. Bien qu’elle eût négocié quatre contrats de mariages différents concernant la propriété immobilière pendant les quatorze années précédentes, elle attaquait son mari pour obtenir la moitié de ses possessions. Trump se voulait philosophe. « Quand un homme quitte une femme, surtout quand on a l’impression qu’il l’a quitté pour une paire de fesses – et une belle ! –, il y a toujours la moitié de la population qui va s’éprendre de la femme quittée », me dit-il.
Ivana avait embauché un responsable des relations publiques pour l’aider dans son nouveau rôle. « Tout est très calculé », me dit un de ses conseillers. « Ivana est très rusée. Elle joue son rôle à fond. » Plusieurs étages sous l’appartement des Trump, des touristes japonais envahirent le lobby de la Trump Tower avec leurs appareils photos. Inévitablement, ils prirent des photos du portrait familier de Trump qui avait fait la couverture de son livre Trump: The Art of Deal, et qui était posé sur un chevalet devant l’agence immobilière de la Trump Tower. Les Japonais prenait encore Donald Trump pour l’incarnation du pouvoir et de l’argent et semblaient penser, comme Trump l’avait fait avant eux, que ce monument de marbre rouge et de laiton était le centre du monde.
Trump est une girouette, toujours en train de se retourner pour voir qui d’autre est dans la salle.
Pendant des jours, Trump quitta à peine l’immeuble. Des hamburgers et des frites lui étaient livrés depuis le fast-food située à proximité. Son corps gonfla, ses cheveux bouclèrent le long de son cou. « Tu me rappelles Howard Hughes », lui dit un de ses amis. « Merci », répondit Trump. « Je l’admire. » Au téléphone, il semblait bouillonnant, sans soucis, aussi confiant que sur le portrait dans le lobby. Comme John Connaly, l’ancien gouverneur du Texas, Trump avait des millions de dollars déposés en garanties personnelles. Sa dette personnelle, rien que sur la compagnie aérienne Trump Shuttle, était de 135 millions de dollars. Bear Stearns s’était vu garantir 56 millions de dollars pour les positionnements de Trump sur Alexander’s et American Airlines. Le casino Taj Mahal avait une série de dispositions compliquées qui rendait Trump responsable de 35 millions de dollars. Trump avait personnellement assuré l’hôtel Plaza pour 125 millions.
À West Palm Beach, Le Plaza de Trump était tellement vide qu’il était surnommé the Trump See-through (« le fond transparent de Trump »). Cet immeuble à lui seul pesait 14 millions de dollars en dettes personnelles. Les demeures de Trump à Greenwich et Palm Beach, ainsi que le yacht, avaient été promis aux banques pour 40 millions de dollars de remboursement de crédits impayés. Le Wall Street Journal estimait que les garanties de Trump pouvaient dépasser les 600 millions de dollars. En une décennie époustouflante, Donald Trump était devenu le Brésil de Manhattan. « Quiconque est quelqu’un s’assoit entre les colonnes. Le pire c’est la nourriture, mais de là tu verras tout le monde », m’avait dit Donald Trump dix ans plus tôt au Club 21. Donald s’était déjà taillé une place dans ce temple new-yorkais. On nous assit immédiatement entre les colonnes, dans la vieille salle du haut, alors décorée de lambris noir et de banquettes en Naugahyde rouges.
C’était à l’automne 1980, une belle saison à New York. Les Yankees étaient en bonne voie pour remporter la saison ; une star de cinéma se présentait aux présidentielles et utilisait le terme « dérégulation » dans sa campagne. Donald était un nouveau à l’époque, il avait 34 ans, et il était très effronté. Il commençait tout juste à apparaître dans les journaux et il adorait ça. On parlait déjà de lui dans les quotidiens et les hebdomadaires mais il rêvait d’une attention nationale. « Vous avez vu que le New York Times trouve que je ressemble à Robert Redford ? » me demanda-t-il.
Entre 1980 à 1990, Trump n’avait pas beaucoup changé physiquement. Il avait déjà des pommettes saillantes et une mâchoire présente, avec une tendance à avoir l’air mou au milieu. Il avait conservé ses cheveux blonds, garantie de jeunesse, et le visage élastique. Trump est une girouette, toujours en train de se retourner pour voir qui d’autre est dans la salle. Quand il était petit garçon, il ne laissait aucun répit non plus. « Donald était l’enfant qui, aux goûters d’anniversaire, jetait du gâteau partout », me dit une fois son frère Robert. « Si je construisais une pile de Lego, Donald arrivait et les collait les uns aux autres, si bien qu’ils devenaient inutilisables. » Et en 1980, il était déjà marié à Ivana, un ancien mannequin et athlète de Tchécoslovaquie.
Un soir de 1976, Trump se trouvait au bar du Maxwell’s Plum. Ça n’existe plus aujourd’hui, mais le nom même évoque des hordes de célibataires frénétiques sous un plafond Art Nouveau. C’était le lieu où les hôtesses de l’air espéraient rencontrer un banquier, et où les mannequins se cherchaient des rendez-vous galants. Donald y rencontra son top modèle, Ivana Zelnickova, qui venait de Montréal. Elle aimait raconter l’histoire de comment elle avait été skier avec Donald, faisant semblant d’être une débutante comme lui avant de l’humilier en le doublant dans les slaloms. Ils se marièrent à New York à Pâques 1977. Le maire Beame était présent à l’église Marble Collegiate. Donald avait déjà fait alliance avec Roy Cohn, qui allait devenir son avocat et son mentor.
Juste avant le mariage, Donald aurait dit à Ivana : « Tu dois signer cet accord. » « Qu’est-ce que c’est ? » demanda-t-elle. « Juste un document qui va protéger l’argent de ma famille. » Cohn fit l’offre galante d’aider Ivana à trouver un avocat. « Nous n’avons pas ce type de documents en Tchécoslovaquie », répondit apparemment Ivana. Mais elle dit à ses amis qu’elle était terrifiée par Cohn et par le pouvoir qu’il avait sur Donald. Dans le premier contrat, Ivana obtenait 20 000 dollars par an. Deux ans plus tard, Trump avait constitué sa propre fortune. « Tu ferais mieux de revoir le contrat, Donald », lui aurait dit Cohn. « Sinon tu vas avoir l’air dur et radin. » Ivana résista. « Si ça ne te plaît pas, garde le vieux contrat », aurait répondu Trump.
Donald était déterminé à avoir une famille nombreuse. « Je veux cinq enfants, comme dans ma famille, parce qu’avec cinq, je suis sûr d’en voir un tourner comme moi », confia Donald à l’un de ses amis proches. Il était prêt à être généreux avec Ivana et la rumeur courut qu’il lui donnerait une récompense en liquide de 250 000 dollars pour chaque enfant. Les Trump et leur bébé, Donald junior, habitaient un appartement de la 5e Avenue décoré de sofas en velours beige et d’une table en os et peau de chèvre provenant du magasin de meubles italien Casa Bella. Ils avaient une collection d’animaux en verre Steuben qu’ils exposaient sur des étagères de verre dans le hall d’entrée. Les étagères étaient soulignées de petites guirlandes de lumières blanches qu’on voit habituellement sur les sapins de Noël.
Donald essayait de s’adapter au monde des esthètes et des petites robes de cocktail noires. Il venait de terminer le Grand Hyatt, sur la 42e rue, et était considéré comme un jeune talent. Il avait assemblé la parcelle de la 5e Avenue qui allait devenir la Trump Tower et avait fait enrager l’establishment de la ville en détruisant les frises art déco qui ornaient l’immeuble Bonwit Teller. Déjà, à l’époque, le style de Trump consistait à exciter le publique. « Qu’est-ce que vous croyez ? Vous pensez que ça m’a fait mal de détruire les sculptures ? » me demanda-t-il ce jour-là au « 21 ». « Oui. » « Qu’est-ce qu’on s’en fout ? » dit-il. « Disons que j’aie donné ces merdes au Met. Ils n’auraient fait que les mettre à la cave. Je n’aurai jamais la bienveillance de l’establishment, des décideurs de New York. Vous croyez que si j’échouais, ces types à New York seraient malheureux ? Ils seraient aux anges ! Parce qu’ils n’ont jamais rien tenté à l’échelle de ce que moi j’essaye de faire dans cette ville. Je me fiche de leur bienveillance. »
Donald était un peu un grand enfant, mal dégrossi et à l’ego surdimensionné. Il avait apporté le style de Brooklyn et du Queens à Manhattan, bafouant ce qui était pour lui des conventions inutiles, comme la préservation des lieux symboliques. Ses costumes étaient mal coupés, avec de grands revers au pantalon. Il ne lui manquait que le cigare. « Je ne me donne pas d’airs », me dit-il à l’époque. Il se baladait dans New York dans une Cadillac argentée avec des plaques « DJT » et des vitres tintées, et son chauffeur était un ancien flic de la ville. Ce jour-là, Donald et moi n’étions pas seuls à déjeuner. Il avait invité Stanley Friedman à se joindre à nous. Friedman était un des associés de Roy Cohn, et comme lui, une légende dans la ville. Il faisait partie de la machine politique du Bronx, et allait bientôt en être nommé chef du département.
Plus tard, Friedman irait en prison pour le rôle qu’il allait jouer dans le scandale des parcmètres. Trump et Friedman passèrent la majeure partie du déjeuner à s’échanger des anecdotes sur John Cohn. « Roy peut tirer d’affaire n’importe qui en ville », me dit Friedman. « C’est un génie. » « C’est un avocat nul, mais c’est un génie », dit Trump. À un moment donné, Preston Robert Tisch, connu de tous sous le nom de Bob, débarqua dans la salle du haut du « 21 ». Bob Tisch et son frère, Laurence, aujourd’hui à la tête de CBS, avaient fait fortune dans l’immobilier new-yorkais et en Floride. Bob Tisch, comme son frère, était un citadin, un homme bienveillant et élégant, bienfaiteurs des hôpitaux et des universités. « J’ai battu Bob Tisch sur le site du centre de conventions », dit Donald à très haute voix au moment où Tisch s’arrêtait notre table. « Mais maintenant on est amis, bons amis, n’est-ce pas Bob ? C’est pas vrai ? » Bob Tisch garda le sourire mais son ton devint brusquement aigu, comme celui d’un enfant qui se serait mal conduit. « Oh oui, Donald », dit-il, « de bons amis, de très bons amis. »
Vers la fin des vendredis après-midi d’été, le bruit de la ville est remplacé par un calme étrange. En juin, je me trouvais en compagnie de l’un des avocats les plus combatifs de Donald Trump. « On ne gagnera certainement pas l’opinion dans la presse populaire », me dit-il, « mais on gagnera, vous verrez. » Je pensai à Trump, à quelques pâtés de maisons de là, isolé dans la Trump Tower, se battant pour sa survie financière. Le téléphone sonna plusieurs fois. « Oui, oui ? C’est comme ça ? » dit l’avocat avant d’éclater de rire en évoquant les – comme il les appelle – « couilles de laiton » de son client, qui tenait tête aux nombreux types représentant Chase Manhattan et Bankers Trust, à qui il devait des centaines de millions de dollars.
« Donald est très en forme. C’est le genre de défi qu’il aime », me dit l’avocat. « C’est bizarre. On croirait que rien ne va mal. » « Ne croyez rien de ce que vous lisez dans les journaux », avait dit Trump à son éditeur Joni Evans. « Quand ils vont entendre de bonnes nouvelles à mon sujet, qu’est-ce qu’ils vont faire ? » Random House se hâtait de publier son nouveau livre, Trump: Surviving at the Top. Le premier tirage était de 500 000 exemplaires. Dans la salle de conférence de la Trump Tower, cette semaine-là, un avocat avait apparemment dit à Trump une évidence : l’hôtel Plaza ne rapporterait peut-être jamais les 400 millions qu’il l’avait payé. Trump resta serein. « Passez-moi le Sultan de Brunei au téléphone », dit-il. « J’ai la garantie personnelle que le Sultan de Brunei me reprendra le Plaza et que je ferai un immense profit. »
Les banquiers et les avocats dans la salle de conférence regardèrent Trump avec un mélange d’incrédulité et d’émerveillement. Aussi cyniques soient-ils, Trump, le virtuose de l’immobilier, avait sur eux le pouvoir de l’imagination car son plus grand talent avait toujours été de savoir convaincre les autres du champ des possibles. La frontière entre l’escroc et l’entrepreneur est souvent floue. « Ils disent que le Plaza vaut 400 millions de dollars ? Trump dit qu’il en vaut 800 millions. Qui sait combien ça vaut en réalité ? Je peux vous dire une chose : ça vaut bien plus cher que ce que je l’ai payé », me confia Trump. « Quand Forbes dévalue toutes mes propriétés, ils disent que je ne vaux que 500 millions ! Et bien, c’est 500 millions de plus que ce avec quoi j’ai débuté. » « Les gens pensent-il vraiment que j’ai des problèmes ? » me demanda Trump en 1990. « Oui », lui répondis-je alors, « ils pensent que vous êtes fini. »
C’était un après-midi de juillet, la poussière semblait retomber, et nous étions au beau milieu d’une conversation téléphonique de deux heures. La conversation en elle-même était une négociation. Trump tentait de me mettre sur la défensive. J’avais écrit à son sujet dix ans auparavant. Trump avait alors parlé d’un de ses amis proches qui était le fils d’un célèbre promoteur new-yorkais. « Je lui ai conseillé de sortir de l’ombrage de son père », m’avait-il dit alors. « C’était du off », me dit Trump. Je consultai mes vieilles notes. « Faux, Donald », dis-je. « Ce qui était off, c’est quand vous avez attaqué votre autre ami en disant qu’il était alcoolique. » Du tac au tac, Trump répliqua : « Je vous crois. » Puis il rit. « Certaines choses ne changent jamais. » « Attendez cinq ans », me dit Trump. « C’est très simple. C’est comme le contrat Mery Griffin. Quand je l’ai roulé, la presse voulait que je perde. Ils ont dit : “Bordel de Dieu ! Trump s’est fait prendre !” Laissez-moi vous dire quelque chose. C’est bon pour moi qu’on me croit pauvre maintenant. Vous ne me croiriez pas si je vous parlais des marchés que je suis en train de signer. J’imagine que je suis pervers… j’ai vraiment adoré les semaines qui viennent de s’écouler », dit-il, comme s’il sortait d’un spa rajeunissant.
Les marchés avaient toujours été son seul art. On disait alors qu’il signait des contrats incroyables avec les prestataires qu’il avait employés pour construire ses casinos et les éléphants en fibre de verre qui décoraient l’allée menant au Taj Mahal. Ces derniers étaient désespérés car ils n’étaient pas certains d’être payés pour ces mois de travail. Trump était célèbre pour sa capacité à tirer jusqu’au plus petit profit de ses transactions. On savait qu’il signait alors des accords complètement fous, qu’il n’aurait jamais pu conclure deux mois auparavant. « Trump ne signe aucun deal à moins qu’il n’y ait un petit plus, une petite goutte de larcin moral », disait de lui un de ses rivaux. « Les choses devenaient trop faciles pour moi », me dit Trump. « J’ai fait beaucoup d’argent et je l’ai fait trop facilement, au point de m’ennuyer. Tout ce que j’ai fait a marché ! J’ai repris le Bally, j’ai gagné 32 millions de dollars. Au bout d’un moment, c’est devenu trop facile. »
La peur de l’ennui a toujours joué un grand rôle dans la vie de Trump. Il a une capacité d’attention réduite. Il semblait même s’être lassé de sa femme. Il me dit qu’il s’était lassé de ses contrats, de ses sociétés, « des hypocrites de New York », « des hypocrites de Palm Beach », de la plupart des gens, des auteurs « négatifs » et des gens « négatifs » en général. « Tu frappes, tu frappes et tu frappes encore, et finalement ça ne veut plus dire grand choses », dit-il. « Eh, quand vous m’avez rencontré pour la première fois, je n’avais quasiment rien fait ! J’avais construit un immeuble ou deux, ce n’était pas extraordinaire. »
Ce matin de 1990, Trump avait une fois de plus fait la une du New York Daily News parce que Forbes l’avait retiré de la liste des hommes les plus riches du monde, fixant son réseau à 500 millions de dollars alors qu’il était de 1,7 milliard de dollars en 1989. « Il me mettent en une pour cette raison minable ! » dit Trump. « S’ils me mettent en couverture du Daily News, ils vendent plus de journaux ! Ils me mettent en une aujourd’hui alors qu’il y a des guerres qui éclatent ! Vous savez pourquoi ? Malcom Forbes s’est fait jeter du Plaza ! Par mes soins ! Vous connaissez l’histoire sur Malcom Forbes et moi, quand je l’ai sorti de l’hôtel Plaza ? Non ? Et bien je l’ai fait. Vous pourrez lire l’histoire dans mon nouveau livre. Et je ne l’ai pas viré parce qu’il n’avait pas payé sa note. Je m’attendais donc à cette attaque de Forbes. Le même auteur qui a écrit cet article a également écrit celui sur Mery ! Le même auteur fait l’objet d’une enquête. Vous avez entendu parler de ça non ? »
(Un des auteurs de Forbes faisait l’objet d’une enquête pour utilisation frauduleuse de cartes policières périmées. Il n’avait pas écrit que Trump s’était fait avoir par Mery Griffin.) « Ce qui m’est arrivé est ce qui arrive à toutes les sociétés aux États-Unis en ce moment. Il n’y a pas une entreprise aux États-Unis qui ne fait pas de restructuration. Vous n’avez pas vu le Wall Street Journal ce matin au sujet de Revlon ? Ce qui se passe à Revlon est exactement ce qui est arrivé à Donald Trump. Mais personne n’en fait la couverture d’un journal. Mes problèmes ne méritaient même pas une colonne de ce journal. » (Revlon vendait 182 millions de dollars de marchandise pour récupérer de l’argent, mais ça n’avait rien à voir avec la crise de Trump.)
Trump débitait un torrent de mots hypnotique et sans fin. Souvent, il semblait dire ce qui lui passait par la tête. Il parlait de lui à la troisième personne : « Trump dit… Trump croit. » Ses phrases pétillaient et se retournaient sur elles-mêmes comme des feux d’artifice dans un ciel d’été. Il me faisait penser à un marchand de foire tentant d’ameuter les passants sous sa tente. « Je suis plus populaire aujourd’hui que je ne l’étais il y a deux mois. J’estime qu’il y a deux publics. Le vrai public et la haute société merdique de New York. Le vrai public a toujours aimé Donald Trump. Le vrai public sait que Donald Trump traverse une phase de lynchage. Quand je sors en ce moment, c’est dingue. Je suis assailli, c’est la folie complète », me dit Trump. Trump est souvent belliqueux, comme pour épicer les choses.
Pendant une de nos conversations téléphoniques, il s’en prit à un auteur local qu’il qualifia de « honteux » et massacra la femme d’un investisseur que je connaissais en la traitant de « géant – un véritable poteau du point de vue physique ». Après la signature du contrat du Resort International, lors de la soirée du Nouvel An de Barbara Walters et Mery Adelson dans leur résidence d’Aspen, on demanda à Trump de formuler un vœu pour l’année à venir. « Je souhaiterais avoir un autre Mery Griffin à abattre », dit-il. Avant l’ouverture du Taj Mahal, Marvin Roffman, un analyste financier de Philadelphie, dit à juste titre que le Taj était parti pour un chemin semé d’embûches. À cause de ça – selon Roffman –, Trump l’a fait licencier. « Est-ce pour cela que vous l’avez attaqué ? » demandai-je à Trump. « Je le referais. Voilà un type qui m’appelait en me suppliant d’acheter des actions à travers lui, et qui en échange me ferait des commentaires positifs. » « Vous l’accusez de fraude ? » demandai-je. « Je l’accuse d’être mauvais dans ce qu’il fait. »
Le sénateur John Dingell, du Michigan, demanda au gouvernement d’enquêter sur les circonstances de son licenciement. Quand je demandai à Roffman de me parler des accusations que Trump portait à son encontre, il dit : « C’est le plus gros ramassis de mensonges que j’ai entendu de toute ma vie. » L’avocat de Roffman, James Schwartzman, qualifia les accusations de Trump d’ « acte désespéré d’un homme désespéré ». Roffman poursuivit Trump pour diffamation. « Donald croit en la théorie du grand mensonge », m’avait dit son avocat. « Si vous répétez quelque chose encore et encore, les gens finiront par vous croire. » « Un de mes avocats a dit ça ? » dit Trump quand je lui en parlai. « Si l’un de mes avocats a dit ça, je voudrais savoir lequel pour pouvoir le virer. J’aimerais bien savoir qui est cette ordure ! »
L’art des affaires
L’un des premiers gros contrats de Trump à New York fut d’acquérir un terrain sur le 34e ouest mis en vente par la Penn Central Railroad, alors en faillite. Trump soumit un plan de centre de conventions aux responsables de la ville. « Il nous a dit qu’il renoncerait à ses 4,4 millions de dollars de commission si nous donnions le nom de son père au centre de conventions », me confiait alors l’ancien adjoint au maire Peter Solomon. « Quelqu’un a fini par lire le contrat. Il n’était écrit nulle part qu’une telle somme devait lui revenir. C’était incroyable. Il a presque obtenu de voir le centre baptisé du nom de son père en échange d’une somme d’argent qu’il n’avait jamais vraiment eu à donner. »
Le premier vrai coup d’immobilier de Trump à New York fut l’acquisition de l’hôtel Commodore, qui allait devenir le Grand Hyatt. Ce contrat, signé en incluant un abattement d’impôt controversé de la part de la ville, fit la réputation de Trump. Ses associés de l’époque était les Pritzker, une famille très respectée de Chicago, alors propriétaires de la chaîne Hyatt. Leur contrat était précis : Trump et Jay Pritzker s’étaient mis d’accord sur le fait qu’en cas de litige, ils auraient une période de dix jours pour arbitrer leur différent. À un moment donné, ils eurent un petit désaccord. « Jay Pritzker partait pour un voyage au Népal, où il serait injoignable », me dit un des avocats de la famille Pritzker. « Donald a attendu que Jay soit dans l’avion pour l’appeler. Naturellement, Jay ne pouvait pas le rappeler. Il était sur une montagne au Népal. Plus tard, Donald n’a cessé de répéter : “J’ai essayé de te joindre. Je t’ai donné les dix jours. Mais tu étais au Népal.” C’était scandaleux. Pritzker était son associé, pas son ennemi ! Voilà comment il s’est comporté sur son premier contrat important. »
Plus tard, Trump relata même l’incident dans son livre. « Sers leur la soupe habituelle à la Trump », dit-il à l’architecte Der Scutt avant une présentation du design de la Trump Tower lors d’une conférence de presse en 1980. « Dis leur que ça va faire 10 000 m2, 68 étages. » « Je ne mens pas, Donald », répondit l’architecte.
Trump finit par racheter les parts d’espace commercial de la Trump Tower à Equitable Life Assurance. « Il a payé Equitable 60 millions de dollars après une négociation au bras de fer », me dit un grand promoteur. « Les actions pour tout l’espace commercial s’élevaient à 120 millions de dollars. Soudainement, Donald disait que ça en valait 500 millions ! » Quand The Art of the Deal fut publié, il dit au Wall Street Journal que le premier tirage serait de 200 000 exemplaires. Il gonflait le chiffre de 50 000. Au mois de mars, quand Charles Feldman, de CNN, questionna Trump sur l’effondrement de son empire, Trump sorti en trombe du studio.
Plus tard, il dit au patron de Feldman, Ted Turner : « Ton journaliste a menacé ma secrétaire et l’a fait pleurer. » Quand la bourse s’effondra, il annonça qu’il s’était retiré à temps et qu’il n’avait rien perdu. En fait, il avait pris un sérieux coup sur ses actions Alexander’s et American Airlines. « Ce que j’ai dit c’est que mis à part les actions Alexander’s et American Airlines, je m’étais retiré des marchés », me dit Trump rapidement. Quelles forces, dans le passé de Trump, ont bien pu générer en lui un tel besoin d’autopromotion ?
En 1980, je rendis visite au père de Trump dans ses bureaux de l’avenue Z, près de Coney Island, à Brooklyn. La fortune personnelle de Fred Trump dans l’immobilier s’était faite avec l’aide de la machine politique de Brooklyn, et en particulier celle de Abe Beame. Dans les années 1940, Trump et Beame partageaient un ami proche et avocat, un chef de parti politique à Brooklyn de nom de Bunny Lindenbaum.
À l’époque, Beame travaillait au bureau du budget de la ville ; 30 ans plus tard, il en deviendrait le maire. Trump, Lindenbaum et Beame se croisaient souvent lors des dîners et des galas de charité des clubs politiques de Brooklyn. Le pouvoir de ces clubs dans le New York des années 1950 n’était pas à sous-estimer ; ils donnèrent naissance à Fred Trump et lui permirent d’effectuer sa plus grosse acquisition, la parcelle de 30 hectares sur le terrain de la ville qui allait accueillir les 3 800 appartements du Trump Village. En 1960, un immense lopin de terre près d’Ocean Parkway à Brooklyn devint disponible pour des projets de développement. La commission de planification de la ville avait approuvé un généreux abattement d’impôts au profit d’une fondation à but non lucratif afin d’y construire une coopérative de logement. Fred Trump s’en prit à cet abattement qu’il qualifia de « cadeau ».
Peu de temps après, Trump décida de partir lui-même en guerre contre cet abattement. Bien que la commission eut déjà donné son accord pour le projet à but non lucratif, Lindenbaum alla voir le maire, Robert Wagner, et Beame, qui était dans le camp de Wagner, apporta son soutien à Trump. Fred Trump parvint à remporter les deux tiers de la propriété, et en moins d’un an, il avait posé les bases du Trump Village. Lindenbaum se vit offrir le siège à la commission de planification de la ville, préalablement occupé par Robert Moses, le courtier qui avait construit la plupart des autoroutes de New York, des aéroports et des parcs.
L’année suivante, Lindenbaum organisa un déjeuner de levée de fonds pour Wagner, qui se présentait à sa propre réélection. 43 constructeurs et propriétaires firent don de milliers de dollars ; Trump, d’après le journaliste Wayne Barrett, promit 2 500 dollars, une des plus grosses contributions. Le déjeuner fit la une des journaux et Lindebaum, mis en disgrâce, fut forcé de démissionner de la commission. Mais Robert Wagner remporta l’élection et Beame devint son contrôleur des finances. En 1966, alors que Donald intégrait l’école de commerce de Wharton, Fred Trump et Lindenbaum firent l’objet d’une enquête pour leur rôle dans le dossier d’hypothèque de 60 millions de dollars Mitchell-Lama. « Existe-t-il un moyen pour empêcher un homme qui fait du business de cette façon d’obtenir un autre contrat avec l’État ? » demanda le directeur de la commission d’enquête au sujet de Trump et de Lindenbaum. Finalement, Trump fut contraint de restituer les 1,2 million de dollars qu’il avait gagnés en spéculant sur le terrain, et dont il s’était en partie servis pour acheter un terrain à proximité afin d’y construire un centre commercial. Le bureau de Fred Trump était agréablement modeste. Les salles étaient séparées par des vitres. La « Trump Organization », comme Donald avait déjà décidé d’appeler la société de son père, était un petit cottage sur le terrain du Trump Village.
À l’époque, Donald dit à des journalistes que la Trump Organization était propriétaire de 22 000 unités de logement, alors qu’en réalité elle en possédait la moitié. Fred Trump avait alors 75 ans. Il était poli mais pas bête. Il critiqua beaucoup les premiers contrats de son fils, le mettant en garde en lui disant notamment que « s’étendre vers Manhattan était comme acheter un billet pour le Titanic. » Donald l’ignora. « Un paon aujourd’hui, un plumeau à poussière demain », aurait dit le promoteur Sam Lefrak en évoquant Donald Trump. Mais en 1980, il était clair que Donald incarnait tous les espoirs de son père. « Je dis toujours à Donald : “L’ascenseur vers le succès est en panne. Monte une marche à la fois” », me dit Fred Trump à l’époque. « Mais que pensez-vous de ce que mon Donald a accompli ? Ça laisse abasourdi non ? »  Donald Trump a toujours perçu son père comme un modèle à suivre. Dans The Art of the Deal, il écrit : « Fred Trump est né dans le New jersey en 1905. Son père, arrivé là de Suède, était propriétaire d’un restaurant qui marchait modérément. »
Donald Trump a toujours perçu son père comme un modèle à suivre. Dans The Art of the Deal, il écrit : « Fred Trump est né dans le New jersey en 1905. Son père, arrivé là de Suède, était propriétaire d’un restaurant qui marchait modérément. »
En vérité, la famille Trump était allemande et désespérément pauvre. « À un moment, ma mère fit de la couture pour nous permettre de survivre », me confia le père de Trump. « Pendant un temps, mon père a tenu un restaurant dans le Klondike, mais il est mort jeune. » Le cousin de Donald, John Walter, réalisa un jour un arbre généalogique élaboré. « Nos avons le même grand-père », me dit Walter. « Il était allemand, et alors ? » Bien que Fred Trump naquît dans le New Jersey, certains membres de la famille racontent qu’il se sentit obligé de cacher ses racines allemandes car la plupart de ses locataires étaient juifs. « Après la guerre, il pensait que les juifs ne voudraient jamais lui louer quoi que ce soit s’ils apprenaient son ascendance », aurait déclaré Ivana. Ce qui est certain, c’est que le camouflage de Fred Trump aurait facilement pu laisser penser à un enfant que dans le business, tout passe.
Quand je demandai à Donald Trump de me parler de ça, il resta évasif : « En réalité, c’est très compliqué. Mon père n’était pas allemand ; les parents de mon père étaient allemands… suédois, et en fait d’un peu partout en Europe… et j’ai même pensé, dans la seconde édition, mettre l’accent sur les autres lieux parce que je recevais trop de courrier de Suède : Pourrais-je venir et m’exprimer au Parlement ? Accepterais-je de rencontrer le président ? » Donald Trump semble prendre au sérieux certains aspects de ses origines allemandes.
D’après ce qu’Ivana confia à un ami, John Walter travaillait pour la Trump Organization et lorsqu’il rendait visite à Donald dans son bureau, il claquait les talons en déclarant : « Heil Hitler ! » C’est apparemment une blague familiale.
En avril 1990, peut-être dans un élan de nationalisme tchèque, Ivana dit à son avocat Michael Kennedy que de temps à autre son mari lisait un ouvrage rassemblant des discours d’Hitler, Discours, qu’il gardait dans le tiroir de sa table de nuit. Kennedy en gardait depuis une copie dans un placard de son bureau, comme si c’était une grenade. « Est-ce que votre cousin John vous a donné les discours d’Hitler ? » demandai-je à Trump. Trump hésita. « Qui vous a dit ça ? » « Je ne me souviens pas », répondis-je. « En vérité, c’est mon ami Marty Davis de la Paramount qui m’a donné un exemplaire de Mein Kampf, et il est juif. » (« Je lui ai bien donné un livre à propos d’Hitler », dit Marty Davis. « Mais c’était Discours, les discours d’Hitler, pas Mein Kampf. Je pensais que ça pouvait l’intéresser. Je suis bien son ami, mais je ne suis pas juif. »)
Plus tard, Trump remit ce sujet sur la table. « Si j’avais ces discours, et je ne dis pas que je les ai, je ne les lirais jamais. » Ivana essayait-elle de convaincre ses amis et son avocat que Trump était un crypto-nazi ? Trump n’est pas un grand lecteur, ni un passionné d’histoire. Le fait qu’il possèdât un exemplaire des discours d’Hitler indiquait au mieux un intérêt pour le savoir d’Hitler en matière de propagande. Le Führer décrivait souvent ses défaites à Stalingrad et en Afrique du nord comme de grandes victoires. Trump continuait d’accorder plus d’importance qu’il n’en avait à son empire qui s’effritait. « Personne n’a autant de liquidités que moi », dit-il au Wall Street Journal longtemps après avoir appris qu’il en allait autrement. « Je veux être le roi du cash. »

Donald et son père
Fred Trump, comme son fils, ne put jamais résister aux exagérations. Quand Donald était enfant, son père acheta une maison qui « avait 9 salles de bains et des colonnes de Tara », me raconta Fred Trump. La maison, cependant, était dans le Queens. Donald envisagerait plus tard un monde plus vaste. C’était sa mère, Mary, qui révérait le luxe. « Ma mère avait un sens de la grandeur », me dit-il. « Je me souviens d’elle regardant le couronnement de la reine Elizabeth, totalement fascinée. Mon père ne s’intéressait pas du tout à ce genre de choses. » Donald Trump se rendait souvent sur les chantiers avec son père, car ils étaient incroyablement proches, c’était presque des esprits jumeaux. Sur les photos de famille, Fred et Donald se tiennent ensemble, souvent bras-dessus bras-dessous, alors que les sœurs de Donald et son plus jeune frère, Robert, sont dans le flou. Ivana dit à des amis que Donald avait même persuadé son père de le nommer responsable des fonds d’investissement de ses trois frères et sœurs.
Parmi les cinq enfants, Donald était le deuxième fils. Enfant, il était si turbulent que ses parents l’envoyèrent dans un internat militaire. « C’était comme ça que ça marchait dans la famille Trump », m’expliqua un ami de longue date. « Ce n’était pas une atmosphère aimante. » Donald était grassouillet à l’époque, mais l’école militaire le fit maigrir. Il devint fort, et se rapprocha encore d’avantage de son père. « Je devais sans cesse me défendre », me dit-il à une occasion. « Les types comme mon père sont durs. Il faut rendre coup pour coup. Sinon, ils ne vous respectent pas ! » Les membres de la famille disent que le premier né, Fred junior, se sentait souvent exclu de la relation entre Donald et son père. Jeune homme, il annonça son intention de devenir pilote d’avion.
Plus tard, d’après un ami d’Ivana, Donald et son père rabaissèrent souvent Fred junior pour son choix de carrière. « Donald disait : “Quelle est la différence entre ce que tu fais et conduire un bus ? Pourquoi n’es-tu pas dans le business familial de l’immobilier ?” » Fred junior devint alcoolique et mourut à l’âge de 43 ans. Ivana a toujours dit à ses amis proches que la pression que lui avaient fait subir son père et son frère avait précipité sa mort. « Peut-être inconsciemment, on lui a mis la pression », m’avouait Trump. « On se disait que l’immobilier était facile pour nous et que ça l’aurait été pour lui aussi. J’avais du succès, et ça faisait pression sur Fred aussi. Qu’est-ce qu’on fait, là ? La psychanalyse de Donald ? » La relation de Donald et Robert avait aussi eu ses moments sombres. Robert, qui lui avait pris part au business familial, avait toujours été « le gentil », dans l’ombre de son frère.
Vinrent s’ajouter des frictions entre la femme de Robert, Blaine, et Ivana. Blaine ne ménageait pas sa peine pour les bonnes œuvres de New York et Robert et Blaine étaient extrêmement populaires – on les surnommait « les bons Trump ». « Robert et moi avons le sentiment que si nous disons quoi que ce soit au sujet de la famille, nous devenons des personnages publiques », me dit Blaine. L’hostilité réprimée du frère explosa après l’ouverture du Taj Mahal. « Robert dit à Donald qu’il s’en irait s’il ne lui donnait pas son autonomie », confia Ivana à un ami. « Donc Donald le laissa seul et il y eut un problème avec les machines à sous qui coûta à Donald entre 3 et 10 millions de dollars les trois premiers jours. Quand Donald explosa, Robert fit ses cartons et s’en alla. Lui et Blaine allèrent passer Pâques dans sa famille à elle. »
À New York, Trump devint bientôt célèbre pour son goût de la confrontation.
Tout comme son père avait eut Bunny Lindenbaum comme guide, Donald Trump avait Roy Cohn, le Picasso du rafistolage de l’intérieur. « Cohn apprit à Donald quelle fourchette utiliser », me dit un ami. « Je viendrai avec mon avocat Roy Cohn », disait souvent Trump aux responsables de la ville en 1980, avant qu’il ne sache se débrouiller seul. « Donald m’appelle entre 15 et 20 fois par jour », me dit une fois Cohn. « Il prête une attention folle aux détails. Il demande toujours : “Qu’en est-il de ceci ? Qu’en est-il de cela ?” » Dans le cadre d’un dossier de Trump d’abattement fiscal, d’après le biographe de Cohn, Nicholas von Hoffman, le juge se vit remettre un morceau de papier qui ressemblait à un affidavit. Il ne comportait qu’une seule phrase : « Pas de délais supplémentaire ou d’ajournement. Stanley M. Friedman. »
À l’époque, Friedman était devenu chef du comté du Bronx. Il n’était pas nécessaire de payer pour des faveurs de ce genre. C’était un classique ; le pouvoir de suggestion de faveurs futures suffisait. Friedman avait aussi été d’une aide cruciale pour les plans de Trump de l’hôtel Commodore. « Dans les derniers jours de l’administration Beame », d’après Wayne Barrett, « Friedman précipita un abattement d’impôts de 160 millions de dollars sur 40 ans… et fit les documents pour ce canard boiteux de Beame. » Friedman avait déjà accepté de rejoindre la firme d’avocats de Cohn, qui représentait Trump. « Trump a perdu tout compas moral lorsqu’il a fait alliance avec Roy Cohn », fit un jour remarquer Liz Smith.
À New York, Trump devint bientôt célèbre pour son goût de la confrontation. Il devint aussi le plus gros contributeur d’Hugh Carey, le gouverneur de New York, avec le frère de ce dernier. Trump et son père donnèrent 135 000 dollars. Il bougeait vite à présent ; il s’était installé dans un bureau et un appartement de la 5e Avenue et avait embauché Louise Sunshine, la chef des levées de fonds de Carey, en tant que « directrice des projets spéciaux ». « Je connaissais Donald mieux que quiconque », me dit-elle. « Nous sommes une équipe, Sunshine et Trump, et quand les gens nous poussaient, nous poussions plus fort. » Sunshine avait levé des millions de dollars pour Carey, et elle avait l’un des meilleurs carnets d’adresse de la ville. Elle fit rencontrer à Donald tous les acteurs du pouvoir de la ville et de l’état et travailla à la vente des appartements de la Trump Tower. La taxation de l’immobilier est immensément compliquée.
Souvent, les comptes des profits et des pertes ne vont pas de paire avec la disponibilité des liquidités. Parfois, un promoteur peut avoir énormément de liquidités et pourtant ne pas déclarer de revenus imposables ; les lois de l’imposition permettent aussi aux promoteurs d’avoir moins de liquidité mais de plus grosses sommes d’impôts à payer. Cela dépend du promoteur. Quand Donald Trump posa les bases d’un nouvel immeuble d’appartements sur la 61e Rue et le 3e Avenue, Louise Sunshine se vit offrir 5 % des parts du nouveau Trump Plaza, comme il fut nommé. Il y avait des frictions entre Sunshine et son patron. Conséquence de la comptabilité de Trump sur le Trump Plaza, Louise Sunshine, d’après un ami proche, aurait eut à payer un million de dollars d’impôts. « Pourquoi structures-tu le Trump Plaza de cette façon ? » aurait-elle demandé à Donald.
« Où est-ce que je vais trouver un million ? » « Tu n’as qu’à me vendre tes 5 % du Trump Plaza et tu les auras », dit Trump. Sunshine était tellement médusée qu’elle alla quêter l’aide de son ami milliardaire Leonard Stern. « J’ai tout de suite fait un chèque de un million de dollars afin que ma bonne amie ne se retrouve pas déplumée par Donald », me dit Stern. « J’ai dit à Louise : “Dis à Trump qu’à moins qu’il ne te traite correctement tu vas le poursuivre en justice ! Et qu’en conséquence, sa façon de traiter les gens sera portée à l’attention du public mais aussi de la Commission de Contrôle des Casinos.” » Louise Sunshine embaucha Arthur Liman, qui allait bientôt représenter le financier Michael Milken, pour s’occuper de son cas. Liman parvint à un accord : Trump paya à Louise 2,7 millions de dollars pour ses parts du Trump Plaza. Sunshine remboursa Leonard Stern. Pendant plusieurs années, Trump et Sunshine restèrent en froid. Mais dans le plus pur style new-yorkais, ils redevinrent amis dix ans plus tard. « Donald n’aurait jamais dû utiliser son argent comme instrument de pouvoir sur moi », me dit Sunshine, ajoutant : « Je l’ai pardonné. » 
Comme Michael Milken, Trump commença à croire que ses talents démesurés pouvaient s’appliquer à n’importe quel business. Il commença à étendre l’empire familial de l’immobilier aux casinos, aux compagnies aériennes et aux hôtels. Avec Citicorp comme outil, il acheta la Plaza et Eastern Shuttle. Il les géra étonnement bien, mais les avait payés trop cher. Il avait toujours bénéficié de la coopération des plus grandes banques, qui plus tard allaient paniquer. « Vous ne pouvez pas imaginer les sommes d’argent que les banques nous jetaient », me raconta un ancien avocat associé de Trump. « Pour chaque contrat que nous signions, nous avions six ou huit banques prêtes à nous donner des centaines de millions de dollars. Il nous fallait trier les financements, les banques se précipitaient pour signer sur tout ce que Donald concevait. »
« Il acheta de plus en plus de propriétés et s’étendit tant qu’il assura sa propre destruction. Dépenser de l’argent était une drogue. Et sa drogue devint son talon d’Achille », me dit un important promoteur. Les négociations de Trump, d’après un avocat qui travailla sur l’acquisition du casino d’Atlantic City, Resorts international, étaient toujours étonnement désagréables. Après le succès de The Art of the Deal, les avocats de Trump commencèrent à parler de « l’ego de Donald » comme s’il s’agissait d’une entité à part entière. « L’ego de Donald ne nous permettra jamais d’accepter ce point », répéta encore et encore un des avocats pendant la négociation. « La clé avec Donald, comme avec toutes les fortes têtes, c’est de lui dire d’aller se faire foutre », me dit l’avocat. Quand Mortimer Zuckerman, le PDG de Boston Properties, soumit un plan qui fut choisi pour le site du Colisée de la 59e Rue, Trump fit une crise d’apoplexie. « Il appela tout le monde pour saboter le contrat. Bien sûr, Mort était associé avec les frères Salomon donc Trump n’obtint aucun résultat », se souvint une personne proche de Zuckerman.
Marla
Une image d’Ivana et Donald Trump me reste en mémoire. C’était l’hiver 1987. Ils étaient à la patinoire Wollman. Donald venait de la terminer pour la ville. Il s’était largement répandu dans les journaux sur les idiots que le maire Koch et la ville avaient été, perdant des années et de l’argent pour n’arriver à rien sur cette histoire de patinoire. Trump avait pris le boulot et l’avait bien fait. S’il s’accorda plus de crédit qu’il n’en méritait, personne ne lui en tint rigueur ; la patinoire était enfin ouverte et remplie de patineurs heureux. Ivana portait un saisissant manteau en lynx qui mettait en avant ses cheveux blonds. Ils se tenaient par le bras. Ils avaient l’air si jeunes et si riches, goûtant pleinement leur succès. Une foule polie s’était rassemblée pour les féliciter du triomphe de la patinoire. Les gens près de Donald semblaient inspirés par sa présence, comme s’il s’agissait d’un héros. Son bonheur semblait être le reflet de l’adulation de la foule. Près de moi un homme s’écria : « Pourquoi ne négociez-vous pas les accords SALT pour Reagan, Donald ? » Ivana rayonnait. La neige commença à tomber très légèrement et depuis la patinoire résonnait la valse des patineurs.
Quelques mois avant la séparation des Trump, Donald et Ivana étaient attendus à un dîner donné en leur honneur. Les Trump étaient en retard et ce dîner n’était pas à prendre à la légère. Le nom de famille des hôtes était lié à l’histoire même de New York, mais comme s’ils avaient reconnu l’arrivée d’une nouvelle force dans la ville, ils honoraient Donald et Ivana Trump. Trump entra dans la pièce en premier. « Il fallait que j’enregistre l’émission de Larry King », dit-il. « Je passe dans l’émission ce soir. » Il semblait ne connaître aucun répit. Trump ne prêtait pas attention à sa compagne blonde et personne dans la salle ne la reconnut avant qu’Ivana ne commençât à parler. « Mon Dieu ! Qu’est-ce qu’elle s’est fait ? » demanda un invité.
Les joues slaves d’Ivana avaient disparu ; ses lèvres étaient gonflées à bloc. Sa poitrine avait été re-sculptée et son décolleté considérablement augmenté. Les invités étaient si déstabilisés par son apparence que sa présence créa une atmosphère bizarre. Pendant tout le dîner, Donald s’agita. Il regardait sa montre. Il répéta plusieurs fois qu’il passait en ce moment-même dans l’émission de Larry King, comme s’il s’attendait à ce que les invités se lèvent. Il avait été belliqueux à l’encontre de King ce soir-là, et il voulait que l’assemblée le voie, peut-être pour confirmer son pouvoir. « Ça vous ennuie si je m’assois un peu en retrait ? Parce que vous avez vraiment très mauvaise haleine, vraiment », avait-il dit à Larry King sur une chaîne de télévision nationale. « Allez Arnold ! Pose avec moi ! Allez ! » s’écria Ivana Trump en direction du designer Arnold Scaasi par une tiède soirée du mois de juin 1990.
Ils étaient au Waldorf-Astoria, à une cérémonie de remise de récompense sponsorisée par la fondation Fragrance, et Ivana était l’une des présentatrices. Le tapis était usé dans la salle Jade ; les paparazzis étaient prêts à surgir. Les kits de dossiers de presse recouvraient les tables de cet événement « immanquable », de ceux qui ont souvent lieu dans la vie de la haute société new-yorkaise. Sous la teinte bleue verte des éclairages, les robes des plus grands couturiers avaient l’air bon marché. J’étais surprise de la voir apparaître. La veille, la crise que son mari traversait avec les banques avait fait la une des trois tabloïds locaux.
« TRUMP S’EFFONDRE ! » s’écriait le Daily News. Un éditorialiste avait même dit que les problèmes de Trump étaient une occasion de se réjouir pour la ville, et proposait un jour férié. « Ivana ! Ivana ! Ivana ! » lui hurlaient les photographes. Ivana souriait à la manière d’une candidate aux élections présidentielles. Elle portait une ample robe faite de satin et de perles vert menthe ; ses cheveux étaient relevés en chignon. Aussi humiliée pour ses enfants qu’elle ait pu se sentir ce soir-là à cause de la mauvaise publicité, elle avait décidé de les laisser à la maison. Ivana était au Waldorf à 18 h 15, saluant les journalistes et les paparazzis par leurs prénoms. Elle ne pouvait pas se permettre de s’aliéner l’establishment de la parfumerie en annulant dans un moment si crucial, car elle allait bientôt commercialiser un parfum et elle allait avoir besoin de leur bienveillance.
Ivana semblait déterminée à conserver son nouveau statut dans la ville des alliances, car son futur financier dépendait de sa capacité à sauver le nom de la marque. Elle s’apprêtait à intégrer un monde difficile pour une femme seule doté d’une fortune réduite. Elle n’avait pas de Rothko à mettre au mur, ni de bijoux impressionnants. Mais elle avait son prénom Ivana et elle se préparait à commercialiser des écharpes, des parfums et des chaussures, tout comme son mari avait réussi à commercialiser le nom Trump.
À quelques mètres de nous, le reporter local de CBS parlait devant la caméra dans le journal du soir. Il commentait l’écroulement de Trump pendant qu’Ivana discutait avec Scaasi et Estée Lauder. Lauder, une grand femme d’affaires elle-même, avait supposément dit à Ivana quelques mois plus tôt : « Retourne avec Donald. C’est un monde froid, là dehors. » Je me souvins d’une scène d’attroupement dans Le Jour du fléau, de Nathanael West. Ivana autorisa même le journaliste de CBS à lui tendre un micro. « Donald et moi sommes partenaires dans le mariage et dans les affaires. Je serai à ses côtés pour le pire et le meilleur », dit-elle aux journalistes avec un aplomb bizarre. Ivana était devenue, comme Donald, un agent double, capable de projeter une image d’innocence et de grande confiance. Elle s’était presque transformée en Donald Trump. « Pour vous dire la vérité, j’ai fait d’Ivana une femme très populaire. J’ai créé beaucoup de satellites. Hey, que ce soit Marla ou Ivana. Marla peut faire tous les films qu’elle veut maintenant. Ivana peut faire tout ce qu’elle veut », me dit Donald Trump au téléphone à l’époque.
« New York est un endroit très dur », m’avait dit Ivana Trump des années avant cela. « Je suis dure moi aussi. Quand on me donne un coup sur le nez, je réagis en frappant encore plus durement. » Nous marchions parmi les gravas de l’hôtel Commodore, qui allait bientôt rouvrir sous le nom de Grand Hyatt. Ivana s’était vue confier la tâche de superviser toute la décoration ; elle était totalement investie malgré la tenue qu’elle avait choisie pour cheminer dans la poussière ambiante : un jogging Thierry Mugler en laine blanche et des chaussures Dior pâles. « Je vous ai déjà dit de ne jamais laisser un balais comme ça dans la salle ! » cria-t-elle à un ouvrier. Hurler sur ses employés était devenu une marque de fabrique, peut-être sa façon de sentir son propre pouvoir. Plus tard, à Atlantic City, elle deviendrait célèbre pour son obsession de la propreté.
Le concept de « syndrome de Stockholm » est à présent utilisé par l’avocat d’Ivana pour décrire sa relation avec Donald. « Elle avait la mentalité d’une captive », me dit Kennedy. « Au bout d’un moment, elle ne pouvait plus combattre son bourreau, et elle a commencé à s’identifier à lui. Ivana est sourde, bête et aveugle quand il en va de Donald. » Si Donald travaillait 18 heures par jour, Ivana faisait de même. Les Trump embauchèrent deux nourrices et un garde du corps pour leurs enfants. Elle s’en alla gérer le casino Trump Castle à Atlantic City, passant souvent deux à trois nuits par semaine là-bas à superviser les équipes. Déterminée à apporter du glamour au Trump Castle, elle devint célèbre pour son attention aux apparences, allant jusqu’à sortir de la salle de jeux une serveuse enceinte qui tentait désespérément d’obtenir de gros pourboires. La femme fut placée dans un lounge à bonne distance et on lui donna un habit de clown pour masquer son état.
À New York, Ivana ne résista pas au goût du grandiose de son mari. Peu après que la Trump Tower fut achevée, le couple prit possession de son triplex. Les avocats d’Ivana parlaient souvent de son amour des arts domestiques et décrivaient ses confitures maisons. Pourtant, la cuisine de son appartement, qu’elle avait elle-même dessinée, était minuscule, pas plus grande qu’une kitchenette, avec un sol en linoléum doré. « Il y a une cuisine dans l’aile des enfants et c’est là que les nourrices cuisinent », me dit une amie de la famille. Le salon des Trump avait un sol en onyx beige avec des emplacements découpés pour mettre les tapis. Il y avait une cascade coulant le long d’un mur en marbre, une fontaine italienne et les fameuses fresques murales. Leur chambre disposait d’un mur de verre renfermant des fleurs de soie mais avec le temps, Ivana se lassa du décor.
Elle fit appel à un décorateur de renom. « Que puis-je faire de cet intérieur ? » lui aurait-elle demandé. « Absolument rien », dit-il. Soir de Noël 1987. Ivana venait de recevoir une nouvelle pile de documents légaux qui faisait la taille d’un bottin téléphonique. « Qu’est-ce que c’est ? » aurait-elle demandé à Donald. « C’est notre nouveau contrat de mariage. Tu obtiens dix millions de dollars. Signe-le. » « Mais je ne peux pas lire ça maintenant, c’est Noël ! » répondit Ivana. Selon Kennedy, Donald fit pression sur elle. Trump semblait avide de la voir signer les papiers, peut-être parce qu’un photographe d’Atlantic City le faisait chanter en le menaçant de publier des photos de lui et Marla Maples. Même si Ivana gérait le Trump Castle de façon très efficace, elle semblait terrifiée par son mari. Elle signa les papiers qui lui attribuaient dix millions de dollars et la demeure de Greenwich, dans le Connecticut.
Plus tard, Trump dit à des journalistes : « Ivana a eu 25 millions de dollars. » Les tactiques qu’il utilisait dans les affaires étaient à présent utilisées à la maison. « Donald commença à appeler et crier sur Ivana constamment : “Tu ne sais pas ce que tu fais !” » me rapporta l’un des plus proches assistants d’Ivana. « Quand Ivana raccrochait le téléphone, je lui disais : “Comment peux-tu tenir le coup ?” et Ivana répondait : “Parce que Donald a raison.” » Il commença à la dénigrer : « Cette robe est horrible. » « Ton décolleté est trop profond. » « Tu ne passes pas assez de temps avec les enfants. » « Qui voudrait toucher à ces seins en plastique ? » Ivana dit à ses amis que Donald ne voulait plus coucher avec elle. Elle se sentait responsable. « Je pense que c’était l’objectif de Donald de se débarrasser d’Ivana en l’envoyant à Atlantic City », me confia une de ses assistantes. « Pendant ce temps, Marla Maples était dans une suite au Trump Regency. Atlantic City était censé être son terrain de jeu. »
Ivana avait déjà mis son mari en garde contre Atlantic City. « Pourquoi se développer dans un lieu où il n’y a pas d’aéroport ? » Trump, cependant, était déterminé à y investir, même si ses associés de Las Vegas lui avaient dit que le marché du jeu dans le Nevada avait un facteur de profit qui pourrait lui rapporter 200 millions par an. Mais à ce moment-là, Marla Maples était à Atlantic City, non loin de New York. Trump était devenu, d’après un de ses amis, « si focalisé sur Marla qu’il ne prêtait plus attention à ses affaires ». Bien qu’Ivana se fût installée à Atlantic City pour faire plaisir à Donald, sa présence désormais, alors que Marla était entrée en scène, était un obstacle pour lui. L’acquisition de l’hôtel Plaza lui permit de lancer un ultimatum : « Soit tu agis comme mon épouse, tu rentres à New York et tu t’occupes de nos enfants, soit tu gères le casino à Atlantic City et nous divorçons. »
« Que vais-je faire ? » demanda-t-elle à l’une de ses assistantes. « Si je ne fais pas ce qu’il dit, je vais le perdre. » Trump convoqua même une conférence de presse pour annoncer le nouveau poste d’Ivana comme présidente de l’hôtel Plaza : « Ma femme, Ivana, est un manager brillant. Je la paierai un dollar par an et toutes les robes qu’elle voudra ! » Ivana appela ses amis en pleurs. « Comment Donald peut-il m’humilier de la sorte ? » « Je pense que Marla est très différente de l’image qu’elle renvoie », me dit Donald Trump en juillet 1990. « Son image est celle d’une très belle blonde plantureuse. » Une Donna Rice ? « Elle est très différente de ça. Elle est intelligente, très gentille et n’a aucune ambition. Elle aurait pu gagner une fortune ces six derniers mois si elle l’avait voulu ! » « Comment avez-vous pu autoriser Marla à être la fille de la pub des jeans No Excuses ? » demandai-je à Trump. « Je me suis dit qu’elle pouvait gagner 600 000 dollars en une seule journée de travail. Au sujet de cette mauvaise pub, je me suis dit que ces 600 000 dollars pouvaient la faire vivre jusqu’à la fin de ses jours », me dit Trump.
À la une
En février 1990, Trump décolla pour le Japon en disant aux journalistes qu’il allait assister à un match de Mike Tyson. Sa véritable motivation était de rencontrer des banquiers pour essayer de vendre le Plaza, car l’audit de novembre d’Arthur Andersen avait été catastrophique. Lors de son vol retour, il reçut un appel par radio dans l’avion. Liz Smith avait sorti un scoop sur la séparation des Trump. Toute l’histoire sordide de Marla Maples et d’Ivana se battant sur les slaloms d’Aspen était étalée dans les journaux. Ivana avait fait à Donald ce qu’il avait lui-même fait à Jay Pritzker au Népal plusieurs années auparavant. Depuis l’avion, Donald appela Liz Smith. « Félicitations pour votre article », lui dit-il avec sarcasme. « C’est fini avec Ivana. Elle est devenue comme Leona Helmsley. » « Honte à vous ! » répondit Smith. « Comment osez-vous parler de la mère de vos enfants en ces termes ? » « Vous n’avez qu’à écrire que c’est quelqu’un du bureau d’Howard Rubenstein qui l’a dit », dit Trump à Smith, faisant allusion aux bons contacts de son attaché de presse. (« Je n’ai jamais dit ça », me disait Trump. « Si, il l’a dit », soutenait Smith.)
Les banquiers japonais avec qui Trump avait négocié une tentative de vente se retirèrent soudainement. « Les Japonais méprisent le scandale », me dit un de leurs associés. Plusieurs semaines plus tard, Donald appela Ivana. « Pourquoi ne pas marcher ensemble le long de la 5e Avenue pour les photographes et prétendre que tout ce scandale était un coup publicitaire ? On pourrait dire qu’on voulait voir qui allait prendre partie pour toi et qui allait se ranger à mes côtés. » À mesure que la presse devenait plus sympathique envers Ivana, Donald hurlait à ses avocats : « C’est n’importe quoi ! » Ivana commença à opérer des réconciliations dans toute la ville. « Nous pouvons être amis maintenant Leonard, n’est-ce pas ? » dit-elle dans une soirée à Leonard Stern, d’après un de ses amis. « Ton problème était avec Donald, pas avec moi. Je t’ai toujours bien aimé. »
Les avocats de Trump essayèrent de toutes leurs forces de suivre ce que faisait Ivana. « Donald a vu une facture remise par Ivana cette semaine et qui fait état de 7 000 dollars de draps Pratesi pour leur fille, Ivancka », dit un des avocats. « Il a appelé, furieux. “Pourquoi une gamine de 7 ans aurait besoin de 7 000 dollars de draps ?” Elle a payé une chemise 350 dollars à Montenapoleone. C’était pour qui, son nouveau meilleur ami Jerry Zipkin ? » L’avocat décrivit la facture d’Ivana chez Carolina Herrera : « Nous recevons une facture de 25 000 dollars. Ivana a photocopié l’original et à la place d’une robe à 25 000 dollars, elle écrit à la main : “6 articles pour 25 000 dollars.” » (Un porte-parole d’Ivana assurait que c’était totalement faux.)
Le scandale avait de sérieuses répercussions sur les enfants Trump. Donny Jr était ridiculisé à l’école Buckley. Ivancka avait éclaté en pleurs à Chapin. Quand Donald et Marla Maples assistèrent au concert d’Elton John, Donny Jr se mit à pleurer car son père avait promis aux enfants de laisser tomber Marla. « Les enfants sont détruits », dit Ivana à Liz Smith. « Je ne sais pas comment Donald peut dire qu’ils vont bien. Ivancka est rentrée de l’école en pleurant : “Maman, est-ce que ça veut dire que je ne vais plus être Ivancka Trump ?” Le petit Eric m’a demandé : “Est-ce que c’est vrai que tu t’en vas et que tu ne vas pas revenir ?” » Aussi cavalière qu’était l’attitude d’Ivana en public, elle pleurait souvent en privé. Un temps la complice des conspirations de son mari, elle dit à des amis qu’elle se sentait à présent comme ses victimes.
Le samedi du 44e anniversaire de Donald Trump, je tentai de me promener dans les jardins de West Side, au dessus du centre Lincoln, à Manhattan. Les rails étaient rouillés, la terre avait repris ses droits. La propriété s’étendait, pâté de maison après pâté de maison. Il faisait frais le long de l’Hudson ce matin-là, et une brise plaisante soufflait sur l’eau. Le seul signe de la présence de Trump était une haute barrière surmontée de boucles élaborées de fils barbelés destinée à empêcher les sans-abris du coin de passer. C’était sur ce terrain, sur les hauteurs de sa mégalomanie, que Trump avait dit vouloir ériger « le plus haut immeuble du monde », un plan endigué avec succès par les activistes du quartier qui refusaient de voir des parties de West Side obscurcies par l’ombre d’une telle construction. « Ils n’ont aucun pouvoir », avait dit Trump à l’époque, effaré que quiconque pût résister à ses projets grandioses. Ivana s’en alla à Londres afin de participer à un événement public de plus pour promouvoir le Plaza.
Sauf que cette fois, on raconta que c’étaient ses amis le baron et la baronne Ricky di Portanova qui payèrent la note. Ivana avait fait orchestrer sa campagne médiatique new-yorkaise par John Scanlon, qui avait été à la tête des relations publiques de CBS pendant le dossier de diffamation de Westmoreland. À Londres, elle était choyée par Eleanor Lambert, la doyenne des publicistes de mode. Une rumeur courut dans Londres selon laquelle elle ne pouvait pas se payer l’hôtel et avait déménagé chez une amie à Eaton Square. Elle marchait sur les pas d’Undine Spragg, qui avait si bien calculé son ascension dans Les Beaux mariages d’Edith Wharton. Sir Humphry Wakefield rassembla une liste d’invités anoblis pour un dîner, mais il y avait des frictions entre lui et Ivana. Quand les invités, dont la duchesse de Northumberland, arrivèrent, beaucoup d’entre eux furent désagréablement surpris d’avoir été attiré à un dîner qui était en fait donné en l’honneur d’Ivana Trump. « Humphry paiera pour ça », aurait dit un invité.
Ce samedi-là, New York semblait étrangement vide sans les Trump. Donald était parti fêter son anniversaire à Atlantic City. Des centaines d’employés du casino avaient reçu l’instruction de se tenir le long de l’allée principale pour l’accueillir, car on manquait de soutiens venus de Manhattan. La veille, il avait manqué à rembourser 73 millions de dollars dus à des créanciers et des banquiers. Des clowns et des bouffons empruntés au théâtre de Trump, le Xanadu, furent payés pour divertir les employés et les journalistes qui patientaient en attendant sous les minarets et les éléphants de Trump, qui allaient bientôt être saisis. Trump arriva très tard, entouré de ses gardes du corps. Son visage était grave, sa bouche pincée. Dans un cérémonial compliqué, les cadres dirigeants de Trump soulevèrent le rideau qui révéla son cadeau d’anniversaire, un immense portrait de Donald Trump, le même que sur le tableau photographié par les japonais dans le hall de la tour de Manhattan. La taille du portrait était bizarre sur le trottoir d’Atlantic City : trois mètres de Donald, penché en avant, appuyé sur son coude, le visage figé dans un rictus défiant et familier.
En quelques jours, les banquiers acceptèrent de donner à Trump 65 millions de dollars pour payer ses factures. Une grosse partie de son empire devrait probablement être démantelé, mais il en garderait le contrôle. Il lui serait dorénavant alloué 450 000 dollars par mois sur le plan personnel. « Je peux vivre avec ça », dit Trump. « Aussi absurde que cela puisse paraître, il était plus malin de faire les choses de cette façon plutôt que de laisser un juge présider une braderie dans un tribunal des faillites », me dit un banquier. Trump pavoisait au sujet du plan de sauvetage. « C’est une grande victoire. C’est un super accord pour tout le monde », dit-il. Pas exactement. On racontait que les banquiers de Trump étaient si mécontents de son bilan comptable – il y avait apparemment un trou d’un milliard de dollars – qu’ils lui demandèrent de s’engager sur son futur héritage pour garantir les nouveaux prêts. Le père de Trump, qui l’avait créé en l’aidant à signer ses premiers contrats, semblait maintenant venir à nouveau à son secours. « N’importe quoi », me dit Trump. « Les banques m’ont donné cinq ans. Les banques ne m’auraient jamais demandé mon futur héritage et je ne l’aurais jamais donné. »
Peu après, Trump annonça que le grand magasin français Galeries Lafayette allait acheter le vaste espace que Bonwit Teller avait laissé vacant dans la Trump Tower. « Ce n’est en aucun cas un grand retour », me dit Trump. « Parce que je ne suis jamais parti nulle part. » Je cherchais toujours à saisir Donald Trump. Un jeudi pluvieux de juillet 1990, je me rendis à la cour fédérale, où il devait témoigner dans un dossier civil dans lequel il était défendant. Lui et son entrepreneur étaient accusés d’avoir embauché des immigrés clandestins polonais pour effectuer le travail de démolition sur le site de la Trump Tower. « La brigade polonaise », comme on les appelait, avait été incroyablement exploitée, gagnant 4 dollars de l’heure pour un travail habituellement payé cinq fois plus. La dernière fois que j’étais allée dans ce quartier, c’était pour entendre le verdict du procès de John Gotti.
Je connaissais bien le coin. Le garde à l’entrée me salua par mon prénom. Je traînais souvent dans et autour des salles d’audience pour observer les visages célèbre de la décennie passée. Je repensai à Bess Myerson, Michael Milken, Ivan Boesky, Leona Helmsley, Imelda Marcos et Adnan Khashoggi, détruits et traînés à terre dans le kaléidoscope fou des années 1980. Chacun d’entre eux avait, à un moment de sa vie, pensé être comme Donald Trump, une figure de grandeur, doté de super pouvoirs. Devant le tribunal, la police avait monté des barricades. Tant de célébrités avaient passé ces portes que les grands panneaux jaunes étaient laissés là de façon routinière, sur les marches du massif palais de justice.
« On a créé ce type ! On a cru à ses conneries ! » — Des journalistes en colère
Je repensai aux dix années qui s’étaient écoulées depuis que j’avais rencontré Donald Trump pour la première fois. Il était aujourd’hui à la mode de dire de lui qu’il avait été le symbole de la grossièreté des années 1980. Mais Trump était devenu en 1990 bien davantage qu’un homme vulgaire. Comme Michal Milken, Trump semblait penser que son argent lui donnait la liberté de faire la loi. Personne ne l’arrêta. Ses exagérations et ses mensonges furent rapportés et les cela fit rire les gens. Ses banquiers l’arrosèrent d’argent. Les responsables de la ville le laissèrent presque décider de la politique publique en érigeant son mur de béton sur l’Hudson River. New York, comme les banquiers de Chase et Manny Hanny, autorisa Trump à exister dans un univers dénué de toute réalité. « J’ai rencontré deux journalistes », me dit Trump au téléphone, « et ils voyaient tout à fait ce que je voulais dire. Ils m’ont complètement cru. Puis ils sont partis et ont écrit des choses horribles sur moi, tout comme vous allez aussi le faire j’en suis sur. »
Il y a longtemps, Trump me comptait parmi ses ennemis dans son monde de « positifs » et de « négatifs ». Je me dis que la prochaine dizaine de personnes à qui Trump allait parler se verraient sûrement conter un catalogue de mes transgressions imaginées par Donald Trump. Quand j’entrai dans la salle d’audience, Trump était parti. Son avocat, le vénérable et bien connecté Milton Gould, affichait un large sourire car il pensait apparemment qu’il allait remporter le procès haut la main. Trump avait dit qu’il ne savait rien des démolitions, que son entrepreneur avait été un « désastre ». Pourtant, un informateur du FBI avait témoigné du fait qu’il avait prévenu Trump de la présence de la brigade polonaise.
Il l’avait prévenu qu’il n’obtiendrait peut-être pas sa licence de casino s’il ne s’en débarrassait pas. Je déambulai jusqu’à la salle de presse au 5e étage pour entendre ce qui se disait sur le témoignage de Trump. Les journalistes semblaient fatigués ; ils avaient déjà entendu tout ça avant. « Nom de Dieu », me cria l’un d’eux. « On a créé ce type ! On a cru à ses conneries ! Ça a toujours été un hypocrite, et on a noirci des pages entières de nos journaux à son sujet ! » Je repensai à la dernière question que Donald Trump m’avait posée la veille au téléphone. « Quelle est la longueur de votre article ? » « Long », avais-je répondu. Trump semblait satisfait. « Ça fait la une ? »
Traduit de l’anglais par Caroline Bourgeret d’après l’article « After The Gold Rush », paru dans Vanity Fair.
Couverture : Donald et Ivana Trump.
L’article L’odieux divorce de Donald et Ivana Trump est apparu en premier sur Ulyces.