Accès libre Hymnes européens
10.05.2024 à 19:11
Elections européennes 2024 : quand et où ont lieu les meetings des différents partis ?
Hugo Palacin

Comme pour chaque campagne électorale, les meetings politiques se succèdent à mesure que le scrutin approche. Ces moments de rencontre entre les candidats et leurs sympathisants permettent aux candidats de mettre en avant leurs propositions programmatiques. Les principaux partis ont d’ores et déjà tenu leurs premiers meetings de campagne, mais bon nombre d’événements continuent d’être […]
L’article Elections européennes 2024 : quand et où ont lieu les meetings des différents partis ? est apparu en premier sur Touteleurope.eu.
Texte intégral (3097 mots)

Comme pour chaque campagne électorale, les meetings politiques se succèdent à mesure que le scrutin approche. Ces moments de rencontre entre les candidats et leurs sympathisants permettent aux candidats de mettre en avant leurs propositions programmatiques. Les principaux partis ont d’ores et déjà tenu leurs premiers meetings de campagne, mais bon nombre d’événements continuent d’être organisés un peu partout en France jusqu’au scrutin, le 9 juin.
Sommaire
- Meetings de la majorité présidentielle (Renaissance, Horizons, MoDem, Parti radical et UDI)
- Meetings du Rassemblement national
- Meetings d’Europe Ecologie-Les Verts
- Meetings des Républicains
- Meetings du Parti socialiste et de Place publique
- Meetings de La France insoumise
- Meetings de Reconquête
- Meetings d’autres listes
Meetings de la majorité présidentielle (Renaissance, Horizons, MoDem, Parti radical et UDI)
Les prochains meetings :
- Meeting le lundi 13 mai à partir de 19h30, aux Dock Circus de Lyon (Rhône).
- Meeting le samedi 18 mai à Strasbourg (Bas-Rhin).
- Meeting le mercredi 5 juin à Lorient (Morbihan).
- Meeting le jeudi 6 juin à Nice (Alpes-Maritimes).
Les précédents meetings :
- Meeting de lancement de campagne, le samedi 9 mars au Grand Palais de Lille (Nord).
- Meeting le vendredi 22 mars à la Maison des associations de Bayonne (Pyrénées-Atlantiques).
- Meeting le mardi 7 mai, à la Maison de la Mutualité à Paris (5e arrondissement).
Meetings du Rassemblement national
Les prochains meetings :
Pas de meeting annoncé pour l’instant.
Les précédents meetings :
- Grand meeting de lancement de campagne, le dimanche 3 mars au Parc Chanot à Marseille (Bouches-du-Rhône).
- Meeting le vendredi 22 mars à La Roselière à Montbéliard (Doubs).
- Meeting le samedi 6 avril à la salle Durandal de Lécluse (Nord).
- Meeting le samedi 13 avril au Palais des Congrès de Royan (Charente-Maritime).
- Meeting le mercredi 1er mai au Palais des Congrès de Perpignan (Pyrénées-Orientales).
- Meeting le mardi 7 mai, à la salle L’Agora à Saint-Avold (Moselle).
Meetings d’Europe Ecologie-Les Verts
Les prochains meetings :
- Grand meeting le dimanche 2 juin à partir de 14 heures, aux Docks d’Aubervilliers (Seine-Saint-Denis).
Les précédents meetings :
- Meeting de lancement de campagne “Pulsations”, le samedi 2 décembre 2023, à l’Elysée Montmartre dans le 18e arrondissement de Paris.
- Meeting “Dignité”, le samedi 20 janvier 2024, au Grand Playground à Villeneuve-d’Ascq (Nord).
- Meeting des Jeunes écologistes, le dimanche 14 avril, à la Salle Bellevilloise, dans le 20e arrondissement de Paris.
- Réunion publique le jeudi 25 avril, au Kaleidoscoop à Strasbourg (Bas-Rhin).
- Meeting le samedi 4 mai, aux Chantiers de la Garonne à Bordeaux (Gironde).
Meetings des Républicains
Les prochains meetings :
Pas de meeting annoncé pour l’instant.
Les précédents meetings :
- Grand meeting de lancement de campagne, le samedi 23 mars aux Docks d’Aubervilliers (Seine-Saint-Denis).
- Meeting le vendredi 26 avril, à la salle Barcelone de Toulouse (Haute-Garonne).
Meetings du Parti socialiste et de Place publique
Les prochains meetings :
- Meeting le lundi 13 mai à partir de 18 heures, au Pavillon de Buxerolles à Limoges (Haute-Vienne), en présence de la tête de liste Raphaël Glucksmann et du premier secrétaire du PS, Olivier Faure.
- Meeting le mardi 14 mai à partir de 19 heures, à la salle Louis Aragon de Camon (Somme), en présence de la tête de liste Raphaël Glucksmann.
- Meeting le vendredi 17 mai à partir de 18 heures, à Morcenx-la-Nouvelle (Landes), en présence de la tête de liste Raphaël Glucksmann et du premier secrétaire du PS, Olivier Faure.
- Meeting le samedi 18 mai à partir de 18 heures, à Montpellier (Hérault), en présence de la tête de liste Raphaël Glucksmann.
- Meeting le samedi 25 mai à partir de 15 heures, à Brest (Finistère), en présence de la tête de liste Raphaël Glucksmann et du premier secrétaire du PS, Olivier Faure.
- Meeting le jeudi 30 mai à partir de 18h30, à Paris, en présence de la tête de liste Raphaël Glucksmann et du premier secrétaire du PS, Olivier Faure.
- Meeting le vendredi 31 mai à partir de 18h30, à Tours (Indre-et-Loire), en présence de la tête de liste Raphaël Glucksmann.
- Meeting le samedi 1er juin à partir de 18 heures, à Marseille (Bouches-du-Rhône), en présence de la tête de liste Raphaël Glucksmann et du premier secrétaire du PS, Olivier Faure.
Les précédents meetings :
- Meeting de lancement de campagne de Place publique le dimanche 8 octobre 2023 à l’Elysée Montmartre dans le 18e arrondissement de Paris.
- Meeting le samedi 20 janvier 2024 à la Faïencerie à Bordeaux (Gironde).
- Meeting le vendredi 9 février à la Maison du Peuple de Clermont-Ferrand (Puy de Dôme).
- Meeting le dimanche 10 mars au H7 à Lyon (Rhône).
- Meeting le dimanche 24 mars au Phare à Tournefeuille (Haute-Garonne).
- Meeting le mercredi 27 mars à la salle des fêtes de Gentilly à Nancy (Meurthe-et-Moselle).
- Meeting le mercredi 3 avril au Trianon Transatlantique à Sotteville-Lès-Rouen (Seine-Maritime).
- Meeting le samedi 13 avril au Zénith Nantes Métropole à Saint-Herblain (Loire-Atlantique).
- Meeting le mercredi 24 avril à la salle de la Bourse à Strasbourg (Bas-Rhin).
- Meeting le jeudi 25 avril, à la salle des fêtes de l’Hôtel de ville d’Avignon (Vaucluse).
- Meeting le lundi 29 avril, au Jardin de Ville à Grenoble (Isère).
- Meeting le mardi 30 avril, à Cergy (Val-d’Oise).
- Meeting le mercredi 1er mai, à la Maison des Sports Raphaël Barros de Villeurbanne (Rhône).
Meetings de La France insoumise
Les prochains meetings :
- Meeting le lundi 13 mai à partir de 19 heures, au Mégacité à Amiens (Somme), en présence de la tête de liste Manon Aubry, de l’eurodéputée sortante Marina Mesure, du député François Ruffin et du candidat Anthony Smith.
- Meeting le samedi 25 mai, à Paris, en présence de Jean-Luc Mélenchon.
Les précédents meetings :
- Convention de l’Union populaire, meeting de lancement de campagne, le samedi 16 mars au Parc des expositions de Villepinte (Seine-Saint-Denis).
- Meeting le mercredi 20 mars, au Palais des Congrès de Schoelcher (Martinique).
- Meeting le vendredi 22 mars, au 2.0, aux Abymes (Guadeloupe).
- Meeting le samedi 6 avril, au Jardin d’Eden à La Saline-les-Bains (La Réunion).
- Meeting le dimanche 14 avril, au Corum de Montpellier (Hérault).
- Meeting le mercredi 17 avril, à la salle Watremez de Roubaix (Nord).
- Meeting le mardi 23 avril, au Palais de la Musique et des Congrès de Strasbourg (Bas-Rhin).
- Meeting le mardi 30 avril, à Alp’Expo à Grenoble (Isère).
- Meeting le dimanche 5 mai, à la halle François Mitterrand de Saint-Joseph (La Réunion).
Meetings de Reconquête
Les prochains meetings :
- Réunion publique le vendredi 10 mai à partir de 19h30, à la Halle au Beurre de Forges-les-Eaux (Seine-Maritime), en présence de la tête de liste Marion Maréchal et de l’eurodéputé sortant Nicolas Bay.
Les précédents meetings :
- Meeting de lancement de campagne, le dimanche 10 mars au Dôme de Paris - Palais des Sports, dans le 15e arrondissement de Paris.
- Meeting le mercredi 3 avril à Charvieu-Chavagneux (Isère).
- Meeting le jeudi 11 avril au Stirwen à Carnac (Morbihan).
- Meeting d’Eric Zemmour le samedi 27 avril, à Lille (Nord).
- Meeting de Sarah Knafo le lundi 6 mai, à Paris.
Meetings d’autres listes
Les prochains meetings :
- Meeting national du Parti communiste français (PCF) le mercredi 15 mai à partir de 18 heures, au gymnase Japy à Paris (11e arrondissement).
- Meeting national du Parti communiste français (PCF) le dimanche 2 juin à partir de 15 heures, à la Friche de la Belle de Mai à Marseille (Bouches-du-Rhône).
Les précédents meetings :
- Meeting de lancement de campagne du Parti communiste français (PCF) le jeudi 11 avril au Mégacité d’Amiens (Somme).
- Meeting de la liste Europe, Territoires, Ecologie (PRG, RPS, Volt…) le samedi 20 avril au centre de congrès Diagora à Labège (Haute-Garonne).
- Meeting de la liste Europe, Territoires, Ecologie (PRG, RPS, Volt…) le lundi 22 avril à la salle de la Mairie de Guéret (Creuse).
- Meeting du Parti animaliste le samedi 27 avril, à la salle polyvalente Anna Politkovskaïa de Grenoble (Isère).
Pour aller plus loin…
L’article Elections européennes 2024 : quand et où ont lieu les meetings des différents partis ? est apparu en premier sur Touteleurope.eu.
10.05.2024 à 19:04
Elections européennes 2024 : qui sont les candidats de la liste Renaissance ?
Hugo Palacin

Qui sont les 81 candidats qui figurent sur la liste de la majorité présidentielle pour les élections européennes du 9 juin ? Le suspense a été long mais Renaissance et ses alliés ont fini par lever le voile en révélant d’abord les 30 premiers noms de leur liste “Besoin d’Europe” le 3 mai, puis l’intégralité […]
L’article Elections européennes 2024 : qui sont les candidats de la liste Renaissance ? est apparu en premier sur Touteleurope.eu.
Texte intégral (4988 mots)

Qui sont les 81 candidats qui figurent sur la liste de la majorité présidentielle pour les élections européennes du 9 juin ? Le suspense a été long mais Renaissance et ses alliés ont fini par lever le voile en révélant d’abord les 30 premiers noms de leur liste “Besoin d’Europe” le 3 mai, puis l’intégralité de leurs candidats le 7 mai.
Y figurent de nombreux eurodéputés sortants, des élus locaux, des figures de la Macronie et quelques nouveaux visages issus de la société civile.
Fin février, le camp présidentiel avait d’abord annoncé l’identité de sa tête de liste : Valérie Hayer. L’eurodéputée a ainsi la lourde tâche de mener la campagne de la majorité présidentielle jusqu’au scrutin, le 9 juin. Agée de 38 ans, originaire de Mayenne, elle a été élue pour la première fois au Parlement européen en 2019. Cheffe de la délégation française de Renew Europe, elle est devenue présidente de ce groupe, troisième force politique à Strasbourg, à la suite de la nomination en janvier 2024 de Stéphane Séjourné comme ministre de l’Europe et des Affaires étrangères.
De nombreux sortants reconduits
Si la majorité présidentielle a tardé à présenter son début de liste, c’est notamment en raison d’une série de contraintes. Celle du renouvellement pour commencer. Ainsi, la moitié des 30 premiers candidats sont des eurodéputés sortants.
Les sept premières positions sont occupées par des candidats qui siégeaient au Parlement européen lors de la mandature 2019-2024. Derrière Valérie Hayer figurent Bernard Guetta (2e) et Marie-Pierre Vedrenne (3e). Suivent le président de la commission de l’Environnement au Parlement européen Pascal Canfin (4e), Nathalie Loiseau (5e), Sandro Gozi (6e) et Fabienne Keller (7e).
Citons également en positions éligibles Laurence Farreng (9e), Gilles Boyer (10e), Christophe Grudler (12e), Stéphanie Yon-Courtin (13e), Jérémy Decerle (14e) ou encore Max Orville (18e). La réélection s’annonce en revanche plus compliquée pour Catherine Amalric (27e) et le président de la commission de la Pêche, Pierre Karleskind (30e).
Quelques nouveaux visages
Le reste des candidats n’a donc encore jamais mis les pieds au Parlement européen. En haut de la liste, on retrouve le sapeur-pompier Grégory Allione, en 8e position. Agé de 52 ans, cet ancien directeur de la fédération nationale des sapeurs-pompiers est une figure reconnue dans le monde des soldats du feu. Pour le temps de la campagne, il s’est mis en congés de la direction de l’Ecole nationale supérieure des officiers (ENSOSP) d’Aix-en-Provence.
Autre personnalité issue de la société civile, l’avocate Rachel-Flore Pardo. Cette experte des questions de cyberharcèlement et de violences sexistes, passée par plusieurs cabinets ministériels, hérite de la 21e place.
L’autre principale contrainte concernait la répartition des positions entre les différentes composantes de la majorité présidentielle. Pas moins de cinq partis sont alliés sous la bannière commune “Besoin d’Europe” pour le scrutin de juin : le parti du chef de l’Etat, Renaissance, celui de l’ancien Premier ministre Edouard Philippe, Horizons, le MoDem de François Bayrou, l’Union des démocrates et indépendants (UDI) et enfin le Parti radical.
Au-delà des eurodéputés sortants qui appartiennent à l’une ou l’autre de ces formations politiques, de nouvelles figures pourraient faire leur apparition au Parlement européen. Il en va ainsi de l’ancien maire de Nancy et président du Parti radical, Laurent Hénart (16e), ou de l’ancienne secrétaire d’Etat à la Biodiversité, Bérangère Abba (17e), l’une des candidates d’Horizons pour ces élections. A noter également la présence au 20e rang du président des Jeunes avec Macron (JAM), Ambroise Méjean.
Des cadors en fin de liste
Lors des élections européennes, les dernières positions sur les listes, non éligibles, reviennent parfois à des candidats importants, historiques ou symboliques. La majorité ne déroge pas à cette tradition. Ainsi, on retrouve au 74e rang l’avocat Jean Veil, fils de Simone Veil, qui fut la première femme présidente du Parlement européen en 1979.
Plus bas figurent les chefs des principaux partis du camp présidentiel : l’ancien Premier ministre Edouard Philippe (76e), patron d’Horizons, François Bayrou (78e), président du MoDem, et le ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, Stéphane Séjourné (80e), qui occupe toujours la fonction de secrétaire général de Renaissance.
Enfin, la 81e et dernière place revient à Elisabeth Borne, Première ministre de 2022 à 2024.
La liste des candidats de Renaissance
En gras figurent les eurodéputés sortants.
| N° | Candidat | Âge | Profession/Engagement | Département |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Valérie Hayer | 38 | Députée européenne depuis 2019, présidente du groupe Renew Europe au Parlement européen | Mayenne (53) |
| 2 | Bernard Guetta | 73 | Député européen depuis 2019 | Paris (75) |
| 3 | Marie-Pierre Vedrenne | 41 | Députée européenne depuis 2019 | Ille-et-Vilaine (35) |
| 4 | Pascal Canfin | 49 | Député européen depuis 2019, président de la commission de l’Environnement au Parlement européen, ancien ministre délégué au Développement (2012-2014) | Seine-Saint-Denis (93) |
| 5 | Nathalie Loiseau | 60 | Députée européenne depuis 2019, présidente de la sous-commission Sécurité et défense, ancienne ministre chargée des Affaires européennes (2017-2019) | Paris (75) |
| 6 | Sandro Gozi | 56 | Député européen depuis 2020, ancien secrétaire d’Etat italien aux Affaires européennes (2014-2018), secrétaire général du Parti démocrate européen | Italie |
| 7 | Fabienne Keller | 64 | Députée européenne depuis 2019, quatrième questeure du Parlement européen, ancienne sénatrice (2004-2019), ancienne maire de Strasbourg (2001-2008) | Bas-Rhin (67) |
| 8 | Grégory Allione | 52 | Sapeur pompier, directeur de l’école nationale supérieure des officiers (ENSOSP) | Var (83) |
| 9 | Laurence Farreng | 57 | Députée européenne depuis 2019 | Pyrénées-Atlantiques (64) |
| 10 | Gilles Boyer | 52 | Député européen depuis 2019 | Paris (75) |
| 11 | Valérie Devaux | 59 | Conseillère départementale de la Somme, conseillère municipale d’Amiens, candidate UDI | Somme (80) |
| 12 | Christophe Grudler | 59 | Député européen depuis 2019 | Territoire de Belfort (90) |
| 13 | Stéphanie Yon-Courtin | 50 | Députée européenne depuis 2019 | Calvados (14) |
| 14 | Jérémy Decerle | 39 | Député européen depuis 2019 | Saône-et-Loire (71) |
| 15 | Sylvie Gustave-dit-Duflo | 53 | Conseillère régionale de Guadeloupe, présidente de l’Office français de la biodiversité (OFB) | Guadeloupe (971) |
| 16 | Laurent Hénart | 55 | Président du Parti radical, ancien secrétaire d’Etat (2004-2005), ancien député de Meurthe-et-Moselle (2002-2012), ancien maire de Nancy (2014-2020) | Meurthe-et-Moselle (54) |
| 17 | Bérangère Abba | 47 | Ancienne secrétaire d’Etat (2020-2022), ancienne députée de la Haute-Marne (2017-2020) | Haute-Marne (52) |
| 18 | Max Orville | 61 | Député européen depuis 2022 | Martinique (972) |
| 19 | Séverine de Compreignac | 55 | Conseillère municipale de Paris, secrétaire générale du groupe MoDem à l’Assemblée nationale | Paris (75) |
| 20 | Ambroise Méjean | 28 | Président des Jeunes avec Macron | Rhône (69) |
| 21 | Rachel-Flore Pardo | 30 | Avocate | Paris (75) |
| 22 | Jean-Charles Orsucci | 52 | Maire de Bonifacio | Corse-du-Sud (2A) |
| 23 | Alexandra Leuliette | 44 | Directrice de cabinet du recteur de l’Académie de Toulouse | Haute-Garonne (31) |
| 24 | Xavier Fournier | 41 | Conseiller municipal de Guérande, secrétaire général du groupe des Indépendants au Sénat | Loire-Atlantique (44) |
| 25 | Shannon Seban | 28 | Conseillère municipale de Rosny-sous-Bois | Seine-Saint-Denis (93) |
| 26 | François Decoster | 51 | Maire de Saint-Omer, conseiller régional des Hauts-de-France, président du groupe Renew Europe au Comité européen des régions | Pas-de-Calais (62) |
| 27 | Catherine Amalric | 59 | Députée européenne depuis 2023 | Cantal (15) |
| 28 | James Chéron | 46 | Maire de Montereau-Fault-Yonne, conseiller régional d’Île-de-France | Seine-et-Marne (77) |
| 29 | Magali Altounian | 34 | Conseillère municipale de Nice, conseillère régionale de Provence-Alpes-Côte-d’Azur | Alpes-Maritimes (06) |
| 30 | Pierre Karleskind | 44 | Député européen depuis 2019, président de la commission de la Pêche au Parlement européen | Finistère (29) |
| 31 | Hélène Pollozec | 27 | Conseillère départementale de Mayotte | Mayotte (976) |
| 32 | Benjamin Djiane | 47 | Chef d’entreprise, membre du bureau exécutif de Renaissance | Calvados (14) |
| 33 | Rosa André | 52 | Conseillère municipale de Saint-Germain-en-Laye | Yvelines (78) |
| 34 | Phanit Siv | - | Directeur d’exploitation | Loir-et-Cher (41) |
| 35 | Yolène Pagès | 36 | Agricultrice et ingénieure agronome | Aveyron (12) |
| 36 | Aziz Skalli | 46 | Conseiller municipal de Bordeaux | Gironde (33) |
| 37 | Stéphanie Marquez | - | Conseillère municipale d’Ibos | Hautes-Pyrénées (65) |
| 38 | Pierre-Jean Baty | 32 | Conseiller régional d’Île-de-France | Paris (75) |
| 39 | Rebecca Breitman | 34 | Conseillère municipale de Strasbourg | Bas-Rhin (67) |
| 40 | Dimitri Oudin | 37 | Conseiller municipal de Reims | Marne (51) |
| 41 | Anne-Pascale Guédon | 57 | Directrice générale | Hauts-de-Seine (92) |
| 42 | Laurent Cappelletti | - | Conseiller municipal de Mauguio Carnon | Hérault (34) |
| 43 | Danielle Attias | - | Professeure | Rhône (69) |
| 44 | Moreani Frebault | - | Directeur général des services | Polynésie française (987) |
| 45 | Louise Coffineau | - | Conseillère politique environnement et climat dans une ONG | Belgique |
| 46 | Renan Mégy | 45 | Conseiller territoire du Premier ministre | Bouches-du-Rhône (13) |
| 47 | Cécile Prost | - | Dirigeante fondatrice de TPE | Isère (38) |
| 48 | Pierre-Luc Vervandier | - | Chargé de mission | Belgique |
| 49 | Karine Guguen | 50 | Agent de service de la fonction publique territoriale | Côtes-d’Armor (22) |
| 50 | Gaëtan Blaize | - | Directeur de développement commercial | Haute-Garonne (31) |
| 51 | Judith Dossemont | 55 | Conseillère municipale de Roquevair, conseillère départementale des Bouches-du-Rhône | Bouches-du-Rhône (13) |
| 52 | Arnaud Michel | - | Conseiller municipal d’Arras | Pas-de-Calais (62) |
| 53 | Valérie Rouverand | - | Conseillère municipale de Nîmes | Gard (30) |
| 54 | Victorien Leman | 34 | Maire de Rohan | Morbihan (56) |
| 55 | Martine Bouvard | - | Conseillère municipale de Roquebrune-sur-Argens | Var (83) |
| 56 | Philippe Grégoire | - | Cadre administratif | Vienne (86) |
| 57 | Claire Scotcher | - | Ancienne cadre | Pyrénées-Atlantiques (64) |
| 58 | Romain Atlante | - | Conseiller municipal de Levallois-Perret | Hauts-de-Seine (92) |
| 59 | Vanessa Duhamel | 53 | Conseillère municipale de Lille | Nord (59) |
| 60 | Loïc Guilpain | 37 | Enseignant en physique-chimie | Indre-et-Loire (37) |
| 61 | Hermine Mauzé | 38 | Cheffe d’entreprise | Ille-et-Vilaine (35) |
| 62 | Daniel N’Dao | 37 | Conseiller municipal de Remiremont | Vosges (88) |
| 63 | Ophély Massat | 30 | Conseillère municipale de Saverdun | Ariège (09) |
| 64 | Pierre Jakubowicz | 36 | Conseiller municipal de Strasbourg | Bas-Rhin (67) |
| 65 | Aurélie Trotin | 39 | Ingénieure commerciale | Hauts-de-Seine (92) |
| 66 | David Franck | - | Président du Conseil consulaire et conseiller des Français de l’étranger en Ukraine | Ukraine |
| 67 | Eva Attina | 19 | Etudiante | Ardennes (08) |
| 68 | Alain Bourcier | 67 | Maire de Gimouille | Nièvre (58) |
| 69 | Laëtitia Pichon | - | Conseillère municipale de Tassin-la-Demi-Lune | Rhône (69) |
| 70 | Erwan Crouan | 51 | Maire de Quéménéven | Finistère (29) |
| 71 | Pegah Malek-Ahmadi | 32 | Collaboratrice parlementaire | Paris (75) |
| 72 | Alexandre Folmer | 40 | Ingénieur | Moselle (57) |
| 73 | Valérie Gonzo-Massol | 54 | Conseillère départementale de Haute-Savoie, conseillère municipale d’Annecy | Haute-Savoie (74) |
| 74 | Jean Veil | 76 | Avocat, fils de Simone Veil | Paris (75) |
| 75 | Violette Spillebout | 51 | Députée du Nord, conseillère municipale de Lille | Nord (59) |
| 76 | Edouard Philippe | 53 | Ancien Premier ministre (2017-2020), maire du Havre, président d’Horizons, ancien député de Seine-Maritime (2012-2017) | Seine-Maritime (76) |
| 77 | Anne Le Gagne | 54 | Conseillère municipale de Saint-Malo | Ille-et-Vilaine (35) |
| 78 | François Bayrou | 73 | Haut-commissaire au plan, maire de Pau, président du MoDem, président du Parti démocrate européen, ancien ministre, ancien député européen (1999-2002), ancien député des Pyrénées-Atlantiques | Pyrénées-Atlantiques (64) |
| 79 | Caroline Ortiz | - | Cheffe d’entreprise | Haute-Savoie (74) |
| 80 | Stéphane Séjourné | 39 | Ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, secrétaire général de Renaissance, ancien député européen (2019-2024) | Vienne (86) |
| 81 | Elisabeth Borne | 63 | Députée du Calvados, ancienne Première ministre (2022-2024), ancienne ministre (2017-2022) | Calvados (14) |
Pour aller plus loin…
Découvrez les candidats des autres listes pour les élections européennes de 2024 en France :
Et découvrez nos autres articles sur les élections européennes de 2024 :
L’article Elections européennes 2024 : qui sont les candidats de la liste Renaissance ? est apparu en premier sur Touteleurope.eu.
10.05.2024 à 14:45
Elections européennes 2024 : qu’indiquent les sondages pour la France ?
Hugo Palacin

Alors que les principaux partis ont tous désigné leur tête de liste pour mener la campagne électorale, les sondages sur les élections européennes se succèdent. Autant de sources de satisfaction, d’inquiétude, d’espoir ou de mécontentement pour les candidats et les militants engagés dans cette campagne. Pour mieux s’y retrouver parmi les dizaines de sondages sur […]
L’article Elections européennes 2024 : qu’indiquent les sondages pour la France ? est apparu en premier sur Touteleurope.eu.
Texte intégral (5697 mots)
Alors que les principaux partis ont tous désigné leur tête de liste pour mener la campagne électorale, les sondages sur les élections européennes se succèdent. Autant de sources de satisfaction, d’inquiétude, d’espoir ou de mécontentement pour les candidats et les militants engagés dans cette campagne.
Pour mieux s’y retrouver parmi les dizaines de sondages sur les intentions de vote des Français, qui se succèdent en prévision des élections européennes, nous vous proposons cet agrégateur. Il permet de visualiser plus finement l’évolution des intentions de vote des Français, de sondage en sondage, jusqu’au scrutin, le 9 juin.
L’écart se creuse entre le RN et Renaissance
Depuis mai 2023, nous avons recensé 83 études d’opinion dans notre agrégateur de sondages. Des sondages dont la publication s’est intensifiée en janvier 2024, permettant d’observer plus finement et sur une période plus condensée l’évolution des intentions de vote pour les différentes listes candidates aux élections européennes. Depuis avril, la publication de nouvelles études d’opinion est quasi quotidienne.
Première observation, la liste du Rassemblement national (RN), menée par Jordan Bardella, a toujours fait la course en tête. Donné aux alentours de 25 % d’intentions de vote en mai 2023, le RN a depuis largement consolidé sa place de leader dans les sondages, dépassant désormais la barre des 30 %. Dans un sondage réalisé début mars pour le Huffington Post, YouGov plaçait même le parti lepéniste à 33 %.
De fait, l’écart avec la majorité présidentielle se creuse, la liste macroniste ne parvenant pas à progresser dans les sondages. Donnée à environ 19 % en mai 2023, elle a entamé une lente remontée avant de repasser sous la barre des 20 % courant novembre. Depuis, Renaissance et ses alliés baissent peu à peu : testée à partir de fin février dans les sondages, Valérie Hayer est donnée à environ 16 % d’intentions de vote. Elle était même créditée début mai de 15 % d’intentions de vote par Harris interactive, son score le plus faible.
Le PS se détache
La liste alliant le mouvement Place publique et le Parti socialiste (PS-PP) s’affirme depuis plusieurs semaines comme le troisième acteur de cette campagne. Donnée entre 9 et 10 % d’intentions de vote courant février, elle a lentement progressé, atteignant désormais 13,5 % en moyenne. Petit à petit, l’écart avec la majorité présidentielle s’est réduit. Début mai, Harris interactive plaçait la liste menée par Raphaël Glucksmann à 14 %, un point seulement derrière celle de Valérie Hayer (15 %).
Derrière le RN, Renaissance et les socialistes, plusieurs listes se tiennent dans un mouchoir de poche. Depuis les premiers sondages, Les Républicains (LR) naviguent autour des 7 % d’intentions de vote, sans vraiment décoller. La France insoumise (LFI), sondée au départ aux alentours de 10 %, a depuis chuté dans les études d’opinion et se stabilise désormais autour de 8 %.
La liste d’Europe Ecologie Les Verts, elle, a longtemps chuté dans les sondages. Au-dessus de la barre des 10 % l’été dernier, les écologistes sont tombés en-dessous des 6 % et peinent désormais à passer les 7 %. Reconquête, enfin, ne décolle pas : le parti d’Eric Zemmour alterne entre 5 et 6 % d’intentions de vote.
Ces 7 listes sont les seules à être constamment créditées de plus de 5 % des voix dans les sondages, ce qui leur permet d’espérer être représentées dans l’hémicycle européen à l’issue du scrutin. Le Parti communiste français (PCF) vient ensuite avec environ 3 % d’intentions de vote en moyenne, légèrement en-dessous du seuil (3 %) qui permet de voir une partie des frais de campagne de la liste remboursée, bien qu’il ne soit pas qualificatif.
Découvrez L’Essentiel des Européennes, notre newsletter qui récapitule les informations à ne pas manquer sur les élections européennes. Pour la recevoir chaque semaine, abonnez-vous gratuitement !
Notre méthodologie
Les listes présentes sur cette infographie sont celles qui sont testées dans les études d’opinion des instituts de sondage concernant les élections européennes de 2024. A chaque liste est attribuée une courbe. Celle-ci est obtenue par “rolling” : elle suit la moyenne des cinq derniers sondages en date et évolue donc à chaque nouvelle étude d’opinion publiée. Concrètement, si un parti a obtenu 24 %, 25 %, 26 % et 27 % d’intentions de vote lors des quatre derniers sondages et qu’un nouveau sondage le place à 28 %, sa courbe d’évolution se situera désormais à hauteur de 26 %, ce qui équivaut à la moyenne des cinq sondages.
Cette méthode permet de “lisser” les résultats des sondages successifs et d’éviter de trop grandes variations d’une étude d’opinion à l’autre. La tendance des intentions de vote pour chaque parti permet alors d’être observée plus finement, sur le moyen terme et non à plusieurs instants donnés, offrant ainsi une photographie plus large de l’évolution des intentions de vote des Français aux élections européennes du 9 juin 2024.
Sur l’infographie, les résultats des différentes listes pour chacun des sondages pris en compte sont consultables sous forme de points, au second plan. Ils peuvent ainsi être comparés avec la courbe d’évolution de la tendance d’intention de vote de chaque liste.
Pour aller plus loin…
Les sondages retenus dans cet agrégateur :
- 83. Euro-Rolling Ifop-Fiducial pour Le Figaro, LCI et Sud Radio, réalisé 6 au 9 mai 2024 auprès de 1 348 électeurs.
- 82. Euro-Rolling Ifop-Fiducial pour Le Figaro, LCI et Sud Radio, réalisé 3 au 7 mai 2024 auprès de 1 332 électeurs.
- 81. OpinionWay pour CNews, Europe 1, Le Journal du Dimanche, réalisé du 5 au 6 mai 2024 auprès de 1 026 électeurs.
- 80. Euro-Rolling Ifop-Fiducial pour Le Figaro, LCI et Sud Radio, réalisé 2 au 6 mai 2024 auprès de 1 323 électeurs.
- 79. Harris interactive et Toluna pour Challenges, M6 et RTL, réalisé du 30 avril au 3 mai 2024 auprès de 2 043 électeurs.
- 78. Elabe pour BFMTV et La Tribune Dimanche, réalisé du 30 avril au 3 mai 2024 auprès de 1 375 électeurs.
- 77. Euro-Rolling Ifop-Fiducial pour Le Figaro, LCI et Sud Radio, réalisé du 30 avril au 3 mai 2024 auprès de 1 358 électeurs.
- 76. Euro-Rolling Ifop-Fiducial pour Le Figaro, LCI et Sud Radio, réalisé du 29 avril au 2 mai 2024 auprès de 1 375 électeurs.
- 75. Cluster17 pour Le Point, réalisé du 29 avril au 1er mai 2024 auprès de 2 111 électeurs.
- 74. Eurotrack OpinionWay pour Les Echos et Radio Classique, réalisé du 29 au 30 avril 2024 auprès de 1 075 électeurs.
- 73. OpinionWay pour CNews, Europe 1, Le Journal du Dimanche, réalisé du 29 au 30 avril 2024 auprès de 1 009 électeurs.
- 72. Euro-Rolling Ifop-Fiducial pour Le Figaro, LCI et Sud Radio, réalisé du 26 au 30 avril 2024 auprès de 1 360 électeurs.
- 71. Euro-Rolling Ifop-Fiducial pour Le Figaro, LCI et Sud Radio, réalisé du 25 au 29 avril 2024 auprès de 1 345 électeurs.
- 70. Odoxa pour Public Sénat et la presse régionale, réalisé du 25 au 26 avril 2024 auprès de 916 électeurs.
- 69. Harris interactive et Toluna pour Challenges, M6 et RTL, réalisé du 24 au 26 avril 2024 auprès de 2 005 électeurs.
- 68. BVA Xsight pour RTL, réalisé du 25 au 26 avril 2024 auprès de 1 434 électeurs.
- 67. Euro-Rolling Ifop-Fiducial pour Le Figaro, LCI et Sud Radio, réalisé du 23 au 26 avril 2024 auprès de 1 345 électeurs.
- 66. Eurotrack OpinionWay pour Les Echos et Radio Classique, réalisé du 24 au 25 avril 2024 auprès de 1 011 électeurs.
- 65. Cluster17 pour Le Point, réalisé du 23 au 25 avril 2024 auprès de 1 767 électeurs.
- 64. Euro-Rolling Ifop-Fiducial pour Le Figaro, LCI et Sud Radio, réalisé du 21 au 25 avril 2024 auprès de 1 350 électeurs.
- 63. Ipsos pour le Cevipof, Le Monde, la Fondation Jean Jaurès et l’Institut Montaigne, réalisé du 19 au 24 avril 2024 auprès de 10 651 électeurs.
- 62. OpinionWay pour CNews, réalisé du 23 au 24 avril 2024 auprès de 1 007 électeurs.
- 61. Euro-Rolling Ifop-Fiducial pour Le Figaro, LCI et Sud Radio, réalisé du 20 au 24 avril 2024 auprès de 1 335 électeurs.
- 60. Euro-Rolling Ifop-Fiducial pour Le Figaro, LCI et Sud Radio, réalisé du 19 au 23 avril 2024 auprès de 1 335 électeurs.
- 59. Harris interactive et Toluna pour Challenges, M6 et RTL, réalisé du 19 au 22 avril 2024 auprès de 2 005 électeurs.
- 58. Euro-Rolling Ifop-Fiducial pour Le Figaro, LCI et Sud Radio, réalisé du 18 au 22 avril 2024 auprès de 1 339 électeurs.
- 57. Euro-Rolling Ifop-Fiducial pour Le Figaro, LCI et Sud Radio, réalisé du 16 au 19 avril 2024 auprès de 1 371 électeurs.
- 56. Eurotrack OpinionWay pour Les Echos et Radio Classique, réalisé du 17 au 18 avril 2024 auprès de 1 021 électeurs.
- 55. Euro-Rolling Ifop-Fiducial pour Le Figaro, LCI et Sud Radio, réalisé du 15 au 18 avril 2024 auprès de 1 376 électeurs.
- 54 OpinionWay pour CNews, réalisé du 16 au 17 avril 2024 auprès de 1 002 électeurs.
- 53. Euro-Rolling Ifop-Fiducial pour Le Figaro, LCI et Sud Radio, réalisé du 13 au 17 avril 2024 auprès de 1 364 électeurs.
- 52. Euro-Rolling Ifop-Fiducial pour Le Figaro, LCI et Sud Radio, réalisé du 12 au 16 avril 2024 auprès de 1 349 électeurs.
- 51. Harris interactive et Toluna pour Challenges, M6 et RTL, réalisé du 12 au 15 avril 2024 auprès de 2 005 électeurs.
- 50. Euro-Rolling Ifop-Fiducial pour Le Figaro, LCI et Sud Radio, réalisé du 11 au 15 avril 2024 auprès de 1 326 électeurs.
- 49. Euro-Rolling Ifop-Fiducial pour Le Figaro, LCI et Sud Radio, réalisé du 9 au 12 avril 2024 auprès de 1 347 électeurs.
- 48. Cluster17 pour Le Point, réalisé du 9 au 11 avril 2024 auprès de 1 782 électeurs.
- 47. Ipsos pour Radio France et Le Parisien, réalisé du 10 au 11 avril 2024 auprès de 1 500 électeurs.
- 46. Euro-Rolling Ifop-Fiducial pour Le Figaro, LCI et Sud Radio, réalisé du 8 au 11 avril 2024 auprès de 1 355 électeurs.
- 45. Euro-Rolling Ifop-Fiducial pour Le Figaro, LCI et Sud Radio, réalisé du 6 au 10 avril 2024 auprès de 1 343 électeurs.
- 44. Euro-Rolling Ifop-Fiducial pour Le Figaro, LCI et Sud Radio, réalisé du 5 au 9 avril 2024 auprès de 1 335 électeurs.
- 43. YouGov pour le Huffington Post, réalisé du 3 au 9 avril 2024 auprès de 1 028 électeurs.
- 42. Harris interactive et Toluna pour Challenges, M6 et RTL, réalisé du 5 au 8 avril 2024 auprès de 2 018 électeurs.
- 41. Euro-Rolling Ifop-Fiducial pour Le Figaro, LCI et Sud Radio, réalisé du 4 au 8 avril 2024 auprès de 1 343 électeurs.
- 40. OpinionWay pour CNews, réalisé du 3 au 5 avril 2024 auprès de 1 509 électeurs.
- 39. Elabe pour BFM TV et La Tribune Dimanche, réalisé du 2 au 4 avril 2024 auprès de 1 391 électeurs.
- 38. Harris interactive et Toluna pour Challenges, M6 et RTL, réalisé du 28 au 29 mars 2024 auprès de 1 976 électeurs.
- 37. BVA Xsight pour RTL, réalisé du 27 au 28 mars 2024 auprès de 1 398 électeurs.
- 36. Harris interactive et Toluna pour Challenges, M6 et RTL, réalisé du 22 au 25 mars 2024 auprès de 2 027 électeurs.
- 35. Ifop-Fiducial pour LCI, Le Figaro et Sud Radio, réalisé du 19 au 20 mars 2024 auprès de 1 112 électeurs.
- 34. Harris interactive et Toluna pour Challenges, M6 et RTL, réalisé du 15 au 18 mars 2024 auprès de 2 124 électeurs.
- 33. Eurotrack OpinionWay pour Les Echos et Radio Classique, réalisé du 13 au 14 mars 2024 auprès de 1 008 électeurs.
- 32. Cluster17 pour Le Point, réalisé du 8 au 9 mars 2024 auprès de 1 399 électeurs.
- 31. YouGov pour le Huffington Post, réalisé du 26 février au 7 mars 2024 auprès de 1 008 électeurs.
- 30. Elabe pour BFM TV et La Tribune Dimanche, réalisé du 5 au 7 mars 2024 auprès de 1 397 électeurs.
- 29. Ipsos pour le Cevipof, Le Monde, la Fondation Jean Jaurès et l’Institut Montaigne, réalisé du 1er au 6 mars 2024 auprès de 11 770 électeurs.
- 28. Ipsos pour Euronews, réalisé du 23 février au 5 mars 2024 auprès de 2 000 électeurs
- 27. Ifop pour Le Journal du Dimanche, réalisé du 29 février au 1er mars 2024 auprès de 1 111 électeurs.
- 26. BVA pour RTL, réalisé du 27 au 28 février 2024 auprès de 1 344 électeurs.
- 25. Odoxa pour Public Sénat et la presse régionale, réalisé du 21 au 22 février 2024 auprès de 939 électeurs.
- 24. Eurotrack OpinionWay pour Les Echos et Radio Classique, réalisé du 14 au 15 février 2024 auprès de 1 009 électeurs.
- 23. Elabe pour BFM TV et La Tribune Dimanche, réalisé du 7 au 9 février 2024 auprès de 1 426 électeurs.
- 22. Ifop-Fiducial pour LCI, Le Figaro et Sud Radio, réalisé du 7 au 8 février 2024 auprès de 1 356 électeurs. Hypothèse retenue pour cet article : “Valérie Hayer tête de liste Renaissance”.
- 21. YouGov pour le Huffington Post, réalisé du 29 janvier au 7 février 2024 auprès de 1 001 électeurs.
- 20. Eurotrack OpinionWay pour Les Echos et Radio Classique, réalisé du 17 au 18 janvier 2024 auprès de 1 019 électeurs.
- 19. Ifop pour Le Nouvel Economiste, réalisé du 16 au 17 janvier 2024 auprès de 1 348 électeurs.
- 18. YouGov pour le Huffington Post, réalisé du 8 au 15 janvier 2024 auprès de 1 004 électeurs.
- 17. Ifop pour L’Itinérant, réalisé du 12 au 15 janvier 2024 auprès de 875 électeurs. Hypothèse retenue : “Olivier Véran tête de liste de la majorité présidentielle”.
- 16. Harris interactive pour Challenges, réalisé du 12 au 15 janvier 2024 auprès de 1 030 électeurs.
- 15. Cluster17 pour Le Point, réalisé du 13 au 14 janvier 2024 auprès de 1 955 électeurs.
- 14. Elabe pour BFMTV et La Tribune Dimanche, réalisé du 10 au 12 janvier 2024 auprès de 1 400 électeurs.
- 13. Odoxa pour Public Sénat et la presse régionale, réalisé du 13 au 14 décembre 2023 auprès de 913 électeurs.
- 12. Eurotrack OpinionWay pour Les Echos et Radio Classique, réalisé du 13 au 14 décembre 2023 auprès de 1 005 électeurs.
- 11. Ipsos pour Le Monde et le Cevipof, réalisé du 29 novembre au 12 décembre 2023 auprès de 11 691 électeurs.
- 10. Ifop-Fiducial pour Sud Radio, réalisé du 8 au 11 décembre 2023 auprès de 1 062 électeurs.
- 9. Eurotrack OpinionWay pour Les Echos et Radio Classique, réalisé du 15 au 16 novembre 2023 auprès de 1 004 électeurs.
- 8. Ipsos pour La Tribune Dimanche, réalisé du 9 au 10 novembre 2023 auprès de 1 412 électeurs. Hypothèse retenue : “Stéphane Séjourné tête de liste Renaissance”.
- 7. Ifop-Fiducial pour Le Figaro et Sud Radio, réalisé du 11 au 12 octobre 2023 auprès de 1 375 électeurs. Hypothèse retenue : “Stéphane Séjourné tête de liste Renaissance”.
- 6. Ifop-Fiducial pour le Journal du Dimanche et Sud Radio, réalisé du 30 au 31 août 2023 auprès de 1 026 électeurs. Hypothèse retenue : “NUPES listes séparées”.
- 5. Ifop-Fiducial pour Sud Radio, réalisé du 4 au 5 juillet 2023 auprès de 921 électeurs.
- 4. Ipsos pour Le Monde et le Cevipof, réalisé du 16 au 26 juin 2023 auprès de 10 631 électeurs. Hypothèse retenue : “NUPES listes séparées”.
- 3. Elabe pour L’Opinion, réalisé du 19 au 21 juin 2023 auprès de 1 397 électeurs. Hypothèse retenue : “NUPES listes séparées”.
- 2. Cluster17 pour Le Point, réalisé du 17 au 19 mai 2023 auprès de 1 760 électeurs. Hypothèse retenue : “NUPES listes séparées”.
- 1. Ifop-Fiducial pour le Journal du Dimanche et Sud Radio, réalisé du 10 au 12 mai 2023 auprès de 1 310 électeurs. Hypothèse retenue : “NUPES listes séparées”.
Les listes testées dans les sondages et leurs sigles :
AR : L’Alliance rurale (liste menée par Jean Lassalle, qui a remplacé Willy Schraen)
Aut. : Autres listes/partis
DLF : Debout la France (liste initialement menée par Nicolas Dupont-Aignan, ayant finalement annoncé son retrait de la campagne des élections européennes)
EAC : Ecologie au centre (liste menée par Jean-Marc Governatori)
EELV : Europe Ecologie Les Verts (liste menée par Marie Toussaint)
EPT : Ecologie positive et Territoires (liste menée par Yann Wehrling)
LFI : La France insoumise (liste menée par Manon Aubry)
LO : Lutte ouvrière (liste menée par Nathalie Arthaud)
LP : Les Patriotes (liste menée par Florian Philippot)
LR : Les Républicains (liste menée par François-Xavier Bellamy)
ND : Nouvelle Donne (liste menée par Pierre Larrouturou)
NE : Notre Europe (liste menée par Jean-Christophe Fromantin)
NPA : Nouveau parti anticapitaliste (liste menée par Selma Labib)
PA : Parti animaliste (liste menée par Hélène Thouy)
PCF : Parti communiste français (liste menée par Léon Deffontaines)
PRG : Parti radical de gauche (liste menée par Guillaume Lacroix, avec Régions et peuples solidaires, et Volt France)
PP : Parti pirate (liste menée par Caroline Zorn)
PS - PP : Parti socialiste et Place publique (liste menée par Raphaël Glucksmann)
Rec. : Reconquête ! (liste menée par Marion Maréchal)
Ren. : Renaissance, avec le Mouvement démocrate, Horizons, le Parti radical et l’Union des démocrates et indépendants (liste menée par Valérie Hayer)
Res. : Résistons ! (liste initialement menée par Jean Lassalle, qui a finalement rejoint la campagne de l’Alliance rurale)
RN : Rassemblement national (liste menée par Jordan Bardella)
UPR : Union populaire républicaine (liste menée par François Asselineau)
L’article Elections européennes 2024 : qu’indiquent les sondages pour la France ? est apparu en premier sur Touteleurope.eu.
10.05.2024 à 14:06
Hugo Palacin

L’Arc de Triomphe à Paris, mais aussi le Colisée de Rome, la Grand-Place de Bruxelles ou encore la Puerta del Sol de Madrid. Ces mercredi 8 et jeudi 9 mai, des dizaines de monuments situés aux quatre coins du Vieux continent se sont parés des couleurs de l’Union européenne. Une date qui ne doit rien […]
L’article [Diaporama] Journée de l’Europe : des bâtiments emblématiques, dont l’Arc de Triomphe, illuminés aux couleurs de l’Europe est apparu en premier sur Touteleurope.eu.
Texte intégral (1956 mots)

L’Arc de Triomphe à Paris, mais aussi le Colisée de Rome, la Grand-Place de Bruxelles ou encore la Puerta del Sol de Madrid. Ces mercredi 8 et jeudi 9 mai, des dizaines de monuments situés aux quatre coins du Vieux continent se sont parés des couleurs de l’Union européenne.
Une date qui ne doit rien au hasard, puisque ce 9 mai était célébrée la Journée de l’Europe. Celle-ci marque chaque année l’anniversaire de la “déclaration Schuman”, qui a exposé le 9 mai 1950 l’idée d’une nouvelle forme de coopération politique en Europe, pour éviter toute guerre entre les nations européennes. Cette proposition est considérée comme la naissance de ce qui est aujourd’hui l’Union européenne.
Mais ce 9 mai marquait aussi le début d’un compte à rebours. Dans un mois, le 9 juin, on connaîtra la composition du nouveau Parlement européen après que 380 millions de citoyens des 27 Etats membres auront été appelés aux urnes du 6 au 9 juin. L’occasion parfaite pour faire passer un double message, de célébration de la construction européenne et d’incitation au vote.
Découvrez les différentes illuminations en photos
“Avec ces illuminations qui se déroulent dans des villes de tout le continent, le Parlement européen et les autorités nationales et locales ont envoyé un message de rassemblement à 440 millions de citoyens européens, soulignant l’importance de ces élections européennes pour l’avenir de chacun”, indique le Parlement européen dans un communiqué de presse.
Outre le drapeau européen, le slogan du Parlement européen “Utilisez votre voix”, décliné dans les 24 langues officielles de l’UE, était largement diffusé sur les façades des différents bâtiments à l’occasion de ces illuminations.
L’article [Diaporama] Journée de l’Europe : des bâtiments emblématiques, dont l’Arc de Triomphe, illuminés aux couleurs de l’Europe est apparu en premier sur Touteleurope.eu.
07.05.2024 à 19:08
Hugo Palacin

Un programme et une liste pour Renaissance C’est leur projet. Les drapeaux européens et français sur sa droite, le visage d’Emmanuel Macron à ses côtés, projeté en fond sur sa gauche. Lundi 6 mai, la cheffe de file des centristes français, Valérie Hayer, a présenté son programme aux journalistes. La liste “Besoin d’Europe” défendra 48 […]
L’article L’Essentiel des Européennes #11 - Renaissance révèle son programme | Les Espagnols sur la ligne de départ | Les propositions de Marie Toussaint est apparu en premier sur Touteleurope.eu.
Texte intégral (6486 mots)
Pour recevoir cette newsletter sur les élections européennes chaque mercredi, abonnez-vous gratuitement !

Un programme et une liste pour Renaissance
C’est leur projet. Les drapeaux européens et français sur sa droite, le visage d’Emmanuel Macron à ses côtés, projeté en fond sur sa gauche. Lundi 6 mai, la cheffe de file des centristes français, Valérie Hayer, a présenté son programme aux journalistes. La liste “Besoin d’Europe” défendra 48 propositions durant cette campagne. Autant de mesures qui sont “les meilleures pour lutter contre les risques sécuritaire et migratoire, les risques climatique et économique, et les risques sur nos valeurs”, a défendu celle qui préside aussi le groupe libéral Renew au Parlement européen.
3 priorités. Comme premier combat, la liste de la majorité présidentielle entend “faire de l’Europe une puissance forte, sûre et indépendante”. Valérie Hayer et ses colistiers veulent créer un fonds de soutien aux industries de défense et mobiliser 100 milliards d’euros dans ce domaine. La seconde bataille des macronistes : “faire de l’Europe une puissance écologique, économique et sociale”. Un “plan Europe 2030” de 1 000 milliards financé par un emprunt commun doit par exemple permettre de développer l’énergie nucléaire, la production de vaccins ou encore les véhicules propres. Enfin, la majorité présidentielle compte “défendre le modèle européen et nos valeurs”, ce qui passe par l’inscription de l’IVG dans la Charte européenne des droits fondamentaux ou une majorité numérique à 15 ans sur les réseaux sociaux.
Liste bouclée. Comme ses concurrentes, la liste “Besoin d’Europe” s’appuiera sur 81 candidats, dont on connaît désormais tous les noms depuis ce mardi. Juste derrière Valérie Hayer, on retrouve surtout des eurodéputés sortants : l’ancien journaliste Bernard Guetta (2e position), actif sur les questions diplomatiques, et la spécialiste du commerce international et de l’emploi, Marie-Pierre Vedrenne (3e). La présence à la quatrième place du président de la commission de l’Environnement au Parlement européen, Pascal Canfin, marque le soutien renouvelé des macronistes au Pacte vert. Toujours sur cette liste, suivent la cheffe de la sous-commission Sécurité et défense, Nathalie Loiseau (5e) et Sandro Gozi (6e), responsable des questions institutionnelles pour son groupe. Enfin, les ténors de la majorité ferment la marche à des positions inéligibles, avec la présence du patron du MoDem François Bayrou (78e), des anciens Premiers ministres Edouard Philippe (76e) et Elisabeth Borne (81e), ainsi que celle du ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, Stéphane Séjourné (80e).
L’extrême droite lève le voile sur ses candidats
Deux listes. La semaine passée, Reconquête et le Rassemblement national ont dévoilé les noms des candidats figurant en haut de leur liste respective pour les élections européennes du 9 juin. Les trombinoscopes diffèrent à certains égards, le RN entendant notamment renforcer sa “normalisation” en investissant des personnalités plus consensuelles, quand Reconquête mise sur des candidats polémiques, pour certains hérauts de la “fachosphère”. Mais les mouvances nationalistes, voire d’ultra-droite, n’en demeurent pas moins très bien représentées dans les deux cas.
Ingrédients. En marge de son traditionnel rassemblement du 1er mai, le parti à la flamme a annoncé l’identité de ses 35 premiers candidats. Un savant mélange de continuité, avec l’investiture de 10 eurodéputés sortants, de renouvellement, avec la présence de nombreux élus locaux, et d’ouverture, en positionnant des néophytes de la politique à des places éligibles. Derrière le trio de tête Jordan Bardella - Malika Sorel - Fabrice Leggeri, annoncé depuis des semaines, on retrouve notamment le directeur général du RN Gilles Pennelle au 15e rang, le maire de Beaucaire (Gard) Julien Sanchez en 17e position, ou encore le chef du Rassemblement national de la Jeunesse, Pierre-Romain Thionnet, en 23e place.
En famille. Chez Reconquête, on se cantonne pour l’instant aux 12 premiers noms (au moment de l’envoi de votre newsletter, le parti dévoile ses autres candidats). Là aussi, les investitures de Marion Maréchal, tête de liste, Guillaume Peltier (2e) et le sortant Nicolas Bay (4e), étaient connues depuis des semaines. Sarah Knafo, conseillère politique et compagne d’Eric Zemmour, fondateur du parti, vient s’intercaler entre eux au 3e rang. La présidente du Mouvement conservateur, Laurence Trochu, arrive ensuite (5e), devant le président de Génération Z, Stanislas Rigault (6e). Deux figures, connues pour leurs récurrentes sorties polémiques sur les réseaux sociaux et dans les médias, suivent après : Jean Messiha (8e) et le cofondateur de Génération identitaire, Damien Rieu (12e).
Dans le reste de l’actu en France
Dimanche, pour la première fois depuis le début de la campagne, le chef de file du RN, Jordan Bardella, a accepté de débattre avec ses principaux concurrents. Réunis lors d’un “Grand Jury” spécial organisé par RTL, Le Figaro, Paris Première et M6, les leaders des sept premières listes dans les sondages ont débattu, deux heures durant, au rythme de quatre thèmes centraux : la défense européenne, le défi écologique, l’immigration et la guerre économique face à la Chine et aux Etats-Unis. Une confrontation à revoir ici.
Depuis ce lundi, 9 heures, les candidats peuvent officiellement déclarer la participation de leur liste aux élections européennes de 2024 en la déposant auprès du ministère de l’Intérieur. Certains partis s’y sont pris dès ce début de semaine, à l’image des socialistes, des insoumis ou encore de Lutte ouvrière. Une étape obligatoire pour espérer concourir au scrutin du 9 juin. La période de dépôt des listes s’étend jusqu’au vendredi 17 mai à 18 heures. Tous les détails sont à retrouver dans notre article.
Présidente de la sous-commission Sécurité et Défense du Parlement européen au cours de la mandature qui s’achève, Nathalie Loiseau (Renew Europe) se verrait bien conserver cette fonction, indique Politico. Et ce même si cette sous-commission pourrait changer de stature et devenir une commission à part entière, également en charge de l’industrie de l’armement et de la lutte contre les ingérences étrangères. Pour le média européen, que la France tienne à cette présidence est logique compte tenu de son rang de première puissance militaire européenne.
La tête de liste Renaissance, Valérie Hayer, et ses colistiers se voient amputés de temps d’antenne au profit du chef de l’Etat. L’Arcom (l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique) a indiqué jeudi que le discours d’Emmanuel Macron à la Sorbonne sur l’Europe devrait être intégralement décompté du temps de parole pour le camp présidentiel par les médias audiovisuels qui l’ont retransmis.
Manon Aubry accélère. A moins de cinq semaines du scrutin et alors que les projecteurs étaient braqués depuis plusieurs jours sur sa colistière et visage de la cause palestinienne, Rima Hassan, la tête de liste insoumise entend relancer sa campagne. Au programme notamment, deux grands meetings avec des figures de LFI. Un premier lundi 13 mai à Amiens en présence du député François Ruffin, puis un autre le samedi 25 mai à Paris, cette fois-ci aux côtés du leader insoumis, Jean-Luc Mélenchon.
Le Centre jette l’éponge. Unis sous bannière commune, le maire divers droite de Neuilly-sur-Seine, Jean-Christophe Fromantin, et le sénateur du Tarn, Philippe Folliot, renoncent finalement à présenter une liste aux élections européennes. Dans les différents sondages, leur candidature était créditée au mieux de 0,5 % d’intentions de vote. Les deux élus ambitionnent toutefois d’unir leurs formations politiques respectives, Territoires en mouvement et l’Alliance centriste, pour de futurs combats.

Les candidats espagnols sur la ligne de départ
Girl power. En Espagne, les élections européennes sont surtout une affaire de femmes. Le Parti socialiste ouvrier espagnol (PSOE, gauche) au pouvoir et le Parti populaire (PP, droite) ont dévoilé la semaine dernière leurs listes de candidats pour le scrutin qui se tiendra le 9 juin dans le pays. Les deux principales formations ibériques ont comme point commun d’avoir décidé de mettre en avant des figures féminines de leur camp pour mener campagne.
Figures. Le PSOE a confié la tête de sa liste à Teresa Ribera, troisième vice-présidente du gouvernement socialiste et ministre de la Transition écologique depuis 2018. Sa dauphine est une figure du Parlement européen, en la personne d’Iratxe García Pérez, eurodéputée depuis 2004 et présidente du groupe des socialistes et démocrates (S&D) à Strasbourg. La liste du PSOE fait la part belle aux sortants, puisque 13 des 21 eurodéputés élus en 2019 sont investis candidats, quasiment tous en positions éligibles.
La droite en forme. Côté Parti populaire, c’est l’eurodéputée Dolors Montserrat, vice-présidente du groupe PPE au Parlement européen et ancienne ministre de la Santé espagnole, qui a été intronisée cheffe de file. Elle forme avec ses deux colistières suivantes (Carmen Crespo et Alma Ezcurra, élues régionales de l’autre côté des Pyrénées) un trio féminin qui entend infliger une déroute électorale aux socialistes au pouvoir. Tous les sondages donnent le Parti populaire victorieux, remportant environ 25 des 61 sièges dont bénéficiera l’Espagne à l’issue du scrutin, tandis que le PSOE en récolterait 18. Derrière, les nationalistes de Vox et la coalition de gauche Sumar pourraient envoyer 6 élus chacun à Strasbourg. Les sièges restants seraient répartis entre des listes candidates à faibles scores.
Dans le reste de l’actu en Europe
L’affaire secoue l’Allemagne. L’eurodéputé et candidat Matthias Ecke a été sévèrement agressé vendredi alors qu’il collait des affiches de campagne, à Dresde. Rétabli après un passage à l’hôpital, le socialiste a reçu de nombreux messages de soutien des quatre coins du continent. Plusieurs jeunes hommes sont suspectés par les autorités, dont au moins un se classe à l’extrême droite.
Toujours en Allemagne, les chrétiens-démocrates de la CDU viseraient une coalition avec les socialistes et les centristes au Parlement européen pour soutenir leur candidate à la présidence de la Commission, Ursula von der Leyen, fait savoir Euractiv. De leur côté, les socialistes européens ont signé samedi une déclaration commune promettant de ne jamais former d’alliance avec les deux groupes d’extrême droite (CRE et ID).
Plus petit pays de l’Union européenne, Malte compte 39 candidats, pour 6 sièges, dont la présidente du Parlement européen, Roberta Metsola.
Direction l’est du continent, où des figures historiques ne se représentent pas. Certains eurodéputés polonais arrivés sur les bancs de l’hémicycle en même temps que la Pologne faisait son entrée dans l’UE en 2004 raccrochent le costume, 20 ans après leur première élection. Le conservateur Jerzy Buzek fait ainsi ses adieux au Parlement européen, qu’il avait présidé entre 2009 et 2012.
Elle aussi est arrivée dans l’UE en 2004. En Hongrie, le challenger du Premier ministre nationaliste Viktor Orbán a tenu un grand rassemblement antigouvernemental dimanche. On reste en Europe orientale. Selon un sondage local en Roumanie, l’alliance entre les socialistes et les libéraux-conservateurs arriverait largement en tête à Bucarest, enregistrant 48 % des intentions de vote. La coalition de centre droit se classerait en seconde position dans la capitale (24 %), devant l’extrême droite (10 %). Un symbole de l’écart qui sépare le monde urbain des campagnes : à l’échelle du pays, les nationalistes arriveraient plutôt en seconde position. On vous parlait de la situation en Roumanie dans la 5e édition de notre newsletter.

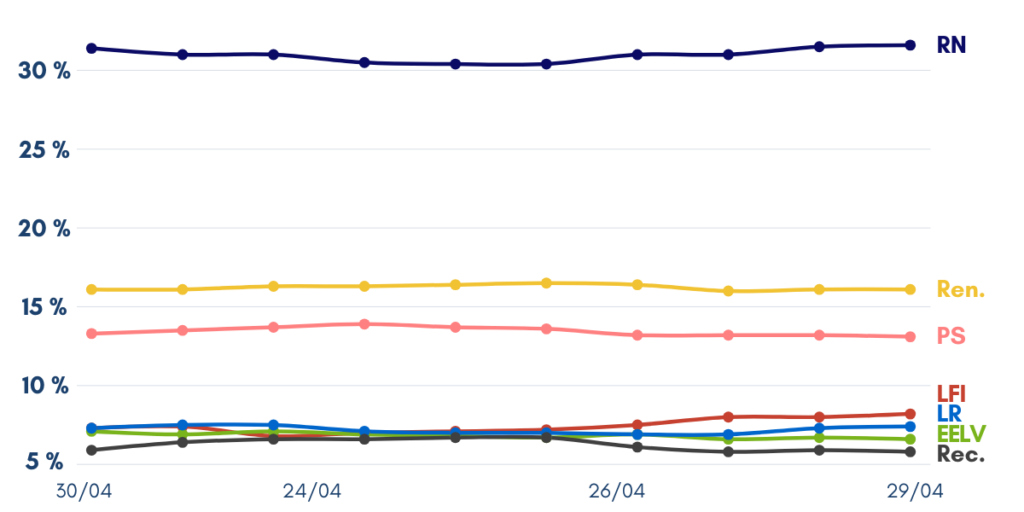
A l’approche du scrutin, les tendances des intentions de vote se cristallisent pour les différentes listes. Les moyennes du RN (31,6 %), de la majorité présidentielle (16,1 %) et du PS-Place publique (13,1 %) ne varient qu’à la marge par rapport à la semaine dernière.
LFI, en revanche, remonte, passant de 7,4 % d’intentions de vote en moyenne la semaine dernière, à 8,2 % désormais. Chemin inverse pour Les Ecologistes, donnés à 7,3 % lors du dernier point hebdomadaire, contre 6,6 % aujourd’hui. Les Républicains (7,4 %) et Reconquête (5,8 %) restent, eux, stables.
Agenda
- Mardi 7 mai, 18h30 : meeting de Jordan Bardella (RN) à la salle L’Agora à Saint-Avold (Moselle).
- Mardi 7 mai, 19 heures : meeting de Valérie Hayer (Renaissance) à la Maison de la Mutualité à Paris (5e arrondissement).
- Jeudi 9 mai : Journée de l’Europe. Illumination de bâtiments emblématiques dans les Etats membres pour promouvoir les élections européennes de juin.
- Vendredi 10 mai, 19h30 : réunion publique de Marion Maréchal (Reconquête) à la Halle au Beurre de Forges-les-Eaux (Seine-Maritime).
- Lundi 13 mai, 18 heures : meeting de Raphaël Glucksmann (PS-Place publique) au Pavillon de Buxerolles à Limoges (Haute-Vienne).
- Lundi 13 mai, 19 heures : meeting de Manon Aubry (LFI) au Mégacité d’Amiens (Somme).
- Mardi 14 mai, 19 heures : meeting de Raphaël Glucksmann (PS-Place publique) à la salle Louis Aragon de Camon (Somme).


Peu nombreux sont les eurodéputés à avoir eu l’honneur d’être incarnés au cinéma. Elu au Parlement européen de 2009 à 2019, José Bové fait désormais partie de ce cercle très restreint. Dans Une affaire de principe, sorti le 1er mai, l’acteur belge Bouli Lanners se pare en effet de la moustache et de la pipe du célèbre parlementaire.
Tourné en partie dans les couloirs de l’hémicycle strasbourgeois, le film retrace l’enquête menée par des eurodéputés écologistes, dont José Bové, après la démission du commissaire européen à la Santé John Dalli en 2012. Soupçonné de corruption liée à l’industrie du tabac, le Maltais était pourtant très impliqué dans la lutte contre le tabagisme.
A quelques semaines des élections européennes, le film donne une image courageuse de l’action des eurodéputés et de leurs équipes, à l’instar de Fabrice, l’assistant parlementaire interprété par Thomas VDB. De nombreuses scènes permettent aussi de faire un peu de pédagogie sur le fonctionnement de l’institution. Ainsi, on découvre au fil des du récit les rouages du Parlement européen, en même temps que Clémence, une jeune stagiaire incarnée par Céleste Brunnquell.

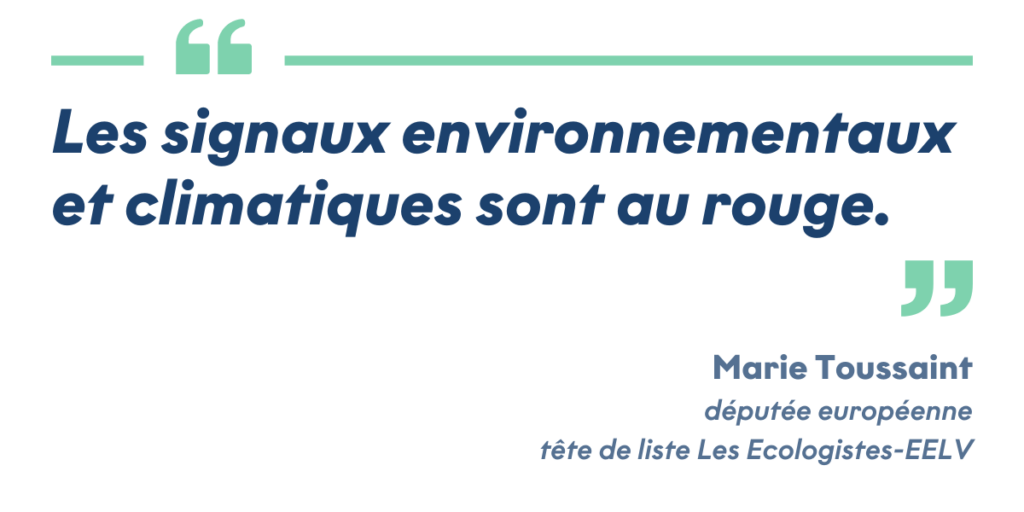
Tirée de la préface du programme des écologistes dévoilé il y a quelques jours, notre phrase de la semaine est signée Marie Toussaint. La tête de liste EELV porte un programme de plus de 170 pages, construit autour de 9 chapitres “pour un Etat providence écologique européen”.
Elle propose par exemple “un droit de veto social européen”, selon lequel toute nouvelle législation de l’UE devra faire l’objet d’une étude de son impact sur les plus pauvres. Les écologistes veulent aussi un “Fonds de souveraineté écologique” adossé à la Banque européenne d’investissement (BEI) afin de prendre le contrôle des entreprises fossiles les plus polluantes. Ils proposent par ailleurs de verdir la politique agricole commune (PAC) et d’atteindre 100 % d’énergies renouvelables en 2040.
Les Verts souhaitent adopter une directive européenne anti‐discrimination pour lutter contre toutes les formes de ségrégation, dont celles fondées sur le handicap et le racisme, mais aussi rouvrir le dossier du Pacte asile et migration pour renforcer la solidarité d’accueil entre les Etats membres. Côté institutions, Marie Toussaint et ses colistiers entendent mettre fin à la règle de l’unanimité des Etats membres au Conseil de l’UE, notamment dans les affaires fiscales, et donner un droit d’initiative législative aux eurodéputés, aujourd’hui réservé à la Commission européenne.

1 sur 4
Un député européen sur quatre a déclaré une activité rémunérée en dehors de son indemnité parlementaire lors de la législature 2019-2024. C’est l’un des principaux enseignements du rapport de l’ONG Transparency International UE, publié lundi, qui s’appuie sur les déclarations d’intérêts publiques que ces élus sont obligés de remplir et de transmettre au Parlement européen.
Au total, les revenus annexes générés par l’ensemble des eurodéputés représente environ 8,7 millions d’euros par an. Parmi les dix parlementaires qui récoltent le plus de revenus en parallèle de leur mandat, on retrouve en 2e position Jérôme Rivière, ancien élu du RN qui siège aujourd’hui parmi les non-inscrits. Il a perçu 220 000 euros par an au cours de ses cinq années de mandat, comme dirigeant d’entreprises. 8e de la liste, Geoffroy Didier (LR, PPE) a quant à lui gagné près de 115 000 euros par an en travaillant pour le compte du cabinet d’avocats CARLARA, en parallèle de son mandat d’eurodéputé.
Pour rappel, l’exercice de fonctions ou de professions annexes est légalement compatible avec le mandat de député européen. Durant la législature, tous les eurodéputés gagnent une indemnité d’environ 10 000 euros brut mensuels, donc avant impôts, “en tant que représentants des citoyens européens”, note pour sa part Transparency International UE. “Pourtant, une grande majorité d’entre eux consacrent encore du temps à des emplois annexes, qu’ils soient rémunérés ou non”. Une situation qui “brouille les frontières entre intérêts personnels et priorités politiques”, dénonce l’ONG. A noter également, depuis le scandale du Qatargate, il est interdit pour les eurodéputés de s’engager dans “des activités de lobbying rémunérées qui sont en relation directe avec le processus décisionnel de l’Union”.

Journée de l’Europe
Cette année, le 9 mai est férié à l’occasion de l’Ascension. Mais depuis 1985, cette date est également l’occasion de célébrer la Journée de l’Europe.
Pour mieux en saisir l’origine, il faut remonter au 9 mai 1950. Le ministre français des Affaires étrangères Robert Schuman prononce alors un célèbre discours. Il propose de mettre en commun sous une autorité supranationale les productions française et allemande de charbon et d’acier. Ce projet donnera naissance l’année suivante à la CECA (Communauté européenne du charbon et de l’acier), l’ancêtre de l’Union européenne.
En 1985, les dirigeants européens font du 9 mai la Journée de l’Europe. Depuis, cette date est l’occasion chaque année d’évoquer l’Union européenne, ses réalisations et ses valeurs à travers de nombreuses festivités. Cette année, à l’approche des élections européennes, plus de 60 villes à travers l’Europe illumineront certains de leurs monuments aux couleurs du drapeau européen. A la tombée de la nuit, le Colisée à Rome, la Grand-Place à Bruxelles ou encore l’Arc de Triomphe à Paris se pareront de jaune et de bleu.
![[Quiz] Connaissez-vous… les groupes politiques dans lesquels siègent les eurodéputés français ?](https://www.touteleurope.eu/wp-content/uploads/2024/05/Quiz-NL-EE24-11-groupes-politiques-MEP-FR.png)
Si les députés européens sont généralement affiliés à des partis politiques dans leur pays, au Parlement européen, ils siègent au sein de groupes politiques transnationaux, regroupant des élus de différentes nationalités.
De La Gauche à Renew Europe en passant par les deux principaux, le Parti populaire européen (PPE) et l’Alliance progressiste des socialistes et démocrates (S&D) : saurez-vous indiquer dans quel groupe politique siège chaque eurodéputé français ? Testez vos connaissances avec notre quiz, ici.
Et découvrez ici tous nos autres quiz pour mesurer vos connaissances sur l’Union européenne.

Un classique pour terminer cette semaine. Ce 7 mai marque le 200e anniversaire de la célèbre symphonie n°9 de Beethoven. On vous propose d’écouter sa conclusion, “L’Ode à la joie”, devenue depuis l’hymne européen.
Envie d’en savoir plus ? Retrouvez l’intégralité de notre dossier sur les élections européennes !
L’article L’Essentiel des Européennes #11 - Renaissance révèle son programme | Les Espagnols sur la ligne de départ | Les propositions de Marie Toussaint est apparu en premier sur Touteleurope.eu.
07.05.2024 à 18:57
Elections européennes 2024 : qui sont les candidats de la liste Reconquête ?
Hugo Palacin

Pour sa première participation aux élections européennes, Reconquête mise sur des visages connus. Le parti, fondé en 2021 par le polémiste d’extrême droite Eric Zemmour, a confié la tête de sa liste à Marion Maréchal. A 34 ans, la petite-fille de Jean-Marie Le Pen et nièce de Marine Le Pen se lancera pour la première […]
L’article Elections européennes 2024 : qui sont les candidats de la liste Reconquête ? est apparu en premier sur Touteleurope.eu.
Texte intégral (3998 mots)

Pour sa première participation aux élections européennes, Reconquête mise sur des visages connus. Le parti, fondé en 2021 par le polémiste d’extrême droite Eric Zemmour, a confié la tête de sa liste à Marion Maréchal.
A 34 ans, la petite-fille de Jean-Marie Le Pen et nièce de Marine Le Pen se lancera pour la première fois dans la bataille des européennes. Elle tentera de retrouver des fonctions d’élue, elle qui a par le passé été députée du Vaucluse (2012-2017) et conseillère régionale de Provence-Alpes-Côte-d’Azur (2015-2017), avant de se mettre temporairement en retrait de la vie politique.
Guillaume Peltier, Sarah Knafo et Nicolas Bay bien placés
Derrière elle sur la liste de Reconquête, on retrouve deux vice-présidents exécutifs du parti nationaliste. Guillaume Peltier, ancien député du Loir-et-Cher (2017-2022), figure en 2e position. Il a par ailleurs été vice-président des Républicains, avant de rallier Eric Zemmour pour sa campagne présidentielle de 2022.
Nicolas Bay figure au 4e rang. Elu en 2019 au Parlement européen sur la liste du Rassemblement national, il a lui aussi quitté sa famille politique d’origine pour rallier Reconquête en 2022. Après avoir siégé parmi les non-inscrits à Strasbourg, il a récemment rejoint le groupe des Conservateurs et réformistes européens (CRE) au sein du Parlement européen. Il est le seul et premier eurodéputé français à siéger dans ce groupe.
Entre eux, en 3e place, on retrouve la compagne et conseillère politique d’Eric Zemmour, Sarah Knafo. A 31 ans, c’est la première fois qu’elle candidate à un scrutin.
Figures identitaires et nationalistes
La 5e position de la liste revient à Laurence Trochu, présidente du Mouvement conservateur, parti allié à Reconquête pour les élections européennes. Derrière elle, en 6e place, on retrouve une autre figure du parti d’Eric Zemmour : Stanislas Rigault. Agé de 24 ans, il préside “Génération Z”, le mouvement de jeunesse de Reconquête.
L’ancien haut-fonctionnaire Jean Messiha, polémiste d’extrême droite habitué des plateaux de télévision du groupe Bolloré, hérite quant à lui du 8e rang. Suivent trois conseillers régionaux : Sophie Grech (9e) et Philippe Vardon (10e), élus en Provence-Alpes-Côte-d’Azur, puis Eve Froger (11e), élue en Normandie. Damien Rieu, cofondateur du mouvement d’ultra-droite Génération identitaire, est au 12e rang.
Le reste de la liste est composé de nombreux responsables départementaux de Reconquête. Beaucoup étaient candidats de la formation nationaliste lors des élections législatives de 2022, tous ayant été battus. Le fondateur du parti, Eric Zemmour, occupe la symbolique 80e et avant-dernière place, tandis que l’ultime position revient à Evelyne Reybert, mère d’une des deux victimes de l’attentat de Romans-sur-Isère (Drôme), perpétré par un réfugié soudanais en avril 2020.
La liste des candidats de Reconquête
En gras figurent les eurodéputés sortants.
| N° | Candidat | Âge | Profession/Engagement | Département |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marion Maréchal | 34 | Vice-présidente exécutive de Reconquête, ancienne députée du Vaucluse (2012-2017) | - |
| 2 | Guillaume Peltier | 47 | Vice-président exécutif de Reconquête, conseiller départemental du Loir-et-Cher, ancien député du Loir-et-Cher (2017-2022) | - |
| 3 | Sarah Knafo | 31 | Conseillère politique d’Eric Zemmour, auditrice à la Cour des comptes | - |
| 4 | Nicolas Bay | 46 | Député européen depuis 2014, vice-président exécutif de Reconquête | - |
| 5 | Laurence Trochu | 50 | Présidente du Mouvement conservateur | Yvelines (78) |
| 6 | Stanislas Rigault | 24 | Président de Génération Z | - |
| 7 | Agnès Marion | 46 | Cheffe de cabinet de Marion Maréchal | Rhône (69) |
| 8 | Jean Messiha | 53 | Haut-fonctionnaire, polémiste | - |
| 9 | Sophie Grech | 38 | Conseillère régionale de Provence-Alpes-Côte-d’Azur, conseillère municipale de Marseille | Bouches-du-Rhône (13) |
| 10 | Philippe Vardon | 43 | Conseiller régional de Provence-Alpes-Côte-d’Azur, conseiller municipal de Nice | Alpes-Maritimes (06) |
| 11 | Eve Froger | 27 | Conseillère régionale de Normandie, conseillère municipale du Grand-Quevilly, assistante parlementaire de Nicolas Bay au Parlement européen | Seine-Maritime (76) |
| 12 | Damien Rieu | 34 | Cofondateur de Génération identitaire | - |
| 13 | Séverine Duminy | 47 | Professeur de mathématiques, responsable nationale du réseau Parents Vigilants | Nord (59) |
| 14 | Marc-Etienne Lansade | 50 | Maire de Cogolin | Var (83) |
| 15 | Emmy Font | 31 | Cheffe de cabinet d’Eric Zemmour | Bouches-du-Rhône (13) |
| 16 | Philippe Cuignache | 64 | Chef d’entreprise | Paris (75) |
| 17 | Marine Chiaberto | 37 | Responsable juridique | Isère (38) |
| 18 | Franck Manogil | 41 | Conseiller régional d’Occitanie | Hérault (34) |
| 19 | Elodie Weber | 50 | Professeur d’espagnol | - |
| 20 | Hilaire Bouyé | 24 | Vice-président de Génération Zemmour | - |
| 21 | Elisabeth Louvel | 42 | Juriste | Finistère (29) |
| 22 | Olivier Le Coq | 56 | Chef d’entreprise | Yvelines (78) |
| 23 | Lucy Georges | 54 | Conseillère municipale de Saint-Nicolas-de-Port | Meurthe-et-Moselle (54) |
| 24 | Arnaud Humbert | 52 | Chef d’entreprise | Deux-Sèvres (79) |
| 25 | Geneviève Pozzo di Borgo | 52 | Conseillère municipale de Nice | Alpes-Maritimes (06) |
| 26 | Franck Gaillard | 49 | Maire de Chaume-et-Courchamp | Côte-d’Or (21) |
| 27 | Paola Plantier | 43 | Assistante de direction | Guadeloupe (971) |
| 28 | Stéphane Blanchon | 49 | Conseiller régional d’Auvergne-Rhône-Alpes | Isère (38) |
| 29 | Sabine Clément | - | Coiffeuse | Yvelines (78) |
| 30 | Franck Chevrel | 56 | Chef d’entreprise | Morbihan (56) |
| 31 | Wendy Lonchampt | 30 | Conseillère municipale de Wissous | Essonne (91) |
| 32 | Sébastien Buard | 45 | Enseignant | Sarthe (72) |
| 33 | Corinne Giraud | 63 | Retraitée | Charente-Maritime (17) |
| 34 | David Meyer | 46 | Avocat | Paris (75) |
| 35 | Isabelle Gilbert | 59 | - | Paris (75) |
| 36 | Dany Bonnet | 33 | Chargé de développement | Gironde (33) |
| 37 | Sandrine Delatre | 49 | Mère au foyer | Vendée (85) |
| 38 | Serge Lévy | - | Antiquaire | Drôme (26) |
| 39 | Nathalie Ballerand | 61 | Consultante commerciale | Dordogne (24) |
| 40 | Xavier Fourboul | 37 | Chef de projet | Rhône (69) |
| 41 | Isabelle Lamarque | 56 | Gérante de société | Loiret (45) |
| 42 | Antoine Camus | 27 | Conseiller municipal de Saint-Apollinaire | Côte-d’Or (21) |
| 43 | Annick Pillot | 60 | Cadre dans l’aéronautique | Pyrénées-Atlantique (64) |
| 44 | Alexandre Zyzeck | - | Consultant | Bas-Rhin (67) |
| 45 | Florie Ansannay-Alex | - | Etudiante | Savoie (73) |
| 46 | Maurice Portiche | 77 | Ancien ambassadeur de France au Burkina Faso et au Laos | - |
| 47 | Pascale Deutsch | 61 | Conseillère municipale de Ouistreham | Calvados (14) |
| 48 | Cédric Torrens | 35 | Directeur d’agence immobilière | Tarn-et-Garonne (82) |
| 49 | Fabienne Marquet | 52 | Directrice dans la protection de données | Haute-Vienne (87) |
| 50 | Marc Taulelle | 70 | Conseiller municipal de Nîmes | Gard (30) |
| 51 | Maylis Perrot | 32 | Mère au foyer | Loire (42) |
| 52 | Antoine Baudino | 32 | Conseiller municipal de Berre-l’Etang | Bouches-du-Rhône (13) |
| 53 | Sabine Léger | 34 | Auxiliaire de puériculture | Loire-Atlantique (44) |
| 54 | Raymond Herbreteau | 74 | Maire des Ventes-de-Bourse | Orne (61) |
| 55 | Dominique Piussan | 62 | Professeure de harpe | Haute-Garonne (31) |
| 56 | Olivier Cleland | 57 | Dirigeant d’une exploitation agricole de céréales | Seine-Maritime (76) |
| 57 | Leïla Rosenstech | 45 | Mère au foyer | Ille-et-Vilaine (35) |
| 58 | Guy-Eric Imbert | 60 | Agent des douanes et pilote d’hélicoptère | Oise (60) |
| 59 | Corinne Berardo | 63 | Principale de collège | - |
| 60 | Jean Moucheboeuf | 42 | Conseiller municipal de Nice | Alpes-Maritimes (06) |
| 61 | Myriam Cadenel | 59 | Docteur en chirurgie dentaire | Alpes-de-Haute-Provence (04) |
| 62 | Praince Loubota | 36 | Commercial | Seine-Saint-Denis (93) |
| 63 | Anne-Marie Pinson | - | - | Creuse |
| 64 | Eric Laqua | 60 | Conseiller municipal de Lucé | Eure-et-Loir (28) |
| 65 | Nhu-Anh Do | - | Gérante de gîte | Yonne (89) |
| 66 | Jean-Luc Coronel de Boissezon | 56 | Professeur d’histoire du droit | - |
| 67 | Karin Hartmann | - | Conseillère municipale de Cagnes-sur-Mer | Alpes-Maritimes (06) |
| 68 | Arnaud Chapon | 55 | Bibliothécaire | Meuse (55) |
| 69 | Laure Pellier | 56 | Adjointe administrative | Drôme (26) |
| 70 | Florent Hammerschmitt | 29 | Assistant juridique | Moselle (57) |
| 71 | Caroline Hubert | 47 | Brigadier-chef de police | Vosges (88) |
| 72 | Alain Smith | - | Agent de médiation | La Réunion (974) |
| 73 | Claire-Emmanuelle Gauer | 32 | Conseillère régionale de Normandie | Orne (61) |
| 74 | Jean-Michel Lamberti | 60 | Commercial | Haute-Corse (2B) |
| 75 | Fanny Judek | 34 | Agent administratif | Pas-de-Calais (62) |
| 76 | Thierry Perret | 62 | Retraité | Jura (39) |
| 77 | Simone Benouadah | 50 | - | Val-de-Marne (94) |
| 78 | Yann Bompard | 37 | Maire d’Orange, conseiller départemental du Vaucluse | Vaucluse (84) |
| 79 | Ornella Evangelista | 33 | Responsable événementiel | Seine-Saint-Denis (93) |
| 80 | Eric Zemmour | 65 | Président et fondateur de Reconquête, candidat à l’élection présidentielle de 2022 | Paris (75) |
| 81 | Evelyne Reybert | - | - | Drôme (26) |
Pour aller plus loin…
Découvrez les candidats des autres listes pour les élections européennes de 2024 en France :
Et découvrez nos autres articles sur les élections européennes de 2024 :
L’article Elections européennes 2024 : qui sont les candidats de la liste Reconquête ? est apparu en premier sur Touteleurope.eu.
07.05.2024 à 18:09
Que fait l’Union européenne en matière d’emploi et de protection sociale ?
Rédaction Toute l'Europe

L’Union européenne ne se limite pas à son marché intérieur. Socle européen des droits sociaux en 2017, directive sur les salaires minimums en 2022 ou encore plus récemment celle sur les travailleurs des plateformes… L’emploi et la protection sociale font partie des domaines d’action de l’UE, qui tend à renforcer son engagement en la matière. […]
L’article Que fait l’Union européenne en matière d’emploi et de protection sociale ? est apparu en premier sur Touteleurope.eu.
Texte intégral (3651 mots)

L’Union européenne ne se limite pas à son marché intérieur. Socle européen des droits sociaux en 2017, directive sur les salaires minimums en 2022 ou encore plus récemment celle sur les travailleurs des plateformes… L’emploi et la protection sociale font partie des domaines d’action de l’UE, qui tend à renforcer son engagement en la matière.
Mais il est vrai que son rôle était limité aux origines du projet européen en 1957. L’UE connaîtra un tournant social dans les années 1980, à la faveur de l’Acte unique européen, orientation qui se confirmera nettement au cours de la décennie suivante. Avant un retour en force des sujets sociaux depuis plusieurs années.
Les débuts de la politique européenne de l’emploi et de la protection sociale
En 1957, le traité instituant la Communauté économique européenne, plus connu sous le nom de traité de Rome, est signé et lance officiellement la construction européenne. Si celui-ci vise à assurer le “progrès économique et social”, cet objectif est principalement poursuivi à travers l’économie, par une levée progressive des barrières commerciales entre Etats membres de la Communauté économique européenne (CEE), à savoir la France, l’Allemagne de l’Ouest, l’Italie, la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas.
La dimension sociale de l’Europe des Six n’est pas pour autant éludée. Le traité de Rome institue le Fonds social européen (FSE), le plus ancien fonds structurel de l’UE, qui finance initialement la reconversion des travailleurs et leurs mobilités entre Etats membres.
Seize ans après le traité de Rome, en 1973, l’Europe est frappée de plein fouet par le premier choc pétrolier, qui acte la fin des “Trente Glorieuses” et d’une période de prospérité économique. L’inflation et le chômage prennent de l’ampleur. En réaction, les désormais neuf Etats membres de la CEE adoptent leur premier plan d’action sociale au niveau européen en 1974. Celui-ci vise notamment à élaborer des directives relatives aux restructurations d’entreprises, à la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs et à l’égalité hommes-femmes dans le milieu professionnel. Mais le véritable tournant social de la construction européenne n’arrive que dans les années 1980, sous l’impulsion du président de la Commission européenne Jacques Delors (1985-1995). Il initie les rencontres de Val Duchesse, du nom du château belge où elles ont lieu, qui permettent aux partenaires sociaux européens de participer à la création des normes sociales de la CEE. C’est la naissance du “dialogue social européen”.
L’adoption de l’Acte unique européen en 1986, traité qui ouvre la voie au marché unique, constitue un autre moment clé de la prise en compte des questions sociales. La lutte contre le chômage devient alors un objectif important de la Commission européenne, avec pour visée la cohésion économique et sociale. C’est aussi lors de la présidence de Jacques Delors qu’est lancé le Programme européen d’aide aux plus démunis (PEAD), en 1987. Celui-ci visait à redistribuer les invendus de la politique agricole commune (PAC) à des associations caritatives, comme le Secours populaire ou les Restos du Cœur en France.
Une intégration européenne encore plus poussée est confirmée en 1992 avec le traité de Maastricht, qui transforme la CEE en Union européenne. Mais c’est le traité d’Amsterdam, signé en 1997, qui vient réellement changer la donne au niveau européen. L’emploi est dès lors perçu comme aussi important que les autres domaines de l’économie européenne. Le titre VI du traité d’Amsterdam est entièrement consacré à cette question. La dynamique d’Amsterdam est ensuite précisée lors du sommet de Luxembourg en novembre 1997, qui donne naissance à la “stratégie européenne pour l’emploi”. Si chaque Etat membre reste souverain en matière d’emploi, la coordination dans ce domaine est renforcée, avec la mise en place d’objectifs communs. Chaque année, les pays de l’UE élaborent alors des Plans nationaux pour l’emploi (PNAE) – aujourd’hui appelés Programmes nationaux de réforme (PNR) – comportant les mesures prises pour atteindre leurs cibles concernant l’emploi et la lutte contre le chômage.
Depuis les années 2010
Au cours des années 2010, l’Union européenne, qui se remet petit à petit de la crise économique de 2008, cherche encore à renforcer sa dimension sociale. En 2017, un texte majeur est adopté : le socle européen des droits sociaux. Non contraignant, il fixe cependant 20 principes sociaux vers lesquels l’Europe doit tendre. Ceux-ci sont divisés en trois chapitres “Egalité des chances et accès au marché du travail”, “Des conditions de travail équitables” et “Protection et inclusion sociales”. Le socle européen des droits sociaux aboutit à l’adoption, en 2021 par les Vingt-Sept, les eurodéputés et les partenaires sociaux lors du sommet de Porto, de trois grands objectifs chiffrés à atteindre d’ici à 2030 : un emploi pour au moins 78 % des 20-64 ans ; une participation à des activités de formation pour au moins 60 % des adultes chaque année ; au minimum 15 millions de personnes menacées de pauvreté ou d’exclusion sociale en moins.
En 2020, la crise liée à la pandémie de Covid-19 et ses lourdes conséquences économiques placent les préoccupations sociales au cœur des priorités européennes. Dans un premier temps, l’UE a réagi en mettant en place l’initiative temporaire SURE (aide à l’atténuation des risques de chômage en cas d’urgence). Concrètement, ce soutien financier aux Etats membres (sous forme de prêts) a permis de financer des mesures de sauvegarde de l’emploi comme des régimes de chômage partiel.
Dans un second temps, l’UE a répondu aux problématiques économiques en mettant en place un plan de relance européen, baptisé Next Generation EU, lequel prévoit le versement de 750 milliards d’euros aux Etats membres sous forme de transferts et de prêts. Dans leurs plans de relance nationaux, les Etats membres sont incités, outre la lutte contre le changement climatique et la préservation de l’environnement, à favoriser la résilience économique et sociale.
En 2023, l’UE a instauré l’Année européenne des compétences. Le but de cette année thématique est notamment de promouvoir l’acquisition des compétences nécessaires à de bonnes perspectives professionnelles pour l’ensemble des citoyens européens.
Le FSE+, la principale manne financière européenne pour l’emploi et la protection sociale
Doté de 88 milliards d’euros pour la période 2021-2027, le Fonds social européen+ permet de financer de très nombreux projets à travers l’Union européenne. Une multitude d’acteurs différents — entreprises, collectivités locales, associations, universités… — peuvent prétendre aux financements du FSE+.
Programmes de formation en entreprise, d’aide pour les chercheurs d’emplois et les plus démunis ou encore de réinsertion de prisonniers… les exemples d’initiatives financées par le FSE+ (dont les fonds sont gérés à 35 % par les Régions et à 65 % par l’Etat en France) sont très variés.
Certains programmes de la période budgétaire européenne 2014-2020 font maintenant partie intégrante du FSE+. A savoir l’Initiative pour l’emploi des jeunes (IEJ), qui finance des projets pour les moins de 30 ans n’étant ni en emploi, ni en étude, ni en formation (NEET). Mais aussi le Fonds européen d’aide aux plus démunis (FEAD), successeur du Programme européen d’aide aux plus démunis créé en 1987 et qui vient en aide aux associations de lutte contre la pauvreté. Ainsi que le programme pour l’emploi et l’innovation sociale (EaSI), soutenant l’emploi et la mobilité professionnelle dans une perspective de réduction des inégalités sociales.
Depuis 2022, l’initiative Alma propose un séjour supervisé à certains jeunes (ni en emploi, ni en étude, ni en formation) dans un autre Etat membre d’une durée de deux à six mois pour favoriser leur inclusion et améliorer leurs compétences.
Exemples récents de mesures européennes pour l’emploi et la protection sociale
Directive sur les salaires minimums (2022)
Le but de ce texte est de favoriser une convergence à la hausse des salaires minimums en Europe. Il n’impose pas la mise en place d’un “smic” dans les cinq pays qui n’en disposent pas au niveau national (Danemark, Finlande, Suède, Autriche et Italie), où il est défini par branches. Ce qui serait contraire aux traités européens. La directive invite notamment les Etats membres à favoriser les négociations collectives, qui impliquent une importante mobilisation des partenaires sociaux, dans la définition des salaires minimaux. Car celles-ci favorisent des salaires minimums plus élevés. Le texte prévoit aussi un suivi des mesures mises en place par les Etats membres.
Directive sur l’équilibre femmes-hommes dans les conseils d’administration des entreprises cotées en bourse (2022)
Le texte impose une féminisation des conseils d’administration des grandes sociétés cotées en bourse. D’ici à juillet 2026, 40 % des postes d’administrateurs non exécutifs devront être occupés par le genre sous-représenté, le plus souvent les femmes, ou bien 33 % de tous les postes d’administrateur. Les Etats membres de l’Union européenne, qui disposent de deux ans pour transposer la directive dans leur droit national, seront tenus de mettre en place des sanctions dissuasives telles que des amendes pour s’assurer du respect des nouvelles règles. Les PME de moins de 250 salariés ne sont pas concernées par cette nouvelle législation.
Directive sur la transparence des salaires (2023)
Les inégalités hommes-femmes se reflètent notamment à l’endroit des salaires. En 2022, les femmes gagnaient en moyenne 12,7 % de moins que les hommes dans l’UE, d’après Eurostat. Pour réduire ces écarts, l’Union européenne a adopté en mai 2023 une directive fixant des règles de transparence des rémunérations. Le texte impose aux Etats membres de mettre en place, d’ici le 7 juin 2026, des dispositifs permettant une meilleure transparence et une meilleure communication des salaires, aussi bien pendant la phase de recrutement que pendant l’exécution du contrat de travail.
Directive sur les travailleurs des plateformes numériques (en phase finale d’adoption, 2024)
Proposée fin 2021 par la Commission européenne, la directive a notamment pour objectif de permettre aux travailleurs des plateformes numériques de bénéficier d’un statut en adéquation avec leur situation professionnelle. A savoir de ne pas être considéré en tant que travailleurs indépendants lorsqu’un fort lien de subordination avec la plateforme dont ils dépendent est établi. Après un accord politique des Etats membres début mars 2024, la directive a été définitivement adoptée par les eurodéputés le 24 avril. Elle doit encore être formellement approuvée par les Vingt-Sept pour entrer en vigueur.
Le Fonds social pour le climat (adopté en 2023, lancement en 2026)
L’UE s’est engagée à atteindre la neutralité carbone à l’horizon 2050. Une importante transition écologique, déclinée à travers le Pacte vert pour l’Europe, est ainsi prévue pour y parvenir. Mais l’UE et ses Etats membres souhaitent limiter le coût social des mesures envisagées et adoptées. Comme l’extension du marché du carbone européen aux secteurs du transport routier et du chauffage. Le Fonds social pour le climat, adopté en 2023 pour la période 2026-2032, sera alimenté par une partie des nouvelles recettes du marché du carbone et permettra des aides matérielles et financières pour les ménages et entreprises les plus vulnérables. L’UE a fixé le budget du fonds à 65 milliards d’euros, qui seront complétés par les Etats membres.
L’article Que fait l’Union européenne en matière d’emploi et de protection sociale ? est apparu en premier sur Touteleurope.eu.
07.05.2024 à 15:28
Combien la France et les Etats membres reçoivent-ils du plan de relance européen ?
Rédaction Toute l'Europe

Conçu pour répondre aux conséquences économiques de la pandémie de Covid-19, le plan de relance européen de 750 milliards d’euros (806,9 milliards en prix de 2022), adopté en juillet 2020, poursuit sa mise en œuvre. De nombreux Etats membres ont reçu des fonds de la facilité pour la reprise et la résilience (FRR), le principal […]
L’article Combien la France et les Etats membres reçoivent-ils du plan de relance européen ? est apparu en premier sur Touteleurope.eu.
Texte intégral (1881 mots)

Conçu pour répondre aux conséquences économiques de la pandémie de Covid-19, le plan de relance européen de 750 milliards d’euros (806,9 milliards en prix de 2022), adopté en juillet 2020, poursuit sa mise en œuvre. De nombreux Etats membres ont reçu des fonds de la facilité pour la reprise et la résilience (FRR), le principal instrument du plan européen. A l’image de la France qui a déjà perçu 23,4 milliards d’euros et s’apprête à toucher 7,5 milliards d’euros supplémentaires, sur un total de 40,3 milliards, uniquement de subventions (voir plus loin le mode de distribution des fonds). Ces 40,3 milliards de subventions européennes abondent le plan de relance national français de 100 milliards.
De quoi est composé le plan de relance européen ?
D’une valeur de 723 milliards d’euros, la FRR est dotée de 338 milliards d’euros (prix de 2022) de subventions versées directement aux Etats membres. Mais également de 385,8 milliards d’euros de prêts disponibles pour les Etats membres qui souhaitaient en profiter. En tout, 290,9 milliards d’euros de prêts ont été sollicités par les Etats membres, auprès de la Commission européenne. La France n’y a pas eu recours.
Outre ces subventions et ces prêts, le plan de relance européen comprend 83,1 milliards d’euros supplémentaires étoffant les programmes européens comme Horizon Europe pour la recherche et l’innovation, mais aussi certains instruments financiers comme InvestEU ou le nouveau fonds pour une transition juste.
Comment est calculée la répartition de la facilité pour la reprise et la résilience ?
La clé de répartition entre les Etats membres tient compte de plusieurs critères :
- La population du pays ;
- Son produit intérieur brut (PIB) par habitant ;
- Son taux de chômage sur la période 2015-2019 ;
- La baisse du PIB observée en 2020 et 2021.
Pour tenir compte de ce dernier critère, les montants alloués à chaque Etat membre ont été réévalués en juin 2022.
En juin 2023, la Commission a également autorisé les Etats membres à inclure un chapitre RePowerEU aux plans nationaux. Doté d’une enveloppe de 20 milliards d’euros, celui-ci vise à se passer du gaz, du pétrole et du charbon en provenance de Russie d’ici à 2027.
Qui sont les pays bénéficiaires du plan de relance européen ?
En ce qui concerne les subventions, l’Espagne est le premier bénéficiaire de la FRR. Au total, Madrid doit toucher 79,9 milliards d’euros, selon la Commission européenne. L’Italie bénéficie quant à elle de 71,8 milliards d’euros. Viennent ensuite la France (40,3 milliards) puis l’Allemagne (28 milliards) et la Pologne (25,3 milliards).
Concernant les prêts, chaque Etat membre pouvait déposer une demande, jusqu’au mois de décembre 2023, pour une somme allant jusqu’à 6,8 % de son revenu national brut. Somme que l’Etat membre emprunteur doit ensuite intégralement rembourser, contrairement aux subventions.
Treize Etats ont demandé à contracter des prêts, pour un montant total de 290,9 milliards d’euros. Ainsi, l’Italie devra rembourser 122,6 milliards d’euros et l’Espagne 83,2 milliards. La France aurait pu en bénéficier, mais elle a décidé de ne pas y recourir.
L’Italie est donc le principal bénéficiaire du plan de relance européen avec 194,4 milliards d’euros, dont près de deux tiers de prêts.
Le plan français a été amendé en juillet 2023, passant de 37,5 à 40,3 milliards d’euros.
2,3 milliards ont été octroyés grâce à l’ajout d’un chapitre RePowerEU. L’objectif de ce plan européen est de se passer du gaz, du pétrole et du charbon en provenance de Russie d’ici à 2027. 500 millions d’euros sont par ailleurs issus de la réserve d’ajustement au Brexit, un fonds mis en place pour soutenir les acteurs les plus impactés par la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne.
Une majorité d’Etats membres ont également vu leur plan augmenter en 2023 ou 2024.
Combien les Etats membres ont-ils déjà perçu du plan de relance européen ?
Sur les 27 Etats membres de l’Union européenne, 24 ont touché des fonds du plan de relance européen au 6 mai 2024.
Ces montants sont versés de la façon suivante :
- Après l’évaluation des plans nationaux de la Commission européenne et la validation du Conseil de l’UE, une tranche de 13 % du montant total est versée. Ce premier versement est qualifié de “pré-financement”.
- Pour bénéficier de nouveaux décaissements, chaque Etat doit en faire la demande auprès de la Commission européenne. Celle-ci vérifie que les objectifs intermédiaires du plan national ont été atteints, et décide ou non de procéder au déblocage d’une nouvelle tranche, dans la limite de deux par an.
L’Italie a déjà reçu 102,5 milliards d’euros. L’Espagne a quant à elle perçu 38,4 milliards d’euros tandis que la France en est à 23,4 milliards d’euros. Les montants touchés par la Hongrie (0,9) correspondent uniquement au pré-financement. Au total, un peu plus de 232 milliards d’euros ont déjà été déboursés, selon la Commission européenne. L’Irlande, les Pays-Bas et la Suède n’ont pas encore reçu de versement.
Proportionnellement, le plan français est l’un des plus avancés : 58 % du montant total a déjà été versé à Paris. Seul le Danemark fait légèrement mieux, avec 59 % des sommes déjà octroyées (pour un montant total de 1,6 milliard d’euros seulement). Après l’avis positif de la Commission européenne le 3 mai 2024, la France doit toucher une nouvelle tranche de paiement d’un montant de 7,5 milliards d’euros courant juin, portant le total perçu à 30,9 milliards soit plus de 75% des fonds qui lui sont alloués.
Quelle procédure pour bénéficier des fonds ?
Pour bénéficier des fonds de “Next Generation EU”, les Etats membres ont transmis leurs “plans pour la reprise et la résilience” à la Commission européenne. Ceux-ci avaient l’obligation de se conformer aux conclusions du Conseil européen du 21 juillet 2020 et aux lignes directrices fixées par la Commission européenne.
La Commission européenne avait deux mois pour les étudier. Une fois l’évaluation soumise, le Conseil de l’Union européenne devait se prononcer sur sa validité. Une ultime étape avant les premiers versements.
L’article Combien la France et les Etats membres reçoivent-ils du plan de relance européen ? est apparu en premier sur Touteleurope.eu.
07.05.2024 à 12:48
Hugo Palacin

Moments incontournables des campagnes électorales, les débats entre candidats aux élections européennes vont rythmer les prochaines semaines, jusqu’au scrutin du 9 juin. Public Sénat a ouvert le bal le jeudi 14 mars, avec un débat entre les principales têtes de liste organisé au Parlement européen. Depuis, les rendez-vous rassemblant les protagonistes de cette campagne électorale […]
L’article Elections européennes 2024 : quand et avec quels candidats auront lieu les prochains débats télé et radio ? est apparu en premier sur Touteleurope.eu.
Texte intégral (2935 mots)

Moments incontournables des campagnes électorales, les débats entre candidats aux élections européennes vont rythmer les prochaines semaines, jusqu’au scrutin du 9 juin.
Public Sénat a ouvert le bal le jeudi 14 mars, avec un débat entre les principales têtes de liste organisé au Parlement européen. Depuis, les rendez-vous rassemblant les protagonistes de cette campagne électorale se succèdent à l’agenda.
Les grandes dates de débats à retenir :
- Mardi 21 mai : débat entre têtes de listes organisé par LCI.
- Jeudi 23 mai : débat européen entre les Spitzenkandidaten, organisé par le Parlement européen.
- Jeudi 23 mai : débat entre Gabriel Attal et Jordan Bardella sur France 2.
- Lundi 27 mai : débat entre têtes de listes organisé par BFM TV.
- Jeudi 30 mai : débat entre têtes de listes organisé par CNews et Europe 1.
- Mardi 4 juin : débat entre têtes de listes organisé par France 2.
Un duel entre Gabriel Attal et Jordan Bardella le 23 mai
La confrontation était attendue depuis longtemps. Jeudi 23 mai, le Premier ministre Gabriel Attal débattra avec Jordan Bardella, tête de liste et président du Rassemblement national. Un débat organisé par France 2, à partir de 20h15, et animé par la journaliste Caroline Roux, sur le créneau de l’émission “L’Evénement”. Ce duel entre numéros deux et figures montantes de leur camps respectifs s’annonce être un moment médiatique important de cette campagne électorale.
Succession de débats en mai et juin
Dans les derniers jours avant le scrutin, la campagne s’intensifiera et les débats devraient se multiplier. Quatre rendez-vous télévisés sont pour l’instant programmés, rassemblant les principales têtes de liste.
Les trois principales chaînes françaises d’information en continu seront de la partie. LCI devrait organiser son débat le mardi 21 mai, puis BFM TV le lundi 27 mai. Trois jours plus tard, le jeudi 30 mai, ce devrait être au tour de CNews et d’Europe 1, qui compteront quelques absents à gauche : Raphaël Glucksmann (PS) et Marie Toussaint (Les Ecologistes) ont d’ores et déjà indiqué qu’ils n’y participeraient pas, en raison du positionnement idéologique de la chaîne détenue par le groupe Bolloré.
Enfin, France 2 devrait clôturer la saison des débats le mardi 4 juin, quelques jours seulement avant que les Français ne soient appelés aux urnes le dimanche 9 juin (la veille pour les électeurs français de certains territoires d’outre-mer ou qui résident sur le continent américain).
Les Spitzenkandidaten débattront aussi
Si les débats télévisés se feront surtout à l’échelle de chaque pays, entre les têtes de liste nationales, certains événements réuniront, comme en 2019, les Spitzenkandidaten. Les chefs de file des principales familles politiques européennes ont débattu pour la première fois fin avril à Maastricht (Pays-Bas, lire plus bas).
Ils devraient se retrouver une deuxième fois le jeudi 23 mai pour un débat européen organisé par le Parlement européen en direct de l’hémicycle de Bruxelles. Une diffusion est prévue dans les 27 Etats membres, comme en 2019. Le nom de la chaîne française qui le retransmettra n’a pas encore été communiqué.
Parmi les principaux Spitzenkandidaten désignés par leur famille politique européenne respective, on pourrait ainsi retrouver Walter Baier (Parti de la gauche européenne), Bas Eickhout (Parti vert européen), Nicolas Schmit (Parti socialiste européen), Marie-Agnes Strack-Zimmermann (Parti de l’Alliance des libéraux et des démocrates pour l’Europe / Renew Europe) et la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen (Parti populaire européen).
Grandes interviews et face-à-face
Outre les confrontations entre les principales têtes de listes, certains rendez-vous médiatiques sont réalisés avec un seul ou quelques candidats à la fois. France Inter ou BFM TV ont par exemple déjà expérimenté des confrontations entre deux têtes de liste aux élections européennes en France.
Tout au long de la campagne, les antennes du groupe Radio France consacreront au total près de 100 heures de programmes à ces élections européennes. A l’image de Raphaël Glucksmann et Jordan Bardella, les principales têtes de liste sont reçues dans la matinale de France Inter, comme elles l’ont été dans celle de France info, au cours d’une séquence intitulée “Demain l’Europe”.
Les candidats ont eu une heure pour détailler leur programme en direct. Un format inauguré le lundi 18 mars par François-Xavier Bellamy (LR). Jordan Bardella (RN) lui a succédé le vendredi 22 mars, puis Valérie Hayer (Renaissance) le lundi 25 mars, Raphaël Glucksmann (PS-PP) le vendredi 29 mars, Manon Aubry (LFI) le mercredi 3 avril, Marie Toussaint (Les Ecologistes) le vendredi 5 avril et Marion Maréchal (Reconquête) le jeudi 11 avril.
Un certain nombre de médias, qui ne souhaitent ou ne peuvent pas organiser de débats réunissant l’ensemble des principales têtes de liste, les recevront et les intervieweront une par une d’ici le 9 juin.
Les débats passés
Dimanche 5 mai, organisé par RTL, Le Figaro, M6, Paris Première et LCP, en présence de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV), Raphaël Glucksmann (PS-PP), Valérie Hayer (Renaissance), François-Xavier Bellamy (LR), Jordan Bardella (RN) et Marion Maréchal (Reconquête). Revoir le débat ici.
Jeudi 2 mai, organisé à l’université de la Sorbonne en marge de la deuxième édition de l’Université de Libération, “Grand oral” des élections européennes en présence de Manon Aubry (LFI), Léon Deffontaines (PCF), Marie Toussaint (EELV), Raphaël Glucksmann (PS-PP), Clément Beaune (Renaissance) et François-Xavier Bellamy (LR).
Lundi 29 avril, débat européen entre Spitzenkandidaten, organisé à Maastricht (Pays-Bas) par Studio Europa Maastricht et Politico, en présence de Walter Baier (Parti de la gauche européenne), Maylis Roßberg (Alliance libre européenne), Bas Eickhout (Parti vert européen), Nicolas Schmit (Parti socialiste européen), Valeriu Ghilețchi (Mouvement politique chrétien européen), Marie-Agnes Strack-Zimmermann (Parti de l’Alliance des libéraux et des démocrates pour l’Europe / Renew Europe), Anders Vistisen (Identité et démocratie) et la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen (Parti populaire européen).
Mardi 16 avril, organisé par le groupe local d’Angers du think tank “The Shift Project”, fondé par Jean-Marc Jancovici, en présence de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV), Raphaël Glucksmann (PS-PP), Valérie Hayer (Renaissance), François-Xavier Bellamy (LR) et Jean-Philippe Tanguy (RN). Débat centré autour de la question : “quel avenir pour le Pacte vert européen ?”.
Mercredi 10 avril, organisé par RFI et France 24, en présence de Manon Aubry (LFI), Léon Deffontaines (PCF), Marie Toussaint (EELV), Raphaël Glucksmann (PS-PP), Valérie Hayer (Renaissance), François-Xavier Bellamy (LR), Fabrice Leggeri (RN) et Marion Maréchal (Reconquête). Revoir le débat ici.
Mercredi 27 mars, organisé par France info et ChangeNOW, en présence de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV), Aurore Lalucq (PS-PP), Clément Beaune (Renaissance), François-Xavier Bellamy, Mathilde Androuët (RN) et Nicolas Bay (Reconquête). Débat centré sur la thématique de la transition écologique et sociale.
Jeudi 14 mars, organisé par Public Sénat et le groupe de presse régionale Ebra, en direct du Parlement européen de Strasbourg, en présence de Manon Aubry (LFI), Léon Deffontaines (PCF), Marie Toussaint (EELV), Raphaël Glucksmann (PS-PP), Valérie Hayer (Renaissance), François-Xavier Bellamy (LR), Thierry Mariani (RN) et Marion Maréchal (Reconquête). Revoir le débat ici.
Pour aller plus loin…
Retrouvez également le dossier consacré aux élections européennes 2024 sur le site Vie publique.
L’article Elections européennes 2024 : quand et avec quels candidats auront lieu les prochains débats télé et radio ? est apparu en premier sur Touteleurope.eu.
07.05.2024 à 12:33
Matthieu Quentin

“A cinq jours près, l’annonce coïncide avec le 20e anniversaire de l’adhésion de la Pologne à l’UE”, commentent Les Echos. Ce lundi 6 mai, la Commission européenne a en effet annoncé son intention de “mettre un terme à la procédure enclenchée en décembre 2017 [Article 7 du traité sur l’Union européenne, NDLR]” à l’encontre de […]
L’article La Commission européenne annonce vouloir mettre fin à la procédure déclenchée contre la Pologne pour violation de l’état de droit est apparu en premier sur Touteleurope.eu.
Texte intégral (2075 mots)

“A cinq jours près, l’annonce coïncide avec le 20e anniversaire de l’adhésion de la Pologne à l’UE”, commentent Les Echos. Ce lundi 6 mai, la Commission européenne a en effet annoncé son intention de “mettre un terme à la procédure enclenchée en décembre 2017 [Article 7 du traité sur l’Union européenne, NDLR]” à l’encontre de Varsovie. Celle-ci avait pour but de “sanctionner ses atteintes à l’état de droit”, en particulier à propos de l’indépendance des juges, rappelle le quotidien économique.
De fait, l’exécutif européen a salué “les mesures prises par le gouvernement de Donald Tusk pour restaurer l’indépendance du système judiciaire”, après les huit années au pouvoir du parti nationaliste et hostile à l’UE Droit et justice (PiS), note Le Monde.
“Aujourd’hui marque un nouveau chapitre pour la Pologne. Après plus de six ans, nous pensons que la procédure de l’article 7 peut être close. Je félicite le Premier ministre Donald Tusk, et son gouvernement pour cette avancée majeure”, a déclaré la présidente de la Commission Ursula von der Leyen [Libération].
Reconnaissance des valeurs européennes
Selon Bruxelles, “il n’y a plus de risque clair d’une violation grave de l’état de droit en Pologne au sens de l’article 7 du traité de l’UE”, rapporte L’Express. Pour justifier la fin de cette procédure, l’exécutif européen “souligne que le pays a lancé une série de mesures pour améliorer l’indépendance de son système judiciaire, a reconnu la primauté du droit européen, et s’est engagé à appliquer les décisions de la justice de l’UE et de la Cour européenne des droits de l’homme”, détaille France info.
En outre, la Commission dit se réjouir “du plan d’action sur l’état de droit présenté en février par Varsovie, ainsi que de la décision [du pays] de participer au Parquet européen, qui a démarré ses activités en 2021 et compte 22 pays participants”, ajoutent Les Echos.
Ainsi, la décision de clore la procédure “sera soumise aux ministres des Vingt-Sept lors du Conseil des affaires générales du 21 mai [prochain] pendant lequel ils pourront présenter leurs observations”, fait savoir Le Monde. Ensuite, Bruxelles mettra “formellement fin” à cette procédure, qui “peut déboucher en théorie sur une suspension des droits de vote d’un pays au sein du Conseil de l’UE, en cas de ‘violation grave’ de l’état de droit”, précise le journal du soir.
Soulagement de Varsovie
“La possibilité d’une conclusion rapide de la procédure de l’article 7 n’est pas seulement la conséquence de notre travail au ministère de la Justice, mais elle est également le résultat de l’engagement de l’ensemble du gouvernement”, s’est félicité le ministre polonais de la Justice Adam Bodnar sur X, cité par l’agence de presse polonaise Polska Agencja Prasowa. “Nous sommes déterminés et dévoués à nos valeurs européennes communes”, a-t-il ajouté.
Fin février, Bruxelles “avait déjà mis en avant les efforts de Varsovie en matière d’état de droit”, approuvant alors le déblocage de 137 milliards d’euros (76,5 milliards de fonds de cohésion et 60 milliards au titre du plan de relance), gelés depuis 2022 en raison des “réformes controversées” entreprises par le PiS [France info]. A ce titre, la Pologne a déjà reçu une première tranche de “6,3 milliards d’euros” du plan de relance post-Covid, tandis que les fonds de cohésion destinés à Varsovie devraient également être débloqués, indique Der Spiegel.
“Il n’y a donc plus désormais qu’un Etat membre sous le coup de l’article 7 : la Hongrie de l’illibéral Viktor Orbán”, commentent Les Echos. Toutefois, “Bruxelles [se dit] très préoccupé par la situation en Slovaquie [où le populiste, NDLR] Robert Fico […] est revenu au pouvoir avec une rhétorique moins agressive dans la forme que celle de son voisin, mais assez proche dans le contenu”, analyse le quotidien. Par ailleurs, le Parlement européen a également exprimé en février dernier son inquiétude à l’égard du recul de l’état de droit en Grèce.
Les autres sujets du jour
Commerce extérieur
- CETA : les communistes vont forcer un vote à l’Assemblée sur l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et le Canada [France info]
Elections européennes
- Elections européennes 2024 : les quatre questions qui hantent le secteur de l’énergie [Les Echos]
- Elections européennes 2024 : six mesures concrètes prises par l’UE qui ont un impact sur notre quotidien [France Bleu]
- Européennes 2024 : quelles sont les principales mesures du programme de Valérie Hayer ? [Public Sénat]
Guerre en Ukraine
- La Russie annonce des exercices nucléaires près de l’Ukraine et menace des cibles britanniques [France 24]
Israël/Gaza
Numérique
UE-Chine
- Pékin fait de la Serbie son cheval de Troie en Europe [Les Echos]
- Visite d’Etat de Xi Jinping : “L’Europe doit mettre fin à une forme de naïveté à l’égard de la mondialisation”, plaide Jordan Bardella [France info]
L’article La Commission européenne annonce vouloir mettre fin à la procédure déclenchée contre la Pologne pour violation de l’état de droit est apparu en premier sur Touteleurope.eu.
06.05.2024 à 16:38
10 dates qui ont marqué les relations entre l’Union européenne et la Chine
Juliette Verdes

Après deux décennies d’isolement chinois, les années 1970 marquent le début d’un rapprochement entre le pays et les puissances occidentales. Des relations diplomatiques entre la République populaire de Chine (RPC) et la Communauté économique européenne sont établies dès mai 1975, avec la première visite d’un commissaire européen chargé des Relations extérieures, Christopher Soames, à Pékin. […]
L’article 10 dates qui ont marqué les relations entre l’Union européenne et la Chine est apparu en premier sur Touteleurope.eu.
Texte intégral (4695 mots)

Après deux décennies d’isolement chinois, les années 1970 marquent le début d’un rapprochement entre le pays et les puissances occidentales. Des relations diplomatiques entre la République populaire de Chine (RPC) et la Communauté économique européenne sont établies dès mai 1975, avec la première visite d’un commissaire européen chargé des Relations extérieures, Christopher Soames, à Pékin. Après la mort de Mao Zedong, le partenariat entre la RPC et la CEE puis l’UE se poursuit notamment dans le domaine économique, à tel point que la fin de la Guerre froide marque le début d’une “lune de miel” commerciale entre les deux puissances.
Depuis la crise financière de 2008 toutefois, et l’arrivée au pouvoir de Xi Jinping en 2013, les relations se sont progressivement crispées. La Commission européenne a été jusqu’à qualifier la Chine de “partenaire, concurrent stratégique et rival systémique” en 2019. Une succession de différends commerciaux et diplomatiques, ainsi que l’invasion de l’Ukraine par la Russie en février 2022, ont ensuite renforcé les tensions naissantes.
Avril 1978 : accord commercial entre la CEE et la Chine
Cet accord commercial marque un premier tournant dans l’histoire des relations entre la Communauté économique européenne (CEE) et la Chine. Il a pour but de simplifier le processus douanier afin d’accroitre les échanges commerciaux bilatéraux, et comporte également une exigence d’équilibre des échanges entre les deux parties. En cas de non-réciprocité, une commission mixte CEE-Chine est chargée de réajuster les échanges commerciaux. L’article 2 de l’accord comprend une “clause de la nation la plus favorisée” : autrement dit, la Chine et la CEE devront s’accorder les mêmes avantages qu’à leurs autres partenaires commerciaux, selon un principe de réciprocité.
Septembre 1985 : accord de coopération économique et commerciale
L’accord de 1978 ayant donné des résultats satisfaisants, les ministres des dix pays membres de la CEE autorisent la Commission européenne à ouvrir des négociations avec la Chine pour renouveler leur partenariat commercial. Le nouvel accord de coopération économique et commerciale est officiellement ratifié à Bruxelles en septembre 1985. Il reprend les principaux éléments du texte de 1978, en précisant les domaines de coopération des deux parties contractantes : l’industrie, le secteur agricole, l’énergie, la science ou encore la technologie…
Les deux signataires s’engagent également à renforcer leur coopération via une coproduction, des co-entreprises, ou encore le transfert de technologie. En outre, des clauses visent à améliorer le climat des investissements.
27 juin 1989 : les Européens adoptent un embargo sur les armes en réaction aux événements place Tian’anmen
En juin 1989, un mouvement de contestation inquiète le président chinois Deng Xiaoping. La population pékinoise soutient largement la grève de la faim menée par les étudiants sur la place Tian’anmen, et bloque l’armée chinoise aux portes de la capitale. Dans la nuit du 3 au 4 juin 1989, l’armée réprime violemment le mouvement contestataire, faisant plusieurs milliers de morts.
Ce massacre choque l’opinion publique mondiale, et les Etats-Unis décrètent immédiatement un embargo sur les ventes d’armes à la Chine. En Europe, les ministres réunis à l’occasion du Conseil européen de Madrid le 27 juin 1989 instaurent une mesure similaire en raison des graves atteintes aux droits de l’homme commises par la Chine. Inscrit dans une déclaration commune, l’embargo contre la Chine est toujours en vigueur en 2024, bien que la question de sa levée ait été discutée à plusieurs reprises.
Les discussions autour de l’embargo sur les armes
En octobre 2003, le ministère des Affaires étrangères chinois publie un premier document stratégique à destination de l’Union européenne. Il y pose les conditions d’un partenariat entre les deux entités, dont la levée de l’embargo sur les ventes d’armes. Lors du 8e sommet Union européenne-Chine en septembre 2005, les Européens réaffirment, à la demande de Pékin, “leur volonté de continuer à œuvrer en vue de la levée de l’embargo”. Mais le changement de position de certains pays membres et l’arrivée au pouvoir d’Angela Merkel en Allemagne enterrent durablement le projet.
11 décembre 2001 : la Chine entre à l’OMC
Après la chute de l’URSS au début des années 1990, la Chine et l’UE renforcent leur relation bilatérale. En 1993, la CEE devient officiellement l’Union européenne et se dote d’une ambition nouvelle quant à son rôle sur la scène internationale, tandis que la Chine voit dans l’UE un partenaire économique de taille et un contrepoids à l’influence américaine.
Au terme de quinze années de longues négociations, la Chine fait son entrée dans l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC) le 11 décembre 2001. L’Union européenne appuie la candidature chinoise, avec l’espoir que le pays devienne une économie de marché et que son insertion dans la mondialisation entraîne une libéralisation politique en interne. L’UE espère également profiter du marché de la Chine, en pleine expansion. Celle-ci devient le deuxième partenaire commercial de l’UE en 2002 ; et deux ans plus tard, l’Union européenne devient le premier partenaire commercial de la Chine.
2008 : la crise économique accélère les investissements chinois en Europe
A partir de 2008, l’Union européenne est touchée de plein fouet par la crise économique et financière. Côté chinois, si les exportations diminuent dans un premier temps, le contexte reste plus favorable aux grandes entreprises et aux banques qui vont investir en Europe. La crise renforce l’interdépendance entre la Chine et l’UE. Le pays achète notamment des obligations et bons du Trésor d’Etats européens en difficulté, notamment la Grèce.
En décembre 2008, la prise de contrôle du port grec du Pirée par le groupe de logistique China Ocean Shipping Company (COSCO) fait grand bruit. La presse de l’époque explique que l’opération permet à la Grèce de moderniser ses infrastructures à moindre coût en les privatisant partiellement, tandis que les Chinois offrent un accès privilégié au marché européen à leurs produits. Huit ans plus tard, la Grèce cède la totalité du port au groupe COSCO, qui en devient l’actionnaire majoritaire.
14 mars 2013 : Xi Jinping arrive au pouvoir
Arrivé au pouvoir en 2013, Xi Jinping s’impose comme une figure politique forte dès le début de son mandat. Critiquant la “stagnation” qui caractérise la période précédente, il met en avant le “rêve chinois” et veut faire de son pays un acteur de premier plan au niveau mondial. En 2013, au Kazakhstan, il évoque pour la première fois son projet de “nouvelles routes de la soie” (Belt & Road Initiative, BRI), la création d’une nouvelle route commerciale entre l’Asie, l’Europe et l’Afrique impliquant la participation de plus de 68 pays. En 2017 le forum “17+1” dédié au projet BRI est créé, dont font partie 11 pays de l’UE. Tout en proposant aux Etats souffrant économiquement de financer et de construire des infrastructures de transport, la Chine y facilite les exportations de ses marchandises. Dans le même temps, Xi Jinping opère une dérive autoritaire, aboutissant à la réforme constitutionnelle de 2018 qui abolit la limite des deux mandats présidentiels.
11 décembre 2016 : l’UE refuse de reconnaître le statut d’économie de marché à la Chine
Quinze ans après son adhésion à l’OMC, la Chine devait se voir automatiquement reconnaitre le statut d’économie de marché (SEM), qui ne lui a pas été directement octroyé en 2001. Concrètement, ce statut obligerait tous les membres de l’OMC à tenir compte des prix pratiqués sur le marché intérieur chinois. Il aurait également rendu les enquêtes contre le dumping (vente à un prix inférieur au coût) plus difficiles à mener.
Or en 2016, l’Etat chinois joue encore un rôle considérable et contrôle des pans entiers de “l’économie socialiste de marché”. Les Etats-Unis et le Japon annoncent clairement qu’ils ne reconnaîtraient pas le SEM à la Chine, au risque d’être sanctionnés par l’OMC. L’UE, qui s’était pourtant engagée à le faire, change d’avis au cours de l’année 2016. Un revirement qui crée la surprise et lance une longue série d’hostilités commerciales entre les deux parties. La Chine dépose une plainte à l’OMC dès le 12 décembre 2016, visant l’UE et les Etats-Unis contre leur méthode d’évaluation anti-dumping mis en place la même année.
2019 : la Chine qualifiée de “partenaire, concurrent et rival systémique”
Le 12 mars 2019, le Parlement européen, le Conseil européen et la Commission livrent leur nouvelle vision stratégique vis-à-vis de la Chine dans une communication conjointe. Le pays est désormais considéré comme “un partenaire de coopération avec lequel l’UE partage des objectifs étroitement intégrés, un partenaire de négociation avec lequel l’UE doit trouver un juste équilibre sur le plan des intérêts, un concurrent économique dans la course à la domination technologique et un rival systémique dans la promotion d’autres modèles de gouvernance”.
2020 : Signature d’un accord global sur les investissements
Fruit de négociations débutées en 2013, un accord de principe sur les investissements entre l’Union et la Chine est adopté à la fin de l’année 2020… Mais n’est toujours pas ratifié à l’heure actuelle.
Par le biais de cet accord, l’Union a pour ambition de réduire le déséquilibre avec Pékin, en raison de l’écart existant entre d’un côté l’ouverture du marché européen aux investissements étrangers, de l’autre les barrières à l’entrée et les discriminations auxquelles sont confrontées les entreprises européennes qui souhaitent investir en Chine. L’accord prévoit à la fois la libéralisation des investissements mais aussi la levée des contraintes, permettant l’ouverture de plusieurs secteurs du marché chinois (transport, automobile, santé, numérique…). Ce traité est le plus important jamais conclu par le pays avec un partenaire étranger dans le domaine de l’investissement.
Néanmoins, le contexte géopolitique a évolué au fil des années. La Commission européenne suspend l’accord en 2021, à la suite des sanctions prises par la Chine à l’encontre de responsables et députés européens ayant dénoncé les exactions du régime chinois dans la région du Xinjiang.
2021 : sanctions européennes contre la Chine pour la répression des Ouïghours et sanctions chinoises contre la Lituanie
Au cours de l’année 2021, les tensions culminent entre la Chine et l’UE. En mars 2021, l’Union prend des sanctions (interdiction de visas et gel d’avoirs) contre quatre responsables chinois en raison de la répression de la minorité musulmane ouïgoure dans la région du Xinjiang. L’UE accuse ces hauts fonctionnaires de “graves atteintes aux droits de l’homme” et de se rendre coupable de “détentions arbitraires et [de] traitements dégradants infligés aux Ouïgours et aux membres d’autres minorités ethniques musulmanes”.
Le ministère chinois des Affaires étrangères dément toute atteinte aux droits de l’homme, et ne tarde pas à prendre des mesures de représailles. Pékin annonce mettre en place des sanctions contre quatre entités (dont le comité politique et de sécurité du Conseil de l’UE) et dix responsables européens (dont des eurodéputés), interdits de séjour en Chine.
En mai 2021, le différend est lié cette fois à la question taïwanaise. La Lituanie se retire du forum “17+1” du BRI, et donne son accord à l’ouverture dans son pays d’une représentation de Taïwan sous le nom de “Bureau de représentation de Taïwan”. Pour la Chine, cet acte représente un pas en avant vers la reconnaissance de l’indépendance de l’île, qu’elle considère comme partie intégrante de son territoire. En signe de représailles, les autorités chinoises mettent en place des pratiques commerciales discriminatoires à l’encontre de l’Etat Balte, rejetant les demandes d’importations et bloquants les exportations de Vilnius vers la Chine.
Le 27 janvier 2022, l’UE annonce qu’elle engage une procédure auprès de l’OMC contre la Chine “en raison de ses pratiques commerciales discriminatoires à l’encontre de la Lituanie, qui frappent également d’autres exportations du marché unique de l’UE”. La procédure ne devrait pas aboutir avant plusieurs années.
La pression chinoise s’accentue autour de Taïwan
Signe d’une relation politique tendue, la vice-présidente de la Commission Margrethe Vestager dénonce en octobre 2021 une “pression accrue” de la Chine sur Taïwan et déplore sa présence militaire dans le détroit, ce qui fait selon elle planer un risque sur “la sécurité et la prospérité” de l’Europe. En août 2022, les tensions entre Pékin et Taipei sont exacerbées par la visite de la présidente de la Chambre des représentants des Etats-Unis, Nancy Pelosi. Une “provocation” pour la Chine, qui a multiplié les manœuvres militaires autour du détroit de Taïwan tout au long de l’année 2022.
2022 : la guerre en Ukraine et le rapprochement sino-russe
Lors d’une rencontre organisée en marge des Jeux olympiques de Pékin, trois semaines avant l’invasion russe de l’Ukraine en février 2022, Xi Jinping et son homologue russe Vladimir Poutine signent une déclaration commune scellant “l’amitié sans limites” des deux pays. Depuis lors, la Chine n’a jamais condamné l’invasion de l’Ukraine. Le sommet UE-Chine convoqué par la Commission européenne en avril 2022 n’a pas fait avancer le dialogue avec Pékin, pour qui l’application de sanctions à l’encontre de la Russie n’est pas envisageable dans la mesure où les Chinois veulent se poser en médiateurs du conflit.
Ce rapprochement sino-russe fait craindre un soutien militaire du gouvernement de Xi Jinping à la Russie. Le 19 février 2023, le Secrétaire d’Etat américain Antony Blinken laisse entendre que Pékin est sur le point de livrer des armes à Moscou, ce que les autorités chinoises démentent. Quelques jours plus tard, le 24 février, le plan de paix pour l’Ukraine publié par le ministère chinois des Affaires étrangères ne mentionne toujours pas le caractère illégal de l’invasion de l’Ukraine. Xi Jinping et Vladimir Poutine réaffirment leur partenariat le 22 mars 2023, notamment à travers une “déclaration conjointe sur l’approfondissement du partenariat de coordination stratégique globale de l’ère nouvelle”, qui affiche son hostilité envers l’Occident.
Sur fonds de tensions géopolitiques et commerciales, le président chinois, Xi Jinping, a rencontré son homologue français Emmanuel Macron et la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen le 6 mai 2024. Pour le dirigeant chinois, il s’agit de la première visite sur le continent européen depuis 2019.
Des enquêtes antisubventions ouvertes à l’encontre de la Chine
La Commission européenne a récemment lancé de multiples enquêtes à l’encontre d’entreprises ou de consortiums chinois, dans le cadre des réglementations européennes antisubventions. En octobre 2023, l’exécutif européen a ainsi lancé une procédure contre les subventions de Pékin pour son industrie automobile, et tout particulièrement ses voitures électriques. En février 2024, une autre enquête a visé une filiale du constructeur ferroviaire chinois CRRC, numéro un mondial du secteur. Enfin, en avril 2024, deux procédures ont été dirigées contre des géants chinois des secteurs photovoltaïque et éolien.
En juin 2023, la Commission européenne avait présenté une nouvelle stratégie pour “renforcer la sécurité économique” de l’UE. Celle-ci vise à mieux filtrer les investissements étrangers et à protéger les technologies sensibles de l’Europe.
L’article 10 dates qui ont marqué les relations entre l’Union européenne et la Chine est apparu en premier sur Touteleurope.eu.
06.05.2024 à 14:57
Elections européennes : quels eurodéputés français sont candidats ?
Hugo Palacin

Qui sera réinvesti par son parti aux élections européennes de juin 2024 ? En haut de la liste ou en position non éligible ? Qui devra faire ses cartons et quitter l’hémicycle strasbourgeois ? Qui retournera se consacrer à ses autres mandats politiques, à son ancienne profession ou, tout simplement, à sa vie personnelle ? Ces questions, beaucoup des […]
L’article Elections européennes : quels eurodéputés français sont candidats ? est apparu en premier sur Touteleurope.eu.
Texte intégral (5652 mots)

Qui sera réinvesti par son parti aux élections européennes de juin 2024 ? En haut de la liste ou en position non éligible ? Qui devra faire ses cartons et quitter l’hémicycle strasbourgeois ? Qui retournera se consacrer à ses autres mandats politiques, à son ancienne profession ou, tout simplement, à sa vie personnelle ? Ces questions, beaucoup des 79 eurodéputés français de la mandature qui s’achève se les posent eux-mêmes.
Certains ne savent pas s’ils poursuivront leur travail au Parlement européen après le 9 juin. Pour l’ensemble des partis politiques représentés à Strasbourg, les listes de candidats aux élections européennes sont sur le point d’être bouclées (si elles ne le sont pas déjà). D’ici le 17 mai, date limite du dépôt des listes auprès du ministère de l’Intérieur, les tractations en coulisses vont bon train, faisant forcément des déçus de dernière minute, relégués aux positions inéligibles, voire hors de la liste.
In fine, les électeurs auront le dernier mot grâce à leur vote, le 9 juin prochain. C’est eux qui décideront du nombre de sièges alloués à chaque formation politique. Autant de facteurs qui laissent dans l’inconnue une grande partie des 79 élus français en poste au Parlement européen.
A quelques semaines du scrutin, 57 d’entre eux ont fait état de leur envie de rempiler. 14 autres, au contraire, ont d’ores et déjà annoncé qu’ils raccrocheraient le costume de député européen à l’issue de leur mandat. Les 8 restants n’ont pas encore fait part de leurs intentions.
Sommaire
- Groupe Renew Europe (Renaissance, MoDem, Horizons, Parti radical)
- Groupe Identité et démocratie (Rassemblement national)
- Groupe des Verts/Alliance libre européenne (Europe Ecologie Les Verts, Régions et peuples solidaires)
- Groupe du Parti populaire européen (Les Républicains, Les Centristes)
- Groupe de l’Alliance progressiste des socialistes et démocrates (Parti socialiste, Place publique, Nouvelle Donne)
- Groupe de la Gauche au Parlement européen (La France insoumise, Gauche républicaine et socialiste)
- Groupe des Conservateurs et réformistes européens (Reconquête)
- Députés français non-inscrits
Groupe Renew Europe (Renaissance, MoDem, Horizons, Parti radical - 23 députés)
Le 3 mai, Renaissance et ses alliés ont levé le voile sur leur liste pour les élections européennes en annonçant l’identité des 30 premiers candidats. Parmi ceux-là, 15 sont des eurodéputés sortants de la majorité présidentielle.
Outre la tête de liste, Valérie Hayer, on retrouve ainsi Bernard Guetta (2e position), Marie-Pierre Vedrenne (3e), Pascal Canfin (4e), Nathalie Loiseau (5e), Sandro Gozi (6e), Fabienne Keller (7e), Laurence Farreng (9e) et Gilles Boyer (10e) dans les premiers noms. Suivent Christophe Grudler (12e), Stéphanie Yon-Courtin (13e), Jérémy Decerle (14e), Max Orville (18e), Catherine Amalric (27e) et Pierre Karleskind (30e).
Ne figurant pas parmi ces premiers candidats, Stéphane Bijoux, Ilana Cicurel, Guy Lavocat et Salima Yenbou ont toutefois confié à Toute l’Europe leur souhait d’être de nouveau candidats pour le camp présidentiel. Quant à Irène Tolleret, elle nous avait fait part de sa volonté de rempiler pour un second mandat au Parlement européen. Dans un entretien à Midi Libre, elle a finalement annoncé fin avril “[ne plus avoir] la force” de retourner à Strasbourg et Bruxelles pour cinq années supplémentaires.
Longtemps auparavant, Catherine Chabaud, Dominique Riquet et Sylvie Brunet avaient fait savoir qu’ils ne seraient pas candidats en juin. La navigatrice Catherine Chabaud a indiqué dès mai 2023 dans un entretien avec Ouest-France qu’elle ne rempilerait pas pour un second mandat. Quant à l’ancien maire de Valenciennes (2002-2012) Dominique Riquet, il quittera le Parlement européen après quinze années à siéger à Strasbourg. Enfin, Sylvie Brunet a confirmé auprès de Toute l’Europe qu’elle ne se représenterait pas non plus.
Groupe Identité et démocratie (Rassemblement national - 18 députés)
Le 1er mai, le Rassemblement national (RN) a dévoilé le début de sa liste pour les élections européennes. Parmi les 35 premiers candidats annoncés, on retrouve 10 des 18 eurodéputés sortants. A commencer par Jordan Bardella, président du parti et tête de liste pour le deuxième fois d’affilée, après le scrutin de 2019.
Mathilde Androuët (4e position), Jean-Paul Garraud (5e), Thierry Mariani (9e), Philippe Olivier (11e), Catherine Griset (14e), Virginie Joron (16e), Marie Dauchy (22e), France Jamet (30e) et André Rougé (31e) figurent ainsi sur cette liste.
Deux parlementaires avaient confié à Toute l’Europe qu’ils ne souhaitaient pas se représenter. Elue à Strasbourg depuis 2014, Dominique Bilde entend désormais se consacrer à sa vie privée. “J’ai 70 ans, je travaille depuis l’âge de 15 ans et je n’ai jamais arrêté. J’ai besoin de repos désormais”, explique-t-elle. Même situation pour Gilles Lebreton : “Ayant, à 65 ans, accompli dix ans de mandat, j’ai décidé de quitter la vie politique et de laisser ma place à plus jeune que moi”. Enfin, selon les informations de Contexte, le député européen Jean-Lin Lacapelle ne sera pas candidat, lui non plus.
Pour les 5 autres eurodéputés sortants, il faudra attendre que la suite de la liste soit connue. Eric Minardi, délégué du RN en Polynésie française, est l’unique élu du RN à avoir confirmé auprès de Toute l’Europe son intention de rempiler, bien qu’il ne figure pas parmi les 35 premiers noms dévoilés par la formation d’extrême droite.
Groupe des Verts/Alliance libre européenne (Europe Ecologie Les Verts, Régions et peuples solidaires - 12 députés)
Chez les députés écologistes, on se verrait bien rester à Strasbourg. 10 d’entre eux sont candidats aux élections européennes, dont 7 sur la liste des Ecologistes - EELV. Parmi les prétendants, Marie Toussaint, investie tête de liste aux élections européennes de 2024, et David Cormand, qui l’épaulera en seconde position sur la liste. Mounir Satouri (4e position), Benoît Biteau (6e), Caroline Roose (7e), Claude Gruffat (12e) et François Thiollet (20e) sont également présents sur la liste des écologistes pour ce scrutin.
Damien Carême figurait initialement sur cette liste, en 10e position. En désaccord avec la stratégie des écologistes, il a décidé de démissionner du parti et, par conséquent, de se retirer de la liste. Finalement, il sera bel et bien candidat aux élections européennes, mais sur la liste… de La France insoumise, au 8e rang.
Quant à Lydie Massard, arrivée dans l’hémicycle en 2023 à la suite de l’élection de Yannick Jadot au Sénat, elle a été désignée cheffe de file par son parti, Régions et peuples solidaires (RPS). Alliés de longue date d’EELV, les régionalistes de RPS, mécontents des places qui leurs étaient accordées sur la future liste commune, ont préféré se tourner vers de nouveaux partenaires et former une coalition avec le Parti radical de gauche (PRG) et Volt. Lydie Massard devrait figurer sur cette liste.
Devenue une figure du Parlement européen, Karima Delli ne sera pas réinvestie par EELV. Les statuts du parti limitent ses parlementaires à trois mandats successifs pour une même fonction. Elue depuis 2009, la présidente de la commission des Transports et du Tourisme devra ainsi quitter Strasbourg (sauf si elle trouve une place sur une autre liste…). Gwendoline Delbos-Corfield et François Alfonsi ne rempileront pas non plus pour un nouveau mandat européen.
Groupe du Parti populaire européen (Les Républicains, Les Centristes - 8 députés)
Comme en 2019, François-Xavier Bellamy a été investi tête de liste pour mener la campagne des Républicains aux élections européennes. Plusieurs de ses collègues au Parlement européen seront de nouveau ses colistiers pour ce scrutin.
C’est ainsi le cas des anciens ministres Nadine Morano (6e position) et Brice Hortefeux (7e), de Nathalie Colin-Oesterlé (8e), membre du parti Les Centristes, d’Anne Sander (10e), première questeure du Parlement européen, ainsi que de Geoffroy Didier (11e), secrétaire général délégué des Républicains. Tous figurent parmi la liste des premiers candidats dévoilée par le parti fin avril.
Un seul membre de la délégation française du groupe du Parti populaire européen (PPE) avait annoncé qu’il ne se représenterait pas. Elu à Strasbourg depuis 2009, Arnaud Danjean avait indiqué dans le Journal de Saône-et-Loire qu’il se mettrait en retrait de la vie politique à l’issue de son mandat. Quant à Laurence Sailliet, elle a seulement indiqué qu’elle ne soutiendra pas la liste menée par François-Xavier Bellamy pour ce scrutin.
Groupe de l’Alliance progressiste des socialistes et démocrates (Parti socialiste, Place publique, Nouvelle Donne - 7 députés)
Bis repetita chez les socialistes aussi, s’agissant de la tête de liste. Raphaël Glucksmann est chargé de mener la campagne du Parti socialiste (PS), comme en 2019. A ses côtés, en 4e position sur la liste, figure de nouveau Aurore Lalucq, avec qui il co-préside Place Publique, parti allié au PS. Chez les roses, Nora Mebarek et Christophe Clergeau héritent respectivement des 2e et 5e positions.
Députée européenne depuis 2009, Sylvie Guillaume ne se représente pas pour “laisser la place à de nouvelles figures”, a-t-elle indiqué à Toute l’Europe. Pascal Durand, élu en 2019 sur la liste de la majorité présidentielle qu’il a finalement quitté, ne compte pas se représenter non plus.
Enfin, Pierre Larrouturou est lui aussi candidat, mais pas aux côtés du PS et de Place publique cette fois-ci. Le petit parti qu’il a fondé, Nouvelle Donne, présente sa propre liste aux élections européennes, conjointement avec Allons Enfants, un mouvement qui regroupe des militants âgés de moins de 30 ans.
Groupe de la Gauche au Parlement européen (La France insoumise, Gauche républicaine et socialiste - 6 députés)
Chez les insoumis, les voyants sont (presque) tous au vert. Manon Aubry a été ré-investie tête de liste par La France insoumise pour mener la campagne, comme en 2019. Younous Omarjee figure en 2e position sur cette liste, juste devant Marina Mesure (3e). Leïla Chaibi hérite, elle, de la 5e place.
Emmanuel Maurel a décidé de faire campagne sous bannière communiste. Son mouvement, la Gauche républicaine et socialiste (GRS), s’est allié au Parti communiste français (PCF) dans le cadre de ce scrutin. L’avenir européen d’Anne-Sophie Pelletier enfin est plus que compromis, depuis que l’eurodéputée a été exclue de la délégation insoumise en décembre 2023 pour des faits de harcèlement.
Groupe des Conservateurs et réformistes européens (Reconquête - 1 député)
Le 6 février 2024, Nicolas Bay est devenu le premier (et le seul) eurodéputé français à siéger au sein du groupe des Conservateurs et réformistes européens (ECR). Elu en 2019 sur la liste du Rassemblement national, il a rallié en 2022 Eric Zemmour et Reconquête lors de l’élection présidentielle française. Il figure en 4e position sur la liste menée par Marion Maréchal en vue du scrutin du 9 juin.
Députés français non-inscrits (4 députés)
Quatre députés français siègent aujourd’hui parmi les non-inscrits, tous élus il y a cinq ans sur la liste du Rassemblement national. Gilbert Collard, Maxette Pirbakas et Jérôme Rivière ont quitté le RN après avoir rallié Eric Zemmour et son parti Reconquête lors de l’élection présidentielle de 2022.
La liste du parti d’extrême droite aux élections européennes de 2024 sera menée par Marion Maréchal, mais rien n’indique pour l’instant si les intéressés figureront dessus. Maxette Pirbakas a confirmé à Toute l’Europe son intention de “continuer le travail entrepris”, sans dévoiler auprès de quelle formation politique. Au contraire, Jérôme Rivière a déclaré qu’il ne se représenterait pas pour un nouveau mandat.
Quant à Hervé Juvin, il a été exclu de la délégation française du RN en novembre 2022 après avoir été condamné en appel pour violences conjugales. Difficile d’imaginer le parti de Marine Le Pen l’investir de nouveau pour le prochain scrutin.
Tableau synthétique :
| Groupe | Prénom | NOM | Parti | Réponse |
|---|---|---|---|---|
| Renew Europe | Catherine | AMALRIC | Parti Radical | Oui |
| Stéphane | BIJOUX | Renaissance | Oui | |
| Gilles | BOYER | Horizons | Oui | |
| Sylvie | BRUNET | Mouvement Démocrate | Non | |
| Pascal | CANFIN | Renaissance | Oui | |
| Catherine | CHABAUD | Mouvement Démocrate | Non | |
| Ilana | CICUREL | Renaissance | Oui | |
| Jérémy | DECERLE | Renaissance | Oui | |
| Laurence | FARRENG | Mouvement Démocrate | Oui | |
| Sandro | GOZI | Renaissance | Oui | |
| Christophe | GRUDLER | Mouvement Démocrate | Oui | |
| Bernard | GUETTA | Renaissance | Oui | |
| Valérie | HAYER | Renaissance | Oui | |
| Pierre | KARLESKIND | Renaissance | Oui | |
| Fabienne | KELLER | Renaissance | Oui | |
| Guy | LAVOCAT | Renaissance | Oui | |
| Nathalie | LOISEAU | Horizons | Oui | |
| Max | ORVILLE | Mouvement Démocrate | Oui | |
| Dominique | RIQUET | Parti radical | Non | |
| Irène | TOLLERET | Renaissance | Non | |
| Marie-Pierre | VEDRENNE | Mouvement Démocrate | Oui | |
| Salima | YENBOU | Renaissance | Oui | |
| Stéphanie | YON-COURTIN | Renaissance | Oui | |
| Identité et démocratie | Mathilde | ANDROUËT | Rassemblement national | Oui |
| Jordan | BARDELLA | Rassemblement national | Oui | |
| Aurélia | BEIGNEUX | Rassemblement national | - | |
| Dominique | BILDE | Rassemblement national | Non | |
| Annika | BRUNA | Rassemblement national | - | |
| Patricia | CHAGNON | Rassemblement national | - | |
| Marie | DAUCHY | Rassemblement national |
Oui |
|
| Jean-Paul | GARRAUD | Rassemblement national | Oui | |
| Catherine | GRISET | Rassemblement national | Oui | |
| Jean-François | JALKH | Rassemblement national | - | |
| France | JAMET | Rassemblement national | Oui | |
| Virginie | JORON | Rassemblement national | Oui | |
| Jean-Lin | LACAPELLE | Rassemblement national | Non | |
| Gilles | LEBRETON | Rassemblement national | Non | |
| Thierry | MARIANI | Rassemblement national | Oui | |
| Eric | MINARDI | Rassemblement national | Oui | |
| Philippe | OLIVIER | Rassemblement national | Oui | |
| André | ROUGE | Rassemblement national | Oui | |
| Verts/Alliance libre européenne | François | ALFONSI | Régions et Peuples Solidaires | Non |
| Benoît | BITEAU | Les Ecologistes - EELV | Oui | |
| Damien | CARÊME | - | Oui | |
| David | CORMAND | Les Ecologistes - EELV | Oui | |
| Gwendoline | DELBOS-CORFIELD | Les Ecologistes - EELV | Non | |
| Karima | DELLI | Les Ecologistes - EELV | Non | |
| Claude | GRUFFAT | Les Ecologistes - EELV | Oui | |
| Lydie | MASSARD | Régions et Peuples Solidaires | Oui | |
| Caroline | ROOSE | Les Ecologistes - EELV | Oui | |
| Mounir | SATOURI | Les Ecologistes - EELV | Oui | |
| François | THIOLLET | Les Ecologistes - EELV | Oui | |
| Marie | TOUSSAINT | Les Ecologistes - EELV | Oui | |
| Parti populaire européen | François-Xavier | BELLAMY | Les Républicains | Oui |
| Nathalie | COLIN-OESTERLE | Les Centristes | Oui | |
| Arnaud | DANJEAN | Les Républicains | Non | |
| Geoffroy | DIDIER | Les Républicains | Oui | |
| Brice | HORTEFEUX | Les Républicains | Oui | |
| Nadine | MORANO | Les Républicains | Oui | |
| Laurence | SAILLIET | - | - | |
| Anne | SANDER | Les Républicains | Oui | |
| Alliance Progressiste des Socialistes et Démocrates | Christophe | CLERGEAU | Parti socialiste | Oui |
| Pascal | DURAND | - | Non | |
| Raphaël | GLUCKSMANN | Place publique | Oui | |
| Sylvie | GUILLAUME | Parti socialiste | Non | |
| Aurore | LALUCQ | Place publique | Oui | |
| Pierre | LARROUTUROU | Nouvelle Donne | Oui | |
| Nora | MEBAREK | Parti socialiste | Oui | |
| La Gauche - GUE/NGL | Manon | AUBRY | La France Insoumise | Oui |
| Leila | CHAIBI | La France Insoumise | Oui | |
| Emmanuel | MAUREL | Gauche républicaine et socialiste | Oui | |
| Marina | MESURE | La France Insoumise | Oui | |
| Younous | OMARJEE | La France Insoumise | Oui | |
| Anne-Sophie | PELLETIER | - | - | |
| Conservateurs et Réformistes européens | Nicolas | BAY | Reconquête ! | Oui |
| Non-inscrits | Gilbert | COLLARD | - | - |
| Hervé | JUVIN | - | - | |
| Maxette | PIRBAKAS | - | Oui | |
| Jérôme | RIVIERE | - | Non |
L’article Elections européennes : quels eurodéputés français sont candidats ? est apparu en premier sur Touteleurope.eu.
- GÉNÉRALISTES
- Basta
- Blast
- L'Autre Quotidien
- Alternatives Eco.
- La Croix
- Euronews
- Le Figaro
- France 24
- FTVI
- HuffPost
- L'Humanité
- LCP
- Le Media
- Le Monde
- Libération
- Mediapart
- La Tribune
- EUROPE
- Courrier Europe Centle
- Euractiv
- Toute l'Europe
- INTERNATIONAL
- Equaltimes
- CADTM
- Courrier International
- Global Voices
- Info Asie
- Inkyfada
- I.R.I.S
- Jeune Afrique
- Kurdistan au féminin
- N-Y Times
- Orient XXI
- Of AFP
- Rojava I.C
- OSINT / INVESTIGATION
- OFF Investigation
- OpenFacto°
- Bellingcat
- Disclose
- G.I.J.N
- MÉDIAS D'OPINION
- AOC
- Au Poste
- Cause Commune
- CrimethInc.
- Issues
- Les Jours
- Le Monde Moderne
- LVSL
- Marianne
- Médias Libres
- Quartier Général
- Rapports de force
- Reflets
- Rézo
- StreetPress
- OBSERVATOIRES
- Armements
- Acrimed
- Catastrophes naturelles
- Conspis
- Culture
- Extrême-droite
- Human Rights
- Inégalités
- Information
- Internet actu ✝
- Justice fiscale
- Liberté de création
- Multinationales
- Situationnisme
- Sondages
- Street-Médics
- Routes de la Soie
- Vrai ou Fake ?









