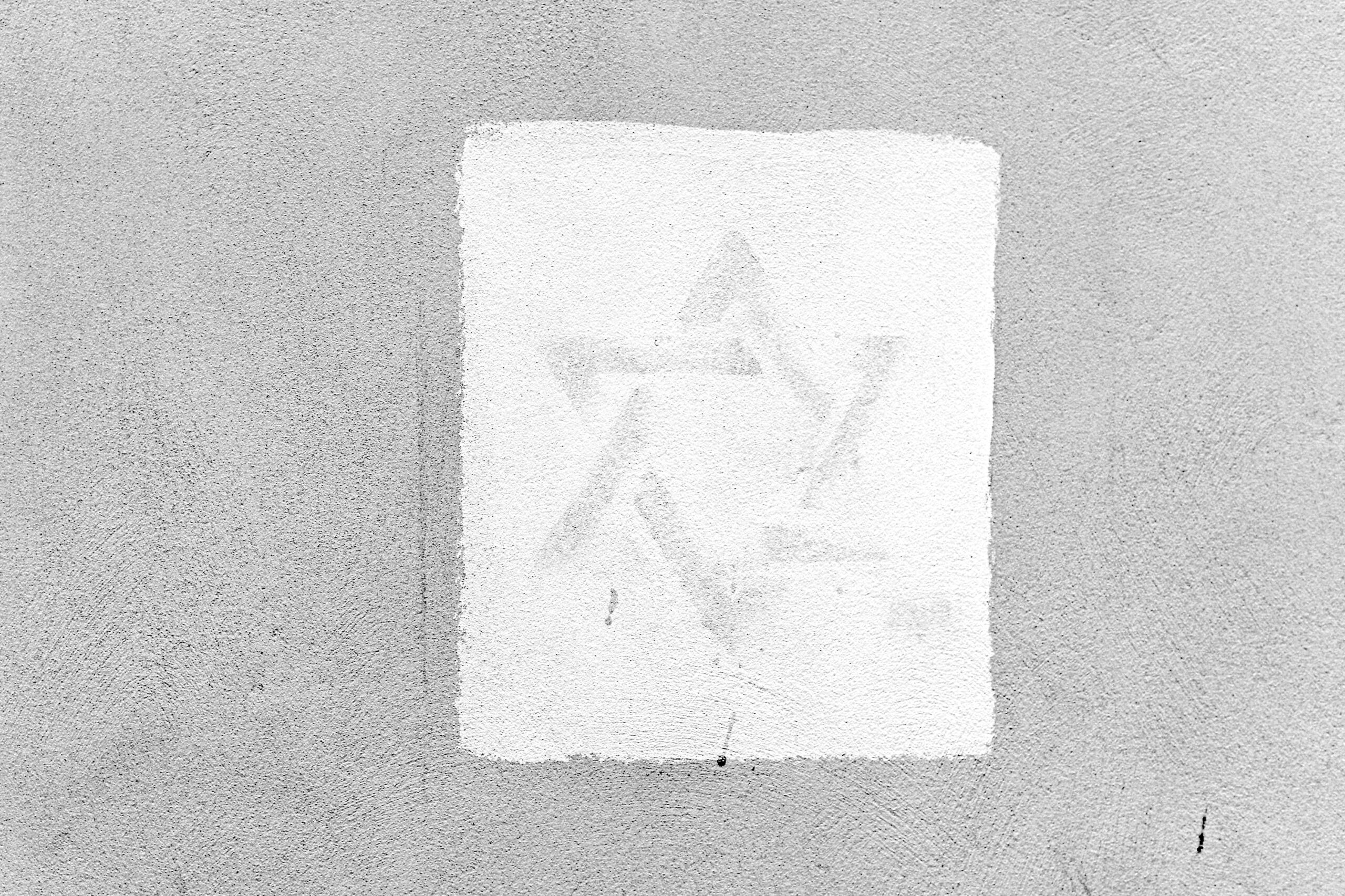Abonnés + Accès libre Actu Economie Guerre
09.11.2025 à 19:00
Comment parler de l’Ukraine en guerre ? Enquêtes sur la zone grise
Matheo Malik
Notre manière de décrire et de raconter la guerre en Ukraine est empreinte de réflexes, d’habitudes de langage, d’imprécisions — qui proviennent souvent de l’influence du filtre russe sur nos représentations.
Mais entre une rigueur scientifique inatteignable et les mots de la propagande, sommes-nous condamnés à errer dans une zone grise ?
L’article Comment parler de l’Ukraine en guerre ? Enquêtes sur la zone grise est apparu en premier sur Le Grand Continent.
Texte intégral (5165 mots)
Le langage, dans les situations de guerre plus encore que dans d’autres, n’est jamais neutre, qu’il soit tenu par l’une des parties ou — ce qui a été moins étudié — par des observateurs extérieurs. Nous nous proposons ici d’avancer quelques remarques sur la manière dont le discours a pris en charge, à trente ans d’intervalle, les deux guerres de Bosnie et d’Ukraine, en rappelant d’abord la propagande des agresseurs avant d’étudier comment il peut arriver à des commentateurs moins impliqués, sans pour autant tomber dans le mensonge, de recourir à des expressions problématiques.
Les mots agresseurs : parler la langue de la guerre en ex-Yougoslavie
Le langage des agresseurs a été, dans l’un et l’autre cas, sans surprise. Il visait à contester la réalité de l’agression, soit en niant purement et simplement son existence, soit en la transformant en opération défensive.
L’une des manipulations langagières utilisées couramment par les nationalistes serbes dans la description des événements des années 1990 a consisté à remplacer les noms désignant les différentes parties par des termes impropres chargés de lourdes connotations négatives. Ainsi les Croates étaient-ils souvent appelés des « Oustachis » — nom renvoyant aux fascistes croates alliés des nazis entre 1940 et 1945 — et les Bosniaques des « Turcs » — ce dernier terme qualifiant la population des Slaves islamisés d’une Bosnie longtemps intégrée à l’Empire ottoman. Le discours de guerre des agresseurs se nourrissait ainsi d’une reprise de références historiques plus ou moins lointaines et se voulant stigmatisantes 1. Cette substitution nominale présentait un double avantage. Elle était d’abord dévalorisante en assimilant les parties en présence à des groupes politiques ou à des pays qui s’étaient illustrés à un moment de leur histoire par leur violence de masse.
Mais elle visait aussi, plus subtilement, à inscrire les guerres en cours dans un temps long.
Pensées à l’échelle de l’Histoire, celles-ci cessent de constituer un événement isolé pour ne plus être qu’une étape dans un affrontement mené à l’échelle de l’Europe depuis les traités de Westphalie (1648), voire depuis le XVIe siècle et l’avancée des Ottomans dans les Balkans et en Hongrie. Un historien a même pu noter que la ligne de front dans les guerres de l’ex-Yougoslavie reprenait les frontières stabilisées par le « système westphalien » 2.
Ainsi le recours insistant à un autre terme qualifiant les Bosniaques, celui de « Musulmans » — appellation choisie par Tito pour désigner une « nationalité » et non une religion, d’où la majuscule — permettait-il de la même manière de situer la lutte menée à leur encontre dans le cadre transhistorique du combat de l’Europe chrétienne contre l’Empire ottoman, opposition devenue très récemment, dans la pensée d’extrême-droite, celle de l’Europe contre le monde islamique.
Ces qualifications de l’ennemi avaient pour enjeu la transformation de l’agression en « guerre défensive », ce qui permettait, selon une antienne remontant au thomisme médiéval, d’en faire une « guerre juste ».
Une autre pratique de la propagande nationaliste serbe a consisté en effet à inverser les responsabilités dans le déclenchement de la guerre : il s’agissait de les attribuer à ceux qui avaient voulu l’éclatement de la fédération yougoslave, dont les nationalistes serbes se considéraient les défenseurs selon une dialectique paradoxale qui les faisait mêler sans solution de continuité la « défense du peuple serbe » et la « défense de la Yougoslavie » — une contradiction que l’on retrouvera en partie dans le discours russe sur l’Ukraine. Dès lors qu’il s’agit d’un combat millénaire qualifié de « guerre sainte », la chronologie et la nature des faits importaient peu, comme le montraient, selon Belgrade, la prétendue présence sur le terrain de nombreux « moudjahidines » et la référence obsessionnelle à la défaite serbe contre les Ottomans à Kosovo Polje (le 15 juin 1389 !), transformée en événement fondateur.
Ainsi les médias de Belgrade ou de Pale — bourgade située sur les hauteurs de Sarajevo et pseudo-capitale des « Serbes de Bosnie » —, mais aussi ceux de Zagreb, parlaient-ils toujours, même à propos d’opérations militaires planifiées par leur armée, de « défense contre l’agression », formule présentant l’assaillant comme une victime, l’emploi systématique de termes défensifs inversant la lecture morale de la confrontation.
Poutine et la guerre des mots en Ukraine : de la novlangue à la construction d’une réalité alternative
Des mécanismes de propagande proches se laissent identifier aujourd’hui dans le discours russe à propos de l’Ukraine, à commencer par le fait de considérer les habitants de ce pays comme des Russes, en niant leur identité, et d’affirmer que la Russie ne fait que se défendre, qui plus est « contre des nazis », en ressuscitant là encore une histoire lointaine, mais très fortement présente dans la culture politique russe.
Il semble cependant que l’on soit monté d’un cran dans le langage utilisé par l’agresseur, car ce ne sont pas quelques mots isolés qui sont ici en cause, mais l’ensemble d’un discours structuré, assimilable à une novlangue qui n’est pas sans faire penser à celles qu’ont étudiées Victor Klemperer pour le nazisme 3 ou Henri Locard pour les Khmers rouges 4.
Dans son petit Vocabulaire du poutinisme 5, Michel Niqueux a ainsi identifié pas moins de quarante expressions problématiques régulièrement utilisées par Poutine, ses proches ou les intellectuels dont ils se réclament, et contribuant à substituer à la réalité de la guerre une réalité alternative.
L’expression la plus connue est évidemment celle d’ « opération militaire spéciale ».
Elle est employée en particulier dans le message télévisé de Poutine annonçant le déclenchement de la guerre le 24 février 2022 : son but est « protéger les personnes qui ont été soumises à des abus, à un génocide par le régime de Kiev pendant huit ans. » Et à cette fin, poursuit-il, « nous chercherons à démilitariser et à dénazifier l’Ukraine, à traduire en justice ceux qui y ont commis de nombreux crimes sanglants contre des civils, y compris des citoyens de la Fédération de Russie » 6.
Qu’il soit question de « dénazifier » l’Ukraine dans la déclaration du 24 février n’est pas anodin. Les différents termes de cette langue de substitution sont connectés les uns aux autres en un réseau sémantique serré permettant de construire deux récits simultanés, l’un portant sur la guerre en Europe, l’autre, plus large, sur le rôle de la Russie dans le monde et dans l’histoire.
Le premier récit visant à justifier l’intervention repose sur la présentation du gouvernement ukrainien comme infiltré par des nazis, cette lutte s’inscrivant dans le prolongement de la Seconde Guerre mondiale, appelée « Grande guerre patriotique » par les Russes — d’où les références récurrentes à Staline. Il s’agit donc d’assurer la protection des populations russophones, Ukrainiens et Russes formant un seul peuple historique — « civilisation russe », « monde russe ».
Mais le rôle de la Russie ne doit pas se limiter à chasser les « nazis » d’Ukraine.
Comme le montrent un certain nombre d’entrées du Vocabulaire (« conservatisme », « désoccidentalisation », « idée russe », « majorité mondiale », etc.), sa mission serait — à un niveau plus élevé et quasiment métaphysique — de lutter contre la dérive morale de l’Occident, qui a négligé les « valeurs traditionnelles » de la foi chrétienne, en particulier en cessant de privilégier la famille et en accordant du crédit aux thèses LGBT+.
On ne s’étonnera pas alors de rencontrer au détour du Vocabulaire des entrées comme celle de « Satan », l’expression « satanisme » étant devenue un lieu commun dans le discours de Poutine comme dans celui de l’Église orthodoxe russe pour qualifier « l’occidentalisme », selon une autre dénomination assez vague mais, non sans quelque paradoxe, extrêmement clivante et surtout très idéologique, et justifier en conséquence qu’une sorte de « guerre sainte » soit menée contre ce monde « corrompu » 7.

Les mots d’un récit inconscient dans la guerre en ex-Yougoslavie
Ce recours des agresseurs à un langage de propagande n’a rien d’original.
Plus intéressants sont les discours tenus par des commentateurs réputés « neutres », en tout cas qui ne sont pas explicitement engagés dans la défense de l’un des camps. Nous ne nous trouvons plus ici dans le cas de mensonges purs et simples, encore moins de censures, mais d’approximations langagières souvent involontaires.
Parmi les expressions entendues à l’époque de la guerre en ex-Yougoslavie figurait celle de « belligérants », visant à désigner les différents participants, à savoir les Bosniaques, les Croates et les Serbes, en les regroupant sous un vocable unique. Que cette expression, régulièrement employée par les médias, apparaisse comme critiquable pourrait surprendre puisqu’elle décrit objectivement la réalité. Les peuples en question étaient bien en train de se faire la guerre et l’expression (bellum gerere) est étymologiquement adéquate. Le problème est que son utilisation conduit à une forme d’indifférenciation. En mettant en avant un point commun indiscutable — les deux nations se battent —, elle oblitère le fait que l’une a agressé l’autre.
Source d’indifférenciation, l’expression « belligérants » est de surcroît porteuse de connotations, identifiables dans d’autres expressions de l’époque, tendant à suggérer qu’il s’agissait d’une « guerre civile ». À la prendre à la lettre, cette dernière expression n’est pas non plus inappropriée, puisque la lutte opposait les citoyens d’un même État, qu’on l’appelle Yougoslavie, Croatie ou Bosnie-Herzégovine. Mais, outre qu’elle conduit elle aussi à confondre agresseur et agressé, elle suggère une idée de complexité, que l’on retrouvait dans nombre de formules, au point que l’on pourrait parler d’une véritable rhétorique de la complexité.
L’idée qu’une guerre est complexe — ce qui est indiscutable 8 — tend à réduire la responsabilité des parties en jetant le doute sur les explications proposées.
Combien de fois n’avons-nous pas entendu, quand nous mettions en cause le gouvernement nationaliste de la Serbie, des remarques comme « c’est plus compliqué que cela » ? Cette même idée de complexité tend par ailleurs à dissuader d’intervenir, ou du moins incite à le faire avec prudence. Si la situation est complexe, si les responsabilités ne se situent pas toutes du même côté, il convient d’y réfléchir à deux fois avant de s’engager.
On notera que cette rhétorique de la complexité était sous-tendue par une certaine forme de temporalité suggérant que l’antagonisme en cause était ancien, datant de plusieurs décennies, voire de plusieurs siècles. En témoignaient le recours à l’adjectif « ancestral » ou, plus important, cette autre expression beaucoup entendue à l’époque, celle de « conflit inter-ethnique », doublement problématique.
Outre que la notion d’ethnie — dont des linguistes ont montré qu’elle s’était peu à peu substituée à celle de race, devenue inacceptable — doit être maniée avec précaution, elle n’avait de toute manière guère de sens dans l’ex-Yougoslavie où les distinctions entre les diverses composantes d’un peuple unique se sont faites pour l’essentiel sur des différences religieuses 9. Par ailleurs, parler d’un conflit interethnique contribue à l’essentialiser. L’expression tend à suggérer l’idée de haines à la fois anciennes et irrationnelles, qu’il est vain d’essayer de comprendre tant elles sont ancrées depuis des millénaires dans l’inconscient des peuples en cause 10.
Pour ces mêmes raisons, la notion de « purification ethnique » n’a pas toujours été maniée avec la prudence nécessaire.
Créée au XIXe siècle par l’écrivain Vuk Karadzic, elle désigne le fait de séparer des « ethnies » en chassant d’un territoire un groupe considéré comme indésirable. En ce sens, elle correspondait bien à une réalité concrète, mais tendait dans le même temps à valider la notion contestable d’ « ethnie », en reprenant le langage et les fantasmes des agresseurs.
À propos de ces expressions inappropriées, on notera le cas singulier du mot « génocide », dont on sait combien il est aujourd’hui l’objet de controverses 11. Alors qu’il n’est pas encore approprié au moment où l’emploie le journaliste Roy Gutman en 1993 12, il le deviendra deux ans plus tard après le massacre de Srebrenica (11-17 juillet 1995).
On voit comment les expressions les plus banales employées par des personnes de bonne foi — comme « belligérants » ou « conflit interethnique » — peuvent être porteuses de connotations lourdes d’imaginaire et qui ne sont pas sans conséquence au moment de prendre des décisions militaires.
Car, au-delà de ces connotations, c’est un véritable récit inconscient qui circulait dans les médias à l’époque de la guerre en ex-Yougoslavie.
Même s’il n’était jamais formulé directement et s’il convenait de le reconstituer à partir d’éléments linguistiques disséminés, il suggérait que les pays occidentaux avaient affaire à des peuples qui s’étripaient depuis des siècles pour des raisons obscures et qu’il convenait d’être prudents avant de se mêler à ces rivalités. Et ce d’autant plus que les commentateurs se considéraient comme étrangers à cette histoire et à sa rationalité, et revendiquaient une forme d’incompréhension radicale rendant difficile tout jugement éthique et politique 13.
Ce qui a commencé en Ukraine : « la guerre d’agression de la Russie contre l’Europe »
Trente ans après la guerre en ex-Yougoslavie, on retrouve dans les commentaires sur la guerre en Ukraine des points communs avec l’univers du langage de l’époque, mais aussi des différences notables.
On laissera ici de côté le discours de certains responsables politiques situés à l’extrême-gauche et à l’extrême-droite, qui soutiennent la Russie de manière plus ou moins affichée et utilisent eux aussi l’ambiguïté du langage pour proférer des contre-vérités.
Plus intéressantes sont les déclarations malencontreuses de commentateurs de bonne foi.
Inappropriées, à l’évidence, sont ainsi toutes les expressions, fréquentes dans les médias, donnant à penser que la guerre entre la Russie et l’Ukraine aurait commencé le 24 février 2022.
En disant qu’une agression aurait eu lieu à cette date, on affirme, là encore, quelque chose de juste, mais au prix d’un mensonge par omission considérable, dont on comprend qu’il choque les Ukrainiens puisque c’est en 2014 que la Russie s’est emparée de la Crimée et a appuyé l’insurrection « séparatiste » dans le Donbass.
Ce n’est pas un hasard si les agressés ont souvent recours à l’expression « invasion à grande échelle » pour cette deuxième étape de la guerre en 2022, marquée par un niveau de moyens et une intensité inconnus en Europe depuis 1914.
Mais le terme de « guerre » est-il lui-même approprié ? L’idée n’est évidemment pas de lui substituer celui d’ « opération militaire spéciale », comme le voudrait Vladimir Poutine et comme il l’impose en Russie sous peine de prison, mais de constater qu’il peut être lourd d’ambiguïtés et contribuer, comme l’expression « belligérants », à indifférencier les acteurs.
Pour cette raison, il serait peut-être plus opportun d’utiliser une expression comme « guerre d’agression », laquelle aurait pour bénéfice de rappeler que si les deux pays sont bien en train de s’affronter à l’instant de la description, il demeure deux inégalités foncières que le langage devrait tenter de prendre en compte, à savoir que l’un a agressé l’autre et que la victime, sauf à disparaître, ne peut se permettre de perdre la guerre.
« Guerre » nous paraît en tout cas plus approprié que « conflit », expression également source d’indifférenciation, qui lui est souvent substituée, et revient à gommer toute la dimension militaire en insistant sur le désaccord entre les parties. Il existe certes un conflit entre les Russes et les Ukrainiens, mais nul ne songerait à utiliser ce terme pour décrire par exemple une agression dans la rue.
Une autre question est celle de savoir comment articuler « guerre » et « Ukraine » dans les syntagmes qui les associent. Valentin Omelyantchyk s’est ainsi interrogé sur les différentes manières de combiner les deux mots sans fausser la réalité. Si aucune expression n’est ici véritablement inappropriée, il note que le substantif « Ukraine » « joue tour à tour le rôle de circonstance, d’objet et de sujet dans la mise en scène liée à l’action supposée par le verbe » 14.
Cette différence grammaticale n’est pas sans effet.
« Guerre en Ukraine » laisse ouverte la question des acteurs impliqués ; « Guerre d’Ukraine » les fait apparaître de façon symétrique en leur donnant le rôle d’objets et en conférant un statut décisif à l’espace où se joue l’affrontement ; « Ukraine en guerre » les présente de manière asymétrique en confiant à « Ukraine » le rôle de sujet.
Omelyantchyk montre ainsi que « chacune de ces expressions ouvre un espace sémantique médiatique propre reflétant les positions des protagonistes » 15.
En fait, comme nous l’ont fait remarquer justement plusieurs collègues ukrainiens, toute expression limitant le territoire de l’agression à l’Ukraine est de toute façon insuffisante, en donnant le sentiment que le projet de conquête impériale du président russe s’arrêterait aux limites de ce pays et qu’il s’agirait donc avant tout d’un différend sur les frontières.
Or comme l’ont compris tardivement les pays de l’Union européenne en soutenant clairement l’Ukraine — et comme le montre la description de l’idéologie poutinienne dans le lexique de Niqueux —, cette agression n’est que la première étape d’un projet beaucoup plus vaste, celui de la reconstitution de l’empire soviétique — on sait que Poutine considère que sa désagrégation a été la plus grande catastrophe géopolitique du XXe siècle — voire de celui de Pierre le Grand — sa grande référence historique car elle marque l’affirmation d’une logique impériale proprement russe.
L’expression la plus appropriée serait donc celle de « guerre d’agression de la Russie contre l’Europe ».
Plus rigoureuse que les autres, elle est évidemment inutilisable en raison de sa longueur. Mais les expressions plus brèves qu’il nous arrive à tous d’utiliser pour commenter cette guerre risquent d’avoir pour effet de donner crédit à une version faussée ou partielle de l’Histoire.
Car comme pour l’ex-Yougoslavie, certaines de ces interventions sont soutenues par un récit inconscient, perceptible notamment derrière les déclarations de responsables politiques se présentant officiellement comme neutres, alors que l’étude de leur discours permet pour le moins d’en douter.
Ainsi quand, de retour de la Place Rouge où il a assisté au défilé « antinazi » du 9 mai aux côtés de Poutine, le président du Brésil Lula qualifie d’ « absurde » la guerre en Ukraine 16, il profère à la fois une évidence — quelle guerre, sous un certain angle, ne l’est pas ? — et un mensonge par omission en oubliant de rappeler que la Russie a attaqué l’Ukraine, que celle-ci est contrainte de se défendre et qu’il existe donc des raisons parfaitement identifiables de la guerre et de ses développements.
Mais surtout, la formule « absurde » s’inscrit dans le prolongement de déclarations de Donald Trump, dont celle comparant les Ukrainiens et les Russes à de jeunes enfants se battant dans un bac à sable.
Le récit, ici, n’est plus celui de la complexité de luttes ancestrales comme dans le cas de l’ex-Yougoslavie, il repose sur la métaphore des chicaneries de l’enfance, avec pour double corollaire que l’objet des disputes est sans intérêt et que, les acteurs n’étant pas accessibles à la raison, il est peut-être vain de chercher à intervenir 17.
*
Contrairement à la propagande, ces impropriétés de langage sont souvent involontaires. Il nous arrive à tous d’y recourir. Elles n’auraient guère de conséquences si elles ne servaient de supports, on le voit, à une représentation fantasmatique des événements, susceptible de jouer à l’heure des décisions politiques.
Pour qualifier ce langage intermédiaire entre un discours totalement rigoureux, sans doute utopique, et celui de la propagande, on pourrait aller jusqu’à parler d’une zone grise, au sens où l’entendait Primo Levi.
Une zone où se mêlent approximations, omissions et stéréotypes, et où les mots employés — qui ne sont ni vrais ni faux — contribuent cependant à altérer le réel et à influer sur l’action.
L’article Comment parler de l’Ukraine en guerre ? Enquêtes sur la zone grise est apparu en premier sur Le Grand Continent.
31.10.2025 à 17:05
Nucléaire : face à Poutine, l’Europe doit apprendre à faire peur
Matheo Malik
Poseidon, Bourevestnik.
Depuis 48 heures, la Russie est en train de subvertir la dissuasion nucléaire en la faisant sortir des gonds de la rationalité.
Selon Stéphane Audrand, pour conjurer la peur, il faut apprendre à la manier.
L’article Nucléaire : face à Poutine, l’Europe doit apprendre à faire peur est apparu en premier sur Le Grand Continent.
Texte intégral (6889 mots)
La Russie de Poutine nous menace. Comment se préparer sérieusement sans tomber dans l’alarmisme ? Les chiffres et les analyses sont un bon point de départ. Si vous souhaitez soutenir une rédaction indépendante, abonnez-vous au Grand Continent
Que sont les « armes du Manège » de Vladimir Poutine ?
Le test très médiatisé du missile à propulsion nucléaire 9M730 Bourevestnik par la Russie a rencontré un certain écho dans les médias occidentaux ; lui a succédé l’évocation par Vladimir Poutine d’un essai de la torpille lourde autonome thermonucléaire Status-6 Poseidon.
Alors que les spécialistes de la dissuasion nucléaire ont plutôt tendance à considérer qu’il s’agit de « non-événements », les médias s’en émeuvent, et les réseaux sociaux sont comme toujours propices à la diffusion d’arguments erronés ou exagérés — voire de pure propagande russe — qui alimentent une peur panique de l’apocalypse nucléaire.
C’est sans doute l’effet principal recherché par Moscou : nous effrayer.
Depuis 2018, la poursuite par la Russie du développement de ce qu’on appelle les « armes du Manège » 18 — une nouvelle génération d’armes stratégiques présentée comme étant « de rupture » — s’inscrit largement dans une stratégie de peur — Sergueï Karaganov, nous y reviendrons, parle même aujourd’hui de « terreur » — plus que de dissuasion.
Il s’agit de provoquer et d’entretenir des sentiments collectifs irraisonnés, désarmants et coûteux dans les sociétés occidentales, bien plus que de dissuader de manière rationnelle ; et au sein des élites russes, en miroir, de se convaincre de sa propre puissance malgré les signes objectifs du déclin.
Le calcul derrière la dissuasion nucléaire
Qu’elle soit nucléaire ou non, la dissuasion repose en premier lieu sur un calcul rationnel : en démontrant que l’on dispose de capacités de destruction crédibles et d’une volonté de les utiliser dans le cadre d’une doctrine explicite, l’adversaire comprend que les coûts de son éventuelle agression dépasseraient de loin les bénéfices qu’il pourrait en retirer.
Parce qu’elle est porteuse de la plus grande capacité de destruction et pratiquement impossible à mettre en échec, la dissuasion nucléaire est de nature à prévenir les agressions les plus sérieuses et à inhiber les décisions les plus extrêmes. Lorsqu’elle est mutuelle, elle tend à une forme d’autolimitation des conflits : il n’est rationnellement pas possible de l’invoquer pour empêcher une « petite » agression, car en retour elle pourrait entraîner les adversaires dans un échange destructeur hors de proportion.
Il se crée alors un effet de « seuil », toujours un peu flou, en dessous duquel l’arme nucléaire ne peut pas être une option. L’ambiguïté du seuil fait partie inhérente d’une situation internationale qui voit coexister plusieurs puissances nucléaires : il s’agit à la fois d’être convaincant sur ses capacités et sa volonté, raisonnablement clair sur ce que la dissuasion protège, ambigu sur la limite précise du seuil de son déclenchement, mais aussi rassurant quant à sa propre rationalité.
La dissuasion vis-à-vis de Moscou repose depuis le début de la Guerre froide sur la promesse de représailles en cas d’agression et pas seulement d’une défense puissante.
Stéphane Audrand
En maintenant un dialogue stratégique permanent avec l’adversaire, même au plus fort des crises, on peut espérer qu’un calcul raisonnable fonctionnera entre les parties et que l’incertitude contribuera à la retenue de chacun, personne ne voulant « s’approcher du seuil ».
La métaphore la plus évidente est celle d’un taureau, au milieu d’un champ sans clôture : ne pas trop s’approcher de lui, et le contourner à bonne distance, est la voie la plus sûre pour éviter un problème.
Face à un État non doté, l’emploi en premier de l’arme nucléaire n’est pas non plus aisé à assumer, même pour un pays comme la Russie en Ukraine : le poids politique du tabou des armes nucléaires, l’importance des opinions mondiales hostiles à son usage et les bénéfices discutables qui seraient retirés d’un emploi tactique limité de l’arme au regard de son coût politique — de même que l’existence d’options conventionnelles puissantes et précises — font que l’arme nucléaire demeure pour l’heure cantonnée aux hypothèses les plus extrêmes, pour lesquelles elle conserve toute sa pertinence.
La dissuasion russe est déjà opérationnelle
La Fédération de Russie, héritière principale de l’Union soviétique, est pleinement insérée dans cet exercice « réaliste et rationnel » de la dissuasion nucléaire. Ses forces stratégiques sont nombreuses, crédibles et diversifiées : sous-marins nucléaires lanceurs d’engins, bombardiers porteurs de missiles de croisière ou aérobalistiques, missiles balistiques à portée tactique, intermédiaire ou intercontinentale sur transport-érecteur-lanceur, missiles en silos… L’arsenal russe, bien que parfois vieillissant, est suffisamment puissant — pléthorique même — pour remplir parfaitement sa fonction de dissuasion nucléaire.
Malgré les difficultés de sa modernisation, il comporte encore de nombreux vecteurs efficaces mettant en œuvre plus de 2600 têtes nucléaires stratégiques et environ 2000 têtes non stratégiques ; quels que soient les progrès de la défense antibalistique dans les pays qu’elle considère comme ses adversaires, la Russie serait toujours capable en 2025 de saturer toute défense pour infliger des dommages insupportables — y compris aux États-Unis ou à la Chine.
Quant à la volonté des dirigeants russes d’utiliser le cas échéant l’arme nucléaire pour défendre les intérêts les plus vitaux de la Russie, personne n’en doute.
Le test des vecteurs de l’arme nucléaire est une forme de routine pour les puissances qui en sont dotées. Qu’il s’agisse de tirs de missiles balistiques ou de raids aériens simulés, l’objectif est à la fois de s’entraîner, de s’assurer du bon fonctionnement technique des vecteurs, de la bonne connaissance des procédures et de démontrer à sa population, ses partenaires, ses adversaires et au monde que la dissuasion « fonctionne ».
Les tirs balistiques entre puissances nucléaires font l’objet de notifications préalables et suivent souvent un calendrier annuel assez routinier qui contribue aussi à la stabilité stratégique.
Paradoxalement, un pays qui cesserait brutalement ses exercices nucléaires sans raison valable susciterait plus de méfiance que de soulagement.
Le but des nouvelles « armes du Manège »
Pourquoi alors développer des armes aussi « exotiques » qu’un missile de croisière à propulsion nucléaire, une torpille thermonucléaire sous-marine à la charge prétendue de 100 mégatonnes ou même — on le sait depuis 2024 — un missile balistique conventionnel à portée intermédiaire ?
Si la recherche sur le planeur manœuvrant hypersonique Avangard peut se comprendre dans une optique de modernisation des arsenaux balistiques, les autres « armes du Manège » semblent bien plus incongrues et leur apport concret à la dissuasion russe apparaît discutable en termes purement rationnels.
Certes, lorsque les recherches furent lancées par la Russie dans les années 2010, les inquiétudes sur le devenir de la défense antibalistique justifiaient sans doute l’exploration de ruptures possibles pour se prémunir contre un éventuel déclassement ; mais l’état actuel des rapports de force stratégiques ne donne aucun intérêt au missile Bourevestnik, malgré sa portée. Peu discret, il serait rapidement repéré par n’importe quel avion de guet aérien ; volant à des vitesses transsoniques, il pourrait être intercepté par n’importe quel avion de chasse occidental. Même s’il pourrait, par sa portée et sa durée de vol, aborder un territoire adverse par « n’importe quelle direction », cela n’est en rien une capacité nouvelle.
Un pays qui cesserait brutalement ses exercices nucléaires susciterait plus de méfiance que de soulagement.
Stéphane Audrand
Pour se limiter au territoire nord-américain, la possibilité d’une frappe par le sud des États-Unis existe depuis que les SNLE soviétiques sont à la mer, et la Russie dispose actuellement de suffisamment de SNLE et de sous-marins nucléaires porteurs de missiles conventionnels pour disposer de moyens crédibles, gradués, tous azimuts, difficiles à repérer et qui permettraient de frapper le territoire américain sur une trajectoire non polaire bien plus facilement qu’avec un Bourevestnik.
De même, la torpille Poseidon, si elle pourrait sans doute frapper de manière inopinée un grand port, n’apporte pas de capacité concrète vraiment nouvelle : New York ou San Francisco peuvent là encore être atteintes par une attaque surprise depuis un sous-marin s’approchant à quelques dizaines de kilomètres de côtes bien trop longues pour être surveillées de façon étanche.
Conserver de tels programmes « exotiques » actifs dans un pays en pleine guerre et qui peine à moderniser toutes ses forces stratégiques et conventionnelles doit avoir une autre motivation.
Et c’est sans doute du côté de la peur qu’il faut chercher.
Au-delà du calcul rationnel, Moscou cherche à instiller la peur chez ses adversaires, leurs décideurs et leurs opinions — pour réveiller de vieilles phobies.
Semer « la terreur » en Europe
Le cœur de la dissuasion repose sur un calcul rationnel.
Parce qu’elle est porteuse d’une promesse de destruction et qu’elle se doit de comporter une dose d’ambiguïté pour compliquer le calcul stratégique de l’autre, la dissuasion doit pourtant reposer aussi sur une dose de peur.
Celle-ci participe pleinement de son bon fonctionnement puisqu’elle est de nature à faire hésiter — « au bord du gouffre » — un dirigeant qui penserait avoir trouvé une formule pour agresser l’autre en contournant, détruisant, neutralisant ou encaissant les capacités qui devraient le dissuader.
Le précédent de la Guerre froide
Cette peur a des ressorts profonds.
Peur pour soi, peur pour ses proches, peur pour sa patrie ; peur de mourir, mais aussi peur d’échouer, de perdre la face, là encore devant soi-même, ses proches, ses amis ou son peuple. Pendant la Guerre froide, on résumait cette idée par un slogan cherchant l’espoir dans la peur : « Même les Soviétiques aiment leurs enfants. »
Si le comportement le plus courant — et, semble-t-il, le plus adapté — reste celui de la froide détermination, en temps de crise, certains dirigeants peuvent volontairement adopter un comportement qui se veut effrayant, pour faire douter de leur propre rationalité. On a ainsi reproché à Nixon sa madman theory 19 et un comportement qualifié de brinkmanship 20.
Faute de fournir un message politique désirable, la Russie construit son image sur un message terrifiant.
Stéphane Audrand
Parce qu’elle tend à rendre plus concrète et incarnée la promesse de destruction, la peur peut avoir son intérêt dans le dialogue stratégique, notamment nucléaire.
Ainsi, lors de la crise de 1969 entre l’URSS et la Chine, face à Mao qui considérait que son pays était, par la taille de sa population, immunisé face à la dissuasion nucléaire soviétique, Moscou avait laissé entendre via ses canaux d’influence que les frappes nucléaires éventuelles contre la Chine pourraient viser non pas à massacrer la population, mais à décapiter la direction du Parti communiste chinois. Cela aboutit à un éparpillement paniqué des cadres du Parti, à la seule mise en alerte connue à ce jour des forces nucléaires chinoises, mais aussi à un recul de la Chine dans ses agressions sur la frontière sibérienne et à l’ouverture de négociations 21.
C’est là un usage de la peur comme complément du calcul rationnel, mais dans une démarche qui reste fondamentalement dissuasive.
À dire vrai, pendant toute la Guerre froide, Moscou a joué sur cette peur du nucléaire, notamment en Europe. Il s’agissait pour l’Union soviétique d’insister sur les dégâts que provoquerait l’emploi d’armes nucléaires sur le sol européen — voire de les fantasmer — et de surjouer systématiquement la peur de l’atome pour diviser l’Alliance atlantique, saper la légitimité de la dissuasion et espérer permettre à l’URSS d’exploiter son avantage numérique conventionnel en cas de conflit.
L’imaginaire occidental développé dans les médias a, dès les années 1950, associé l’atome à l’apocalypse et la radioactivité à un mal suprême, d’autant plus « maléfique » qu’il est invisible.
Le point culminant de cette peur fut sans doute la crise des euromissiles, qui vit d’immenses vagues de protestation en Europe, motivées et alimentées par l’URSS via ses relais de propagande. Cette situation fit dire à François Mitterrand, fort lucide, que « le pacifisme est à l’Ouest et les euromissiles sont à l’Est ». Il ne s’agissait pas pour l’Union soviétique de dissuader par un calcul rationnel, mais d’obtenir un avantage en prenant appui sur la peur primale du nucléaire et la vulnérabilité d’une société démocratique aux phobies collectives se transcrivant en choix électoraux.
C’est probablement la même stratégie qui anime l’ancien officier du KGB Vladimir Poutine depuis février 2022 lorsqu’il tire profit de la menace nucléaire
Certes, le maître du Kremlin a beau jeu d’exploiter la peur : il a pour lui la stabilité relative de l’autocrate et la capacité à ignorer les peurs de sa population. Surtout, peut-être, il peut d’autant plus facilement jouer de la peur qu’il inspire que nous ne sommes pas en capacité intellectuelle, politique ou matérielle de lui rendre la pareille.
La nouvelle rhétorique russe
Pour se convaincre qu’il s’agit avant tout d’une stratégie déclaratoire — et, donc, se rassurer un peu — il faut différencier, depuis trois ans, le comportement et le discours.
Le comportement russe en matière nucléaire est resté relativement cohérent et prévisible : les exercices des forces stratégiques se déroulent à date prévue, ils impliquent toujours les composantes habituelles et s’inscrivent dans les cycles annuels connus.
Le signalement stratégique de mars 2022 (mise en alerte des forces stratégiques russes, sortie des SNLE occidentaux) a été l’occasion d’un « dialogue » tendu mais classique entre la Russie et les puissances nucléaires occidentales, et aucun signal concret indiquant une option nucléaire russe imminente et crédible n’a été signalé publiquement depuis 22.
Il en va tout autrement du discours public, de plus en plus agressif et désinhibé, menaçant urbi et orbi — soit directement par la voix du Kremlin, soit par des individus plus ou moins proches du pouvoir, au premier rang desquels l’ancien président Dimitri Medvedev, devenu le « Monsieur Apocalypse nucléaire » du Kremlin.
Au-delà des rodomontades des propagandistes, certains des plus proches conseillers en matière de stratégie poussent dans cette direction de l’effroi comme arme décisive contre l’Europe.
Sergueï Karaganov déclarait ainsi dès 2023 qu’il fallait construire une stratégie de « dissuasion et d’intimidation » qui envisage l’utilisation des armes nucléaires, estimant qu’il n’y aurait pas de représailles américaines en défense de l’Europe (et ignorant les dissuasions française et britannique 23).
Tout récemment, poursuivant son cheminement, le même Karaganov déclarait à la télévision publique qu’il fallait changer de stratégie — la Russie s’étant montrée selon lui trop raisonnable et mesurée — et s’efforcer « d’instiller la terreur et la crainte de Dieu chez les alliés européens des États-Unis ».
Estimant que l’arme nucléaire avait été laissée « en marge du grand jeu russe », il fallait maintenant envisager un « châtiment » contre les voisins européens, d’abord conventionnel puis, si nécessaire, nucléaire. Châtier n’est pas dissuader : Karaganov fait entrer la rhétorique nucléaire dans un âge du chantage messianique.
Sergueï Karaganov a fait partie des conseillers ayant poussé à une révision de la doctrine nucléaire russe, jugeant qu’elle était trop timide et fixait trop haut le seuil d’emploi de l’arme nucléaire. Si la révision de décembre 2024 reste finalement conforme à l’idée d’une doctrine défensive réservant l’arme nucléaire à des fins dissuasives dans le cadre de scénarios extrêmes, il ne faut pas sous-estimer l’influence que peut avoir ce genre de discours dans les cercles de pouvoir.
Ce type de propos présente deux types de risques : pour la Russie, que le pouvoir russe finisse par s’auto-intoxiquer avec ses propres éléments de langage ; pour l’Europe, qu’elle se soumette à cette peur, alors même que, pour l’heure, l’arme nucléaire n’a pas été décisive pour faire triompher l’agression russe — parce que la dissuasion fonctionne.
L’impasse d’une stratégie européenne : le bouclier sans l’épée
Si l’on a beaucoup évoqué pour justifier ces discours la stratégie de « sanctuarisation agressive » russe en matière nucléaire, celle-ci a toutefois montré ses limites.
Certes, les pays occidentaux ont été dissuadés d’intervenir directement en Ukraine ; il semble d’ailleurs, vu le comportement de l’administration Biden et de ses alliés européens dès la crise de l’hiver 2021-2022, qu’ils s’en sont dissuadés eux-mêmes assez rapidement sans que les menaces russes ne soient déterminantes dans cette crainte occidentale d’une intervention directe pour sanctuariser l’Ukraine. En revanche, la rhétorique russe n’a pas réussi à paralyser l’aide à l’agressé, au moins jusqu’à l’élection de Donald Trump.
Parce qu’elle tend à rendre plus concrète et incarnée la promesse de destruction, la peur peut avoir son intérêt dans le dialogue stratégique, notamment nucléaire.
Stéphane Audrand
En cela, l’arme nucléaire russe n’a que partiellement réussi à « sanctuariser » son agression — la dissuasion occidentale ayant en revanche protégé le territoire des États de l’Alliance, puisqu’aucun n’a été frappé par la Russie de manière délibérée pour entraver l’aide à l’Ukraine ; d’un autre côté, le territoire russe est frappé chaque jour par l’Ukraine, bien au-delà des territoires ukrainiens occupés par la force depuis 2014, y compris à l’aide d’armes occidentales. Pour l’heure, en dehors d’une modification de sa doctrine nucléaire censée « abaisser le seuil » et le rendre encore plus « flou », le Kremlin n’a pas vraiment progressé dans cette « sanctuarisation » de son agression.
Dans ces conditions, si la dissuasion nucléaire russe fonctionne toujours dans sa rationalité pour protéger les intérêts les plus vitaux — si elle est aussi parvenue à une forme de limite dans sa capacité à freiner l’assistance occidentale à l’Ukraine — le battage et la consommation de ressources autour du Bourevestnik et du Poseidon ne se justifient guère que par la recherche d’une « incarnation » de la terreur que peut représenter la Russie, incarnation qu’elle se doit de projeter autant contre ses adversaires que vers sa population.
La Russie a recours à cette stratégie précisément parce que des armes peuvent avoir un effet psychologique considérable sur les opinions occidentales ; elles contribuent aussi à faire reculer le calcul stratégique rationnel au profit du réflexe de peur irrationnelle 24. Dans tous les cas, il s’agit d’installer dans les esprits l’idée que la Russie pourrait frapper n’importe où et n’importe quand, avec des armes que les Européens ne pourraient arrêter, et sans qu’il leur soit possible de répliquer, surtout depuis le retour de Donald Trump.
Cette peur a plusieurs vertus pour la Russie.
D’une part, elle crée dans les populations européennes un sentiment de vulnérabilité — sentiment d’autant plus important dans les pays d’Europe ne disposant pas d’une dissuasion nucléaire autonome. L’exemple de l’emploi du missile Orechnik contre l’Ukraine en novembre 2024 a été frappant : en Allemagne et en Scandinavie s’est développée une véritable phobie, aboutissant à la recherche d’abris et de bunkers pouvant abriter la population. Ce n’était pas le cas en France, pays à la fois plus éloigné mais qui se sait surtout protégé par sa propre dissuasion nationale autonome.
Le programme européen du « mur anti-drones » est un autre exemple de cette pensée réflexe issue d’une peur panique.
Face à l’incursion agressive des drones russes au-dessus de la Pologne et au désarroi qu’ils créent dans la population, la peur conduit une partie des décideurs européens à essayer de trouver une réponse strictement défensive et technologique, en envisageant la promesse d’une « défense totale » qui pourrait non pas dissuader, mais décourager l’agression russe.
Cette instrumentalisation de la peur parvient donc en même temps à saper la confiance des populations européennes envers leurs dirigeants, à renforcer l’image d’une Russie ne craignant pas les représailles et à détourner une partie substantielle des crédits européens de défense dans la recherche d’une chimère défensive totale.
À l’autre bout du spectre, le Bourevestnik ravive la crainte d’une menace nucléaire russe omniprésente et foudroyante.
La stratégie russe de la terreur fonctionne comme une tenaille : de l’essaim de drones tueurs à l’apocalypse nucléaire.
Moscou cherche, au-delà du calcul rationnel, à instiller la peur chez ses adversaires, leurs décideurs et leurs opinions.
Stéphane Audrand
Une Alliance atlantique sans tête
L’impact est d’autant plus fort que non seulement le leadership américain de l’Alliance atlantique n’est pas là pour rassurer les Européens et faire prévaloir le calcul rationnel de la dissuasion, mais que Donald Trump est lui-même vulnérable à l’influence de la peur et agit de manière à renforcer, volontairement ou non, les actions de propagande russe.
Ne lisant notoirement aucun des documents qui lui sont fournis, s’informant par ouï-dire et sur les réseaux sociaux, étant de longue date hostile aux armes nucléaires et ouvertement effrayé par elles, le locataire de la Maison Blanche qui prétendait être « l’adulte dans la pièce » au Conseil de l’Atlantique Nord — le Secrétaire général de l’OTAN Mark Rutte ne l’appelait-il pas « daddy » ? — s’avère être lui aussi une victime potentielle de la rhétorique de peur moscovite.
S’il vient d’annoncer une reprise possible des essais nucléaires américains, il n’est pas certain que cela soit la marque du retour d’un leadership américain stable et rationnel sur le sujet. Au contraire, la déclaration du président américain, qui semble mélanger tests des vecteurs et essais des armes nucléaires, suggère plutôt une forme de pensée réflexe à la fois instable et éloignée de la rationalité historique des stratèges américains qui avaient, depuis 1949, réussi à la fois à dissuader l’URSS (le plus simple) et à rassurer les alliés européens (le plus difficile).
Avec une Alliance dont le leadership historique hésite entre repli sur soi et vassalisation, des États très divisés face aux questions de dissuasion et des institutions communautaires pensées pour une ère de paix par le commerce, l’Europe semble bien démunie face à l’agenda du Kremlin, qui vise à diviser et à soumettre les populations européennes, à saper la confiance dans la démocratie, dans l’Union et dans l’Alliance et à détruire tout ce qui fait notre prospérité et notre force.
Faute de fournir un message politique désirable, la Russie construit son image sur un message terrifiant, et l’Amérique n’est plus là pour nous rassurer. Que faire ?
Déjouer la « tentation Karaganov » : la nouvelle dissuasion européenne
Nommer la peur est sans doute le premier pas pour la vaincre.
Admettre qu’une grande partie de la rhétorique russe ne vise pas la raison mais les émotions est un point crucial, notamment pour les analystes des questions stratégiques qui ont trop tendance, par influence du réalisme, à se concentrer sur le froid calcul 25.
Une fois admis l’impact de cette peur — dans nos populations comme chez nos dirigeants — il faut l’affronter et faire en sorte que le dialogue stratégique avec la Russie revienne sur le chemin du calcul rationnel et de la dissuasion ; non pas en instillant nous-mêmes la terreur, mais en étant déterminés et crédibles.
Accepter la peur pour la dominer
Pour ce faire, il faut accepter que la voie du « découragement » de l’agression soit irrationnelle sur le plan stratégique et n’ait pour ressort que nos peurs.
L’idée de doter l’Europe d’un « mur » de défense contre les drones et les missiles, comme le proposent largement la Commission européenne et l’Allemagne, a pour fondement l’idée implicite et fausse qu’on ne peut pas frapper la Russie et qu’il faut donc empiler les boucliers, faute de pouvoir tirer l’épée.
Or la dissuasion vis-à-vis de Moscou repose depuis le début de la Guerre froide sur la promesse de représailles en cas d’agression et pas seulement d’une défense puissante. Que ces représailles soient définies comme massives ou graduées ne change rien : depuis 1949, le monde occidental a toujours promis à tout agresseur qu’il subirait en cas d’attaque des coûts qui dépasseraient de loin les bénéfices de l’agression — en somme, des coûts insupportables.
Il faut souligner que, depuis quelques années, des échanges militaires violents ont impliqué des puissances nucléaires, sans que le seuil d’emploi de l’arme ne soit franchi ni qu’aucune « escalade irrémédiable » ne soit engagée. L’Inde a frappé le Pakistan, Israël et l’Iran ont échangé des salves de missiles — or, à chaque fois, les représailles ont été l’occasion à la fois d’une soigneuse planification militaire et d’un intense travail diplomatique, pour faire comprendre à l’agresseur que les représailles ne visaient absolument pas à engager une escalade guerrière ou à monter aux extrêmes mais bien à répondre à l’agression pour la faire cesser et à rétablir la dissuasion — d’abord par des moyens conventionnels.
Ce chemin doit commencer à être emprunté en Europe.
En dehors de la France et du Royaume-Uni — deux puissances nucléaires habituées à avoir leur destin national en main et à parler de concert lorsque les menaces extrêmes surgissent — les pays d’Europe sont tragiquement dépendants de Washington pour fixer un cap dans l’usage de la force.
Que ce cap manque ou qu’il soit, comme aujourd’hui, erratique ou incertain, et c’est le réflexe du bouclier qui prévaut.
Mais sans épée et sans volonté de s’en servir, le meilleur bouclier du monde n’imposera jamais à l’agresseur des coûts insupportables.
La grande question qui demeure, depuis février 2022, est donc bien celle-ci : les Européens veulent-ils collectivement être les garants de leur propre existence, ou souhaitent-ils s’en remettre à d’autres qui leur concèderont — peut-être — le droit d’exister ?
Troquer le bouclier pour l’épée : après le Groenland, un signalement stratégique au Svalbard
Une fois entamé ce changement de nos modèles mentaux — et il sera long — il y aura des réformes à la fois militaires et institutionnelles à engager.
Sur le plan militaire, être prêts à rétablir la dissuasion vis-à-vis de la Russie impose de se doter de capacités à la frapper de manière prompte et efficace, afin de faire cesser toute agression contre nous, comme nous en avons le droit de par l’article 51 de la Charte des Nations unies.
Si les capacités nucléaires combinées de la France et du Royaume-Uni — autour de 500 armes nucléaires — sont suffisantes pour garantir la sécurité du continent européen contre les menaces les plus extrêmes, il faut néanmoins disposer de capacités conventionnelles plus autonomes et plus crédibles pour mener des représailles conventionnelles graduées en cas d’agression, et ne pas être confrontés à une situation où nous devrions choisir entre « le M51 ou rien ».
La structuration d’une capacité européenne de représailles conventionnelles est essentielle. Comme nous ne pouvons pas tout financer, il faut donc avoir le « courage » d’ignorer publiquement le Bourevestnik et d’abandonner l’idée d’une défense antimissiles et antidrones totale du territoire européen. Le renforcement de la défense antiaérienne dont nous avons besoin est réel, mais doit se limiter aux emprises clefs de nos forces militaires — les grandes bases — et aux sites les plus vitaux de nos systèmes politiques et de nos économies — sites gouvernementaux, infrastructures énergétiques et de transport.
Il ne s’agit pas ainsi de protéger nos populations de tout acte hostile, mais de disposer d’un bouclier nous prémunissant contre toute frappe désarmante, qui complète l’épée prête à frapper l’agresseur, avec ou sans l’aide ou l’assentiment des États-Unis. Disposer en Europe de ces capacités est crucial, pour notre survie politique, pour la survie de l’Alliance et de l’Union et même pour notre crédibilité vis-à-vis de Washington.
Les pays d’Europe sont tragiquement dépendants de Washington pour fixer un cap dans l’usage de la force.
Stéphane Audrand
Pour contrer la « tentation Karaganov » d’une frappe nucléaire, la coordination franco-britannique a un défi majeur : faire admettre l’existence d’une dissuasion nucléaire crédible qui protège l’Europe sans l’avis de Washington.
Il semble pourtant que, pour l’heure, les cercles décisionnaires russes ne croient pas vraiment à une projection des garanties de sécurité franco-britanniques au-delà de leurs territoires respectifs si les États-Unis s’abstenaient 26.
C’est là un enjeu majeur, qui doit passer à la fois par des déclarations communes, mais aussi par des signalements stratégiques calibrés vis-à-vis de la Russie.
Le raid Pégase de l’Armée de l’Air et de l’Espace réalisé en 2025 au-dessus de la Scandinavie, ou le déploiement de Rafale en Pologne issus d’unités des Forces aériennes stratégiques peut participer à ces signalements.
Mais nous pouvons et nous devons aller plus loin.
Ainsi, plutôt que de prolonger une séquence symbolique mais d’un intérêt discutable au Groenland, on pourrait envisager la même séquence, franco-britannique, au Svalbard norvégien — menacé de manière beaucoup plus immédiate et directe par la Russie.
Sortir la défense du jeu politique
Les capacités militaires dont nous devons disposer — bouclier et épée — n’ont de valeur que si une volonté est là pour les utiliser.
Sur le plan institutionnel, afin de contrer la peur, il importe que les Européens engagent des réformes qui, à l’échelon national comme aux échelons communs de l’Alliance et de l’Union, matérialisent leur détermination et leur capacité démocratique à employer la force de manière résolue, sans qu’une crise politique « courante » ne mine notre crédibilité ou ne paralyse notre réponse, ni que tout ne repose sur l’allié américain.
Sur le plan national, chaque pays devrait avoir à cœur de trouver une voie qui sécurise ses capacités nationales d’engagement en les plaçant à la fois sous contrôle démocratique mais hors de l’écume du jeu politique. Pour la France, cela pourrait être par exemple une réforme de l’élection et de l’exercice du pouvoir présidentiel. En (re)faisant du président de la République un arbitre, garant de l’indépendance nationale, qui ne présiderait plus le Conseil des ministres mais serait toujours le chef des armées, nous retrouverions sans doute une crédibilité que la crise politique actuelle nous fait perdre un peu chaque jour ; ce nouveau rôle du Président, adossé à des capacités de frappe nucléaires et conventionnelles crédibles, aériennes et balistiques, serait de nature à donner du crédit à toute garantie de sécurité donnée par la France à l’espace européen — surtout s’il contribue de manière efficace à l’animation du tandem Paris-Londres.
À l’échelle de l’Union et de l’Alliance, il est de même urgent de développer nos capacités d’agir avec les États-Unis si nous le pouvons, et sans eux si nous le devons, tout en conférant aux institutions communes un rôle de facilitateurs mais non de décideurs supranationaux.
Le cadre pertinent est celui de la « coalition des volontaires » : un groupe de pays ouvert, informel, qui discute de sujets concrets plutôt que de virgules dans un communiqué final, et qui permette à tout l’espace européen de renforcer sa sécurité en s’appuyant sur les pays les plus avancés et volontaires en matière d’autonomie stratégique et en admettant un « partage des tâches » face au péril commun.
Sans épée et sans volonté de s’en servir, le meilleur bouclier du monde n’imposera jamais à l’agresseur des coûts insupportables.
Stéphane Audrand
C’est de cette coalition des volontaires européens — en y ajoutant le Canada — qu’il faut obtenir le signal fort d’une détermination à protéger l’espace démocratique européen par la force en infligeant à tout agresseur des coûts insupportables.
Pour l’instant, Vladimir Poutine et Sergueï Karaganov estiment que nous sommes décadents et faibles.
Si nous ne parviendrons sans doute jamais à les détromper sur le premier point, nous avons les moyens de leur faire comprendre qu’ils ont tort sur le second.
Le Bourevestnik ou du Poseidon ne sont pas des armes d’apocalypse. Ce sont des armes de peur, un moyen de créer une paralysie désarmante en Europe.
Nous commencerons à gagner au moment où nous aurons commencé à ne plus avoir peur.
L’article Nucléaire : face à Poutine, l’Europe doit apprendre à faire peur est apparu en premier sur Le Grand Continent.
26.10.2025 à 06:30
Le nouvel antisémitisme
Matheo Malik
Nous n'avons pas encore mesuré toutes les conséquences du plus grand succès stratégique du Hamas : depuis le 7 octobre, un nouvel antisémitisme s'est enraciné en Occident.
Alberto Melloni signe un texte important : la méditation lucide et angoissée d'un des plus grands historiens du christianisme.
L’article Le nouvel antisémitisme est apparu en premier sur Le Grand Continent.
Texte intégral (8698 mots)
Pour l’historien, il y a des questions particulièrement lancinantes. Et lorsque les comptes ne tombent pas juste — les comptes intellectuels, s’entend —, elles refont surface comme un présage sinistre et inéluctable, le signe de cette « mondialisation de l’impuissance » que dénonce le pape Léon XIV — en admettant par là-même qu’il en est lui aussi victime.
L’une de ces questions topiques a trait à la manière, aux temporalités et aux étapes par lesquelles s’est formé cet objet historique dense, complexe et stratifié que nous appelons antisémitisme — et qu’il serait plus précis et utile d’appeler die Sache-Antisemitismus.
Que des convictions et des mystifications théologiques, des théories scientifiques et pseudo-scientifiques, des sentiments politiques et des emballements se soient entremêlés derrière ce terme, tout le monde le conçoit. Tout le monde sait d’ailleurs que cette « chose » — élaborée entre les conciles du IVe siècle et celui de 1215, puis de Luther jusqu’au XXe siècle — a marqué le règne de la chrétienté et empoisonné la catéchèse des églises ; tout le monde sait qu’elle a subi une métamorphose politique spectaculaire et disséminé une théorie justifiant abominations et persécutions, jusqu’à la planification de l’extermination industrielle des Juifs d’Europe, apogée distincte — et conséquence — de tout ce qui l’a préparée.
Mais d’un point de vue historique, le vrai questionnement n’est pas tant qu’il y ait eu un enchevêtrement d’horreurs au centre du XXe siècle, ni, bien sûr, que cet enchevêtrement ait eu des origines, des causes et une histoire.
La question historique la plus angoissante est beaucoup plus tranchante, précise et pointue.
Si l’on voulait la décomposer en une série de sous-questions — énoncées de manière presque casuistique — cela donnerait à près la liste suivante.
Pourquoi le pape Léon le Grand, peu de temps après les décrets impériaux qui frappaient les chrétiens et les juifs des mêmes sanctions, invente-t-il un vocabulaire d’invectives sur le sacrilège déicide, destiné à perdurer dans le temps ?
Pour quelle raison précise — culturelle, théologique, politique — les croisés qui se mettent en marche sous le commandement de la papauté grégorienne, alors qu’ils descendent vers les embarquements du sud, massacrent-ils les juifs ?
Par quels instruments spécifiques le droit canonique médiéval emprunte-t-il des éléments à la théorie augustinienne, sur la nécessité d’un judaïsme minoritaire et humilié au sein des sociétés chrétiennes, pour fixer des lois de discrimination ?
Quel mécanisme a fait que la haine des Juifs fut le seul point de contact entre évangéliques et papistes au début de la réforme luthérienne ?
Sur quelle base les figures ecclésiastiques qui connaissaient l’ancien principe interdisant le baptême invitis parentibus le contournent-elles — conduisant à une période allant des conversions forcées à l’enlèvement d’enfants juifs ?
Sous nos yeux, le présent a commencé à accumuler des preuves qui suggèrent à quel point la formation d’une culture de mépris et de haine anti-juive peut être rapide, précise, géométrique.
Alberto Melloni
Quel est le passage conceptuel qui mène de la haine anti-musulmans à la haine anti-juifs et à la culture de l’ennemi qui les nourrit ?
Et pourquoi si peu de croyants, dans l’Europe de Karl Barth et de Dietrich Bonhoeffer, voient-ils que les stéréotypes de la discrimination chrétienne correspondent aux politiques nazies et fascistes qui persécutent d’abord les droits, puis la vie des Juifs ?
Le retour de la guerre et le retour de l’antisémitisme
Ce sont là des questions qui ont ponctué le travail quotidien de ceux qui ont abordé l’antisémitisme de manière professionnelle et scientifique.
Des questions froides et hors-sol en apparence — intimement urgentes en vérité.
Mais un présent désespérant a fait irruption, dans lequel pòlemos est revenu avec la force d’un dieu « pater, c’est-à-dire potens » — expliquait le philosophe Massimo Cacciari dans un essai sur le célèbre fragment 53 d’Héraclite où la guerre, comme toujours en grec, est au masculin — dont « la puissance ne se manifeste pas en détruisant, mais en posant » et « qui unit tout le monde précisément en exacerbant les différences » ; en nous rendant antagonistes, hostiles, incapables de communiquer.
Sous nos yeux, le présent a commencé à accumuler des preuves qui suggèrent à quel point la formation d’une culture de mépris et de haine anti-juive peut être rapide, précise, géométrique — cette culture même dont nous interrogeons, en historiens, la genèse.
Des signes, des indices, des mentalités émergent d’un contemporain dans lequel se renouent — comme toujours dans la candeur d’une apparente « innocence » subjective chez ceux qui l’expriment — un antisémitisme ancien et sa métamorphose moderne.
Ce nouvel antisémitisme est rendu invulnérable par un argument tout aussi géométrique et objectif, qui refuse de l’utiliser comme alibi face à une guerre qui n’est pas plus horrible que tant d’autres, mais sur laquelle s’est déclenché un incendie verbal rongé de cynisme politique.
Comme un dinosaure devant Ellie Sattler et Alana Grant dans Jurassic Park, une énorme haine antisémite qui semblait éteinte marche devant nous, se déplace, se nourrit, se reproduit.
Les théologies et le concile semblaient l’avoir rejetée et fossilisée par des décennies de dialogue judéo-chrétien.
La lucidité morale des constitutions démocratiques et du sens civique semblait l’avoir enfouie sous une montagne de « plus jamais ça ».
Au lieu de cela, nous voyons sous nos yeux les anciens stéréotypes de l’antisémitisme chrétien — parfois défini comme « antijudaïsme » avec une nuance dont la fonction est en fait implicitement auto-absolutrice — réapparaître dans une variante sécularisée — mais pas trop non plus : l’accusation de déicide, la diaspora comme sanction, la légende de l’effusion rituelle du sang des enfants faisaient passer cet antisémitisme d’un autre temps pour un mythe populaire et grand public, cru et crédible ; elles ont ressuscité et se sont régénérées dans un nouvel amalgame.
Cette réutilisation des vieux thèmes apportera la tragédie à ceux qui seront victimes de la violence qu’elle légitime ; mais elle frappera ensuite les compilateurs des nouveaux bréviaires de la haine — qui se retrouveront avec entre les mains un sens de la liberté détrempé de sang et une profession de foi corrompue par la haine.
Abstraction faite de ceux qui n’avaient jamais renoncé à l’antisémitisme, ce spectacle soulève pour les autres une question brûlante : aurions-nous dû nous attendre au retour de l’antisémitisme ?
Ma réponse est la suivante : non seulement nous aurions dû nous y attendre, mais nous savions qu’il reviendrait.
Nous le savions si bien que nous ne pouvions pas nous l’avouer.
Nous n’avions juste pas les bons instruments pour nous dire explicitement que les innombrables « plus jamais ça » des cérémonies sur la Shoah et l’indignation collective face aux attentats contre les synagogues, les restaurants casher ou les écoles juives d’Europe, l’alerte face à la haine dans les stades, étaient tous fondés sur du sable. Tous. Les hypocrites comme les plus sincères pouvaient arriver à cette conclusion. Du sable rempli de nobles intentions — mais du sable. Du sable mélangé à de la prose pleine d’émotions — mais du sable.
Une énorme haine antisémite qui semblait éteinte marche désormais devant nous.
Alberto Melloni
La mémoire des survivants, condamnés à se souvenir et à demander de se souvenir, semblait avoir fixé la ponctuation morale du discours public : leurs voix brisées, leurs visages « endurcis » (Is 50,7), leurs paroles lentes permettaient de ne pas dire que cette partition était tracée sur des lignes souvent vides, dans lesquelles nous espérions que le temps écrirait l’analyse profonde, impitoyable, sévère, que nous ne souhaitions pas faire nous-mêmes
Ces survivants, eux, avaient le pressentiment de cette dissolution.
Les plus implacables envers eux-mêmes, comme Primo Levi, en avaient d’ailleurs été broyés. Les plus pessimistes — je pense à Liliana Segre — décrivaient amèrement un avenir dans lequel ce qu’ils avaient porté et enduré se réduirait à dix lignes dans un manuel scolaire — une simple leçon de chose, comme un exemple de la méchanceté humaine.
Les autres se fiaient à une superstition civique qui s’énonçait comme une règle de grammaire latine : « les verbes spero, promitto et iuro sont toujours suivis de l’infinitif futur ».
Et alors, avec un volontarisme impatient, les autres se plongeaient dans des gestes et des textes artistiques, historiques, cinématographiques — une véritable liturgie de la mémoire. Ils étaient convaincus que quelques notes — le « si-mi, si-mi, do-si-sol-si » de John Williams dans La Liste de Schindler, par exemple — suffiraient à saturer la surdité des indifférents d’un acouphène sentimental.
Ils supportaient les enchantements de Roberto Benigni à Birkenau dans La vie est belle comme si une telle épreuve pouvait en quelque sorte se fondre dans le creuset de l’histoire.
Ils encourageaient la transhumance saisonnière des jeunes vers les camps, accompagnés de maires et d’enseignants volontaires stimulant l’identification de soi-même à la souffrance ; une identification qui ne s’accompagnait pas de l’exigence nécessaire — et nécessairement radicale — qu’aurait exigé ce contexte et qui devenait ainsi une compassion générique pour une autre douleur qu’elle comblait du même mouvement, par une simple effusion de larmes — une minute, un jour, une heure.
La logique de la mémoire comme « émotion » a ainsi laissé intacts les préjugés qui paissent dans le temple sordide des consciences insensibles aux exorcismes ordinaires — car l’exorcisme fonctionne si le Mal est appelé par son nom, s’il est reconnu dans son être non pas absolu mais très humain, s’il est raillé, quitte à s’exposer à la vengeance.
Nous savions tout — et nous le savions tous.
Mais nous espérions que ce château de cartes pourrait retarder, repousser d’une génération le moment où il faudrait rendre des comptes ; peut-être même deux générations ; ou trois. Puis — qui sait ? — le sable du temps passerait et le mal, alors, serait oublié.
La Shoah en miniature et la pédagogie du sang
Pourtant, il a suffi de quelques heures un 7 octobre — comme la date de la fusillade des rebelles d’Auschwitz, comme la date du début de la guerre du Kippour.
Quelques heures utilisées pour quelque chose d’infiniment plus important qu’une nouvelle scène du conflit israélo-arabe.
Dans cette bande de terre palestinienne que le siège israélien avait transformée en un terreau parfait, une série d’actes, pondérés avec méthode, a été préparée avec la même précision que celle par laquelle un prédicateur scrupuleux choisit les formules de ses invocations.
Grâce à l’argent des nababs vénérés par les vendeurs de Rolex et de Ferrari.
Grâce à l’inefficacité de l’armée la plus puissante du Moyen-Orient.
Grâce à la confiance stupide dans les technologies de renseignement les plus coûteuses au monde.
Grâce à l’illusion que les maîtres de la bande de Gaza étaient les alliés fiables des efforts déployés par le gouvernement israélien pour réduire « l’autorité » de l’Autorité palestinienne à des proportions vaticanes.
Grâce à la patience avec laquelle les Frères musulmans — qui habillaient les enfants en tenue de camouflage, les décoraient du ruban des martyrs, les entraînaient dès l’âge de cinq ans à prendre un otage et à le tenir en joue — avaient construit une pédagogie du sang qui portait en elle une soif de vengeance.
Tout a été vu, tout a été photographié, tout a été dit.
Tout a été ignoré.
Tout a été sous-estimé par un gouvernement qui s’appuie sur des personnages que la presse qualifie de « messianiques » ou d’« ultra-orthodoxes ». Des personnages qui ont peu à voir avec le judaïsme de Martin Buber, Franz Rosenzweig ou Emmanuel Lévinas — car le fondamentalisme biblique dont ils se vantent n’est pas redevable aux pères fondateurs de la sagesse du judaïsme ou du sionisme ou de l’État d’Israël, mais dérive d’une hérésie évangélique américaine qu’on appelle généralement le sionisme chrétien.
Cette doctrine fixe la seconde venue du Christ à un moment postérieur à la reconstitution du royaume de Juda, à la destruction des mosquées, à la reconstruction du Troisième Temple, à la reprise du sacrifice et du véritable holocauste, offert à la présence divine… Une pantomime chrétienne dont le matérialisme amoral aurait terrifié les maîtres de toutes les générations venues après Moïse — mais qui a trouvé dans certains partis et certains milieux sa niche électorale et théologique.
Jusqu’au jour fixé : Shemini Atzeret — le même shabbat que lors de l’attaque de la synagogue de Rome en 1982.
Ce jour-là, les enfants d’un système éducatif dans lequel ils avaient défilé vêtus de costumes de soldats — ceux qui avaient chez eux la photo de leurs pères en cagoule noire les tenant dans leurs bras — ont attaqué l’ennemi de toujours, avec un objectif précis, identique pour chacune des brigades déployées.
L’objectif n’était pas de commettre un acte terroriste — même très sanglant.
L’objectif était de produire une « Shoah en miniature ».
L’objectif était de faire subir, en terre d’Israël à des jeunes, laïques et dansants, à des habitants de kibboutz « pacifistes », à des soldats et soldates de conscription qui avaient donné quelques signaux d’alarme ignorés dans le brouhaha du bizutage de caserne, tout ce qui avait été infligé pendant la Seconde Guerre mondiale à leurs grands-parents et arrière-grands-parents en Ukraine et en Pologne, en France et en Croatie, en Italie ou en Allemagne.
Le 7 octobre n’était pas un acte de terrorisme commis par des terroristes. Ce n’était pas un acte de résistance — cette attaque n’avait rien à voir avec l’État palestinien. Ce n’était pas non plus un geste « spectaculaire » à la Ben Laden.
C’était l’acte par excellence d’un État sui generis qui allait accomplir sa finalité statutaire et étatique avec ses propres soldats : tuer, brûler, violer, mutiler et — enfin et surtout — déporter. Déporter pour tuer ; tuer pour déporter.
C’était un message qui disait clairement à ceux qui avaient souvent utilisé le théorème de la « terre des Pères » lointains que leurs pères proches étaient venus là, dans ce rectangle de l’ancien Empire ottoman, pour rien.
Car lorsque le Hamas affirme que « le drapeau d’Allah doit flotter sur chaque centimètre de Palestine », selon la formulation des Frères, il évoque pour ses sujets et ses esclaves un destin de mort.
Mais lorsque le Hamas planifie et réalise les plans du 7 octobre, il ne mène pas une « guerre » comme tant d’autres. Il mène « cette » guerre : l’extermination.
Ne pouvant commettre un « génocide » de dimensions nazies, il a dû se limiter à sa miniaturisation : mais comme un maquettiste obsessionnel qui collectionne les trains électriques, il a tout reconstruit au millimètre près.
La rafle maison par maison, les portes enfoncées, les exécutions sommaires gratuites à la vue de tous, la déportation effectuée par « sélection », la captivité et, en tout état de cause, la mort d’un nombre aussi élevé que possible de « pièces », comme aurait dit Heinrich Himmler.
Tout, le 7 octobre, a été préparé et déployé pour dire qu’Israël n’avait pas de voisin hostile ni d’ennemi puissant, mais qu’il avait à ses côtés un bourreau auquel il ne pouvait échapper.
Un adversaire qui avait compris que les barbelés et le mur avaient en fait une valeur ambivalente : ceux qui les avaient mis en place pour emprisonner étaient eux-mêmes emprisonnés et ne pouvaient s’échapper de cette portion de terre qui, au lieu d’être Heretz Israël, avait été choisie par le Hamas comme ghetto d’où, à l’aube ensoleillée du 7 octobre, sont partis de Gaza les vagues de tireurs, puis de déporteurs, de violeurs, de pillards.
Il espérait exactement ce qu’il a obtenu : des morts, des otages, des réactions, des effets.
Le Hamas a fait le pari qu’il existait dans le monde un homme assez fou pour se lancer dans un bellum perpetuum sans plan — et qu’il habitait à Césarée.
Alberto Melloni
Mais surtout la marchandise la plus précieuse : la conviction que cet acte si évocateur donnerait à Netanyahou quelque chose qu’il saisirait immédiatement. Lui qui n’était ni Levi Eshkol ni Moshé Dayan, ni Golda Meir ni Yitzhak Rabin, aurait trouvé ce jour-là — s’il était parvenu à éviter une crise gouvernementale et à échapper à la mise en place d’un gouvernement d’union nationale que le chef de l’État aurait pu exiger — une fonction politique, une légitimation militaire, des prétextes, un consensus, un mandat.
Et il aurait mené la première guerre d’Israël sans objectifs stratégiques clairs.
Une guerre destinée à donner au Hamas l’autre chose dont il avait urgemment besoin : des martyrs, comme l’avait expliqué son chef Sinwar.
Des martyrs par milliers.
Des martyrs combattants — mais encore mieux s’ils étaient innocents.
Des martyrs individuels — mais encore mieux s’il s’agissait de familles.
Des martyrs adultes — mais encore mieux s’il s’agissait d’enfants. À jeter — par le biais de son ministère de la Santé — dans le système d’information, avec un bulletin qui n’aurait pas eu trop besoin d’être falsifié ni enrichi par la description des règles d’engagement israéliennes qui confient à l’IA la reconnaissance faciale (l’appeler The Gospel était un blasphème gratuit) et le choix du système d’arme « proportionné » à la valeur de la cible.
Les actes d’Israël sur les villes de la bande de Gaza ont fourni des martyrs à profusion.
Dans un contexte où l’État hébreu aurait pu mettre en place un système de représailles aussi terrible que celui qui a littéralement explosé dans les poches des commandants du Hezbollah au Liban, une série d’opérations a été ordonnée dans un environnement urbain où aucun général n’aurait voulu s’aventurer.
Le Hamas a fait le pari qu’il existait dans le monde un homme assez fou pour se lancer dans un bellum perpetuum sans plan — et qu’il habitait à Césarée.
Tout ce que les chefs et les différentes brigades du Hamas souhaitaient s’est donc produit.
Et cela continue de se produire.
Le retournement : une guerre informationnelle sans fin
Tout ce que Hamas voulait obtenir s’est produit — y compris dans le rebond médiatique.
Très peu ont dit que le 7 octobre était « un acte légitime de résistance » ou une manière pour les Palestiniens « d’affirmer leur existence ».
Peu ont dit qu’il s’agissait d’un « acte justifié de lutte d’un peuple opprimé ».
Peu s’attendaient à une réaction « modérée » de la part d’Israël — pas même Joe Biden qui avait recommandé à Netanyahou de ne pas commettre l’erreur américaine post-11 septembre.
Mais entre-temps, un tourbillon prévisible — le Hamas n’a pas utilisé de boucliers humains, mais pratiqué des sacrifices humains — a érodé l’idée qu’Israël ne faisait que réagir mais qu’il était en train « d’accomplir » quelque chose. L’aveu que les massacres de civils étaient atrocement et inacceptablement similaires à ceux perpétrés par tant d’armées dans tant de zones de guerre a cédé la place au fait qu’Israël faisait quelque chose de nouveau ; et que cela dépendait du fait qu’il était le bénéficiaire type du « double standard » selon lequel certains pays s’autorisent ce qu’ils interdisent à d’autres.
Pendant ce temps, les 1500 victimes du 7 octobre ont été « compensées » par un nombre équivalent de morts — des terroristes et beaucoup d’innocents — qui s’est agrandi. Le double, le quintuple, le décuple — cinquante fois plus.
La stratégie du Hamas consistant à installer ses commandements dans les hôpitaux a « fonctionné » ; la tactique consistant à camoufler les chefs parmi les civils et les enfants a « fonctionné ».
Le langage a changé : l’armée israélienne qui frappait est devenue Israël qui bombarde, les crimes de guerre dont étaient accusés les dirigeants du gouvernement israélien et du Hamas sont devenus l’extermination des sionistes ; les violations des lois de la guerre par le commandement israélien, la faute des Juifs. À Gaza, la guerre est devenue un massacre, une hécatombe — un « génocide ».
Était-ce là l’objectif du Hamas ?
Dans la nuit du 6 au 7 octobre 2023, dans l’attente de voir couler le sang israélien et palestinien en un « déluge », quelqu’un avait-il planifié ce renversement des rôles qui allait retourner l’opinion publique mondiale et ressusciter une haine ancienne sous une nouvelle forme ?
Quelqu’un avait-il parié, en « prenant en otage 253 Israéliens et 2 millions de Gazaouis » comme l’a dit le cardinal Zuppi, que le lancement de 5 000 roquettes et l’assaut en trois vagues sur Kfar Aza, Nir Yitzhak, Nir Oz, Re’im et la rave Supernova, serait soupçonné d’être non pas un fait militaire, mais un alibi, un complot, un prétexte finalement bienvenu ?
Le Hamas avait-il calculé que pour chaque milicien tué sur ce champ de bataille saturé, de nouvelles « vocations » verraient le jour ?
Avait-il pensé que personne ne ferait un examen de conscience politique, moral et théologique sévère sur ce qu’il avait fait ou dit lorsque le Hamas avait pris le pouvoir par un coup d’État, liquidé les membres de l’Autorité palestinienne, imposé une économie de guerre financée à prix d’or et transformé des kilomètres de tunnels en une poudrière invulnérable ?
Avait-il misé sur le fait que l’analphabétisme religieux ferait oublier le problème de ce qui maintient la cohésion d’un réseau interconfessionnel chiite-sunnite — dont les Frères musulmans sont le ciment — plus redouté par les émirats et les gouvernements arabes que par ceux de « l’entité sioniste » ?
Avait-il prévu qu’on pourrait, pour la « Palestine libre » — c’est-à-dire une Palestine qui effacerait l’État juif d’une manière qui semble aujourd’hui impossible, mais qui pourrait l’être demain —, se diriger vers un « modèle syrien » et voir un chef comme Ahmed al-Chaara passer des rangs de Daech au rôle d’homme d’État ?
Peut-être que oui.
Mais il y a autre chose — bien plus difficile à admettre.
Les responsables marketing du Hamas, à Gaza et ailleurs, ont peut-compris avant nous — qui avons encore du mal à le concevoir — que chaque gramme de solidarité européenne et occidentale envers une population utilisée par les grandes puissances arabes depuis des décennies, trompée à plusieurs reprises par les stratgères iraniens, brimée par la dictature du Hamas, opprimée par la politique israélienne, meurtrie par les colons fondamentalistes juifs — que chaque gramme de cette solidarité se transformerait en une tonne de ce nouvel antisémitisme que nous voyons naître, qui est revenu pour rester — et qui nous fait ressentir la même impuissance que les familles de Gaza qui ont osé demander la reddition du Hamas et ont été passées par les armes.
Ce qui ne tient plus : la fonction du mot « génocide »
L’enlisement de la guerre, le nombre de victimes d’un conflit qui a relégué au second plan la vie des otages israéliens et gazaouis — pour lesquels un mouvement important s’est battu en Israël, sans bénéficier de toute la solidarité à laquelle on aurait pu s’attendre de la droite, du centre et de la gauche —, n’a pas entraîné la montée d’un front pacifiste.
L’horreur indélébile du conflit n’a pas alimenté une dénonciation de la guerre comme une superstition qui promet de résoudre des problèmes qu’elle ne fait qu’aggraver, de la guerre comme un crime, de la guerre comme un acte d’idolâtrie des « sangs » — comme dans le Psaume 50 dans lequel on supplie au pluriel : de sanguinibus libera me Domine.
Si l’on voulait le dire de manière visuelle, cette guerre n’a pas vu se hisser le drapeau de la paix — on l’a plutôt baissé pour hisser celui de la Palestine — celui de l’Autorité nationale palestinienne, certes, mais surtout celui du soutien à la Palestine combattante, c’est-à-dire au Hamas.
Et cela ne tient pas.
Tout comme ne tient pas l’hypothèse implicite selon laquelle le bon juif doit être une victime — et que s’il se soustrait à ce rôle, c’est un juif qui, au fond, fait aux autres ce qu’il a subi. C’est-à-dire un « génocide ».
Cette catégorie historiquement complexe qui, dans le droit international, est considérée par certains comme trop vague pour être efficace et par d’autres comme trop restrictive pour pouvoir sanctionner des crimes qui ont échappé à tous les systèmes de prévention mis en place par la politique et la diplomatie, est entré dans le discours public pour devenir un dogme : ceux qui hésitent à l’utiliser — ceux qui parlent de massacre, de carnage ou de toute autre chose — doivent accepter d’être insultés et traités de lâches, de complices, de sionistes.
Le terme a lentement conquis le devant de la scène.
L’inculpation de Benjamin Netanyahou et du ministre Yoav Gallant, ainsi que de Yahya Sinwar, Mohammed Deif et Ismail Haniyeh — tous tués par Israël — devant la Cour pénale internationale avec les mandats d’arrêt correspondants, date de mai 2024.
Une longue discussion diplomatique a suivi à l’ONU puis devant la Cour internationale de justice sur les obligations violées par Israël en tant que puissance occupante de Gaza.
Bien avant cela, en janvier 2024, l’hypothèse d’actions « vraisemblablement génocidaires » avait été formulée devant la CIJ par l’Afrique du Sud : un rapport rédigé entre le 26 février et le 5 avril 2024 par la rapporteuse spéciale Francesca Albanese 27 consacrait le terme dans les instances onusiennes, non seulement pour Gaza, mais aussi dans un sens plus large, faisant de la guerre qui a commencé en 2023 le dernier chapitre d’une politique israélienne qui aurait été depuis ses origines — c’est-à-dire depuis 1948 — ségrégationniste, coloniale, déshumanisante — et, en dernière analyse, génocidaire.
Le 5 décembre 2024, un rapport d’Amnesty International 28 rendait publiques ses conclusions sur le « génocide » en cours à Gaza.
À partir de là, au cours de l’année 2025, le terme est non seulement devenu courant dans les manifestations publiques contre Israël, mais il s’est également transformé en une sorte de ligne de démarcation entre ceux qui, en l’utilisant, se rangent du côté du droit international et ceux qui, en le refusant, sont accusés d’être les « complices » de celui-ci.
Seule exception provisoire : la papauté qui, tant sous François que sous Léon, a au moins laissé ouverte la question de la nature effectivement « génocidaire » de la succession interminable de morts, de mutilations, de blessures et de souffrances endurées par les civils de Gaza, Rafah et Khan Younis depuis maintenant près de la moitié de la durée de la Seconde Guerre mondiale.
Mais à part eux deux, personne n’est autorisé à définir autrement le massacre inutile causé par deux armées en guerre parmi les maisons, les tentes, les personnes déplacées ; à utiliser un autre mot que celui-là.
Une nouvelle contrainte : théorème de la réduction au génocide
Qu’on le veuille ou non, le mot de « génocide » est devenu la clef de voûte d’une construction idéologique dans laquelle se reconnaissent des foules terriblement nombreuses, une clef qui s’enracine dans des domaines politiques éloignés, et qui est le moteur de la logique du boycott commercial — mais aussi sportif, artistique ou scientifique.
Peut-on considérer l’accusation de « génocide » comme un pur phénomène de psychologie de masse ?
Ne faudrait-il pas, au fond, refuser de plonger la tête la première dans ce débat ? Faire œuvre de sagesse, attendre que passe l’engouement pour un mot qui est d’ordinaire utilisé avec une parcimonie suspecte dans d’autres contextes de guerre, mais dont l’usage pourrait se perdre pour parler de ce conflit-là ?
Il n’est pas à craindre que l’usage se perde, car ce mot est au cœur du problème historique posé face à nous.
L’usage du mot « génocide », depuis le 7 octobre, renferme une sorte de théorème de psychologie sociale qui se décomposerait à peu près comme ceci : les Israéliens, héritiers des victimes de la Shoah, feraient aux Palestiniens ce qu’ils ont subi. Ce que les troupes de Tsahal font à Gaza ne serait que l’apogée d’une « déshumanisation » des Palestiniens qui constitue l’essence même de la politique israélienne — mais aussi le résultat des annexions récentes. Cette déshumanisation serait l’aboutissement de l’occupation des terres de 1967, le résultat de la proclamation de l’État d’Israël, le fruit du sionisme en tant que tel.
Le caractère absurde d’un tel raisonnement idéologique n’est même pas en soi le véritable sujet.
Le fait est que rendre dogmatique la définition du « génocide » qu’on accuse Israël de perpétrer, plutôt que de condamner le carnage dont ses armées se rendent coupable, laisse supposer quelques arrières-pensées.
La logique est simple, froide, implacable : si Israël n’est pas coupable d’avoir accepté la conduite criminelle de la guerre du Hamas et de s’être bercé d’illusions en pensant que la montagne de victimes civiles qu’il faisait était la responsabilité de l’ennemi, mais qu’il est bien coupable de « génocide », alors tout ce qui arrivera aux Juifs, où qu’ils se trouvent, est légitime.
Et ce n’est pas tout : alors tout ce que le judaïsme a subi pendant la Shoah se trouvera rétrospectivement atténué, voire compensé.
Nous, auteurs de la Shoah, avons été des racistes, des fascistes, des nazis et des criminels méprisables.
Mais comme les descendants de nos victimes font la même chose, cela signifie que ce crime préparé par des siècles de haine n’était qu’un exemple de la méchanceté humaine, qui a toujours existé et existera toujours — et que donc, les Juifs n’étant plus seulement des victimes, nous pourrions nous aussi cesser de considérer les hommes de notre passé comme de simples bourreaux.
Si ce qui se passe à Gaza n’est pas une horreur qui angoisse chaque âme vivante, mais tout simplement un « génocide », alors le mal d’autrefois devient un mal qui en a engendré un autre auquel il ne s’ajoute pas, mais dont il peut se soustraire.
Équation morbide. Compteurs à zéro.
Le « génocide » manqué des fascistes et des nazis devient une prémisse mineure du « vrai » crime, qui ne serait pas celui commis contre six millions d’Européens mais contre les Palestiniens de partout, représentés aujourd’hui par les dizaines de milliers de civils gazaouis morts dans la guerre contre le Hamas. Et de même qu’ils seraient les seules véritables victimes, les seuls véritables coupables seraient Netanyahou, ou son gouvernement, ou l’État d’Israël, ou les Israéliens, ou les Juifs — dans un crescendo aveugle et indiscriminé.
Insister sur le fait que le siège de Gaza serait un génocide, voire « le » génocide, transforme le rêve des Frères musulmans de diriger un régime théocratique islamiste en une option politique réaliste — ou en tout cas moins irréaliste. Cela justifie l’effacement de cette erreur de l’histoire qu’aurait été la création de l’État d’Israël et la destruction d’une société dépeinte comme compacte et féroce, religieusement vindicative, où tout ce qui n’est pas abus de pouvoir serait tromperie, propagande, alibi.
Enfin, le terme « génocide » efface tout doute méthodologique.
Si les souffrances intolérables endurées par les civils de Gaza sont — on espère pouvoir dire : ont été — un « génocide », alors on ne peut pas remettre en question la stratégie d’information du Hamas ; alors on ne peut comparer la réaction « disproportionnée » de l’aviation israélienne à celle des Alliés sur l’Italie fasciste, l’Allemagne nazie et le Japon impérial — événements après lesquels nous avons construit un système de lois internationales pour la protection des populations en guerre, système qui n’a jamais eu d’effet décisif, mais qui devrait être contraignant pour un État civilisé.
L’antisémitisme met une seconde à s’enflammer et un millénaire à s’éteindre.
Alberto Melloni
La reconstruction du système : de quoi le nouvel antisémitisme est-il le nom ?
Le mot de « génocide » est le ferment de cet antisémitisme qui se cristallise, sous une mobilisation pleine d’intentions éthiques, d’indignation humanitaire, de cette pietas qui ne peut manquer d’être présente face à des milliers et des milliers d’enfants morts, mutilés, rendus orphelins par une guerre qui, à Gaza, à 1 heure du matin le 7 octobre, a été saluée par des coups de feu en l’air et des klaxons orchestrés par le Hamas autour de ses propres enfants revenus couverts du sang d’autrui.
Car lorsque les bons sentiments, les bonnes raisons, les bonnes intentions se seront évaporés, lorsque là-bas la guerre cédera la place à une trêve — comme cela pourrait être le cas après l’annonce du début de mise en œuvre du plan de Trump — lorsque le Moyen-Orient aura des dirigeants politiques qui abandonneront l’idée de répandre du sel sur les décombres des villes de l’autre, ce qui restera de ce côté-ci du mare nostrum sera un autre antisémitisme.
Un antisémitisme tout nouveau ou peut-être l’ancien rajeuni par le bref et intermittent répit qu’il s’était accordé.
Mais il sera, comme l’autre, une haine construite théologiquement 29.
Dans l’ancien antisémitisme — entendu comme un système —, l’accusation de « déicide » jouait un rôle central.
Elle ne désignait pas tant la responsabilité du meurtre de Jésus de Nazareth — condamné à un supplice romain par un jugement du préfet romain — que la conviction qu’il y avait une culpabilité collective des Juifs de tous les temps et une sanction — la diaspora — infligée collectivement au peuple d’Israël, rejeté pour l’éternité par l’Éternel, chassé partout afin que chaque partie de la chrétienté ait « ses » Juifs à disposition pour se prouver à elle-même que le crime pour lequel ils avaient été condamnés n’était pas prescrit.
Le « génocide » a aujourd’hui la même fonction — et les trois volumes de l’histoire mondiale du génocide publiés dans la série des grands manuels encyclopédiques de Cambridge sont là pour nous le dire 30.
Alors que chaque événement historique ancien ou récent, comporte une part de responsabilités individuelles, il n’existe une culpabilité collective indélébile que pour Israël et pour les Juifs.
Comme dans l’ancien antisémitisme, elle est capable de provoquer un court-circuit si rapide qu’il passe inaperçu : ainsi, les seules fautes collectives seraient celles des Israéliens, récalcitrants à leur rôle ; au fond, ce seraient les fautes de tous les Juifs.
À l’exception des « convertis », bien sûr.
Le deuxième pilier de l’antisémitisme d’origine chrétienne était en effet la « conversion ».
La preuve morale de l’innocence, dans l’antisémitisme chrétien, était qu’il « suffisait » de se convertir pour échapper à la discrimination du christianisme — pas toujours à celle du racisme nazi toutefois. Aujourd’hui, à la place du baptême, il y a le rejet. On ne demande pas aux Juifs d’abandonner la foi des pères mais plutôt l’histoire des frères : à la place de la capitulation devant la vérité, on demande aujourd’hui le renoncement à l’occupation — par amalgame à la conquête de territoires non prévus par le partage qui a créé les deux États et qu’Israël a annexés au cours des guerres qu’il a menées dans son histoire d’État laïc (initialement socialiste) puis d’État dans lequel la composante religieuse joue, de plus en plus, un rôle exorbitant.
Comme dans le régime chrétien, seul le juif converti à temps échappe à la condamnation, de même dans ce nouveau régime, seul le juif qui répudie et échappe à l’occupation — en paroles s’il est hors d’Israël, ou alors en quittant Israël pour laisser les Palestiniens gouverner la « Terre Sainte » — se montre digne d’un destin dans lequel, comme le veut Augustin, quelqu’un d’autre le gardera intact pour le Jour dernier.
Le troisième pilier de l’antisémitisme était le supersessionisme, ou théologie de la substitution : la doctrine selon laquelle l’alliance d’Israël n’aurait pas été prolongée dans la nouvelle alliance, mais remplacée.
Le nouveau peuple de Dieu, racheté par le sang de Jésus, prenait la place de l’ancien — hypocrite, incrédule, formaliste, adepte de la vengeance et non de l’amour… et assoiffé de sang. L’accusation portée contre les Juifs d’enlever des enfants le Vendredi saint pour les saigner et pétrir les pains azymes avait un pouvoir suggestif énorme : même une connaissance superficielle de la Halakah suffisait à démontrer qu’il s’agissait d’une légende invraisemblable, mais elle s’inscrivait dans le culte des saints et dans la sensibilité populaire.
Aujourd’hui, l’accusation de sang n’est différente que dans sa mécanique : il n’y a plus de rabbins qui dissèquent les artères d’un saint Simon, mais des personnes, des universités, des entreprises, complices du génocide et donc méritant un boycott nécessaire, justifié, non négociable, qui devrait être accepté avec la même docilité que celle avec laquelle les Juifs soumis à la torture ont confessé devant les tribunaux ecclésiastiques.
L’Église du pape qui téléphonait à Gaza et du patriarche qui s’était offert au Hamas en échange des otages, pourrait veiller.
Alberto Melloni
Échapper à la tenaille
Y a-t-il un moyen d’empêcher ce résidu antisémite de s’installer parmi nous ?
Il y a de bonnes raisons d’en douter.
La dernière fois, sa formation n’a rencontré aucun obstacle. Il s’est transmis entre les générations, les cultures, les confessions, jusqu’à ce que la Shoah ne provoque une prise de conscience ; nous avons ensuite perçu la fragilité de celle-ci.
Cette fois-ci, la politique de Netanyahou vient s’ajouter à cela, salant un peu plus la marmite qui bouillonne d’indignation et au fond de laquelle ce sel antisémite restera avec une épaisseur encore plus importante.
Ceux qui ont choisi comme métier l’étude de l’histoire ont vécu jusqu’à présent avec une conviction : produire des connaissances historiques a une efficacité paradoxale, mais réelle.
Plus elle est à l’abri de finalités simplistes et idéologiques, plus elle obtient des résultats éthiques et sociaux.
C’est pourquoi l’étude de l’antisémitisme était si urgente dans les années 1950 31.
C’est pourquoi il était si nécessaire d’en comprendre les mécanismes anciens et récents, des baptêmes forcés aux silences dilemmatiques de Pie XII, de la haine du Talmud au tournant de Vatican II.
L’angoisse de l’historien d’aujourd’hui est que la rapidité avec laquelle l’antisémitisme se recompose en une théologie politique pleine d’une énergie terrible ne signifie pas tant que son travail a été vain mais qu’il n’y a rien d’utile à faire — si ce n’est se livrer à la logique inacceptable qui sous-tend le discours public de la droite israélienne (« puisque personne ne partage nos méthodes, quelle que soit leur intensité, autant faire un carnage, car cela ne changera rien »).
Mais peut-être que la persévérance dans ce métier, la conviction obstinée que la rigueur critique peut contrebalancer — sinon aujourd’hui, peut-être demain — la fureur idéologique, est le seul antidote au sentiment angoissant d’impuissance qui s’empare de nous.
Le métier d’historien enseigne précisément qu’il existe une force de résistance à ce rebond de l’antisémitisme : elle se trouve dans les églises chrétiennes.
Certes, il existe des églises chrétiennes d’une troisième sorte : le monde évangélique qui a inventé le sionisme chrétien est un partisan de la pire politique israélienne ; il sera favorable à l’annexion de la « Samarie ». Il serait heureux si un accident ou un missile quelconque — houthi serait parfait — détruisait les mosquées, déclenchant un bain de sang. Il soutiendra toutes les politiques qui promettent de nouvelles terres à la Terre promise.
Dans les Églises établies en revanche, et en particulier dans le catholicisme romain, il pourrait y avoir la conscience et la crédibilité nécessaires à une résistance.
L’Église du pape qui téléphonait à Gaza et du patriarche qui s’était offert au Hamas en échange des otages, pourraient veiller.
Non par inspiration divine, mais par conscience historique que l’antisémitisme met une seconde à s’enflammer et un millénaire à s’éteindre — car il sait trouver des raisons théologiques pour se nourrir, dans un buisson impie et inextinguible qui contamine la terre sur laquelle il brûle.
Les églises ont-elles encore en elles cette force théologique ?
Comme l’aurait dit le pire ambassadeur français de tous les temps, « l’avenir nous renseignerait ».
L’article Le nouvel antisémitisme est apparu en premier sur Le Grand Continent.
- GÉNÉRALISTES
- Ballast
- Fakir
- Interstices
- Lava
- La revue des médias
- Le Grand Continent
- Le Diplo
- Le Nouvel Obs
- Lundi Matin
- Mouais
- Multitudes
- Politis
- Regards
- Smolny
- Socialter
- The Conversation
- UPMagazine
- Usbek & Rica
- Le Zéphyr
- Idées ‧ Politique ‧ A à F
- Accattone
- Contretemps
- A Contretemps
- Alter-éditions
- CQFD
- Comptoir (Le)
- Déferlante (La)
- Esprit
- Frustration
- Idées ‧ Politique ‧ i à z
- L'Intimiste
- Jef Klak
- Lignes de Crêtes
- NonFiction
- Nouveaux Cahiers du Socialisme
- Période
- Philo Mag
- Terrestres
- Vie des Idées
- ARTS
- Villa Albertine
- THINK-TANKS
- Fondation Copernic
- Institut La Boétie
- Institut Rousseau
- TECH
- Dans les algorithmes
- Framablog
- Gigawatts.fr
- Goodtech.info
- Quadrature du Net
- INTERNATIONAL
- Alencontre
- Alterinfos
- CETRI
- ESSF
- Inprecor
- Journal des Alternatives
- Guitinews
- MULTILINGUES
- Kedistan
- Quatrième Internationale
- Viewpoint Magazine
- +972 mag
- PODCASTS
- Arrêt sur Images
- Le Diplo
- LSD
- Thinkerview
- Fiabilité 3/5
- Slate
- Fiabilité 1/5
- Contre-Attaque
- Issues
- Korii
- Positivr