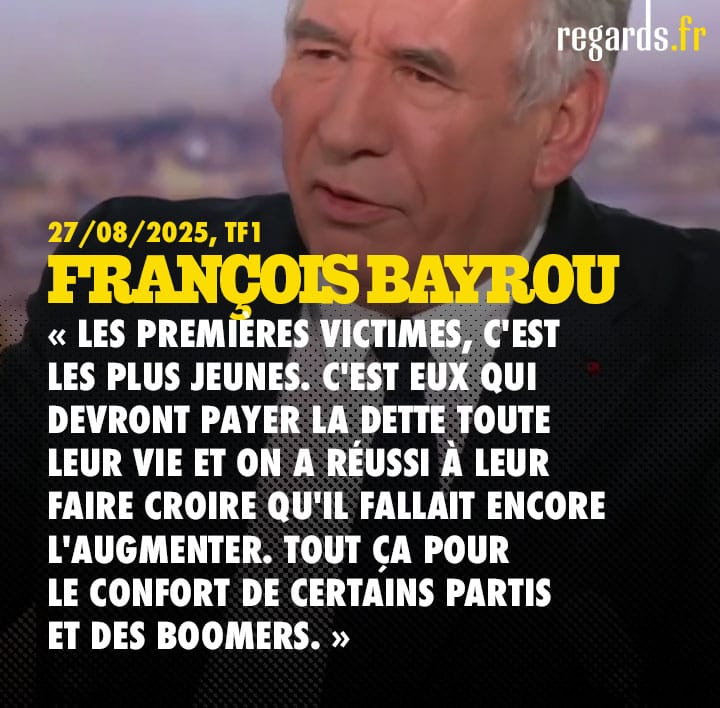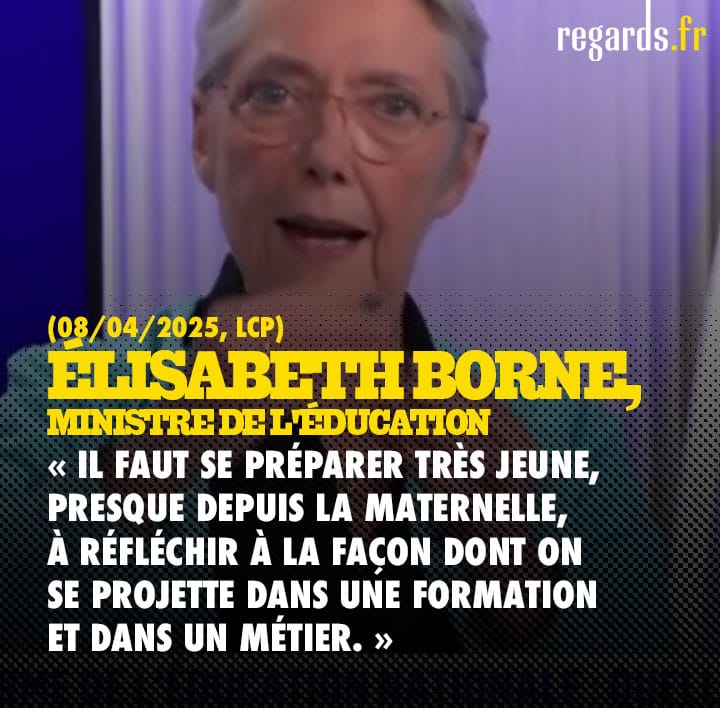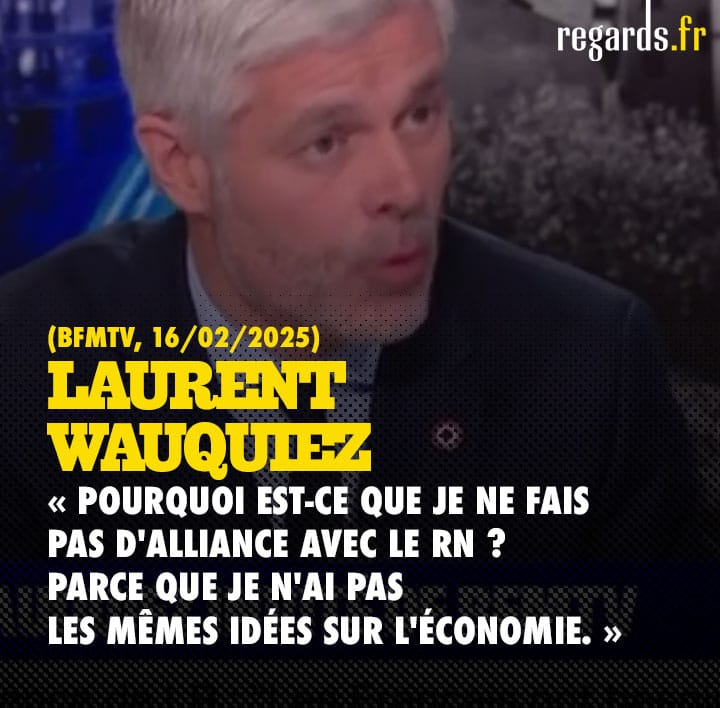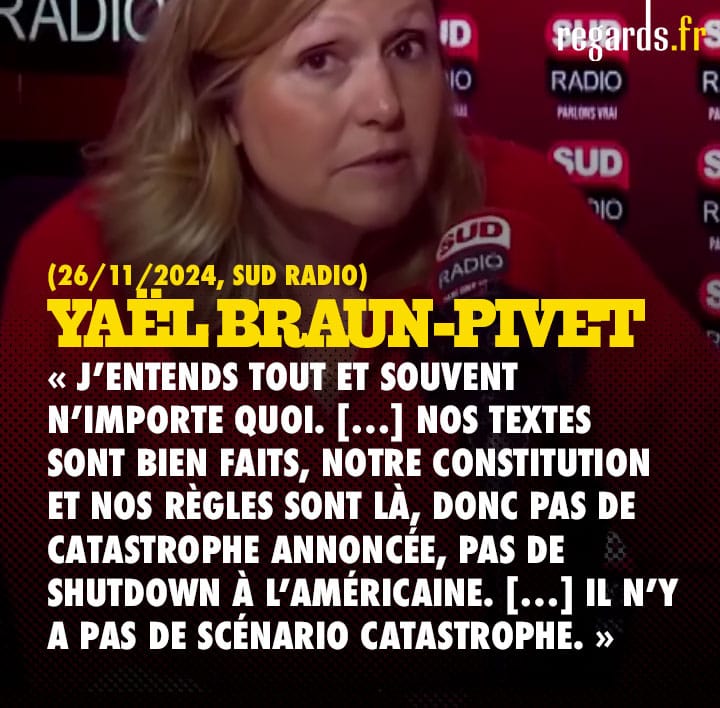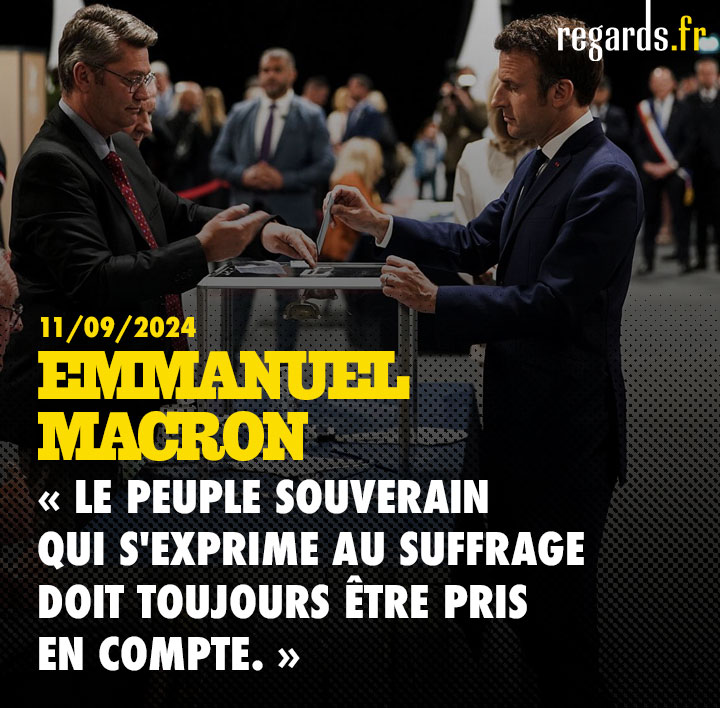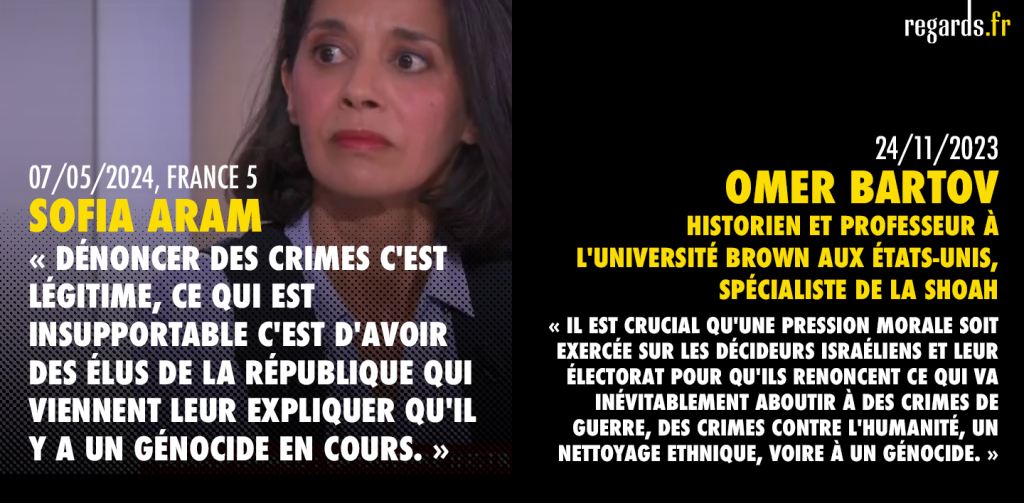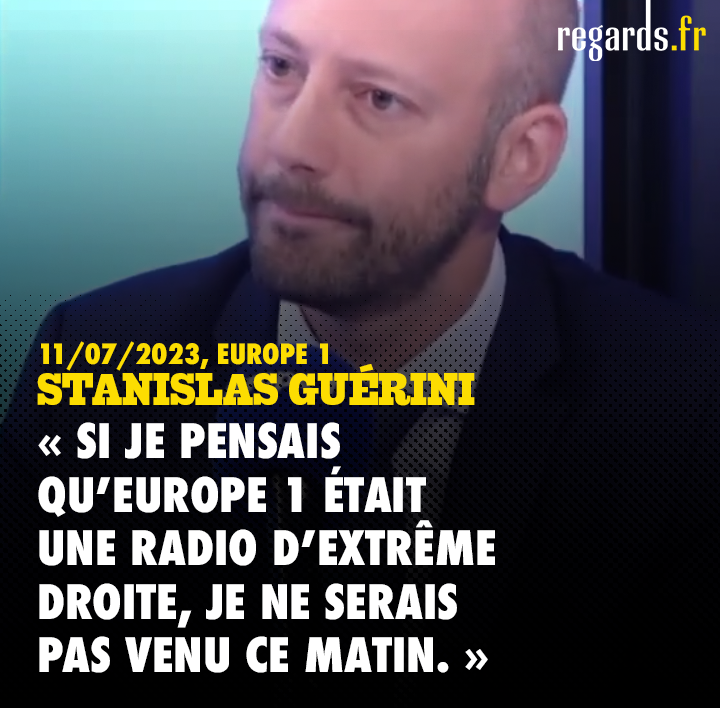10.03.2026 à 11:24
🔴 BRÈVE DU JOUR
Pablo Pillaud-Vivien
Lire + (159 mots)
L’entreprise, fabrique du vote
Selon une enquête publiée par HEC, le travail est devenu un lieu central de formation des attitudes politiques. Les déterminants classiques (salaire, diplôme ou catégorie sociale) n’expliquent qu’imparfaitement les préférences électorales : ce qui compte le plus, c’est la qualité du lien social dans l’entreprise. Les salariés qui votent pour l’extrême droite se déclarent plus isolés et plus défiants envers leurs collègues, tandis que ceux proches de la gauche radicale expriment davantage de solidarité horizontale, mais une critique plus forte de la hiérarchie et de l’organisation du travail. Autrement dit, la politique ne naît pas seulement des inégalités économiques : elle se fabrique aussi dans les rapports sociaux quotidiens du travail.
10.03.2026 à 11:24
Municipales : l’heure de vérité pour LFI
Catherine Tricot
Texte intégral (1198 mots)
LFI présente cette année 276 listes qui marquent sa nouvelle volonté de s’ancrer localement. Mais entre divisions à gauche et stratégies divergentes pour le second tour, ces élections diront si la force électorale nationale des insoumis peut se traduire en pouvoir municipal.
Cette année, La France insoumise fête ses 10 ans d’existence et veut franchir un palier dans son implantation locale. Alors qu’elle avait peu investi les élections municipales en 2020, elle en fait désormais un objectif important et présente 276 listes. C’est trois fois plus qu’en 2020.
TOUS LES JOURS, RETROUVEZ L’ESSENTIEL DE L’ACTU POLITIQUE DANS NOTRE NEWSLETTER
Le mouvement de Jean-Luc Mélenchon entend conforter ses zones de force : les grandes villes universitaires et les banlieues populaires. LFI sera présente dans la totalité des 36 villes de plus de 100 000 et dans plus de la moitié des villes rassemblant entre 50 000 et 100 000 habitants (49 sur les 89). Signe de cet engagement du mouvement : 19 députés LFI sont candidats. En revanche, la présence des insoumis décroît rapidement en dehors des grandes villes : moins du tiers dans les villes de 20 000 à 50 000 (103 sur 344) et moins de 10% dans les villes de 10 à 20 000 habitants (42 sur 543).
Les élections municipales ont été soigneusement préparées avec la publication d’un ouvrage collectif, Pour un nouveau communalisme, Les communes au cœur de la révolution citoyenne qui réaffirme le fait communal contre les politiques de métropolisation et d’intercommunalité. Une « boîte à outils programmatique » a été adoptée ; elle se retrouve pour l’essentiel dans les différentes propositions des listes LFI : cantine bio et « gratuite pour les familles en dessous du seuil de pauvreté », municipalisation de l’eau… La composition des listes a été soignée pour atteindre la parité des têtes de liste au niveau national et pour mettre en avant des personnalités racisées, la « nouvelle France ».
Derrière cette cohérence nationale, les campagnes ont aussi été locales. Leurs résultats seront finement analysés… et des leçons seront tirées. Qu’est-ce qui mobilise et fait gagner LFI ? Le style « rentre dedans » de la campagne parisienne ou marseillaise ? Le ton « ferme mais calme » de la campagne toulousaine ? Ou « le grand n’importe quoi » de La Courneuve ? Ou encore la campagne « trêve de polémiques » à Roubaix ?
C’est d’ailleurs à Roubaix que LFI a les chances de victoire les plus grandes. Dans cette ville qui approche les 100 000 habitants, un récent sondage donne 44% à la liste conduite par David Guiraud au premier tour. LFI pourrait également s’imposer dans quelques villes de banlieue (Villeneuve-d’Ascq, Vaulx-en-Velin, Vénissieux) et surtout en Île-de-France (Argenteuil, Saint-Denis, Aubervilliers, La Courneuve, Evry…) transformant sa forte influence nationale en victoires locales.
Qu’est-ce qui mobilise et fait gagner LFI ? Le style « rentre dedans » de la campagne parisienne ou marseillaise ? Le ton « ferme mais calme » de la campagne toulousaine ? Ou « le grand n’importe quoi » de La Courneuve ? Ou encore la campagne « trêve de polémiques » à Roubaix ?
Quand elle n’est pas donnée en tête des gauches – ce qui est le plus fréquent –, l’enjeu est d’ores et déjà celui du second tour. Dans combien de villes LFI rassemblera-t-elle plus de 10% des voix et se trouvera donc en situation de se maintenir ? Dans la grande majorité des communes, le rapprochement des listes de gauche est la condition d’une victoire face à la droite, voire face à l’extrême droite. La tradition depuis 1962 est celle d’une fusion des listes intégrant des éléments de programme et des candidats en position éligible. Mais ça, c’était avant. Avant le délire qui frappe la gauche politique depuis deux ans, redoublé depuis cinq semaines.
Après avoir affirmé qu’il n’y aurait pas d’accord national avec LFI, le PS appelle au désistement de la liste de gauche arrivée en deuxième position. Au nom de la mobilisation des électorats, LFI s’y refuse. Jean-Luc Mélenchon a dit la ligne samedi soir à Marseille ; elle devient celle du mouvement ce lundi dans un communiqué. LFI réclame une « fusion technique » partout où il y a un risque de droite ou d’extrême droite. Cette fusion technique se ferait entre listes de gauche parvenues au-dessus des 10%. Répondant aux appels lancés par le PS aux insoumis « à se désolidariser clairement et pleinement des propos [de Jean-Luc Mélenchon] », le mouvement radical refuse des négociations au cas par cas car « LFI n’est pas une addition de baronnies ». Les insoumis réclament l’intégration d’un nombre de candidats à proportion des résultats du premier tour mais sans participation à la majorité. Autre réponse du berger insoumis à la bergère socialiste qui réclamait une clarification sur la violence en politique. Dans ce même communiqué, ils refusent toute concession au sujet de la mort de Quentin Deranque et réaffirment « la solidarité avec le [au singulier, ndlr] mouvement antifasciste face aux tentatives de criminalisation faisant suite au drame de Lyon ». En revanche, ils en appellent aux têtes de liste communistes, écologistes et citoyennes pour ouvrir dès maintenant des négociations. Donc pas Paris, pas Toulouse, pas Lille et même pas Marseille… mais des discussions sont possibles à Lyon, Nîmes ou Le Havre.
Les socialistes paieront le prix fort de cette montée en intransigeance de toute part. De nombreuses villes de gauche pourraient tomber à droite. Et Marseille à l’extrême droite. S’en suivrait un déchirement plus grand entre forces de gauche, chacunes voulant reporter sur l’autre la responsabilité de ces bérézina locales.
Mais on sait que l’impact politique ne sera pas que local. Il sera national alors que s’ouvre l’année présidentielle et législative. Quelles seront les conséquences de ces choix politiques délétères ? Déplorables pour les habitants de ces villes. Mais politiquement, qu’en tireront les électeurs de gauche ? Il leur reste à imposer un retour à la raison de ces deux partis. Le combat contre l’accession du RN au pouvoir le vaut bien, non ?
- GÉNÉRALISTES
- Ballast
- Fakir
- Interstices
- Issues
- Korii
- Lava
- La revue des médias
- Time [Fr]
- Mouais
- Multitudes
- Positivr
- Regards
- Slate
- Smolny
- Socialter
- UPMagazine
- Le Zéphyr
- Idées ‧ Politique ‧ A à F
- Accattone
- À Contretemps
- Alter-éditions
- Contre-Attaque
- Contretemps
- CQFD
- Comptoir (Le)
- Déferlante (La)
- Esprit
- Frustration
- Idées ‧ Politique ‧ i à z
- L'Intimiste
- Jef Klak
- Lignes de Crêtes
- NonFiction
- Nouveaux Cahiers du Socialisme
- Période
- ARTS
- L'Autre Quotidien
- Villa Albertine
- THINK-TANKS
- Fondation Copernic
- Institut La Boétie
- Institut Rousseau
- TECH
- Dans les algorithmes
- Framablog
- Gigawatts.fr
- Goodtech.info
- Quadrature du Net
- INTERNATIONAL
- Alencontre
- Alterinfos
- Gauche.Media
- CETRI
- ESSF
- Inprecor
- Guitinews
- MULTILINGUES
- Kedistan
- Quatrième Internationale
- Viewpoint Magazine
- +972 mag
- PODCASTS
- Arrêt sur Images
- Le Diplo
- LSD
- Thinkerview