Luttes Climat Féminisme Décolonial Décroissance Bonnes feuilles Essais Entretiens Vivants Technocritique
15.10.2025 à 16:09
« Justice pour Julia ! » : au Chili, vague de violences en territoire mapuche
Le 8 novembre 2024, Julia Chuñil est partie en forêt avec ses animaux. Elle n’est pas revenue. Depuis, les manifestations se multiplient dans tout le Chili, demandant justice et vérité pour cette cheffe de communauté et défenseuse territoriale mapuche, dans un contexte tendu d’extractivisme et de criminalité. Et puis, la terrible nouvelle est arrivée…
L’article « Justice pour Julia ! » : au Chili, vague de violences en territoire mapuche est apparu en premier sur Terrestres.
Texte intégral (10095 mots)
Je remercie Javier Troncoso pour notre entretien téléphonique, et le collectif Ad Kimvn pour la mise en relation. En espérant que justice soit faite.
Cela fait bientôt un an que Julia Chuñil Catricura, 72 ans, femme mapuche et défenseuse territoriale a disparu dans la région de Los Ríos, au sud du Chili1. J’apprends sa disparition alors que je suis au Chili pour mon dernier terrain de recherche dans le cadre de ma thèse, qui porte sur l’agir politique de femmes rurales et mapuche autour de la souveraineté alimentaire. Depuis cinq ans maintenant, je m’attache à documenter leurs stratégies de résistance pour la terre, dans un contexte de vulnérabilité socio-écologique intense.
Le 25 novembre 2024, journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, je rejoins un groupe de femmes mapuche à Temuco. Elles scandent « Ni una menos (Pas une de moins) ». Beaucoup se sont identifiées à Julia. Sur les pancartes qu’elles brandissent, on peut lire : « Donde está ? ¿ Chew muley Julia Chuñil ? (Où est Julia Chuñil ?) ». Dans les territoires mapuche, les violences de genre sont indissociables des violences liées à un modèle de prédation, compris comme « un processus d’accumulation par et dans la destruction »2. Les slogans font écho aux mobilisations contre les disparitions forcées sous la dictature.
Julia Chuñil était engagée dans l’amélioration des conditions d’existence de sa communauté, qu’elle présidait. Reconnue dans sa commune, elle œuvrait à la revitalisation de la culture mapuche, notamment à travers sa participation à des trafkintü, nom mapuche donné aux échanges non monétaires de semences, de plantes, d’artisanat et de savoirs. Elle participait aussi à l’organisation de cérémonies mapuche (bien qu’elle soit elle-même évangéliste). Comme beaucoup de femmes mapuche des régions rurales, elle vivait de son activité d’agriculture de subsistance et de la vente des produits de son potager et de ses animaux. Malgré les pressions qu’elle subissait de la part d’un entrepreneur de l’industrie forestière appelé Juan Carlos Morstadt Anwandter, Julia refusait de quitter ses terres. Peu de temps avant sa disparition, elle confiait à sa famille : « S’il m’arrive quelque chose, vous savez déjà qui c’est », en faisant allusion à J. C. Morstadt.
Depuis sa disparition le 8 novembre 2024, les manifestations pour exiger vérité et justice pour Julia Chuñil se multiplient dans les grandes villes chiliennes – Santiago, Concepción, Valparaiso, Temuco… – et même à l’étranger. Sur les réseaux sociaux, la mobilisation est tout aussi vive. L’artiste Constanza Nahuelpan a même écrit une chanson pour la défenseuse territoriale : « ¿ Chëw Müley Julia Chuñil ?3 ».

Le 8 août 2025, près de 5000 personnes se sont retrouvées à l’Estadio nacional lors d’une journée de solidarité pour Julia Chuñil et sa famille.
Certaines voix dénoncent la violence structurelle perpétrée à l’encontre des femmes, particulièrement présente en Abya Yala4, une problématique analysée par de nombreuses chercheuses féministes telles que la chercheuse Rita Segato5. Les écologistes rappellent l’urgence de protéger les défenseur·ses autochtones et environnementaux, en exigeant l’application effective du traité environnemental dit « accord d’Escazú », ratifié par le Chili en 2022. ANAMURI, l’association nationale de femmes rurales et autochtones, dénonce également le racisme et le colonialisme qui nourrissent les logiques extractivistes menaçant la vie des communautés.
Julia Chuñil est peut-être la victime d’un nouveau féminicide politique, qu’il est urgent de dénoncer et de nommer.
La disparition de Julia Chuñil ravive le débat sur la répression des défenseur·ses de l’environnement, en particulier en contexte autochtone. Julia Chuñil est peut-être la victime d’un nouveau féminicide politique, qu’il est urgent de dénoncer et de nommer. Les luttes portées par les femmes autochtones, qu’elles soient autour de pratiques politiques « discrètes », ou luttes plus frontales, restent encore trop invisibilisées. L’image romantique de « gardiennes de la nature » ne rend pas justice à la complexité de leurs combats et de leurs stratégies multiples.
Un continuum de violences
Depuis la colonisation espagnole au XVIe siècle, les Mapuche subissent une dépossession de leurs territoires, inscrite dans une longue histoire de violences et de domination. Après l’indépendance chilienne en 1818, l’occupation militaire de l’Araucanie (1861-1883) réduit les terres communautaires entre 5 et 10% de leur superficie originelle et une grande partie est réattribuée à des colons, entraînant une grande fragmentation sociale et culturelle. Le colonialisme républicain marque avec force la persécution des Mapuche, à travers, entre autres, leur subordination à des « institutions et une territorialité exogènes »6.
Au XXe siècle, la réforme agraire puis la contre-réforme agraire sous la dictature de Pinochet redessinent les rapports à la terre, les terres collectives mapuche étant depuis lors soumises à la logique de la propriété privée. Le modèle néolibéral ancre une logique extractiviste et favorise l’expansion massive de monocultures de pins et d’eucalyptus, particulièrement dans les régions à forte population mapuche. Soutenue par des subventions publiques, cette filière concentre les richesses de quelques entreprises et provoque de lourdes conséquences environnementales, notamment pour la perpétuation des modes de vie mapuche. L’industrie forestière se déploie au prix d’inégalités criantes. Les emplois – à 95% masculins – sont précaires et ne génèrent pas le développement promis7.
Le « retour à la démocratie » dans les années 1990 ne modifie pas les structures héritées du régime dictatorial, mais ouvre un nouvel espace pour les revendications autochtones. En 1992, les mobilisations autour de la contre-commémoration de la « découverte des Amériques » constituent une fenêtre d’opportunité pour les organisations mapuche8.
En 1993, la Ley Indígena9 reconnaît pour la première fois la présence des peuples autochtones dans la constitution chilienne et crée la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI, « Corporation nationale pour le développement autochtone »), qui veille à l’application de divers programmes de santé, d’éducation et d’accès à la terre à travers un mécanisme d’achat de terres auprès de propriétaires privés. Cette reconnaissance reste toutefois obtenue au prix d’un compromis politique puisqu’elle canalise les « aspirations légitimes de justice » dans un cadre institutionnel10.

La politique indigéniste d’alors avait comme objectif clair d’encourager la valorisation de l’identité autochtone, mais aussi sa « modernisation »11. L’autochtonie devient une « valeur ajoutée » si elle répond aux besoins du marché, dans un contexte de grandes réformes néoliberales qui se poursuivent dans les décennies suivantes. Le « néolibéralisme multiculturel », à partir des années 2000, renforce ainsi la division entre le « bon indien » et le « mauvais indien »12. Les femmes autochtones incarnent « par nature » le « bon indien », considérées comme les « reproductrices biologiques, culturelles et symboliques » de leur culture13. Dans ce cadre, leurs savoirs, souvent au cœur de projets d’ethno-développement et d’empowerment, lorsqu’ils peuvent être capitalisés, tendent à renforcer leur assignation au care, sans pour autant interroger les structures de domination qui la sous-tendent. Pourtant, derrière cette image de « gardienne de la nature », perçue comme apolitique, elles mènent des luttes concrètes pour la terre, l’eau et la biodiversité, affirmant ainsi leur pouvoir d’agir politique.
À la fin des années 1990, les conflits territoriaux s’intensifient au Chili et les territoires mapuche sont particulièrement visés par la répression de l’État. Si les figures médiatisées de ces luttes sont essentiellement masculines, décrites par les médias et la sphère politique sur le registre du terrorisme et de la violence, les femmes mapuche y jouent un rôle central.
➤ Lire aussi | Résister au Brésil : pas d’agroécologie sans féminisme・Héloïse Prévost (2023)
La « Commission pour la Paix et l’Entente »
La disparition de Julia Chuñil révolte d’autant plus qu’elle survient sous un gouvernement qui s’était engagé à résoudre cette dette historique de l’État chilien envers la nation Mapuche. Trente-deux ans après la promulgation de la Ley Indígena, l’écart entre les revendications territoriales et les terres effectivement acquises reste conséquent et le mécanisme de redistribution perpétue la spéculation immobilière et les conflits entre communautés.
Dans ce cadre, la « Commission présidentielle pour la Paix et l’Entente » (Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento) a remis en 2025, après deux ans de travail, son rapport proposant un ensemble de recommandations autour de la justice, la réparation, la restitution des terres et du développement territorial14. Pour les Mapuche, ce processus suscitait des espoirs de changement, dans un pays où les avancées juridiques en matière de droits fonciers et politiques y restent limitées15.
La disparition de Julia Chuñil révolte d’autant plus qu’elle survient sous un gouvernement qui s’était engagé à résoudre la dette historique de l’État chilien envers la nation Mapuche.
Bien que cet accord ait été qualifié d’historique en raison de la portée des recommandations et de la méthodologie de consultation employée, de nombreuses interrogations subsistent, notamment sur la création d’un nouvel organe dédié aux politiques autochtones, qui ne serait que « décoratif »16. Le texte émet également des recommandations concernant le « développement territorial et économique » des régions. Mais il reste globalement centré sur des logiques d’intégration au marché agroindustriel et d’« efficacité », dans la prolongation d’une vision paternaliste. Rien ne fait état de l’accès effectif à l’eau, de la préservation des ressources aquatiques dans des régions où le stress hydrique est croissant et les sécheresses récurrentes.
Depuis la remise du rapport, les critiques se sont intensifiées, notamment sur les irrégularités du nouveau processus de consultation autochtone, ouvert en août 2025. Les organisations mapuche ont généralement rejeté les recommandations.
Dans ce climat, la disparition forcée de Julia Chuñil prend aussi une autre portée, pointant du doigt les violences continues qui s’exercent sur les communautés mapuche, en particulier sur les femmes.

L’élimination de femmes mapuche dans des luttes territoriales
L’une des luttes territoriales les plus emblématiques est celle de Ralco (Alto Biobío), opposant des communautés Pewenche de la cordillère contre un projet hydroélectrique. Porté par l’entreprise Endesé et soutenu par l’État comme symbole de développement, le barrage hydroélectrique Ralco fait partie d’un projet d’aménagement sur le fleuve Bío Bío, qui a eu des impacts environnementaux et sociaux majeurs, illustrant la violence extractiviste.
Autorisé en 1997 par la CONADI, malgré des critiques sur sa légalité, il a forcé au déplacement de nombreuses familles pewenche, inondant leur invernada et réduisant leur capacité de subsistance17. En 2003, toutes les familles concernées avaient fini par accepter, sous pression, la permutation de terres proposée par l’entreprise Endesa, par le biais de la CONADI. Cimetières, sites cérémoniels et lieux sacrés ont été engloutis, bouleversant les pratiques religieuses et l’habiter. L’arrivée de travailleurs et de nouveaux propriétaires privés a introduit une logique axée sur la propriété privée, l’individualisme et l’exploitation intensive, contrastant avec le rapport à la terre des Pewenche18.
Au cœur de cette lutte de près de dix ans, le souvenir des sœurs Berta et Nicolasa Quintreman est encore vif. En 2013, Nicolasa Quintreman fut retrouvée morte, son corps flottant dans les eaux du lac artificiel du barrage de Ralco19. Elle avait déclaré qu’elle ne quitterait pas ses terres, même morte.
On peut aussi rappeler le cas de Macarena Valdés, qui luttait également contre un autre projet hydroélectrique à Panguipulli. Les circonstances de sa mort, laissant fortement présumer un féminicide maquillé en suicide, ne sont toujours pas élucidées.
Le concept de « continuum de la violence sexuelle » permet de saisir l’ampleur et la diversité des abus et violences subis par les femmes, ainsi que les liens entre domination patriarcale, racisme structurel et extractivisme.
Aujourd’hui, d’autres défenseuses territoriales continuent leur lutte malgré les menaces. C’est le cas de la machi (chaman20) Millaray Huichalaf, engagée depuis quinze ans pour la défense du fleuve Pilmaikén (Los Ríos) contre l’entreprise norvégienne Startkraft et sa centrale hydroélectrique. En août 2025, l’entreprise a ouvert les vannes du barrage sans prévenir, alors que la machi et sa communauté étaient en pleine cérémonie sur le fleuve. La crue provoquée a emporté une jeune fille et un homme qui tentait de la sauver. Depuis, Millaray Huichalaf fait de nouveau face à des intimidations policières et à une criminalisation de sa lutte.
La lutte de Julia Chuñil pour la dignité mapuche prolonge ces résistances féminines face à la prédation de leur territoire.
➤ Lire aussi | Luttes féministes en Amérique latine : penser ensemble le patriarcat et le colonialisme・Lina Álvarez-Villarreal (2023)
Ces violences extrêmes sont à analyser à l’aune du « continuum de la violence sexuelle »21. Ce concept permet de saisir l’ampleur et la diversité des abus, contraintes et violences subis par les femmes, exacerbés en contexte extractiviste, ainsi que les liens entre domination patriarcale, racisme structurel et extractivisme22. On y voit un lien avec le concept de terricide développé par Moira Millán (Puelmapu, Argentine), pour désigner un continuum de violences que subissent les Mapuche et peuples autochtones en général (écocide, génocide, épistémicide, féminicide), à travers une « matrice civilisatrice de la mort » qui affecte à la fois les terres et les corps subalternisés. Ce concept permet de mieux saisir le contexte de la disparition de Julia Chuñil.

¿ Donde està Julia Chuñil ?
Julia Chuñil se définissait comme « cheffe de famille et combattante ». Dans un documentaire, elle raconte son bonheur de prendre soin de ses animaux et de son potager, et de participer aux trafkintü (troc). Cette forme de solidarité, principalement organisée par les femmes permet de tisser des réseaux de solidarité et d’échange, et de « faire communauté » :
On partage avec les personnes, parfois d’autres communautés, on récupère nos graines, c’est important. Les graines qu’on récolte, on les échange contre des choses qu’on n’a pas. J’aime participer et ramener des boutures, des graines, de la farine, tout ce que je fais dans ma maison. Cette année on n’a pas pu l’organiser, à cause du problème qu’on a ici.23
Dirigeante mapuche, mère de 5 enfants et grand-mère de 10 petits enfants, Julia Chuñil présidait la communauté de Putreguel (Région de Los Ríos), composée de 17 familles. Depuis 2015, elle menait l’occupation et la protection d’un terrain de près de 900 hectares, dont une grande partie de forêt naturelle et cinq cours d’eau, espérant sa régularisation foncière par la CONADI (la Corporation nationale pour le développement autochtone). Elle y vivait de manière précaire, sans électricité, ni eau potable ni couverture téléphonique, et pratiquait une agriculture paysanne, de subsistance.
Le 8 novembre 2024, Julia est partie avec trois de ses chiens pour surveiller ses animaux dans les collines voisines. Seuls deux chiens sont revenus ; Julia et son jeune chien Cholito, qui ne la quittait jamais, ne furent jamais retrouvés. Aucune trace d’elle n’a été retrouvée et ses enfants, soutenus par la Fondation Escazú24, ont porté plainte pour enlèvement, évoquant la possibilité d’un féminicide politique.

Cette disparition est à replacer dans le cadre d’un long conflit foncier. Le terrain revendiqué par la communauté de Julia Chuñil faisait partie de la réforme agraire avant de passer entre les mains de propriétaires privés sous la dictature. Il comprend notamment un cimetière mapuche, où Julia souhaitait être enterrée. Après une première transaction irrégulière impliquant l’entrepreneur Juan Carlos Morstadt (descendant de colons allemands) et la banque Scotiabank, le terrain est abandonné par une première communauté à laquelle il avait été attribué. La communauté de Julia s’y est alors installé pour protéger le site, espérant que la CONADI leur transfèrerait les droits à la terre.
Lors d’un entretien, Javier Troncoso, fils de Julia Chuñil, raconte :
Ma mère n’a jamais eu de terre à elle, elle travaillait ici et là pour d’autres, elle travaillait de la vente de produits agricoles, et a réussi à s’en sortir seule. Et aujourd’hui elle se sentait épanouie parce qu’elle avait ce bout de terre, sa forêt et ses animaux. (Javier Troncoso, mai 2025)
La forêt naturelle pour les Mapuche va bien au-delà d’une ressource alimentaire ou de bois de chauffe, elle est un lieu de cueillette, notamment de plantes médicinales utilisées pour les soins quotidiens et lors de cérémonies religieuses. La forêt est profondément liée à l’habiter mapuche.
Avec l’annulation de la vente, les terres passèrent à nouveau entre les mains de J.C. Morstadt mais la CONADI n’informa pas la communauté de Julia : « On l’a su après sa disparition et Morstadt n’a jamais rendu l’argent », souligne Javier Troncoso. Depuis lors, Julia Chunil avait signalé à sa famille plusieurs menaces de l’entrepreneur, qui continuait d’abattre des arbres autochtones pour leur commercialisation. Javier ajoute : « ils ont essayé d’acheter ma mère, comme ils l’ont fait avec d’autres, et ma mère a aussi caché beaucoup de choses, elle ne voulait pas nous inquiéter ».

L’enquête a été marquée par une succession de quatre procureurs et a souffert d’un manque flagrant de continuité et de transparence. Les avocats de la famille dénoncent la fuite du dossier d’enquête vers les médias alors qu’il était confidentiel, l’absence de de moyens techniques (géoradar, drones), des perquisitions répétées, dont certaines violentes, visant la famille.
Une telle inversion du soupçon sur les victimes peut stupéfier : elle illustre pourtant la criminalisation systématique des luttes autochtones. Javier Troncoso raconte :
Ils n’enquêtent pas sur lui [Morstadt], nous sommes les principaux suspects de la disparition de ma mère maintenant. En plus de la présence quotidienne de la police, on a eu beaucoup de perquisitions, ici et chez ma sœur. Trois procureurs sont venus chez ma sœur. Ma sœur a subi chez elle une torture psychologique, on lui disait : « Allez, dis-nous où est ta mère. » C’est donc encore plus douloureux de voir toutes ces injustices que les policiers commettent à notre égard. Ils viennent encore de changer de procureur ce mois-ci. Et déjà dix jours de perquisitions domiciliaires. Il y a des enfants ici, il y a des personnes âgées, ils ont bafoué les droits des enfants. Ils ne respectent pas la loi parce que nous sommes Mapuches.
Le cas de Julia se situe dans un double contexte : celui de la criminalisation des mouvements sociaux, et particulièrement du mouvement mapuche, et celui de l’expansion de la prédation extractive sous couvert de transition énergétique.
Le 7 août 2025, cinq organisations – dont le Mouvement pour l’eau et les territoires (MAT), l’Observatoire latino-américain des Conflits environnementaux (OLCA) et la Commission éthique contre la torture – ont présenté au Comité des droits économiques, sociaux et culturels de l’ONU un rapport dénonçant la vulnérabilité structurelle des défenseurs et défenseuses de l’environnement au Chili, en particulier des femmes autochtones. Le cas de Julia est effectivement replacé dans un contexte plus large, d’une part celui de la criminalisation des mouvements sociaux, et particulièrement du mouvement mapuche, et d’autre part celui de l’expansion de la prédation extractive sous couvert de transition énergétique. En 2023, vingt défenseur·euses de l’environnement ont été menacé·es au Chili, dont 65% de femmes, selon la Fondation Escazú Ahora. Cette dernière dénonce le vide juridique et éducatif concernant la reconnaissance de la figure de défenseur·euse de l’environnement. Si le président Gabriel Boric a publiquement exprimé sa préoccupation pour la disparition de Julia Chuñil et promis de poursuivre les recherches, sa déclaration n’est encore suivie d’aucune avancée notable.
Le 1er octobre 2025, près d’un an après sa disparition, les avocats de la famille de Julia Chuñil dévoilent une information d’une rare violence.
Dans un enregistrement issu d’une conversation téléphonique, J. C. Morstadt confie à son père : « Julia Chuñil, ils l’ont brûlée ». L’enregistrement a été exposé auprès d’organismes de défense des droits humains. Cette révélation insoutenable doit accélérer le processus d’enquête afin que justice soit faite. Un reportage du 12 octobre 2025, sur Canal 13, une chaîne de télévision nationale, remet en question l’activisme de Julia Chuñil au sein du mouvement mapuche et écologiste. Les journalistes insistent une fois de plus sur culpabilité de ses enfants dans son assassinat, sans preuve concrète. Ce reportage nie une fois de plus la subjectivité politique de Julia Chuñil, et, par extension des femmes autochtones.
Les trajectoires comme celle de Julia Chuñil s’inscrivent dans une histoire plus large, où les femmes mapuche jouent un rôle décisif dans les luttes pour la défense des territoires. Au-delà d’actions ancrées dans une politique du quotidien, elles traversent aussi les sphères politiques : certaines prennent part à des organisations nationales voire internationales, construisent des alliances avec des organisations non mapuche, agissent depuis les instances institutionnelles, se mobilisent pour faire valoir leurs droits, en tant que femme, et en tant qu’autochtone.
Sans la mobilisation massive de collectifs mapuche et chiliens, Julia Chuñil, aurait subi l’invisibilisation de sa vie et de sa lutte, qu’il est important de comprendre dans sa globalité. Raconter l’histoire de Julia Chuñil, c’est refuser l’oubli et l’effacement.

Image d’accueil : Affiche du Réseau des femmes autochtones pour la défense de la mer (Red de mujeres originarias por la defensa del mar). Illustration de Carla Soto Ampuero @carlawillin

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !
Depuis 2018, Terrestres est la revue de référence des écologies radicales.
À travers des essais, enquêtes, traductions inédites et récits de résistances, nous explorons les nouvelles pensées et pratiques nécessaires pour répondre à la catastrophe écologique.
Chaque semaine, nous publions en accès libre des articles qui approfondissent les enjeux écologiques, politiques, et sociaux, tout en critiquant l’emprise du capitalisme sur le vivant. Plus qu’une revue, Terrestres est un laboratoire d’idées et un lieu de réflexions critiques, essentielles à l’élaboration d’alternatives justes et émancipatrices.
En nous lisant, en partageant nos articles et en nous soutenant, par vos dons si vous le pouvez, vous prenez le parti de l’écologie radicale dans la bataille culturelle qui fait rage.
Merci  !
!
Notes
- Il est souvent utilisé le terme d’activiste environnementale pour définir Julia Chuñil. Je préfère le terme de défenseuse territoriale, qui, à mon sens, est beaucoup plus englobant et imbrique les multiples dimensions de sa lutte et de son rapport au territoire.
- Adèle Blazquez et Martin Lamotte, 2024, « Prédation : l’accumulation par et dans la destruction », L’Homme, pp. 251-252.
- Pour l’écouter : https://www.youtube.com/watch?v=9sUI-Wqlyc8
- Abya Yala, terme issu des Gunas (peuple de l’actuel Panama) désigne le territoire américain avant la colonisation et est souvent traduit par « terre de pleine maturité ». Le terme s’est plus largement diffusé à partir de 1992 et des contre-célébrations du 500e anniversaire de la « découverte des Amériques ».
- Voir entre autres, son ouvrage La guerre aux femmes, trad. Irma Velez et Alicia Rinaldy, Paris, Payot, 2022.
- Nahuelpan Moreno, H. J., & Antimil Caniupan, J. (2019). « Colonialismo republicano, violencia y subordinación racial mapuche en Chile durante el siglo XX ». HiSTOReLo. Revista de Historia Regional y Local, 11(21), 211‑248 ; Le Bonniec, F. (2003). « État de droit et droits indigènes dans le contexte d’une post-dictature : Portrait de la criminalisation du mouvement mapuche dans un Chili démocratique ». Amnis, 3, 1‑19.
- Reyes, R., & Nelson, H. (2014). « A Tale of Two Forests : Why Forests and Forest Conflicts Are Both Growing in Chile ». The International Forestry Review, 16(4), 379‑388.
- Baeza, C. (2012). « Multiculturalisme et construction identitaire au Chili (1990-2011) » : Critique internationale, n° 54(1), 119‑143.
- Cette loi résulte d’un « pacte » en 1989 entre le candidat de la Concertation des Partis de la Démocratie, Patricio Aylwin et des organisations autochtones, principalement mapuche. Les représentations autochtones demandaient alors la reconnaissance constitutionnelle de la plurinationalité, finalement écartée du texte. Finalement, la loi de 1993 reconnaît d’abord l’existence de trois « ethnies », dont Mapuche, et sept « communautés autochtones ». Ce n’est qu’avec la ratification tardive de la Convention 169 de l’OIT en 2008, que les autochtones sont désignés comme « peuples ». Aujourd’hui le Chili en reconnaît 12, dont le dernier en 2019, le peuple afrodescendant chilien. La loi de 1993 marque aussi le début de l’auto-identification dans les recensements. Voir l’original ici (document pdf).
- https://fundacionaylwin.cl/el-acuerdo-de-nueva-imperial/
- Idem.
- Boccara, G., & Ayala, P. (2011). « Patrimonializar al indígena. Imaginación del multiculturalismo neoliberal en Chile ». Cahiers des Amériques latines, 2011/2(67), 207‑228.
- Yuval-Davis, N. (1996). « Género y nación : Articulaciones del origen, la cultura y la ciudadanía ». Arenal. Revista De Historia De Las Mujeres, 2(3), 163‑175.
- https://www.comisionpazyentendimiento.gob.cl/
- Environ 12% de la population chilienne se considère autochtone, dont environ 80% mapuche.
- Salvador Millaleo, « Sobre la Comisión para la Paz y el Entendimiento », El País, 8 mai 2025.
- L’invernada désigne le site de vie et de culture coutumier des Pewenche, encore largement inscrits à ce moment-là dans l’agro-pastoralisme semi-nomade.
- Hakenholz, T. (2004). « Un peuple autochtone face à la « modernité » : La communauté Mapuche-Pewenche et le barrage Ralco (Alto Bío Bío, Chili) ». Les Cahiers d’Outre-Mer. Revue de géographie de Bordeaux, 57(228), article 228.
- Si la thèse de l’accident semble être confirmée, les modifications environnementales et socio-culturelles provoquées par le barrage ont, d’une autre manière, participé à sa mort.
- Personne centrale du système spirituel et médicinal mapuche.
- Kelly, L.,Traduit de l’anglais par Tillous, M.(2019). « Le continuum de la violence sexuelle ». Cahiers du Genre, 66(1), 17-36.
- Hillenkamp, I., & Prévost, H. (2024). « Extractivisme et résistances paysannes dans l’agroécologie au Brésil : Une analyse de genre des conflictualités. ». Revue internationale des études du développement, 255, 41‑66.
- Trafkintü : intercambio de semillas y saberes, de Victor Gutiérrez Astete.
- https://www.escazuahorachile.cl/
L’article « Justice pour Julia ! » : au Chili, vague de violences en territoire mapuche est apparu en premier sur Terrestres.
24.09.2025 à 19:14
Conseils #4 : Nastassja Martin, Non-noyées, un Déluge et des barrages sur la Loire
Une nouvelle vague de conseils des Terrestres pour bien résister à la rentrée. Quatre livres au programme : des glaciers qui donnent le vertige, l'héritage de la lutte majeure de SOS Loire Vivante, un « manuel de dénoyade » pour s’immerger dans l’époque et un grand roman du dérèglement climatique. Bonnes lectures !
L’article Conseils #4 : Nastassja Martin, Non-noyées, un Déluge et des barrages sur la Loire est apparu en premier sur Terrestres.
Texte intégral (6201 mots)
Beau livre · Les sources de glace · Olivier de Sépibus & Nastassja Martin

Le retrait des glaciers signe la catastrophe en cours, comme un condensé d’Anthropocène. Le livre Les sources de glaces participe de la mise en récit de ces disparitions et des luttes à naître pour ne pas qu’elles sombrent dans les oubliettes de la mauvaise conscience des Modernes.
Il faut l’avouer, en matière d’édition, le beau coûte cher, et notre conseil de lecture ne déroge pas à la règle. Si ses 37€ excèdent votre budget lecture, vous pouvez feuilleter l’ouvrage en librairie, le faire commander par votre bibliothèque ou vous le faire offrir. Mais il faut dire la beauté de l’objet, le travail d’orfèvre des éditions Paulsen, la peau duveteuse de la couverture, le chemin parfaitement maîtrisé qui serpente entre textes, poèmes et photographies.
Le regard s’égare dans l’image. On peine à saisir l’échelle, le plan, la nature même de ce que l’on voit. La verticalité parfois permet de ressaisir l’ensemble, il est immense. Par ses photos, Olivier de Sépibus nous fait sentir la texture du glacier, on effleure sa peau, poreuse, craquelée, épiderme endormi d’un dragon millénaire. Mais aussi, à mesure que l’on avance dans des séries chapitrées par la poésie magnifique de René Char, peau de chagrin : la moraine gagne, la neige brunie s’épuise en filet d’eau, il ne reste plus rien de blanc et pourtant, le glacier est là, immense, métamorphosé, mais partout présent dans la forme du vallon, la pente du pierrier.
Dans un texte dont on aurait rêvé pour Terrestres, mais qui se trouve ici dans un si bel écrin que l’on ne regrette vraiment rien, Nastassja Martin nous invite à sentir-penser le glacier comme sujet, un être animé, qui se gonfle et se dégonfle dans sa lente respiration annuelle, glisse, s’étale et dont la pulsation insuffle les battements du monde, circulant de l’océan aux sommets alpins et délivrant à tous les êtres l’eau qui les fait vivre. Le glacier renferme la mémoire du monde, et sa disparition signale les pathologies de notre civilisation.
Lorsqu’on considère le glacier comme une ressource, son épuisement inexorable invite à l’action. Si c’est un stock d’eau potable, bâchons-le pour en ralentir la fonte ; si c’est une source d’informations sur l’histoire longue de notre planète, extrayons des carottes pour les conserver dans des réfrigérateurs ; si c’est un substrat qui stabilise le sol et retient la montagne, le pompage subglaciaire pourrait offrir un répit pour les villages de l’aval. Mais si le glacier est un être avec lequel nous partageons le monde, qui nous constitue et auquel nous sommes liés de mille façons, alors cette agitation ne peut suffire. Pire, elle détourne de ce que nous devons aux êtres chers lorsqu’ils disparaissent : le recueillement, la joie de les aimer et la responsabilité de leur faire une place dans nos vies et nos mémoires pour transmettre ces liens à celles et ceux qui ne les connaîtront pas. J’ai l’impression que ce livre fait cela.
On ne « sauvera » pas les glaciers des Alpes, mais on peut faire vivre leurs fantômes afin que ces géants qui ont façonné les montagnes et ses habitants persistent sous d’autres formes. Transmettre la conscience de leur puissance, de leur majesté, quand bien même celles-ci ne se manifestent plus sous l’aspect grandiose d’une immense étendue blanche mais dans les formes modestes et surprenantes de cette vie nouvelle qui émerge et s’organise là où la glace se retire.
Comme le monument au pigeon disparu dont nous parle Aldo Leopold, mais libéré des réflexes mémoriels d’une civilisation bâtisseuse qui fige dans la pierre le souvenir de ses héros, ce livre contribue à une œuvre collective : inventer des récits et bricoler des mémoires, non pas tant pour honorer les êtres disparus que pour les garder bien vivants en nous et autour nous, comme autant de petites touches qui diffractent le sublime du paysage pour en faire un milieu plein de liens, de signes et de sens.
« Revers des sources :
pays d’amont,
pays sans biens,
hôte pelé,
je roule ma chance
vers vous »René Char, Retour amont – Poèmes
Virginie Maris
► Les sources de glace, d’Olivier de Sépibus & Nastassja Martin, Paulsen, 2025
Récit · Au pied du barrage · Martin Arnould
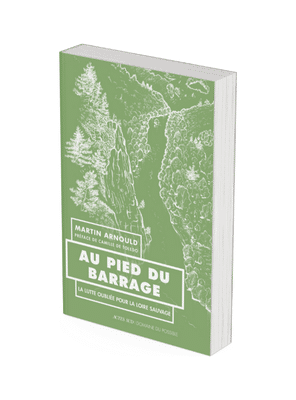
Première enquête dans la nouvelle ligne de la collection Domaine du possible, désormais dirigée par Anne de Malleray, le livre de Martin Arnould nous replonge dans une lutte à la fois majeure et méconnue du mouvement écologiste français : le combat, à partir de 1986, de SOS Loire Vivante contre la construction programmée de plusieurs barrages sur le haut bassin de la Loire, en particulier celui de Serre-de-la-Fare qui menaçait d’engloutir vingt kilomètres de gorges sauvages entre Goudet et Solignac-sur-Loire.
En mêlant un amour palpable des lieux avec une description minutieuse des modes d’action et de l’organisation du mouvement, quelques éléments biographiques, des anecdotes, des connaissances écologiques et hydrographiques, une mise en perspective historique, Martin Arnould parvient à nous faire à la fois sentir et comprendre la lutte, notamment l’occupation résolue du site durant cinq ans, à partir de 1988, qui a fini par contraindre l’État à renoncer d’abord au barrage de Serre-de-la-Fare en 1991, puis à l’ensemble du programme d’aménagement lourd de la Loire en 1994.
Mais il faut dire aussi à quel point le livre constitue un pari éditorial réussi, qui amorce une vraie réflexion sur les manières de raconter les luttes et les expériences de l’écologie politique, pour « nourrir la critique et outiller l’action » comme le défend le nouveau manifeste de la collection.
Autour du récit principal, qui constitue la colonne vertébrale de l’ouvrage, on sinue ainsi entre les superbes dessins de Jean-Alfredo Albert (qui disent, depuis aujourd’hui, les paysages sauvés des eaux), les photographies historiques de la lutte (qui rappellent parfois la joie drôle et rageuse de celles de la lutte des femmes de Greenham) et un entretien particulièrement émouvant entre l’éditrice, Martin Arnould et son père, Jean-François, aujourd’hui âgé de 90 ans, figure de la lutte lui aussi.
Cette composition donne au livre la puissance croisée du témoignage, forcément partiel et partial, de l’un des acteurs de la lutte, et des matériaux plus bruts, qui permettent à chacun·e de s’approprier le récit, avec ses failles, ses étonnements, ses certitudes, ses doutes, ses enthousiasmes, tout en le laissant résonner avec nos propres attachements et nos propres expériences.
Je dois d’ailleurs dire que le livre m’a d’autant plus touché que nos séminaires de travail avec le collectif de rédaction de la revue se passent souvent dans ces coins de Haute-Loire que j’ai appris à aimer, et parce que j’ai aussi tenté de me bagarrer — avec nettement moins de succès — pour défendre un autre bout de Loire, plus en aval, contre un autre grand projet stupide et destructeur.
Ce côté « ouvert » d’un livre-matériaux et sa rencontre avec ma propre expérience affective et militante a d’ailleurs fait naître une interrogation — mais vos lectures feront certainement émerger d’autres questions !
Pour ma part, je n’arrête pas de me demander comment les militant·es de SOS Loire Vivante ont pu échapper à ce qui est aujourd’hui le quotidien de toute opposition à un grand projet, à savoir la violence policière constante, les expulsions du moindre début d’occupation, le fichage par les services de renseignement, bref la répression méthodique.
Le récit de la lutte n’est certes pas exempt de violence, avec notamment des incendies et des coups de fusil de la part des partisans du projet. Elle est aussi hantée par l’ombre du meurtre de Vital Michalon, tué en 1978 par la grenade d’un gendarme lors d’une manifestation antinucléaire à Creys-Malville, traumatisme durable du mouvement écologiste français.
Mais comme le concède Arnould avec un étonnement rétrospectif, les Premiers ministres successifs, de gauche comme de droite, de Rocard à Balladur, tous ont eu « l’obligeance de ne jamais envoyer les gendarmes mobiles, comme Jean-Marc Ayrault le fera à Notre-Dame-des-Landes ou Manuel Valls à Sivens » (p. 91). Pourquoi cette retenue ? Faut-il, comme semble le faire parfois l’auteur, chercher l’explication dans les formes d’organisation particulière revendiquées par SOS Loire Vivante (non-violence totale, composition politique très large, alliance avec de grandes ONG comme le WWF) ? Ou bien doit-on plutôt attribuer cette relative paix policière à un contexte politique particulier, un moment où, peut-être, le capitalisme n’a pas pleinement conscience de la menace existentielle qu’une écologie politique conséquente constitue pour lui ?
Le livre, par sa construction, laisse élégamment la question en suspens : à nous d’y réfléchir ! Ce faisant, il se place à l’endroit le plus juste pour raconter aujourd’hui un combat comme celui de Loire Vivante. Tout en contribuant à garder vivace la mémoire d’une lutte, il maintient cette mémoire ouverte : comme une matière à inspiration autant qu’à discussion.
Aurélien Gabriel Cohen
► Au pied du barrage de Martin Arnould, Actes Sud, 2025
Essai · Non noyées : leçons féministes Noires apprises auprès des mammifères marines · Alexis Pauline Gumbs
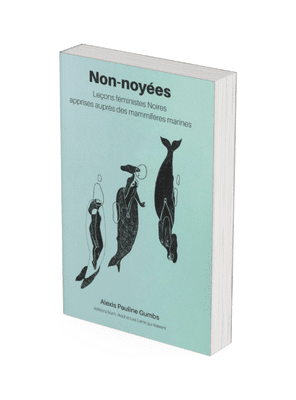
Ce n’est pas vraiment un recueil de poésie, ni un récit de « nature writing » à la première personne, et pas un pamphlet antispéciste non plus. Non noyées est un peu tout ça, et aussi autre chose : un « manuel de dénoyade » pour respirer dans des conditions irrespirables qui explore dix-neuf « leçons féministes Noires apprises auprès des mammifères marines » (le féminin générique est employé à travers le livre). S’auto-définissant comme « semeuse de troubles queer noire, évangéliste de l’amour et cousine aspirante de tous les êtres sensibles », Alexis Pauline Gumbs s’est imposée ces dernières années comme une penseuse incontournable des féminismes Noires, de l’écologie, et des maternités radicales.
Du « droit à l’obscurité » inspiré de la baleine à bec, aux pratiques d’alimentation collectives et circulaires des raies manta, en passant par l’abandon confiant des dauphins-pandas qui s’échouent sur les rivages, certains que la marée les ramènera à la mer, l’autrice tisse habilement savoirs naturalistes et poésie pour décrire les existences étonnamment queer, féroces, et parfois ludiques des mammifères de la mer. Au-delà des dualismes stériles – entre spirituel et politique, masculin et féminin (jusque dans le choix des polices de caractères, qui explorent une écriture dégenrée), elle pratique « l’art de l’identification » : non pas un geste de nomination, de capture ou de classification d’autres espèces, mais un mouvement par lequel on se reconnaît en elles, et avec elles.
Celles et ceux qui s’attendent à trouver ici un manifeste antiraciste pour une justice interespèces rigoureusement argumenté risquent d’être désorientés, peut-être même irrités, par l’absence de direction programmatique, par la pluie de « je t’aime » qui émaillent le texte, et par la primauté accordée à la résonance sensible plutôt qu’à la critique acérée. Pour reprendre le titre de la célèbre invitation d’Audre Lorde à nommer ce qui est structurellement invisibilisé, coulé et marginalisé, la poésie n’est pourtant pas un luxe, et encore moins quand elle rend hommage aux héritages des féministes Noires et qu’elle nous permet de nous identifier « avec une personne qui appartient soi disant à une autre espèce ». Encore faut-il accepter de ralentir. Et là encore, nous pouvons apprendre des mammifères marines : la phoque commune, lorsqu’elle plonge, peut faire tomber les battements de son cœur à trois, parfois quatre par minute (leçon 17).
Les dessins de Maya Mihindou sont d’une puissance radieuse, et à eux seuls, justifient qu’on ouvre le livre et qu’on s’y attarde – des baleines, des bateaux, des racines, des bulles et des sirènes s’entrelacent, nagent, s’affrontent, et résistent, évoquant la mue, la fugitivité, le souffle et la guérison – c’est magnifique, ça fait songer, et, comme dirait l’ami à qui j’ai envoyé des photos du livre par message, « purée, ça donne tellement envie de se faire tatouer » !
Léna Silberzahn
► Non noyées : leçons féministes Noires apprises auprès des mammifères marines d’Alexis Pauline Gumbs,
Burn~Août / Les liens qui libèrent, 2024
Roman · Le Déluge · Stephen Markley
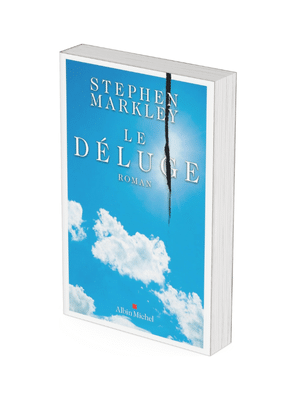
Le roman de Stephen Markley intitulé Le Déluge, paru aux États-Unis en 2022, prend la forme d’une fresque sociale et politique décrivant les affres d’une civilisation prise dans la tourmente du réchauffement climatique.
Situé dans le contexte géopolitique des États-Unis, le décor dressé par l’auteur au début du roman est des plus réalistes. On y retrouve ce qui semble de plus en plus, aujourd’hui, former le tissu de nos vies quotidiennes et de notre actualité médiatique : multiplication des catastrophes écologiques, montée de la violence et du fascisme, développement des technologies numériques, de l’IA et des systèmes de surveillance.
Sur une période temporelle allant de 2013 à 2039, on suit les trajectoires de personnages mis à l’épreuve de ces bouleversements et de leurs conséquences sur les plans intime, social et politique. Des liens, frictions, échos ou dépendances se nouent entre les vies de Tony, climatologue menacé de mort pour ses travaux sur la fonte des glaces arctiques ; de Keeper, jeune prolétaire drogué et désœuvré devenu le jouet involontaire de groupes terroristes ; d’Ashir, ingénieur informaticien qui construit des systèmes de modélisation prédictifs pour tenter de limiter les effets de la crise climatique ; de Murdock, ancien démineur de l’armée américaine recruté par un groupe de saboteurs ; de Kate, jeune militante transformée en égérie internationale de la lutte écologique ; de Jackie, publicitaire BCBG avide d’ascension sociale, prête à vendre son âme aux lobbys pétroliers et industriels pour empêcher le vote d’une loi sur le climat ; ou encore celle du « Pasteur », ancien acteur hollywoodien converti à l’évangélisme qui utilise les réseaux sociaux et la réalité virtuelle pour diffuser massivement son message d’apocalypse.
Quelles réponses chacune de ces trajectoires tente d’apporter aux bouleversements engendrés par le réchauffement climatique, pour le meilleur comme pour le pire ? Markley nous fait entrer dans la tête de chaque personnage pour suivre les mouvements et métamorphoses qui s’opèrent en lui au cours du temps et face aux événements, tout en explorant les effets de résonance ou de rétroaction à distance qui se produisent entre ces lignes de vie, tissant la toile d’une intrigue complexe, prise dans les soubresauts d’une Terre en éruption.
La montée se fait tout en crescendo, augmentant en proportion du déchaînement et de la multiplication des catastrophes écologiques – montée des eaux, méga-feux, sécheresses, ouragans, tempêtes -, exacerbant les inégalités, les dominations de classe, la déshumanisation technologique et le racisme qui déchirent la société américaine contemporaine.
À mesure que l’étau climatique se resserre, toutes ces vies se trouvent emportées dans le mouvement d’une spirale collective infernale au sein de laquelle elles ne cessent de se débattre et de chercher des issues. La montée en puissance des catastrophes écologiques nourrit une angoisse grandissante et une désagrégation du corps social, se traduisant par la montée de politiques techno-sécuritaires et autoritaires qui ne font, en retour, qu’accroître les violences et les destructions.
Le roman tire sa force de la description progressive et minutieuse, quasi-scientifique, de la complexité des ressorts, à la fois politiques, économiques, sociaux et psychologiques, qui participent à la formation de cette spirale infernale. Il déplie aussi la palette des choix qui s’offrent à nous aujourd’hui pour tenter d’y répondre et leurs possibles conséquences sur notre avenir commun : transformation sociale, réforme politique, quête eschatologique, sacrifice apocalyptique ou repli identitaire violent. Sa lecture peut indéniablement susciter de l’éco-anxiété, tant la dystopie qui s’y dessine semble réaliste, fidèle portrait d’un ensemble de tendances à l’œuvre dans notre monde contemporain.
Mais il est aussi possible de le voir comme une œuvre cathartique, réveillant et explorant toutes les émotions de pitié et de terreur que peuvent susciter les bouleversements de notre époque, moins pour condamner les lecteurs à la passivité et à l’inaction que pour leur donner les moyens d’appréhender un réel de plus en plus complexe, en révélant les tensions, contradictions, et ambivalences de notre nouvelle condition.
Sophie Gosselin
► Le Déluge de Stephen Markley, Albin Michel, 2024 (traduit de l’américain par Charles Recoursé)
NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !
Depuis 2018, Terrestres est la revue de référence des écologies radicales.
À travers des essais, enquêtes, traductions inédites et récits de résistances, nous explorons les nouvelles pensées et pratiques nécessaires pour répondre à la catastrophe écologique.
Chaque semaine, nous publions en accès libre des articles qui approfondissent les enjeux écologiques, politiques, et sociaux, tout en critiquant l’emprise du capitalisme sur le vivant. Plus qu’une revue, Terrestres est un laboratoire d’idées et un lieu de réflexions critiques, essentielles à l’élaboration d’alternatives justes et émancipatrices.
En nous lisant, en partageant nos articles et en nous soutenant, par vos dons si vous le pouvez, vous prenez le parti de l’écologie radicale dans la bataille culturelle qui fait rage.
Merci
!
L’article Conseils #4 : Nastassja Martin, Non-noyées, un Déluge et des barrages sur la Loire est apparu en premier sur Terrestres.
05.09.2025 à 10:38
La Palestine, l’impérialisme et la catastrophe climatique
Penser ensemble Gaza et le climat ? Oui, car tout se tient comme le défend ici Hamza Hamouchene, qui retrace l’écocide au long cours derrière le génocide en cours. Après la destruction de l’agriculture et l’accaparement de l’eau, les projets énergétiques d’Israël jettent une lumière crue sur l’impérialisme extractiviste à l’œuvre dans la logique coloniale.
L’article La Palestine, l’impérialisme et la catastrophe climatique est apparu en premier sur Terrestres.
Texte intégral (13475 mots)
Cet article est basé sur un chapitre du livre collectif Rising for Palestine : Africans in Solidarity for Decolonisation and Liberation (« Se soulever pour la Palestine : les Africain·es solidaires de la décolonisation et de la libération »), édité par Raouf Farah et Suraya Dadoo, à paraître aux éditions Pluto Press début 2026.
À première vue, il peut sembler inapproprié, voire déplacé, d’aborder les enjeux climatiques et écologiques alors qu’un génocide se déroule actuellement à Gaza. Mais il ne s’agit pas seulement d’un génocide ; on assiste également à un écocide, voire à ce que certain·es décrivent comme un holocide, c’est-à-dire l’anéantissement délibéré d’un tissu social et écologique dans son intégralité. La bande de Gaza est jonchée de plus de 40 millions de tonnes de débris et de matériaux dangereux, qui recouvrent pour la plupart des restes de corps humains. Au début de l’année 2024, une grande partie des terres agricoles de Gaza était déjà ravagée, après que les vergers, les serres et les cultures de subsistance ont été anéantis par les bombardements incessants. Les oliveraies et les fermes ne sont plus qu’un tas de terre et de poussière, les munitions et les toxines contaminent les sols et les eaux souterraines, tandis que l’eau de mer au large de Gaza est saturée d’eaux usées et de déchets, après qu’Israël a coupé l’alimentation en électricité et détruit les stations d’épuration.
Saisir l’ampleur de la dévastation écologique que génère le génocide commis par Israël permet de mettre en évidence les nombreuses interconnexions entre la crise climatique et écologique et la lutte pour la libération de la Palestine. Il ne peut y avoir de véritable justice climatique à l’échelle mondiale sans la libération du peuple palestinien, de même que cette lutte de libération est intrinsèquement liée à la survie de la terre et de l’humanité.
Les propos qui vont suivre cherchent à démontrer que la destruction des écosystèmes opérée par Israël est en lien direct avec la violence coloniale que l’État hébreu déploie en Palestine, et qui a atteint son paroxysme avec le génocide en cours. Nous cherchons ici à démontrer que les dommages environnementaux ont constitué, dès le départ, un aspect essentiel du système de domination coloniale sioniste, et comment ces dégradations ont constitué un outil pour contrôler et anéantir. Par la suite, la présente analyse abordera des enjeux cruciaux tels que la vulnérabilité climatique disproportionnée imposée aux Palestinien·nes, le déploiement par Israël de stratégies d’éco-blanchiment et d’éco-normalisation pour camoufler sa stratégie d’occupation et d’apartheid, ainsi que l’écocide en cours à Gaza et la place d’Israël dans le régime du capitalisme fossile mondial. Enfin, nous évoquerons la résistance du peuple palestinien à travers des pratiques enracinées dans le respect de la terre et des cultures, qui promeuvent non seulement un rejet de la domination mais également une conception particulière de la justice environnementale, ancrée dans les luttes de libération.
Orientalisme environnemental
Israël a toujours décrit la Palestine d’avant 1948 comme un territoire vide et désertique, contrastant avec l’oasis florissante promise par la création de l’État d’Israël. Ce discours environnemental raciste dépeint les peuples autochtones de Palestine comme des sauvages qui négligent, voire détruisent les terres sur lesquelles ces populations vivent depuis des millénaires. Cette perspective environnementale n’est pas nouvelle, ni même propre au colonialisme israélien. En invoquant le concept d’« orientalisme environnemental », la géographe Diana K. Davis souligne que dans l’imaginaire anglo-européen du 19ᵉ siècle, les milieux naturels dans le monde arabe ont souvent été représentés comme « dégradés d’une certaine façon », ce qui impliquait la nécessité d’une intervention pour les améliorer, les restaurer, les normaliser et les réparer1.
L’idéologie sioniste de la Rédemption de la terre se reflète dans le discours construit autour des projets de boisement menés par le Fonds national juif (FNJ), une organisation parapublique israélienne. Le FNJ a cherché à recouvrir les vestiges matériels et symboliques des 86 villages palestiniens détruits lors de la Nakba en ayant recours au boisement2. Sous couvert de politiques de conservation, l’organisation a instrumentalisé la plantation d’arbres pour dissimuler la réalité des déplacements massifs de populations liés à la colonisation, du nettoyage ethnique, de la destruction de l’environnement et de la dépossession, tout en créant de nouveaux paysages destinés à remplacer les paysages autochtones.
La chercheuse Ghada Sasa décrypte avec brio ces pratiques éco-coloniales, qu’elle décrit comme relevant d’un colonialisme « vert », c’est-à-dire l’appropriation par Israël de concepts environnementalistes pour éliminer la population palestinienne autochtone et accaparer ses ressources. Elle décrit comment l’État hébreu utilise les classifications et appellations de préservation de l’environnement (parcs nationaux, forêts et réserves naturelles) pour justifier l’accaparement des terres et empêcher le retour des réfugié·es palestinien·nes, dans le but de vider la Palestine de son essence historique pour judaïser et européaniser son territoire, en effaçant l’identité palestinienne et en éliminant la résistance à l’oppression coloniale. Ces pratiques servent également à « écologiser » l’image de l’État d’Israël dans un contexte d’apartheid3.
Qu’il s’agisse de campagnes de boisement ou de l’accaparement des ressources en eau, les atteintes aux milieux naturels commises par Israël en Palestine illustrent comment la relation à la nature s’inscrit dans une logique coloniale plus vaste.
L’eau fait partie des ressources qu’Israël accapare en Palestine. Peu après la création de l’État d’Israël en 1948, le FNJ a asséché le lac Hula et les zones humides environnantes dans le nord de la Palestine historique4, au prétexte que cela était nécessaire pour agrandir les surfaces agricoles. Or, non seulement le projet n’a pas permis de dégager des terres agricoles « productives » pour les colons juif·ves européen·nes nouvellement arrivé·es, mais cela a également causé des dommages environnementaux considérables, en décimant des espèces végétales et animales essentielles4 et en polluant les eaux se déversant dans la mer de Galilée (lac de Tibériade), ce qui a eu un impact sur la qualité de l’eau du fleuve Jourdain en aval5. À peu près à la même période, la compagnie nationale des eaux israélienne Mekorot a commencé à détourner les eaux du Jourdain vers les colonies et les villes côtières israéliennes, ainsi que vers les colonies juives installées dans le désert du Naqab (Néguev)6. À la suite de l’occupation par Israël de la Cisjordanie et de la bande de Gaza en 1967, le pompage des eaux du Jourdain s’est intensifié. Aujourd’hui, le fleuve n’est plus qu’un ruisseau pollué par les déchets et les eaux usées, en particulier sa section en aval7.
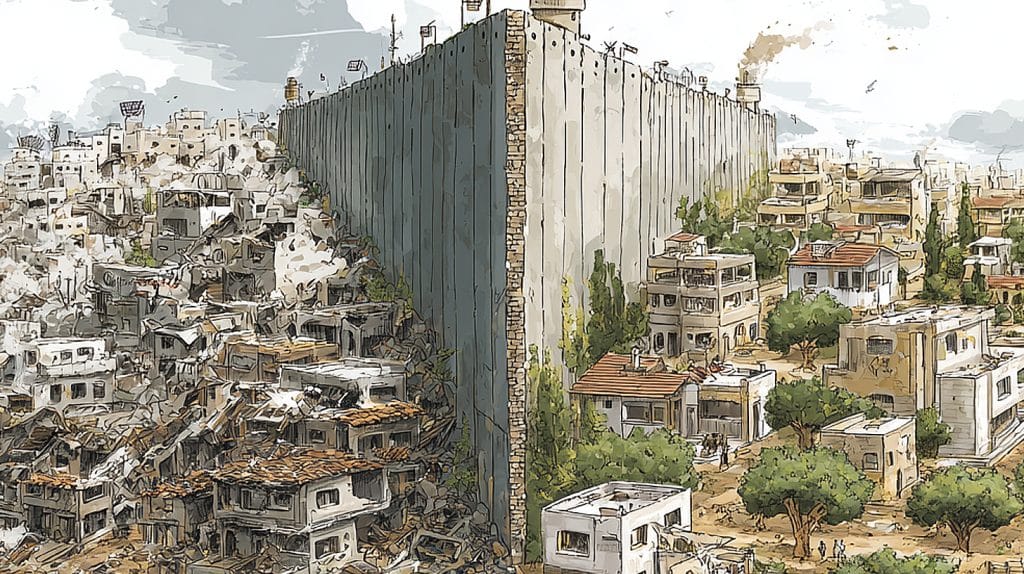
Qu’il s’agisse de campagnes de boisement ou de l’accaparement des ressources en eau, les atteintes aux milieux naturels commises par Israël en Palestine illustrent comment la relation à la nature s’inscrit dans une logique coloniale plus vaste. Le colonialisme de peuplement est une forme de domination qui vient violemment perturber les relations des peuples avec leur environnement, en ce qu’il « fragilise stratégiquement la survivance collective des communautés autochtones sur leurs terres8 ». Vu sous cet angle, le colonialisme de peuplement s’apparente à une domination écologique, car il efface les relations essentielles qu’entretiennent les peuples autochtones avec leurs milieux naturels pour imposer des modèles écologiques coloniaux. Comme le fait remarquer Kyle Whyte, « les populations de colons s’efforcent de créer leurs propres écosystèmes en éradiquant les écosystèmes autochtones, ce qui exige souvent d’introduire d’autres ressources et d’autres êtres vivants9 ». À cet égard, la chercheuse Shourideh Molavi affirme elle aussi que la violence coloniale est « avant tout une violence écologique », une tentative de remplacer un écosystème par un autre. Ce point de vue est partagé par l’architecte Eyal Weizman, qui soutient que « l’environnement constitue l’un des instruments du racisme colonial, sur lequel on s’appuie pour accaparer les terres, renforcer les lignes de siège et perpétuer la violence10 ». Weizman observe qu’en Palestine, « la Nakba revêt également une dimension environnementale moins connue, à savoir le bouleversement global de l’environnement, de la météo, des sols ; la perturbation du climat local, de la végétation et de l’atmosphère. La Nakba est un processus de changement climatique imposé par la colonisation.10 »
Pour aller plus loin, vous pouvez lire aussi dans Terrestres « Prise de terre et Terre promise : sur l’État colonial d’Israël » d’Ali Zniber, août 2024.
La crise climatique en Palestine
Dans ce contexte où l’État israélien est responsable de la dégradation des milieux naturels en Palestine, la population palestinienne est aujourd’hui confrontée à l’intensification de la crise climatique à l’échelle mondiale. D’ici la fin du siècle, les précipitations annuelles dans la région pourraient diminuer de 30 % par rapport à la période 1961-199011. Le groupe intergouvernemental d’experts sur l’évolution du climat (GIEC) prévoit une augmentation des températures de 2,2 à 5,1 °C, ce qui entraînera des perturbations climatiques aux effets potentiellement catastrophiques, notamment une accélération de la désertification12. L’agriculture, qui constitue la clé de voûte de l’économie palestinienne, s’en trouvera profondément impactée. Le raccourcissement des saisons de croissance des cultures et l’augmentation des besoins en eau entraîneront une hausse des prix des denrées alimentaires, ce qui constitue une menace pour la sécurité alimentaire.
La vulnérabilité de la population palestinienne face au changement climatique doit être comprise dans le contexte de la violence coloniale qu’elle subit depuis un siècle : occupation, apartheid, dépossessions, déplacements de populations, oppression systémique et génocide. Comme l’a souligné Zena Agha13, ces violences exercées sur le temps long expliquent pourquoi les conséquences de la crise climatique affecteront, et affectent déjà les populations israélienne et palestinienne des Territoires palestiniens occupés (TPO) de manière profondément asymétrique. Ainsi, tandis que l’occupation continue d’empêcher les Palestinien·nes d’accéder aux ressources et de développer des infrastructures et des stratégies d’adaptation, Israël fait partie des pays les moins vulnérables au changement climatique dans la région, et des mieux préparés pour y faire face. Ainsi, en accaparant, pillant et en exerçant un contrôle sur la plupart des ressources disponibles en Palestine, des terres à l’eau en passant par l’énergie, Israël est en mesure de développer des technologies susceptibles d’atténuer certains des effets du changement climatique, aux dépens des travailleur·euses palestinien·nes et avec le soutien actif des puissances impérialistes. Pour résumer, les capacités d’adaptation au changement climatique sont profondément asymétriques entre Israël et la Palestine, et ces capacités sont déterminées en fonction de la race, de la religion, du statut juridique et des hiérarchies coloniales. On parle alors d’apartheid climatique, ou éco-apartheid14.
La vulnérabilité de la population palestinienne face au changement climatique doit être comprise dans le contexte de la violence coloniale qu’elle subit depuis un siècle : occupation, apartheid, dépossessions, déplacements de populations, oppression systémique et génocide.
La question de l’accès à l’eau illustre parfaitement cette situation profondément inégalitaire. Contrairement aux pays voisins, la région située entre le fleuve Jourdain et la mer Méditerranée ne souffre pas de pénuries d’eau. Pourtant, les populations palestiniennes de Cisjordanie et de Gaza sont affectées de manière chronique par une crise de l’accès à l’eau, en raison de la primauté donnée aux populations juives imposée par l’occupation, et de l’apartheid pratiqué autour des infrastructures hydrauliques. Depuis le début de l’occupation de la Cisjordanie en 1967, l’État d’Israël a monopolisé les sources d’eau douce, une pratique légitimée par les accords d’Oslo II en 1995, qui ont accordé à Israël le contrôle d’environ 80 % des ressources en eau présentes sur le territoire cisjordanien. Alors qu’Israël a perfectionné ses technologies de gestion des eaux et généralisé l’accès à l’eau de part et d’autre de la « Ligne verte », il devient de plus en plus difficile pour les Palestinien·nes d’accéder aux ressources en eau en raison de l’apartheid, de l’accaparement des terres et des dépossessions. En effet, l’État hébreu contrôle les sources d’eau douce, impose des quotas d’approvisionnement stricts à la population palestinienne, interdit tous les projets d’aménagement, tels que la création de puits, et a détruit à de nombreuses reprises des infrastructures d’approvisionnement en eau mises en place par les Palestinien·nes. En conséquence, la population juive israélienne installée entre le Jourdain et la Méditerranée dispose d’abondantes ressources en eau, grâce à l’accaparement et aux technologies de dessalement de l’eau de mer, tandis que la population palestinienne est confrontée à des pénuries chroniques qui s’aggraveront sous l’effet du changement climatique.

Les disparités sont frappantes : la consommation quotidienne d’eau par habitant·e en Israël était de 247 litres en 2020, soit plus de trois fois les 82,4 litres dont dispose quotidiennement chaque Palestinien·ne de Cisjordanie15. Dans les territoires occupés, 600 000 colons israélien·nes illégaux utilisent six fois plus d’eau que les 3 millions de Palestinien·nes. En outre, dans les colonies israéliennes illégales sont consommés jusqu’à 700 litres d’eau par personne et par jour, notamment pour entretenir des équipements de luxe comme les piscines et les gazons, tandis que certaines communautés palestiniennes, qui ne sont pas rattachées au réseau de distribution d’eau, survivent avec à peine 26 litres par personne et par jour. Ceci est proche de la moyenne dans les zones sinistrées et bien moins que la quantité d’eau suffisante pour les besoins personnels et domestiques, soit entre 50 et 100 litres d’eau par personne et par jour, préconisés par les Nations Unies et l’OMS16. En 2015, seuls 50,9 % des ménages cisjordaniens bénéficiaient d’un accès quotidien à l’eau, tandis qu’en 2020, l’ONG israélienne B’Tselem estimait que seulement 36 % des Palestinien·nes de Cisjordanie jouissaient d’un accès à l’eau stable tout au long de l’année, avec un approvisionnement en eau disponible moins de 10 jours par mois pour 47 % d’entre elles et eux.
Dans les territoires occupés, 600 000 colons israélien·nes illégaux utilisent six fois plus d’eau que les 3 millions de Palestinien·nes.
La situation est pire encore à Gaza. Même avant le génocide actuel, seuls 30 % des ménages disposaient d’un accès quotidien à l’eau, un chiffre qui a fortement chuté depuis le début de l’offensive israélienne17. L’État d’Israël ne se contente pas de bloquer l’approvisionnement en eau propre et en quantité suffisante dans l’enclave de Gaza, il empêche également la construction ou la réparation d’infrastructures de gestion des eaux en bloquant l’acheminement des matériaux nécessaires. Les conséquences sont dramatiques : avant le début du génocide, 90 à 95 % de l’eau à Gaza était impropre à la consommation et inutilisable pour l’irrigation18. La pollution de l’eau était à l’origine de plus de 26 % des maladies signalées et constituait l’une des premières causes de mortalité infantile, responsable de plus de 12 % des décès d’enfants gazaouis19. En février 2025, alors que la violence génocidaire se poursuit et que la famine s’aggrave, Oxfam estimait l’eau disponible à Gaza à 5,7 litres d’eau par jour et par personne20.
Dans un tel contexte de restrictions de l’accès à l’eau, les impacts du changement climatique sur la qualité et la disponibilité de l’eau seront dévastateurs, en particulier à Gaza.
Éco-normalisation et greenwashing à l’ère des énergies renouvelables
Face à l’escalade des tensions liées à l’eau, à l’environnement et au climat auxquelles sont confronté·es les Palestinien·nes, Israël se présente pourtant comme le champion des technologies vertes, du dessalement d’eau de mer et des projets d’énergie renouvelable, déployés en Palestine occupée et ailleurs. En se targuant d’être un pays développé et engagé pour le climat au milieu d’un Moyen-Orient aride et régressif, l’État hébreu utilise son image « écolo » pour justifier sa politique coloniale de dépossession, blanchir son régime de colonisation et d’apartheid et pour occulter les crimes de guerre commis contre le peuple palestinien. Les accords d’Abraham signés avec les Émirats arabes unis (EAU), Bahreïn, le Maroc et le Soudan en 2020 ont permis de renforcer cette image, de même que d’autres accords conclus pour la mise en œuvre conjointe de projets environnementaux autour des énergies renouvelables, de l’agro-industrie et de l’eau. Il s’agit d’une manifestation de l’éco-normalisation, qui consiste à utiliser une forme d’« écologisme » pour blanchir et normaliser les oppressions et injustices environnementales engendrées dans le monde arabe et ailleurs21.
Officialisée en décembre 2020, la normalisation des relations entre le Maroc et Israël est issue d’un accord entre deux puissances occupantes et facilité par leur protecteur impérial (les États-Unis, sous la houlette de Donald Trump), par lequel Israël et les États-Unis ont également reconnu la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. Depuis lors, les investissements et les accords réalisés par Israël au Maroc se sont multipliés, en particulier dans les secteurs de l’agroalimentaire et des énergies renouvelables.
Le 8 novembre 2022, lors de la COP 27 organisée à Charm el-Cheikh, la Jordanie et Israël ont signé un protocole d’accord sous l’égide des Émirats arabes unis, afin de poursuivre une étude de faisabilité pour deux projets interconnectés, nommés Prosperity Blue et Prosperity Green, qui constituent les deux pôles du projet global Prosperity. En vertu de cet accord, la Jordanie achètera 200 millions de mètres cubes d’eau par an à une station israélienne de dessalement d’eau de mer située sur la côte méditerranéenne, dans le cadre du projet Prosperity Blue. Cette station sera alimentée par une centrale solaire de 600 mégawatts (MW) installée en Jordanie (projet Prosperity Green), qui sera construite par Masdar, une entreprise publique émiratie spécialisée dans les énergies renouvelables. La rhétorique philanthropique déployée autour du projet Prosperity Blue masque la réalité du pillage des ressources en eau en Palestine orchestré par Israël depuis des dizaines d’années, comme nous l’avons vu plus haut, et permet à l’État hébreu de nier sa responsabilité dans les pénuries d’eau qui touchent toute la région, tout en se présentant comme un agent de la protection de l’environnement et de la maîtrise des technologies liées à l’eau. L’entreprise Mekorot, actrice majeure des activités de dessalement d’eau de mer en Israël, se positionne comme un leader mondial dans ce domaine, en partie grâce à la propagande israélienne d’éco-blanchiment. Les bénéfices générés par l’entreprise financent à la fois ses propres opérations, ainsi que l’apartheid de l’eau exercé par le gouvernement israélien à l’égard de la population palestinienne.
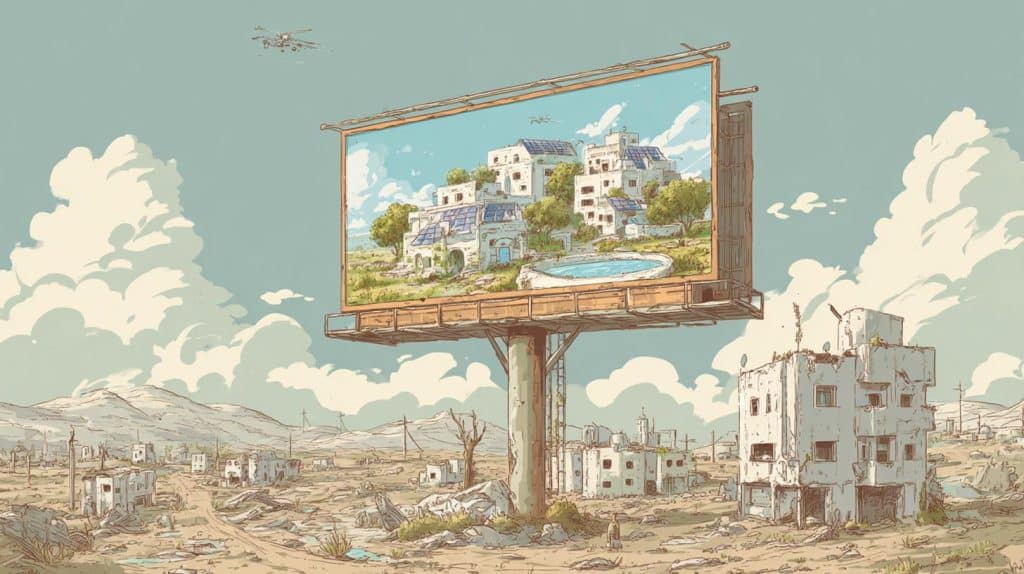
En août 2022, la Jordanie a rejoint le Maroc, les Émirats arabes unis, l’Arabie saoudite, l’Égypte, Bahreïn et Oman en signant un autre protocole d’accord avec deux entreprises israéliennes de production d’énergie, Enlight Green Energy (ENLT) et NewMed Energy, afin de mettre en œuvre des projets d’énergie renouvelable dans toute la région, notamment dans les domaines de l’énergie solaire, de l’énergie éolienne et du stockage de l’énergie. Ces initiatives renforcent l’image d’Israël en tant que plaque tournante de l’innovation en matière d’énergies renouvelables, tout en lui permettant de poursuivre son projet de colonisation et d’étendre son influence géopolitique dans la région. L’objectif est d’intégrer Israël aux sphères énergético-économiques du monde arabe en lui conférant une position dominante, et en créant de nouvelles dépendances qui renforcent la dynamique de normalisation et présentent l’État hébreu comme un partenaire indispensable. Face à l’aggravation des crises écologique et climatique, les pays qui dépendent de l’énergie, de l’eau ou des technologies contrôlées par Israël pourraient en venir à considérer que la lutte de libération des Palestinien·nes passe au second plan, cherchant avant tout à sécuriser leur propre accès à ces ressources.
Plutôt que de considérer le monde arabe comme un ensemble homogène, il est essentiel d’identifier les hiérarchies et les inégalités internes qui la structurent. La région du Golfe fonctionne comme une force semi-périphérique, voire sous-impérialiste.
L’implication d’entreprises des pays du Golfe, telles que la société saoudienne ACWA Power et l’émiratie Masdar dans ces projets coloniaux met en évidence une caractéristique structurelle majeure du monde arabe. Plutôt que de considérer la région comme un ensemble homogène, il est essentiel d’identifier les hiérarchies et les inégalités internes qui la structurent. La région du Golfe fonctionne comme une force semi-périphérique, voire sous-impérialiste. Non seulement les pays du Golfe sont nettement plus riches que leurs voisins, mais ils participent également à la capture et la ponction de la plus-value à l’échelle régionale, reproduisant ainsi les dynamiques d’extraction, de marginalisation et d’accumulation par dépossession qui caractérisent les relations entre les centres impériaux et leurs périphéries.
Croisade contre la nature et écocide à Gaza
Les crimes horribles qu’Israël commet actuellement contre la population et les milieux naturels à Gaza sont le prolongement d’une offensive de longue date qui continue de s’intensifier, comme le souligne Shourideh C. Molavi dans son livre Environmental Warfare in Gaza. En rejetant l’idée que l’environnement ne serait que le décor inerte du conflit, Molavi montre comment les pratiques coloniales de l’État d’Israël instrumentalisent les composantes environnementales pour mener une guerre militaire à l’intérieur, et autour de la bande de Gaza10. Dans cette guerre, la destruction des zones résidentielles va de pair avec la dévastation des espaces agricoles à Gaza.
En ravageant des terres, en imposant aux agriculteur·trices palestinien·nes des restrictions sur les types et la taille des cultures autorisées, et en éradiquant pratiquement toutes les oliveraies et les plantations traditionnelles d’agrumes, Israël déploie à Gaza une violence d’ordre écologique. Outre les incursions et les massacres à répétition, les bulldozers israéliens traversent régulièrement la bande de Gaza pour décimer les cultures et détruire les serres agricoles. Comme cela a été documenté par le groupe de recherche londonien Forensic Architecture, l’État hébreu a petit à petit étendu la superficie de son no-man’s land militarisé, dite « zone tampon », le long de la frontière orientale de Gaza.
Depuis 2014, Israël a également recours à un arsenal chimique pour pulvériser régulièrement des herbicides toxiques au moyen d’avions pulvérisateurs qui détruisent les plantations agricoles palestiniennes sur de vastes portions de territoire dans l’enclave de Gaza22. Le ministère palestinien de l’agriculture estime qu’entre 2014 et 2018, les pulvérisations aériennes d’herbicides ont endommagé plus de 13 kilomètres carrés de terres agricoles à Gaza23. Mais les impacts de ces produits chimiques ne se limitent pas aux cultures ; en effet, l’ONG palestinienne de défense des droits humains Al-Mezan a averti que le bétail consommant des plantes contaminées chimiquement pourrait représenter un danger pour la santé humaine via la chaîne alimentaire24.
À Gaza, les colonisateur·trices sont engagé·es depuis longtemps dans un processus de désertification en transformant des terres agricoles autrefois fertiles en un espace aride et désolé, amputé de sa végétation.
Avant même le début du génocide, ces pratiques avaient ravagé des parcelles entières de terres arables, privant les agriculteur·trices gazaoui·es de leurs moyens de subsistance tout en offrant à l’armée israélienne une meilleure visibilité pour cibler à distance et mener des attaques meurtrières25. En conséquence, et contrairement aux vastes cultures irriguées de fraises, de melons, d’herbes aromatiques et de choux qui prospèrent dans les colonies israéliennes avoisinantes, les terres agricoles de Gaza semblent stériles et sans vie, non pas par nature mais à dessein. Au lieu de « faire fleurir le désert », les colonisateur·trices sont engagé·es dans un processus de désertification en transformant des terres agricoles autrefois fertiles en un espace aride et désolé, amputé de sa végétation.
C’est dans ce contexte de reconfiguration brutale du paysage biopolitique de Gaza (et de la Palestine historique dans son ensemble) par la colonisation qu’a eu lieu l’attaque du Hamas du 7 octobre. Depuis, les crimes commis par Israël à Gaza peuvent désormais être qualifiés d’écocide. L’étendue des dommages sur le territoire n’a pas encore été documentée, et les statistiques sont rapidement dépassées à mesure que l’État hébreu perpétue le génocide. On peut néanmoins citer ici quelques faits établis.

Comme le montre le groupe de recherche Forensic Architecture, dont les analyses s’appuient sur des images satellite, depuis le mois d’octobre 2023, les forces israéliennes ont systématiquement pris pour cible des vergers et des serres, dans une volonté délibérée de commettre un écocide et d’aggraver la famine catastrophique qui sévit actuellement à Gaza, et qui s’inscrit dans une stratégie plus large consistant à priver la population palestinienne des ressources dont elle a besoin pour survivre25. En mars 2024, environ 40 % des terres de Gaza utilisées pour la production agro-alimentaire avaient été ravagées, tandis que près d’un tiers des serres avaient été détruites, un chiffre qui s’élève à 90 % dans le nord et environ 40 % autour de la ville de Khan Younis25, au sud de la bande de Gaza. En outre, l’analyse des images satellite transmises au journal The Guardian en mars 2024 montre qu’à cette date, près de la moitié de la couverture arborée et des terres agricoles de Gaza avaient été anéanties, notamment par l’usage illégal de phosphore blanc. Comme le décrit un article du Guardian, les oliveraies et les fermes ont été réduites à des tas de poussière, les munitions et les toxines contaminent les sols et les eaux souterraines, et l’air est pollué par la fumée et les particules toxiques26. Il est très probable que la situation se soit considérablement aggravée depuis la rédaction de ces articles.
La rupture de l’approvisionnement en eau constitue l’une des facettes les plus meurtrières de l’écocide perpétré par Israël à Gaza. Avant même le début du génocide, environ 95 % des ressources en eau de l’unique nappe phréatique de Gaza étaient contaminées et impropres à la consommation ou à l’irrigation, conséquence du blocus inhumain et des attaques régulières commises par Israël pour empêcher la création et la réparation d’infrastructures de gestion des eaux et d’usines de dessalement. Depuis octobre 2023, les installations et les infrastructures hydrauliques à Gaza ont été totalement détruites, ce qui a entraîné une rupture de l’approvisionnement en eau potable et de gestion des eaux usées. Cette situation provoque de nombreux cas de déshydratation et des maladies, comme la typhoïde.
Pour aller plus loin, vous pouvez lire aussi dans Terrestres « En Palestine, « l’huile qu’on attend un an, les soldats la jettent en un instant » » par le Forum palestinien d’agroécologie, février 2025.
Outre les destructions directes causées par les attaques militaires, le manque de combustible a contraint les habitant·es de Gaza à abattre des arbres pour pouvoir cuisiner ou se chauffer, ce qui vient aggraver la raréfaction des arbres dont souffre actuellement le territoire. En parallèle, même les sols qui subsistent sont menacés par les bombardements israéliens et les destructions. Selon le Programme des Nations unies pour l’environnement (PNUE), bombarder des zones peuplées de manière intensive génère une contamination des sols et des eaux souterraines sur le long terme, à cause de l’afflux de munitions et parce que les bâtiments effondrés libèrent des substances dangereuses telles que l’amiante, des produits chimiques industriels et du carburant dans l’air, les sols et les eaux souterraines27. En juillet 2024, le PNUE estimait que les bombardements avaient généré plus de 40 millions de tonnes de débris et de substances nocives, recouvrant pour la plupart des restes humains. Il faudra 15 ans pour déblayer les décombres de Gaza, pour un coût qui pourrait s’élever à plus de 600 millions de dollars28.
L’écocide perpétré par Israël à Gaza s’étend jusqu’à la mer et au-delà, la côte méditerranéenne étant désormais saturée d’eaux usées et de déchets. Après qu’Israël a coupé l’approvisionnement en carburant de Gaza après le 7 octobre, les coupures d’électricité ont empêché le pompage des eaux usées vers les stations d’épuration, et 100 000 mètres cubes par jour d’eaux usées ont été déversés dans la Méditerranée. Outre la destruction des infrastructures sanitaires, les attaques contre les hôpitaux et le personnel de santé, et les restrictions sévères imposées à l’entrée de fournitures médicales sur le territoire, cette situation a créé les conditions « parfaites » propices à l’apparition de maladies infectieuses, telles que le choléra, et à la résurgence de maladies autrefois éradiquées par la vaccination, comme la polio29.
La longue liste des destructions décrites dans les paragraphes précédents ont conduit de nombreux expert·es et observateur·trices à affirmer que les attaques répétées d’Israël contre les écosystèmes à Gaza ont rendu le territoire invivable.
« Le génocide et les actes barbares perpétrés contre le peuple palestinien sont ce qui attend ceux qui fuient les Suds à cause de la crise climatique… Ce dont nous sommes témoins à Gaza est une répétition du spectacle de l’avenir. »
Gustavo Petro, président de la Colombie
La Palestine contre l’impérialisme américain et le capitalisme fossile mondial
Lors de la COP 28, sommet sur le climat qui s’est tenu à Dubaï en décembre 2023, le président colombien Gustavo Petro a déclaré que « Le génocide et les actes barbares perpétrés contre le peuple palestinien sont ce qui attend ceux qui fuient les Suds à cause de la crise climatique… Ce dont nous sommes témoins à Gaza est une répétition du spectacle de l’avenir.30 » Comme le dit si bien le président colombien, le génocide à Gaza est un avertissement de ce qui nous attend si nous ne nous organisons pas et ne résistons pas. L’empire et ses classes dirigeantes sont prêts à sacrifier des millions de personnes noires, basanées et blanches de la classe ouvrière pour garantir l’accumulation du capital et perpétuer leur domination. Cela se reflète clairement dans le refus de ces élites, lors de la COP 29 à Bakou, de s’engager en faveur de l’action climatique tout en continuant à financer le génocide à Gaza, de même que dans l’apartheid autour de l’accès aux vaccins lors de la pandémie de COVID-19.
Cela révèle également comment la guerre et les complexes militaro-industriels alimentent la crise climatique. En effet, l’armée américaine est l’institution qui émet le plus de CO2 au monde31. Pour ce qui est de la guerre génocidaire à Gaza, les émissions générées par l’État d’Israël ont dépassé, en deux mois seulement, les émissions annuelles de carbone d’une vingtaine des pays les plus vulnérables au changement climatique, et sont causées en grande partie par les vols cargo de l’armée américaine et la fabrication d’armes32. Les États-Unis ne se contentent pas de faciliter un génocide, ils contribuent également activement à l’écocide commis en Palestine.

Mais le lien entre la première puissance mondiale et ce qui se passe en Palestine est encore plus profond. La lutte pour la libération des Palestinien·nes est indissociable de la résistance contre le capitalisme fossile et l’impérialisme américain. La Palestine est située au cœur du Moyen-Orient, une région qui occupe une place centrale dans l’économie capitaliste mondiale, non seulement en raison des flux commerciaux et financiers qu’elle concentre, mais aussi car celle-ci constitue le noyau du système mondial des combustibles fossiles, assurant environ 35 % de la production de pétrole à l’échelle mondiale33. En parallèle, Israël cherche à devenir une plaque tournante régionale de la production d’énergie, notamment grâce aux gisements de gaz comme les champs de Tamar et Leviathan en Méditerranée, pour lesquels le pays a accordé de nouvelles licences d’exploration gazière, quelques semaines seulement après le début de sa guerre génocidaire à Gaza.
L’hégémonie américaine au Moyen-Orient, et ses effets sur le système du capitalisme fossile mondial, repose sur deux piliers : l’État d’Israël et les monarchies du Golfe. Le premier, décrit par l’ancien secrétaire d’État américain Alexander Haig comme « le plus grand porte-avions américain au monde, impossible à couler », représente le point d’ancrage de l’empire américain dans la région en participant au contrôle des ressources en combustibles fossiles, ce qui ouvre la voie à l’innovation en matière de technologies de surveillance et d’armement. Son intégration dans l’économie de la région s’opère par le biais de secteurs tels que l’agro-industrie, les énergies et la désalinisation. Pour renforcer leur domination, les États-Unis et leurs alliés s’emploient activement à normaliser la position d’Israël dans la région. Ce processus a débuté avec les accords de Camp David de 1978 et le traité de paix signé entre Israël et la Jordanie en 1994, suivis par les accords d’Abraham conclus en 2020 avec les Émirats arabes unis, Bahreïn, le Soudan et le Maroc. Avant le 7 octobre, la normalisation des relations entre Israël et l’Arabie saoudite était imminente, dans le cadre d’un accord conçu sous l’égide des États-Unis qui aurait anéanti la cause palestinienne. Les actions de la résistance palestinienne ont perturbé ces plans.
La libération de la Palestine doit être un enjeu central des luttes en faveur de l’environnement et de la justice climatique à l’échelle mondiale.
Tout cela démontre que la libération du peuple palestinien ne relève pas simplement d’une question de morale ou de droits humains ; il s’agit aussi d’une confrontation directe avec l’impérialisme américain et le système du capitalisme fossile. C’est pourquoi la libération de la Palestine doit être un enjeu central des luttes en faveur de l’environnement et de la justice climatique à l’échelle mondiale. Cela implique de s’opposer à la normalisation d’Israël et de soutenir le mouvement Boycott, désinvestissement et sanctions (BDS), notamment dans le domaine des technologies vertes et des énergies renouvelables. Il ne peut y avoir de justice climatique sans démanteler la colonie sioniste d’Israël et renverser les régimes réactionnaires des pays du Golfe. La Palestine est en première ligne sur le front international contre le colonialisme, l’impérialisme, le capitalisme fossile et la suprématie blanche. C’est pourquoi les mouvements pour la justice climatique et les organisations antiracistes et anti-impérialistes doivent soutenir la lutte de libération, et défendre le droit des Palestinien·nes à résister par tous les moyens nécessaires.
Résistance et éco-soumoud
Face au cataclysme qu’elle subit, la population palestinienne continue de résister et de nous inspirer jour après jour par son soumoud (détermination, fermeté). Ce terme a de multiples significations. La chercheuse et militante palestinienne Manal Shqair le définit comme un ensemble de pratiques quotidiennes de résistance et d’adaptation aux difficultés de la vie quotidienne sous la domination coloniale imposée par Israël34. Le terme fait également référence à la persistance du peuple palestinien à demeurer sur ses terres, et à préserver son identité et sa culture face à la dépossession et aux discours qui présentent les colons juif·ves comme la seule population légitime de la région34.
Pour aller plus loin, vous pouvez lire aussi dans Terrestres « Démembrer et pulvériser les corps : sur la guerre d’anéantissement à Gaza » de Suzanne Beth, janvier 2025.
En introduisant le concept d’éco-soumoud, qui renvoie aux actes quotidiens de ténacité des Palestinien·nes qui emploient des moyens écologiques ancrés dans la terre afin de maintenir un lien profond avec celle-ci, les travaux de Manal Shqair nous permettent d’approfondir notre compréhension de la persévérance du peuple palestinien. Cette notion englobe les savoirs autochtones, les valeurs culturelles et les pratiques quotidiennes que les Palestinien·nes mettent en œuvre pour résister à la rupture violente de leur lien avec la terre. L’éco-soumoud repose sur l’idée que les seules réponses viables aux crises écologique et climatique sont celles qui soutiennent la quête de justice, de souveraineté et d’autodétermination du peuple palestinien, en mettant fin au régime israélien d’occupation et d’apartheid qui, en tant que colonie de peuplement, doit être démantelé. La pratique de l’éco-soumoud est ancrée dans la foi qu’il est possible de vaincre le colonialisme israélien, et véhicule l’aspiration inébranlable des populations colonisées à être elles-mêmes maîtresses de leur destin.
La résistance héroïque dont font preuve les Palestinien·nes, qui s’exprime à travers la notion d’éco-soumoud et par un profond attachement à la terre, est une source d’inspiration pour les mouvements progressistes du monde entier, en lutte pour un monde plus juste face à des désastres qui s’accumulent. Pour conclure ce chapitre, on peut citer l’écomarxiste Andreas Malm, qui établit un parallèle poignant entre la résistance du peuple palestinien et la lutte contre le réchauffement climatique :
« Qu’est-ce que le front climatique peut apprendre de la résistance palestinienne ? Que même lorsque la catastrophe est intégrale, implacable et ininterrompue, nous continuons à résister. Même lorsqu’il est trop tard, lorsque tout a été perdu, lorsque les terres ont été saccagées, nous sortons des décombres et nous nous battons. Nous ne cédons pas, nous ne nous rendons pas, nous n’abandonnons pas, car les Palestinien·nes ne meurent pas. Les Palestinien·nes ne seront jamais vaincu·es. Une armée puissante est perdante si elle ne gagne pas, mais une armée de résistance faible est gagnante tant qu’elle ne perd pas. J’espère que la guerre en cours à Gaza se terminera avec une résistance intacte, ce qui serait une victoire. La pérennité de la résistance palestinienne serait en soi une victoire, car nous continuerons à nous battre, quels que soient les désastres que vous déversez sur nous. C’est une source d’inspiration pour le front de lutte contre le changement climatique. En cela, les Palestinien·nes ne se battent pas seulement pour eux-mêmes. Ils et elles se battent pour l’humanité toute entière, pour l’idée d’une humanité qui résiste aux catastrophes, quelle qu’en soient les formes, et qui continue à se battre malgré la supériorité écrasante de ses adversaires. Je pense qu’il y a toutes sortes de raisons d’être solidaire de la résistance palestinienne, pour son propre bien, mais aussi pour le nôtre.35 »
La tâche qui nous attend est très difficile mais, pour répondre à l’appel formulé par Frantz Fanon, nous devons, dans une relative obscurité, découvrir notre mission, la remplir et ne pas la trahir36.
Illustration principale : ©Fourate Chahal El Rekaby.

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !
Depuis 2018, Terrestres est la revue de référence des écologies radicales.
À travers des essais, enquêtes, traductions inédites et récits de résistances, nous explorons les nouvelles pensées et pratiques nécessaires pour répondre à la catastrophe écologique.
Chaque semaine, nous publions en accès libre des articles qui approfondissent les enjeux écologiques, politiques, et sociaux, tout en critiquant l’emprise du capitalisme sur le vivant. Plus qu’une revue, Terrestres est un laboratoire d’idées et un lieu de réflexions critiques, essentielles à l’élaboration d’alternatives justes et émancipatrices.
En nous lisant, en partageant nos articles et en nous soutenant, par vos dons si vous le pouvez, vous prenez le parti de l’écologie radicale dans la bataille culturelle qui fait rage.
Merci  !
!
Notes
- Davis, D.K. « Imperialism, orientalism, and the environment in the Middle East : history, policy, power and practice », dans Davis et Edmund Burke (eds.), Environmental Imaginaries of the Middle East and North Africa, Athènes (Ohio), Ohio University Press, 2011.
- Galai, Y. « Narratives of redemption : “The international meaning of afforestation in the Israeli Negev” », International Political Sociology 11, n° 3 : 273-291, 2017.
- Sasa, G. « Oppressive pines : Uprooting Israeli green colonialism and implanting Palestinian A’wna », Politics, 43(2), 219-235, 2022.
- « Rehabilitation of the Hula Valley », Water for Israel, KKL-JNF.
- Zeitoun, M. et Dajani, M. « Israel is hoarding the Jordan River – it’s time to share it », The Conversation, 19 décembre 2019.
- Grassroots Palestinian Anti-Apartheid Wall Campaign (2025), « Weaponizing Water For Israel’s Genocide, Apartheid and Ethnic Cleansing ».
- Amnesty International, « L’occupation de l’eau », 2017.
- Molavi, S. C. Environmental Warfare in Gaza : Colonial Violence and New Landscapes of Resistance, Londres, Pluto, 2024.
- Whyte, K. « Settler Colonialism, Ecology, and Environmental Injustice », Environment and Society, 9, 1 (septembre) : 135, 2018.
- Molavi, op. cit.
- Tippmann, R. et Baroni, L. « ClimaSouth Technical Paper N.2. The Economics of Climate Change in Palestine », 2017.
- Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), Programme d’assistance au peuple palestinien, Stratégie d’adaptation au changement climatique et programme d’action pour l’Autorité palestinienne, 2010.
- Agha, Z. « Climate Change, the Occupation, and a Vulnerable Palestine », Al-Shabaka, 26 mars 2019.
- Dajani, M. « Challenging Israel’s Climate Apartheid in Palestine », Al-Shabaka, 30 janvier 2022.
- B’Tselem, « Parched : Israel’s policy of water deprivation in the West Bank », mai 2023.
- Voir la page des Nations Unies relative à l’accès à l’eau.
- The Applied Research Institute – Jérusalem (ARIJ), « Water resource allocations in the Occupied Palestinian Territory : Responding to Israeli claims », juin 2012.
- Lazarou, E. « L’eau et le conflit israélo-palestinien », Service de recherche parlementaire européen, 2016. https://www.europarl.europa.eu/
- Kubovich, Y. « Polluted Water Leading Cause of Child Mortality in Gaza, Study Finds », Haaretz, 16 octobre 2018.
- « Moins de 7 % des niveaux d’eau d’avant-guerre sont disponibles à Rafah et dans le nord de Gaza, aggravant une catastrophe sanitaire », Oxfam France, février 2025.
- Cette partie s’inspire dans une large mesure des travaux de Manal Shqair. Pour aller plus loin, voir Shqair, M. « L’éco-normalisation israélo-arabe : Écoblanchiment des colonies de peuplement en Palestine et dans le Jawlan », Transnational Institute, 2023.
- Forensic Architecture, « Herbicidal warfare in Gaza », 19 juillet 2019.
- Gisha, « Closing In : Life and Death in Gaza’s Access Restricted Areas », 2019.
- Al Mezan Center for Human Rights, « Effects of Aerial Spraying on farmlands in the Gaza Strip », 2018 (document pdf).
- Forensic Architecture, « A Cartography of Genocide : Israel’s Conduct in Gaza since October 2023 », 25 octobre 2024.
- Ahmed, K., Gayle, D. et Mousa, A. « « Ecocide in Gaza » : does scale of environmental destruction amount to a war crime ? », The Guardian, 29 mars 2024.
- Programme des Nations unies pour l’environnement (PNUE), « Environmental legacy of Explosive weapons in Populated Areas », 5 novembre 2021.
- Al Jazeera, « Clearing Gaza rubble could take 15 years, UN agency says », 15 juillet 2024.
- Ahmed, op. Cit
- Gouvernement de Colombie, « President Petro : The unleashing of genocide and barbarism on the Palestinian people is what awaits the exodus of the peoples of the South unleashed by the climate crisis », 1er décembre 2023.
- Mallinder, L. « “Elephant in the room” : The US military’s devastating carbon footprint », Al Jazeera, 12 décembre 2023.
- Neimark, B., Bigger, P., Otu-Larbi, F., et Larbi, R., « A Multitemporal Snapshot of Greenhouse Gas Emissions from the Israel-Gaza Conflict », 5 janvier 2024.
- BP, BP Statistical Review of World Energy 2022, 71st Edition, 2022 (document pdf).
- Shqair, op. cit. ; Johansson, A. et Vinthagen, S. Conceptualizing Everyday Resistance : A Transdisciplinary Approach, New York, Routledge, 2020 : 149-152.
- Extrait d’une conférence donnée par Andreas Malm à l’Université de Stockholm le 7 décembre 2023, intitulée « On Palestinian and Other Resistance In Times of Catastrophe ».
- Fanon, F. Les damnés de la terre, Éditions Maspero, Paris, 1961.
L’article La Palestine, l’impérialisme et la catastrophe climatique est apparu en premier sur Terrestres.
03.09.2025 à 11:58
Pour une écologie de la libération : antiracisme et écologie politique
Alors que la possibilité du fascisme prend corps à grande vitesse, il ne s’agit plus de convaincre, mais d’organiser le camp de l’émancipation, observe Fatima Ouassak dans ce texte incisif, qui ouvre le livre collectif « Terres et liberté ». Elle appelle à assumer la radicalité et à construire un front commun écologiste et antiraciste : l’écologie de la libération.
L’article Pour une écologie de la libération : antiracisme et écologie politique est apparu en premier sur Terrestres.
Texte intégral (4557 mots)
Ce texte est l’introduction par Fatima Ouassak du livre collectif qu’elle a coordonné : Terres et Liberté. Manifeste antiraciste pour une écologie de la libération, paru en mai 2025 aux éditions Les Liens qui Libèrent. L’ouvrage est la première parution de la collection « Écologies de la libération », que dirige Fatima Ouassak.
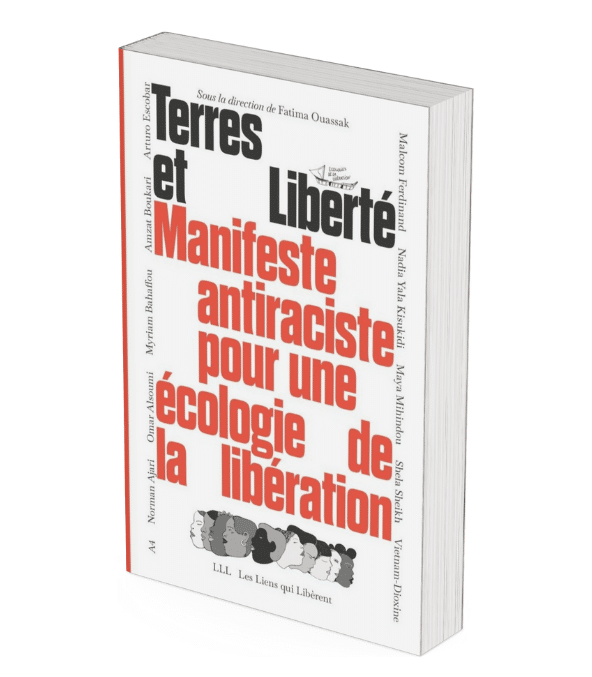
« Chaque génération doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission, la remplir, ou la trahir. »
Frantz Fanon, Les Damnés de la terre, 1961
Nous vivons à l’aube d’un basculement historique en Occident. Mille bruits de fond le laissent entendre : l’idée même de changement structurel — vers plus de justice — rendu nécessaire par l’urgence climatique est abandonnée par les grandes puissances mondiales, et le fascisme allié au néolibéralisme gagne partout du terrain. L’horizon s’obscurcit d’une possible gestion fasciste de l’urgence climatique : plus question de partager l’eau, l’air, la terre, la possibilité de vivre bien, de vivre tout court, avec celleux décrété·es indignes d’appartenir à l’humanité. Cette possibilité du fascisme prend corps — l’air de rien — très vite.
Dans le même temps — pour partie en réaction — grandit dans le camp de l’émancipation une exigence radicale de justice : la domination des un·es sur les autres n’est plus supportable. Cette exigence est le fruit d’une prise de conscience collective : celle de militant·es, d’intellectuel·les, de syndicalistes, de paysan·nes, d’avocat·tes, d’artistes, d’éditeur·ices, de journalistes engagé·es qui partagent l’ambition de construire un front commun contre ce qui ravage le monde.
En France, ce souffle radical pointe son nez aux portes de l’écologie politique. Le terrain est favorable : depuis une dizaine d’années se tisse un début d’alliance entre luttes écologistes et antiracistes, et on voit arriver une production théorique d’une écologie décoloniale. Un travail qui s’est ancré dans des luttes locales pour les soutenir et s’en inspirer, et qui a mené, en 2020, à un mot d’ordre partagé entre écologistes et antiracistes : « On veut respirer ! ».
La question est stratégique. La lutte continue, nous sommes d’accord. Mais avec qui ? Pour quoi faire ? S’agit-il de monter en radicalité dans une course contre la montre face au grand capital acoquiné avec l’extrême droite et d’adopter une stratégie révolutionnaire ? S’agit-il au contraire d’arrondir les angles pour freiner le train qui risque de tous·tes nous précipiter dans le ravin et de se ranger derrière une stratégie de repli ? Foncer et faire feu de tout bois ? Ou se terrer et se protéger des vents mauvais ? Nous considérons ici qu’il faut en écologie, comme en tout, résister corps et âme au fascisme. Face aux possibles basculements mortifères, nous n’avons plus le temps de prendre des pincettes en faisant le dos rond.
Va donc pour la course contre la montre et le feu
Partant de là, remplir notre mission, c’est assumer notre radicalité, la revendiquer. Cela risque de provoquer des controverses ? Tant mieux, vive la controverse ! Cela risque de cliver ? Encore heureux : il ne s’agit pas de convaincre les partisan·nes de la suprématie blanche de rejoindre le camp de l’émancipation. Il s’agit d’organiser le camp de l’émancipation, où nous sommes suffisamment nombreux·ses, et de construire des maquis — physiques, intellectuels et culturels. Remplir notre mission, c’est, malgré les critiques que nous pouvons lui adresser, ne pas rompre avec le champ de l’écologie. Le rapport critique à l’écologie ne doit pas viser à nous en débarrasser, mais au contraire à nous l’approprier. Répondre à notre mission, c’est aussi, dans un contexte d’extrême-droitisation des champs politique et médiatique, refuser de mettre la question raciale sous le tapis. Alors que l’antiracisme est diabolisé et que la défense de la liberté de circuler est taxée de haute trahison, du courage, il en faut. Mais personne n’a dit que notre mission était facile.
Depuis, nous sommes nombreux·ses à avoir découvert la mission de notre génération : travailler à un projet écologiste où l’égale dignité humaine est à la fois le centre et l’horizon. Reste à savoir si nous nous apprêtons à la remplir ou à la trahir. Voilà très précisément où nous en sommes aujourd’hui.
Il s’agit d’analyser précisément la singularité coloniale, islamophobe et anti-migrant·es du fascisme qui se répand aujourd’hui en Europe. Et comprendre que tout se tient : ce qui ravage la Terre ravage les populations non blanches, ce qui ravage les populations non blanches ravage la Terre.
Terres et Liberté est le premier point de ralliement que nous proposons, entre écologie et antiracisme. À l’heure où, en France, la terre se soulève aussi bien pour empêcher l’accaparement de l’eau au profit de quelques-un·es que pour dénoncer le meurtre d’un adolescent tué par la police, à l’heure où ce qui agite en silence les populations non blanches concerne l’enterrement des parents, quelle est la terre où reposer en paix ? Ici ou là-bas ? C’est une question derrière laquelle se cachent mille autres. Quelle est la terre où se reposer et vivre en paix ? Celle où faire grandir ses enfants ? Ces questionnements sont à la fois singuliers et universels. La terre ne concerne pas seulement les conditions de subsistance. Elle est aussi affaire de dignité car la libération de la terre est une condition à l’émancipation de celleux qui l’habitent.
C’est précisément cet enjeu que nous cherchons ici à explorer. Terres au pluriel car toutes ne se valent pas : elles sont souvent traitées comme le sont leurs habitant·es. Et Liberté au singulier pour rappeler que personne n’est libre si tout le monde ne l’est pas. Premier ouvrage de la collection « Écologies de la libération », Terres et Liberté vise à introduire les principaux enjeux, sujets de débat, champs d’action et luttes menées, dans une perspective croisée écologiste et antiraciste.
Une conviction nous anime : si nous y travaillons sérieusement, l’antiracisme peut devenir le nouveau souffle de l’écologie politique, et l’enrichir de joies militantes, de savoirs académiques, d’espérance, et d’une histoire pleine de détermination à vivre libres.
Terres au pluriel car toutes ne se valent pas : elles sont souvent traitées comme le sont leurs habitant·es. Et Liberté au singulier pour rappeler que personne n’est libre si tout le monde ne l’est pas.
Le maquis où il est désormais possible de verser dans un pot commun les héritages antiracistes et les héritages écologistes, c’est l’écologie de la libération. La pensée de Frantz Fanon, celle de Maria Lugones, la vision politique d’Abdelkrim El Khattabi, celle de Thomas Sankara, la libération de l’Algérie malgré cent trente-deux ans de destruction, la lutte pour protéger la terre guyanaise, la résistance en Kanaky, la résilience en Palestine… forment ce maquis où l’on peut résister pour contrer « l’écologie des frontières » mobilisée par les dirigeant·es d’extrême droite. Et où renouveler nos imaginaires, préciser nos horizons idéologiques, dans le détail. Qu’entendons-nous exactement par « racisme environnemental », « écocide », « extractivisme », « effondrement » et « fin du monde », « habiter colonial », « réparation », « justice climatique », « éthique du soin », « rhizome », « libération animale », « ancrage territorial »… ? Autant de définitions nécessaires pour déployer des outils d’émancipation.
L’écologie de la libération, c’est notre réponse à l’urgence que constituent les conséquences du dérèglement climatique et la montée en puissance des fascismes alliés au néolibéralisme en France et en Europe. C’est l’ensemble des grilles d’analyse, projets politiques et mouvements sociaux qui visent à libérer les animaux humains et non humains d’un système d’exploitation et de domination : les grilles d’analyse permettent de comprendre les ravages écologiques sur les êtres et les terres produits par la combinaison de systèmes d’oppression patriarcale, capitaliste et coloniale ; les projets politiques ouvrent des horizons écologistes à la fois anticapitalistes et anticolonialistes ; les mouvements sociaux se composent de collectifs d’habitant·es, d’associations culturelles, de tiers-lieux, d’entreprises, de syndicats, qui luttent contre le système responsable du dérèglement climatique et ses conséquences, avec au centre, les enjeux d’égale dignité humaine. Tout notre travail ici consiste à donner de la voix et du coffre à cette écologie de la libération. Se saisir des impensés et des angles morts de l’écologie politique — suprématie blanche et occidentale, rapports de domination coloniale et racisme environnemental entre autres — pour développer de nouveaux outils critiques. Une manière d’ouvrir un véritable espace antiraciste, et de participer ainsi aux ruptures et au renouvellement nécessaires dans l’écologie, en France et en Europe. La mission de notre génération est de travailler à un front commun écologiste, radicalement antiraciste. Travaillons-y vite, partout, nombreux·ses.
Image d’accueil : « Bush Babies » de Njideka Akunyili Crosby, 2017. Wikiart.

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !
Depuis 2018, Terrestres est la revue de référence des écologies radicales.
À travers des essais, enquêtes, traductions inédites et récits de résistances, nous explorons les nouvelles pensées et pratiques nécessaires pour répondre à la catastrophe écologique.
Chaque semaine, nous publions en accès libre des articles qui approfondissent les enjeux écologiques, politiques, et sociaux, tout en critiquant l’emprise du capitalisme sur le vivant. Plus qu’une revue, Terrestres est un laboratoire d’idées et un lieu de réflexions critiques, essentielles à l’élaboration d’alternatives justes et émancipatrices.
En nous lisant, en partageant nos articles et en nous soutenant, par vos dons si vous le pouvez, vous prenez le parti de l’écologie radicale dans la bataille culturelle qui fait rage.
Merci  !
!
L’article Pour une écologie de la libération : antiracisme et écologie politique est apparu en premier sur Terrestres.
09.07.2025 à 19:30
« Au Congo, l’extractivisme détruit une économie fondée sur la relation »
La guerre en RDC dure depuis 30 ans. Inéluctables conflits tribaux ? Non : ingérences étrangères pour le contrôle des métaux. Dans un entretien avec Celia Izoard, la juriste Gloria Menayame et le politiste David Maenda Kithoko dénoncent la malédiction, au Congo, de ne pas pouvoir se percevoir autrement que comme une ressource pour les puissances capitalistes.
L’article « Au Congo, l’extractivisme détruit une économie fondée sur la relation » est apparu en premier sur Terrestres.
Texte intégral (8544 mots)
Cet article est le second épisode d’une enquête en deux parties de Celia Izoard sur l’extractivisme minier en RDC. Premier épisode : « Un néo-colonialisme technologique : comment l’Europe encourage la prédation minière au Congo ».
Politiste, David Maenda Kithoko, 30 ans, est originaire de la ville d’Uvira, sur les rives du lac Tanganyika, à l’est de la RDC (République Démocratique du Congo). Avec sa famille, il a été réfugié successivement au Burundi, au Rwanda, aux Comores, à Mayotte puis à Lyon. Là, il a cofondé avec des amis Génération lumière, une association qui milite contre l’extractivisme et pour la paix en RDC.
Juriste, Gloria Menayame, 31 ans, a grandi dans la ville de Kisangani, sur les rives du fleuve Congo. Arrivée en France en 2017, elle fait partie de Génération Lumière et milite au sein de l’ONG Congolese Action Youth Platform (CAYP) et pour l’initiative Genocost, qui vise à faire reconnaître les crimes subis par le peuple congolais.
Propos recueillis par Celia Izoard.
Celia Izoard : Vous avez vécu la guerre pendant votre enfance au Congo. Que compreniez-vous alors du conflit ? Comment l’analysez-vous aujourd’hui ?
Gloria Menayame : J’avais 7 ans quand les forces rwandaises et ougandaises ont attaqué ma ville, Kisangani. Mon père est venu me chercher à l’école et nous sommes restés six jours dans la cave. En sortant j’ai découvert une ville méconnaissable, détruite. Un millier de personnes étaient mortes. Dans la Kisangani d’après-guerre, il y avait beaucoup de délinquance et de prostitution juvéniles. La ville à l’époque devait ressembler un peu à Goma avant qu’elle tombe ces derniers temps : il y avait partout des ONG locales et internationales. Je vivais en face du QG de la Monusco, le camp des casques bleus. Vers 14 ans, j’ai été parmi les premières personnes à être formées par l’UNICEF. Ils venaient de créer un programme pour former des jeunes à devenir des relais communautaires sur la santé et la délinquance, par exemple on animait des émissions de radio.
C’est depuis longtemps une région de mines artisanales d’or et de diamants. Tous les jeunes allaient travailler dans les mines d’or, à la « Sokimo » (Société minière de Kilo-moto). C’était une province riche. Il y avait beaucoup de « diamantifères », des gens du coin qui s’étaient enrichis en vendant des pierres précieuses.
Adolescente, je savais déjà que l’attaque de l’Ouganda et du Rwanda était liée à ces minéraux. Mais pour moi, l’expression « Diamants de sang », c’était juste un slogan, ça voulait dire que les gens se battent pour les diamants, pour en avoir plus que le voisin. Ça n’avait pas réellement de signification politique. C’est plus tard que j’ai découvert l’importance du tantale et de l’étain pour le secteur du numérique, et que j’ai compris que la guerre au Congo était liée à l’importance cruciale du commerce de métaux pour les puissances capitalistes.
Celia Izoard : Dans cette guerre qui frappe l’est du Congo depuis 30 ans, on a l’impression d’un état de chaos et de violence permanents dans lequel tout le monde meurt – des gens d’origines très diverses. Pourquoi l’appelez-vous « génocide » ?
Gloria Menayame : Au sein de l’ONG CAYP, nous parlons d’un « genocost », un génocide motivé par les gains économiques. Ce ne sont pas des guerres tribales où tout le monde est en train de s’entre-tuer, comme on nous le dit depuis l’Europe. Ce n’est pas un champ de bataille où des sauvages se massacrent parce qu’ils veulent tous avoir accès aux ressources. En RD Congo [RDC], il y a 450 ethnies et 250 langues différentes, cette pluralité n’est pas un problème en soi. La question, c’est : qui instrumentalise les groupes armés ? Derrière les revendications ethniques, foncières ou religieuses, on retrouve toujours les mêmes acteurs : le Rwanda, l’Ouganda, eux-mêmes soutenus par les grandes puissances.
Gloria Menayame
À la longue, on en conclut que l’enjeu de cette guerre est de se débarrasser de la population pour avoir accès aux richesses.
Ce n’est pas normal qu’une guerre dure 30 ans. J’ai 31 ans aujourd’hui et elle n’a jamais cessé. Elle a déjà fait 6 millions de morts et elle continue. La terreur, les exactions, l’usage du viol visent à détruire le socle social. Obliger des enfants à violer leur maman, par exemple, c’est briser toutes les règles de la société. Les femmes subissent des mutilations de leurs parties génitales, les chefs coutumiers sont systématiquement assassinés. C’est la possibilité même d’habiter ce territoire qui est détruite par les massacres. Car ce que les centaines de peuples qui vivent dans cette région ont de commun, c’est le fait d’être attaché à la terre – les noms bantous sont souvent liés à la terre. Teominaté : tu es celui/celle qui vient de telle colline, de tel endroit. Or il y a aujourd’hui dans le pays près de 7 millions de déplacés internes, plus que nulle part au monde. Le déracinement est massif. À la longue, on en conclut que l’enjeu de cette guerre est de se débarrasser de la population pour avoir accès aux richesses.
Celia Izoard : Quand on pense à un génocide, on pense à la politique d’extermination nazie ou aux massacres des Tutsies – des crimes commis en quelques années ou en quelques mois. Mais ça peut aussi être un processus génocidaire qui se déroule sur un temps long, comme celui qui a fait disparaître la majorité des peuples autochtones de l’Amérique du Nord…
Gloria Menayame : Oui. Cette situation s’inscrit dans la continuité de l’histoire du Congo et même de sa création en tant qu’entité coloniale, en 1885, à la conférence de Berlin où les grandes puissances se sont partagé l’Afrique. Contrairement aux autres colonies, le Congo a alors été pensé comme un marché dans lequel chacune des puissances irait puiser des ressources, et ce, sans les Congolais·es. Le Congo n’existe que pour être pillé. Sous Leopold II de Belgique, c’était l’hévéa et le caoutchouc ; aujourd’hui ce sont les mines. Hier les occupants coupaient les mains des gens pour les obliger à travailler, aujourd’hui ils violent les femmes et ils précipitent les enfants dans les puits de mine. Il y est admis que la vie ne vaut rien et qu’elle peut être sacrifiée pour accéder aux ressources.
Gloria Menayame
Le Congo n’existe que pour être pillé. Il y est admis que la vie ne vaut rien et qu’elle peut être sacrifiée pour accéder aux ressources.
Celia Izoard : Et pourtant l’armée congolaise et les groupes locaux comme les Maï Maï participent eux aussi à la terreur et à la guerre pour la prise de possession des carrés miniers…
Gloria Menayame : À la base, les Maï Maï sont des groupes d’autodéfense des villages. Ils n’avaient aucune revendication sur le contrôle des ressources. Mais ils font comme les autres : ils pratiquent la terreur et s’emparent des mines. Ils sont devenus des marchands de métaux précieux. Ils deviennent eux-mêmes bourreaux pour s’inscrire dans ce marché, dans cette économie de guerre. C’est aussi parce que la guerre a fait disparaître les autres possibilités de subsistance.
Les guerres du Kivu en République démocratique du Congo : 1994-2025
1994 Génocide au Rwanda. Le parti de Paul Kagamé l’emporte sur les extrémistes Hutus. Repli des géocidaires au Kivu.
1995 Création des Allied Democratic Forces (ADF), groupe armé ougandais affilié à l’État islamique
1996-1997 1ère guerre du Congo. Chute de Mobutu au Congo-Zaïre (actuelle RDC) après 32 ans de dictature soutenue par la France. Arrivée au pouvoir de Laurent-Désiré Kabila avec l’appui du Rwanda (et du secteur minier occidental)
1998-2003 2ème guerre du Congo. Laurent-Désiré Kabila fait scission avec le Rwanda. Rébellion au Kivu soutenue par le Rwanda, l’Ouganda et le Burundi
2000 Le Conseil de sécurité de l’ONU crée un groupe d’experts posté au Kivu pour surveiller les groupes armés et « réunir des informations sur toutes les activités relatives à l’exploitation illégale des ressources naturelles »
2001 En RDC, arrivée au pouvoir de Joseph Kabila, fils de Laurent Désiré Kabila
2004-2009 Guerre au Kivu. Le Rwanda soutient l’offensive du Congrès national pour la défense du peuple (CNDP) en RDC
2007 Accord minier RDC-Chine portant notamment sur l’extraction de cuivre et de cobalt au Katanga (sud du pays) et de diamants (province du Kasaï)
2010 Loi Dodd-Frank (USA) sur les minerais de conflit
2012-2013 Guerre au Kivu. Création du M23 (issu d’une scission du CNDP), vaincu en 2013
2016 Félix Tshisekedi devient président de RDC après des élections (truquées)
2017 Au Rwanda, Power Resources (GB) investit dans une fonderie de tantale
2018 Au Rwanda, Luma Holdings (Pologne) investit dans la fonderie d’étain en copropriété avec l’État
2019 Au Rwanda, création d’une raffinerie d’or
2021 Début de la nouvelle offensive du M23 au Kivu
2022 Annexion de la ville de Bunagana par les troupes du M23
2023 Accord de coopération entre la RDC et le Bureau des recherches géologiques et minières (BRGM), France
Février 2024 Accord minier UE-Rwanda
Juillet 2024 En France, l’association Génération Lumière organise une marche contre l’extractivisme
Décembre 2024 Accord minier UE-RDC
Janvier 2025 Annexion de la ville de Goma par le M23
Mai 2025 Accord minier USA-Rwanda. Accord de défense + mines USA-RDC
Celia Izoard : C’est un cercle vicieux, l’extractivisme crée la guerre, puis la guerre encourage l’extractivisme parce que l’agriculture n’est plus possible…?
Gloria Menayame : C’est ça, l’agriculture n’est pas compatible avec la guerre. La région de Goma et Bukavu, c’était vraiment traditionnellement la région nourricière, une zone volcanique, très fertile : production de lait, de pommes de terre, de fromages. Aujourd’hui le fromage et le saucisson ne se font plus à Goma. Il faut le faire venir de Gisenyi, de l’autre côté de la frontière, au Rwanda.
L’exploitation minière détruit le sol, le sous-sol, change la façon d’habiter la terre. La population de Goma et Bukavu était essentiellement formée d’agriculteurs et d’éleveurs, très attachée à la terre. Mais tout le monde se met dans le commerce des mines. À quoi bon faire de l’agriculture ? Tu vas avoir un troupeau de vaches et, du jour au lendemain, des rebelles vont venir tout brûler. Tu ne vas pas semer si ta récolte a de grandes chances d’être attaquée. Ce n’est pas viable. Donc les gens deviennent mineurs, transporteurs, vendeurs. Et comme on produit de moins en moins de nourriture dans la région, elle devient de plus en plus chère, donc il faut de plus en plus d’argent pour l’acheter. D’où vient cet argent, sinon de la vente des minerais ?
Ma ville natale, Kisangani, est presque une île sur le fleuve Congo. Si tu voulais manger du bon poisson frais, c’était là que tu allais. Quand j’étais petite, comme il y en avait tellement et qu’on ne pouvait pas le conserver, il était vendu le jour même ou jeté. Mais aujourd’hui, le poisson est devenu cher. Les Wagénias [les pêcheurs dits acrobates des chutes de Wagénia, sur le fleuve Congo] disent que « le poisson ne meurt plus », que les poissons sont tristes. Les poissons ne viennent plus, ils ne remontent plus à la surface. En fait c’est parce que le fleuve Congo est pollué, principalement par les mines.

Celia Izoard : L’expression la plus couramment associée au Congo est la « malédiction des ressources », qui indique le paradoxe d’un pays ravagé par la guerre et la pauvreté malgré toutes ses ressources naturelles. Mais parler de « malédiction », d’une sorte de mauvais sort, n’est-ce pas une manière de dissimuler la prédation ?
David Maenda Kithoko : Cette histoire de « malédiction des ressources » me hérisse les poils. Qui a maudit ? Qui met en place les instruments pour exécuter la malédiction ? À quel moment habiter à Bunagana devient une malédiction ? Dans la culture chrétienne, la malédiction sans cause est sans effet. Nous n’avons rien demandé. Nous n’avons rien fait d’autre que de naître et de vivre sur ce territoire.
C’est une expression qui est reprise comme si c’était une évidence. Nous sommes maudits. Ah bon ? Mais vous, quand vous exploitez ces ressources, vous n’êtes pas maudits ? Et l’Angleterre, qui a fait la Révolution industrielle grâce à toutes ses mines de charbon et de fer, pourquoi n’a-t-elle pas subi cette fameuse malédiction des ressources ?
David Maenda Kithoko
Dire que le Congo est un « scandale géologique », c’est une manière de blâmer la victime. Tu nais sur un territoire qui, dans le regard de l’autre, est un appel. On t’a violée parce que tu étais attirante. C’est ta faute.
Ça me fait penser à l’autre expression souvent employée pour parler de mon pays : le Congo serait un « scandale géologique ». C’est la formule qu’a employée le géologue belge Jules Cornet à son retour du Katanga, où il prospectait pour la colonie dans les années 1910. C’est un regard assez étrange. Il lorgne sur les cailloux. Il ne s’intéresse qu’au sous-sol, et pas aux êtres vivants qui sont au-dessus. Et il semble justifier par avance tous les crimes qui vont être commis, causés par ce « scandale géologique ». C’est une manière de blâmer la victime. Tu nais sur un territoire qui, dans le regard de l’autre, est un appel. On t’a violée parce que tu étais attirante. C’est ta faute. Ce scandale géologique a justifié la manière de tuer et de nous déshumaniser dans ce territoire. Cette idée des richesses irrésistibles semble là pour justifier les massacres, les viols, les atrocités qui ont lieu dans ma région.
Quand on parle de la France, on ne parle jamais de ses ressources minières, on parle de ce que l’esprit humain a créé, de la culture, de la gastronomie… mais pour les pays africains, on parle des minerais. Vous ne nous intéressez pas, ce sont les cailloux qui nous intéressent, vous êtes un scandale géologique. Alors qu’au Congo on a une production culturelle très importante, ne serait-ce que la musique [ndlr : Ninho, Tiakola, Dadju, SDM, Gims et Damso sont tous originaires de RDC].
Un exemple récent de cette supposée « malédiction » : l’accord minier signé en 2024 entre l’Union européenne et le Rwanda pour l’approvisionnement en métaux stratégiques, soi-disant pour la transition écologique. Génération lumière dénonce cet accord depuis plus d’un an : on sait depuis 25 ans que le Rwanda est le principal bénéficiaire des minerais de conflit pillés au Congo, et qu’il produit lui-même très peu de métaux. Or la signature de cet accord a coïncidé avec une montée en puissance de l’offensive du M23 et de l’armée rwandaise en RDC, et avec la prise de possession de Goma, de Bukavu et des principales zones minières du Kivu.
On a là un exemple très tangible de colonialisme visible, assumé. C’est une pure prédation de ressources au bénéfice des métropoles. Et on trouve toujours un argument moral pour justifier ça. Ici, les gouvernements européens utilisent l’alibi de la transition écologique pour faire accepter cette politique à leurs populations ; de même qu’à l’époque des colonies, l’argument invoqué était la défense de la civilisation contre la barbarie.

Celia Izoard : Que vous inspire ce nouvel accord que viennent de conclure les USA avec la RDC et le Rwanda ? C’est un accord de paix entre le Rwanda et la RDC chapeauté par les États-Unis, qui ont signé avec chacun des deux pays un accord minier.
David Maenda Kithoko : Cet accord n’a aucune chance d’amener la paix, pas plus que les précédents. La même situation se rejoue sans cesse. En 2008, on a signé les accords de 100 ans avec la Chine, ils étaient censés durer un siècle et assurer la paix et le développement de routes et d’hôpitaux, en échange de concessions dans les mines de cuivre et de cobalt du Katanga, dans les mines d’or. Une dizaine d’années plus tard, les infrastructures ne sont pas là, mais la corruption et la pollution ont augmenté. Et la guerre se poursuit parce que les Occidentaux veulent reprendre la main sur les Chinois.
David Maenda Kithoko
On conditionne la survie sur un territoire aux ressources de ce territoire. C’est le regard qui a toujours été porté sur le Congo.
D’autre part, les États-Unis ont toujours allié, soutenu et financé le Rwanda. Ça me paraît étrange qu’ils prétendent nous protéger alors qu’ils ont fabriqué la puissance militaire qui nous agresse et qu’ils continuent à le soutenir. Cet accord de « paix » me paraît d’autant moins protecteur qu’il inclut un partenariat commercial avec le Rwanda sur l’étain et le tantale, des minerais qui ont de fortes chances de continuer à provenir du Kivu livré au feu et au sang. Les États-Unis ont toujours favorisé une stratégie de maintien du chaos en RDC, qui les avantage, et semblent continuer sur cette voie.
Je suis encore plus choqué que les dirigeants congolais eux-mêmes voient cela comme une porte de sortie et ne se questionnent pas sur cette valeur cardinale : nous sommes humains, nous n’avons pas besoin d’offrir quoi que ce soit en échange de la paix. Les prémisses de cet accord « défense contre ressources » sont colonialistes. On conditionne la survie sur un territoire aux ressources de ce territoire. C’est le regard qui a toujours été porté sur le Congo. C’est comme si les Congolais·es n’avaient droit à la vie qu’en tant que pourvoyeurs de ressources. On ne les préserve pas parce qu’ils ont le droit de vivre, mais pour les intérêts économiques extractivistes.
Pour aller plus loin, vous pouvez lire aussi dans Terrestres « Mines, bétail, soja : comment les multinationales saignent le Brésil » d’Erika Campelo, mai 2025.
Celia Izoard : Finalement, la malédiction, ce serait plutôt la cupidité des empires qui a transformé le pays en « ressources », ce qui fait qu’aujourd’hui, la classe politique et la population congolaise ont tendance à vouloir tirer parti de ce « scandale géologique » ?
David Maenda Kithoko : Oui, Les Congolais·es ont grandi dans un imaginaire totalement extractiviste et ont intégré cette image de leur pays comme scandale géologique. Comment sortir du modèle extractiviste quand il y a des expressions comme ça, qui banalisent le fait que tout un territoire, tout un pays, soient assignés à la mine ? À l’Assemblée nationale, le 29 mars 2024, j’ai assisté à une rencontre sur les projets de transformation de cobalt pour batteries en RDC, pour favoriser l’indépendance économique du pays. Après avoir entendu l’ambassadeur du Congo s’exprimer, je lui ai dit : « Qu’est-ce que c’est que cette manière de parler de nous ? Tout ce que tu dis là, c’est « venez acheter, venez prendre dans nos sous-sols ». » Est-ce qu’on ne peut pas se penser sans le désir européen, le désir des riches pour nos ressources ? Est-ce qu’on ne peut rien faire d’autre, jamais ? La malédiction, elle est là, de se percevoir comme ressource, de ne pas pouvoir se percevoir autrement que comme ressource. On a du mal à imaginer une forme de vie qui ne serait pas fondée sur la mine, on ne se projette que là-dedans. Derrière cet accord avec les Américains, il y a ce même présupposé – que, de toute façon, ce sera les mines. Dans le meilleur des cas, ce qui est dit c’est que le Congo doit exploiter ses ressources de manière équitable. Ce modèle-là sature nos imaginaires.
David Maenda Kithoko
La malédiction, elle est là : de ne pas pouvoir se percevoir autrement que comme ressource. On a du mal à imaginer une forme de vie qui ne serait pas fondée sur la mine.
Je suis contre. Et la santé des gens ? Et l’exploitation des forêts? Récemment, un de mes amis est parti travailler dans les mines du Nord Kivu, il est rentré malade. Il y a des rivières taries à cause des mines. On est capables d’imaginer une autre économie en Afrique, moins dépendante d’un marché mondialisé, moins violente avec la terre.
Dans ma ville natale, à Uvira, il y a le port sur le lac Tanganyka qui permet des échanges de produits agricoles et de pêche non seulement à l’intérieur du pays, mais aussi dans presque toute la région des Grands lacs. Il n’y a pas d’école d’ingénieurs nautiques, et pourtant les gens fabriquent des bateaux avec un savoir-faire exceptionnel. Il existe à Uvira une autre forme d’économie, une économie basée d’abord sur la relation. Les gens arrivent à créer des tontines, une forme d’épargne en dehors du système bancaire fondée sur la confiance. J’y ai également vu une sorte de mutualisation dans la construction des logements. Lorsqu’un jeune souhaite fonder un foyer, d’autres viennent l’aider à construire la maison et ainsi de suite. Cette économie encastrée dans la relation, ces formes de réciprocité à la Karl Polanyi, c’est précisément ce que détruit l’extractivisme minier au Congo.

Celia Izoard : Certes, on peut arrêter de s’identifier à la proie, mais il faut aussi que la prédation s’arrête… Qu’est-ce qui le permettrait, selon vous ?
David Maenda Kithoko : On dit chez nous : C’est à celui qui est ivre de travailler sur son ébriété. Le problème, c’est la demande pour ces ressources, c’est l’addiction à ces ressources. Cette société occidentalisée est régie par l’extractivisme. On bouffe les mines. Tu imagines qu’on fabrique maintenant des caleçons connectés… des gourdes connectées ! Tout ça, ce sont des minerais. Il faut lutter contre la surconsommation de métaux en Europe.
Pour aller vers cette désintoxication, il faut peut être commencer par prendre soin des objets. C’est-à-dire apprendre à réparer. Et donner à ce geste technique une ambition politique qui s’inscrit dans la réduction de la production, dans un souci du soin à la Terre et ceux et celles qui la peuplent. Le législateur doit créer un nouveau droit pour les citoyen·nes, le droit à réparer. Contraindre chaque fabricant à prévoir la réparabilité de ses produits, pour allonger la durée de vie des objets. Plus les outils durent, plus on questionne le modèle d’affaire de ces multinationales. En parallèle, il faut des politiques publiques du renoncement, appuyée par des campagnes de sensibilisation comme celle de l’Ademe [les « dévendeurs »] qui a été censurée.
Gloria Menayame
Ce qui a changé, c’est qu’on met en avant, non pas seulement la corruption des élites du pays, mais aussi les dynamiques impérialistes et néo-coloniales qui l’entretiennent et qui sont la véritable cause de la guerre.
Gloria Menayame : C’est difficile de rêver à une ouverture. Il faut comprendre que toutes les personnalités qui semblaient capables de changer le cours des choses ont été assassinées : Patrice Lumumba [1925-1961], Général Mamadou Ndala [1978-2014].
Pour autant, notre action n’est pas vaine. En 2022, la Cour internationale de justice a condamné l’Ouganda à verser 325 millions de dollars de réparations pour sa responsabilité dans la 2e Guerre du Congo (1998-2003). Mais le Rwanda n’a pas été condamné, pas plus que les chefs de guerre congolais qui ont commis des exactions et qui font encore partie aujourd’hui du gouvernement de la RDC. L’ONG CAYP milite pour qu’ils soient jugés et que les responsabilités soient établies.
Chaque 2 août, le jour anniversaire du début de la 2e Guerre du Congo, nos organisations préparent une commémoration du génocide congolais. Cette date de commémoration a récemment été actée par une loi en RDC.
Pour garder espoir, on peut aussi dire que notre génération de la diaspora congolaise est mieux équipée pour comprendre et pour agir. La génération précédente nous a laissé des acquis, mais elle ne voyait le pouvoir qu’à travers une seule classe politique. C’était « Kabila dégage », parce qu’il avait été mis au pouvoir par le Rwanda, parce qu’il était corrompu – alors même qu’en RDC, beaucoup de gens le soutenaient. La diaspora ne parlait pas le même langage que les habitant·es. Aujourd’hui, nous pouvons faire signer des tribunes à des partenaires locaux à Goma ou à Kinshasa. Ce qui a changé, c’est qu’on met en avant, non pas seulement la corruption des élites du pays, mais aussi les dynamiques impérialistes et néo-coloniales qui l’entretiennent et qui sont la véritable cause de la guerre. Et cela renforce notre lien avec les habitant·es de là-bas, ça crée un pont.
Image d’ouverture : lac Kivu, 2024. Wikimedia.

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !
Depuis 2018, Terrestres est la revue de référence des écologies radicales.
À travers des essais, enquêtes, traductions inédites et récits de résistances, nous explorons les nouvelles pensées et pratiques nécessaires pour répondre à la catastrophe écologique.
Chaque semaine, nous publions en accès libre des articles qui approfondissent les enjeux écologiques, politiques, et sociaux, tout en critiquant l’emprise du capitalisme sur le vivant. Plus qu’une revue, Terrestres est un laboratoire d’idées et un lieu de réflexions critiques, essentielles à l’élaboration d’alternatives justes et émancipatrices.
En nous lisant, en partageant nos articles et en nous soutenant, par vos dons si vous le pouvez, vous prenez le parti de l’écologie radicale dans la bataille culturelle qui fait rage.
Merci  !
!
L’article « Au Congo, l’extractivisme détruit une économie fondée sur la relation » est apparu en premier sur Terrestres.

