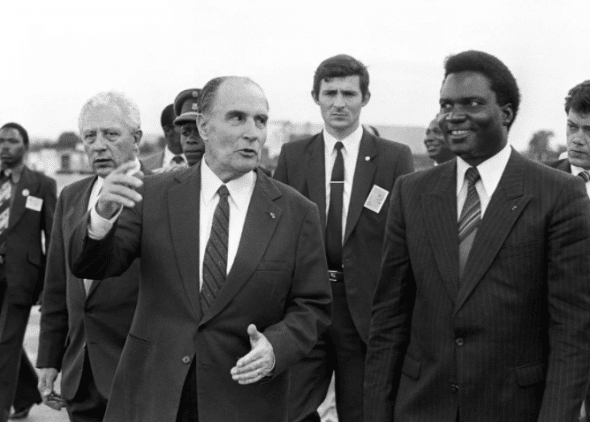L’appel du 10 septembre devait annoncer un automne chaud : partie de groupes de discussion souverainistes, la proposition de bloquer le pays pour protester contre la politique du gouvernement Bayrou avait gagné en audience tout au long de l’été. Reprise à gauche, elle a finalement donné lieu à une journée de mobilisation assez classique. Les blocages furent dans l’ensemble mis en échec et les Gilets jaunes ne furent pas ressuscités. Cependant, le nombre de personnes présentes dans les rues donnait une idée du potentiel. Les manifestations syndicales du 18 septembre pouvaient être l’étincelle. Entre un gouvernement tout juste censuré, une rentrée placée sous le signe de l’austérité et un président plus impopulaire que jamais, toutes les conditions semblaient réunies pour un mouvement social d’ampleur. Force est de constater que celui-ci n’a pas (encore) eu lieu. Analyse de la stratégie perdante de l’intersyndicale.
Avec le succès de la journée du 18, bien plus massive – un million de manifestants selon la CGT – et visiblement plus populaire que celle du 10, un boulevard semblait s’ouvrir. Las, l’occasion fut gaspillée : le gouvernement proposa aux principaux syndicats une rencontre le 24 septembre, dictant son tempo.
Quand les syndicats sabotent leur propre grève
Rompus à l’idéologie du « dialogue social », ceux-ci acceptèrent, n’obtinrent rien, et publièrent dans la foulée ce communiqué : « Après la réussite de la mobilisation interprofessionnelle du 18 septembre, l’ensemble des organisations syndicales avait posé un ultimatum. Elles ont été reçues ce matin par le Premier ministre, pour obtenir des réponses concrètes aux revendications exprimées par les travailleuses et les travailleurs. L’intersyndicale déplore une occasion manquée. Après un long échange avec le Premier ministre sur les enjeux qui se posent pour le monde du travail, aucune réponse claire n’a été apportée à la colère des salarié·es, agent·es, demandeurs·euses d’emploi, jeunes, retraité·es … […] Le monde du travail a assez souffert et c’est pourquoi l’ensemble des organisations syndicales appelle à amplifier la mobilisation lors d’une nouvelle journée d’action et de grève interprofessionnelle le jeudi 2 octobre prochain ». S’ensuit une liste de revendications déjà connues par cœur, que le fameux « dialogue social » n’a jamais fait aboutir.
Comment ne pas voir dans cette faible menace d’une simple journée de mobilisation un triste aveu de faiblesse ? Pire, en organisant celle-ci deux semaines après la précédente, l’intersyndicale préparait sa défaite, en laissant retomber la colère pourtant très vive des Français. Dans l’intervalle, la secrétaire générale de la CGT Sophie Binet déclara « ne pas souhaiter la chute du gouvernement » tout en se déclarant très mécontente de sa politique… Les travailleurs qui avaient sacrifié deux journées de salaire dans l’espoir d’obtenir un budget moins austéritaire et plus juste sur le plan fiscal, apprécieront.
L’enchaînement de mouvements syndicaux perdants a eu une tendance démobilisatrice sur les forces vives.
Le gouvernement Lecornu, pourtant lui-même bien peu en position de force en plein emménagement à Matignon, ne s’y trompa pas. La menace d’un mouvement social d’ampleur s’écartait. Et ce, malgré les différentes grèves locales, les débuts de blocages de lycées et d’université, la motivation perceptible dans les cortèges. Le 2 octobre fut ainsi une journée décevante, avec un net reflux de la masse des manifestants (« près de 600.000 » annonça la CGT), sanctionnant l’absence de stratégie syndicale. Comment aurait-il pu en être autrement ? Nulle mansuétude, nul deus ex machina à attendre, seul le rapport de force entre deux intérêts sociaux antagoniques décide de l’issu d’une telle mobilisation face à un gouvernement. Comme l’observait déjà Hypocrite, « tout ce qui rampe a pour partage les coups ».
De la grève générale à la grève par procuration
À ce triste spectacle, certaines composantes de l’extrême gauche opposent les appels imprécatoires à la grève générale. Certes, la perspective est séduisante : plutôt que de simples journées d’action, grèves perlées et autres démonstrations d’impuissance collective, les travailleuses et travailleurs n’auraient qu’à bloquer collectivement l’outil de production, jusqu’à ce que le pouvoir cède. Oui, mais… Si la CGT des grandes heures du mouvement ouvrier n’en fut pas capable, ni en 1914, ni d’ailleurs en 1936 ou 1968, qu’attendre d’une intersyndicale divisée, représentant d’ailleurs une part déclinante du monde du travail ?
Au-delà du déclin du taux de syndicalisation, stabilisé à un niveau historiquement bas, la surreprésentation du public face au privé (environ 18% de syndiqués contre 8% dans le secteur privé) a de quoi doucher les ardeurs révolutionnaires. Les précédents mouvements sociaux d’ampleur conduits par les syndicats, tels ceux contre les réformes des retraites de 2010 et 2023, ou contre la « loi Travail » de 2016, sont ainsi portés par une partie de la population ayant peu de prise directe sur la marche économique du pays. Pour compenser cette faiblesse, les grèves s’opèrent par procuration, en soutenant celles de secteurs stratégiques et encore fortement syndiqués : rail, transport publics, raffineries, parfois ports et gestion des déchets. Au risque d’un isolement de secteurs combatifs, plus facilement circonscrits, ou d’une dérive corporatiste, au détriment des victoires collectives.
 À lire aussi...
« Les mouvements sans grève ne gênent personne » – Entretien…
À lire aussi...
« Les mouvements sans grève ne gênent personne » – Entretien…
La grève générale ne se décrète pas. Ses partisans arguent qu’elle se prépare sur le temps long, par un patient travail d’entreprise, à contre-courant des tendances dominantes dans un monde du travail en rapide mutation. Leur faible présence dans les segments les plus stratégiques, ceux au centre des chaînes de valeurs d’aujourd’hui, telle la logistique, ne plaide pas en leur faveur. L’enchaînement de mouvements syndicaux perdants a eu une tendance démobilisatrice sur les forces vives : le coût important des grèves nationales en termes d’énergie, d’argent et de risques professionnels face à des gouvernements peu disposés à laisser « gouverner la rue », peu inquiétés par une gauche parlementaire affaiblie et divisée, fatigue immanquablement.
L’union ne fait pas toujours la force
Toutefois, à ces problèmes qu’il serait possible de résoudre, s’ajoute celui des directions syndicales. La recherche d’un front uni se fait au détriment de la stratégie : accommoder les revendications des centrales les plus corporatistes, les plus libérales, à celles des structures les plus combatives aboutit à une égalité par le bas déplorable. La CFDT, dont près d’un tiers des adhérents ont voté Macron dès le premier tour en 2022, impose ses conditions à l’unité, avec l’assentiment des directions de FO, de Solidaires ou de la CGT. Cette routine des mouvements où le camp social part perdant avant même d’avoir entamé le rapport de force dit assez la compromission institutionnelle des appareils syndicaux, particulièrement de leurs directions.
Celle-ci a un effet délétère sur des bases toujours plus réticentes à s’engager dans des batailles considérées comme perdues d’avance. Cette perte de confiance dans les syndicats est d’ailleurs à l’origine de leur court-circuitage tant dans la rue, par le mouvement des gilets jaunes ou celui du 10 septembre, que dans le monde du travail, avec l’émergence de nouveaux « collectifs » de travailleurs s’organisant hors des organisations traditionnelles.
Ce déprimant panorama ne doit pas pour autant faire oublier le travail de fourmi, aussi ingrat qu’héroïque, de militantes et de militants qui continuent de porter la flamme sous différentes couleurs syndicales. C’est ce labeur patient qui permet encore aux centrales de mobiliser dans la grève et dans les rues plusieurs centaines de milliers (voire millions) de personnes lorsqu’un mouvement s’engage. Et c‘est à partir de ces bonnes volontés que différentes initiatives de régénérescence syndicales pourraient s’engager : leur expérience de terrain, la confiance de leurs collègues, leur éloignement des directions, tout ceci redonne espoir. D’autre part, et à rebours des mouvements nationaux, bien des luttes locales sont encore couronnées de succès, comme celles des femmes de ménage de nombreux hôtels ces dernières années. Ces petites victoires si peu médiatisées sauvent des vies et démontrent ici et là la pertinence de l’outil syndical.
Sortir de la défaite syndicale
Si celui-ci connaît des limites lorsqu’il s’agit de déployer un rapport de force sur le temps long avec le pouvoir en place, ne serait-il pas temps qu’il envisage d’autres stratégies que l’union pour l’union et les grèves perlées ? Étant donné la faiblesse du camp macroniste et la menace d’une victoire prochaine du Rassemblement National, la séquence politique actuelle semble plaider pour que les syndicats accroissent la pression populaire afin d’arracher des victoires avec la gauche politique, surtout celle qui vote la censure – ce qui exclut donc le Parti socialiste.
Pourtant, à chaque mobilisation populaire lancée par les partis, les syndicats crient à la remise en cause de la Charte d’Amiens. Les passes d’armes entre la France insoumise et l’ancien secrétaire général de la CGT Philippe Martinez sont restées dans les mémoires des militants, tandis que l’écrasante majorité de la population n’a pas compris ces guerres de chapelle. Certes séparer l’action dans le champ politique et dans le monde du travail, comme le prévoit la charte d’Amiens, n’est pas une mauvaise chose en soi : elle offre une plus grande autonomie tant aux partis qu’aux syndicats et ne rend pas ces derniers comptables des erreurs du parlementarisme. À l’heure où de plus en plus de syndiqués votent RN, au moins au second tour contre le camp libéral, cette séparation permet de maintenir dans la sphère syndicale un public réticent à voter pour la gauche.
Mais sans aller jusqu’à fusionner syndicats et partis, on peine à comprendre la passion de certains bureaucrates syndicaux pour les guerres intestines contre les partis de gauche, qu’ils accusent de « récupération ». Par ailleurs, la réalité des liens entre la CGT et le PCF pendant plusieurs décennies, pour ne prendre que cet exemple, montre qu’une coopération plus étroite est possible, et peut donner des résultats. A cet égard, et étant donné le rabougrissement des bases syndicales, l’obstination de certains responsables syndicaux à rejeter tout mouvement qu’ils n’ont pas initié n’est qu’un caprice puéril.
La base est en avance sur les directions. Sans doute parce que les travailleurs n’ont pas le temps d’aller à Matignon ou dans des conclaves palabrer avec le MEDEF.
Outre les partis politiques, la jonction opérée entre des bases syndicales locales et des mobilisations extra-syndicales, qu’elles soient autonomes, citoyennes ou environnementales, permet aussi localement de renouer avec une combativité qui appelle la victoire et non plus le simple témoignage. Les exemples de mobilisations communes entre les Soulèvements de la Terre et les syndicats contre l’entreprise logistique Geodis ou pour conserver et transformer la raffinerie de Grandpuits, offrent aux syndicats un moyen de s’ouvrir à d’autres publics et de renforcer leurs combats par des appuis bienvenus. Là encore, la base est en avance sur les directions. Sans doute parce que les travailleurs n’ont pas le temps d’aller à Matignon ou dans des conclaves palabrer avec le MEDEF.