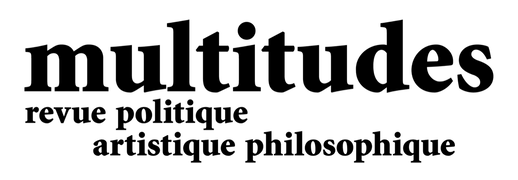22.03.2025 à 10:32
Cosmo-esthétique et cosmopolitique indigène À partir du cas yanomami
multitudes
Si l’anthropologie est la philosophie avec les gens au dedans1, alors la philosophie peut travailler ses concepts en apprenant auprès de l’anthropologie. Dans cet article, je vais proposer quelques pistes inchoatives pour penser une cosmo-esthétique indigène en m’appuyant sur les paroles du chaman yanomami Davi Kopenawa2. En réalité, mon point de départ est une remarque … Continuer la lecture de Cosmo-esthétique et cosmopolitique indigène À partir du cas yanomami →
L’article Cosmo-esthétique et cosmopolitique indigène <br>À partir du cas yanomami est apparu en premier sur multitudes.
Texte intégral (6378 mots)
Si l’anthropologie est la philosophie avec les gens au dedans1, alors la philosophie peut travailler ses concepts en apprenant auprès de l’anthropologie. Dans cet article, je vais proposer quelques pistes inchoatives pour penser une cosmo-esthétique indigène en m’appuyant sur les paroles du chaman yanomami Davi Kopenawa2. En réalité, mon point de départ est une remarque de Darcy Ribeiro rapportée par Sergio Cohn à Ailton Krenak sur le désir de beauté des Amérindiens dans leur vie quotidienne3. Krenak établit alors un lien d’appartenance essentielle entre les cultures des peuples amérindiens et la création de beauté dans les gestes les plus quotidiens, comme dans une petite plume de coiffe d’enfant, dans une boîte en bambou contenant de l’eau, ou encore, lors des cérémonies, dans les danses et chants des participants. Je commence donc par retenir le souci indigène de la beauté. Pour avancer ma proposition de « cosmo-esthétique » indigène à partir du cas yanomami, je soutiendrai d’abord que ce souci est une certaine disposition de l’aisthesis, du sentir, à l’égard du cosmos, ici entendu comme la « terre-forêt » des Yanomami (urihi a dans leur langue) : une certaine sensibilité à la beauté de la forêt. Pour explorer cette piste, je procèderai en deux temps. Ainsi, dans un premier temps, je m’attacherai à étudier certains aspects de la cosmo-esthétique yanomami en analysant les expériences chamaniques narrées par Kopenawa. Puis, dans un second temps, je verrai en quoi cette cosmo-esthétique est indissociable d’une cosmo-politique comprise comme défense de la forêt et recherche d’alliés, parmi les autres habitants de la forêt et les Blancs, pour conduire cette défense.
La cosmo-esthétique comme expérience chamanique de la Forêt
Je propose de distinguer deux sens indissociables de la cosmo-esthétique yanomami : premièrement, il s’agit d’une aisthesis, d’un sentir qui expérimente la puissance des êtres de la forêt ; deuxièmement, il s’agit d’une pratique quotidienne de la beauté, qui se manifeste dans les rituels, ornements et chants, et qui opère par une imitation des puissances que l’on cherche à capter. De manière plus générale et plus englobante, la cosmo-esthétique est une expérience de la forêt qui consiste à être sensible à sa beauté. Pour analyser le premier sens que je donne ici à la cosmo-esthétique, il faut revenir à la description par Davi Kopenawa de son expérience chamanique d’inhalation de la poudre hallucinogène yãkoana 4.
Pour commencer, il faut rappeler que le chaman est, dans la société yanomami, celui qui occupe la position d’un savoir d’initié : son savoir (reposant sur la maîtrise de l’expérience répétée de perception transformée) n’est pas accessible aux gens « ordinaires », les « profanes ». Il incarne l’idée de cosmo-esthétique de deux manières : premièrement, il est l’expérimentation d’une autre aisthesis, qui est une manière d’être affecté par des êtres-autres (autres-qu’humains) ; deuxièmement, la présentation de ces êtres-autres, les « esprits » chamaniques, prend une tournure esthétique fondamentale au sens d’une expérience de la beauté la plus étincelante.
La description de l’expérience chamanique des « esprits » chamaniques se trouve dans la première partie de la Chute du ciel intitulée « Devenir autre ». Ce titre désigne le processus d’initiation par lequel Davi Kopenawa est devenu chaman, mais il peut aussi précisément s’appliquer à l’expérience chamanique de « devenir-autre » de la perception et de l’aisthesis : il s’agit de « mourir » à la vision ordinaire et d’expérimenter un état autre et d’accéder à une forme supérieure de la vision pour voir les « esprits ». Ce voir supérieur est, tout aussi bien, une plongée dans le mythe5. Ainsi que le dit Lévi-Strauss, le mythe est une « histoire du temps où les hommes et les animaux n’étaient pas encore distincts6 ». Le temps du mythe est un passé absolu, un passé qui n’a jamais été présent. Le chaman, sous l’effet de la yãkoana, voit les xapiripë, terme qui est traduit par « esprits » chamaniques et qui désigne, dans la cosmologie yanomami, l’utupë, ou l’image (non-iconique), l’essence véritable des êtres de la forêt et, en même temps, les images de l’humanité archaïque du passé mythique dont les membres portent le nom d’animaux et dont la métamorphose a engendré les animaux actuels et empiriques de la forêt (ceux qui peuvent être, pour les Yanomami, du gibier).
Pour reprendre l’analyse de Viveiros de Castro sur « l’ontologie des esprits amazoniens », ce qu’expérimente le chaman, en faisant descendre les esprits, c’est une remontée vers le stade virtuel antérieur aux actualisations qui distribuent les différences finies et externes des espèces, remontée qui lui permet de faire l’expérience d’une différence infinie interne à lui-même. Viveiros de Castro, pour illustrer l’idée qu’il ne s’agit pas ici d’une indifférenciation entre humanité et animalité, donne l’exemple (habituel chez lui, mais pas spécialement mis en avant par Kopenawa) du jaguar mythique :
« La question de savoir si, par exemple, le jaguar mythique est un bloc d’affects humains sous la forme d’un jaguar ou un bloc d’affects félins sous la forme d’un humain est rigoureusement indécidable, étant donné que la métamorphose mythique est un “événement” ou un “devenir” hétérogène (une superposition dense d’états) et non un “processus” de “changement” (une vaste transposition d’états homogènes7). »
Dans la démarche qui est la nôtre, il s’agit du premier sens de la cosmo-esthétique : l’expérimentation d’un devenir-autre-que-soi dans le sentir. Le terme « cosmo-esthétique » se justifie par le fait que le chaman expérimente une aisthesis qui fait sentir les états d’autres êtres qui peuplent le cosmos de la terre-forêt : en ce sens, il est habitant de la forêt au sens fort d’être habité par elle. Mais, au-delà de ce premier sens de la cosmo-esthétique, il faut revenir à la description des xapiri pour voir en quoi l’expérience chamanique est aussi une expérience esthétique au sens de rencontre de la beauté des êtres de la forêt.
Davi Kopenawa, en s’adressant à Bruce Albert dans le préambule de leur livre, rapporte le désir de ce dernier de connaître les xapiri, en disant que le terme utilisé par les Blancs pour les nommer est « esprits ». Ce terme, admet-il, est un produit du « langage mélangé 8» qu’il a bricolé pour s’adresser aux Blancs : en réalité, la description qui en est faite est celle d’humanoïdes minuscules ornés de parures et de peintures corporelles extrêmement lumineuses et colorées. Le chaman, suite à une longue initiation ascétique, devient capable de faire descendre ou d’appeler à lui les esprits qui se présentent à lui dans une danse. La description qu’en donne Kopenawa est celle d’une saisissante expérience esthétique qui mobilise la vision, mais aussi l’odorat, l’ouïe et le goût. Les xapiri sont des corps propres, non souillés par la consommation de viande de gibier, et sont recouverts de peinture corporelle rouge (de la teinture de rocou) et ornés de noir luisant. Leur déplacement s’effectue à grande vitesse sur des miroirs brillants, qui sont des surfaces qui ne reflètent que la lumière. Dans le vol de leur déplacement, ils dégagent un parfum savoureux et enivrant. Leur constitution corporelle est tellement délicate que même leurs pets embaument. Leurs chants sont magnifiques, et sont appris auprès des arbres. L’ancêtre mythique du merle est l’inventeur des chants entonnés dans les fêtes intercommunautaires reahu 9.
En arrivant auprès de leur « père », le chaman qui les a convoqués, ils évoquent les lieux d’où ils viennent, les eaux d’une rivière sucrée, et les forêts sans maladies où ils se repaissent de nourritures inconnues. Toutes ces descriptions suggèrent un état superlatif du corps : les xapiripë sont des corps humains moins les vicissitudes et les imperfections de l’état ordinaire du corps. Le corps des xapiripë, précise Kopenawa dans le film A Queda do céu, est solide et résistant comme un rocher10. Arraché à la fragilité constitutive des corps humains ordinaires, à la possibilité de tomber malade, le corps des xapiripë est, pour finir, immortel. Corps qui échappe aux déterminations normales du corps, il est, comme le dit Viveiros de Castro, à la fois moins qu’un corps car comparable à de la poussière, et plus qu’un corps car capable de métamorphoses11.
L’expérience de la beauté est centrale dans la séance chamanique de « descente » des esprits. Ainsi, le chaman doit se faire « maison des esprits », c’est-à-dire leur aménager un lieu accueillant, qui leur convienne et leur soit agréable. Pour cela, le chaman, qui est leur « père », doit imiter l’état supérieur de leur corps : il doit s’imposer une diète ascétique, comportant des restrictions sexuelles et alimentaires. Mais il doit aussi, et c’est au fond la même chose, se préoccuper de la beauté des lieux d’accueil12. Pour appeler les esprits en grand nombre, le jeune chaman doit compter sur l’aide des anciens qui l’initient et qui dépêchent les esprits du coq de roche, de la colombe et de l’oiseau tãrakoma en émissaires auprès des autres. Ceux-ci convient leurs congénères en leur vantant la beauté des lieux. L’initiation chamanique est ainsi un processus éthico-esthétique : pour appeler les esprits, il faut devenir semblable à eux, pour en être le « père », c’est-à-dire tendre à se purifier pour devenir de plus en plus beau.
L’expérience de la beauté est aussi notable dans le fait que Kopenawa énonce avoir lui-même des préférences dans son rapport aux esprits. Ainsi, le chant des esprits cassique ayokorari l’émerveille, et il considère ces esprits comme « les plus beaux » et distincts par là de tous les autres. Son désir est de porter sans cesse « leur chemin dans [sa] pensée13 ». Si l’expérience esthétique comprise comme joie suscitée par la beauté des êtres et événements perçus est essentielle dans le devenir-autre du chaman, il faut ajouter en complément que l’expérience de la laideur est répulsive. Ainsi, dans son premier contact de jeunesse avec les napëpë [étrangers, ennemis, par extension les « Blancs »], Kopenawa a-t-il été effrayé par leur laideur. Cette laideur pressentie comme annonciatrice de malheurs pour la forêt et ses habitants a été confirmée par la suite : les invasions d’orpailleurs ont, non seulement provoqué de mortelles épidémies, mais, en plus, ont souillé les rivières et avili la beauté de la forêt.
Pour compléter l’analyse de la cosmo-esthétique yanomami, il peut être intéressant, dans une inspiration « contre-anthropologique14 », d’envisager, à l’inverse, la manière dont Kopenawa conçoit la cosmo-esthétique des napëpë : cette analyse est déployée dans le chapitre où Kopenawa définit les Blancs par leur « amour de la marchandise », amour à prendre en un sens charnel car il dit que les marchandises sont pour eux des fiancées. Il ajoute que l’euphorie qu’elles provoquent chez eux finit par obscurcir tout le reste dans leur esprit15. Cet obscurcissement peut être compris comme une cosmo-esthétique négative : on y lit, en creux, l’absence de considération pour la multiplicité des êtres qui peuplent la « terre-forêt ». Dans le film déjà cité plus haut, Kopenawa, parlant de ces Blancs qui, avides de marchandises, détruisent la forêt comme des insectes qui mangent des feuilles, dit qu’ils n’ont aucune considération pour la forêt. Avoir une pensée obscurcie, c’est n’avoir aucune considération pour la forêt sentie et vécue comme multiplicité infinie d’êtres qui l’habitent : c’est une expérience appauvrie du cosmos. Ce que j’appelle ici cosmo-esthétique négative des napëpë rejoint le diagnostic que Baptiste Morizot fait de la « crise de la sensibilité » :
« Par “crise de la sensibilité”, j’entends un appauvrissement de ce que nous pouvons sentir, percevoir, comprendre, et tisser comme relations à l’égard du vivant. Une réduction de la gamme d’affects, de percepts, de concepts et de pratiques nous reliant à lui16. »
Cette crise, Morizot l’envisage à travers la notion forgée par l’écrivain et lépidoptériste Robert Pyle d’« extinction d’expérience de la nature », notion qui désigne une perte de relations affectives et perceptives au vivant dans la vie quotidienne. L’exemple qui illustre cet appauvrissement de l’aisthesis est donné par une étude récente montrant qu’un enfant nord-américain entre 4 et 10 ans est capable d’aisément reconnaître plus de mille logos de marques, mais demeure incapable d’identifier les feuilles de dix arbres de sa région17. Cet exemple illustre ad nauseam la pensée contre-anthropologique de Kopenawa : ce à quoi sont sensibles les Blancs, ce qui affecte leur aisthesis, c’est le monde de la marchandise.
La cosmo-esthétique yanomami, comprise comme expérience chamanique d’un sentir-autre et comme souci collectif pour la beauté (par imitation de la beauté et de la puissance des êtres de la forêt), se prolonge en politique de la forêt envisagée comme cosmos de multiples habitants : Davi Kopenawa, en tant que chaman chargé de soigner les siens et de retenir la chute du ciel (selon le mythe yanomami de fin du monde), est entré en politique pour défendre la forêt et ses habitants.
La cosmopolitique comme défense de la Forêt
Sa politique est fondée sur sa cosmo-esthétique et sur la pratique yanomami de l’habiter : si la cosmo-esthétique est puissance d’être affecté par la multiplicité des êtres et agences de la forêt, alors la cosmo-politique indigène est une politique de représentation de cette multiplicité auprès de la société englobante, c’est-à-dire, dans ce cas, de la société nationale brésilienne. Son mot d’ordre fondamental est donc « défendre la forêt », mot d’ordre que l’on peut comprendre de la façon suivante : défendre les habitants de la forêt dans leur multiplicité, et, pour cela, défendre la spécificité des Yanomami en leur accordant une autonomie sur un territoire « démarqué ». La cosmo-politique indigène est donc indissociablement une cosmo-esthétique si l’on prend en compte le fait que, pour Kopenawa, les anciens de son peuple « considéraient simplement que la forêt était belle et qu’elle devait continuer ainsi pour toujours18 ». Cette cosmo-politique ne peut manquer de rencontrer l’autre sens du cosmopolitisme, celui hérité des Lumières : l’exigence d’une politique qui aille au-delà du cadre national. Dans le parcours de Kopenawa, cette rencontre a eu lieu de deux manières : par le soutien de diverses ONG et par ses interventions à la tribune de l’Assemblée de l’ONU. La stratégie politique consiste ici à mobiliser une sphère de l’opinion publique internationale qui puisse faire pression sur la société nationale et son gouvernement.
Penser la politique yanomami, c’est penser une politique d’alliances. Je m’intéresserai ici à l’alliance possible avec les Blancs. Kopenawa s’est rendu compte que le terme « écologie » (ecologia), qu’il prononce en portugais, est capable d’opérer une communication avec de potentiels alliés Blancs, les habitants des villes, voire que sa diffusion a permis de sortir les Yanomami de leur invisibilité. Il considère que, sans même connaître le mot, les anciens yanomami pratiquaient déjà l’écologie, inspirés par les paroles des esprits xapiripë. Cette rencontre inter-culturelle et inter-ethnique avec la parole de Blancs écologistes a produit deux effets notables sur la pensée de Kopenawa, un emprunt et une prise de distance critique. Pour ce qui est de l’emprunt positif, il dit lui-même qu’en apprenant à connaître les paroles des Blancs sur ce qu’ils nomment la nature, sa pensée s’est précisée et étendue : il a compris que ce qu’il faut défendre, ce n’est pas simplement « le petit endroit » où habitent les Yanomami, c’est « toute la forêt, […] et même, très loin au-delà d’[eux], la terre des Blancs » : ce qui, en yanomami, se nomme « urihi a pree – la grande terre-forêt », c’est-à-dire « ce que les Blancs nomment le monde entier19 ». Cette friction entre les paroles des Blancs et la cosmologie yanomami a produit un intéressant effet de télescopage de deux cosmopolitiques : la cosmopolitique indigène comme pratique d’habitation du lieu en négociation intelligente avec les autres êtres qui l’habitent et le cosmopolitisme hérité des Lumières compris comme politique pensée du point de vue d’une humanité qui occupe la totalité du globe terrestre. Prolongeant à mon tour la pensée de Kopenawa, j’ai suggéré ailleurs que si l’on pense l’organisation de cette lutte à la fois locale et globale à l’heure de la crise écologique, il faut envisager un « internationalisme cosmopolitique20 » (dont les traits nouveaux sont à la fois naissants et à inventer).
Pour ce qui est de la prise de distance critique à l’égard de la pensée de l’écologie des Blancs, Kopenawa revient sur le terme (portugais) qu’ils emploient pour désigner la nature : meio ambiente, qui, littéralement, signifierait « milieu ambiant » ou « milieu environnant », et qui est communément traduit par le terme « environnement21 ». Bruce Albert propose de le traduire par « milieu naturel », pour faire la synthèse de l’idée de milieu et de l’idée de nature. Kopenawa est très critique à l’égard de cette compréhension de la forêt comme « milieu environnemental » : ainsi comprise, la forêt n’est plus qu’un reste non encore éliminé par le processus de production de la société industrielle du « peuple de la marchandise ». L’écologie des gens des villes envisage la forêt comme un résidu ou un espace résiduel dont la fonctionnalité diverse peut justifier la protection en partie : on peut y préserver une biodiversité utile pour l’industrie pharmaceutique, on peut y envisager des aires d’éco-tourisme, on peut la voir comme un espace de ressourcement spirituel. Dans tous les cas, cette écologie des gens des villes subordonne la protection de la forêt à sa fonctionnalité économique : consciente des excès de l’industrialisme, elle veut mettre un frein à une surexploitation trop destructrice des « milieux » environnants. Mais cette écologie de surface est loin de l’écologie cosmique de Kopenawa fondée sur un amour « habité » de la forêt. Les passages de Kopenawa dans les villes, pour parler aux Blancs, ne sont que tactiques : il utilise la ville comme espace de discussion et de propagation de sa parole pour défendre la forêt, et ne souhaite pas s’y attarder.
Si les Blancs ne parlent que de protéger des aires réservées, le risque est grand, pour Kopenawa, que les Yanomami se retrouvent acculés dans de petites portions de terre isolées et entourées d’espaces dédiés à la production des marchandises et qui achèveraient de polluer et rendre inhabitables les lambeaux de terre indigènes. L’espace « naturel » préservé et clôturé des Blancs, réduit à peau de chagrin, n’est pas en mesure de soutenir ce qui fait la richesse de la forêt, në ropë, sa « valeur de fertilité ». La menace est grande d’un appauvrissement considérable de l’existence yanomami comme habitation de la forêt : à forêt réduite, habitant de la forêt réduit à l’état de débris. C’est ce à quoi Kopenawa ne saurait se résoudre, ce pourquoi il veut défendre la forêt tout entière, et pas seulement le territoire de son peuple.
Que faire de l’hyperbole de la cosmo-esthétique indigène ?
La cosmo-esthétique de Kopenawa représente, du point de vue d’un lecteur non-indigène, une provocation hyperbolique. Il est difficile pour ce lecteur de ne pas mesurer la distance cosmologique qui le sépare de ce qui ressemble à une appréhension du monde quasi-préindustrielle. Je dirais que deux manières distinctes de conclure se présentent à nous. Premièrement, il faut reconnaître à l’expérience de la cosmo-esthétique indigène son altérité irréductible. Kopenawa et les siens veulent être laissés tranquilles dans leur territoire : il y aurait un « indigéno-pessimisme22 » d’après lequel les indigènes, n’attendant rien de bon des Blancs, exigent d’être respectés dans leur désir de séparation. À ce sujet, il faut évoquer ce qui constitue peut-être, pour Kopenawa, la menace la plus insidieuse qui pèse sur les Yanomami comme peuple de la forêt : non pas seulement l’appât du gain des napepë (dont découle le saccage de la forêt), mais l’attrait que représente aux yeux de la jeune génération la puissance des objets techniques des Blancs. Kopenawa mentionne ainsi le smartphone comme objet typique de la cosmo-technique du Blanc, l’objet qui, par excellence, connecte le Blanc à son cosmos : le jeune Yanomami, fasciné par la connexion au monde par le biais de l’écran du smartphone, peut être tenté de devenir Blanc23. Pour Kopenawa, cet objet participe de la cosmo-esthétique négative du napë qui manifeste une déconnexion avec la multiplicité des êtres de la Forêt. Mais, pour être complet sur la question du rapport du chaman yanomami et des technologies du napë, il faut ajouter qu’il en conçoit aussi un usage tactique : depuis 2018, l’association Hutukara qu’il préside a lancé un programme de formation audiovisuelle destinée à fortifier la transmission des connaissances yanomami. Sur le sens politique de ce programme, l’anthropologue Marília Senlle (avec laquelle Kopenawa développe ce projet) s’exprime ainsi : « c’est à la fois une nouvelle arme destinée à pacifier les Blancs et une manière de subvertir le smartphone pour que, dans les communautés [yanomami], les jeunes puissent avoir accès à des contenus sur les Yanomami eux-mêmes, en enregistrant leurs propres connaissances, ou celles d’autres peuples indigènes, ce qui participe d’une politique des images24 ».
Mais une autre conclusion peut être tirée de ces considérations. Kopenawa lui-même recherche l’alliance avec les gens des villes, inquiets de l’avancée de la destruction de la nature par la société industrielle. On peut alors chercher des équivalents de la cosmo-esthétique indigène dans les sociétés urbaines. À titre d’ébauche d’alliances affectives, on peut citer le mouvement des « jardins partagés » qui peut être envisagé comme une tentative de briser la séparation entre ville et campagne, en faisant des expérimentations de communs agricoles en ville et dont l’idée de reprise de terres est en un sens une réindigénisation de la modernité. On peut aussi penser aux propositions de Gilles Clément sur le « tiers-paysage » (à comprendre comme un tiers-état du paysage), espace délaissé qui fonctionne comme une réserve soustraite à l’exploitation et qui est habité par une diversité d’espèces vivantes. Sans doute faut-il penser une synthèse de ces deux conclusions : défendre à la fois la singularité des modes d’être et de sentir indigènes, et chercher des équivalents de cette radicalité hyperbolique qui, en tant que telle, est impossible à transposer, c’est-à-dire se faire autant que possible indigène dans la modernité du monde industriel. Ce programme écoromantique qui fait de l’indianité un projet et non pas un souvenir du passé n’est-il pas aussi improbable que nécessaire ?
1Eduardo Viveiros de Castro, Métaphysiques cannibales, Paris, PUF, 2009, traduction d’O. Bonilla, p. 164.
2Bruce Albert et Davi Kopenawa, La Chute du ciel. Paroles d’un chaman yanomami, Paris, Plon, 2010.
3Sergio Cohn (org.), Encontros. Ailton Krenak, Rio de Janeiro, Azougue, 2015, p. 257 ; traduction à paraître dans Ailton Krenak, Le Réveil des peuples de la terre, Bellevaux, Dehors, 2025, traduction de J. Pallotta.
4Selon les travaux ethnologiques de Bruce Albert, effectuer une séance de chamanisme se dit également yãkoanamu, « agir sous l’emprise de la poudre yãkoana ». Davi Kopenawa a été initié au chamanisme, au début des années 1980, par le père de son épouse, qui a été le leader de la communauté où il réside aujourd’hui avec sa famille, Watoriki. La poudre de yãkoana est inhalée. Elle est confectionnée à partir de résine tirée de la partie profonde de l’écorce de l’arbre Virola elongata qui contient un puissant alcaloïde hallucinogène, la Diméthyltryptamine (DMT).
5À ce sujet, on peut rappeler ce que dit Philippe Descola des pratiques chamaniques et de leur expérimentation d’une vision autre : « contrairement à ce que l’on dit parfois, à savoir que les “religions chamaniques” seraient le produit des images mentales suscitées par la prise de psychotropes, la vision vient plutôt confirmer quelque chose qui s’était déjà structuré auparavant par le récit », in Philippe Descola (avec Alessandro Pignocchi), Ethnographies des mondes à venir, Paris, Seuil, 2022, p. 60.
6Claude Lévi-Strauss et Didier Éribon, De près et de loin, Paris, Odile Jacob, 1988, p. 193.
7Eduardo Viveiros de Castro, « La forêt des miroirs. Quelques notes sur l’ontologie des esprits amazoniens », in Frédéric Laugrand et Jarich Oosten (dir.), La nature des esprits dans les cosmologies autochtones, Laval, Les Presses Universitaires de Laval, 2007, p. 51.
8Bruce Albert et Davi Kopenawa, La Chute du ciel, op. cit., p. 858, note 1.
9La fête reahu est à la fois une cérémonie d’alliance entre maisons collectives proches et une maison funéraire.
10Eryk Rocha et Gabriela Carneiro da Cunha, A Queda do Céu, Aruac Filmes, 2024.
11Eduardo Viveiros de Castro, « La forêt des miroirs », in Frédéric Laugrand et Jarich Oosten (dir.), La nature des esprits dans les cosmologies autochtones, op. cit., p. 56.
12Bruce Albert et Davi Kopenawa, La Chute du ciel, op. cit., p. 184.
13Bruce Albert et Davi Kopenawa, ibid., p. 225.
14Voir, à ce sujet, mon article « De la contre-anthropologie comme lutte des peuples dans la théorie », in Les Temps qui restent, numéro 1, avril-juin 2024.
15Bruce Albert et Davi Kopenawa, La Chute du ciel, op. cit., p. 550.
16Baptiste Morizot, Manières d’être vivant, Arles, Actes Sud, 2020, p. 21.
17Morizot cite une étude menée en 2014 par Discover the Forest et l’US Forest Service. Voir Baptiste Morizot, ibid., p. 22.
18Bruce Albert et Davi Kopenawa, La Chute du ciel, op. cit., p. 648.
19Bruce Albert et Davi Kopenawa, ibid., p. 652.
20Voir Julien Pallotta, Por uma internacional cosmopolítica, São Paulo, n-1 edições, 2024.
21Bruce Albert et Davi Kopenawa, La Chute du ciel, op. cit., p. 654.
22Voir mon article « De la contre-anthropologie comme lutte des peuples dans la théorie », art. cit.
23Voir l’intervention de Kopenawa dans l’émission Roda viva du 15 avril 2024 (accessible en ligne).
24Marília Senlle, communication personnelle.
L’article Cosmo-esthétique et cosmopolitique indigène <br>À partir du cas yanomami est apparu en premier sur multitudes.
22.03.2025 à 10:30
Introduction
Cocco Giuseppe
L’idée de ce dossier était de faire un bilan du débat autour du retour de la guerre de grande échelle au cœur de l’Europe, après les 80 ans de paix qui, hormis dans l’ex-Yougoslavie, avaient suivi la fin du cataclysme de la deuxième guerre mondiale. Frédéric Gros, en 2005, avait pensé que les guerres étaient … Continuer la lecture de Introduction →
L’article Introduction est apparu en premier sur multitudes.
Texte intégral (2510 mots)
L’idée de ce dossier était de faire un bilan du débat autour du retour de la guerre de grande échelle au cœur de l’Europe, après les 80 ans de paix qui, hormis dans l’ex-Yougoslavie, avaient suivi la fin du cataclysme de la deuxième guerre mondiale. Frédéric Gros, en 2005, avait pensé que les guerres étaient terminées. Juste après l’invasion russe de l’Ukraine, il a écrit que « personne en Europe n’y croyait ». Mais, « cette fois, c’est vraiment la guerre ». On peut donc « renvoyer à leur statut de métaphores un paquet d’expressions […] : guerre des sexes, guerre psychologique, guerre commerciale, guerre générationnelle1 ». Or, Gros se trompe à nouveau : la vraie guerre, celle qui est là, mélange toutes les autres, et ceci parce que, d’un côté, elle transforme tout ce qu’elle peut en arme et parce que, d’un autre côté, elle fait de ce qui était métaphorique un champ de bataille. Ce dossier de Multitudes s’efforce d’analyser les guerres « littérales » (où des armées ravagent des vies et des territoires par l’usage massif d’armes destructrices), plutôt qu’à répertorier tout ce qui a été récemment affublé d’un vocabulaire polémologique, mais sans non plus s’illusionner sur une continuité réelle entre guerres ouvertes et violence systémique (slow violence).
Comme toujours, devant la guerre, la gauche se déchire entre différentes approches face à l’urgence et au chantage qu’elle impose. C’est la force et la faiblesse de la gauche démocratique. La guerre n’est jamais une « bonne chose ». Mais comment faire vivre son refus quand la guerre nous est imposée ? Il faut toujours se méfier des guerres qui se disent « justes ». Mais la résistance contre l’invasion de ton pays, contre la destruction de tes villes, contre l’enlèvements des enfants, n’est-elle pas une guerre juste ?
Ainsi, la gauche s’est divisée. D’une part, il y a ceux qui pensent qu’il ne faut pas renoncer à défendre la paix. De l’autre, il y a ceux qui disent qu’il faut bien se défendre contre l’oppression venue de l’extérieur. Dans le second cas, se défendre implique de changer les priorités qui sont sur la table, de changer d’urgences : la transition énergétique, la réduction des inégalités. Ne pas se défendre peut résulter dans une augmentation des visées des agresseurs – qui impliqueront plus d’inégalités et moins d’efforts pour l’environnement.
Ce qu’il y a de monstrueux dans la guerre en général, et dans celle-ci en particulier, c’est qu’elle rend impossible la solution de ces problèmes urgents, puisqu’elle les submerge dans une violence généralisée. C’est sans doute pour cela que certains gouvernements se livrent à l’escalade guerrière (Poutine, Netanyahu, Hamas) : pour substituer une urgence qui les renforce à des urgences qui les menacent.
Dans l’immédiat, le dilemme paraît sans issue. Si l’Europe ne se réarme pas pour maintenir ses budgets écologiques et son welfare, ces mêmes politiques seront mises en pièces par les nouveaux rapports de force : pire, si l’agression est victorieuse, il y en aura d’autres. Si au contraire l’Europe choisit le réarmement, c’est elle-même qui doit réduire ses compromis écologiques et sociaux, tout en devant gouverner les problèmes de la militarisation.
En réalité, bien sûr, ces clivages ne sont pas aussi nets. Surtout, ils ne respectent pas forcément les lignes de partage qui existaient avant l’invasion russe. En fait, les fractures sont aussi transversales que la guerre est un terrible mécanisme de binarisation à commencer par le campisme de l’ami et de l’ennemi que Carl Schmitt, le juriste nazi, aimait tant.
C’est que la guerre ne se présente pas partout de la même manière. En Europe occidentale, on peut même penser que les steppes ukrainiennes sont aussi lointaines qu’elles l’étaient lorsque le rideau de fer les cachait. Ainsi, on peut avoir la sensation qu’il y un espace pour que les priorités de la paix, de l’écologie et de la réduction des inégalités ne soient pas abandonnées. On peut se disputer en France sur la couleur du premier ministre, dans les récriminations mais dans la paix civile. D’un autre point de vue, toutefois, la guerre apparaît bien plus proche, même interne. Cet espace de paix est lui-même menacé : Orban ici, Trump là-bas font entrevoir que ce n’est pas la couleur du gouvernement, mais le fait de pouvoir l’élire et le contester qui est en jeu.
S’agit-il seulement d’une question de points de vue ? Le dossier en présente plusieurs. Non pas pour faire l’impasse, ni pour dire que tout se vaut, mais pour contribuer à ce que le débat ait lieu : pour affirmer que des perspectives antagonistes doivent être écoutées. Entre l’idée qu’on peut encore refuser la guerre qui est déjà là et celle qu’il faut tout faire comme si on était en guerre, ce qui reste, c’est qu’on peut encore en discuter et essayer une mobilisation démocratique.
Peut-être la véritable bifurcation est-elle celle-ci : il y a la place pour continuer à discuter de la guerre, entre refus et mobilisation, dans la mesure où les conditions d’expression démocratique persistent. Dans des espaces médiatiques que l’internet avait rendu multi-perspectivistes, mais que les mass-médias et le capitalisme de plateforme enferment dans des visions en tunnels, ce dossier de Multitudes donne place à des positionnements incompatibles entre eux, mais devant tous être écoutés. Les positions contradictoires peuvent alimenter un débat nuancé qui n’a pas forcément de solution consensuelle : une première contradiction souligne la continuité, plutôt que la séparation absolue, entre guerre et paix ; une deuxième contradiction oppose la vie à la violence brutale de la guerre totale ; de nombreuses autres contradictions (relatives à la persistance des colonisations, aux violences lentes de la logistique, aux traitements des minorités, etc.) ne pourront pas être abordées dans les pages limitées de ce dossier, qui ne prétend pas résoudre les problèmes, mais mieux les présenter.
Lorsqu’on regarde la guerre de loin, ces énigmes semblent abstraites, comme si on pouvait faire des choix ou éviter d’en faire. Quand on la regarde de près, les déchirements continuent. Les femmes ukrainiennes réfugiées à Trieste le montrent bien, puisqu’elles sont à la fois près et loin du front : si elles défendent la résistance de leur pays, de leurs villes, de leurs maisons face à l’énième tentative impériale de les réduire à l’esclavage, elles défendent aussi la vie des jeunes pour qu’ils ne soient pas mobilisés. Elles veulent résister pour défendre la vie, alors que le propre de la guerre est de nier ce conatus. Il n’y a pas de solution qui ne soit pas violente : ou la violence de la défaite, ou la violence des massacres au front, des enlèvements d’enfants, des viols et des tortures.
Giuseppe Cocco défend la nécessité de repenser les luttes à la lumière d’un changement de paradigme imposé par une guerre de nouveau type : qui a comme cible le projet démocratique européen et les ressources du Sud Global. Massimiliano Guareschi se penche sur la crise des dimensions constituantes de la guerre en même temps que Francesco Brusa fait un bilan pessimiste de tout ce qui se passe dans la région. Monique Selim rappelle ce que la guerre signifie depuis toujours pour les femmes. Yves Citton tente de désarmer les discours sur la guerre qui appellent actuellement au gonflement des budgets militaires. Thierry Baudouin reconstitue les dimensions maritimes de la géopolitique russe et pense que, à l’heure de Trump, l’Europe peut et doit négocier même avec un Poutine qui n’a respecté aucun traité, aucun accord. Avec un point de vue bien différent, Ilko-Sascha Kowalczuk appréhende la guerre à partir de l’expérience d’avoir vécu sous le talon de fer du totalitarisme socialiste (en Allemagne orientale) et souligne la nécessité de défendre la liberté sans accepter aucune médiation. Jules Falquet déplace les interrogations depuis le champ de la guerre vers la question du militarisme. Behrang Pourhosseini envisage la relation guerrière entre Israël et l’Iran comme une modalité de contrôle interne des populations (Palestiniens, femmes). Ariel Kyrou pense qu’il faut obstinément opposer tout à la guerre, sans se fermer les yeux sur ses horreurs et ses menaces, mais en les ouvrant différemment.
Au moment où nous terminons d’éditer le dossier, la nouvelle coalition qui a ramené Donald Trump à la présidence des États-Unis montre ses dents. De cette bouche arrogante exhale la même puanteur qui se propage à Moscou et à Beijing. Cela nous fait penser au pourrissement de l’histoire dont parlait Claude Lefort justement devant les débuts de la guerre d’Algérie. Mais c’est bien l’air putrifié des années 1930 qu’on a l’impression de respirer. Le protagonisme technofasciste d’un Elon Musk vise à créer le chaos en Europe en fomentant directement les partis néonazis. En même temps, Donald Trump multiplie avec truculence les menaces impériales contre l’Europe aussi bien que contre les migrants. L’annonce de vouloir les interner dans la prison de Guantanamo ne pourrait être plus explicite.
Il faut peut-être essayer de réfléchir à la mécanique de la spirale folle qui s’est mise en place. Dans un article publié dans le très sérieux Financial Times, le milliardaire Peter Thiel définit le retour de Donald Trump comme une apokalipsis (au sens original de « révélation »). Voilà une extrême droite guerrière qui, sous couvert d’isolationnisme, fait de cette eschatologie son projet d’une guerre contre le mal : que ce soient la démocratie ukrainienne, les « théories du genre » ou les politiques de migrations. Les graffitis issus des mobilisations écologiques radicales disaient qu’une « autre fin du monde est possible », aujourd’hui, c’est le technofascisme qui en offre une : horizontalement, par l’affirmation urbi et orbi du critère impérial du Lebensraum (l’espace vital), et verticalement, par le nomos de Mars.
La paix est de plus en plus urgente, mais elle n’a pas de chances de s’affirmer si nous n’inventons pas de nouvelles formes de résistance aux logiques de guerres entre les géoclasses. Si nous ne savons pas ce qu’est la nouvelle résistance et avons du mal à nous reconnaître dans celle, démocratique, des Ukrainiennes et des Ukrainiens, c’est probablement parce que, de tant normer les figures a priori de l’opprimé abstrait, nous avons perdu la capacité de lire entre les lignes du vrai et du faux, et ne savons plus nous reconnaître dans les traces de l’oppression – justement dans la résistance. L’historien Carlo Ginzburg, fils d’un résistant mort sous la torture de la Gestapo à Rome en 1944, suggère que ce sont Walter Benjamin et Marc Bloch, « dans un des moments les plus sobres de l’histoire du XXe siècle, tout de suite après le pacte Ribbentrop-Molotov, à la veille de la Seconde Guerre mondiale », qui peuvent nous guider en ayant proposé de « lire l’histoire à rebrousse-poil », comme capacité de lire les « témoignages entre les lignes », et donc saisir les « révélations involontaires », celles qui nous permettent de faire la part entre « la force des mythes et les mensonges2 ».
1Frédéric Gros, Pouquoi la guerre ?, A. Colin, Paris, 2023, p. 8.
2« Les révélations involontaires », in Carlo Ginzburg, La lettre tue (2021), traduction de Martin Rueff, Verdier, Paris, 2024, p. 70.
L’article Introduction est apparu en premier sur multitudes.
- GÉNÉRALISTES
- Ballast
- Fakir
- Interstices
- Lava
- La revue des médias
- Le Grand Continent
- Le Monde Diplo
- Le Nouvel Obs
- Lundi Matin
- Mouais
- Multitudes
- Politis
- Regards
- Smolny
- Socialter
- The Conversation
- UPMagazine
- Usbek & Rica
- Le Zéphyr
- CULTURE / IDÉES 1/2
- Accattone
- Contretemps
- A Contretemps
- Alter-éditions
- CQFD
- Comptoir (Le)
- Déferlante (La)
- Esprit
- Frustration
- IDÉES 2/2
- L'Intimiste
- Jef Klak
- Lignes de Crêtes
- NonFiction
- Nouveaux Cahiers du Socialisme
- Période
- Philo Mag
- Terrestres
- Vie des Idées
- Villa Albertine
- THINK-TANKS
- Fondation Copernic
- Institut La Boétie
- Institut Rousseau
- TECH
- Dans les algorithmes
- Framablog
- Goodtech.info
- Quadrature du Net
- INTERNATIONAL
- Alencontre
- Alterinfos
- CETRI
- ESSF
- Inprecor
- Journal des Alternatives
- Guitinews
- MULTILINGUES
- Kedistan
- Quatrième Internationale
- Viewpoint Magazine
- +972 mag
- PODCASTS
- Arrêt sur Images
- Le Diplo
- LSD
- Thinkerview
- Fiabilité faible
- Contre-Attaque
- Issues
- Korii
- Positivr
- Regain
- Slate
- Ulyces