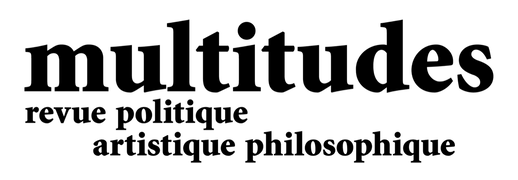22.03.2025 à 10:23
Femmes entre guerres et paix
multitudes
Femmes entre guerres et paix Cet article examine, dans le cadre de l’histoire récente, les positions des femmes face à la guerre et à la paix, celles qu’on leur attribue idéologiquement, celles qu’elles subissent malgré elles, dans leurs implications volontaires ainsi que dans leurs engagements militants au sein d’une multitude d’organisations qui ont changé de nature avec la fin de la guerre froide. L’auteure rappelle que les femmes ne sont pas des pacifistes par essence, mais plutôt des humains comme les autres, opposés à la guerre et œuvrant à la pacification du monde dans un contexte de plus en plus favorable à la guerre, qui exalte le virilisme et a enterré l’objection de conscience. L’unité et la solidarité de femmes de camps politiquement adverses constituent la face aujourd’hui dominante de leurs combats dans nombre de conflits comme celui, exemplaire, qui oppose le gouvernement israélien aux Palestiniens et réunit juives, musulmanes et non croyantes. Women between War and Peace This article examines, in the context of recent history, women’s positions on war and peace, both those attributed to them ideologically and those they have to endure in spite of themselves, in their voluntary involvement as well as in their militant commitments within a multitude of organizations that have changed in nature with the end of the Cold War. The author reminds us that women are not pacifists in essence, but rather human beings like any others, opposed to war and working to pacify the world in a context increasingly favorable to war, which exalts virilism and has buried conscientious objection. The unity and solidarity of women from politically opposing camps is the dominant face of their struggles today in many conflicts, such as the exemplary one between the Israeli government and the Palestinians, which brings some women together, Jews, Muslims and non-believers alike.
L’article Femmes entre guerres et paix est apparu en premier sur multitudes.
Texte intégral (3683 mots)
Se plonger dans la quête des liens qu’ont les femmes avec la guerre et la paix enjoint tout d’abord à quelques démontages d’opinions courantes et de soi-disant évidences. En premier lieu on trouve l’idée que la guerre est une affaire d’hommes, ce qui parait un fait objectif majoritaire mais qui est démenti à la marge par les historiens et les anthropologues. Danièle Palmieri et Irène Hermann1 rappellent ainsi toutes les participations féminines à la guerre et les nombreuses cheffes de guerre dans un passé proche et lointain ainsi que dans les sociétés précapitalistes, au-delà des célèbres Amazones. Plus récemment, au XXe siècle, les femmes ont formé des bataillons et été au front en Russie, en Yougoslavie et dans nombre de guerres de libération nationale comme en Algérie, au Vietnam ou encore au Bangladesh. Dans ce dernier pays les militants ont toujours mis les femmes en tête des manifestations, ce qui revient à leur faire subir les premiers coups sans vraiment décourager les attaques. Les armées révolutionnaires comptent aussi significativement des femmes combattantes2 mais les Jihadistes ramènent les femmes à leurs fonctions les plus serviles. Une fois la victoire arrivée, malgré leur rôle important et les dangers que les femmes ont encourus au risque de leur vie, elles sont plus ou moins renvoyées dans leur foyer et de façon récurrente écartées des institutions politiques centrales.
Lorsque les femmes ont été l’objet de viol en temps de guerre – ce qui est très courant – leur exclusion de la société et le rejet de leurs familles en font généralement des parias. Au Bangladesh où le nombre de femmes principalement hindoues mais aussi musulmanes violées par les militaires pakistanais a été très élevé, car le viol a été commandité comme une arme de destruction ethnique, les programmes de réhabilitation lancés à l’Indépendance ont été des échecs exemplaires et les femmes violées ont été assimilées à des prostituées. La volonté étatique d’en faire des héroïnes (biragona) s’est heurtée aux logiques patriarcales qui les ont ramenées au sort de prostituées (baragona) avec la proximité linguistique.
Sur un autre registre, la participation des femmes à l’effort de guerre, sous différentes formes de services et de soin est notable dans toutes les guerres, comme le montrent les travailleuses de la résistance 3 dans l’Ukraine actuelle en guerre contre l’invasion russe, où des femmes deviennent bénévoles dans des organisations humanitaires dans des villages mais aussi sur le front. Néanmoins la guerre terminée, quel que soit le traitement des femmes qui se sont distinguées par leurs actions ou ont été des « butins » sacrificiels définitivement déshonorées et déshonorantes, peu de reconnaissance leur est donnée. De manière générale la domination masculine qui innerve partout avec plus ou moins de nuances les sociétés se révèle avec une force éclatante et les armées sont, en temps de paix, essentiellement masculines même si quelques dictateurs comme Kadhafi aimaient afficher leurs gardes du corps féminins.
Si on se tourne ensuite sur le rapport des femmes à la paix, on est face à une telle masse de documents que se préfigure un véritable tonneau des Danaïdes, dans lequel une multitude d’ONG et de mouvements les plus divers, d’études spécifiques conduites par de grandes entreprises, s’ajoutent à quelques articles de recherche plus scientifique. En outre apparait la difficulté de tracer des axes de classement de ces matériaux qui dépassent un tant soit peu leur hétérogénéité, dès lors qu’on ne se contente pas de deux axiomes d’ailleurs complémentaires où s’entremêlent constats incontestables et préjugés : les femmes sont les premières victimes des guerres et sont « naturellement » attirées par la paix, car ce sont avant tout des mères qui donnent la vie. Là encore la violence de femmes durant les guerres, égale à celles des hommes dans la torture, l’assassinat et parfois la participation aux sévices sexuels lorsqu’on les y autorise ou les encourage, balaye l’énoncé tendanciellement essentialiste d’une consubstantialité entre femmes et paix. L’héroïne de Santosh 4, jeune policière indienne coiffée d’une cheffe à la réputation redoutable, illustre remarquablement bien comment une femme peut exceller dans des coups meurtriers, s’acharnant avec tout à la fois passion et sang-froid sur le corps sanguinolent et inanimé, dans ce cas, d’un jeune adivasi accusé à tort de viol.
Le critère historique de la guerre froide peut néanmoins être retenu au départ pour déblayer un peu le terrain des femmes militant en faveur de la paix. Durant tout le XXe siècle où le monde est partagé entre pays communistes ou rangés dans la sphère d’influence de l’URSS, et le camp des États-Unis et du capitalisme avec ses dictatures inféodées d’Amérique latine, les mouvements de femmes pour la paix suivent en général cet antagonisme frontal avec des singularités nationales. Ainsi en va-t-il de la Ligue internationale des femmes pour la paix et la liberté qui semble animée par les mêmes aspirations que le Mouvement de la paix, fondé en 1948, dans l’orbite du Parti communiste français même si, loin de là, tous les adeptes de cette organisation fondamentalement pacifiste ne sont pas membres du Parti. Le Mouvement de la paix, toujours actif en 2024 sous la forme d’une association 1901 et de multiples comités locaux, s’érige avant tout contre l’arme atomique et pour le désarmement nucléaire. Le Rassemblement des femmes pour la paix 5 est créé dans la même optique après la Seconde Guerre mondiale par quelques femmes résistantes proches du parti communiste. En effet genre, féminisme et condition des femmes sont aussi au cœur de la guerre froide, comme le montrent avec beaucoup d’acuité des historiennes et des politistes6 retraçant les logiques subjectives de la mobilisation des femmes qui s’inscrit objectivement dans le cadre de la création et du financement d’organisations concurrentes par des institutions internationales aux intentions politiques masquées. Bien que ces organisations pacifistes de femmes demandent parfois l’égalité entre hommes et femmes, elles ne se présentent nullement comme féministes si l’on entend par ce qualificatif une perspective de transformation sociale des rôles sexués.
La chute de l’URSS et l’unification capitalistique met un terme à cette cartographie duelle et voit l’émergence d’une foule de regroupements nationaux de femmes en faveur de la paix. On distingue alors deux schèmes articulés, dont le premier est un combat contre le gouvernement d’un pays, comme l’illustre le cas particulier du Mouvement des femmes et des filles pour la paix et la sécurité au Burundi créé en 2015. L’unité et la solidarité de femmes de camps politiquement adverses constituent la seconde face aujourd’hui dominante dans nombre de conflits. Les politiques internationales de (ré)conciliation concrète des ennemis peuvent être appréhendées comme un contexte favorisant leur actualisation locale ou nationale, par des femmes dont on ne doit pas pourtant pas négliger l’autonomie. Ainsi des femmes singulières s’associent concrètement pour démontrer que l’intersubjectivité pacificatrice peut être généralisée à une échelle macro-politique et opérer contre la guerre et pour la paix. Les femmes en noir font ainsi irruption dans le cadre de la fin de la Yougoslavie et des guerres des Balkans qui font rage et débouchent sur le génocide de Srebrenica. Elles constituent un modèle d’organisation de femmes pour la paix qui a essaimé partout dans le monde et continue de se développer.
Le conflit qui ravage le Moyen Orient depuis des décennies voit ainsi fleurir à l’initiative de femmes israéliennes des organisations les unissant aux femmes palestiniennes pour réclamer avec force l’arrêt de la guerre et éventuellement la création de deux États, tel Women Wage Peace fondé en 2014. En France plus récemment, depuis 2022, Guerrières de la paix prône le rassemblement des femmes de toutes origines et croyances contre les haines et racismes destructeurs et convoque en particulier les femmes musulmanes et juives à se dresser contre l’assignation et l’identitarisme. Un forum mondial des femmes pour la paix est institué en 2023 à leur initiative sous l’égide de l’ONU et de l’UNESCO.
Si ce bref descriptif de quelques organisations significatives ne fait pas des femmes des pacifistes par essence, mais plutôt des humains comme les autres opposés à la guerre et œuvrant à la pacification du monde, en revanche la sociologue André Michel juge le complexe militaro-industriel fondamentalement lié à l’ordre patriarcal et au développement du capitalisme7. La notion de complexe militaro-industriel, très en vigueur dans la seconde moitié du XXe siècle, est tombée en désuétude alors même que le XXIe siècle se révèle extraordinairement producteur d’armements et de guerres innombrables, nourries par les livraisons d’armes toujours plus généreuses des pôles hégémoniques. L’oubli, aujourd’hui, de la notion de complexe militaro-industriel fait écho corollairement à l’obsolescence de l’antimilitarisme8. Efficace est la menace médiatisée de façon outrancière de tomber sous le coup de l’accusation de Munichois, qui revient à confondre évènements et contextes passés et actuels profondément différents. On voit là poindre la persistance d’une volonté d’abattre la chimère communiste, pourtant défunte depuis 1991, et les processus de décommunisation qui ont été instaurés par la suite dans les anciennes républiques socialistes de l’Est9.
L’objection de conscience, qui fut par exemple un outil de contestation notoire durant la guerre d’Algérie, est similairement difficilement pensable dans la configuration présente où les thématiques nationalitaires et identitaires, classiques de l’extrême-droite, sont exaltées comme universelles et apodictiques. La clause de conscience des médecins, très respectée, fonctionne en revanche remarquablement bien chez ceux et celles qui rejettent l’avortement comme en Italie et aux USA ! Ceux et celles qui refusent de combattre sont assimilé.es à des lâches dans le cadre d’une nécessité impérieuse de défendre son pays, répétée à l’infini comme un devoir qui incombe à chacun, pour légitimer, parfois et dans certaines circonstances, crimes de guerre et crimes contre l’humanité, comme au Rwanda en 1994 où personne n’a manqué à l’appel à tuer. Le mouvement des Refuzniks fondé en 1979 en Israël et les 130 réservistes qui en 2024 n’acceptent pas de retourner sur le front font figure d’exception, à laquelle le peu d’attention accordé par la presse est significatif.
Les courants anarchistes et libertaires qui, au XXe siècle, ont été les fers de lance de l’antimilitarisme sont renvoyés vers une extrême-gauche bannie, potentiellement terroriste et ayant perdu le sens de l’amour de la nation. Ce climat délétère encourage les guerres, leur virilisme intrinsèque, un esprit de revanche primaire sur le mode de la vendetta qui transforme les États en appareils de terreur et achève de les déconsidérer compte tenu du nombre de civils qu’ils tuent. La perte de poids des institutions internationales pour peser sur les décisions guerrières des gouvernements est flagrante, dans le monde globalisé présent où les guerres sont des marchandises spectaculaires, diffusées d’un bout à l’autre de la planète, provoquant des haines passionnelles et clivant les collectifs. Catherine Hass observe dans cette optique avec acuité que « les guerres semblent aujourd’hui détruire avec elles toute possibilité qu’il en soit autrement en détruisant toute politique ; elles détruisent la possibilité même d’une pensée de la politique, de la paix et donc du possible. Or… penser la politique, c’est foncièrement penser le possible10. »
Bertrand Badie11 souligne dans la même veine que l’hypothèse antérieure faisant de l’hégémonie un facteur de paix et de stabilité est aujourd’hui invalidée et que, la guerre ne produisant plus de victoires, il est indispensable de construire des politiques de paix fondées sur la reconnaissance de l’altérité. D’aucun·es estimeront qu’il s’agit là d’un vœu pieux, inapplicable, et que certaines guerres sont plus légitimes que d’autres au nom de la protection qu’elles nous assureraient. D’autres se questionneront sur ce nous, sans parvenir à repérer son échelle et sans comprendre s’il s’agit d’un nous interne, endogénéisé, ou plus vaste – et selon quelle logique d’appartenance sensible ou institutionnelle, sans bien savoir qui ce nous inclut et qui il exclut, sans saisir le sens des assertions définitionnelles de ce nous par une proximité revendiquée et un éloignement clair, sans en comprendre les termes et les registres aux dénominations vagues et creuses : géographique, culturelle, religieuse, économique, politique ? Et pourquoi pas genrées, poussant à un nous les hommes, nous les femmes ? Femmes à promouvoir et soutenir en Afghanistan quand il fallait contrer la mainmise soviétique sur l’État, mais femmes à abandonner quand les Talibans au pouvoir les enferment sans bruit et tentent d’éradiquer leurs opposants plus islamistes qu’eux-mêmes, dont ils débarrassent ainsi le monde global !
Derrière des controverses abyssales sur ce nous oxymorique, l’identité reviendrait au galop, qu’elle soit géopolitique ou tout simplement identitariste, avec son cortège de justifications guerrières et d’imbécillités rabâchées. L’idée que tant de contrées sont encore à nettoyer de leurs déviances de tous ordres, de leurs populations-déchets, de leurs masses de sauvages, et à civiliser, reste en effet, malgré les échecs des dernières expéditions meurtrières menées en Irak, vivace dans les lancements des guerres actuelles. L’imaginaire de la paix – rayonnant après Hiroshima et la Seconde Guerre mondiale – fait effroyablement défaut présentement, alors même que les guerres innombrables devraient le nourrir. Le second mandat de Trump ne rallumera certainement pas cet horizon de la paix et l’on note en outre, dans les statistiques comparatives avec les élections de 2020, selon les catégories en vigueur aux USA, une légère baisse du vote pour Trump des femmes « blanches » (52 % au lieu de 54 %) ainsi que des femmes « noires » (7 % au lieu de 9 %) mais une augmentation des femmes « latino » (37 % au lieu de 30 %). Le nombre de femmes votant pour « un homme fort qui nous défend », comme Trump, interpelle sur la configuration actuelle. La puissance suggestive de la transgression qu’il incarne s’adresse à l’inconscient et autorise chacun·e à céder à ses pulsions. La paix en ressort absente des désirs comme de toutes les fausses interrogations sur les bienfaits de la guerre. La paix ressemble à une âme errante…à laquelle pourtant il faudrait mieux se fier pour l’avenir de l’humanité, des sociétés et de l’environnement.
1Danièle Palmieri & Irène Hermann, « Between Amazons and Sabines: a historical approach to women and war », in International Review of the Red Cross, no 877, March 2010, p. 19-30.
2Camille Boutron (2024) Combattantes, quand les femmes font la guerre, éditions Les périgrines.
3Daria Saburova (2024) Travailleuses de la résistance., Les classes populaires ukrainiennes face à la guerre, Éditions du Croquant.
4Sandhiya Suri, Santosh, 2024.
5France Huart, « Le Rassemblement des femmes pour la paix. Une communication stratégique alliant émotions et engagement », Sextant [Online], 34, 2017, http://journals.openedition.org/sextant/514
6Ioana Cirstocea, & Françoise Thebaud, Le genre de la guerre froide, Clio, 2023/1 no 57 ; Ioana Cirstocea, La fin de la femme rouge, Presses universitaires de Rennes, 2019.
7André Michel, Agnès Bertrand, Monique Séné (1985), « Le complexe militaro-industriel et les violences à l’égard des femmes », Nouvelles questions féministes, no 11/12, p. 9-85.
8Philippe Lecomte (2001) « L’antimilitarisme, proposition de définition », Les champs de mars, no 9, p. 111-133.
9Antoine Heemeryck (2010), L’importation démocratique en Roumanie, L’Harmattan, Paris.
10Catherine Hass (2019), Aujourd’hui la guerre. Penser la guerre, Paris, Fayard.
11Bertrand Badie (2024), L’art de la paix, Paris, Flammarion.
L’article Femmes entre guerres et paix est apparu en premier sur multitudes.
22.03.2025 à 10:21
La terre tremble autour du front
multitudes
La terre tremble autour du front Le paradoxe de ces trois années d’invasion russe en Ukraine est que, plutôt que la guerre, c’est le monde environnant qui semble avoir changé. Alors que la ligne de front est pratiquement à l’arrêt, le cadre politique européen et surtout celui nord-américain se sont déplacés beaucoup plus à droite. Ce sont surtout les contours idéologiques dans lesquels le conflit est perçu par les populations qui sont les plus proches qui ont changé. Les innombrables élections dans les pays de l’Europe centre-orientale et du Caucase, aussi bien que les manifestations de rue qui traversent les sociétés, nous montrent une situation ambigüe : la projection hégémonique du Kremlin se nourrit aujourd’hui de la continuation des combats et de l’apparente inaction des gouvernements occidentaux. Plus le temps passe, plus les contradictions qui se sont accumulées au cours de la transition inachevée des pays post-soviétiques réapparaissent. The Earth Trembles around the Front Line The paradox of three years of Russian invasion of Ukraine is that, rather than the war itself, it’s the surrounding world that seems to have changed. While the front line has virtually ground to a halt, the political framework in Europe and especially North America has shifted much further to the right. Above all, it is the ideological contours within which the conflict is perceived by the populations closest to it that have changed. The countless elections in the countries of Central and Eastern Europe and the Caucasus, as well as the street demonstrations that are sweeping across societies, show us an ambiguous situation: the Kremlin’s hegemonic projection is now nourished by the continuation of the fighting and by the apparent inaction of Western governments. The more time passes, the more the contradictions that accumulated during the unfinished transition of post-Soviet countries reappear.
L’article La terre tremble autour du front est apparu en premier sur multitudes.
Texte intégral (3702 mots)
Alors que la ligne de front semble presque immobile, la terre tout autour tremble, subit des glissements et se déplace à des rythmes imprévisibles. Ces trois années d’invasion russe en Ukraine (et d’une tenace résistance de Kiev) ont comme « figé » la guerre dans un combat de tranchées exténuant. D’un point de vue plus politique, elles ont remis en question beaucoup de choses, voire tout. En sourdine flottent des questions sur la proximité ou la distance de la fin du conflit et sur ce que signifie « fin » pour une guerre d’agression visant à modifier des frontières internationalement reconnues et à nier à l’Ukraine et à son peuple toute forme de subjectivité. Des interrogations se posent aussi sur quelles hétérogenèses des fins peuvent se profiler à l’horizon, tant pour la Russie de Poutine que pour la résistance ukrainienne, tant pour l’Europe que pour les équilibres globaux.
Le débat, à quelques rares exceptions près, s’est définitivement enkysté. Comme le montrent également les quatre heures et demie de conférence de presse de fin d’année tenue en décembre, le Kremlin poursuit une ligne rhétorique ambiguë de « patriotisme soft », visant moins à galvaniser la citoyenneté qu’à minimiser les problèmes et à renvoyer l’image d’un État qui maitrise pleinement les événements. Poutine se déclare souvent « ouvert à tout type de négociation », pour ensuite affirmer que Zelensky n’est pas un interlocuteur légitime. Kiev a partiellement tempéré ses objectifs, indiquant ouvertement que les frontières de 1991 (donc les territoires du Donbass et la péninsule de Crimée, actuellement sous contrôle russe) peuvent éventuellement être récupérées « par des voies diplomatiques », suggérant ainsi que la guerre pourrait également s’arrêter par un cessez-le-feu sur la ligne de front. En même temps, les Ukrainiens ne peuvent que continuer à s’opposer à un envahisseur qui continue à attaquer et bombarder toutes ses villes.
Pendant ce temps, à l’échelle mondiale, un désalignement de plus en plus marqué semble être en cours par rapport à l’équilibre des rapports de force entre les États (et les acteurs internes aux différents États) qui prévalait en quelque sorte jusqu’à l’ère pré-pandémique : la résurgence du conflit arabo-israélo-palestinien, la réélection de Donald Trump à la Maison-Blanche dans une version certainement beaucoup plus technofasciste et subversive qu’en 2016 où pèse la présence de l’étrange allié Elon Musk, la tentative de coup d’État en Corée du Sud par Yoon, les timides tentatives de construction d’une contre-hégémonie mondiale par les BRICS, la révolution étudiante au Bangladesh et la chute d’Assad en Syrie… pour ne citer que quelques-uns des récents événements marquants. Le continent européen change également, avec la formation d’une nouvelle commission communautaire plus orientée « à l’est », un cycle électoral qui a donné des résultats mitigés avec une croissance marquée de la droite dans divers contextes, mais aussi la fin d’hégémonies qui semblaient inébranlables comme celle du PiS en Pologne ainsi que l’embrasement de protestations et de contestations qui, bien qu’elles ne puissent être directement associées à la guerre en Ukraine, reflètent de fait certains des éléments fondamentaux, comme en Géorgie…
Europe et démocratie
Au lendemain de la guerre sanglante en ex-Yougoslavie des années 90, la philosophe croate Rada Iveković écrivait dans son Autopsie des Balkans. Essai de psycho-politique : « face à l’Europe de l’Est, ainsi qu’aux Balkans, l’Europe n’a pas su être un sujet au moment où il le fallait, c’est-à-dire à partir de 1989. Elle n’a pas su planifier sa construction, son devenir-sujet politique à long terme, par l’inclusion ». Elle ajoute : « comme si, dans les guerres en cours, l’Europe n’était que marginalement responsable (ou pratiquement pas) et seulement dans le sens où elle intervient, par humanitarisme, pour les arrêter plus ou moins avec succès ». Elle conclut avec une remarque qui – en la relisant aujourd’hui – ne peut que sembler prophétique : « Il arrive un moment où il est trop tard pour trouver de bonnes solutions. Si nous ne comprenons pas que les guerres en cours sont des guerres européennes, il y a un risque d’en avoir d’autres, peut-être un peu plus loin, dans certains pays de l’ancienne Union soviétique, à l’occasion d’autres tours de vis de la construction européenne ». Elle nous invite à réfléchir à combien l’ex-Yougoslavie d’un côté et l’Ukraine de l’autre peuvent et doivent être considérées comme des questions européennes au sens large, dans une logique qui met en cause les évolutions historico-politiques du continent au moins depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. En particulier, elle nous indique aussi, peut-être, une tendance de la part de l’Europe (maintenant entendue au sens spécifique de l’Union européenne) à fuir les responsabilités auxquelles elle est appelée.
À la suite du 24 février 2022, lorsque les chars russes sont entrés en Ukraine, Bruxelles a immédiatement pris une position de condamnation ferme de l’invasion et de soutien résolu à Kiev dans son effort d’autodéfense. Au fil des jours, en synergie avec les discours menés par le président américain de l’époque, Joe Biden, et par le leader ukrainien lui-même, Zelensky, la ligne rhétorique autour du conflit entamé par la Russie de Poutine s’est de plus en plus établie sur l’affrontement entre démocratie et autocratie. Non sans raison : le régime instauré à Moscou par l’ancien agent du KGB à partir des années 2000 est à tous égards un système dictatorial, ou du moins de « démocratie contrôlée ». En effet, les élections y sont organisées uniquement pour reconfirmer le gouvernement en place, la presse indépendante et l’activisme pour les droits de l’homme y subissent des pressions qui, dans de nombreux cas, aboutissent même à des assassinats ciblés (le cas célèbre d’Anna Politkovskaïa, ainsi que ceux des antifascistes Stanislav Markelov et Anastasia Babourova), des lois fortement répressives y ont été introduites contre les ONG et les dissidences sexuelles, et les syndicats y ont un espace d’action pratiquement nul.
De plus, il n’est pas non plus si extravagant d’affirmer que, d’une part, la décision d’entamer une guerre à grande échelle par l’invasion de l’Ukraine est née, entre autres, de la volonté de stopper et de prévenir les processus de révolution sociale qui se concrétisaient dans le pays agressé, poussés par un désir de rapprochement avec l’Europe et l’OTAN (la Révolution orange de 2004 et la Révolution de la dignité de 2013/14). D’autre part, la Russie a poursuivi au cours de la dernière décennie une série d’alliances avec des régimes de type autoritaire, comme la Syrie d’Assad ou la Biélorussie de Loukachenko (mais aussi la Corée du Nord de Kim Jong-un, ou la Hongrie d’Orbán sur le sol continental). Assez spontanément, donc, l’Europe et l’Ukraine ont essayé de mobiliser leurs propres populations et leur alliance renouvelée autour du concept de « démocratie », une démocratie conçue à la fois comme point de départ et comme une promesse d’avenir pour Kiev (l’entrée dans l’UE), base autour de laquelle s’est structuré le conflit avec la Russie.
Une telle dichotomie peut évidemment être compliquée et enrichie de nuances, qui ont très souvent à voir, d’une part, avec la mémoire de la Grande Guerre patriotique en Russie et, d’autre part, avec les appels controversés à la résistance antisoviétique en Ukraine. Le sociologue Volodymyr Artiukh écrit : « si la propagande de Kiev efface les symboles soviétiques et fait appel aux corps et aux sentiments, la propagande du Kremlin encombre l’espace symbolique de signaux iconiques, tout en effaçant les corps, à la fois littéralement et discursivement. Les Russes utilisent des symboles dépourvus de connotation idéologique pour détruire des corps réels, tandis que les Ukrainiens utilisent des corps détruits, et dépourvus de connotation idéologique, pour lutter contre des symboles ». Tout cela pour dire qu’en effet, bien souvent (et pas seulement en Ukraine), la juste et légitime résistance à l’invasion russe et la lutte pour la démocratie prennent les traits d’une volonté de décolonisation qui s’exerce à la fois contre l’occupation soviétique de l’après-guerre et contre les influences russes tout court (comme dans le refus de la langue russe dans divers domaines, des communications officielles au quotidien).
Hégémonie ou domination ?
Dans ce sens, l’une des dynamiques qui s’est créée, ou plutôt approfondie, avec l’invasion russe en Ukraine a également été celle d’un « sens renouvelé de fraternité » entre les populations et les républiques du contexte post-soviétique : des membres de la dissidence biélorusse s’efforcent de soutenir Kiev depuis l’étranger quand ils ne combattent pas, armes à la main, aux côtés des troupes de Zelensky ; la Géorgie, également engagée sur le champ de bataille avec sa propre légion, est en ébullition avec des manifestations de rue dans le pays depuis près d’un an ; les populations de Pologne et des pays baltes – pour lesquelles, par ailleurs, le traumatisme des conflits passés avec la Russie est réactivé – sont impliquées dans diverses formes de soutien et de mutualisme avec les ukrainiens et ukrainiennes.
Cependant, le récent cycle électoral présente une image certainement plus complexe. En fait, surtout l’année dernière, il semble que les forces politiques dites « pro-russes » aient obtenu une série de succès auparavant considérés comme impensables dans les urnes : en Moldavie, un référendum pour inscrire dans la constitution l’objectif d’adhésion à l’Union européenne est passé de justesse (et a presque uniquement séduit les diasporas de l’Ouest et le centre urbain de la capitale Chișinău) ; lors des présidentielles controversées en Roumanie, l’outsider ultranationaliste Călin Georgescu s’est démarqué, ayant à plusieurs reprises exprimé des opinions proches de Poutine et ayant même rencontré dans le passé l’idéologue eurasien Aleksandr Dugin ; mais aussi en Géorgie, la majorité des préférences est allée au parti au pouvoir, très lié à la Russie, ce qui est un très mauvais résultat bien que la régularité du vote soit très contestée. En général, depuis deux ans, il n’est pas incorrect de dire que les pays d’Europe centrale et orientale (Hongrie, Slovaquie, Roumanie, mais aussi dans une certaine mesure Moldavie, Bulgarie et République tchèque) représentent le « maillon faible » du soutien européen à l’Ukraine agressée et expriment souvent des positions politiques de condescendance envers les actions du Kremlin, au niveau institutionnel tout comme au niveau de l’opinion publique.
Il s’agit cependant d’élections qui soulèvent de nombreuses questions quant à la régularité du processus de vote, et sur lesquelles pèsent souvent des accusations d’ingérence de la part de la Russie ou de la part de sujets impliqués dans des réseaux internationaux, dont beaucoup ont des liens avec la Russie. En même temps, il est impossible de ne pas y voir également le signe d’une projection hégémonique du projet poutinien – qui convainc manifestement plus de gens qu’il n’y paraît, bien que de manière souvent vague et même contradictoire – ainsi que d’une insatisfaction de longue date à l’égard de l’Europe qui traverse ces sociétés, probablement générée dès la crise économique de 2008 et qui a ensuite explosé de manière définitive avec la question migratoire de 2015. À cela s’ajoutent des difficultés concrètes survenues après la guerre en Ukraine : la forte dépendance énergétique de certains pays envers la Russie rend difficile le désengagement à court terme ; l’insatisfaction des travailleurs du secteur agricole de la Roumanie et de la Pologne face aux canaux préférentiels activés dans le commerce des céréales ukrainiennes ; l’augmentation des prix des loyers et des logements due à l’afflux de réfugiés en Moldavie, etc.
La réalité est que, trois ans après le début de l’invasion, la stratégie de soutien poursuivie par les alliés de Kiev (Europe et États-Unis de Biden) a montré toutes ses limites : les retards dans la livraison des aides, la décision d’exclure toute forme d’intervention directe (dès la zone d’exclusion aérienne initiale), ainsi que la réticence à accorder à l’Ukraine la possibilité d’effectuer des attaques en territoire russe et l’indisponibilité de tracer un chemin clair de l’adhésion du pays agressé à l’OTAN sont tous des éléments qui, probablement, contribuent à modifier la perception que les populations de l’Est ont de l’ordre euro-atlantique. Si pour tous les points susmentionnés, il existe des considérations de risque qui expliquent, et dans de nombreux cas justifient, le « désengagement » de l’Europe et des États-Unis envers l’Ukraine, le revers de la médaille est une perte de poids hégémonique dans divers contextes : du point de vue d’une personne géorgienne, moldave ou même ukrainienne, quelles sont les preuves en ce moment qu’une intégration politique et militaire rapide dans l’espace européen représente une quelconque garantie de sécurité et de développement ? Paradoxalement, la proposition de « pacte social » que Poutine offre sur la scène internationale – une offre qui, clairement, prend les tons et parfois la forme d’une menace et qui propose de renoncer à toute une série de droits civils et politiques en échange d’une relation de protection-subordination au sein de la sphère d’influence de Moscou – risque de rencontrer un véritable consensus chez des pans de plus en plus larges de populations en dehors de la Russie.
Dans la spirale de l’imitation
Dans ces dynamiques s’inscrivent également des tendances de longue date : comme nous l’avons mentionné, c’est au moins depuis 2008 que les relations entre l’Europe occidentale et l’Europe orientale sont en crise et, d’une certaine manière, le modèle démocratique européen en général a souffert d’une baisse de l’investissement politique de la part de la population du continent. Il existe de multiples interprétations des raisons pour lesquelles une telle trajectoire s’est produite : on observe à l’échelle mondiale une capacité croissante des droites populistes à capter l’insatisfaction des laissés-pour-compte, des « perdants » de la mondialisation, mais aussi peut-être à attirer le soutien d’une nouvelle classe capitaliste qui est plus en phase avec un ordre marchand, plus « protectionniste » que « libéral ». Dans son récent livre When Left Moves Right : The Decline of the Left and the Rise of the Populist Right in Postcommunist Europe, l’analyste Maria Snegovaya explique comment dans les pays d’Europe centrale et orientale, tout cela s’est également mélangé à une certaine insatisfaction produite par les complexités des conditions imposées dans les processus d’intégration et à la différente composition sociale par rapport à l’Ouest.
De leur côté, Ivan Krastev et Stephen Holmes, dans The Light that Failed. A Reckoning, suggèrent qu’entre l’Europe occidentale et l’Europe orientale s’est établi un rapport d’« imitation », dans lequel les pays post-communistes ont « copié » avec enthousiasme les modèles et les institutions de leurs homologues, pour ensuite être déçus par les résultats. Cela a engendré des ressentiments qui les ont amenés à rivaliser pour l’identité de « véritables européens ». Orbán, par exemple, a fait sienne cette identité de défenseur des valeurs continentales contre les démocraties libérales en déclin. Ainsi, la Russie de Poutine elle-même, pour se démarquer de la décennie libérale de l’ère Eltsine, s’est de plus en plus engagée dans un défi d’imitation agressive avec l’Occident (ou avec une idée artéfactuelle de l’Occident). Krastev et Holmes écrivent :
« exaspérés par cette exigence impérieuse et vaine que la Russie imite une image idéalisée de l’Occident, les initiés du Kremlin ont décidé d’imiter ce qu’ils percevaient comme les comportements les plus odieux de l’hégémon américain afin de “tendre un miroir” à l’Occident et de montrer à ces prétendus missionnaires à quoi ils ressemblent vraiment une fois leurs prétentions auto-flatteuses retirées. Le “miroir” est une façon pour les imitateurs d’autrefois de se venger de leurs prétendus modèles en révélant les défauts peu attrayants et l’hypocrisie agaçante de ces derniers. Ce qui rend cette rage de démasquer significative, c’est que le Kremlin la poursuit souvent comme une fin en soi, indépendamment des avantages collatéraux que le pays pourrait espérer en tirer, et même à un coût considérable. L’ingérence de la Russie dans les élections présidentielles américaines de 2016, pour en venir à l’exemple le plus frappant de cette approche ironique et provocante du “miroir”, a été interprétée par ses organisateurs et ses auteurs comme une tentative de reproduire ce que le Kremlin considérait comme des incursions injustifiées de l’Occident dans la vie politique de la Russie ».
Dans une logique de ce type, et avec l’imprévisibilité schizophrène donnée par la réélection de Donald Trump, il est évident que la rhétorique – bien qu’à bien des égards obligatoire et non dénuée de sens concret – présentée par Zelensky et par Bruxelles sur la « défense de la démocratie » contre l’autocratie russe risque de révéler toutes ses limites. Aux yeux de nombreuses personnes, pas forcément séduites par le modèle politique de Moscou, le concept de démocratie européenne – surtout au moment où l’Europe se montre peu capable de remettre en question ses propres équilibres et de se reconstruire dans un cadre plus social-démocrate – ne peut que résonner comme un retranchement sur un statu quo sur lequel planait déjà un important fardeau de désillusion et de scepticisme.
D’autre part, la juste opposition à l’invasion entre les mains des élites de plusieurs pays devient de plus en plus un capital symbolique dépensé sur la scène politique pour éviter d’aborder d’autres problèmes : cela se produit avec les oppositions en Géorgie, mais aussi dans certaines occasions avec le gouvernement moldave de Maia Sandu, ainsi que dans une grande partie des débats où l’étiquette de « pro-russe » est attribuée davantage à des fins diffamatoires qu’à partir d’une évaluation substantielle. C’est peut-être aussi ici que se niche l’une des menaces les plus cruciales posées par l’invasion de Poutine : dans le jeu agressif de miroirs et d’imitations mis en place par le Kremlin, l’Europe risque à son tour de refléter et d’imiter certains des comportements les plus rétrogrades de son « adversaire ». On le voit, par exemple, dans l’obsession qui pousse souvent à réduire les votes ou les manifestations de protestation à des phénomènes liés uniquement à la « propagande russe » ou à la « guerre hybride », dans une attitude similaire à la manière dont la Russie parle souvent de « révolutions de couleur » pour discréditer les mouvements de base qui contestent le pouvoir. Ce type de réaction apporte de l’eau au moulin de l’accusation d’hypocrisie – justement au moment où la meilleure défense de la démocratie serait la capacité de réforme et d’autocritique.
Traduit de l’italien par Giuseppe Cocco
L’article La terre tremble autour du front est apparu en premier sur multitudes.
- GÉNÉRALISTES
- Ballast
- Fakir
- Interstices
- Lava
- La revue des médias
- Le Grand Continent
- Le Monde Diplo
- Le Nouvel Obs
- Lundi Matin
- Mouais
- Multitudes
- Politis
- Regards
- Smolny
- Socialter
- The Conversation
- UPMagazine
- Usbek & Rica
- Le Zéphyr
- CULTURE / IDÉES 1/2
- Accattone
- Contretemps
- A Contretemps
- Alter-éditions
- CQFD
- Comptoir (Le)
- Déferlante (La)
- Esprit
- Frustration
- IDÉES 2/2
- L'Intimiste
- Jef Klak
- Lignes de Crêtes
- NonFiction
- Nouveaux Cahiers du Socialisme
- Période
- Philo Mag
- Terrestres
- Vie des Idées
- Villa Albertine
- THINK-TANKS
- Fondation Copernic
- Institut La Boétie
- Institut Rousseau
- TECH
- Dans les algorithmes
- Framablog
- Goodtech.info
- Quadrature du Net
- INTERNATIONAL
- Alencontre
- Alterinfos
- CETRI
- ESSF
- Inprecor
- Journal des Alternatives
- Guitinews
- MULTILINGUES
- Kedistan
- Quatrième Internationale
- Viewpoint Magazine
- +972 mag
- PODCASTS
- Arrêt sur Images
- Le Diplo
- LSD
- Thinkerview
- Fiabilité faible
- Contre-Attaque
- Issues
- Korii
- Positivr
- Regain
- Slate
- Ulyces