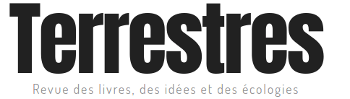18.03.2025 à 11:20
Marx, année zéro : vivre en communiste chez les Indiens
Michael Löwy
Que vous détestiez Marx parce qu'il incarne le prototype du théoricien dogmatique ou que vous voyiez en lui un penseur incontournable pour saisir notre modernité, ce livre est fait pour vous ! Dans un roman passionnant, « Marx en Amérique », Christian Laval conçoit une histoire alternative : et si Marx n’était pas mort en 1883 à Londres ? Laval imagine un Marx réinventant complètement sa vie et sa philosophie en allant s’installer chez les Indiens sénécas…
L’article Marx, année zéro : vivre en communiste chez les Indiens est apparu en premier sur Terrestres.
Texte intégral (3152 mots)
Temps de lecture : 7 minutes
Introduction à l’ouvrage de Christian Laval, Marx en Amérique (Champ Vallon, 2025), suivie d’un extrait.

Voici un livre étonnant, hors du commun. À la fois roman, récit ethnographique et manifeste politique, il nous propose un autre Marx, un Marx communiste, certes, mais très éloigné du partisan du progrès et des forces productives de certains écrits très (trop) connus. L’auteur s’appuie, certes, sur ses Cahiers de Notes Ethnographiques, sur ses dernières lettres sur la Russie, mais il s’agit quand même d’un Marx inconnu, produit de l’imagination romancière.
Marx se rend aux États-Unis et devient l’ethnologue d’une communauté indienne
Le sociologue Christian Laval nous propose un Marx, qui, après avoir organisé en 1883 un faux enterrement, avec la complicité de ses filles et de Friedrich Engels, part en Amérique pour rencontrer les Iroquois dont parlait si bien l’anthropologue américain Lewis Morgan (1818-1881). Déguisé en George Tullok, ethnologue anglais d’origine germanique, il découvre au village de Tecumseh, dans l’État de New York, une communauté de Senecas, derniers descendants de la Confédération des Iroquois, qui luttent pour garder leurs traditions communistes, démocratiques et solidaires. Fasciné par cette expérience de « communisme concret », Marx finit par s’intégrer dans cette communauté, par épouser White Wing, une institutrice veuve, et par prendre une nouvelle identité : le Seneca Clever Fox. Sa solidarité avec les Iroquois va même le conduire à faire sauter le bureau d’une entreprise de spéculation foncière responsable de l’expropriation des terres indigènes : « la dynamite, voilà l’ultime arme de la critique »…
Fasciné par cette expérience de « communisme concret », Marx finit par s’intégrer dans une communauté issue de la Confédération des Iroquois, qui luttent pour garder leurs traditions communistes, démocratiques et solidaires.
Ce nouveau Marx reçoit après quelques années la visite de son ami Engels, qui l’accuse d’être devenu rousseauiste, et de sa fille Eleanor (« Tussy ») qui le compare à son ami William Morris. Devant sa fille, « Clever Fox » se livre à un bilan auto-critique : j’ai cru, dit-il, que la liberté passait par l’esclavage du capital, j’ai même osé parler de la « grande influence civilisatrice du capital » et du rôle révolutionnaire de la colonisation anglaise de l’Asie. Sa nouvelle conception de l’histoire est inspirée d’un célèbre passage de Morgan : « la nouvelle société de l’avenir sera une résurrection, sous une forme supérieure, de la liberté, égalité, fraternité des anciennes gentes ».

Rêvant d’une nouvelle Confédération de tous les autochtones de l’Amérique du Nord, et, pourquoi pas, de toutes les nations du monde, le vieux Clever Fox décide, à la fin du siècle, de mettre fin à ses jours en plongeant dans les chutes du Niagara. Dans un « Cahier de notes » (imaginaire) à la fin du livre, Marx explique sa nouvelle conception dialectique de l’histoire, en rupture avec l’idéologie bourgeoise du progrès : on doit revenir en arrière pour aller de l’avant. Le communisme est un mouvement backforward, un principe antérieur élevé à un niveau supérieur.
L'infolettre des Terrestres
Toutes les deux semaines, dans votre boîte mail : un éditorial de la rédaction, le résumé de nos dernières publications, un conseil de lecture des Terrestres et des articles tirés de nos archives, en écho à l'actualité.
Un des aspects les plus intéressants – et actuels – du livre sont les réflexions de Marx sur la dimension « écologique » du mode de vie des Iroquois : le respect pour la nature, l’amour pour la Terre mère, un rapport non-propriétaire au monde, la solidarité avec tous les êtres vivants, bref, un « communisme du vivant » aux antipodes de la culture de la rapine, du gaspillage et du vandalisme de la modernité capitaliste.
Comment passer de l’expérience de vie de cette petite communauté seneca (300 âmes) à une transformation de toute la société ? Marx, ou « Clever Fox », n’a pas de réponse, mais suggère que les tentatives communistes doivent se concevoir comme des éléments d’une stratégie d’ensemble, qui combine l’expérimentation locale et la révolution.
Lire aussi sur Terrestres : Michael Löwy, « Marx, prophète de la décroissance ? », décembre 2024.
« On va ainsi de l’avenir au passé pour repartir vers l’avenir »
Le passage qui suit est un extrait de « Marx en Amérique » (pp. 355-357). L’ouvrage se termine par un cahier imaginaire de Marx intitulé « Notes sur la démocratie communiste des Iroquois ». Dans ces pages, Marx reconnaît s’être trompé dans sa philosophie de l’histoire, linéaire et téléologique, et esquisse une auto-critique de ses propres thèses à la lumière des travaux de l’anthropologue américain Lewis Morgan qu’il avait lu attentivement.
L’erreur partait d’une idée juste selon laquelle le capital dans son développement continu allait détruire toutes les bases antérieures de la société en les intégrant dans son propre mouvement, et par cette intégration, les transformer radicalement en conditions de son propre développement. Car telle est sa force, qui est de poser sans cesse les conditions de son propre élargissement en disposant de ce qui existe et en le rendant « utile ». L’ancien monde était conservé parfois, mais rarement, comme vestige inutile et plus souvent comme dimension de l’accumulation du capital mais sous une forme méconnaissable.
À cela, j’ajoutais le point décisif, qui tranchait avec toute la pensée bourgeoise du progrès, que ce mouvement même qui consiste à poser les conditions d’une accumulation toujours plus vaste n’était jamais en même temps que le mouvement de poser les conditions de sa propre fin, pas seulement par la répétition de crises toujours plus profondes mais par l’existence d’un prolétariat toujours plus nombreux et conscient qui porterait en lui, comme le capital de l’autre côté, la puissance de poser les conditions de sa victoire. Tout ceci passait par pertes et profits ce qui dans les anciennes sociétés était pourtant comme le dit Morgan le germe de la démocratie souhaitable. Mais comment pouvait-on croire comme je l’ai fait longtemps qu’en détruisant le monde ancien le capital aurait la bonté et la vertu d’accoucher d’un monde meilleur, alors que tout laisse à penser maintenant qu’il ne peut donner qu’un monde bien pire sous beaucoup d’aspects ? Il ne s’agit d’ailleurs pas ici de plus et de moins, ni de bien et de mal. Mais d’être et de non être. C’est bien ce que dit Morgan si on le lit bien. La propriété dissout la société, elle conduit au pur et simple chaos, à la destruction de ce qui fait l’humanité.
Comment pouvait-on croire comme je l’ai fait longtemps qu’en détruisant le monde ancien le capital aurait la bonté et la vertu d’accoucher d’un monde meilleur ?
Morgan remet tout en place quand il écrit que la société future naîtra d’une « reviviscence » des anciens modes de vie. C’est lumineux. Ce n’est pas la propriété qui engendre la non- propriété directement, c’est la non-propriété qui engendrera la non-propriété par un sursaut révolutionnaire de ce qui ne veut pas mourir.
L’histoire ne va pas en ligne droite, pas en zigzag non plus, elle suit un étrange mouvement, assez complexe il faut bien le dire : on doit revenir en arrière pour aller plus loin en avant. Avant-arrière, arrière-avant. C’est le « retour-avant », le « Fore-return » ou le « Vor-Rückkehr ». C’est une dialectique qui n’a rien à voir avec les jeux de mots à la Hegel, ce n’est pas de la spéculation, ce sont les processus réels. J’avais vu ça il y a longtemps lorsque j’avais écrit quelques pages sur la Révolution française, je m’étais surtout moqué de ces bourgeois qui se prenaient pour Périclès, Caton ou Cicéron. Je n’avais pas com- pris encore la nécessité et l’universalité du « retour-avant ». Les Russes me l’ont fait comprendre par leurs questionnements et leurs angoisses : « faut-il attendre le plein développe- ment du capitalisme pour espérer une révolution socialiste ? » Malheureusement en dépit de ce que j’ai un peu maladroitement essayé de leur expliquer, les meilleurs se sont ralliés à un « marxisme » amoureux du capital ! Engels me l’a confirmé.
Il n’y a pas de révolution qui n’effectue cet étrange retour en arrière non pour se figer dans le passé (là elle échoue) mais pour relancer sous une forme différente, améliorée, ce qu’il y avait de mieux dans le passé.
Échec donc. Mais en y réfléchissant plus longuement, je me suis aperçu que les héros de la Commune de Paris avaient aussi suivi la dialectique du « retour-avant », en se replongeant dans les vieilles traditions de l’autonomie communale contre l’État centralisateur, ils ont réellement inventé quelque chose de nouveau. Tout colle : il n’y a pas de révolution qui n’effectue cet étrange retour en arrière non pour se figer dans le passé (là elle échoue) mais pour relancer sous une forme différente, améliorée, « supérieure » dit Morgan, ce qu’il y avait de mieux dans le passé, ce qu’on veut sauver, ce qu’on veut prolonger et étendre. On va ainsi de l’avenir au passé pour repartir vers l’avenir. Avancer en régressant, marcher en reculant. Hegel avait eu l’intuition de ça sans doute, comme de bien d’autres choses, mais il n’a pas été jusqu’à faire l’analyse des « retours- avant » comme il faudrait la faire. C’est ce que font les Red Guns [les indiens], certes dans les conditions les plus défavorables : un « retour-avant », concept clé de la dialectique du temps, si j’ai le temps de la rédiger (ce qui m’étonnerait car j’ai bien d’autres choses à faire ou à ne pas faire !). […] »

Lire aussi sur Terrestres : Kai Heron, « La sortie du capitalisme en débat chez les écosocialistes », mai 2024.
Photo d’ouverture : réplique d’une maison sénéca en construction sur le site historique de l’État de Ganondagan New York, 1997. Crédits : Peter Flass, CC BY 4.0.

SOUTENIR TERRESTRES
Nous vivons actuellement des bouleversements écologiques inouïs. La revue Terrestres a l’ambition de penser ces métamorphoses.
Soutenez Terrestres pour :
- assurer l’indépendance de la revue et de ses regards critiques
- contribuer à la création et la diffusion d’articles de fond qui nourrissent les débats contemporains
- permettre le financement des trois salaires qui co-animent la revue, aux côtés d’un collectif bénévole
- pérenniser une jeune structure qui rencontre chaque mois un public grandissant
Des dizaines de milliers de personnes lisent chaque mois notre revue singulière et indépendante. Nous nous en réjouissons, mais nous avons besoin de votre soutien pour durer et amplifier notre travail éditorial. Même pour 2 €, vous pouvez soutenir Terrestres — et cela ne prend qu’une minute..
Terrestres est une association reconnue organisme d’intérêt général : les dons que nous recevons ouvrent le droit à une réduction d’impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant. Autrement dit, pour un don de 10€, il ne vous en coûtera que 3,40€.
Merci pour votre soutien !
L’article Marx, année zéro : vivre en communiste chez les Indiens est apparu en premier sur Terrestres.
22.02.2025 à 10:50
Repenser le travail pour contrer l’exploitation des vivants
Mireille Bruyère
Le capitalisme exploite le travail des humains... et des non-humains. Une transformation radicale du travail est donc nécessaire, soutient le philosophe Paul Guillibert, qui appelle à une alliance entre anticapitalistes, antiracistes et écologistes pour un « communisme du vivant ». Comment faire communauté autour de l’autonomie et de la subsistance dans un monde désormais majoritairement urbain ?
L’article Repenser le travail pour contrer l’exploitation des vivants est apparu en premier sur Terrestres.
Texte intégral (5329 mots)
Temps de lecture : 13 minutes
À propos de l’ouvrage de Paul Guillibert, « Exploiter les vivants : une écologie politique du travail », paru en 2023 aux Éditions Amsterdam.
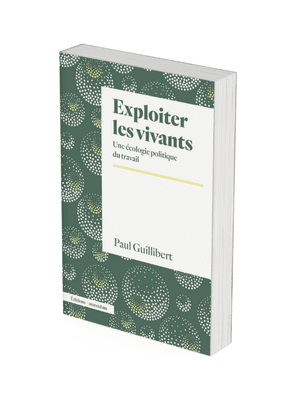
Le dernier ouvrage du philosophe Paul Guillibert, « Exploiter les vivants : une écologie politique du travail », est présenté par l’auteur comme une suite exploratoire de son premier livre, « Terre et capital, pour un communisme du vivant » publié aux mêmes Éditions Amsterdam en 2021. Dans ce nouveau livre, Paul Guillibert se propose d’éclairer avec les moyens de la philosophie marxienne les conditions d’une alliance anticapitaliste entre la classe ouvrière et les mouvements écologistes. Il s’agit de « repolitiser le travail en écologie politique » (p. 199) – et, pourrait-on ajouter, de « repolitiser l’écologie politique par le travail ».
Construire une écologie politique du travail
En philosophe rigoureux, l’auteur ne cherche pas la construction théorique d’une nouvelle classe révolutionnaire au sens marxien du terme, dans la mesure où tous les humains et non-humains dominés par le capitalisme ne sont pas à la même place, ne tiennent pas le même rôle dans le rapport de production et de reproduction capitaliste. Tous ces différents groupes dominés ne peuvent donc pas être une « classe en soi », car ils n’ont pas les mêmes intérêts matériels et économiques. Leur alliance repose alors sur une analyse théorique fondée sur les concepts marxiens que sont l’exploitation, l’appropriation et l’aliénation, depuis les différentes positions des dominés. Le livre est une tentative de les relier dans le concept plus général d’« exploitation du vivant », qui prend le statut de mot d’ordre fédérateur et d’aiguillon d’une nouvelle alliance universelle anticapitaliste, antiraciste et écologiste.
L'infolettre des Terrestres
Toutes les deux semaines, dans votre boîte mail : un éditorial de la rédaction, le résumé de nos dernières publications, un conseil de lecture des Terrestres et des articles tirés de nos archives, en écho à l'actualité.
Pour parvenir à cette proposition, l’auteur présente un arpentage de la majorité des approches de l’écologie politique et de l’anticapitalisme. Sa capacité à les exposer de manière claire, rigoureuse et synthétique est indiscutablement la grande force de ce livre, qui pourrait compter comme un ouvrage de référence destiné à celles et ceux qui souhaitent découvrir ou approfondir la connaissance des liens entre l’écologie politique et le marxisme. La plume de Paul Guillibert n’est jamais polémique : il discute avec honnêteté les limites de chaque proposition, non pas en elle-même mais dans sa capacité à s’articuler à d’autres propositions théoriques.
L’auteur prend comme point de départ les deux grandes impasses actuelles de l’écologie, qu’il cherche à dépasser. La première tient à l’espérance du salut dans le technosolutionnisme. La deuxième, nommée « écologie domestique » et destinée à réussir la transition écologique, en appelle presque exclusivement à l’éthique individuelle. Il présente ensuite succinctement la majorité des courants de l’écologie politique qu’il synthétise par un arbre des pensées de l’écologie humaine (p. 36). C’est en parcourant toutes les branches de cet arbre avec les outils de la critique marxiste que Paul Guillibert tente de construire une « écologie politique du travail ».
Lire aussi sur Terrestres : Frédéric Keck, « Animaux de tous les pays, unissez-vous ! », mars 2024.
L’ouvrage est divisé en trois chapitres. Le premier expose les différentes théories critiques du capitalisme susceptibles de nous éclairer sur les causes profondes de l’écocide en cours. Citant Éric William, un penseur marxiste : « Pas une seule brique de la ville de Bristol n’a été façonnée sans le sang d’un esclave » (p. 52), il part du constat que l’exploitation ouvrière dans les pays occidentaux est complémentaire de l’esclavage et du colonialisme.
Pour autant, l’auteur estime que le concept de plantationocène de Donna Haraway et Anna Tsing est bien trop englobant et homogène pour saisir toute la diversité des modes d’aliénation et d’exploitation du capitalisme. Il s’appuie sur les approches féministes et écoféministes sur le travail de reproduction pour considérer l’économie comme une activité scindée en deux sphères distinctes et inséparables, condition l’une de l’autre : celle du travail majoritairement masculin, producteur de valeur économique, et celle du travail majoritairement féminin dit de « reproduction », à l’intérieur de l’espace domestique ou bien dans des espaces domesticisés. Alors que nombre de propositions féministes interprètent la séparation entre espace productif et espace reproductif comme une technique de pouvoir, pour les écoféministes du courant de la subsistance, le travail dit de « reproduction » est un des lieux privilégiés de la résistance au capitalisme et de la construction de l’autonomie matérielle et politique, d’entretien et soin du vivant. Ce travail perd ainsi la connotation négative d’un travail seulement aliénant, dominé, et contraire à l’émancipation. L’auteur en déduit que le dépassement de la dualité entre production et reproduction ouvre des « voies normatives plus concrètes en termes de réorganisation de la vie quotidienne ».

Au terme de cette partie, Paul Guillibert présente le capitalisme comme un double processus : l’exploitation du travail salarié, et l’appropriation du travail de reproduction et des forces naturelles. Il s’agit alors de « réintégrer la critique des forces productives dans la critique du capital », au sens où l’analyse marxiste doit dépasser la seule critique de l’exploitation du travail en l’intégrant dans une approche plus large du capital. Quant au capital, il est entendu comme rapport social total incluant un rapport au travail comme exploitable et source de valeur et un rapport à la nature comme appropriable et sans valeur (p. 79).
La nature travaille-t-elle ? Redéfinir le travail
La deuxième partie du livre se penche plus précisément sur le concept de travail, central dans le champ marxiste afin de construire un pont entre critique des forces productives et critique du capital. L’auteur passe en revue de nombreuses contributions en commençant par rappeler que le concept de travail défini comme activité séparée et élargie à la production de tous les besoins sociaux est une invention de la modernité. Il propose de définir le travail moderne dans le capitalisme comme une activité pénible, technique, fondée sur la division du travail, marque de la modernité capitaliste. En effet, le travail défini comme simple activité technique et pénible existe dans d’autres sociétés que les sociétés capitalistes.
Pour Paul Guillibert, on peut parler de mise au travail de certaines espèces ou de certains processus d’engendrement de la nature. Mais on ne peut pas dire que la nature dans son ensemble travaille.
Le propre du capitalisme étant de séparer le travail du reste des activités humaines, le travail est inséparable de la division du travail. Celle-ci est une conséquence de l’appropriation privée des moyens de production. Cette définition permet à Paul Guillibert d’affirmer que les animaux de l’élevage agro-industriel travaillent, et que l’on peut parler de mise au travail de certaines espèces ou de certains processus d’engendrement de la nature (p85). Par contre, on ne peut pas aller jusqu’à dire, à l’instar de Jason Moore1, que la nature dans son ensemble travaille.
Cette clarification posée, l’auteur se met à distance de deux propositions théoriques du rapport entre humains et non-humains qu’il estime être des impasses stratégiques : d’une part l’antispécisme, qui se cantonne à une dénonciation morale et non politique, et d’autre part les philosophies du vivant, qui postulent la primauté du concept « vivant » et écrasent la dimension politique de l’écologie.
Lire aussi sur Terrestres : Paul Guillibert, « Jason W. Moore, cosmologie révolutionnaire et communisme de la vie », mai 2024.
Pour lui, la mise au travail du vivant et l’appropriation de la nature par le capitalisme procèdent d’une subsomption réelle en ce sens qu’elle change profondément la manière dont la dynamique productive du vivant et de la nature fonctionnent pour en tirer le maximum de productivité. Par exemple, la modification de la vie à l’échelle de l’ADN « marque une rupture historique dans les formes d’appropriation ». L’auteur note pertinemment que le maïs transgénique MON810 de Monsanto, qui modifie profondément les processus d’engendrement du vivant, suppose conjointement des appareillages et connaissances scientifiques poussées issues du privé, et des droits de propriété sur ce vivant nouvellement engendré. C’est par cette subsomption réelle et surtout totale de la nature que le capitalisme se définit. Ce parcours permet à Paul Guillibert de proposer une cartographie et un schéma des usages productifs de la nature (p. 130) afin d’identifier la spécificité des usages capitalistes.
Grève, communs et décroissance : les piliers du « communisme du vivant »
La troisième partie de l’ouvrage explore les pistes et les stratégies possibles d’émancipation des humains et du vivant hors des griffes du capitalisme. L’auteur propose pour cela une écologie de la classe ouvrière qui repose sur trois piliers, trois praxis : la grève, les communs et la décroissance. L’articulation de ces trois piliers constitue ce qu’il appelle le « communisme du vivant ».
Contre les écomodernistes marxistes comme le géographe étasunien Matt Huber, l’auteur estime à juste titre que la décroissance de la production et de la consommation est une dimension incontournable de l’émancipation et que le communisme ne peut être qu’un « communisme de la décroissance » (p. 154), ainsi que le formule l’économiste japonais Kohei Saito. Cette décroissance n’est pas principalement quantitative, elle est d’ordre structurel : c’est une « transformation radicale de l’organisation du travail » (p. 155).

La transition serait alors engagée moyennant le maintien de revenus de transition pour les travailleurs des secteurs en décroissance et durant le temps pendant lequel que la sphère de la subsistance et de l’autonomie se développe. Cependant, cette proposition stratégique, qui n’est pas neuve, est présentée trop rapidement. Elle reste prise dans une contradiction difficile à lever : comment faire décroître la production si on maintient des niveaux de revenus qui soutiennent la consommation ? Certes, l’auteur espère que la baisse nécessaire et drastique des hauts revenus va contribuer à la baisse de la production des biens les plus artificiels et polluants, mais nous savons que cela ne sera pas suffisant en termes de limites écologiques. En effet, la décroissance ne peut pas se limiter à un changement dans la répartition des revenus car ce sont aussi les modes de vies de la classe moyenne qui sont actuellement fondés sur des logiques productives insoutenables.
Comment imaginer que l’État acceptera de piloter une baisse de la production et de démanteler des infrastructures qui sont à la source de son pouvoir ?
C’est là que se trouve la principale limite de ce livre : l’auteur entend extraire des pistes stratégiques à partir de la théorie, alors même que la sortie du capitalisme nécessite une transformation radicale, voire révolutionnaire, des institutions. Or, cette transformation ne saurait être une simple technique, ni la mise en application d’une feuille de route. Elle est création du nouveau non réductible à un processus stratégique : c’est une praxis instituante. Comme le formule Cornelius Castoriadis, elle est ce « faire dans lequel l’autre ou les autres sont visés comme autonomes et considérés comme l’agent essentiel du développement de leur propre autonomie2 ». Les mots de « fins » et de « moyens » comme moments séparés sont impropres quand il s’agit de praxis. Cette séparation entre fin et moyens appartient à l’activité technique qui vise une fin posée à l’avance, une « fin finie et définie3 ». La praxis, seule forme possible de l’activité politique, est commencement. Elle s’appuie sur un savoir fragmentaire et surtout provisoire car la praxis, pour nous – les mouvements et les luttes anticapitalistes et écologistes –, « fait surgir constamment un nouveau savoir, car elle fait parler le monde dans un langage à la fois singulier et universel4 ».
Lire aussi sur Terrestres : Geveviève Azam, « Planification écologique : frein d’urgence ou administration de la catastrophe ? », septembre 2023.
Conscient de la difficulté de proposer une alliance autour du mot d’ordre de « décroissance », Paul Guillibert propose le mot d’ordre de « communisme du vivant », plus positivement connoté. Ce « communisme du vivant » est une « cosmologie qui insère la lutte des classes dans les mondes vivants dont elle dépend, une politique de la vie ou une biopolitique par en bas contre la croissance illimitée du profit » (p. 175).
Il s’agit d’une transition « civilisationnelle et pas seulement économique ou énergétique », qui, au vu de notre héritage infrastructurel, nécessite selon l’auteur une dose de planification étatique, un « moment étatique » (p. 175).
La démarche purement philosophique de l’auteur trouve certainement ici une de ses limites. Conscient que la construction théorique du mot d’ordre de l’alliance est insuffisante en soi, il est poussé à faire des propositions stratégiques qui ne peuvent donc avoir qu’une nature technique éloignée de la praxis. Il est vrai en logique, déduite de la théorie, que la transition vers le communisme du vivant nécessite un moment de planification de taille nationale et donc étatique. Mais comment imaginer en réalité un tel moment ? Comment imaginer que l’État acceptera de piloter une baisse de la productivité, de la production, de démanteler des infrastructures inutiles, de permettre la réappropriation commune des moyens de production et donc finalement de baisser la masse totale des revenus alors que ces revenus et ses infrastructures sont la source de son pouvoir ? Ils lui permettent de payer ses fonctionnaires, ses policiers, ses élus, ses militaires… tous nécessaires à sa puissance et à sa raison d’être.
Une alliance politique ne peut pas être seulement la conséquence de la prise de conscience des causes communes de l’exploitation et de l’aliénation.
Si on peut imaginer que le rapport de force au sein des institutions du capitalisme peut conduire à infléchir les politiques publiques vers plus de solidarité, de réduction des inégalités, de protection des plus faibles, en revanche cet infléchissement s’arrête au seuil de la décroissance économique, la croissance étant la source de la puissance de ces institutions.
Si la décroissance est incontournable, elle ne peut pas se penser dans un moment étatique mais plutôt dans un moment révolutionnaire, comme une fracture institutionnelle venant ouvrir des possibles, laisser se développer des fragments, des germes du communisme du vivant avec un État en recul, en décomposition, en déconcentration, en crise, un moment d’État ingouvernable plutôt qu’en planification nationale. C’est la condition pour laisser l’espace à l’inouï, à l’imprévisible qu’est la décroissance matérielle dans un monde porté depuis trois siècles par l’imaginaire de l’expansion illimitée.
Comment penser les alliances politiques entre des groupes éloignés ?
Dans sa conclusion, Paul Guillibert appelle à un rapprochement entre luttes ouvrières, luttes écologiques et luttes anticoloniales et antiracistes. Cet arpentage théorique contribue à clarifier les débats et les controverses qui traversent les mouvements de contestation. Cela permet de dépasser l’opposition superficielle entre l’exploitation ouvrière et la destruction de la nature. En ce sens, c’est un livre utile pour les luttes écologiques anticapitalistes.
Mais ce travail théorique n’est pas suffisant pour contribuer à forger les collectifs, les communautés qui défendront le « communisme du vivant ». Comme le pointe l’auteur dans sa conclusion, ce projet politique est vain sans constitution d’une nouvelle communauté politique qui le porte.
Une alliance politique ne peut pas être seulement la conséquence de la prise de conscience des causes communes de l’exploitation et de l’aliénation. La communauté politique n’émerge pas, n’est pas la conséquence d’un effort de théorisation mais d’une praxis dont l’effort de théorisation n’est qu’une dimension, souvent limitée.
Pour reprendre la célèbre phrase de Marx, « les philosophes n’ont fait qu’interpréter le monde, il s’agit de la transformer ». Il pourrait être utile de faire un pas de plus et penser aussi les conditions d’une praxis instituante de cette communauté politique, une praxis « comme expression même de l’action émancipatrice », ainsi que le formulait Marx.

C’est au cœur d’une praxis qui articule les pratiques des militants écologiques, les luttes ouvrières et les expérimentations d’alternatives et d’autonomie de subsistance que pourra naître cette nouvelle communauté. Or, relier théorie et pratique nécessite un territoire, un sol à taille humaine, et pas seulement une carte stratégique afin que cette relation devienne une réalité sensible, incarnée, un chemin de transformation et de création qui se sédimente dans les corps par l’expérience.
C’est une autre limite de ce livre qui se propose de trouver les concepts de l’alliance. Le territoire d’une praxis ne peut pas être trop grand sans perdre la possibilité d’une action transformatrice réelle et radicale. Dans la conclusion, l’auteur déplore « l’absence de solidarité contre l’opération Wuambushu5 dans un contexte de radicalisation écologiste et de forte mobilisation sociale » (p. 196). On peut le rejoindre sur la dénonciation de cette opération abjecte et raciste, aussi nécessaire que la dénonciation des opérations de répression policière de la lutte contre l’autoroute A69 Toulouse-Castres. Cette dénonciation est nécessaire, pas seulement pour une question morale mais parce que, ainsi que Paul Guillibert le montre clairement dans son livre, ce qui se passe à Mayotte a un lien avec ce qui se passe sur le tracé de l’A69.
Comment développer la décroissance, l’autonomie et la subsistance, alors même que plus de 80 % de la population française vit dans une ville ?
Mais cette dénonciation pose question : comment, alors que les habitants concernés vivent sur deux territoires si éloignés, faire émerger une alliance et une communauté politique concrète ? Certes, les luttes lointaines sont des sources d’inspirations incontournables pour les luttes locales. Mais « inspiration » n’est pas synonyme d’« alliance stratégique concrète ». Les luttes nécessitent une socialisation politique réelle, physique, immédiate et sensible qui dépasse le moment d’inspiration et d’imaginaire. C’est la force matérielle du capitalisme que d’être capable d’aliéner à la même logique autant de groupes humains et non humains si éloignés, limitant de fait les alliances pratiques et durables et les communautés politiques de résistance.
Même au sein du territoire de la métropole déjà vaste, les alliances concrètes butent sur la distance géographique et l’inscription dans le territoire du capitalisme, modelé par la métropolisation qui sépare les groupes sociaux et les moments sociaux. Nous savons qu’il faut faire ces alliances. Mais l’obstacle n’est pas d’ordre philosophique, il est d’ordre matériel. Comment développer la décroissance, l’autonomie et la subsistance, alors même que plus de 80 % de la population française vit dans une ville ? Alors que l’urbanisation est le phénomène le plus massif du capitalisme moderne ?
Personne ne peut y répondre globalement, juste donner quelques pistes, quelques jalons théoriques possibles à la praxis des luttes et des expérimentations. Lu en ce sens modeste, le livre de Paul Guillibert est très utile.
Image d’accueil : Femmes triant et classant des pêches pour la vente au marché, Ontario, Canada, 1986. Wikimedia commons.

SOUTENIR TERRESTRES
Nous vivons actuellement des bouleversements écologiques inouïs. La revue Terrestres a l’ambition de penser ces métamorphoses.
Soutenez Terrestres pour :
- assurer l’indépendance de la revue et de ses regards critiques
- contribuer à la création et la diffusion d’articles de fond qui nourrissent les débats contemporains
- permettre le financement des trois salaires qui co-animent la revue, aux côtés d’un collectif bénévole
- pérenniser une jeune structure qui rencontre chaque mois un public grandissant
Des dizaines de milliers de personnes lisent chaque mois notre revue singulière et indépendante. Nous nous en réjouissons, mais nous avons besoin de votre soutien pour durer et amplifier notre travail éditorial. Même pour 2 €, vous pouvez soutenir Terrestres — et cela ne prend qu’une minute..
Terrestres est une association reconnue organisme d’intérêt général : les dons que nous recevons ouvrent le droit à une réduction d’impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant. Autrement dit, pour un don de 10€, il ne vous en coûtera que 3,40€.
Merci pour votre soutien !
Notes
- Jason W. Moore, Le capitalisme dans la toile de la vie : écologie et accumulation du capital, traduit par Robert Ferro, Les Éditions de l’Asymétrie, 2020.
- Cornelius Castoriadis, L’institution imaginaire de la société, Seuil, 1975, p. 103.
- Ibid, p. 104
- Ibid.
- Opération policière et coloniale de l’État français à Mayotte en avril 2023.
L’article Repenser le travail pour contrer l’exploitation des vivants est apparu en premier sur Terrestres.
01.02.2025 à 17:38
L’utopie capitaliste
Quinn Slobodian
Terrestres organise une conférence publique à Paris le 1 février avec le spécialiste américain du néolibéralisme Quinn Slobodian, auteur du livre "Le capitalisme de l’apocalypse". Alors que le retour de Trump s'annonce comme une radicalisation des pathologies du néolibéralisme, de quelle idéologie est-il porteur ? Sommes-nous déjà entrés dans une ère post-néolibérale ?
L’article L’utopie capitaliste est apparu en premier sur Terrestres.
Texte intégral (988 mots)
Temps de lecture : 2 minutes
Depuis une décennie, le thème de la sécession des riches a émergé dans certains discours politiques et médiatiques. Mais avons-nous une idée précise de ce que signifie ce mouvement ? Si nous savons par expérience directe et par connaissance historique que le capitalisme se renouvelle périodiquement pour poursuivre sa quête infinie de croissance, un mouvement souterrain depuis quarante ans a échappé à la plupart des observateurs.
Parallèlement à la globalisation, il existe une tendance du capitalisme contemporain à faire « sécession » à travers la multiplication des « enclaves » économiques : l’objectif est de se fortifier en se mettant à l’abri de tout contrôle démocratique. Alors que le retour de Trump s’annonce comme une radicalisation des pathologies du néolibéralisme, de quelle idéologie est-il porteur ? Sommes-nous déjà entrés dans une ère post-néolibérale ? Faut-il voir dans l’offensive libertarienne actuelle la mise en place d’un plan coordonné visant à convertir les principaux pays occidentaux à un néofascisme brutalement conquérant ? La victoire politique de Trump et des radicaux du marché annonce-t-elle la mise en place d’une oligarchie assumant une voie autoritaire et précipitant le monde dans une ère post-démocratique ?
La rencontre aura lieu le 1er février 2025 de 17h à 19h, à l’Académie du climat, 2 place Baudoyer 75004 Paris. Entrée libre.
L’entretien sera traduit par l’écrivaine Miranda Richmond Mouillot, animé par les chercheuses et chercheur Haud Guéguen, Fulvia Giachetti, Matilde Ciolli, Jeanne Etelain et Pierre Sauvêtre, membres du Groupe d’études sur le néolibéralisme et les alternatives.
Quinn Slobodian est professeur d’histoire internationale à la Frederick S. Pardee School of Global Studies de l’université de Boston. Site web : https://www.quinnslobodian.com/
Lire sur Terrestres la recension du livre de Quinn Slobodian par Haud Guéguen, « Quand le capitalisme fait sécession », avril 2024.


SOUTENIR TERRESTRES
Nous vivons actuellement des bouleversements écologiques inouïs. La revue Terrestres a l’ambition de penser ces métamorphoses.
Soutenez Terrestres pour :
- assurer l’indépendance de la revue et de ses regards critiques
- contribuer à la création et la diffusion d’articles de fond qui nourrissent les débats contemporains
- permettre le financement des deux salaires qui co-animent la revue, aux côtés d’un collectif bénévole
- pérenniser une jeune structure qui rencontre chaque mois un public grandissant
Des dizaines de milliers de personnes lisent chaque mois notre revue singulière et indépendante. Nous nous en réjouissons, mais nous avons besoin de votre soutien pour durer et amplifier notre travail éditorial. Même pour 2 €, vous pouvez soutenir Terrestres — et cela ne prend qu’une minute..
Terrestres est une association reconnue organisme d’intérêt général : les dons que nous recevons ouvrent le droit à une réduction d’impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant. Autrement dit, pour un don de 10€, il ne vous en coûtera que 3,40€.
Merci pour votre soutien !
L’article L’utopie capitaliste est apparu en premier sur Terrestres.
- GÉNÉRALISTES
- Ballast
- Fakir
- Interstices
- Issues
- Korii
- Lava
- La revue des médias
- Mouais
- Multitudes
- Positivr
- Regards
- Slate
- Smolny
- Socialter
- UPMagazine
- Le Zéphyr
- Idées ‧ Politique ‧ A à F
- Accattone
- À Contretemps
- Alter-éditions
- Contre-Attaque
- Contretemps
- CQFD
- Comptoir (Le)
- Déferlante (La)
- Esprit
- Frustration
- Idées ‧ Politique ‧ i à z
- L'Intimiste
- Jef Klak
- Lignes de Crêtes
- NonFiction
- Nouveaux Cahiers du Socialisme
- Période
- ARTS
- Villa Albertine
- THINK-TANKS
- Fondation Copernic
- Institut La Boétie
- Institut Rousseau
- TECH
- Dans les algorithmes
- Framablog
- Gigawatts.fr
- Goodtech.info
- Quadrature du Net
- INTERNATIONAL
- Alencontre
- Alterinfos
- CETRI
- ESSF
- Inprecor
- Journal des Alternatives
- Guitinews
- MULTILINGUES
- Kedistan
- Quatrième Internationale
- Viewpoint Magazine
- +972 mag
- PODCASTS
- Arrêt sur Images
- Le Diplo
- LSD
- Thinkerview