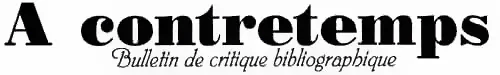23.06.2025 à 08:57
Hommage d'un fils
■ Bruno LE DANTEC ET MON PÈRE UN OISEAU ? Hors d'atteinte, 2024, 272 p. Les larmes, c'était pas prévu, même si le dispositif s'y prêtait : c'était un matin de courte nuit, sur la table basse le café fumait, sur la platine l'adagio du concerto en sol de Ravel revisité par un trio jazz où la voix de David Linx tentait de rayer la carène d'un ciel plombé. Entre mes mains, les dernières pages de Et mon père un oiseau ? L'auteur, Bruno Le Dantec, racontait la mort de sa mère. Il avait déjà (…)
- Recensions et études critiquesTexte intégral (2585 mots)

■ Bruno LE DANTEC
ET MON PÈRE UN OISEAU ?
Hors d'atteinte, 2024, 272 p.
Les larmes, c'était pas prévu, même si le dispositif s'y prêtait : c'était un matin de courte nuit, sur la table basse le café fumait, sur la platine l'adagio du concerto en sol de Ravel revisité par un trio jazz où la voix de David Linx tentait de rayer la carène d'un ciel plombé. Entre mes mains, les dernières pages de Et mon père un oiseau ? L'auteur, Bruno Le Dantec, racontait la mort de sa mère. Il avait déjà perdu son père, ça commençait à faire. J'ai frotté mes yeux, fait une pause et quelques pas dans le salon. L'épilogue s'égrenait sur une vingtaine de pages ; entre les fulgurances du poète martiniquais Monchoachi et un extrait de La Némésis médicale d'Ivan Illich, l'auteur élargissait grand angle sa focale : pour résister aux ravages de la guerre sociale, la solidarité entre les vivants resterait insuffisante si elle ne puisait pas à la source des défunts : « Pour sortir de l'impasse, il faudra tisser des alliances avec nos morts contre cette existence économisée qui ne cesse de nous appauvrir », théorisait l'auteur.
Larmes matinales, donc. Livre refermé, émotion ravalée, je m'ébroue pour chasser la voix de l'ami car quand on lit le texte d'un ami c'est sa voix qui s'invite dans votre tête. Celle de Bruno Le Dantec porte une musique inimitable : loin des clichés provençaux, elle charrie Marseille à la manière d'un ru discret ses eaux filantes – un chant auquel je suis sensible, moi qui ai sacrifié mon accent sétois à force de remarques vexatoires. Quand Bruno cause, c'est tout un baume qui vous mollit le dedans. Le copain dirait la messe, on verrait le Christ fissa se déclouer, se coucher languide sur l'autel et lâcher tout ému : « Ah ouais quand même, les plaisirs terrestres… ». Ami lecteur, tu l'auras compris, cette recension aura la docte distance d'une arapède collée à son rocher. L'objectivité d'un abrazo de fin du monde. Bruno Le Dantec et moi nous nous connaissons depuis mes premiers pas, au mitan des années 2000, dans l'aventure du mensuel marseillais de critique sociale CQFD.
Marseille… Si un type incarne à ce point cette ville et sa myriade de métissages c'est bien Le Dantec. Sa ville dans la peau comme un paysan sa terre sous les ongles. Marseille, ce ventre affamé de cultures ; Marseille, sa plèbe en guerre contre les aménageurs ; Marseille, son ingérable carnaval de La Plaine. Marseille, tout un monde. La preuve : c'est sous le blase de « Nicolas Arraitz » que le pionnier Le Dantec fit connaître aux ébaubis de l'Hexagone le grand frisson du « territoire rebelle » zapatiste. En 1995, le soulèvement indigène entre dans sa seconde année de lutte et les éphémères éditions du Phéromone publient Tendre venin, sous-titré « de quelques rencontres dans les montagnes indiennes du Chiapas et du Guerrero ». La dédicace trahit à elle seule la généreuse poétique de l'écrivain : « À tous les amis mexicains, dont l'esprit guerrier nous fait la vie belle. »
Chemins de traverse et embardées
Quelques trois décennies plus tard, le baroudeur est revenu dans le giron de la matrice phocéenne. Après les diagonales mexicaines, une implantation sévillane et un épisode londonien, le bercail portuaire l'attendait. Bruno Le Dantec a vu du pays et des envers du décor, touché l'os d'une humanité capable du pire et de jaillissantes solidarités, enquillé une liste à la Prévert de petits boulots : aide géomètre, manœuvre, chasseur-cueilleur, réparateur de friteuse à Guatemala City, commis de cuisine sur la Tamise, DJ, traducteur, chapardeur occasionnel, journaliste, berger d'estive dans le Queyras – liste complète pages 204 et 205. CV foutraque, non monnayable aux comptoirs de notre ère néolibéralisée mais qui vous campe une personnalité hors norme, toujours encline à partager des chemins de traverse et de galère, non pas par masochiste inclinaison mais parce que c'est là, dans les ornières sombres du Grand Marché planétaire, que se dénichent les humains les plus vrais. On sent venir la critique : l'analyse, grossière, pècherait par excès de romantisme. On assume. Sur le chemin du vagabond Le Dantec, des humbles au dos cassé par le joug de l'Histoire ont renoué avec la dignité des postures verticales, ça suffit à nourrir des embardées romanesques. La fatalité en prend un coup. D'ailleurs, quelle fatalité ? Puisque lui-même, viré à dix-sept ans de son bahut pour « appel à la révolution » et grandi sous les gueulantes rageuses d'un punk acculé, persuadé qu'il ne ferait pas de vieux os, a survécu. « Je me fabriquais une philosophie des rues, un truc que, seul dans ma tête, j'appelais le zen-punk […]. Se dépouiller du carcan des obligations sociales pour être le plus libre possible et, finalement, se retrouver nu face à la mort », confie l'auteur de Et mon père un oiseau ? Came, alcool, sida, sous leurs strass et paillettes, les années 1980 ont été cette morgue pleine dans laquelle s'est échouée une partie de la jeunesse orpheline des poussées utopistes des décennies passées. Bruno a vu du monde partir.
Quelques temps avant l'explosion de Mai-68, un Debord visionnaire expliquait combien notre situation avait été unifiée par le règne spectaculaire du Capital : « Le spectacle se soumet les hommes vivants dans la mesure où l'économie les a totalement soumis (…) » (thèse 16) [1]. Sous-entendu : c'est de cette expérience commune et partagée par tous que peut naître une révolte capable d'embarquer un maximum d'acteurs vers un ébranlement du socle du pouvoir. On connaît la suite : comment l'inflorescence postmoderne est venue désagréger la puissance rassembleuse d'un tel récit émancipateur. Si les Gilets jaunes ont tenté de réactiver le rêve jamais tu de la colère plébéienne, un autre événement aurait pu servir de ferment à une énième prise de conscience de notre destin collectif : la « guerre » contre le virus du Covid-19 et sa succession de grands enfermements. Une séquence à tout le moins exceptionnelle, aujourd'hui refoulée des mémoires aussi brutalement qu'elle les avait colonisées comme un bad trip sans queue ni tête. Cinq ans après, il semble toujours difficile de dresser un bilan de la charge antisociale portée par cet hygiénisme policier, et ce, alors qu'un consensus de plus en plus large penche pour une fuite de labo à l'origine de la pandémie – hypothèse jugée scandaleusement « complotiste » il y a encore peu. De son origine à son hasardeuse et implacable gestion, la pandémie aura été, aussi, l'aubaine grâce à laquelle une caste techno-sécuritaire a pu tester en grandeur nature des dispositifs de contrôle – imposés ou auto-administrés – inimaginables en temps normal.
Depuis, l'OMS actualise son macabre bilan. Aujourd'hui, il avoisine les 7 millions de morts. Un chiffre sous-évalué, on le sait, notamment parce qu'il ne tient pas compte des morts « collatérales », dont certaines dues à des interventions chirurgicales déprogrammées pour anticiper des afflux de malades. Parmi ces morts collatérales, le père de Bruno : Jean Le Dantec, décédé seul, coupé des siens, le 7 avril 2020, dans une piaule aseptisée de la clinique Korian Valdonne (Bouches-du-Rhône) en milieu de premier confinement.
« Monsieur le pandore, je t'emmerde… »
« Au péage de Pont-de-l'Étoile, un gendarme en embuscade me fait signe de m'arrêter à la sortie du portique. D'un œil blasé, il toise mon attestation auto-délivrée à travers le pare-brise. Je rumine Monsieur le pandore, je t'emmerde. Mon père est en train de mourir tout seul – mais mon corps reste aussi impassible qu'un mannequin dans sa vitrine », raconte Bruno Le Dantec avec rage et impuissance.
Et mon père un oiseau ? relève du récit intime. Il entend « raconter une histoire particulière qui concerne tout le monde ». Intime ne veut pas dire nombriliste. Intime signifie que l'auteur part de sa propre sensibilité pour cerner un mal susceptible d'affecter chacun de nous. Intime s'apparente à « kafkaïen » quand, à coup de mails ou de téléphone, on suit ce fils navigant dans les arcanes d'un système de santé saturé, au bord de l'implosion, pour avoir des nouvelles de son père mourant. Ou pour récupérer ses quelques effets personnels après son décès. Cette intimité nous force à saisir cette étrange équation dans laquelle la pandémie nous a plongés : pour sauver des humains, notre mode d'organisation sociale a dû gagner en inhumanité. La barbarie étatique – ce grand machin qui gère nos existences du berceau jusqu'à la tombe – a toujours eu l'art des oxymores. La prophylaxie, c'est cette politique qui a permis de trier les malades et de laisser crever les vieux. Dans l'intérêt de tous – et notamment des forces productives de la nation. « Foutus technocrates à l'âme froide », accuse l'écrivain.
Dans ce récit, tout s'imbrique et se mélange. La vie vagabondée de l'auteur, celle plus posée de son père. Sans oublier Andrée, sa mère, et Marie, sa fille, guerrières dont les nerfs sont soumis à rude épreuve. Autant de personnages, autant de situations qui progressent en taches de léopard, strates passées et présentes s'empilant dans un désordre chronologique assumé où l'on se perd et se retrouve. Dans cette généalogie aux ramifications capricieuses, la voix du narrateur sert de fil d'Ariane et les anecdotes font diversion. Des personnages secondaires incarnent des solidarités inattendues. Comme cette secrétaire de mairie qui n'hésite pas à batailler avec la machine pour dénicher l'acte de naissance, prétendument introuvable, de Jean Le Dantec. Dans la jungle administrative, jamais l'auteur ne perd sa visée : contourner, autant que faire se peut, les infernales interfaces numériques et chercher l'humain comme un orpailleur son filon.
Et puis il y a cet art de décrire les clichés du passé. Une photo est reproduite en début d'ouvrage : un grand noir et blanc étalé sur deux pages, croquant les futurs parents au faîte de leur jeunesse : « Il existe, écrit-il, une photo de Jean et Andrée jeunes, je suis sûr que c'est la toute première où on les voit ensemble. L'instant capturé est celui où ils tombent amoureux, ça crève les yeux. Ils sont assis par terre, le dos contre un mur. C'est l'été, ils sont moniteurs de colonies de vacances [...]. Andrée regarde fixement l'objectif, la bouche entrouverte, sans sourire mais dans un paisible abandon, comme si elle reprenait son souffle après une course à travers champs. Tout contre elle, Jean sourit. Sa belle tête est penchée sur le côté, le nez en l'air, comme s'il observait la trajectoire d'un avion ou d'un oiseau dans le ciel ; mais peut-être veut-il simplement éviter de fixer l'objectif. »
La pudeur, sûrement. Bruno Le Dantec se perd en conjectures. Il doit son existence à cet amour qu'il essaie de reconstituer a posteriori. De quoi filer le vertige. De quoi permettre à l'ancien enfant terrible de rendre un hommage apaisé à ses parents. De quoi aussi saluer, par effet de ricochet, cet adolescent fougueux qu'il fut, minot qui connut sa première manif à quatorze ans, en soutien à Puig Antich, manif au cours de laquelle « un nervi au cheveu filasse » lui fila un grand coup de bambou sur le crâne. Première bosse pour celui qui allait apprendre à la rouler en dehors d'un Hexagone étriqué.
La blessure algérienne
Dans Et mon père un oiseau ?, Bruno Le Dantec s'adresse à son père, ce professeur de sciences « resté ce fils d'ouvrier qui doute encore de sa légitimité dans le domaine intellectuel ». Un homme curieux de tout ce qui l'entoure – faune, flore, géologie –, mais aussi de l'« histoire sociale et industrieuse des habitants alentours ». Un homme cerné de livres, insatiable chineur, animateur de balades contées. Un homme silencieux, aussi, tourmenté par ses six mois passés de l'autre côté de la Méditerranée durant la guerre d'Algérie. En 1956, Jean perdit son copain Antoine, buté par erreur par un appelé français. Pour venger la bévue, un sous-off' d'active flingua un gosse algérien juché sur son âne. Tutoyant son père, Bruno Le Dantec poursuit : « Un carton gratuit, pour l'exemple : “Voilà comment on patrouille. C'est sur eux qu'on tire, pas sur les copains !”, t'aurait lancé la brute en uniforme après que tu as lâché un “Non !” viscéral, horrifié – en tant que lettré, tu avais été bombardé caporal sans qu'on te demande ton avis. Soixante-treize ans plus tard, les larmes aux yeux, tu m'as avoué : “J'ai encore dans la tête le cri de la mère du petit.” »
Les deuils se croisent et les douleurs se mêlent. Dans un « paysage saccagé par le progrès », Bruno Le Dantec cherche le vieux Marseille de ses parents. Ce temps d'avant les balafres d'asphalte et les boucans motorisés. Quand l'errance géographique s'épuise dans une artère raide et relookée, reste le ciel et les échelles pour y grimper. La voix d'un fils qui rêve à des slogans hors normes, du genre « Tout le pouvoir aux conseils ouvriers, aux oisifs et aux oiseaux ».
Sébastien NAVARRO
■ Signalons que Bruno Le Dantec tient un blog sur « Mediapart » et que sa dernière production –« Gaza et l'épidémie des couteaux »– mérite lecture.
[1] Guy Debord, La Société du spectacle, Folio, 1992, p. 22.
16.06.2025 à 08:14
Digression sur l'innommable
Longtemps les mots ont hésité ; désormais, ils manquent. Chaque jour qui passe dans cette guerre d'extermination sans limites que mène le gouvernement fasciste israélien contre Gaza, atteste qu'aucun mot n'est plus apte à dire une réalité échappant à toute raison, à toute rationalité, même guerrière. D'où cette mutité qui saisit nos consciences ravagées par la polymorphie du malheur infini qu'éprouve toute une population civile martyrisée, et désormais affamée. Oui, les mots manquent. Et (…)
- Digressions...Texte intégral (2750 mots)

Longtemps les mots ont hésité ; désormais, ils manquent. Chaque jour qui passe dans cette guerre d'extermination sans limites que mène le gouvernement fasciste israélien contre Gaza, atteste qu'aucun mot n'est plus apte à dire une réalité échappant à toute raison, à toute rationalité, même guerrière. D'où cette mutité qui saisit nos consciences ravagées par la polymorphie du malheur infini qu'éprouve toute une population civile martyrisée, et désormais affamée. Oui, les mots manquent. Et pourtant il faut exprimer, ne pas taire faute de mots adéquats l'horreur infiniment réitérée que, depuis plus de six cents jours, nous éprouvons chaque matin en apprenant qu'un nouveau palier dans la volonté exterminatrice de Netanyahu et de ses tueurs a été franchi. Et que demain sera pire et après-demain pire encore si rien n'arrête le bras surarmé par l'Occident des criminels de guerre, ces maniaques d'une loi du talion augmentée qu'aucun interdit moral ou religieux ne semble être capable de contenir. C'est dans ce cercle infernal de la déraison exterminatrice que crèvent un par un les Gazaouis et que les habitants de Cisjordanie résistent, tant que faire se peut encore et avec le peu qu'ils ont, à la volonté colonisatrice de fous de dieu qui, s'ils étaient tenants de l'islam, se verraient irrémédiablement voués aux gémonies des défenseurs des « valeurs » de l'Occident.

Après plus de six cents jours, donc, ce qui nous taraude, ce qui exaspère nos impuissances, c'est de constater que, jour après jour et sans que personne ne le contrarie, l'État d'Israël verse, pour sauver la clique qui a capté le pays, dans une logique d'extermination d'un peuple déjà pour partie chassé de sa terre en 1948 [1], et qui vit désormais sa seconde Nakba. Ce qui nous fait mal, un mal de chien, c'est de devoir éprouver, jour après jour, un sentiment d'écœurement à l'idée que, malgré quelques courageuses voix dissidentes, le peuple israélien, né lui-même d'un génocide (et quel génocide !), semble couvrir passivement un processus de nettoyage ethnique de grande ampleur et les crimes contre l'humanité que sa clique dirigeante commet en son nom, sans que personne, malgré ce qui remonte des états d'âme d'une fraction du Mossad et de l'armée, ne songe à déposer la bande d'assassins qui les gouverne – ce qui ne semble pas impossible au vu du pouvoir réel dont ils disposent. Car le pire à vivre pour les Israéliens, ce sera ce sentiment de honte qui, un jour, fatalement, les saisira – et, du même coup les juifs de la diaspora, dont beaucoup pourtant sont engagés dans la résistance à cette cynique entreprise – à l'idée d'avoir acquiescé, directement ou indirectement, à un génocide pensé, acté et accompli par une clique de nervis osant tout, même attiser sciemment, partout dans le monde, une nouvelle vague d'antisémitisme. La bêtise crasse a fait le reste, notamment en France, où, vautrée dans son soutien inconditionnel à Israël après le massacre du 7 octobre 2023 commis par l'autre clique d'allumés – celle du Hamas –, la caste médiatico-politique dominante, cornaquée par des « anti-antisémites » aussi crédibles que ceux qui se revendiquent du Rassemblement national, s'est déshonorée à un point tel qu'aucun mea culpa postérieur ne parviendra à laver la faute originelle que constitua leur inconditionnalité à Tsahal et à ses porte-parole fanatisés.

« L'État d'Israël – déclare l'historienne Sophie Bessis dans un récent entretien accordé à Mediapart – a commis et continue de commettre des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité. D'héritier des victimes du génocide, il est en train de passer dans le camp des bourreaux aux yeux d'une grande partie de l'opinion mondiale. Tout cela est documenté, mais cela reste nié, tu ou occulté par les dirigeants occidentaux. On n'a pas encore pris la mesure de ce séisme [2]. » Cet ébranlement, les Palestiniens le vivent dans leurs chairs ; les Israéliens, eux, ceux qui, du moins, n'ont pas perdu la raison – le vivent dans leurs têtes, au même titre que bien des juifs de la diaspora. Comme un drame infini porté à sa plus haute expression par un suprémacisme colonial débridé, éradicateur et pathologique où rien ne subsiste de la moindre empathie humaine pour l'altérité. Au bout de cela, tout est néant. La mort est la seule perspective. Une mort sans sommation ouvrant sur un champ de ruines d'où sera définitivement effacée toute espérance, même minime, de cohabitation possible. On pourra toujours dire que le Hamas est à l'origine de ce séisme puisque, le 7 octobre 2023, il a ouvert les hostilités, mais cette vision à courte vue de l'histoire ne convaincra que les croisés de l'ordre suprémaciste israélien, qui n'ignorent pas, s'ils lisent Haaretz même distraitement, que cet assaut barbare n'aurait jamais pu avoir lieu sans complicités – objectives ou subjectives – avec le Hamas de la part des services secrets israéliens dont la légendaire efficacité est attestée depuis longtemps. Bien des pistes semblent attester que ce 7-Octobre fut pensé et favorisé en haut lieu, pour donner prétexte et justification à la clique fasciste au pouvoir – Netanyahu-Smotrich-Ben Gvir – et régler une fois pour toutes la question de Gaza et, au-delà, dans la fureur guerrière que déchaîna cet atroce événement, celle de la Cisjordanie, appelée, dans l'imaginaire sioniste conquérant, à redevenir la Judée-Samarie, une « terre juive » enfin éradiquée des autochtones palestiniens [3].
C'est dans cette même perspective nihiliste que doit s'inscrire cette information – confirmée le 7 juin par Avigdor Lieberman, ancien ministre de la Défense –, selon laquelle l'État israélien fournirait, dans la bande de Gaza, des armes à des milices rivales du Hamas, liées à des activités mafieuses et en affaires avec Daesh, pour piller, sous protection de Tsahal, les rares réserves alimentaires qui devraient parvenir à une population affamée. L'innommable, c'est cela. Une parfaite auto-complaisance dans l'ignominie. « Israël travaille à vaincre le Hamas par divers moyens », a récemment déclaré Netanyahu dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux. Et tous les moyens sont bons pour ce criminel de guerre. Ce disant, il s'inscrit, à sa manière de fasciste décomplexé, dans les traces de ses prédécesseurs qui, depuis plusieurs décennies, ont régulièrement parié sur le pire : faire émerger le Hamas pour contrer le Fatah, instrumentaliser les divisions internes à l'OLP pour l'affaiblir, sous-traiter la traque du Hamas en recourant à des bandes mercenaires soudoyées. Toutes pratiques qui définissent un État-voyou en marche vers le pire quand le pire est la condition de l'écrasement de toute espérance, même minime : obtenir un sac de farine pour nourrir sa famille. Toutes les bornes de l'infamie ont dès lors été franchies.

Qu'importe après tout à cette clique de suprémacistes fous, de racistes congénitaux, de fous de dieu et de massacreurs sans limites dirigeant l'État israélien que, sous l'exercice de leur pouvoir, l'image de leur pays se dégrade chaque jour un peu plus aux yeux du monde. Que lui importe que son armée, autoproclamée la « plus morale » du monde, soit devenue, sous ses ordres, l'incarnation même de la barbarie en actes. Que lui importe de piétiner les règles du droit international de la guerre, les principes moraux les plus élémentaires, les décisions de l'ONU. Le cynisme de la clique est tel que rien n'y fera, hors les sanctions, la mise en place d'un embargo militaire et la reconnaissance internationale immédiate d'un État palestinien.
C'est peu de dire, plus six cents jours après le début de cette offensive meurtrière, qu'il y a urgence à arrêter, par tous les moyens, l'incroyable massacre qu'a déjà provoqué cette guerre d'anéantissement mené par l'État israélien. Les chiffres parlent d'eux-mêmes : sur 2 millions d'habitants, 54 000 dépouilles palestiniennes ont été dûment enregistrées à Gaza – le chiffre le plus vraisemblable devant avoisiner les 100 000 victimes, soit 5% de la population gazaouie. Il parle de lui-même, ce bilan atroce, et ce d'autant qu'il concerne exclusivement une population civile directement visée par des snipers ou des drones tueurs pilotés par l'intelligence sacrificielle de Tsahal. Quant aux chiffres des disparus, blessés, estropiés, handicapés à vie, ils sont à un tel étiage que les statistiques ne suivent plus.

Comment en est-on arrivé là, à un tel degré de déshumanisation et d'inculture politique, chez les gouvernants du monde et leur porte-parolat médiatique, pour oblitérer à ce point, au nom d'impératifs purement marchands ou d'intérêts stratégiques, la seule question qu'il faille se poser : comment arrêter la main du crime et isoler, du même coup, le clan des criminels. Il n'en est pas d'autre qui vaille, qui soit plus urgente. Or, cette question n'est toujours pas à l'ordre du jour alors que Gaza brûle et que la situation empire chaque jour un peu plus en Cisjordanie occupée avec l'utilisation d'armes lourdes par l'armée et de méthodes de guerre par les colons, les déplacements forcés de populations, les enlèvements, les démolitions d'habitations. Tout cela est d'une noirceur confondante. La ligne est tracée par la clique fasciste israélienne au pouvoir. Ce sera jusqu'au bout. Pire qu'en 1948. Car il s'agit, cette fois, d'en finir avec les Palestiniens. Et pour ce faire tous les moyens seront bons. Le Hamas, lui, qui prospère sur la martyrologie, se fout qu'il y ait 50 000, 100 000 ou 200 000 victimes. Au contraire, plus il en a, des martyrs, plus ses affaires marchent, plus il recrute. C'est une autre donnée de ce drame à effet dédoublé. Favorisé, voire manipulé, par le pouvoir israélien, le Hamas ne peut prospérer qu'en état de guerre. C'est l'autre face de la terreur qui s'abat sur les Palestiniens, son bras armé et sa police. Quand eux – les Palestiniens – ne demandent qu'à vivre, simplement vivre, sur leur terre.
Ce qu'on sait, de manière sûre, c'est que, livré à des criminels de guerre aussi dingues que Netanyahu, Smotrich et Ben Gvir, Israël a franchi toutes les limites de l'abjection. En passant du statut de peuple génocidé à celui de puissance génocidaire, l' « État des juifs » aura porté un coup probablement fatal au judaïsme et à son histoire de résistance aux répressions qu'il a subies au long des siècles. Ce qu'on a compris également, depuis maintenant plus de six cents jours, c'est que ceux qui, politiciens de petite envergure et éditocrates appointés, ont joué de manière si déguelasse la partition d'antisémitisme contre celles et ceux qui s'opposaient, en pacifistes, aux criminels de guerre israéliens, ont banalisé pour longtemps son exceptionnalité. Et c'est grave. Ils en portent la pleine et entière responsabilité. Elle est si lourde qu'elle leur reviendra tôt ou tard, en boomerang, dans la gueule.
Enfin, un peu perdus dans cet innommable qui nous accable, ravagés par la passivité des pouvoirs qui, de par le monde, continuent d'alimenter un crime de masse en armant les tueurs, il n'est pas inutile, pour finir, de saluer le puissant mouvement de solidarité avec la Palestine qui se développe dans la société civile mondiale, principalement dans la jeunesse. Et d'honorer, du même coup, les initiatives de blocage de containers de composants militaires à destination d'Israël – comme celles des dockers de Fos-sur-Mer ou de Gênes – et l'affrètement de flottilles humanitaires, comme celle du Madleen, cherchant à briser le blocus israélien de Gaza.
Quand le crime est sans nom, la résistance à l'indignité reste le plus sacré des devoirs. Pour que vive dans nos cœurs l'espérance d'un monde simplement vivable, c'est-à-dire débarrassé de tous ses porteurs de haine. L'enjeu est considérable. Pour l'existence même de la Palestine, pour que le judaïsme cesse d'être assimilé aux bourreaux qui le pervertissent et pour nous-mêmes.
Freddy GOMEZ
[1] Entre 1947 et 1949, environ 800 000 Palestiniens ont été chassés de leurs terres par les forces israéliennes au lendemain de la proclamation de l'Etat d'Israël, le 14 mai 1948. « La Nakba – qui se traduit par « catastrophe » ou « désastre » en arabe [NdÉ] – est le nom qu'ont donné les Palestiniens au fait d'avoir été expulsés en très grand nombre de leurs foyers, durant la guerre qui commence avec le plan de partage, le 29 novembre 1947, et qui finit à l'été 1949 avec les armistices israélo-arabes » (Dominique Vidal).
[2] « Les Palestiniens n'ont jamais été autant en danger », entretien entre Rachida El Azzouzi et Sophie Bessis, Mediapart, 31 mai 2025. Sophie Bessis est, par ailleurs, l'auteure d'un remarquable ouvrage – La Civilisation judéo-chrétienne : anatomie d'une imposture –, récemment paru aux Liens qui libèrent.
[3] Comme Gaza et le Golan, la Cisjordanie – Judée-Samarie pour les sionistes – a été conquise par l'État israélien lors de la Guerre des Six Jours de 1967.
09.06.2025 à 08:55
Procès d'un salaud ordinaire
■ Jean-Jacques GANDINI LE PROCÈS PAPON Histoire d'une ignominie ordinaire au service de l'État Préface : Johann Chapoutot Postface : Arié Alimi Le passager clandestin, 2025, 244 p. Initialement publié en 1999 chez Librio, Le Procès Papon, de Jean-Jacques Gandini, avocat et militant anarchiste, méritait cette réédition notablement augmentée que nous offre, dans une édition de bonne facture, Le Passager clandestin. Précédé d'un exergue extrait de Primo Levi – « C'est arrivé. Cela peut (…)
- Recensions et études critiquesTexte intégral (2780 mots)

■ Jean-Jacques GANDINI
LE PROCÈS PAPON
Histoire d'une ignominie ordinaire au service de l'État
Préface : Johann Chapoutot
Postface : Arié Alimi
Le passager clandestin, 2025, 244 p.
Initialement publié en 1999 chez Librio, Le Procès Papon, de Jean-Jacques Gandini, avocat et militant anarchiste, méritait cette réédition notablement augmentée que nous offre, dans une édition de bonne facture, Le Passager clandestin. Précédé d'un exergue extrait de Primo Levi – « C'est arrivé. Cela peut arriver de nouveau : tel est le noyau de ce que nous avons à dire. Cela peut se passer et partout ! » –, son entrée en matière est confiée à Johann Chapoutot qui, dans une préface intitulée « Une carrière française », confirme son sûr talent de portraitiste et d'analyste. Il l'exerce, cette fois, à l'encontre de ce commis du pouvoir par excellence que fut Maurice Papon (1910-2007), haut fonctionnaire de tous les régimes et exécuteur administratif, en tant que secrétaire général de la préfecture de Gironde, entre 1942 et 1944, de la déportation des juifs de la région bordelaise vers Drancy – d'où les forces d'occupation nazies les envoyèrent, pour extermination, vers Auschwitz –, puis, en tant, que préfet de police, de la terrible répression anti-algérienne de la manifestation du 17 octobre 1961 [1] et de celle du 8 février 1962 contre l'OAS qui se solda par la mort de neuf personnes à la station de métro Charonne. La « vie exemplaire » de Papon, nous dit le préfacier de ce livre, recela une vérité d'évidence : « Le pouvoir que l'on exerce avec hauteur […] a sa fin en lui-même (la jouissance sordide du tampon), mais aussi une fin extérieure, au fond tellement intime : l'ordre public à maintenir, l'ordre social à préserver. »
« Le cas Maurice Papon, note Chapoutot, est une coupe géologique dans les structures de pouvoir françaises et de leurs infamies. » Passé de la république radsoc d'avant-guerre à Vichy, puis de Vichy à De Gaulle, il tient, pour sûr, de l'archétype. Comme René Bousquet (1909-1993), lui-même radsoc, qui devint, sous Vichy, secrétaire général de la police, faisant fonction de directeur général de la Police nationale, structure créée le 23 avril 1941 et, de ce fait, principal organisateur de la rafle du Vel d'Hiv des 16 et 17 juillet 1942, de celles d'août 1942 en zone Sud et, aux côtés des forces occupantes, de celle de Marseille en janvier 1943. Au total, 60 000 juifs furent arrêtés, sous ses ordres et par ses services, pour être livrés aux autorités d'occupation et déportés vers les camps d'extermination nazis. Comment expliquer cela ? Simple, en somme : chez ces gens-là, la bascule est naturelle. Elle tient à une boussole intérieure dont l'aiguille pointe toujours vers le pouvoir. Pour le reste, il faut chercher du côté des « origines républicaines de Vichy » [2] : les décrets lois, le grignotage des conquêtes du Front populaire, les camps de rétention pour les réfugiés républicains espagnols et les antinazis allemands et autrichiens. Et y ajouter, le prestige d'une vieille baderne maréchalisée, les places à prendre et l'exaltante perspective d'un Ordre nouveau à maintenir. Tout est là pour comprendre, en fait. Notre passé, mais aussi notre présent. Les « criminels de bureaux » – comme on a dit d'Eichmann ou de Papon –, arpentent toujours les mêmes arcanes du pouvoir et, bien serré dans leurs pognes, le fil qui l'y les a conduits. Et ça n'a pas changé. Essayez pour voir. Puisez à l'actualité. Vous verrez que ça marche très bien.

Après les procès du SS Klaus Barbie en 1987 et du milicien Paul Touvier en 1994, celui de Papon [3] – « l'homme normal », comme dit Gandini, ce « haut fonctionnaire au-dessus de tout soupçon », comme l'assuraient les plus hautes autorités de l'État et leur commis – ferma le triangle de l'infamie. Ce procès, Gandini le suivit de bout en bout, six mois durant, à la Cour d'assises de Gironde, en tant qu'observateur de la Ligue des droits de l'homme, dont il est membre depuis 1977.
C'est Le Canard enchaîné du 6 mai 1981, époque à laquelle le volatile servait encore à quelque chose, qui sortit, dans l'entre-deux tours de l'élection présidentielle de 1981, qui opposait le sortant Giscard à Mitterrand, deux documents accusateurs sur le rôle personnel de Papon dans la déportation des juifs de Bordeaux [4]. La première pièce – datée du 1er février 1943 – atteste d'un ordre de réquisition de la gendarmerie pour escorte, du camp de Mérignac à Drancy, d'un convoi de juifs ; la seconde pièce, émanant du Service aux questions juives, révèle que, « sous influence prépondérante juive au sens de l'ordonnance allemande du 18 septembre 1940 », un appartement d'un Français juif doit être réquisitionné. À l'époque, Papon ministre du Budget dans le gouvernement Barre, déclare que « tout cela ne l'émeut pas beaucoup », ce qui ne l'empêche pas, sans contester l'accusation, de dénoncer un « truquage honteux » et une « manœuvre électorale de dernière minute ». Disposé à porter plainte contre Le Canard enchaîné, il y renoncera, après l'élection de Mitterrand, quand Serge Klarsfeld produira des documents allemands confirmant ceux du Canard.
On sait que le gaullisme eut sa part, bonne part, dans le blanchiment des crimes des hauts fonctionnaires vichystes. De Gaulle lui-même le signifia, dès l'été 1944, au nom des intérêts supérieurs de l'État : « La République était à Londres ; Vichy était nul et non avenu. » Un comble. Les rafles de juifs n'avaient jamais existé, donc. Et le rôle actif qu'y jouèrent les fonctionnaires non plus. Il s'agissait pour le gaullisme de privilégier la répression contre les Allemands et les « collaborateurs notoires » pour des crimes commis contre des « résistants ». Fondé sur la construction d'un récit, évidemment mensonger, visant à attester que la France aurait été uniment dressée contre l'Occupant et ses citoyens forcément résistants au nazisme, le gaullisme lava plus blanc que blanc. Il fallut attendre que ça bouge ailleurs dans la société pour que ce mensonge d'État commence, dans la décennie 1970, à s'effriter. Nul doute que la sortie, en 1969, du film documentaire Le Chagrin et la Pitié, du regretté Marcel Ophuls, y fut pour beaucoup, mais aussi la publication, en 1973, du livre-somme de Robert Paxton, La France de Vichy, 1940-1944. Il n'empêche que la perspective d'un procès Papon mit, de facto, en branle certains notables du gaullisme, comme Philippe Séguin, qui dénonça, relayé par le socialiste Jean-Pierre Chevènement, le « climat d'expiation collective et d'autoflagellation permanente », « morbide et délétère », qui l'aurait permis.

Il aura fallu seize ans de procédure d'instruction – 1981-1997 – pour que, le 8 octobre, s'ouvre enfin le procès de « Maurice Papon, retraité ». Seize ans : comme si l'État attendait que le prévenu passe l'arme à gauche – c'est une façon de parler – pour que son décès éteigne la procédure. Mais le vieux Papon est là, entouré de ses conseils – Maîtres Varaut, Vuillemin et Rouxel qui, immédiatement, demande la mise en liberté de leur client. Le vieillard est malin et retors. Des témoins de « moralité », il en a à la pelle. Parmi les ex-Premiers ministres Messmer et Barre, des ministres, des anciens préfets et d'éminents résistants qui attestent de « l'humanisme » et du « sens du devoir » de Papon.
Il faudra encore 94 audiences, 6 354 documents examinés, un dossier en contenant 50 000, 95 témoins entendus et six mois de procès, « le plus long de notre histoire », précise Gandini, pour que la cour se retire pour délibérer. Elle condamnera Maurice Papon, pour « complicité de crimes contre l'humanité », à la peine de dix ans de réclusion criminelle et, pour la même durée, de suspension de ses droits civils, civiques et de famille. « L'accusé a à peine cillé à l'énoncé du verdict – note Gandini – et il a aussitôt signé un pouvoir à ses avocats pour qu'ils déposent le jour même un pourvoi en cassation qui, étant suspensif, le maintient en liberté. » Autrement dit, Papon est condamné, mais libre. « Étrange spectacle du seul condamné français pour crime contre l'humanité, mis en liberté au début des débats et retourné chez lui, tout aussi libre à leur issue, comme s'il n'avait fait qu'assister à un colloque un peu solennel, désagréable sans doute, mais entièrement consacré à sa personne », notera Nicolas Weill dans Le Débat [5].
Le livre de Gandini – et c'est important de le noter – ne tient pas de la chronique de procès, qui est un genre en lui-même, mais de l'histoire. Il ne raconte pas, en témoin, les péripéties des audiences, mais situe les débats judiciaires et leurs enjeux dans un cadre plus large : « la complicité de crimes contre l'humanité », « le parcours de Papon comme figure emblématique de la continuité de l'État », « Vichy comme coauteur de l'exclusion et complice de l'extermination », « l'histoire des rafles et convois à destination d'Auschwitz via Drancy », « la solution finale », « Papon et sa résistance de la vingt-troisième heure », et enfin, comme corollaire logique de son infamie organisatrice : « le 17 octobre 1961 comme Nuit de cristal de la police parisienne ». Au bout du bout et pièce après pièce, l'auteur dresse un portrait fouillé, précis, contextualisé et accablant de cette basse époque de notre histoire dont la plus sombre page – nous laissait entendre jusqu'à il y a peu la voix sûre de la raison – était désormais tournée.

« Si, vingt-cinq ans après sa première publication, j'ai ressenti l'envie, pour ne pas dire la nécessité, écrit Gandini, d'en proposer une version actualisée, c'est “pour ne pas oublier” devant la montée en puissance et la banalisation des idées d'extrême droite qui n'ont de cesse de réécrire l'histoire. » C'est dans le même registre que se situe la postface de l'avocat Arié Alimi. « Jean-Jacques Gandini, y écrit-il, nous livre des clés de compréhension ô combien nécessaires pour engager [la] réflexion. Mais aurons-nous suffisamment de temps pour y répondre ? À l'heure où l'extrême droite reprend peu à peu la tête des plus grandes démocraties par le jeu même de l'élection, et à peine en place n'hésite pas à détruire peu à peu les structures de l'État de droit, comment nos contemporains pourront-ils réagir face à une Histoire qui semble bégayer ? Certains ont pu penser que la démocratie serait une fin de l'histoire, que la justice internationale nous protégerait durablement. Nous pensions que l'expérience de l'annihilation empêcherait l'individu et la société de replonger dans ses affres passées. Ni le droit ni l'Histoire ne semblent suffire à endiguer une propension qui fait désormais partie intégrante de la condition humaine et sociale. » Le propos est sans doute trop pessimiste pour laisser la moindre place à une alternative, mais il dit l'inquiétude d'un homme qui sait de quoi le post-fascisme est porteur en terme de destruction généralisée des droits et des cohésions humaines.
Comme le prouve cet ouvrage, de lecture indispensable, préface et postface comprises, l'histoire et sa connaissance sont nécessaires pour faire barrage au retour de l'ignoble. Mais la tâche exigera davantage : traquer et dénoncer le plus vivement possible tous les signes de fascisation des possédants-dominants ; ramener la question sociale au cœur de nos perspectives militantes en unifiant, autour d'elle, nos résistances ; les élargir au-delà de nos propres préférences, sensibilités ou adhésions politiques ou syndicales ; organiser dès maintenant des foyers de lutte unitaires contre le retour de l'ignoble et des cordons de solidarité active avec celles et ceux qui, dès aujourd'hui, sont le plus directement menacés par le post-fascisme.
Car les salauds ordinaires à la Papon sont toujours là !
Freddy GOMEZ
[1] Le décompte des victimes oscille, selon les estimations, entre 48 et 200.
[2] Gérard Noiriel, Les Origines républicaines de Vichy, Hachette, 1999.
[3] Voir Le Procès de Maurice Papon, de Gabriel Le Bomin, film documentaire, en accès libre sur « france.tv. » Signalons, par ailleurs, l'entretien que le documentariste a accordé – en compagnie de l'historien Laurent Joly – à David Dufresne sur le site « Au poste »
[4] L'article de Nicolas Brimo qui accompagnait la publication des deux pièces était titré « Quand un ministre de Giscard faisait déporter les juifs : Papon, aide de camps ».
[5] « Penser le procès Papon », Le Débat, n° 103, 1999, pp. 100-111.
02.06.2025 à 07:58
Actuel Proudhon
■ Pierre ANSART NAISSANCE DE L'ANARCHISME Esquisse d'une explication sociologique du proudhonisme Préface de Freddy Gomez L'échappée, « Versus », 2025, 384 p. L'anecdote est savoureuse, aussi je la partage. En 2020, je fis partie du jury d'un modeste prix littéraire. Le grand prix fut attribué à Jean Rouaud pour son essai L'Avenir des simples . Dans son texte, Rouaud dépeignait notre détestable époque soumise à la voracité des « multi-monstres » : les multinationales. Converti au (…)
- Recensions et études critiquesTexte intégral (2589 mots)

■ Pierre ANSART
NAISSANCE DE L'ANARCHISME
Esquisse d'une explication sociologique du proudhonisme
Préface de Freddy Gomez
L'échappée, « Versus », 2025, 384 p.
L'anecdote est savoureuse, aussi je la partage. En 2020, je fis partie du jury d'un modeste prix littéraire. Le grand prix fut attribué à Jean Rouaud pour son essai L'Avenir des simples [1]. Dans son texte, Rouaud dépeignait notre détestable époque soumise à la voracité des « multi-monstres » : les multinationales. Converti au véganisme, l'écrivain se faisait le héros de la cause animale, pourfendant l'inhumanité de l'agro-industrie.
.
Las, le premier repas collectif auquel fut invité le Goncourt cuvée 1990 fut constitué à 100% de charcutaille et de barbaque. Pas une feuille de laitue sur la table. Pire : l'entrée s'était étirée lors d'une interminable cargolade au cours de laquelle des kyrielles d'escargots avaient été occis et enfourchés dans une indifférence généralisée. Comment un tel couac avait-il pu être possible ? Je me souviens avoir observé Rouaud durant le repas, impassible et muet, attendant qu'on lui amène un triste bout de tarte végétale, tandis que nous bâfrions, insouciants, des montagnes saignantes de saucisses et coustellous de porc. J'imaginais ses pensées : était-ce là vile provocation ou bien était-il vraiment tombé dans le tréfonds d'une viandarde plouquerie ?
.
L'Avenir des simples, j'avais pas aimé – même si sur le fond je partageais nombre des constats posés par son auteur. Mais quelque chose mêlant surplomb moralisant et antipathie posturale m'avait lourdement gavé dans ce livre. Surtout, j'avais pas digéré un bref passage où, revisitant quelques vieilles barbes du XIXe siècle, Rouaud avait cancellé le « père de l'anarchie » par cette brutale et définitive sentence : « ce gros con antisémite de Proudhon ». C'est donc d'un commun accord avec ma compagne que notre exemplaire de L'Avenir des simples atterrit dans la boîte à lire du village entre L'Anneau de Cassandra de Danielle Steel et une édition mâchouillée du Malade imaginaire.

Un sociologue de la question sociale
Proudhon, donc. Après son antisémitisme, sa bien connue misogynie et son onfrayenne récup' achèveraient presque de condamner le penseur aux bauges de l'infréquentable. Faut dire que la fièvre postmoderne, coupée de toute visée historiciste, excelle dans l'art du tri sélectif et des condamnations morales. Fort heureusement, quand le philosophe et sociologue Pierre Ansart (1922-2016) publie, en 1970, Naissance de l'anarchisme, sous-titré Esquisse d'une explication sociologique du proudhonisme, il est à dix mille lieues de notre pauvre présent. Un demi-siècle plus tard, les éditions L'échappée sortent ce texte majeur de l'oubli dans une réédition préfacée par Freddy Gomez. Ce dernier, reconnaissant le caractère « difficile et contradictoire » de l'œuvre de Proudhon, met le doigt sur l'essentiel : s'il est un fait important à retenir de l'approche de Pierre Ansart c'est qu'elle a « su lier la sociologie de Proudhon aux temps et aux conditions historiques où elle fut produite, corrigée, amendée, élargie ». Le texte d'Ansart procède, en effet, d'une intuition particulièrement féconde : celle visant à prendre, selon les mots de l'auteur, « pour point de départ l'hypothèse qu'un créateur participe de sa collectivité et de son époque et que celles-ci orientent, souvent à son insu, sa propre création ».
Né à Besançon en 1809 et mort à Paris en 1865, on ne comprend rien à l'œuvre de Proudhon si l'on ne tient pas compte du contexte dans lequel le bonhomme a grandi. Des oies blanches pourront bien rétorquer que « contexte » ne vaut pas « excuse » et que tous les penseurs contemporains de Proudhon n'étaient pas forcément « antisémites » ou « misogynes ». C'est un fait. À cela près que si les mots ont un sens, ils l'ont d'abord en fonction de l'époque dans laquelle ils circulent et des forces politiques et sociales qui les instrumentalisent. L'objet de cette recension n'étant pas de nous appesantir sur ce point hautement inflammable, passons à l'essentiel : à savoir que cette première moitié du XIXe siècle fut ce moment clé où apparut la question qui obséda Proudhon, celle-là même qui devrait tous nous mettre d'accord : la question sociale.
Sur fond d'empires finissants et renaissants, de restaurations monarchistes et d'éphémères poussées républicaines, les journées insurrectionnelles y enchaînent leurs séquences. Liberté, égalité, fraternité, le triptyque de feue la Grande Révolution demeure un mirage aux alouettes quand la journée de travail fait quinze heures et que des minots de dix ans triment dans les bassins miniers du Nord ou dans les ateliers textiles lyonnais. Les corporations ayant été liquidées, la loi Le Chapelier (1791) ayant interdit toute possibilité de « coalitions », les travailleurs se retrouvent seuls face à la puissance patronale. Officiellement, la force de travail se contractualise librement, officieusement un libéralisme désentravé impose un nouveau genre de servage. Tandis que les masses prolétarisées commencent à s'entasser dans des fabriques, les premiers socialismes se théorisent et se concurrencent. Certains portent déjà en eux le germe centralisateur et autoritaire ; d'autres défendent le principe d'une révolution sociale initiée par le bas. Proudhon sera de ces derniers, opposé par exemple au journaliste Louis Blanc (1811-1882) accusé « de prôner un communisme autoritaire où le producteur ne devrait qu'obéir à un pouvoir gouvernemental » ou à l'industrialisme saint-simonien, sorte de « proto-macronisme » vantant la soumission heureuse à un gouvernement de technos en vue d'un progrès partagé. Avec un flair redoutable, Proudhon comprend qu'un changement de personnel politique, même animé des meilleurs intentions progressistes ou planificatrices, ne changera rien au sort des nouveaux prolétaires. Dans son agenda révolutionnaire, la question politique viendra toujours après « la “question sociale” et en fonction de celle-ci ».
« Vivre en travaillant ou mourir en combattant »
C'est dans ce terreau instable et conflictuel où la révolution industrielle ré-agence les communautés humaines en fonction de nouveaux impératifs productivistes que Pierre Ansart cherche les homologies à partir desquelles Proudhon va bâtir son œuvre et sa pensée. À ce titre, Naissance de l'anarchisme vaut d'abord pour sa consciencieuse méthode. L'idée est celle-ci : pour construire sa pensée, toujours singulière et en mouvement, l'auteur du célèbre « la propriété, c'est le vol » va puiser dans le réel de son temps. Notamment dans les pratiques ouvrières. Ces « homologies » sont à la fois sources d'inspiration et concordances ; elles sont surtout la mise en place de pratiques autonomes, ferment de ce que bien plus tard on nommera « autogestion ». Pierre Ansart les classe en trois parties : homologies des structures économiques, des pratiques et des visions du monde. Ces en-têtes globaux et techniques ne doivent pas tromper : dans chacune de ces parties, Ansart nous régale. D'abord parce qu'il n'oublie jamais de nous raconter l'époque en rapport avec la thématique abordée, ensuite parce que son art de la démonstration suit toujours un parcours finement construit. Les hypothèses sont creusées et évaluées afin de cerner au plus près les contours de cette « anarchie positive » prônée par Proudhon, théorie hybride et généreuse jamais vraiment stabilisée qui doit composer avec les survivances du monde féodal et les nouveaux rationalismes libéraux. Proudhon n'est pas un utopiste adepte de la tabula rasa et sa pensée suit un fil rouge : que les classes laborieuses conservent la pleine maîtrise de leur travail et s'agrègent entre elles par le biais d'un élan solidaire visant un mutualisme égalitaire. « Le mouvement créateur de Proudhon, écrit Ansart, se décèle en effet dans cette projection d'un modèle artisano-manufacturier sur l'ensemble de la société économique (…) » seul à même d' « appeler à une totale destruction des rapports sociaux du capitalisme libéral ». Proudhon « propose en effet, au moment où s'étend la propriété capitaliste des usines et des mines, que les instruments de production deviennent la possession collective et indivise de tous les ouvriers et employés de l'établissement : l'usine deviendrait propriété des producteurs immédiats comme un artisanat peut être la possession d'un ou plusieurs artisans. » Possession collective ne veut pas dire « communisme ou communauté », concepts équivalents chez Proudhon qui refuse ardemment « toute doctrine qui chercherait la solution sociale dans une fusion des individualités et des entreprises ». Le penseur avance sur deux jambes : l'épanouissement individuel et les solidarités effectives, les petites structures artisanales et les grands ateliers, tout ça doit cohabiter dans un maillage complémentaire avec comme uniques arbitres les travailleurs. Et si Proudhon consent à ce que le labeur des grandes manufactures implique une spécialisation des tâches, c'est à la condition expresse que chacun tourne sur les postes. Un genre de polyvalence et de formation permanente. La piste d'un taylorisme abrutissant est d'emblée écartée.
Le 28 novembre 1831, à Lyon, c'est la révolution. Sur un drapeau noir, à côté des barricades, on peut lire « Vivre en travaillant ou mourir en combattant ». Les Canuts se soulèvent et se rendent, pour une poignée de jours, « maîtres de la ville ». Quelque 8 000 maîtres-artisans et 30 000 compagnons lyonnais prennent à la gorge les producteurs de soie – les « soyeux » – qui depuis trop longtemps leur imposent des tarifs de misère. Dans une préfiguration communarde, ils supplantent brièvement les dirigeants de la capitale des Gaules. Dans trois ans, ils reprendront la Croix-Rousse, et c'est Thiers, le futur boucher de la Commune, qui les écrasera [2]. Cette fin dramatique, et peut-être écrite d'avance, n'occulte pas l'essentiel : « L'insurrection, partie d'une revendication strictement économique, méfiante à l'égard du domaine politique, s'achève par la création d'une nouvelle organisation sociale et, peut-on dire, par la destruction provisoire du pouvoir d'État », résume l'auteur de Naissance de l'anarchisme.
Spontanéisme ouvrier
Ansart l'affirme : c'est dans l'éthos solidaire des maîtres-artisans, propriétaires de leur machine mais aussi travailleurs (souvent avec leur famille), que Proudhon a beaucoup puisé. Il ne faut pas se tromper : sous ses faux airs réformateurs, presque accommodants avec le système, le mutuellisme peut très vite muter en véritable force résistante et insurrectionnelle quand le conflit éclate avec les donneurs d'ordres industriels. Proudhon a beau rêver à une société plus juste, il ne plane pas pour autant dans l'éther des idées pures. Sa gymnastique philosophico-politique puise au concret. S'il n'a pas de franche inclinaison pour la violence plébéienne, c'est qu'il est persuadé que le processus révolutionnaire doit intégrer à son propre développement les structures de ce meilleur monde à bâtir auquel aspirent les travailleurs coalisés. C'est dans le moment « canut » qu'il va trouver une certaine incarnation de ses intuitions. « Ce modèle [l'organisation mutuelliste] devait avoir, aux yeux de Proudhon, l'éminent privilège de proposer une stratégie immédiatement organisée et immédiatement organisatrice, faisant ainsi de la révolution une action non différée », relève astucieusement Ansart. Pour Proudhon, la seule mutation sociale qui vaille, c'est celle « opérée par les travailleurs en tant que producteurs et par une action menée sur leurs propres conditions sociales de travail ». Un peu à la manière de Michéa en quête de « décence commune » chez les gens d'humble condition, Proudhon projette dans le mutuellisme des maîtres-artisans un savoir-faire et un savoir-être qui, tous deux conjugués, pourraient agir comme une « thérapeutique à l'anxiété » capable d'exalter « dignité et fraternité ». « On peut penser que cette expérience collective était en effet créatrice d'un sentiment aigu d'autonomie et de fierté personnelle », conjecture avec lucidité Pierre Ansart. Une hypothèse bien évidemment confirmée par les développements ultérieurs du mouvement ouvrier et ses assauts sans cesse répétés contre les forces du Capital.
Ce qui est épatant dans la visée proudhonienne, c'est ce pari du spontanéisme ouvrier et la constante « négation du chef autocratique ». Si le mutuellisme de ce début du XIXe siècle comporte bien quelques figures référentielles, aucune n'a eu les moyens ou la volonté de prendre en charge un mouvement suffisamment ancré dans ses pratiques pour échapper à une quelconque récupération.
Pour Proudhon, la perception ouvrière sait faire le tri entre le « réel » et l'« artificiel ». Et Pierre Ansart de commenter : « Est réel ce monde du travail que le sujet expérimente et dont il attend la solution aux problèmes qu'il se pose. Est artificiel, en particulier, le monde de la politique qui est remis aux opinions, aux factions et au hasard. »
Soyons réalistes, exigeons l'impossible…
Le même point de départ, toujours.
Sébastien NAVARRO
[1] Jean Rouaud, L'Avenir des simples, Grasset, 2020.
[2] Sur ces deux épisodes, nous renvoyons nos lecteurs à l'étude en deux livraisons de Dominique Mandouit et Jean-Louis Panné, initialement publiée dans Le Peuple français et reprise sur notre site : « 1831 : les Canuts pour le Tarif » et « 1834 : les Canuts pour l'Association ».
26.05.2025 à 07:48
Digression sur l'effet meute
On sait depuis longtemps que la caste médiatique manifeste une certaine addiction pour la chasse en meute, penchant qui se confirme ces temps-ci au vu du procès qu'elle instruit – de CNews à France Culture – contre La France insoumise en promouvant, sans la moindre prise de distance critique, un libelle intitulé La Meute pour désigner LFI. Ses auteurs – deux investigateurs de la presse mainstream : Olivier Pérou, du Monde et Charlotte Belaïch, de Libération – y tissent, sur la base de (…)
- Digressions...Texte intégral (2609 mots)

On sait depuis longtemps que la caste médiatique manifeste une certaine addiction pour la chasse en meute, penchant qui se confirme ces temps-ci au vu du procès qu'elle instruit – de CNews à France Culture – contre La France insoumise en promouvant, sans la moindre prise de distance critique, un libelle intitulé La Meute pour désigner LFI. Ses auteurs – deux investigateurs de la presse mainstream : Olivier Pérou, du Monde et Charlotte Belaïch, de Libération – y tissent, sur la base de témoignages de déçus, de congédiés ou d'exclus de la maison-mère le plus souvent, un tel écheveau d'accusations et de griefs que tout lecteur moyennement informé en tirera la conclusion qu'il y a, à gauche, pire que le RN, à l'extrême droite, à savoir une organisation pyramidale sous étroit contrôle d'un deus ex machina chapeautant, sous la houlette de sa compagne, une jeune phalange d'affidés essentiellement carriéristes et sans scrupules en charge d'interpréter et de mettre ses diktats en musique.
Le cadre pourrait être ainsi posé : c'est donc l'histoire d'un livre foncièrement accusateur et médiocrement conçu qui, livré à l'exégèse de la nomenclature médiatique et à sa puissante capacité de nuisance, devient, en quelques jours, best-seller pour le duo et, du même coup, machine de guerre contre la seule organisation qui, quoi qu'on en pense – et on peut à l'évidence en penser du mal –, représente, en ces temps inquiétants, le seul bastion institutionnel de gauche capable, en coalisant, de résister institutionnellement au vent électoralement mauvais qui pourrait nous emporter.

Écrivant cela, je sais par avance que, me lisant, quelques-uns de mes amis – anarchistes au cuir tanné, autonomes en mal d'aurore, sectateurs de la Vieille Cause, fanatiques du A cerclé et obsessionnels du cortège de tête – vont ciller. Défendre une organisation autoritaire, c'est quoi ça ? Il m'arrive parfois de penser moi-même, mais seulement les jours chaque fois plus rares où l'enthousiasme d'un mouvement multitudinaire et inventif le permet – la dernière fois, ce fut celui des « Gilets jaunes » – qu'aucune organisation partidaire ne représentera jamais rien d'autre que la défense de ses intérêts spécifiques d'organisation, le plus souvent étrangers à l'indispensable autonomie des luttes et aux modes de fonctionnement qu'elles s'inventent. C'est un point. L'autre, c'est que, dans le dispositif médiatique dominant, il n'est, cela dit, jamais vain de saisir ce qui se joue de nouveau à la faveur de situations nouvelles. Or, pour être nouvelle, la situation politique que nous vivons l'est plutôt, et dans les grandes largeurs. On assiste, à l'échelle nationale, à une reconfiguration complète d'un paysage politique où, d'un côté, les tenants du néo-libéralisme, dont la crise est réelle et peut-être finale, sont en train de basculer, par pur intérêt et pan par pan, du côté du post-fascisme et où, de l'autre, l'ancienne gauche sociale-démocrate, devenue entre-temps libérale-démocrate, tourne sur elle-même comme un canard sans tête avec pour seul projet de ne pas disparaître, ce qui est d'autant moins gagné que, plus ça va, plus il est clair que personne ne regrettera sa disparition. Moi, le premier.
Dans le panorama chaotique de cette recomposition politico-institutionnelle inédite, LFI fait indéniablement barrage parce que « l'insoumission » qu'elle incarne structure, que cela plaise ou non, un front de résistance non négligeable au discours dominant et incarne, par sa double dimension – « mouvementiste » et « partidaire » – qu'elle n'a pas abandonnée au niveau de ses instances de direction et de prise de décisions réelles – une alternative capable de coaliser des colères et des aspirations. Autrement dit, dans un monde politique ravagé par le macronisme, contaminé par un post-fascisme devenu hypothèse plausible et où la gauche de collaboration dans ses diverses variantes ne pèse plus que son poids de ridicule, LFI est devenue la seule incarnation institutionnalisée d'une option résistante assumée, mais aussi d'un courage politique. En attestent sa constance dans le soutien à la Palestine martyrisée et les ignobles accusations, convocations, menaces, insultes et disqualifications que cette invariance lui a values. Et de même l'effort programmatique que fournit LFI quand aucun autre aspirant au pouvoir ne semble se préoccuper de savoir ce qu'il en fera, sauf une machine de répression infernale et toujours plus perfectionnée contre ses opposants, c'est-à-dire ce « nous » diversifié et varié qui nous coagule.

La « meute », c'est peut-être la bande à Méluche quand elle n'investit pas la fragile Garrido, le brave Corbière, la subtile Autain ou le très démocrate Ruffin, mais on concédera facilement que, sur ce point, la meute de Glucksmann n'est pas très différente, et pas davantage celle d'Attal, celle de Le Pen, celle de Philippe (qui s'investit tout seul), celle du Chouan Premier flic de France, celle des écolos – même si, dans leur cas, c'est toujours plus compliqué –, celle des cocos déconstruits pour qui Roussel un jour, c'est Roussel toujours. Autrement dit, dans tous les cas, c'est de la cuisine de parti. Et comme dans toute cuisine qui se respecte il y a un chef. Que Mélenchon le soit à LFI, c'est une évidence. Mais cette évidence n'atteste que d'une logique de parti, pas d'un effet de meute.
Cet effet, c'est bien sûr ailleurs qu'il faut le chercher. Dans l'alignement des planètes interprétatives sur toutes les radios et télés du PAF et dans tous les journaux mainstream, et au-delà, pour promouvoir le libelle en question en accusant LFI des pires turpitudes. C'est grossier, brutal, outrancier, primaire. Ce livre, y entend-on, constituerait un « macro-événement », la preuve incontestable en tout cas que LFI serait devenue une « secte » (Albert Ventura) experte en « enfumage et maquillage de l'antisémitisme » (Étienne Gernelle), un « mouvement fasciste » dirigé par un « Goebbels-Mélenchon » (Alain Jakubowicz). Quant à ses militants, ils seraient des « nazis de gauche » (Thierry Keller), de surcroît « jeanmarielepénisés » (Thomas Legrand). Une chiasse majuscule de plateau, en somme [1].

Dans cette curée, Mediapart fait sûrement cas à part, mais cas tout de même. On sait que son fondateur, Edwy Plenel, aujourd'hui retraité actif toujours vigilant sur sa ligne, ne porte pas Mélenchon dans son cœur, ce qu'on peut comprendre à condition que cette détestation reste professionnellement contrôlée. Donc Mediapart a commis trois journalistes – Lenaïg Bredoux, Youmni Kezzouf et Antton Rouget – pour chroniquer La Meute, dans son édition du 7 mai [2], en en rajoutant dans le croustillant, et en concluant, sur ce ton donneur de leçon qui fait sa marque, que « l'hypocrisie du bloc central, la jubilation de l'extrême droite, voire la joie un peu honteuse des socialistes et des écologistes, ne suffiront pas à disqualifier l'enquête publiée ce jour, nourrie de deux cents entretiens de témoins. Elle vient apporter des éléments supplémentaires à un tableau qui se dessine depuis plusieurs années : celui d'un mouvement dans lequel l'absence de démocratie a nourri la toute-puissance du chef, et de sa compagne, et qui exclut méthodiquement, au fil des années, les voix trop dissidentes. Au point d'instiller la “peur” et la “boule au ventre” auprès de tous ceux et toutes celles qui auraient envie d'apporter un point de vue critique. » Tout est dit : entre confrères on se soutient. L'ennemi, on le terrasse. En meute. La question, cela dit, reste ouverte : elle tient à la place qu'occupe ce brûlot dans le dispositif médiatique général, à la manière dont il a été pensé et aux intérêts qu'il sert. Ils sont clairs, en fait : après avoir tout fait, de diffamations en calomnies, de campagnes de dénigrement en accusations infondées, pour détruire LFI depuis le 7 octobre 2023 et la guerre de destruction massive des Palestiniens entreprise par le pouvoir fascisant israélien, la même meute médiatique, augmentée de Mediapart, tente une offensive conclusive tendant à démontrer que, décidément, LFI mérite d'être « détruite ». Comme Carthage ou Gaza. Ce n'est plus du journalisme, mais une battue.

Dans son blog, hébergé par Mediapart, Samuel Hayat, chargé de recherche au CNRS et chercheur en science politique, a livré un texte qui pointe quelques vérités sur LFI [3] : la première, c'est qu'elle « réussit là où d'autres partis connus et reconnus médiatiquement échouent » et qu'elle « semble être la seule vraie machine efficace à gauche » ; la deuxième, c'est que sa direction a maintenu la forme-parti au sommet de l'organisation et adopté la forme-mouvement à sa base, ce qui ne fait pas d'elle une organisation « démocratique », mais une « machine politique efficace » dans sa stratégie de conquête du pouvoir ; la troisième, c'est que le « charisme » de son chef repose, certes, sur ses talents propres, mais surtout sur le fait que la « communauté charismatique » qui l'entoure le protège dans l'épreuve ; la quatrième, c'est que la forme de « léninisme » organisationnel que LFI développe au sommet de sa pyramide n'est au service d'aucune révolution bolchevique à venir, mais d'un « projet social-démocrate » repensé et ambitieux, comme en atteste L'Avenir en commun, son programme. « Plutôt que d'accuser LFI d'être une meute et Mélenchon un gourou, pointe Samuel Hayat, il faudrait se demander pourquoi ces formes de militantisme sont fonctionnelles, adaptées tant au présidentialisme de la Ve République qu'aux logiques médiatiques et aux mutations de l'engagement militant. » Inutile de préciser que Samuel Hayat – on comprend pourquoi – squatte moins les plateaux de télé que les duettistes Olivier Pérou et Charlotte Belaïch…
Dans un autre texte publié sur le même blog [4], Samuel Hayat rappelle opportunément que, si le combat de LFI est directement axé sur la conquête du pouvoir par la voie électorale, et donc dépendant des moyens et logiques pas toujours démocratiques que cette priorité impose – quel que soit le parti y aspirant –, il existe, pour faire vivre la démocratie directe et l'aspiration à l'émancipation sociale et humaine, d'autres voies où s'invente et se recrée, au quotidien d'une multitude d'insoumissions non étiquetées, une très ancienne tradition libertaire qui n'attend d'aucun pouvoir le droit à l'expérimentation sociale, et même aux soulèvements. Longtemps portée par le syndicalisme révolutionnaire de la première CGT, ce fil ne s'est jamais cassé. Apartidaire par nature et par conviction, il tisse, d'actions directes en ZAD, des dynamiques de démocratisation réelle de la société. « Le désintérêt [de LFI] pour la démocratie interne, ponctue ainsi Hayat, a au moins le mérite de la clarté : si vous voulez la démocratie réelle, il faut aller la chercher et la faire vivre ailleurs, dans les syndicats, les associations, les luttes. » À chacun sa tâche, en somme, à chacun son terrain et ses méthodes.
Dans le paysage ravagé qui nous environne et les menaces existentielles qu'il génère, aucune insoumission n'est de trop.
Freddy GOMEZ
[1] Très illustratif sur le sujet est le texte de Pauline Perrenot publié sur le site Acrimed : « Ce que nous dit l'acharnement médiatique contre LFI »