Abonnés Articles en ACCÈS LIBRE Actu Livres Economie Environnement Genre Guerre
22.02.2024 à 11:05
Un monde sans transition ? une conversation avec Jean-Baptiste Fressoz
celianmartin
Dans son nouvel ouvrage, Sans transition : une nouvelle histoire de l’énergie, l’historien Jean-Baptiste Fressoz démontre à quel point les discours contemporains sur la « transition énergétique » sont nourris de récits historiques frauduleux sur de supposées transitions passées, préservant au passage les intérêts des multinationales du secteur. En mettant au jour l’empilement des sources d’énergie dans l’histoire (nous ne sommes jamais sortis de « l’âge du charbon » !), leurs interdépendances (ou symbioses), et la fabrique des récits de la transition, il nous invite à nous débarrasser d’un concept inopérant, qui empêche de se poser les bonnes questions.
L’article Un monde sans transition ? une conversation avec Jean-Baptiste Fressoz est apparu en premier sur Le Grand Continent.
Texte intégral (8789 mots)
L’une des thèses centrales de votre ouvrage est la mise en cause d’une vision phasiste de l’histoire de l’énergie et des matières en tant que succession d’époques matérielles distinctes (vision phasiste dont vous proposez une généalogie intellectuelle dans le chapitre 2). Or cette vision phasiste ne relève pas simplement du sens commun, mais se retrouve également dans des ouvrages d’auteurs majeurs de l’histoire environnementale. Pouvez-vous revenir sur le genre de récit que propose ce type d’ouvrage, l’usage du terme de transition qu’il mobilise, et sur les phénomènes qu’il empêche de voir ?
Il faut être futurologue ou historien pour arriver à lire l’histoire de l’énergie de manière phasiste. Si l’on prend un graphique représentant le mix énergétique mondial sur un ou deux siècles, on voit tout de suite que rien ne décroît. L’astuce pour voir des transitions, à partir des années 1970, c’est de mettre les énergies primaires en relatif et d’inclure le bois : alors deux transitions apparaissent, l’une du bois au charbon, l’autre du charbon au pétrole. Les historiens ont ensuite collé à cette vision en relatif la notion de « système technique » — qui est problématique —, l’idée qu’il y aurait un « système bois », un « système charbon », un « système pétrole », ou encore « un système technique » de la révolution industrielle centré sur le charbon et la vapeur. Toutes ces catégories sont des abstractions qui simplifient drastiquement la complexité matérielle de la production à chaque époque. Ensuite la chose principale à raconter et expliquer, ce sont les passages d’un système à un autre.
La deuxième caractéristique de l’historiographie est une forme de spécialisation. Vous avez des historiens du charbon, d’autres du bois et d’autres encore du pétrole. Résultat, les intrications entre ces matières et ces énergies qui sont le cœur de mon livre étaient relativement négligées. Enfin, troisièmement, et c’est un travers qui est assez général et qui dépasse largement la question de l’énergie, les historiens ont eu tendance à s’intéresser au nouveau à chaque époque. Ce point avait été parfaitement souligné par David Edgerton dans The Shock of the Old1. Ce biais ne fait que refléter un travers beaucoup plus large : la fascination pour l’innovation. Si vous ouvrez les pages « technologie » d’un journal, vous trouverez des informations sur les innovations voire les derniers gadgets à la mode et pas ou très peu de choses sur les vieilles techniques qui sont avec nous depuis longtemps et qui sont autrement plus importantes. Lit-on en ce moment beaucoup d’articles sur l’évolution technologique des tracteurs ou bien des machines-outils ? Et pourtant il est probable qu’il se passe des choses passionnantes dans ces domaines, peut-être plus importantes que Chat GPT. Cette façon de penser l’histoire et l’innovation est très dangereuse pour la compréhension du défi climatique.
Pourquoi ?
Prenez le dernier rapport du groupe III du GIEC d’avril 2022. Il y a plusieurs pages sur une discussion très étrange : est-ce que la transition à venir va arriver plus vite que les transitions énergétiques du passé ? Or ces transitions du passé sont des constructions intellectuelles assez fantomatiques. Prenez encore le rapport Pisani-Ferry, remis en mai 2023 à Élisabeth Borne : il conclut qu’il faut taxer les riches pour financer la transition, mais il commence nettement moins bien, avec un graphique en relatif du mix énergétique mondial pour expliquer qu’il faut une nouvelle révolution industrielle. L’idée est reprise par Agnès Pannier-Runacher, l’ex-ministre de la transition énergétique. Tout cela reflète une compréhension problématique des dynamiques énergétiques et matérielles du passé : pendant la première révolution industrielle, une notion en elle-même abandonnée depuis longtemps par les historiens, tout a crû. Il n’y a aucune transition d’une énergie à une autre. Le bois de feu croît au XIXe siècle, le bois énergie croît au XXe siècle … Ce biais se retrouve dans le discours des entreprises. Areva par exemple avait fait il y a quelques années une superbe publicité où l’on avait une vision hyper phasiste de l’énergie — éolien, hydraulique, charbon puis pétrole et maintenant place au nucléaire ! C’est pour cette raison que l’histoire de l’énergie a une importance réelle dans le débat public sur le climat. Elle est instrumentalisée à tout bout de champ.
Mon livre opère quelques déplacements par rapport à l’historiographie standard de l’énergie. Premièrement, il part d’un constat trivial et connu… depuis les années 1920 : l’histoire de l’énergie, c’est avant tout une histoire d’empilements. Ni les matières premières, ni les énergies ne sont jamais obsolètes. Et deuxièmement, un point moins trivial et moins connu : c’est une histoire de symbioses. Quand on dit « pétrole », « charbon », on manie en réalité des abstractions statistiques. Ces énergies reposent sur des bases matérielles bien plus larges que ce que désigne leur nom. Le charbon par exemple, c’est énormément de bois (il fallait à peu près une tonne d’étais pour sortir 20 tonnes de charbon au début du XXe siècle). Résultat, l’Angleterre utilise plus de bois en 1900 pour étayer ses mines de charbon qu’elle n’en brûlait un siècle plus tôt… Quant au pétrole, c’est plein de charbon (car il faut de l’acier pour l’extraire et plus encore pour le brûler) et donc de bois… Toutes ces matières et ces énergies sont complètement intriquées. Mon livre s’adresse d’abord à mes collègues historiens en disant : « Regardez, il y a des choses intéressantes qu’on n’a pas racontées », comme l’histoire des étais ou des tubes pétroliers. La question « Est-ce que la transition va avoir lieu ? » ne m’intéresse pas plus que cela parce que tout le monde sait qu’on ne va pas décarboner l’économie mondiale en trente ans. Il suffit de lire les rapports de l’Agence internationale de l’énergie (AIE) ou ceux de l’Energy Information Administration américaine.
Les transitions du passé sont des constructions intellectuelles assez fantomatiques.
Jean-Baptiste Fressoz
Dans L’Événement Anthropocène (écrit avec Christophe Bonneuil)2, vous plaidiez pour une histoire des services énergétiques (pp. 125-126). Vous revenez sur ce point dans le chapitre 1 de ce livre (« À la lueur d’une bougie »), en rappelant que ces services énergétiques ne se confondent pas avec la consommation d’énergie primaire sur un territoire national. Pouvez-vous illustrer ce distinguo avec un exemple ? Plus largement, quelles sont les implications plus larges de cette distinction pour l’histoire de l’énergie et de l’industrialisation ?
C’est un point qui est surtout important pour comprendre l’histoire de l’industrialisation au XIXe siècle, et qui devient moins important pour faire des comparaisons entre pays riches en 1960 qui ont des systèmes énergétiques relativement similaires. En revanche, au début de l’industrialisation, ne prendre en compte que l’énergie primaire biaise complètement la compréhension des dynamiques en cours, car dès que vous faites rentrer une tonne de charbon dans votre économie, d’un seul coup l’énergie explose, parce qu’il y a énormément d’énergie dans le charbon. Le problème, c’est qu’elle est utilisée dans des machines à vapeur ou des usines de gaz d’éclairage qui ont des rendements catastrophiques, et qui perdent l’essentiel de l’énergie primaire – le rendement des machines à vapeur passe de 3 à 15 % au cours du XIXe siècle. On peut aussi ajouter que l’EROI (le taux de retour énergétique) du charbon n’était pas formidable : dans les années 1920, 8 % du charbon anglais est utilisé dans les mines de charbon, rien que pour extraire du charbon ! L’histoire de l’énergie s’est construite sur les données d’énergie primaire, or ce qui compte pour l’activité économique, ce sont bien sûr les services énergétiques. C’est pourquoi l’histoire a renforcé la compréhension d’une industrialisation complètement déterminée par le charbon. C’est un point important qui est surtout historiographique. À un moment, je me suis posé la question : « Est-ce que j’ouvre le chantier d’une histoire non pas de l’énergie, mais des services énergétiques ? ». En réalité, on retomberait plus ou moins sur l’historiographie économétrique des années 1970, qui montrait que la croissance avait été bien plus progressive que l’idée d’une révolution industrielle ne le laisse paraître. Les historiens-économétriciens se basaient non pas sur les séries énergétiques, mais sur des séries économiques à travers la reconstruction du PNB. Bref, le risque était de retomber, après beaucoup d’efforts, sur des résultats assez connus. Mais il reste néanmoins bien des choses à re-raconter une fois prise en compte cette distinction. Par exemple, si vous rapportez le nombre de machines à vapeur au nombre d’entreprises en France en 1900, vous voyez que 98,6 % des entreprises industrielles et agricoles n’ont pas de moteur. L’économie française en 1900, c’est surtout beaucoup d’énergie musculaire !
Vous critiquez, à la suite de l’historien David Edgerton, le biais — aussi bien en histoire des sciences et des techniques qu’en l’histoire de l’énergie — consistant à se focaliser sur le nouveau. Vous proposez a contrario « une histoire sans direction » mettant en cause l’idée que certaines énergies seraient plus « traditionnelles » que d’autres. Cette désorientation passe dans votre ouvrage par la démonstration de la modernité de techniques ou d’énergies vues comme anciennes (la bougie ou le charbon par exemple), ou à l’inverse, par la relativisation de la modernité matérielle d’un bâtiment emblématique du capitalisme industriel, le « Palais de cristal » de l’Exposition universelle de Londres de 18513 (cf. le chapitre intitulé « Timber Palace »). Pouvez-vous revenir sur cette critique et sur la manière dont vous l’illustrez ?
Le discours sur les techniques fait des hypothèses assez arbitraires sur ce qui serait moderne et sur ce qui serait ancien. Sur le palais de cristal, on a effectivement beaucoup de discours philosophiques sur la modernité extraordinaire de ce bâtiment, symbole de la globalisation et du capitalisme moderne. Dans les manuels scolaires c’est aussi la vignette classique du chapitre sur la révolution industrielle… Certes à l’intérieur du palais de cristal, il y avait plein de machines et même un gros morceau de charbon ! Mais pour ce qui concerne le bâtiment en tant que tel, il comporte trois fois plus de bois que de fer et de verre ! Il a été conçu par l’architecte d’un immense propriétaire terrien, spécialiste des serres. Bref, c’est un bâtiment qui est ancré dans le monde aristocratique et agricole. Notez qu’en 1936, le bâtiment flambe d’un seul coup car le bois soumis à plus d’un demi-siècle d’effet de serre était parfaitement sec. Le palais de cristal est finalement une bonne métaphore du capitalisme moderne, mais certainement pas pour les raisons un peu clichées qu’en donne Sloterdijk par exemple.
Le palais de cristal illustre un décalage important entre notre compréhension de ce qui est moderne et la matérialité de la modernité. Vous citiez l’exemple de la bougie. Cet emblème de l’archaïsme est en fait un objet très moderne au XIXe siècle, issu des laboratoires de la chimie organique, produit industriellement dans de grandes usines qui importent des matières grasses du monde entier et en particulier de l’huile de palme d’Afrique de l’Ouest. On recycle aussi les graisses des abattoirs, donc c’est une forme d’économie circulaire avant l’heure ! Les bougies stéariques fabriquées à Londres, Paris ou Marseille sont exportées dans le monde entier à la fin du XIXe siècle. Cet exemple est intéressant car les historiens critiques de la modernité — par exemple Wolfgang Schivelbusch qui a écrit un bon livre sur l’histoire de la lumière4 — prennent bien trop au sérieux les prétentions des modernisateurs, dans le cas d’espèce le gaz d’éclairage, à représenter la modernité. D’ailleurs, si on poursuit l’histoire de la lumière au début du XXe siècle, la grande technologie d’éclairage, ce n’est pas l’électricité, mais… la lampe à pétrole. C’est une énergie fossile mais cela reste low-tech. Donc oui, dès qu’on creuse un domaine on se rend compte qu’on a des histoires stéréotypées de ce qui est moderne et de ce qui ne l’est pas, de ce qui est industriel et de ce qui ne l’est pas : la bougie par exemple est plus industrielle que le gaz ou du moins sa production est plus concentrée. Il y a de très grosses usines de bougies, alors que pour le gaz, il faut mettre une ou plusieurs usines dans chaque ville. Pourquoi les historiens sont fascinés par le gaz d’éclairage ? Parce que c’est une technique qui fonctionne en réseau, et la modernité, c’est forcément le réseau.
Le discours sur les techniques fait des hypothèses assez arbitraires sur ce qui serait moderne et sur ce qui serait ancien.
Jean-Baptiste Fressoz
Votre livre, comme celui d’Antonin Pottier que vous mentionnez à plusieurs reprises dans l’ouvrage5, peut être vu comme une sorte de critique environnementale de l’économie politique : pouvez-vous revenir sur le rôle de certains économistes dans la fabrique de l’apathie climatique, et notamment celui de William Nordhaus, lauréat du « prix Nobel » d’économie en 2018 (vous rappelez la déclaration assez stupéfiante de son co-récipiendaire Paul Romer qui affirme que grâce à la recherche et développement dans les innovations vertes, « décarboner l’économie sera si facile qu’en regardant en arrière on aura l’impression de l’avoir fait sans effort ») ?
Le cas de Nordhaus est intéressant par rapport à ce que je raconte car c’est le premier économiste du climat, il a reçu un prix Nobel pour ses travaux, or il a une vision aberrante de l’histoire des techniques qui n’est pas sans conséquence sur ses conceptions économiques. Dans un papier célèbre, Nordhaus montre que le prix de la lumière s’est effondré au cours de l’histoire grâce au progrès technologique. Mais il confond les dates d’innovations et les dates d’usage. Les théories économiques de Nordhaus ont déjà été bien étudiées par Antonin Pottier. Son prix Nobel a suscité un grand émoi — il montrait par exemple que le réchauffement optimal était de 3,5°C. Mais il y a un aspect de contexte historique qui n’avait pas été remarqué : l’utopie nucléaire. Quand Nordhaus commence à réfléchir sur le climat en 1974-75, il travaille au IIASA (International Institute of Advanced System Analysis), dans un petit groupe d’experts obsédés par le surgénérateur nucléaire. Selon eux, le surgénérateur devait être disponible et même généralisable d’ici à l’an 2000. On ne saurait surestimer l’importance du surgénérateur dans l’imaginaire des premiers experts du climat, aux États-Unis et au IIASA. Le surgénérateur a été un grand projet technologique, il a représenté de 30 à 40 % de la recherche et développement publique sur l’énergie en Angleterre, en France, aux Etats-Unis dans les années 1970. C’est un immense espoir. Grâce au surgénérateur, les horizons temporels de l’énergie deviennent infinis ou se comptent en dizaines de milliers d’années. Tout cela a eu une très grande influence. En 1974 donc Nordhaus travaille au IIASA dans le programme énergie dirigé par Wolf Häfele, qui est l’ancien directeur des surgénérateurs en Allemagne. Il s’initie à la question climatique auprès d’un personnage fascinant qui s’appelle Cesare Marchetti, moins connu que Nordhaus, mais qui a joué un rôle intellectuel capital dans la théorie de la transition énergétique. Marchetti est aussi un fervent défenseur du nucléaire et de l’hydrogène. En 1973, dans un article important, Nordhaus explique qu’il ne faut pas dans un contexte de montée des prix du pétrole faire des efforts de conservation car d’ici l’an 2000, le surgénérateur nucléaire sera disponible et dévalorisera les réserves de pétrole restant sous le sol. Donc autant exploiter le pétrole quand il vaut encore cher ! Le surgénérateur est qualifié de « backstop technology », un filet de sécurité technologique. Et deux ans après, il utilise le même raisonnement sur le changement climatique : cela ne sert à rien de faire des efforts maintenant, parce que ça nous coûtera cher et qu’on n’a pas les technologies, alors que d’ici l’an 2000, on aura le surgénérateur pour faire la transition, qu’il qualifie encore de « backstop technology ». Cela soulève un point historique clef : la question climatique émerge dans la décennie de la « crise énergétique » et les premiers économistes à se saisir de la question ont travaillé sur la crise énergétique. Il y a une continuité forte entre les raisonnements sur la crise énergétique et les raisonnements sur la crise climatique. Nordhaus a eu une grande influence dans les premiers rapports du GIEC. Dans le deuxième rapport de 1995, il est explicitement écrit qu’il vaut mieux ne pas faire d’efforts tout de suite, parce que ce sera plus facile plus tard, et qu’en plus, le cycle naturel du carbone nous aide à réduire la quantité de CO2 dans l’atmosphère. Enfin, je montre que le président du groupe III du GIEC au début des années 1990, Robert Reinstein, qui — c’est intéressant — est ouvertement climatosceptique, explique consulter Nordhaus et s’inspirer de ses travaux ! Donc oui, les théories de Nordhaus ont directement servi la procrastination climatique.
À partir des années 2000, il est vrai que son influence s’érode car l’objectif des deux degrés devient central dans les négociations climatiques, alors que Nordhaus le disait explicitement : « Deux degrés, c’est comme les panneaux sur l’autoroute indiquant 50 miles par heure aux États-Unis, c’est assez arbitraire et injustifié ». Ici on a affaire au deuxième Nordhaus, bien analysé par mon collègue Antonin Pottier, le Nordhaus du modèle DICE, un modèle coûts/bénéfices où il arrive à la conclusion qu’une augmentation de 3,5 degrés correspond à la température économiquement optimale !
Dans la troisième partie, comme vous l’avez indiqué, vous revenez sur l’histoire du groupe III du GIEC (le groupe évaluant les « solutions ») de manière assez iconoclaste, en montrant que ce dernier préconise en fait une ligne assez attentiste dans les années 1990. Comment expliquer l’évolution profonde que vous repérez dans les années 2000 ? Et comment celle-ci a-t-elle rejailli sur les solutions envisagées depuis lors (vous rappelez qu’en 2005, on trouve encore dans un rapport spécial du GIEC des projets de « lacs » artificiels de dioxyde de carbone au fond des océans…) ?
Je ne suis pas expert de ces questions et il y a des gens qui ont travaillé plus sérieusement que moi sur ce point, comme Hélène Guillemot et Béatrice Cointe. Dans les années 2000, l’objectif des deux degrés s’impose, et même 1,5 degré à Paris en 2015. Et donc à partir de là, on a des scénarios très différents de ce qui était fait dans les deux premiers rapports. Des objectifs NZE (Net Zero Emissions) qui incluent des quantités gigantesques « d’émissions négatives ». En pratique, cela revient à utiliser des BECCS (pour Bioenergy Carbon Capture and Storage) : brûler du bois dans des centrales thermiques pour récupérer ensuite le CO2 et l’enfouir sous le sol. Personne n’y croit vraiment, c’est une cheville pour faire entrer l’économie mondiale sous la barre des 2°C. Ce point soulève une question intéressante, me semble-t-il, sur l’effet politique, volontaire ou involontaire, qu’ont ces scénarios net zéro. Leur but est bien sûr d’éclairer la décision. Ce sont des expériences de pensée assistée par ordinateur. On fixe une limite de réchauffement à 2100 et le IAM (modèle d’évaluation intégré) calcule des trajectoires incluant plus ou moins d’efficacité énergétique, de diffusion de renouvelables, de CCS ou de de BECCS. Ces scénarios sont purement normatifs. Ils ne sont pas prédictifs, prospectifs. Une fois encore, les prospectives de l’Agence internationale de l’énergie (le scénario STEPS) n’envisage pas de décarbonation, seulement une légère diminution du charbon d’ici à 2050. La faisabilité, la plausibilité des scénarios NZE n’est pas évaluée ou peu évaluée. Leur réalisme économique et technologique est probablement très faible.
Pourquoi les historiens sont fascinés par le gaz d’éclairage ? Parce que c’est une technique qui fonctionne en réseau, et la modernité, c’est forcément le réseau.
Jean-Baptiste Fressoz
Mais quel est l’effet politique de ces scénarios qui semblent montrer que tout est possible ? Je n’ai pas de réponse tranchée, mais il faut qu’on ait une discussion là-dessus. Il faut aussi qu’on ait une discussion sur les visions du monde et de la technique qui transparaissent dans les rapports du groupe III du GIEC où l’on parle essentiellement de technologies et surtout de technologies complexes qui concernent les pays riches. Le quatrième rapport annonçait par exemple que la fusion nucléaire serait disponible commercialement d’ici à 2050. À l’inverse, dans leurs rapports du groupe III, peu de choses sont dites, mettons sur le train ou la diffusion possible des bicyclettes ou des visioconférences… Bien sûr que ces visions du futur, que ce soient la fusion ou les BECCS, sont discutables et hautement politiques. Le problème est que le débat est très polarisé : dès qu’on commence à discuter la moindre phrase du groupe III, y compris quand il y a une bêtise évidente (quand ils parlent d’histoire), on passe presque pour un dangereux luddite anti-science sur les réseaux sociaux…
Pouvez-vous revenir sur le rôle de certains économistes dans cette évolution du groupe III (notamment Jean-Charles Hourcade) ?
J’ai beaucoup discuté avec Jean-Charles Hourcade sur cette période-là, qu’il a vécue, et il me disait qu’il y avait une vraie bataille avec Nordhaus et le parti de l’attentisme. Ce que Hourcade et ses collègues montraient, modèles à l’appui, c’est qu’il était capital de faire dès maintenant des efforts tout de suite parce que la technique ne tombe pas du ciel. Mais encore une fois, je ne suis pas expert de ces questions. Concernant les rapports, ce qui se passe, c’est que dans le groupe III du GIEC, il y a les rapports centraux, les Assessment reports, tous les 6 ans. Mais parfois, il y a des rapports vraiment étranges quand les gouvernements en demandent sur des sujets précis. Par exemple, en 2005 paraît un rapport sur le CCS (Carbon Capture and Storage), quand l’industrie pétrolière fait miroiter cette solution. Et paf, on a un rapport estampillé GIEC qui propose tout plein de solutions venues de l’industrie pétrolière, y compris d’étranges lacs artificiels de dioxyde de carbone reposant au fond des océans — ce qui n’est probablement pas extraordinaire pour les écosystèmes marins… Le GIEC est un groupe intergouvernemental, donc les gouvernements y ont évidemment un certain rôle, ce qui peut poser problème scientifiquement.
Vous pointez, très rapidement (pp. 272-273), les limites du champ des Sciences and Technology Studies (auxquelles vous avez été formé) lorsqu’il s’agit de comprendre la nature du défi climatique, ainsi que certains aspects de la pensée de Bruno Latour. Pouvez-vous préciser ces réserves et revenir sur votre parcours ?
Plutôt que des limites, c’est plutôt une focalisation sur l’innovation qui a conduit à ce que ce champ soit en décalage par rapport à la question climatique. Quand je découvre les STS (Science and Technology studies) au début des années 2000, le grand sujet, ce sont les innovations, les controverses socio-techniques et l’incertitude. Or pour ce qui concerne le climat, dès 1979 la question n’est plus celle de l’incertitude : il va se réchauffer à cause des émissions de GES (gaz à effet de serre). Le second problème des STS était la manière de traiter le phénomène technologique en le réduisant à l’innovation. En France, à Paris-IV, c’est un Centre d’histoire de l’innovation qui s’occupe des techniques. Bruno Latour officie aussi au Centre de sociologie de l’innovation de l’École des Mines. Sa théorie de l’acteur-réseau, une construction intellectuelle anti-déterministe, est née de sa sociologie de l’innovation et de la capacité supposée de l’innovateur et des dispositifs techniques à reconfigurer le social. Quand on prend un peu de recul on discerne facilement l’influence du revival de Schumpeter en économie — la destruction créatrice, l’innovation disruptive — dans ces analyses. En histoire et en sociologie des techniques on insiste aussi beaucoup trop sur la « construction sociale des techniques ». Les travaux se focalisent sur le moment de l’innovation, quand elle aurait pu prendre des formes variées, ils se focalisent aussi sur les consommateurs ou les « parties prenantes », leur capacité à façonner la technique. Les questions économiques et les contraintes matérielles passent au second plan. Pensez à l’ouvrage de Latour sur Aramis, un métro automatique avec des wagons autonomes qui aurait échoué, conclut Latour, « faute d’avoir été suffisamment aimé ». Toutes ces approches ne sont pas sans intérêt, loin de là, et permettent de produire des enquêtes empiriques très riches. Mais il est vrai que le changement climatique soulevait des enjeux complètement différents de ceux étudiés par les STS des années 2000 : il n’y a pas ou peu d’incertitude et il est causé par des vieilles techniques qui sont très difficiles à infléchir pour des raisons matérielles et économiques.
La technique ne tombe pas du ciel.
Jean-Baptiste Fressoz
Pour revenir sur mon parcours, j’ai eu la chance d’être formé par deux personnalités scientifiques qui se sont tenues à distance des STS dans ce qu’elles avaient de plus problématique. J’ai fait ma thèse au Centre Alexandre Koyré avec l’historien des sciences Dominique Pestre, qui était très critique vis-à-vis de la sociologie des controverses socio-techniques et l’idée sympathique mais utopique de démocratie technique. Le centre Koyré était aussi novateur dans le paysage des sciences sociales françaises pour ses travaux sur les questions environnementales. C’est là que je rencontre Christophe Bonneuil qui est alors un jeune chercheur et qui aura beaucoup d’influence sur mon itinéraire ultérieur, ainsi qu’Amy Dahan, une spécialiste des négociations climatiques. Ensuite je suis recruté comme lecturer à l’Imperial College de Londres où travaillait l’historien des techniques David Edgerton. Son livre The Shock of the Old fut pour moi un choc intellectuel, fournissant la meilleure critique des discours schumpétériens sur la technique. C’est un livre capital qui redéfinit le champ de l’histoire des techniques, en élargit le domaine et l’intérêt, un livre dont les enseignements pour la question climatique restaient encore à tirer.
La deuxième partie de l’ouvrage propose une histoire intellectuelle de la notion de transition et revient sur l’influence de celle-ci dans les politiques climatiques (à l’échelle globale et nationale). Dans cette dernière partie, vous relativisez l’importance historique du climatoscepticisme ; ce qui a été déterminant à vous lire, c’est la croyance partagée, y compris par des experts du climat aussi éminents que Roger Revelle, en la possibilité d’une transition rapide, à l’échelle du demi-siècle (échéance brandie sans aucune justification). L’autre élément marquant que vous mettez en avant, à la suite de Romain Felli6, c’est la croyance — résignée ou confiante — des gouvernements dans la capacité à s’adapter, qu’on évoque dès la fin des années 1970, en tout cas aux États-Unis, et dans les années 1980 en Grande-Bretagne ; il nous semble que c’est là l’une des nouveautés qu’apporte votre ouvrage7. Par ailleurs, à vous lire, ces choix sont opérés en dehors de tout débat public. Ce choix de l’adaptation n’est-il pas contradictoire avec la croyance en une transition rapide que vous évoquez ?
Il y a depuis les années 2010 un très fort intérêt public pour la question du climatoscepticisme et de la construction du doute en général. Les collègues ont beaucoup travaillé ce sujet, pour des raisons principalement judiciaires — nourrir les procès contre les entreprises pétrolières. Bien sûr le climatoscepticisme a existé, il existe encore, il est parfaitement documenté. Il y a des entreprises pétrolières, Exxon tout particulièrement, qui ont créé du doute pour des raisons stratégiques et qui, espérons-le, seront sévèrement ponctionnées pour cela. Après, la question qui se pose à l’historien des années 1980-2000 est la suivante : est-ce que le climatoscepticisme est si déterminant que cela pour comprendre l’inaction climatique ? Depuis que le groupe Total (TotalEnergies) se déclare très concerné et « en transition », arrête-t-il pour autant de pomper du pétrole ? Ce hiatus entre un discours de la transition et des pratiques du réchauffement et de l’adaptation, c’est ce que je vois déjà en action au sein de l’élite politique et industrielle américaine des années 1980. Il y a du climatoscepticisme chez certains bien sûr, en particulier autour du président George Bush Père avec John Sununu, son influent chef de cabinet, mais il y a surtout bien d’autres manières plus subtiles de repousser le problème.
Concernant votre question sur transition et adaptation, les personnes et les dates ici sont importantes. Vous mentionniez le cas de Roger Revelle qui, effectivement, en 1979 au Sénat, raconte absolument n’importe quoi sur les transitions du passé qui montreraient qu’on peut faire une transition rapide hors des fossiles en moins de 50 ans. Mais quelques années plus tard, cette position n’est plus vraiment crédible car des modèles énergétiques globaux indiquent au contraire que les émissions vont beaucoup croitre d’ici à 2050.
The Shock of the Old fut pour moi un choc intellectuel, fournissant la meilleure critique des discours schumpétériens sur la technique. C’est un livre capital qui redéfinit le champ de l’histoire des techniques, en élargit le domaine et l’intérêt, un livre dont les enseignements pour la question climatique restaient encore à tirer.
Jean-Baptiste Fressoz
Il y a d’autres trajectoires plus complexes et plus intéressantes. Prenez par exemple Caroll L. Wilson. C’est un personnage méconnu mais qui joue un rôle fondamental dans l’alerte climatique. Au début des années 1950, il est directeur exécutif de l’AEC (Atomic Energy Commission) et commence déjà à s’intéresser au réchauffement climatique qui a toujours été un excellent argument en faveur du nucléaire. En 1970, il contribue à lancer la question du climat à l’échelle internationale. Et puis à la fin de la même décennie, il pilote le rapport WOCOL sur le charbon : il faut relancer le charbon à l’échelle mondiale car le nucléaire ne tiendra pas ses promesses, les commandes de centrales sont en chute libre à ce moment-là. Il voit aussi que l’essentiel va se jouer en Asie. Dans le rapport WOCOL, l’expert chinois explique que son pays sortira probablement 2 gigatonnes de charbon d’ici l’an 2000. À ce moment-là, la production mondiale de charbon, c’est 3 gigatonnes. Donc je pense que ça calme les ardeurs des Américains lorsqu’il s’agit de se demander : « Est-ce qu’on fait un effort sur le changement climatique ? ». Cela n’empêche pas Wilson de penser le changement climatique. Ce n’est pas un climatosceptique : c’est juste qu’il y a un besoin croissant d’électricité dans le monde, « donc » il faut extraire du charbon. À la fin de sa vie, quand il reçoit le prix Tyler sur l’environnement, son discours est sur l’adaptation et le rôle des OGM pour adapter l’agriculture à un monde qui se réchauffe.
Après il y a aussi dans les années 1980 un double discours de l’élite américaine. Un discours très public sur la transition, surtout à destination des autres pays puis au sein des premières COP. Et un discours plus discret mais crucial pour comprendre la position américaine sur l’adaptation. Une fois encore, ce qui est nouveau, à la fin des années 1970, c’est qu’on a des modèles énergétiques globaux, et aucun ne prévoit de diminution du charbon ou du pétrole. La question devient naturellement : « Ça va se réchauffer, est-ce que c’est grave ? ». Et là, assez vite, il y a un consensus dans les think tanks importants autour de la Maison Blanche, qui disent : « Trois degrés, les États-Unis, ça va, on saura s’adapter ! ».
Je crois que cette histoire est importante car on est encore dans ce régime. Le discours sur les méchantes compagnies pétrolières climatosceptiques est trop rassurant. Il crée une dichotomie entre le capitalisme fossile et le capitalisme vert, une dichotomie ensuite entre un avant où la bataille scientifique était indécise, et un présent où maintenant l’on sait. Insister ainsi sur le rôle du non-savoir, c’est donner beaucoup trop de poids au savoir. J’avais déjà critiqué dans L’Apocalypse joyeuse cette idée d’une « prise de conscience ». Cette vision d’un « éveil » est politiquement contre-productive, en plus d’être historiquement fausse.
L’ouvrage insiste particulièrement sur les temporalités projetées, notamment en ce qui concerne le temps que devrait prendre une éventuelle transition. Or vous rappelez qu’en 1979, au moment du rapport Charney, si la réalité du réchauffement ne fait plus vraiment débat parmi les experts américains du climat, son échéance est encore indécise (pp. 276-277). Cette incertitude n’a-t-elle pas été un facteur de procrastination ? A partir de quand une chronologie plus fine du réchauffement climatique émerge-t-elle ?
Très tôt, il y a des débats sur la dislocation de l’Antarctique Ouest, qui fait craindre une grande élévation du niveau de la mer. Mais on ne sait pas précisément quand ça va arriver, et c’est d’ailleurs toujours le cas aujourd’hui, même si les nouvelles semblent plutôt mauvaises sur ce terrain. Le tempo de la catastrophe qu’on trouve dans les années 1970 — et qui est malheureusement assez raccord avec ce qui se passe — c’est que le changement climatique sera sensible en l’an 2000, qu’il aura des conséquences économiques en 2020, et il sera catastrophique en 2080… On n’a plus qu’à espérer que les climatologues se soient trompés sur la dernière date… En 1978-80 quand vous entendez 2080, cela paraît de la science-fiction. C’est pour ça que les climatologues disent : « On va faire une transition ! ». Et que Exxon peut dire la même chose. Et c’est là où l’on voit que l’histoire joue un certain rôle, parce qu’ils n’arrêtent pas de dire : « Il y a eu des transitions par le passé et elles ont pris 50 ans »… Revelle dit précisément cela quand il témoigne devant le Sénat américain, il convoque l’histoire pour démontrer qu’il faut 50 ans pour faire une transition, alors qu’en réalité on n’en sait rien.
Insister ainsi sur le rôle du non-savoir, c’est donner beaucoup trop de poids au savoir. J’avais déjà critiqué dans L’Apocalypse joyeuse cette idée d’une « prise de conscience ». Cette vision d’un « éveil » est politiquement contre-productive, en plus d’être historiquement fausse.
Jean-Baptiste Fressoz
C’est d’autant plus étrange que Revelle n’est pas qu’un océanographe, il s’occupe à cette époque de démographie et de population. Mais cela montre qu’il n’avait pas encore vraiment réfléchi à ce que c’était que sortir des fossiles. Le débat était limité aux systèmes électriques : c’est vrai qu’en 50 ans, on peut faire basculer un système électrique du charbon au nucléaire : la France l’a fait en moitié moins de temps… Mais peut-être n’avait-il pas pris la mesure de tout ce qu’il y a en dehors du système électrique : les transports, le bâtiment, l’aviation, le plastique, l’acier, les engrais, etc. On n’avait pas encore commencé à réfléchir à ça. Par contre, chez Exxon, c’est clairement le cynisme qui est derrière le bla-bla de la transition. Sur ce point encore, Exxon ment. Edward David, qui parle aux climatologues en 1982, dit que, puisque le système énergétique est en transition, la question intéressante, c’est : qu’est-ce qui va arriver avant, le changement climatique ou la transition énergétique ? Et bien sûr, ajoute-t-il, la transition arrivera avant. Et là il ment : quelque mois après, il se trouve à Pékin et il dit exactement l’inverse, les fossiles domineront l’énergie encore loin dans le XXIe siècle.
Quel rapport (historique et idéologique) existe-t-il entre la notion de transition et celle de « développement durable », autre concept consensuel et extrêmement présent dans le débat public ? Alors que ces notions semblent aux antipodes de la stratégie du doute du climatosepticisme, doit-on y voir au contraire les éléments d’un même arsenal discursif au service du business as usual et de « l’idéologie du capital » ?
Il y a eu pas mal de travaux sur l’émergence du concept de développement durable, qui est proposé par le rapport Brundtland de 1987, puis qui explose dans le discours entrepreneurial dans les années 1990, Dominique Pestre l’a bien montré par exemple8. Je pense que ce sont des dispositifs analogues politiquement qui reviennent à créer l’illusion du contrôle et de la maîtrise. Cela sert à justifier la croissance, à l’imaginer déconnectée des flux des matières… Quand on regarde chronologiquement, la transition énergétique explose dans les années 2000, en réponse à l’objectif des deux degrés. Et peu à peu le terme remplace le développement durable qui était devenu bien trop galvaudé. Dans les années 2000, la transition énergétique a repris l’importance qu’elle avait eue dans les années 1970. Sauf que dans les années 1970, la transition énergétique visait à sortir d’une crise des ressources, ce qui pouvait faire sens : s’il y a moins de pétrole, vous diminuez l’intensité pétrole de votre économie donc vous êtes plus résilient face au renchérissement du prix du pétrole. Et on a repris ce concept-là pour quelque chose de très différent. J’insiste beaucoup là-dessus : on plaque une futurologie néomalthusienne sur les ressources à une situation entièrement différente où on a énormément de ressources qu’il ne faut pas utiliser. Quant à mettre les concepts de transition énergétique, de développement durable et de climatoscepticisme dans le même sac, cela peut être compliqué à dire, car il y a plein de gens bien intentionnés qui s’impliquent dans la transition énergétique. Et cela les énerve inutilement. Les critiques de mon livre sont généralement des entrepreneurs qui s’impliquent dans la transition énergétique et qui se sentent attaqués. Alors que ce n’est pas du tout le cas. Le problème, c’est que la transition énergétique est une notion suffisamment malléable pour servir tout autant à Airbus, Total, Vinci qu’à des planteurs d’éoliennes : c’est ça qui m’intéresse. Je le dis pourtant dans l’introduction et le répète dans la conclusion, les énergies renouvelables sont essentielles ! Le débat est si polarisé que si l’on dit que les éoliennes et les panneaux solaires c’est très bien, mais que cela ne va pas tout décarboner et certainement pas dans les temps impartis (2050), on passe soit pour un pronucléaire, soit carrément pour un climatosceptique, c’est usant…
Si le concept de transition est inopérant, quels concepts seraient selon vous plus appropriés pour faire face à la catastrophe en cours ?
Il y en a deux, je pense. D’abord, la diminution de l’intensité carbone de l’économie. Concrètement, c’est ce qu’on fait avec les renouvelables. Parce qu’il y a besoin de back-up, parce que ça n’est pas non plus complètement décarboné, parce qu’elles alimentent en courant une économie qui dans sa matérialité même (acier, ciment, plastique) va dépendre du carbone pendant encore longtemps : une voiture électrique par exemple, ce n’est évidemment pas décarboné, même si cela diminue l’intensité carbone du transport. C’est évident. Pourquoi faut-il le préciser ? Parce que ça oblige à laisser sur la table la question de la taille de l’économie.
On plaque une futurologie néomalthusienne sur les ressources à une situation entièrement différente où on a énormément de ressources qu’il ne faut pas utiliser.
Jean-Baptiste Fressoz
Et donc la deuxième notion, logiquement, c’est la décroissance, le démantèlement de certains espoirs, projets, dispositifs techniques. Il y a des choses qu’il va falloir réduire voire abandonner, et organiser cela. Et une fois qu’on a dit ça, c’est la question de la répartition qui réapparaît. Si on n’imagine pas un monde où tout va croître sans problème d’environnement, la question des inégalités revient de manière un peu plus brûlante. Tout ceci est fort banal, mais cela donne un autre sens politique à la question climatique. Le débat devient un peu moins centré sur les technologies, même si celles-ci sont évidemment importantes, et un peu plus centré sur les questions sociales, par exemple. Et puis aussi sur la question nord-sud qui est le cœur absolu du problème climatique.
Vous insistez à plusieurs reprises sur le caractère rassurant de la notion de transition énergétique. À l’inverse, vous écriviez dans un texte de 2018 (« Quand la catastrophe suit son cours »9) que « l’histoire nous donne de bonnes raisons d’avoir peur ». Quels effets — ou quels affects — espérez-vous susciter avec la publication de ce livre ? Défendez-vous l’idée, comme Hans Jonas, d’une « heuristique de la peur » ?
Deux postures sont effectivement possibles, mais il y en a une qui est plus fondée empiriquement que l’autre. La première option, c’est de dire : la transition est en marche, il suffit de l’accélérer, faites-nous confiance ! La deuxième : il y a encore d’énormes obstacles technologiques pour imaginer une société décarbonée, et donc tout un chacun doit s’intéresser à cela, comprendre un peu l’expertise, mettre son nez dans les scénarios NZE, regarder leurs hypothèses, s’intéresser au CCS et aux BECCS. La peur, ce n’est pas un sentiment honteux, ce n’est pas « antiscience », anti-progrès ou quoi que ce soit. Après, ce n’est pas mon métier que de dire politiquement ce qu’il faut faire ou penser. Je n’ai rien de très original à dire là-dessus.
Quelles sont vos envies de recherche dans les années à venir ?
Je voudrais étendre cet argument des services énergétiques au muscle humain. Je voulais faire un chapitre sur le muscle humain parce que l’histoire de l’énergie est beaucoup trop centrée sur les machines et les fossiles. Je vais travailler sur le muscle humain au XXe siècle pour comprendre la dynamique historique qui aboutit au constat des sociologues comme David Gaborieau ou Juan Sebastian Carbonell. Chez les historiens, il y a encore une ligne à tracer pour comprendre pourquoi le muscle humain reste absolument central dans d’innombrables univers productifs. Et aussi travailler davantage sur les techniques dans les pays pauvres. Voilà, c’est un peu ça mon envie de recherche actuellement : la modernisation de l’usage du muscle humain dans la production. Le muscle humain n’est pas du tout ringard, c’est quelque chose qui se modernise, tout comme la bougie d’une certaine manière. Et puis ce qui me fascine c’est l’histoire de techniques sous-étudiées comme les pelles, les brouettes, les tonneaux. La brouette, c’est surtout dans les années 1950 que ça se diffuse dans les pays riches, donc ce n’est pas du tout une technique ancienne10.
L’article Un monde sans transition ? une conversation avec Jean-Baptiste Fressoz est apparu en premier sur Le Grand Continent.
02.02.2024 à 11:40
20 livres à lire en février 2024
Marin Saillofest
Du libre-échange à la vie de bohème en passant par l'histoire impériale à travers le prisme de la violence, les parutions de ce mois-ci sont riches. Pour naviguer dans les sorties à venir en février, voici notre sélection des meilleurs publications en sciences sociales.
L’article 20 livres à lire en février 2024 est apparu en premier sur Le Grand Continent.
Texte intégral (6593 mots)
Steve Coll, The Achilles Trap ; Saddam Hussein, the CIA, and the Origins of America’s Invasion of Iraq, Penguin
« The Achilles Trap démêle les personnes, les stratagèmes et les enjeux de pouvoir qui ont conduit à la désastreuse guerre des États-Unis contre l’Irak, détaillant les erreurs d’appréciation fondamentales de l’Amérique dans sa relation ruineuse avec Saddam Hussein, qui dure depuis des décennies. En commençant par l’arrivée au pouvoir de Saddam en 1979 et la naissance du programme secret d’armement nucléaire irakien, Steve Coll retrace les motivations de Saddam. Il fait revivre les diplomates, les scientifiques, les membres de la famille et les généraux qui n’avaient d’autre choix que de s’en remettre à leur chef, un chef directement responsable de la mort de centaines de milliers d’Irakiens, ainsi que de la torture ou de l’emprisonnement de beaucoup d’autres. La CIA et les administrations présidentielles successives n’ont pas réussi à saisir les nuances essentielles de sa paranoïa, de ses ressentiments et de ses incohérences, même lorsque les enjeux étaient incroyablement élevés.
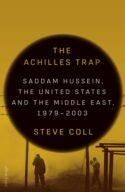
S’appuyant sur des sources inédites et peu médiatisées, sur des entretiens avec des témoins et sur les transcriptions et fichiers audio de Saddam lui-même, The Achilles Trap dresse le portrait remarquable d’un dictateur qui était convaincu que le monde lui voulait du mal et qui a agi en conséquence. Il révèle la manière dont la corruption du pouvoir, les mensonges de la diplomatie et la vanité – des deux côtés – ont conduit à des erreurs d’État évitables : des erreurs qui allaient engendrer des souffrances humaines incommensurables et changer à jamais notre paysage politique. »
Parution le 27 février
Emmanuel Droit, La dénazification. Posthistoire du IIIe Reich, Puf
« Ni complète ni irréprochable, la dénazification se donnait pour ambition de punir et de rééduquer une population allemande jugée coupable. Si cette politique publique épuratoire fut mise en œuvre de manière différente selon les zones d’occupation, elle n’en fut pas moins vécue et partagée par des millions d’Allemands. Plus qu’une procédure politico-judiciaire, elle fut ainsi une expérience tant individuelle que collective, sociopolitique, de responsabilisation, de marginalisation et de réintégration.

Dans cette enquête, Emmanuel Droit tente de cerner au plus près cette expérience majeure de l’histoire du XXe siècle. Entre exigence de transparence et volonté de soustraire certains faits aux puissances occupantes, puis aux autorités allemandes, de les passer sous silence ou de les travestir, il affronte la difficile question des liens entre vérité et histoire, mais aussi entre justice et pardon. »
Parution le 14 février
Andreas Schwab, Freiheit, Rausch und schwarze Katzen. Eine Geschichte der Boheme, C. H. Beck
« Else Lasker-Schüler, Richard Dehmel, Edvard Munch, Oda Krogh, Henri Murger, Franziska zu Reventlow, August Strindberg, Frank Wedekind – tous faisaient partie de la bohème, cette sous-culture artistique qui s’est développée dans le dernier tiers du XIXe siècle à Paris et à Vienne, à Munich et à Berlin, et qui s’est opposée à la société bourgeoise par son style de vie libertin, son esprit rebelle et, surtout, ses conditions financières précaires. Ce livre raconte leur histoire.

La bohème a révolutionné les opinions sur ce qui constitue une bonne vie. Et ce, moins dans des textes et des manifestes que dans la vie active avec toutes ses ambivalences. Andreas Schwab ne dresse pas seulement le portrait des écrivains et des artistes, des hommes et des femmes de la bohème, à l’origine de cette révolution du mode de vie, mais évoque également les lieux où ils se rencontraient, le bar « Das schwarze Ferkel » à Berlin, le « Chat Noir » à Montmartre à Paris, le « Café Stefanie » ou le cabaret « Die Elf Scharfrichter » à Munich. Il en résulte une description de la vie de bohème à l’atmosphère dense, qui fait ressentir la fascination qu’elle exerce et qui s’étend jusqu’à notre époque. »
Parution le 15 février
Elisabeth Braw, Goodbye Globalization ; The Return of a Divided World, Yale UP
« Après la guerre froide, la mondialisation s’est accélérée à une vitesse vertigineuse. La production, le transport et la consommation ont défié les frontières nationales, les entreprises ont gagné plus d’argent et les consommateurs ont eu accès à un éventail toujours plus large de biens. Mais ces dernières années, un profond changement s’est amorcé.

Les chefs d’entreprise et les hommes politiques se rendent compte que la mondialisation ne fonctionne plus. Les chaînes d’approvisionnement sont menacées, la Russie a été expulsée de l’économie mondiale après son invasion de l’Ukraine, et la Chine utilise ces fissures pour obtenir un avantage stratégique. Compte tenu de ces pressions, à quoi ressemblera l’avenir de notre économie mondiale ?
Dans cet ouvrage novateur, Elisabeth Braw explore l’effondrement de la mondialisation et les profonds défis qu’il posera à l’Occident. S’appuyant sur des entretiens avec des dirigeants et responsables politiques du monde entier, elle pose les questions difficiles auxquelles toutes les entreprises et toutes les économies seront confrontées et retrace l’histoire complexe de la mondialisation, depuis l’exubérance des années 1990 jusqu’à la crise actuelle. »
Parution le 12 février
Vincent Pouliot et Jean-Philippe Thérien, Comment s’élabore une politique mondiale. Dans les coulisses de l’ONU, Presses de Sciences Po

« Dysfonctionnements organisationnels, manque d’expertise, absence de volonté politique sont souvent invoqués pour expliquer l’incapacité des institutions internationales à gérer les défis planétaires. Vincent Pouliot et Jean-Philippe Thérien battent en brèche ces idées reçues. Selon eux, la gouvernance mondiale est foncièrement politique car elle procède toujours d’un choix de pratiques et de l’affirmation de certaines valeurs en opposition à d’autres. Pour le démontrer, ils se sont penchés sur la fabrique de trois initiatives onusiennes contemporaines : l’adoption des Objectifs de développement durable en 2015, l’institutionnalisation du Conseil des droits de l’homme à partir de 2005 et la promotion continue de la protection des civils dans les opérations de paix. En observant au plus près les dynamiques de pouvoir mais aussi le bricolage qui ont présidé à leur naissance, ils montrent que l’élaboration des politiques mondiales s’apparente à la confection d’une mosaïque, entre improvisation et conflits sociaux, et qu’elle exprime une vision particulière du bien commun, souvent aux dépens d’autres perspectives. »
Parution le 16 février
Marc-William Palen, Pax Economica ; Left-Wing Visions of a Free Trade World, Princeton UP

« Le libre-échange est aujourd’hui souvent assimilé à une idée de droite. Dans Pax Economica, l’historien Marc-William Palen montre que le libre-échange et la mondialisation trouvent en fait leurs racines dans les politiques de gauche du XIXe siècle. Dans cette contre-histoire d’une idée, Marc-William Palen explore comment, à partir des années 1840, les mondialistes de gauche sont devenus les leaders des mouvements pacifistes et anti-impérialistes de leur époque. Au début du XXe siècle, une alliance improbable de libéraux radicaux, d’internationalistes socialistes, de féministes et de chrétiens considérait le libre-échange comme essentiel à un ordre mondial prospère et pacifique. Bien entendu, cette vision était en contradiction avec les fortes prédilections de l’époque pour le nationalisme, le protectionnisme, les conflits géopolitiques et l’expansion coloniale. Marc-William Palen révèle comment, pour certains de ses partisans de gauche les plus radicaux, le libre-échange représentait une critique sévère de l’impérialisme, du militarisme et de la guerre. »
Parution le 27 février
Nicolás Sesma, Ni una, ni grande, ni libre. La dictadura franquista, Critica

« Ni una, ni grande, ni libre offre un récit complet et actualisé de la dictature franquiste, destiné aussi bien à ceux qui ont vécu ces années qu’à ceux qui veulent redécouvrir et comprendre cet épisode décisif. Il s’agit d’une histoire de la dictature dont le protagoniste n’est plus exclusivement le général Francisco Franco, mais le peuple espagnol dans son ensemble, et qui, surtout, remet définitivement en question le mythe d’une Espagne unique et exceptionnelle.Nicolás Sesma rassemble les meilleures contributions de l’historiographie nationale et internationale pour les mettre au service d’une relecture ambitieuse et multidimensionnelle. Il inclut des références à l’ensemble des parties du pays et à tous ses secteurs sociaux. Une attention égale est accordée à l’immédiat après-guerre et à la décennie des années soixante-dix, à l’autarcie et au développement, à la classe politique et à l’opposition antifranquiste, à l' »estraperlo » et à la culture de la consommation, aux marginaux et aux nouvelles classes moyennes. »
Parution le 21 février
Peter Schäfer, Das aschkenasische Judentum Herkunft, Blüte, Weg nach Osten, C. H. Beck

« Ashkénaze : c’est ainsi que les juifs installés en Europe depuis le Moyen-Âge appelaient leur zone d’implantation, principalement en Allemagne. Avec ce livre, Peter Schäfer offre pour la première fois un aperçu, basé sur des sources archéologiques et écrites, de l’origine et de l’épanouissement du judaïsme ashkénaze et de son cheminement forcé vers l’Europe de l’Est. Sa présentation couvre plus de 2000 ans d’histoire juive, de l’Antiquité au XXe siècle. Un édit de l’empereur Constantin datant de 321 évoque les juifs de Cologne, mais ce n’est qu’aux alentours de l’an 1000 que des communautés juives sont attestées avec certitude à Cologne, Mayence, Spire, Worms, Ratisbonne, Prague ou Francfort. D’où venaient ces juifs ? Comment étaient organisées leurs communautés ? De quoi vivaient-ils et quelles relations entretenaient-ils avec leur environnement chrétien ? Peter Schäfer décrit la vie quotidienne et la piété empreinte de mysticisme des juifs ashkénazes. Il raconte les persécutions et les expulsions de la fin du Moyen-Âge, le renouveau de la vie juive en Pologne, en Lituanie et en Russie, et le cheminement des juifs vers une modernité ambivalente, qui promettait l’émancipation et qui a apporté l’extermination. Depuis, les centres du judaïsme ashkénaze se trouvent aux États-Unis et en Israël, mais ses racines plongent loin dans le judaïsme oriental européen. »
Parution le 15 février
Sébastien-Yves Laurent, État secret, État clandestin : essai sur la transparence démocratique, Gallimard
« Nous semblons vivre à une époque où tout finit par se savoir depuis qu’en 2013 un employé de l’agence de renseignement technique des États-Unis, Edward Snowden, révéla un authentique « secret d’État » : la collecte par les États-Unis de dizaines de millions de communications échangées dans le monde. Depuis lors en tous domaines des documents secrets ont été l’objet de fuites, laissant croire que la notion de secret d’État n’existe plus. L’État aujourd’hui serait-il désormais un État transparent, dépouillé de ses mystères ?

Sébastien-Yves Laurent déjoue les leurres. Dès ses commencements, l’État eut des raisons que la raison commune ignorait : la Raison d’État autorisait des agissements diplomatiques, policiers ou militaires dont le secret était la garantie du succès. Vint le libéralisme politique au XVIIIe siècle, porteur des droits de l’individu et des ferments de la démocratie grâce à la publicité, ici étudiée dans trois pays : Angleterre, États-Unis et France. Le secret fut néanmoins reconnu comme nécessaire au fonctionnement de l’État, mais institutionnalisé en services, budgets, voire commissions parlementaires d’enquête. L’État secret, légalisé, était né.
Vint au tournant de notre siècle le néo-libéralisme qui, doutant de l’efficacité du public face au privé, imposa l’idéologie de la transparence de l’action publique. Alors, le secret démocratique fut mis en cause et se créa dans l’ombre un État clandestin, acteur de liquidations physiques, déstabilisations dans l’univers numérique, emprisonnements extra-légaux. La démocratie en est fragilisée durablement. C’est pourtant notre monde. »
Parution le 22 février
Lauren Benton, They Called It Peace ; Worlds of Imperial Violence, Princeton UP
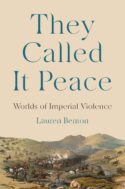
« They Called It Peace offre une histoire panoramique de la façon dont ces routines de violence ont redessiné les contours de l’empire et réorganisé le monde du XVe au XXe siècle. Dans un récit qui s’étend de l’Asie aux Amériques, Lauren Benton montre comment la violence impériale a redéfini la nature même de la guerre et de la paix. Au lieu de préparer une paix durable, des trêves fragiles ont permis un retour facile à la guerre. Les conflits en série et les interventions armées ont projeté un état de fait de guerre perpétuelle à travers le monde. Lauren Benton décrit la façon dont une guerre apparemment limitée a déclenché des atrocités, allant de massacres soudains à de longues campagnes de dépossession et d’extermination. Elle fait revivre de manière saisissante un monde dans lequel les bellicistes se présentaient comme des artisans de la paix et où les Européens imaginaient que la « petite » violence était essentielle à la domination impériale et à l’ordre mondial. Elle révèle comment la violence impériale du passé a fait de la guerre perpétuelle et de la menace d’atrocités des caractéristiques endémiques de l’ordre international. »
Parution le 13 février
Ulinka Rublack, Dürer im Zeitalter der Wunder. Kunst und Gesellschaft an der Schwelle zur globalen Welt, Klett-Cotta

« En 1511, Albrecht Dürer prend une décision radicale : après s’être brouillé avec le marchand de Francfort Jacob Heller à propos d’une commande, il cesse de peindre des retables et se tourne vers d’autres types d’œuvres. Ce conflit fait ici office de lentille à travers laquelle peut s’observer la nouvelle relation entre l’art, la collection et le commerce en Europe jusqu’à la guerre de Trente Ans. En effet, avec le début du XVIe siècle, l’art est devenu partie intégrante d’un secteur croissant de produits de luxe et a connu une vaste commercialisation. Les marchands et leur mentalité ont joué un rôle décisif dans sa diffusion et ses créations. Dürer im Zeitalter der Wunder nous entraîne dans les pensées et les sentiments d’Albrecht Dürer et des amateurs d’art des grandes cours allemandes et des maisons de commerce de son époque, retraçant l’histoire de l’artiste, de son œuvre et du marché européen de l’art et de l’artisanat naissant. »
Parution le 17 février
Emilio Carlo Corriero, La filosofia come orientamento. Un nuovo senso da assegnare alla terra, Einaudi

« La philosophie n’est pas une discipline comme les autres. Contrairement à celles-ci, qui ont un objet défini, l’objet de la philosophie est l’être lui-même sans autre détermination. Et il n’y a pas de philosophie authentique qui ne s’interroge pas sur sa propre définition et ses conditions d’existence. En tant que tension infinie vers la Sagesse, où convergent savoirs théoriques et savoirs pratiques, la philosophie, plutôt que comme science, se présente en fait comme une co-science qui doit pouvoir accompagner tous les savoirs et tous les choix que nous faisons. En ce sens, elle se révèle être avant tout une orientation, selon un besoin d’adaptation et de détermination qui accompagne l’être humain, toujours à la recherche d’une redéfinition de sa place dans le monde. Si, dès la crise des fondements au début du XXe siècle, la philosophie a perçu sa propre différence radicale dans son absence de sol, c’est surtout avec l’avènement de l’Anthropocène et la reconnaissance de l’être humain comme force naturelle que la philosophie peut redécouvrir pleinement sa propre fonction, en réalisant combien son absence de sol – son atopie – dépend de son enracinement naturel et de sa capacité à prendre la bonne distance par rapport à toute forme stable de connaissance. C’est à partir de là, au long d’un parcours critique qui traverse les principales positions théoriques de la pensée occidentale, que ce livre réaffirme tout le potentiel révolutionnaire de la philosophie visant à déterminer une nouvelle orientation possible. »
Parution le 6 février
Éric Bussière, L’Europe de Jacques Delors. Gestation et mise en œuvre d’un projet, Sorbonne Université Presses

« La politique de Jacques Delors à la tête de la Commission européenne entre 1985 et 1994 est le fruit d’un long cheminement. Dès les années 1960, les perspectives nationale et européenne s’entrecroisent dans les missions accomplies par Delors, tour à tour au Conseil économique et social, au Commissariat général au Plan, au cabinet du Premier ministre Jacques Chaban-Delmas, au Conseil général de la Banque de France à partir de 1973, puis au sein des instances dirigeantes du Parti socialiste. Deux lignes qui se rejoignent lorsque Delors entre au Parlement européen en 1979-1981, avant d’être nommé ministre des Finances par François Mitterrand en 1981. Des années d’expériences, de rencontres et de réflexions façonnant un projet revitalisé pour l’Europe.
Sa mise en œuvre de Bruxelles, à partir de 1985, en un processus accéléré, bouscule les hésitations et construit le marché intérieur puis l’union monétaire. La démarche de Delors vient pourtant buter sur les incertitudes et les craintes que soulève le bouleversement européen de 1989 et fait obstacle, lors de la négociation du traité de Maastricht, à une politisation des institutions européennes pourtant nécessaire. »
Parution le 2 février
Nathan Perl-Rosenthal, The Age of Revolutions and the Generations Who Made It, Basic Books

« Les révolutions qui ont fait rage en Europe et en Amérique pendant sept décennies, de 1760 à 1825, ont créé le monde moderne. Les révolutionnaires ont brisé les empires, renversé les hiérarchies sociales et donné naissance à un monde de républiques. Mais de vieilles injustices ont persisté et les puissants moteurs du changement révolutionnaire ont créé de nouvelles formes insidieuses d’inégalité. À travers un kaléidoscope de vies à la fois familières et inconnues – de John Adams, Toussaint Louverture et Napoléon à un naturaliste français ambitieux et une nonne péruvienne séditieuse -, Nathan Perl-Rosenthal raconte l’épopée révolutionnaire comme une histoire générationnelle. La première génération révolutionnaire, animée par des idées radicales, s’est efforcée de briser les liens hiérarchiques de l’ancien ordre. Ses échecs ont façonné une deuxième génération, plus habile dans l’organisation des masses, mais avec une teinte illibérale. Les transformations politiques radicales qu’elle a accomplies après 1800 ont gravé les inégalités sociales et raciales dans les fondements de la démocratie moderne. »
Parution le 20 février
Narges Bajoghli, Vali Nasr, Djavad Salehi-isfahani, Ali Vaez, How Sanctions Work. Iran and the Impact of Economic Warfare, Stanford University Press
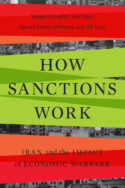
« Les sanctions ont des conséquences énormes. En particulier lorsqu’elles sont imposées par un pays ayant l’influence économique des États-Unis, les sanctions provoquent des ondes de choc évidentes dans l’économie et la culture politique de l’État ciblé, ainsi que dans la vie quotidienne des citoyens. Mais les sanctions économiques induisent-elles les changements de comportement escomptés ? Les sanctions fonctionnent-elles comme elles le devraient ?
Pour répondre à ces questions, les auteurs de l’ouvrage How Sanctions Work mettent l’accent sur l’Iran, le pays le plus sanctionné au monde. Les sanctions globales sont censées provoquer des soulèvements ou des pressions visant à modifier le comportement de l’establishment en place ou à affaiblir son emprise sur le pouvoir. Mais, après quatre décennies, le cas de l’Iran montre que c’est le contraire qui est vrai : les sanctions ont renforcé l’État iranien, appauvri sa population, accru la répression de l’État et intensifié la position militaire de l’Iran à l’égard des États-Unis et de ses alliés dans la région. Au lieu d’offrir une « alternative à la guerre », les sanctions sont devenues une cause de guerre. Par conséquent, How Sanctions Work révèle à quel point il est nécessaire de comprendre comment les sanctions fonctionnent réellement. »
Parution le 6 février
Ramón Villares, Repensar Iberia. Del iberismo peninsular al horizonte europeo, Pasado Presente

« L’idée d’un projet commun pour les pays ibériques, c’est-à-dire de trouver une autre façon de comprendre et d’organiser les territoires et les peuples de la péninsule, a une longue histoire. Ce livre analyse les clés, les blocages et les alternatives avec lesquels cette idée de « composer les Espagnes » ou de « repenser l’Ibérie » s’est dessinée au fil du temps – depuis les possibles unions dynastiques ou les propositions de la Catalogne « impériale » et du Portugal républicain à la fin du XIXe siècle jusqu’à l’ibérisme tripartite du XXe siècle – non pour raviver de vieux débats, mais pour penser avec audace un avenir différent dans lequel d’autres formes de composition ibérique peuvent émerger dans le cadre de l’Union européenne. Bref, penser un nouvel ibérisme adapté au XXIe siècle. »
Parution le 12 février
Iryna Vushko, Lost Fatherland ; Europeans between Empire and Nation-States, 1867-1939, Yale UP

« Ce livre est un portrait collectif de vingt-et-un hommes d’État importants qui ont grandi sous l’empire des Habsbourg. Parmi eux figurent le cofondateur de l’austro-marxisme et le premier ministre des affaires étrangères de la république autrichienne, le cofondateur de l’Union européenne après la Seconde Guerre mondiale, le fondateur du parti communiste de Tchécoslovaquie et l’ambassadeur de Mussolini à Vienne. Certains ont survécu à la Première Guerre mondiale et aux divisions géographiques qui en ont résulté dans leur pays d’origine, et d’autres ont continué à servir dans la politique et les gouvernements de toute l’Europe. Pris ensemble, les récits de ces hommes offrent aux lecteurs une fenêtre sur les grandes questions de l’histoire européenne de la fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle, notamment sur la manière dont un héritage impérial, une vision commune de l’État et du nationalisme, et un engagement en faveur de la résolution pacifique des conflits ont contribué à établir une loyauté et une unité durables en dépit des lignes de fracture géographiques résultant de la guerre. Comme l’explique Iryna Vushko, leurs récits permettent également de mieux comprendre les réussites et les échecs de l’empire Habsbourg. »
Parution le 13 février
Andrea Martini, Fascismo immaginario. Riscrivere il passato a destra, Laterza

« Exilés dans leur pays, contraints d’occuper des scènes marginales, des espaces culturels périphériques : c’est ainsi que les fascistes décrivent leur condition au lendemain de 1945. Pourtant, dès l’immédiat après-guerre, les kiosques à journaux de toute l’Italie étaient remplis de revues dont les articles racontaient sur un ton hagiographique, ou du moins indulgent, les exploits de Mussolini et de ses fidèles. Les rayons des librairies abritaient des mémoires, des biographies et même des romans signés par des fascistes et des pro-fascistes. Ainsi, à l’aube du processus de construction d’une mémoire publique autour du Ventennio et de la saison de la guerre civile, la réécriture de ce même passé par les fascistes était en cours.
Une telle opération n’est pas surprenante en soi : le désir de raconter sa propre version des faits en les pliant à ses propres intérêts est un fait physiologique. Ce qui surprend, en revanche, c’est le succès de cette opération et c’est sur ce point en particulier que le livre enquête, en rendant compte du degré de complicité dont ont fait preuve de larges secteurs du monde journalistique et éditorial. Il n’est pas si évident, en effet, que les protagonistes d’un régime autoritaire et liberticide et d’un gouvernement, celui de la RSI, complice d’une force d’occupation, aient eu la possibilité de faire circuler légalement leur version des faits. »
Parution le 2 février
Danielle Tartakowsky, Les syndicats en leurs murs. Bourses du Travail, maisons du peuple, maisons des syndicats, Champ Vallon

« Cet ouvrage, à la confluence de l’histoire syndicale et municipale, de l’architecture et de l’histoire urbaine, retraverse plus d’un siècle d’histoire de ces modes d’hébergement syndical que sont les Bourses du travail, les maisons du peuple ouvrières et les maisons des syndicats. Il analyse leurs conditions d’émergence, les interactions mouvantes entre syndicats et municipalités, leur inscription dans la ville, la nature des bâtiments qui leur sont dévolus, constitutifs d’un patrimoine qui vaut à une quarantaine d’entre eux d’être classés monuments historiques ou inscrits à l’inventaire du patrimoine. Si la désindustrialisation et la « mise en tourisme » des villes concernées suscitent aujourd’hui des remises en cause, une pluralité d’acteurs sociaux leur accordent un intérêt renouvelé. »
Parution le 16 février
Michael Grüttner, Talar und Hakenkreuz. Die Universitäten im Dritten Reich, C. H. Beck

« Pendant longtemps, les universités allemandes se sont considérées avant tout comme des victimes du régime national-socialiste. Ce n’est que progressivement et à contrecœur que l’idée que cette histoire était plus complexe s’est imposée. Depuis, de nombreuses études ont été publiées sur certaines universités, disciplines et savants. Avec ce livre, Michael Grüttner offre pour la première fois une présentation globale des universités du Troisième Reich. Les 23 universités qui existaient en Allemagne à la fin de la République de Weimar ont été soumises à partir de 1933 à des « purges » massives, qui visaient surtout les étudiants et les scientifiques d’origine juive. A cette « prise de pouvoir » par le haut correspondait une « prise de pouvoir » par le bas : de nombreux professeurs ont adhéré au parti, certains, comme Carl Schmitt et Martin Heidegger, ont tenté de se positionner comme penseurs du régime nazi. Michael Grüttner décrit la prise de pouvoir étonnamment silencieuse, décrit la politique universitaire nationale-socialiste, qui a eu des répercussions très différentes sur les disciplines, et explique pourquoi les sciences au service du national-socialisme ne sont pas seulement devenues moins libres, mais ont même parfois bénéficié d’une plus grande marge de manœuvre que jamais, par exemple en matière d’expérimentation médicale sur les êtres humains. »
Parution le 15 février
L’article 20 livres à lire en février 2024 est apparu en premier sur Le Grand Continent.
25.01.2024 à 13:00
« La société existe », une conversation avec Giorgia Serughetti
baptiste.rogerlacan@legrandcontinent.eu
Margaret Thatcher avait tort. La société existe et ces dernières années l’ont démontré. C’est la thèse de la philosophe Giorgia Serughetti dans un essai important. Face à la crise du modèle néolibéral, elle cherche à définir une alternative à la victoire des populistes de droite. Une lecture clef, à moins de six mois des élections européennes.
L’article « La société existe », une conversation avec Giorgia Serughetti est apparu en premier sur Le Grand Continent.
Texte intégral (5944 mots)
Prenant le contre-pied de la célèbre phrase de Margaret Thatcher, vous avez intitulé votre livre « La société existe ». Quels sont les signes révélateurs que personne aujourd’hui, même ceux qui étaient d’accord avec la phrase de Thatcher à l’époque, ne peut plus ignorer ?
Il est temps de regarder ce qui bouge sous les décombres d’un ordre social que l’on a appelé le néolibéralisme et qui présente des signes évidents de crise. L’idée m’est venue d’une citation de Boris Johnson : le Premier ministre britannique, isolé pour Covid, déclarait : « Je pense que COVID nous a appris une chose : la société existe ». Il s’agit d’un véritable revirement de la part du plus improbable des critiques de Margaret Thatcher, puisque Boris Johnson était l’un de ses épigones, à savoir un dirigeant conservateur au libéralisme assumé en matière de politique économique et sociale.
Mon objectif était d’observer comment les termes du débat sur l’ordre le plus approprié pour gouverner les sociétés actuelles s’articulent dans le discours public. Nous constatons que le consensus qui a soutenu pendant des décennies l’hypothèse selon laquelle le marché était le meilleur régulateur des relations entre les individus, entre les États et les citoyens, et même entre les États et les puissances économiques, est pour le moins en train de se fissurer, de même que l’ordre politique qui en a découlé. Cela se ressent non seulement dans la contestation, mais aussi dans les lieux de débat, de connaissance et de décision. Chez les économistes, même ceux qui se sont engagés à défendre le capitalisme du XXIe siècle, on ressent le besoin de repenser la relation entre l’État et le marché. Quelqu’un, comme Paolo Gerbaudo, a parlé d’un « retour de l’État », d’un changement, d’une nouvelle ère idéologique dans laquelle l’hégémonie du discours néolibéral arrive à sa phase finale, ou du moins commence à vaciller de manière très visible.
Il existe des jalons qui permettent de dater l’émergence de ce consensus, entre les chocs pétroliers et l’élection de Thatcher et Reagan. Mais la temporalité de son délitement n’est pas évidente. Dans quelle phase nous trouvons-nous aujourd’hui ? Quelles sont les étapes critiques que nous avons traversées ?
Il ne fait aucun doute que 2008 a marqué le début d’une nouvelle phase d’un point de vue politique, avec le fort impact de la croissance de ce que l’on appelle les « populismes », qui, en Europe, ont principalement pris un visage de droite. Le populisme victorieux, celui qui a réussi à obtenir suffisamment de soutien pour accéder au pouvoir et gouverner dans certains pays, a certainement été celui de la droite radicale qui, entre victoires et défaites, continue d’être très forte, comme nous le rappellent les Pays-Bas.
Il ne fait aucun doute que 2008 a marqué le début d’une nouvelle phase d’un point de vue politique.
Giorgia Serughetti
Quelle a été la nature de ce mouvement populiste ? Il s’agissait certainement d’une réponse identitaire de la droite au fort mécontentement de populations entières à l’égard de recettes économiques vendues, au cours des décennies précédentes, comme apportant la prospérité à tous. Ce qui s’est passé au lieu de cela, c’est que les inégalités se sont creusées, un phénomène qui a engendré un sentiment de frustration, de ressentiment, mais aussi, très concrètement, une perte de pouvoir social et économique pour de larges couches de la population.
Le populisme a été une réponse, peut-être un raccourci, pour exprimer une demande de changement, mais pas nécessairement une demande de justice, parce que très souvent la solution proposée par ces forces politiques a été une solution d’exclusion, destinée à un peuple, défini en termes essentiellement ethniques. Il ne s’agissait pas d’une réponse universaliste, mais d’une réponse exclusiviste.
Certains auteurs voient en 2008 le début d’un interrègne. D’autres, comme Gerbaudo, soutiennent que nous sommes entrés dans un nouveau moment et qu’il convient d’abandonner cette catégorie, qui indique une transition sans fin. Je ne serais pas aussi radical, je suis beaucoup plus hésitant : où en sommes-nous ? Sommes-nous encore dans l’interrègne ou dans une nouvelle phase ? Je pense que nous sommes encore dans une période de conflit entre des ordres de discours, où l’opération de la critique sociale et politique est de pointer les éléments de fracture dans un ordre qui n’est certes plus incontesté, sans pourtant avoir cédé la place à un nouvel ordre.
Comme vous le notez à juste titre, aujourd’hui, même les défenseurs de l’ordre capitaliste et libéral se rendent compte de la nécessité de sa réforme, de sa remise en ordre. Cela semble s’être moins produit entre 2008 et 2020. Comment l’élite politique et économique a-t-elle réagi à cette phase de turbulences au cours de ces presque douze années ?
Comme vous le notez à juste titre, aujourd’hui, même les défenseurs de l’ordre capitaliste et libéral se rendent compte de la nécessité de sa réforme, de sa remise en ordre. Cela semble s’être moins produit entre 2008 et 2020. Comment l’élite politique et économique a-t-elle réagi à cette phase de turbulences au cours de ces presque douze années ?
Sommes-nous encore dans l’interrègne ou dans une nouvelle phase ?
Giorgia Serughetti
L’élite économique et politique a réagi à la crise de 2008 de manière aveugle et sourde, en insistant sur l’infaillibilité de recettes qui s’étaient déjà révélées faillibles, et en essayant de panser les plaies d’un ordre qui démontrait clairement son insoutenabilité. Celle-ci a été au contraire saisie à l’avance par les forces « populistes ». Elles ont réagi en qualifiant de « populistes » toutes les demandes de changement, ce qui a eu pour seul résultat de renforcer ces mêmes forces, qui n’ont pas été intimidées par ce type d’accusation, pour ne pas dire de dénigrement, en particulier de la part des médias grand public. Cette situation a également empêché la croissance d’alternatives politiques qui avaient une tendance populiste, mais pas les mêmes caractéristiques politiques. Pensez à Podemos : il a été défini comme un mouvement populiste, mais il a délivré un message politique qui était fortement et clairement différent et alternatif à celui de la droite.
Au lieu de cela, l’étiquette de populiste a fini par agréger et dénigrer dans une seule critique toutes les forces qui combattent les élites, tout cela dans le but de mener une opération de sauvetage impossible de ces politiques d’austérité dont nous savons qu’elles ont eu, en vérité, pour effet d’amplifier l’attrait des alternatives critiques à l’establishment, en particulier européen.
Il est certain qu’une politique jugée trop timorée face aux défis des inégalités sociales et des nombreuses crises qui affectent la vie quotidienne des gens, exacerbant leur anxiété et leur besoin de protection, a perdu en crédibilité. Toutefois, c’est aussi, et peut-être avant tout, un échec pour la gauche, qui aurait pu saisir cette même aspiration au changement en offrant des solutions innovantes et transformatrices.
Selon vous, la pandémie a été l’apogée et le point culminant des contradictions du modèle socio-économique néolibéral. Mais elle a aussi montré de manière plastique que la société existait, et qu’elle avait besoin de filets de sécurité que l’État peut activer et réactiver. Pensez-vous que cette vague s’est atténuée depuis 2020 ?
Oui, il y a eu un reflux. Je pense qu’il était surtout lié à une envie et à une émotion, de reprendre le fil de la vie, et de revenir à la soi-disant normalité. C’était un besoin naturel de ne pas rester dans le deuil que représente la pandémie, par rapport à laquelle il y a eu une absence totale de traitement collectif.
Je pense ensuite que cette phase pendant laquelle la réflexion, y compris politique, était possible, et qui avait été ouverte par la pandémie, a été fermée par la guerre. Il y a eu une remobilisation des ressources collectives dans un sens complètement opposé, dans le contexte de l’agression russe, autour des drapeaux nationaux ou de celui de l’Union européenne, qui se présentait comme l’avant-poste des valeurs occidentales.
Cette phase pendant laquelle la réflexion, y compris politique, était possible, et qui avait été ouverte par la pandémie, a été fermée par la guerre.
Giorgia Serughetti
Pendant la pandémie, nous avons assisté à la reconstruction d’un lien social de confiance entre les citoyens et les institutions, ce que les sondages d’opinion ont également révélé. Cela fut même le cas dans un pays comme l’Italie où la méfiance s’est pourtant accrue depuis de nombreuses années à l’égard de toutes les institutions, à quelques exceptions près — le pape, le président de la République et les forces de l’ordre. Cela s’est produit parce que l’État s’est occupé de la vie des gens — certes, parfois avec des traits paternalistes, mais certainement avec la capacité de démontrer la pertinence, la nécessité de l’intervention publique là où le marché ne peut pas opérer.
Le marché n’est pas capable de faire face à ce type de menace pour la santé publique. Et pendant un moment, on aurait pu penser que cette même logique, une fois mise en évidence par la pandémie, pourrait s’appliquer à toutes les crises majeures — et même à des situations plus pérennes — où l’intervention publique serait nécessaire pour combler les lacunes et les inégalités existantes. Cette intervention répond effectivement aux besoins de survie des populations, qui ne sont jamais seulement liés à la santé, mais aussi, bien sûr, aux revenus, à l’accès à des services de qualité et à l’éducation.
Toutes ces questions, qui étaient vraiment à l’ordre du jour pendant la pandémie, sont sorties de l’arène discursive et ont perdu de leur pertinence. Dans presque tous mes écrits après 2020, au risque d’être obsessionnel, je reviens sur ce moment. Je crois que continuer à insister sur cette expérience unique que nous avons tous vécue (pas de la même manière bien sûr, mais en même temps) nous permet de garder l’espace ouvert pour ce sens des possibles — en somme, pour ce que des décennies de « Il n’y a pas d’alternative » nous ont empêchés de voir.
Revenons à la phrase de Margaret Thatcher. On rappelle souvent la première partie : « il n’y a pas de société, il y a des individus ». Mais Thatcher poursuit en disant qu’il y a « des individus et des familles », indiquant que certaines formes d’agrégation identitaire pouvaient être mobilisées : la famille au sens étroit, mais aussi la patrie entendue comme une famille élargie. Quelle est l’importance de cette deuxième partie de la phrase ?
Considérer la famille comme une unité sociale supérieure à l’individu, et la patrie comme une grande famille, qui ne serait rien de plus qu’un rassemblement de familles et d’individus liés par des affinités, est une perspective propre à la droite nationale conservatrice, qui prend une importance accrue actuellement. Elle s’est renforcée face au déni de la notion de société. Par « déni de la société », on n’entend pas le refus d’admettre que les individus entretiennent des relations entre eux — une telle conception de la société était en réalité tout à fait en phase avec l’idée du marché régulant les interactions humaines et citoyennes. Le « déni de la société » renvoie plutôt au rejet de l’idée d’une responsabilité collective face aux maux sociaux et aux injustices. Il s’agit d’une responsabilité basée sur un réseau d’interdépendances personnelles, plus significatif que de simples interactions, et plus contraignant que de simples associations contractuelles sur le marché. Je fais allusion à une forme d’interdépendance qui échappe même au contrôle total des individus. Chacun se construit au sein de la société, naissant dans un système de relations, d’interdépendances et de dépendances des individus vis-à-vis des infrastructures sociales qui accompagnent et soutiennent la vie.
Le « déni de la société » renvoie au rejet de l’idée d’une responsabilité collective face aux maux sociaux et aux injustices.
Giorgia Serughetti
Nier une responsabilité collective fondée sur cette conscience est une étape argumentative fondamentale du néolibéralisme. L’autre consiste à nier le fait qu’il existe des relations de pouvoir au sein des structures qui traversent la société, qui ne sont pas seulement celles du pouvoir gouvernemental exercé du haut vers le bas, mais qui sont des héritages du patriarcat, du racisme et, bien sûr, des divisions de classe. Proposer, à la place de cette vision articulée de la société, qui est aussi un lieu de conflit et de coopération, celle de la nation comme famille élargie, c’est suggérer fondamentalement une relation de parenté entre égaux — égaux par les liens biologiques de descendance — au sein de laquelle les conflits, par exemple entre le haut et le bas, et entre les classes, n’auraient plus de pertinence, ou, en tout cas, plus de légitimité.
Si la nation est perçue comme une grande famille, tous ceux qui la constituent sont symboliquement connectés, soit à la manière de frères et sœurs, soit à la manière de parents et enfants. En général, on ne conteste pas ses parents, on ne se révolte pas contre eux, car ce sont ceux qui nous aiment. Si c’est dans ce cadre que l’on envisage les relations entre les citoyens et l’État, ainsi qu’entre les citoyens eux-mêmes, il apparaît clairement que les possibilités de transformer l’ordre social sont limitées, car cet ordre est considéré comme naturel. C’est la principale conséquence d’un ordre social façonné sur le modèle familial.
Cela est crucial pour analyser et comprendre les propositions politiques de la droite, pour saisir pourquoi elle est conservatrice aussi bien dans les domaines économique et social, et pas seulement en matière de valeurs, contrairement à une idée reçue. Ces courants de droite défendent en effet fondamentalement les inégalités économiques et sociales, et pas seulement les inégalités de statut.
Face à la perspective d’un Parlement européen — et peut-être même d’une Commission — nettement plus à droite en 2024, pensez-vous que cette rhétorique puisse également affecter l’Union ? Assistons-nous à un tournant identitaire à l’échelle européenne ?
Il est important de comprendre quel type de défi ces forces lancent à la construction supranationale de l’Union européenne. Tout d’abord, elles nient sa naturalité, parce qu’elles sont attachées à une idée des nations comme organismes naturels : si l’Union n’a pas de naturalité, parce qu’elle n’est que l’artifice de la volonté de nations individuelles qui ont au contraire une identité propre, il est clair que la construction est affaiblie. Mais ce qui s’est passé, c’est que la peur de la force de ces alignements a poussé un monde politique plus modéré, comme celui du PPE, vers la droite, avec pour résultat l’absorption de son agenda, notamment sur la question des migrations et la timidité sur certains fronts, comme celui des droits. Alors qu’un conflit s’était ouvert avec Budapest et Varsovie, celui-ci a été promptement résolu en raison de la difficulté, surtout en période de guerre, de risquer une rupture avec ces pays.
La peur des nationalistes a déplacé l’axe politique des autres forces plus à droite au niveau européen.
Giorgia Serughetti
Je dirais que sont également complices de l’affaiblissement du projet européen ceux qui auraient dû en être les avocats et les défenseurs. Les enfants des Pères fondateurs, si l’on veut rester dans les métaphores familières, à savoir les socialistes et les membres du Parti populaire européen, qui ont largement abdiqué sur certaines questions. Pas toujours, pas tous, pas de la même manière, mais la peur des nationalistes, comme cela s’est passé au niveau national, a déplacé l’axe politique des autres forces plus à droite au niveau européen.
Face à l’Europe, il y a aussi ce caractère ductile et changeant de ces forces, dont Salvini en Italie est un excellent représentant. Elles ont une forte capacité d’adaptation aux contextes, et une capacité à ménager la frontière entre le peuple et l’élite qui est suffisamment forte pour toujours se placer du côté de l’opposition aux pouvoirs établis, même quand ils ont le pouvoir.
Il est également possible de suivre la voie de Meloni, qui a opté pour la modération, en particulier dans la manière de s’exprimer, se distanciant des postures particulièrement anti-système de sa famille politique d’origine, afin de chercher à obtenir un certain soutien de l’establishment, ce qu’elle a pleinement réussi à faire. C’est un succès remarquable en termes de refonte de son image, qui ne me semble pas entièrement artificiel. Au sein de son parti, il y a sans doute des éléments vraiment extrémistes et radicaux, et même nostalgiques, en désaccord total avec son virage plus conservateur, mais je pense qu’elle est vraiment à l’aise avec ce discours.
C’est une voie possible, peut-être celle qui lui garantira une certaine durée au pouvoir. L’autre voie est celle de Salvini, qui consiste à déplacer constamment la frontière de l’antagonisme peuple/élite, en cherchant sans cesse à augmenter son soutien à travers ce type de conflit. En réalité, les deux stratégies semblent fonctionner.
Meloni est vraiment à l’aise avec le discours conservateur.
Giorgia Serughetti
Pour une raison ou une autre, si leur alliance tient, elles finissent même par augmenter le consensus pour les deux, un phénomène qui a caractérisé ces dernières années en Italie : ce champ politique n’a jamais perdu de pertinence, l’une ou l’autre faction prenant le dessus en fonction de leurs choix, entre populisme et techno-souverainisme, entre figures proches de l’establishment économique, politique et financier et celles qui accentuent un aspect anti-système. Mais elles ne se sépareront jamais. Le jeu de la droite est un jeu de vases communicants qui se maintiennent mutuellement en équilibre.
En novembre dernier, Pedro Sánchez s’exprimait ainsi lors de son discours d’investiture : « soit la démocratie répond en apportant la sécurité, soit le sentiment légitime d’insécurité sociale qu’éprouvent de nombreux citoyens à la suite des révolutions en cours se transformera en colère, et cette colère finira par alimenter des propositions politiques qui finiront par saper la démocratie elle-même. » Est-il souhaitable que la gauche se réapproprie l’idée de sécurité ?
C’est un bon exemple. Le discours sur la sécurité, qui semble avoir retrouvé un espace dans le paysage politique, est l’un des éléments qui permet de mesurer le tournant vers une option plus étatiste, plus soucieuse de justice sociale, et de lutte contre les inégalités.
Évidemment, cela n’a du sens que si l’on ajoute « sociale » à la suite de sécurité, car le mot sécurité a également dominé les dernières décennies, par le biais de l’obsession sécuritaire, du « law and order » et de la répression de la petite délinquance — sans même parler des politiques anti-migrants. Repensé et relancé comme mot-clé en lien avec l’adjectif « social », et donc en lien avec l’idée de société, avec l’idée d’un État-providence qui reviendrait à répondre aux besoins des gens, le réinvestissement du concept de « sécurité » peut vraiment ouvrir un nouvel horizon discursif.
Ce qui est également très intéressant dans le discours de Sánchez, c’est l’extension de la réflexion des questions purement économico-sociales au défi de la transition écologique. La transition écologique est indissociable d’un engagement en faveur de la sécurité sociale. Elle signifie réduire les émissions, transformer les styles de consommation et, pour les petites entreprises, transformer également les processus de production. Si tout cela n’est pas soutenu de manière adéquate par l’intervention de l’État, par des politiques publiques visant à garantir le bien-être des personnes en parallèle avec des politiques sociales et la dotation en ressources nécessaires pour faire face à ces changements, le changement climatique sera la nouvelle ligne de démarcation qui provoquera la polarisation : d’un côté les forces « pétronostalgiques » et de l’autre les partisans de la transition.
Repensé et relancé comme mot-clé en lien avec l’adjectif « social », et donc en lien avec l’idée de société, avec l’idée d’un État-providence qui reviendrait à répondre aux besoins des gens, le réinvestissement du concept de « sécurité » peut vraiment ouvrir un nouvel horizon discursif.
Giorgia Serughetti
L’idée que la sécurité est un pilier de la démocratie n’est pas particulièrement nouvelle, c’est même un pilier du compromis social-démocrate, qui reposait aussi sur un rapport différent à l’environnement, à la production, à la répartition du travail domestique. Cela a-t-il un sens aujourd’hui de se référer à ce compromis avec une certaine nostalgie ?
La nécessité d’apporter des réponses à la perte de sécurité, au déclassement à l’échelle globale, à la perte de revenus et d’emplois, aux délocalisations sauvages, à l’allongement sans fin des chaînes de production et de distribution, aux dommages féroces et très graves causés à des territoires entiers par le biais de la politique industrielle et des politiques de réindustrialisation n’est pas du tout erronée, c’est même quelque chose qui semble vraiment faire défaut en Italie.
Il ne peut y avoir un type d’investissement nouveau et vigoureux sur ces fronts qui ne tienne pas compte des temps nouveaux dans lesquels nous nous trouvons. C’est certainement le cas de la nécessité de développer des politiques du travail en conjonction avec des politiques environnementales. Plus généralement, il faut vraiment repenser la justice sociale, y compris par rapport au compromis social-démocrate du passé. Celui-ci reste précieux en tant que légitimation pour exiger une nouvelle intervention publique dans l’économie, qui a été délégitimée au cours des quarante dernières années. Il n’y a pas seulement la conjonction thématique du travail et de l’environnement, il y a aussi un nouveau besoin de repenser son objet de revendications et de politiques. Prenons, par exemple, la catégorie des « travailleurs ». Elle est traversée par de nombreuses fractures et différences qui nous amènent à reconnaître de nouveaux modèles d’organisation familiale et sociale.
Comment définissez-vous et interprétez-vous la notion d’intersectionnalité ?
Le féminisme joue un rôle crucial dans ce développement. Le 25 novembre à Rome, dans le cadre d’une mobilisation mondiale, s’est déroulée la plus grande manifestation des vingt dernières années, organisée par un mouvement, Non Una Di Meno, qui n’est pas structuré mais largement spontané, avec quelques groupes stables mais sans organisation étendue capable de mobiliser les masses comme le ferait un syndicat ou un parti politique. Ces chiffres, atteints grâce à la participation spontanée des gens, en particulier de la jeunesse, témoignent des urgences politiques actuelles.
Le féminisme replace la dimension matérielle au centre de la réflexion, en partant du thème de la reproduction plutôt que de la production. Cela nous force à ne pas négliger cet aspect quand on parle de travail et de justice.
Pour le féminisme, une opposition à surmonter est celle entre le travail productif et reproductif. Le travail reproductif englobe tout ce qui concerne la reproduction des corps — à commencer par la vie elle-même — mais il s’étend aussi à la prise en charge, la réponse aux besoins vitaux allant du logement à l’habillement, en passant par la nourriture et l’entretien de l’environnement de vie. Toutes ces activités, que l’on peut globalement qualifier de reproduction sociale, ont historiquement été considérées comme relevant des femmes ou, à la limite, des classes subalternes, et donc perçues comme extérieures et étrangères au domaine politique, qui a plutôt mis l’accent sur le travail productif, grâce à l’influence du mouvement ouvrier. L’enjeu est de reconnaître le travail reproductif comme tout aussi essentiel — c’est-à-dire comme condition de possibilité de l’économie de production et de consommation — que le travail productif.
Le féminisme replace la dimension matérielle au centre de la réflexion, en partant du thème de la reproduction plutôt que de la production.
Giorgia Serughetti
C’est ce que la pandémie nous a fait voir de manière éclatante : lors de l’arrêt de toutes les activités, les emplois dits essentiels étaient souvent ceux liés à la sphère reproductive. Sans les activités reproductives effectuées gratuitement à domicile, ou rémunérées dans les maisons de soins ou les hôpitaux, et sans ces activités essentielles liées à la nutrition, l’habillement, le logement — en somme, à la satisfaction des besoins vitaux — il n’y aurait ni société, ni économie, rien que l’on puisse appeler un pays. Cette importance a toujours été claire et évidente pour le féminisme, car les femmes, ayant une connaissance intime des activités reproductives souvent non rémunérées, en ont toujours eu une compréhension particulièrement profonde.
La grève féministe mondiale est une grève des activités productives et reproductives, signifiant que ce jour-là, les femmes s’arrêtent également en refusant d’effectuer ce qui est perçu comme leur rôle « naturel » : s’occuper de la famille, des enfants, de la maison.
Envisager la politisation de ces types de besoins et de cette dimension, c’est affirmer que sans notre contribution, rien n’existe, que sans nous, tout s’arrête, que si nous faisons une pause, tout s’effondre. Politiser cette sphère à une époque où la question de la vie sous toutes ses formes, de la vie physique des individus à celle des êtres humains et non humains dans leurs interactions, est au cœur des enjeux actuels, est l’une des raisons de l’importance, de la capacité d’impact et de la pertinence de ce mouvement. Les gens dans les rues de Rome, de Paris et du monde entier se sont rassemblés non seulement pour dire non à la violence envers les femmes, mais on doit se demander pourquoi ce type de mobilisation a rencontré un tel succès.
D’une part, le mouvement a réussi à politiser cette question de manière innovante, en soulignant que la violence envers les femmes est un problème qui concerne toutes les sociétés, résultant du système global d’inégalités, et nécessitant donc de prêter attention à toutes ses dimensions. Mais son succès tient aussi au fait qu’il a su évoquer une transformation plus profonde que la simple réponse en termes de prévention de la violence, de protection des victimes et de condamnation des coupables. Il a fait naître la perspective d’une politique nouvelle dans ce domaine.
Comment élaborer une politique intersectionnelle ?
En effet, l’intersectionnalité est une loupe qui nous permet de voir comment les différents systèmes d’oppression et les différentes formes d’inégalité s’entremêlent. Idéalement, il s’agit d’une perspective qui pourrait être adoptée dans la conception et la planification de toute politique publique.
Une politique de lutte contre la violence à l’égard des femmes qui ne tient pas compte des différences entre les femmes n’est ni juste ni efficace. Prenons l’exemple le plus frappant, celui de la différence entre les femmes autochtones et les femmes migrantes. Une politique contre la violence ne peut fonctionner si l’on ne tient pas compte des femmes qui ont des difficultés avec leur permis de séjour, de l’accueil dans les centres d’hébergement des femmes qui vivent dans des espaces de promiscuité, des femmes qui n’ont pas de réelle possibilité de dénoncer parce que, si elles se rendent à la police, la première requête sera de montrer leurs papiers. Si nous ne prenons pas en compte toutes ces dimensions, nous ne menons pas réellement une politique contre la violence à l’égard des femmes, mais au mieux une politique contre la violence à l’égard de certaines femmes.
C’est l’un des exemples les plus flagrants de la manière dont cette approche peut être appliquée. Mais toutes les politiques nécessitent un regard intersectionnel. C’est le cas pour la mobilité. Qui utilise les transports en commun ? Pourquoi en ont-ils besoin ? Quelles sont les inégalités en termes d’accès à la mobilité dans une ville ? Quelles ressources devons-nous mobiliser ? Il est clair que les politiques ne peuvent être uniformes, car les inégalités sont multiples et s’entrecroisent. J’espère que cette perspective pourra être adoptée.
Actuellement, l’intersectionnalité est davantage abordée par les mouvements que par les partis politiques. En Italie, parmi les personnalités politiques en vue, Elly Schelin a utilisé le langage de l’intersectionnalité. Mais elle a souvent été moquée comme si ce concept était étranger, compliqué et un peu trop intellectuel, quand bien même il serait en circulation depuis des décennies. Hormis cette exception, l’intersectionnalité reste peu exploitée par les partis, du moins en Italie.
Ce sont les mouvements de société qui cherchent à l’imposer, en appliquant des procédés bien connus : ils cherchent à imposer certaines questions à l’agenda, à modifier le lexique, à déplacer le centre d’attention et à forcer les décideurs à se concentrer sur ces enjeux, souvent par le biais de d’activisme protestataire. Prenons l’exemple de l’activisme environnemental d’Extinction Rebellion, qui, en Italie et ailleurs, a recours à des manifestations telles que le lancement de peinture ou le blocage des rues. C’est un moyen d’exiger l’attention sur ces questions, sans avoir à formuler des propositions dans les termes et les langages plus adaptés aux décideurs politiques comme les partis ou les institutions.
Cela présente des avantages et des inconvénients : d’une part, cela préserve la radicalité de mouvements capables de proposer une plateforme politique large, exigeante et radicalement transformatrice, sans compromettre les possibilités actuelles et les capacités des acteurs politiques à les réaliser ; d’autre part, cela risque de maintenir une séparation entre la revendication et la prise de décision, même face à des acteurs politiques disposés à écouter et à intégrer ces propositions — l’image classique des représentants d’un mouvement assis à la table avec des politiciens pour expliquer leurs demandes.
Parfois, une collaboration se produit, peut-être à l’échelle locale, lorsqu’un comité de Fridays for Future ou un autre mouvement local formule des demandes spécifiques, entamant un dialogue avec une administration qui peut ajuster sa réponse et essayer de répondre à ces demandes. À l’échelle nationale ou supranationale, cependant, la relation est souvent conflictuelle plutôt que collaborative, avec les avantages et inconvénients que cela implique.
Il est remarquable que, dans le contexte de la reconstitution d’une nouvelle gauche émergeant d’un ordre néolibéral en crise, le seul acteur jamais mentionné est le parti politique, auquel nous n’avons fait référence que dans le cadre de la reconfiguration de la politique européenne. Les partis semblent en effet faibles dans leur capacité à offrir des visions convaincantes, alternatives et radicales face aux défis actuels.
Le cas de Sanchez, mentionné précédemment, montre cependant qu’une circulation d’idées et même une certaine ambition radicale existent et qu’avec un soutien électoral adéquat, cette vision peut être mise en œuvre. Il est même possible de démontrer que, si elle est mise en place, elle peut convaincre, être compétitive et vaincre les forces de droite.
L’article « La société existe », une conversation avec Giorgia Serughetti est apparu en premier sur Le Grand Continent.
14.01.2024 à 17:54
« Il a existé une Méditerranée plus paritaire », une conversation avec Guillaume Calafat et Mathieu Grenet
Matheo Malik
Comment penser la mobilité en Méditerranée sans tomber dans le biais du déséquilibre qui a marqué l'époque coloniale ? Dans une vaste enquête qui prend pour cadre « les » Méditerranées à l'époque moderne, Guillaume Calafat et Mathieu Grenet parviennent à restaurer la dimension collective d'un espace pluriel et composite. Entretien.
L’article « Il a existé une Méditerranée plus paritaire », une conversation avec Guillaume Calafat et Mathieu Grenet est apparu en premier sur Le Grand Continent.
Texte intégral (5645 mots)
Le titre de votre ouvrage fait référence non pas à une mais à des Méditerranées. Et son premier chapitre s’intitule « une Méditerranée plurielle ». Est-ce à dire qu’il n’y aurait pas à l’époque moderne d’unité, de singularité méditerranéenne ?
Mathieu Grenet
L’ombre tutélaire de Fernand Braudel, qui a posé l’idée d’une unité morphologique et environnementale de la « mer Intérieure », plane encore aujourd’hui sur l’histoire de la Méditerranée. Toutefois, l’historiographie actuelle de cet espace est de plus en plus spécialisée et notre travail est précisément une tentative de conjoindre en une large synthèse des historiographies qui ont travaillé les différents espaces méditerranéens isolément les uns des autres. Méditerranée orientale et occidentale bien sûr, mais aussi divers espaces régionaux plus circonscrits ayant donné lieu à des champs historiographiques propres comme l’Adriatique ou la mer Tyrrhénienne. Notre idée était précisément de décloisonner et de faire dialoguer ces historiographies « subméditerranéennes ». Cette fragmentation historiographique n’est toutefois pas sans fondement. Une des grandes questions qui traverse notre livre est de déterminer jusqu’à quel point, à l’époque moderne, les riverains de la Méditerranée la pensaient comme un tout. Pour un marin, un marchand, un ambassadeur ou un juif expulsé, la Méditerranée ne se limitait-elle pas plutôt à l’espace où leurs horizons respectifs étaient bornés ? Nous avons essayé de penser la Méditerranée comme articulation de sous-espaces habités, investis ou traversés par des acteurs qui n’en fréquentent que certaines parties.
Guillaume Calafat
Nous avons également tenté de prendre au sérieux les critiques qui ont été adressées au concept de Méditerranée, notamment, dans sa forme singulière héritée de la période coloniale. En pluralisant la Méditerranée, nous voulons souligner que notre synthèse a une dimension kaléidoscopique : elle rend donc compte d’un espace méditerranéen polymorphe en fonction des lieux à partir duquel on fait le choix de l’observer. On ne parle pas de la même Méditerranée selon qu’on l’observe depuis Alger, Carthagène, Marseille ou Le Caire. Cela suppose au demeurant de reconnaître l’existence de points aveugles, de difficultés à aborder l’ensemble de l’espace méditerranéen pour certains sujets car on s’appuie sur une historiographie et des observatoires précis et situés. Le pluriel de notre titre est donc en quelque sorte un pluriel de modestie : une manière de reconnaître qu’il est difficile de saisir en un même mouvement l’histoire d’un ensemble qu’on appellerait la Méditerranée.
Le pluriel de notre titre est en quelque sorte un pluriel de modestie : une manière de reconnaître qu’il est difficile de saisir en un même mouvement l’histoire d’un ensemble qu’on appellerait la Méditerranée.
Guillaume Calafat
À l’époque moderne, les populations qui vivent sur les rives de la Méditerranée se considèrent-elles comme méditerranéennes ? S’il existe, ce sentiment d’appartenance est-il de nature à en surpasser ou à en atténuer d’autres, à commencer par le clivage entre mondes chrétien et islamique ?
On ne rencontre pas dans les sources de l’époque moderne de traces d’un sentiment d’appartenance méditerranéen. Il y a certes différentes formes d’emboîtement des appartenances : à la ville, à l’entité politique dont on relève ou à la religion. Mais il n’y a pas le sentiment d’une appartenance commune à quelque chose qu’on pourrait rapporter à une civilisation méditerranéenne ou à l’existence d’un type méditerranéen, toutes choses qui apparaissent plutôt (et de façon ambiguë) à l’époque contemporaine. La quête de ce qui fait l’unité géographique, anthropologique, ou historique dans cet espace est une question qui va plutôt obséder les militaires et les administrateurs de l’époque coloniale, qui vont faire abstraction de l’hétérogénéité spatiale et culturelle. Ce « méditerranéisme », entendu comme une unité plus souvent hypostasiée qu’observée empiriquement, est toujours vivant aujourd’hui. Les chercheurs qui travaillent sur la Méditerranée sont souvent rappelés à l’idée qu’il y aurait un socle commun à l’ensemble des peuples de cet espace. Il faut savoir en déjouer les pièges en rappelant qu’il s’agit d’une construction récente et chargée idéologiquement.
Mathieu Grenet
Il nous faut effectivement nous garder de la tentation de méditerranéiser nos objets. Quand on observe une diaspora par exemple, on a tendance à privilégier des analyses au prisme d’un espace que nous avons naturalisé, la Méditerranée. Ainsi, l’exil des juifs espagnols en 1492 ou les soi-disant « diasporas marchandes » sont loin de se répartir de manière homogène dans l’espace méditerranéen. On va par exemple avoir tendance à séparer les migrations grecque ou arménienne en Méditerranée des mobilités grecque ou arménienne dans d’autres régions du monde, alors qu’il faudrait plutôt tout à la fois les penser de manière globale et tenir compte de leur possible hétérogénéité à l’intérieur même de l’espace méditerranéen. Nous avons donc veillé à chaque fois que c’était nécessaire à dénaturaliser la catégorie.
Le « méditerranéisme », entendu comme une unité plus souvent hypostasiée qu’observée empiriquement, est toujours vivant aujourd’hui. Il faut savoir en déjouer les pièges en rappelant qu’il s’agit d’une construction récente et chargée idéologiquement.
Guillaume Calafat
Vous faites commencer votre enquête en 1492, une date qu’on associe plutôt à l’histoire de l’Atlantique qu’à celle de la Méditerranée. C’est aussi bien sûr celle de la chute de l’émirat de Grenade et de l’expulsion des juifs d’Espagne, mais comme vous venez de le signaler, il s’agit là d’événements dont les répercussions ne se limitent pas aux frontières méditerranéennes. En quoi 1492 constitue-t-elle malgré tout un moment pertinent pour penser l’histoire méditerranéenne ?
La vieille croyance d’un déport du centre du monde de la Méditerranée vers l’Atlantique suite au voyage de Christophe Colomb a depuis longtemps été battue en brèche. Contrairement à une vulgate erronée, Fernand Braudel lui-même montre bien que 1492 n’a pas été synonyme d’un déplacement du centre de gravité économique européen vers l’Atlantique. Loin de les marginaliser, l’argent américain vient ainsi irriguer nombre de marchés méditerranéens : le marché ottoman est ainsi inondé de piastres dites « sévillanes ». À l’échelle méditerranéenne, qui est celle adoptée pour notre ouvrage, 1492 fait surtout écho à la chute de l’émirat de Grenade et à l’expulsion des juifs d’Espagne qui se traduit par un double mouvement d’homogénéisation à marche forcée de la péninsule Ibérique et de dispersion des séfarades qui vont « ibériser » leurs terres d’accueil au Maghreb, au Portugal, dans l’Empire ottoman ou les États italiens.
Pourquoi avoir choisi de terminer votre étude au mitan du XVIIIe siècle ?
Ce choix permettait d’abord de s’affranchir de marqueurs tels que l’expédition d’Égypte ou le moment révolutionnaire des années 1820, qui ont tous une pertinence mais qui obéissent à des dynamiques différentes de celles qui prévalent à l’époque moderne. Le monde méditerranéen des mobilités, des expulsions et du commerce que nous avons voulu mettre en lumière, qui s’organise à la fin du XVe siècle, bascule dans une dynamique différente à partir du milieu du XVIIIe siècle. L’historiographie actuelle insiste par exemple sur l’importance de la guerre de Sept ans, qui n’a pas concerné uniquement le monde colonial mais a eu des répercussions en Méditerranée. De manière générale, on observe, à compter du XVIIIe siècle, une reconfiguration des rapports de force géopolitiques, avec une asymétrie de plus en plus marquée en faveur des puissances de la rive nord. Sur le plan religieux, le processus de confessionnalisation, au travers du rééquilibrage qu’il opère entre l’Église catholique et les Églises de rite oriental, bouleverse également la donne qui prévalait jusqu’alors.
On observe, à compter du XVIIIe siècle, une reconfiguration des rapports de force géopolitiques, avec une asymétrie de plus en plus marquée en faveur des puissances de la rive nord.
Mathieu Grenet
Guillaume Calafat
Les capitulations accordées à la France par l’Empire ottoman en 1740 transforment une grande partie de l’économie marchande méditerranéenne. À partir du milieu du XVIIIe siècle, on observe par ailleurs l’entrée sur la scène méditerranéenne de nouveaux acteurs comme les Scandinaves, les Autrichiens ou les Russes. Des évolutions concomitantes entraînent également un déplacement du centre de gravité de la vie juive vers l’Europe du nord. Autant d’éléments qui nous semblent justifier d’interrompre notre étude vers 1750, à la veille de « l’ère des révolutions » qui, si nous avions voulu l’intégrer à notre propos, nous aurait sans doute obligé à aller au moins jusqu’aux années 1830.
Quel est le statut politique d’un espace maritime comme la Méditerranée à l’époque moderne ? La mer appartient-elle à personne ? À tout le monde ? Y a-t-il des luttes interétatiques pour son appropriation ou au contraire des formes de coopérations internationales en la matière ?
Sur le plan juridique, la Méditerranée est l’un des terrains privilégiés d’un grand débat sur la souveraineté des mers qui se joue à l’époque moderne. Que l’on pense à l’histoire de Venise en Adriatique, de Gênes dans la mer Ligure ou encore aux revendications ottomanes sur la possession des îles de la Méditerranée orientale, on voit que la Méditerranée a été l’enjeu d’importants débats quant à la question de la souveraineté maritime. Bien avant l’époque moderne, il faut prendre en considération le droit romain, le droit byzantin, ainsi que leurs relectures par les jurisconsultes du Moyen Âge.
En pratique, la revendication la plus courante est une revendication de juridiction sur l’espace maritime : le droit d’y dire le droit. On peut dire le droit par la force, par les flottes : les tournées de l’amiral ottoman, le kapudan pacha, ou du capitaine du golfe vénitien, le montrent bien. On peut aussi revendiquer la souveraineté maritime par les juridictions commerciales et la Méditerranée est l’un des terrains d’élaboration privilégiés des manières de tracer des lignes douanières à large rayon, qui permettent de capturer les trafics, de fragmenter l’espace en régions commercialement différenciées. La Méditerranée institue également des ports francs, notamment en Italie : Livourne, Gênes, Messine, Civitavecchia, mais aussi au-delà, par exemple avec Marseille. Enfin, se pose la question de qui dit le droit sur les côtes, sur les rivages et sur les formes de la navigation. Les traités entre États d’Europe occidentale et les provinces ottomanes d’Afrique du nord possèdent des clauses qui définissent les endroits où les captures en mer sont considérées comme légales ou non. On commence ainsi à imaginer des dispositifs pour réguler l’activité corsaire, endémique en Méditerranée, l’adjudication des prises maritimes. On prévoit par exemple que, dans un port neutre, il y ait un intervalle de 24 heures entre le départ de deux navires rivaux. La Méditerranée façonne la neutralité. En interdisant les captures jusqu’à une certaine distance (et cela peut osciller de 5 à 30 milles des côtes), on élabore des dispositifs qui visent à neutraliser un espace maritime, à en faire un espace neutre. Du fait de son caractère morcelé, de sa fragmentation, la Méditerranée est un terrain d’expérimentation de dispositifs variés et complexes visant à dire le droit, la souveraineté mais aussi la neutralité sur les mers.
Les ports sont quant à eux les lieux d’intenses débats sur ce qu’est un navire et la force d’un pavillon : un souverain a-t-il le droit de demander la visite et la fouille d’un navire battant pavillon étranger stationné dans un port relevant de sa souveraineté ? Avec leur pavillon, les navires sont comme des petites villes, des extensions de leur port d’attache. Il y a donc aussi une question de concurrence et de hiérarchies entre des juridictions, des souverainetés plurielles.
Avec leur pavillon, les navires sont comme des petites villes, des extensions de leur port d’attache.
Guillaume Calafat
Vous exprimez dans votre ouvrage une volonté de tenir à distance aussi bien « le refrain binaire et belliqueux de l’incommensurabilité et de la guerre sainte » que « son symétrique lénifiant du creuset des cultures et du cosmopolitisme ». Concrètement, comment l’historien parvient-il à naviguer entre le Charybde du « choc des civilisations » et le Scylla de la « convivencia » ?
Mathieu Grenet
Ces deux visions idéal-typiques de la Méditerranée, qui correspondent à des moments historiographiques assez forts, ne sont pas complètement dénuées de pertinence au regard du discours des sources, qui ont par exemple souvent tendance à relayer une vision antagonique des relations entre Chrétienté et Islam. Il est toutefois indispensable de s’en affranchir au moins pour partie. Aussi bien dans mon travail sur les îles grecques sous domination ottomane, que dans celui de Guillaume sur le commerce en Méditerranée occidentale, on se rend vite compte du caractère aporétique de ces paradigmes. Les travaux de Francesca Trivellato sur le « cosmopolitisme communautaire » permettent précisément de dépasser cette alternative pour théoriser la coexistence en un même espace et un même temps, de deux dynamiques en apparence contradictoires. Car l’institutionnalisation d’une communauté se fait dans une forme de familiarité voire de complicité, mais aussi d’inimitié avec d’autres groupes.
Guillaume Calafat
Le paradigme de l’incommensurabilité et celui de la coexistence ne sont jamais que les deux faces d’une même pièce. Que ce soit pour penser leur affrontement ou leur porosité, tous deux postulent l’existence de blocs civilisationnels cohérents. Ce que nous avons essayé de démontrer, c’est que si l’on part des sources, on a affaire à des ensembles beaucoup plus disparates et morcelés que ces deux grands blocs. On en revient à l’idée d’une Méditerranée kaléidoscopique, faite d’une mosaïque de communautés et de sujétions qui interdit de penser de façon binaire. Lorsqu’on l’observe attentivement, on se rend ainsi compte qu’une conversion, à l’époque moderne, a une double dimension, religieuse et politique, qu’il faut penser et qualifier précisément.
Vous essayez d’appréhender la Méditerranée moderne au prisme des nombreuses mobilités humaines qui l’animent. Celles-ci, par-delà leur diversité, ont souvent en commun d’être collectives, communautaires, plutôt qu’individuelles et singulières.
Le groupe est une forme de protection. Or, le déplacement en Méditerranée est sujet à de nombreux risques. Les administrations et les États sont pour leur part soumis au défi d’identifier les individus par-delà leur groupe d’appartenance, que ce soit pour pouvoir racheter des captifs ou pour retracer l’itinéraire suivi par un pèlerin. L’articulation de la communauté et de l’individu est l’un des enjeux cruciaux des appareils administratifs modernes. Nous envisageons donc à la fois des mobilités massives, qui concernent des dizaines de milliers de personnes (réfugiés juifs, mais aussi morisques, grecs ou dalmates, tsiganes, albanais, etc.), et des expériences plus individuelles (captivité, pèlerinage, mobilité marchande). Il y a par ailleurs dans les sources un biais sociologique : nous disposons d’un grain individuel plutôt pour les couches aisées et lettrées, susceptibles d’avoir laissé des documents, ce qui nous condamne souvent à envisager les couches les plus pauvres au seul prisme du collectif.
Mathieu Grenet
Votre question soulève également la question des ressources narratives dont dispose l’historien. Natalie Zemon Davis, avec son Léon l’Africain, a montré comment la focalisation sur un itinéraire exceptionnel peut permettre de saisir des dynamiques historiques d’ensemble. Cette approche par l’individu a été beaucoup utilisée pour écrire l’histoire de la Méditerranée au prisme de trajectoires particulières. Sans rejeter cette manière de procéder, nous insistons toutefois sur l’importance de penser, au-delà de la simple addition de ces cas particuliers, le collectif, en ce qu’il donne accès à des droits, des garanties, des protections. Si bien que même les cas individuels s’inscrivent dans des dynamiques collectives. Même quand on les voit individuellement, les migrants inscrivent généralement leurs pas dans des chemins qui ont été tracés et parcourus par d’autres avant eux. Les mobilités collectives ne sont donc pas seulement synchroniques, mais peuvent aussi être diachroniques. Un morisque expulsé d’Espagne aura par exemple tendance à utiliser des savoirs migratoires qui font partie d’une sorte de patrimoine communautaire. On lui indique qui contacter pour franchir les Pyrénées, qui aller voir pour trouver une place sur un bateau, etc. On ne peut donc pas opposer front à front le communautaire et l’individuel, précisément car la compréhension de l’individuel suppose de l’inscrire dans un prisme collectif.
Nous insistons sur l’importance de penser, au-delà de la simple addition des cas particuliers, le collectif, en ce qu’il donne accès à des droits, des garanties, des protections.
Mathieu Grenet
Guillaume Calafat
Et il en va de même pour la conversion, qu’on imagine aujourd’hui comme une opération individuelle et intime, mais qui à l’époque moderne était en fait une opération collective qui nécessitait des médiateurs nombreux.
La forte conflictualité qui caractérise la Méditerranée moderne n’a-t-elle pas été un frein aux circulations et aux échanges ?
Le caractère endémique de la guerre en Méditerranée n’est nullement un frein aux échanges. Il en est même plutôt un levier, assez lucratif pour un certain nombre d’intermédiaires spécialisés dans le passage de rives, les échanges d’information ou la protection. Loin de s’exclure, les pratiques conflictuelles et commerciales s’imbriquent. Wolfgang Kaiser a montré comment les conflits, loin de freiner le commerce, pouvaient lui servir de lubrifiant. Ces conflits sont profitables ; ils sont des occasions de commerce. Certains groupes diasporiques (corse, séfarade, arménien) peuvent en tirer profit en naviguant dans les interstices créés par ces frictions. La captivité, dans un parcours biographique de marin ou de marchand, constitue un horizon possible voire fréquent. Mais elle est aussi un moyen de connaître le monde chrétien pour un musulman et vice versa. C’est donc une occasion, certes forcée et brutale, d’accumuler des savoirs et de faciliter les interconnaissances et les échanges transméditerranéens.
Mathieu Grenet
On voit effectivement apparaître dans les récits d’anciens captifs l’argument de la captivité comme argument de compétences : « J’y suis allé, donc je connais ». On peut faire valoir cette expérience de captivité à l’appui d’une candidature à une fonction ou un emploi qui nécessite ce type de connaissances. L’idée que le conflit serait l’ennemi de l’échange, que le doux commerce permettrait la paix perpétuelle, est un héritage des Lumières qu’il convient d’interroger, voire de déconstruire. Dans la Méditerranée moderne, non seulement cela ne se vérifie pas, mais c’est l’inverse qu’on observe, dans la mesure où la guerre alimente le commerce. C’est notamment vrai pour les neutres qui parviennent, dans tous les sens du terme, à naviguer entre des pôles antagoniques pour faire du conflit une ressource.
Quels sont les principaux obstacles, risques et entraves auxquels sont confrontés ceux qui circulent en Méditerranée à l’époque moderne ?
Guillaume Calafat
La tempête, le naufrage et les aléas climatiques, comme les fameux « coups de vents » ou « coups de mer » méditerranéens, demeurent présents, même si un grand nombre de naufrages ont lieu dans les ports et sont donc moins spectaculaires qu’on se l’imagine. Sinon, la capture au cours d’une attaque corsaire et la captivité qui s’ensuit demeurent les principales menaces. Celles-ci ne sont pas des abordages violents et indiscriminés, notamment parce que les captifs font l’objet de rançons et ont donc une valeur qu’il faut préserver. Encore au XVIIIe siècle, les activités corsaires demeurent très présentes, aussi bien du côté des ordres militaro-religieux catholiques (l’ordre de Malte, l’ordre toscan des chevaliers de saint Étienne) qu’en Afrique du nord (dans les provinces ottomanes d’Alger ou de Tripoli) : le corso, cette activité aux confins de la piraterie et du brigandage sous couvert de guerre sainte, demeure une activité lucrative. Il faut également compter avec les tracasseries administratives dans les ports : les visites, la réclamation de droits et de taxes considérés comme abusifs, les réquisitions sont autant d’aléas que redoutent les marins. Il y a bien sûr aussi, comme dans tout voyage à l’époque moderne, le risque d’être dépouillé qu’on retrouve fréquemment dans les récits de pèlerinage.
Mathieu Grenet
L’une des grandes inquiétudes des voyageurs est en effet d’être détroussés et qu’à cette occasion, on leur vole leurs papiers. La crainte n’est pas tant de perdre ses biens, que les documents qui permettent d’attester son identité et donc de voyager. Le risque est de se retrouver dans une espèce de limbe, sans capacité d’avancer ou de reculer puisqu’on n’a plus les moyens d’attester de son identité. C’est d’ailleurs pourquoi on voyage souvent en groupe, car le collectif peut aider à faire valoir ses droits en cas de problème.
La crainte n’est pas tant de perdre ses biens, que les documents qui permettent d’attester son identité et donc de voyager.
Mathieu Grenet
Face à ces périls, y a-t-il des formes de coopération internationale destinées à sécuriser les échanges et les circulations en Méditerranée ? Et qu’en est-il des initiatives privées : peut-on voir dans les ordres religieux spécialisés dans le rachat des captifs chrétiens la préfiguration des ONG qui de nos jours viennent au secours des migrants au large des côtes ?
Guillaume Calafat
De part et d’autre de la Méditerranée, tant dans le monde chrétien (catholique comme protestant) que musulman mais aussi parmi les communautés juives, on voit apparaître, outre des assurances privées, des caisses de solidarité communautaires en vue de pourvoir au rachat des captifs. Cela passe par des quêtes, des aumônes, mais aussi des taxes sur les navires où les marchandises embarquées qui permettent une forme de mutualisation du risque. Il y a par ailleurs effectivement des ordres rédempteurs comme les trinitaires (plutôt pour les Espagnols) ou les mercédaires (pour les Français), mais ils ne sont pas les seuls acteurs des rachats : les États, par l’intermédiaire de leurs consuls, organisent de véritables politiques de rachat et commencent à passer par des intermédiaires spécialisés, surtout des marchands. Dans tous les cas, les personnes rachetées doivent passer par une période de « sas » car si, comme le soulignait Mathieu, la captivité leur confère une compétence, elle est également source de suspicion : on craint que le captif ait été retourné, se soit converti.
Votre travail sur la Méditerranée moderne apporte-t-il, si ce n’est des réponses, du moins des éclairages qui pourraient être utiles pour penser les défis actuels que connaît cette région du monde, que ce soit en termes d’inégalités de développement, de tensions géopolitiques ou de crise environnementale ?
Il est difficile à l’historien de répondre à une telle question. Nous travaillons bien sûr avec ces enjeux, mais nous essayons de les maintenir en partie à distance. Il n’y a aucune fatalité des espaces sur lesquels nous travaillons, mais au contraire, à l’époque moderne, des transformations et des circulations très intenses. C’est d’ailleurs l’une des différences fondamentales avec l’époque actuelle où le glacis frontalier est beaucoup plus visible et imperméable. Là où le monde contemporain irrigue notre recherche, c’est surtout sur les questions que nous posons au passé, à commencer par celle de la mobilité. Nous cherchons une Méditerranée précoloniale pour rendre moins téléologique l’histoire d’un espace dont la rive sud n’était pas prédestinée à passer sous la coupe de la rive nord. Notre livre cherche à rappeler qu’il a existé une Méditerranée plus équilibrée, plus paritaire.
Là où le monde contemporain irrigue notre recherche, c’est surtout sur les questions que nous posons au passé, à commencer par celle de la mobilité.
Guillaume Calafat
Mathieu Grenet
Nous avons délibérément fait le choix de ne pas nous arrimer à un « contemporain d’accroche ». Mais il est évident que le passage par l’époque moderne permet d’interroger des évidences contemporaines, par exemple l’idée selon laquelle les mobilités en Méditerranée se déploieraient fatalement dans une seule et même direction. C’est donc une manière non tant de mettre à distance le contemporain que de le réinterroger à partir d’une connaissance plus fine de l’époque moderne, afin d’éviter par exemple les effets de « naturalisation » des flux migratoires.
Pour terminer, pourriez-vous nous présenter quelques lieux méditerranéens constituant selon vous de bons observatoires des dynamiques à l’œuvre dans la Méditerranée moderne ?
Guillaume Calafat
Le port toscan de Livourne est intéressant du fait de son ambivalence fondamentale qui résume bien celle de l’époque. C’est un port de guerre, de galères, dans lequel on peut voir des musulmans enchaînés, mais c’est aussi un port dans lequel les juifs ne sont pas assignés à un ghetto ou contraints à porter un signe distinctif, un port dans lequel commercent des musulmans libres. Au travers d’un commerce lié à la violence, à la course, à la prédation maritime, Livourne se forge une expérience moderne : une ville nouvelle, un port franc, porteur d’une neutralité originale. On pourrait observer des logiques similaires à propos de Malte qui est à la fois la ville des ordres militaro-religieux et, à une autre échelle, c’est aussi un lieu de cohabitation entre chrétiens et musulmans. Je pense enfin au Capo Passero, au sud-est de la Sicile, un territoire qui est un lieu de naufrages fréquents (de navires chrétiens et musulmans). Ce fut un lieu investi par les Turcs au milieu du XVIe siècle, un espace frontalier, entre le canal de Sicile et la mer Ionienne, qui témoigne de l’expansion considérable de l’Empire ottoman. Au XVIIIe siècle, il devient également le lieu d’un affrontement entre Britanniques et Espagnols pour le contrôle de la Sicile. Ces espaces partagés — on pense également à Lampedusa — sont d’excellents révélateurs des transformations du monde méditerranéen.
Mathieu Grenet
Je pense pour ma part au Mont-Liban, passé sous contrôle de l’Empire ottoman au début du XVIe siècle, et qui présente à l’époque moderne un paysage politique morcelé, dominé par des grandes familles musulmanes, chrétiennes et druzes. Dans cet espace rural et montagneux, la propriété foncière et l’affermage des impôts constituent d’importants vecteurs du pouvoir. Si le sultan conserve la propriété éminente sur ces terres, on observe localement un complexe empilement administratif et confessionnel, les gouverneurs provinciaux ottomans (les pachas) affermant les revenus fiscaux à des émirs druzes puis sunnites, qui eux-mêmes les sous-afferment à certaines des principales familles maronites de la région, dont les représentants les plus éminents portent le titre de « cheikhs ». Installée dans le district du Kesrouan au début du XVIIe siècle, la dynastie maronite des Khazin monopolise rapidement plusieurs charges-clés, qu’elles soient fiscales, civiles ou religieuses, notamment grâce à de nombreuses fondations monastiques. Parallèlement, elle multiplie les rachats de terres et de villages, au service d’une vaste politique de colonisation par des familles maronites venues du nord, au détriment de l’élément chiite. Régulièrement dépeint à l’époque moderne comme un refuge quasi-inexpugnable, le Kesrouan est aussi de plus en plus souvent décrit, au cours du XVIIe siècle, comme le fief particulier des Khazin. Évoluant sous la protection de la puissante dynastie druze des Maan, ils jouent la carte confessionnelle et commerciale pour se concilier les bonnes grâces de Rome et de la France. Protecteurs locaux des premières missions catholiques (capucines puis jésuites) envoyées au Proche-Orient dans le sillage immédiat de la création de la congrégation de Propaganda fide en 1622, les Khazin promeuvent également le développement agricole d’un territoire qui approvisionne en cultures d’exports (soie, coton, céréales, huiles, etc.) les principaux ports de la côte libanais (Saïda, Acre, Beyrouth), au sein d’un marché très lucratif et désormais mondialisé. Signe de l’affermissement de leur position : en 1655, Abu Nawfal al-Khazin est nommé vice-consul de France à Beyrouth, sous l’autorité du consul en poste à Alep, alors le grand carrefour des routes commerciales et caravanières du Proche-Orient ; ses héritiers se transmettent ensuite le titre sur quatre générations, jusqu’au milieu du XVIIIe siècle. Au cours des XVIIe et XVIIIe siècles, c’est notamment à partir du Mont-Liban que se déploie, dans l’Europe entière et même jusqu’aux Amériques, un important ballet de quêteurs « orientaux », qu’ils soient prélats maronites, moines melkites ou « princes libanais ». Parfois accusés de vivre aux crochets de la solidarité catholique, ces personnages sillonnent l’Europe, de Paris à Vienne en passant par Naples, Bruxelles, Madrid et bien sûr Rome, sollicitant des secours pour les Églises chrétiennes d’Orient et la lutte contre les « Turcs ». Leurs mobilités comme leurs activités cristallisent l’attention croissante des autorités européennes dans la première moitié du XVIIIe siècle, dans un double contexte de multiplication de ces campagnes de quête et de durcissement des mesures contre les quêteurs et autres vagabonds.
L’article « Il a existé une Méditerranée plus paritaire », une conversation avec Guillaume Calafat et Mathieu Grenet est apparu en premier sur Le Grand Continent.
27.12.2023 à 07:00
20 livres à lire en janvier 2024
baptiste.rogerlacan@legrandcontinent.eu
Une grande nouveauté géopolitique en espagnol … et beaucoup d’autres choses. Si parmi vos résolutions, vous vous êtes jurés de lire plus — et en plusieurs langues —, cette sélection devrait vous faciliter la tâche. Des spectres révolutionnaires à l’imperium romain en passant par la circulation des œuvres d’art spoliées, cette sélection de janvier est d’une richesse inouïe. Comme il se doit pour la nouvelle année.
L’article 20 livres à lire en janvier 2024 est apparu en premier sur Le Grand Continent.
Texte intégral (7351 mots)
El Grand Continent, Fracturas de la guerra ampliada, Éditorial Círculo de Bellas Artes
« La guerre en Ukraine est la première guerre européenne du XXIe siècle et a montré que nous avons besoin de nouvelles catégories pour la comprendre.

Les alliances ont changé : l’Europe et les États-Unis luttent pour conserver un rôle de plus en plus flou, la Chine joue un rôle décisif et des pays comme l’Inde, l’Indonésie, le Brésil, l’Afrique du Sud, l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis aspirent à une domination régionale et considèrent qu’une position non alignée sert mieux leurs intérêts nationaux.
Dans le même temps, les sanctions économiques de quelques-uns doivent coexister avec l’interdépendance des marchés des matières premières, de l’énergie ou de la technologie.
Philosophes, politiciens, politologues, économistes, historiens, écrivains et physiciens, toutes figures de premier plan, sont réunis dans ce volume pour aborder ces transformations : de Kharkiv au métavers, la guerre est là. »
Parution le 17 janvier
Steve Tsang et Olivia Cheung, The Political Thought of Xi Jinping, Oxford University Press
« Au cours des cinquante dernières années, le dirigeant suprême de la Chine, Xi Jinping, a opéré des changements extraordinaires qui ont de profondes implications non seulement pour le peuple chinois, mais aussi pour les nations du monde entier. Étant donné que les relations de la Chine avec le reste du monde changent rapidement et fondamentalement sous le règne de Xi, il est impératif que nous sachions ce qu’est la pensée de Xi Jinping, comment elle a évolué et pourquoi elle est si importante.

Dans The Political Thought of Xi Jinping, Steve Tsang et Olivia Cheung donnent une vue d’ensemble de ce qu’est et de ce que n’est pas la “pensée de Xi Jinping” et de ce qu’elle signifie pour la Chine et pour le monde. Xi, désormais dirigeant à vie, a veillé à ce que la “Pensée de Xi Jinping” devienne la nouvelle idéologie de l’État. Manifestement inspiré par la doctrine de la “Pensée de Mao Zedong”, qui a défini les paramètres d’une pensée acceptable pendant un quart de siècle, Xi souhaite que sa doctrine définisse ce qu’il appelle le “Rêve chinois de rajeunissement national” et indique la voie à suivre pour qu’il se réalise d’ici 2050.
Tel que Xi le conçoit, le rêve chinois consiste à rendre à la Chine sa grandeur, ou à la ramener à l’apogée de sa puissance, de son influence et de son statut international à l’époque mythique de sa grandeur, au cours de sa longue histoire impériale. S’appuyant sur des recherches originales concernant les discours, les écrits et les politiques de Xi, Tsang et Cheung conceptualisent la vision de Xi indépendamment des interprétations fournies par le Parti communiste chinois ou d’autres sources. Ils examinent et expliquent en outre comment Xi cherche à transformer cette vision en réalité. »
Parution le 9 janvier
Éric Fournier, « Nous reviendrons ! ». Une histoire des spectres révolutionnaires France XIXe siècle, Champ Vallon

« Au XIXe siècle, les révolutionnaires français mobilisent des spectres, de plus en plus nombreux, de plus en plus gothiques, mais toujours porteurs d’une vive modernité politique. Cet imaginaire révolutionnaire accompagne deux phénomènes majeurs : l’entrée des masses en politique et la violence croissante des massacres fondateurs des régimes successifs.
Cette spectralité peut même être portée par des vivants, et Louise Michel de proclamer : “nous reviendrons, spectres vengeurs sortant de l’ombre !”. En luttant contre les effacements, en renouant les fils brisés, ces revenants soulignent avec force la première leçon de l’Histoire : rien n’est joué d’avance, rien n’est définitivement joué.
Les spectres révolutionnaires du XIXe siècle se sont révélés de puissants antidotes à la résignation. »
Parution le 5 janvier
Rahel Jaeggi, Fortschritt und Regression, Suhrkamp

« L’abolition de l’esclavage, l’introduction de systèmes de sécurité sociale, la sanction du viol conjugal sont généralement considérés comme un progrès social — un changement vers le meilleur. Pourtant, l’idée d’un mouvement de progrès généralisé a perdu son lustre d’antan, elle suscite même le scepticisme.
En revanche, le diagnostic de régression est sur toutes les lèvres. Il est accolé à divers phénomènes contemporains, du populisme autoritaire de droite à la fatigue démocratique. Dans son livre, Rahel Jaeggi défend le couple de concepts progrès et régression comme un outil socio-philosophique indispensable pour la critique de notre époque. Pour elle, ce qui est progressiste ou régressif, ce n’est pas seulement le résultat, mais surtout la forme même des transformations sociales. En s’interrogeant sur les blocages liés à l’expérience qui favorisent les tendances régressives, elle développe un concept de progrès qui évite les distorsions eurocentriques tout comme l’idée d’une tendance inéluctable au développement. Le progrès, montre-t-elle, n’est pas le prélude à un objectif déjà connu, mais un processus d’émancipation jamais achevé. »
Paru le 11 décembre
Norberto Bobbio, Lezioni sulla guerra e sulla pace, Laterza

« En 1964, Norberto Bobbio décide de consacrer ses cours de philosophie du droit au thème de la guerre et de la paix. Un thème — pas nouveau dans la pensée des juristes et des politologues, mais peu fréquent dans les cours universitaires — qui lui a semblé mériter d’être traité non seulement parce qu’il se prêtait à une vaste reconstruction historique et théorique, mais surtout parce qu’il était rendu urgent par le danger d’une guerre atomique, en pleine crise des missiles de Cuba.
Le livre expose et discute les différentes théories qui ont été utilisées au cours de l’histoire pour justifier la guerre et les différents courants pacifistes qui ont tenté de la surmonter, en mettant en évidence leurs arguments, leurs incohérences, leurs forces et leurs faiblesses. Bobbio y avance sa célèbre thèse sur l’impossibilité de justifier la guerre à une époque où l’utilisation d’armes aussi puissantes risque de mettre en cause la survie même de l’espèce humaine. »
Parution le 12 janvier
Guillermo Soler García de Oteyza, El ingenioso e inquieto Oteyza en campo enemigo, Critica

« Au cours du premier tiers du XXe siècle, peu de personnes ont connu le succès et la popularité de Luis de Oteyza (1883-1961). Écrivain voyageur, romancier aventurier, poète, député et diplomate de renom, il doit l’apogée de sa notoriété à sa façon particulière de pratiquer le journalisme. Ainsi, défiant le manichéisme de guerre, il se rend au Maroc en août 1922 pour interviewer le principal ennemi de l’Espagne : Abd el-Krim, le chef de la révolte rifaine dont les troupes avaient humilié l’armée espagnole lors du “désastre d’Anoual”.
Grâce à un travail exhaustif de compilation documentaire et de reconstitution historique, Guillermo Soler nous fait découvrir les tenants et les aboutissants de cette exclusivité mondiale — l’apogée de sa carrière — et nous permet surtout de retracer les principaux événements de l’histoire contemporaine de l’Espagne à travers le parcours personnel et professionnel de cet écrivain et voyageur ingénieux et infatigable. Un periodista en campo enemigo fait revivre l’une des figures de proue du journalisme espagnol dont la plus grande audace, le plus grand succès et le plus grand héritage furent quelque chose d’aussi simple et aussi complexe à la fois que de donner la parole à l’ennemi pour tenter de faire cesser une guerre absurde. »
Parution le 17 janvier
Daniel S. Milo, La survie des médiocres. Critique du darwinisme et du capitalisme, Gallimard

« Darwin a très souvent raison. Mais quand il a tort, ses erreurs sont lourdes de conséquences, tant pour la science que pour la société, parce qu’il est le lecteur attitré du Livre de la Nature. Daniel S. Milo, un historien essayiste qui travaille avec des biologistes depuis quinze ans, fonde cette critique sur leurs propres découvertes. Il part de l’air de famille existant entre la “sélection naturelle” de Darwin et la “main invisible” d’Adam Smith. La nature sait ce qu’elle fait ; le marché a toujours raison. Si les non-humains sont condamnés à innover et à exceller parce que telle est la loi de l’évolution, les humains n’ont pas davantage le droit de s’endormir sur leurs lauriers.
L’homologie entre la nature et le marché vient, pour l’auteur, du “péché originel” de Darwin : il a conçu la sélection naturelle à l’image de la domestication. De là est née l’alliance objective entre le néodarwinisme et le néocapitalisme, les deux modèles se renforçant l’un l’autre. Rien n’est pourtant plus dissemblable que le fonctionnement de la nature et celui de la ferme. L’optimisation est la règle et la raison d’être de la sélection artificielle, mais dans la nature les passables et les médiocres ont aussi leurs chances de survivre et de se multiplier. La compétition n’y est qu’une forme de sociabilité parmi d’autres. Il y a, dans le monde des humains comme dans le monde des non-humains, de la place, une place presque illimitée, pour le faible comme pour le plus fort, pour l’ennuyeux comme pour le plus brillant, pour l’oisif comme pour le besogneux. Si nous saluons la sagesse de la nature, nous devons reconnaître que la tolérance à la médiocrité est un aspect constitutif de son génie. Soyons donc ses dignes disciples ! »
Parution le 11 janvier
Bécquer Seguín, The Op-Ed Novel : A Literary History of Post-Franco Spain, Harvard University Press

« Dans The Op-Ed Novel, Bécquer Seguín entreprend la première étude complète sur la façon dont la littérature contemporaine est façonnée par le journalisme d’opinion, en se concentrant sur les écrivains de fiction qui ont pris la plume dans l’Espagne post-franquiste et sont devenus les gardiens de l’avenir culturel, économique et politique de leur pays. Après la transition de l’Espagne vers la démocratie à la fin des années 1970 et au début des années 1980, des romanciers de renommée internationale tels que Javier Cercas, Antonio Muñoz Molina et Javier Marías ont saisi l’occasion d’alimenter les pages d’opinion de la presse libre nouvellement légale.
The Op-Ed Novel analyse la manière dont le style argumentatif et les préoccupations de leurs chroniques dans El País, le quotidien le plus lu d’Espagne, ont imprégné leurs œuvres de fiction. Ces auteurs, comme d’autres, ont utilisé leurs romans pour régler leurs comptes avec d’autres intellectuels, formuler des affirmations historiques spéculatives et faire avancer des projets politiques partisans. Dans le même temps, leur technique littéraire a considérablement dynamisé le journalisme d’opinion. Guide vivant de la littérature espagnole contemporaine, The Op-Ed Novel offre une vue d’ensemble du climat intellectuel de l’après-franquisme et de l’évolution du rôle du romancier. »
Parution le 9 janvier
Anne O’Donnell, Power and Possession in the Russian Revolution, Princeton University Press
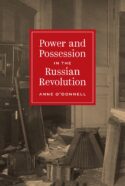
« Les révolutions de 1917 ont balayé non seulement les autorités gouvernementales russes, mais aussi le principe de la propriété sur lequel elles reposaient. Ce bouleversement a déclenché des vagues de dépossession qui sont rapidement allées au-delà de la saisie des usines aux industriels et des fermes aux propriétaires terriens, envisagée par les révolutionnaires bolcheviks, pour pénétrer les fondements de la vie sociale. Dans Power and Possession in the Russian Revolution, Anne O’Donnell restitue l’effort sans précédent des bolcheviks pour éradiquer la propriété privée et créer une nouvelle économie politique — le socialisme — pour la remplacer.
Le récit d’Anne O’Donnell reprend l’histoire de la propriété à l’envers, en montrant comment les liens qui unissaient les gens à leurs biens ont été rompus et comment de nouvelles façons de connaître les choses, de les évaluer et de les posséder ont vu le jour au milieu de l’effervescence politique et du désarroi économique de la révolution. Elle rappelle que la confiscation des biens en Russie après la révolution, comme beaucoup d’autres épisodes de dépossession massive au XXe siècle, a largement échappé aux formes traditionnelles d’archivage. Elle répare cette omission en s’appuyant sur des sources qui relatent l’expérience vécue des bouleversements — pétitions populaires, inspections d’appartements, audits internes des institutions révolutionnaires et registres de la police politique — pour reconstituer des archives de la dépossession. Il en résulte une histoire intime des tentatives des bolcheviks de conquérir les gens et les choses.
La réorganisation de la propriété par les bolcheviks n’a pas seulement changé la vie et le destin des individus, elle a également jeté les bases d’un nouveau type d’État qui, ayant renoncé à la défense de la propriété privée, a donné naissance à type nouveau et énigmatique de propriété : la propriété d’État socialiste. »
Parution le 16 janvier

Luc Boltanski, Arnaud Esquerre et Jeanne Lazarus, Comment s’invente la sociologie. Parcours, expériences et pratiques croisés, Flammarion
« La sociologie, mode d’emploi. Aimée par des écrivains et des artistes, sollicitée par des journalistes, des militants, des responsables politiques pour comprendre l’actualité, qu’on s’en réclame ou qu’on la critique, comment se pratique cette science sociale qui attire tant l’attention ?
Trois sociologues de générations différentes nous ouvrent les portes de leurs laboratoires et nous introduisent à leurs œuvres. Ils expliquent, en dialoguant entre eux, comment on enquête, comment on écrit, comment on forge des concepts, comment on procède à des comparaisons, quels rapports entretenir avec d’autres disciplines. Ils partagent ainsi leurs méthodes pour analyser des problèmes sociaux à partir de questions sociologiques. Ce livre s’adresse à toutes celles et tous ceux qui s’intéressent à la sociologie et souhaitent savoir comment elle s’élabore. »
Parution le 17 janvier
Jean-Baptiste Fressoz, Sans transition. Une nouvelle histoire de l’énergie, Seuil

« Voici une histoire radicalement nouvelle de l’énergie qui montre l’étrangeté fondamentale de la notion de transition. Elle explique comment matières et énergies sont reliées entre elles, croissent ensemble, s’accumulent et s’empilent les unes sur les autres.
Pourquoi la notion de transition énergétique s’est-elle alors imposée ? Comment ce futur sans passé est-il devenu, à partir des années 1970, celui des gouvernements, des entreprises et des experts, bref, le futur des gens raisonnables ?
L’enjeu est fondamental car les liens entre énergies expliquent à la fois leur permanence sur le très long terme, ainsi que les obstacles titanesques qui se dressent sur le chemin de la décarbonation. »
Parution le 12 janvier
Bruno Tertrais, Pax atomica ? Théorie, pratique et limites de la dissuasion, Odile Jacob
« Sommes-nous au bord d’une guerre nucléaire ?

La dissuasion est-elle un facteur modérateur dans les relations internationales ? Quel rôle joue exactement l’arme atomique dans un paysage où les formes de guerre se sont diversifiées ?
Ces questions sont aujourd’hui cruciales face aux menaces proférées par la Russie et alors que les dangers nucléaires se sont multipliés en Asie. Qui a vraiment le pouvoir de déclencher l’Apocalypse ? Comment élabore-t-on les plans d’emploi de l’arme atomique ? Quelles leçons peut-on tirer des crises qui ont parfois amené le monde au bord du gouffre depuis 1945 ? La Bombe maintient-elle la paix entre grandes puissances et continuera-t-elle de le faire ? Au moment où le sort de la planète pourrait basculer, Bruno Tertrais répond à cette question par l’affirmative, sans masquer les limites du concept de dissuasion. »
Parution le 10 janvier
Avinoam Yuval-Naeh, An Economy of Strangers. Jews and Finance in England, 1650-1830, Penn Press

« L’une des notions les plus persistantes, les plus puissantes et les plus dangereuses de l’histoire des juifs de la diaspora est le talent prodigieux qui leur est attribué dans le domaine économique. De l’usurier juif médiéval au grand financier des XIXe et XXe siècles et aux investisseurs contemporains, en passant par le juif de port et le juif de cour du début de l’ère moderne, les juifs occupent une place cruciale dans l’imaginaire économique. Pour les capitalistes et les marxistes, les libertaires et les réformateurs radicaux, les juifs sont intimement liés à l’économie. Cette association est devenue si naturelle que nous oublions souvent l’histoire de la création et de la refonte de cet ensemble complexe de perceptions sur les juifs et l’économie, qui ont émergé dans différents contextes historiques pour répondre à une variété d’angoisses et de besoins personnels et sociétaux.
Dans An Economy of Strangers, Avinoam Yuval-Naeh historicise cette association en se concentrant sur un moment et un lieu précis : la révolution financière qu’a connue l’Angleterre à partir de la fin du XVIIe siècle et qui a coïncidé avec la rétablissement de la population juive dans ce pays, pour la première fois depuis près de quatre cents ans. »
Parution le 9 janvier
Giovanni Brizzi, Imperium. Il potere a Roma, Laterza
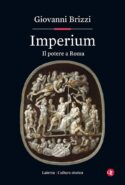
« Qu’est-ce que le pouvoir dans la Rome antique ? De quelle autorité disposaient un consul, un tribun, un triumvir ? Et à quelles fins ? Comment se justifiait l’existence même d’un commandant et à qui devait-il rendre des comptes ? L’imperium de César était-il différent de celui d’Auguste ou de Justinien ?
L’histoire de Rome, tout au long de son parcours millénaire, s’accompagne d’un concept très particulier et original : celui exprimé par le terme imperium. Ce mot traduit la relation entre le pouvoir dans son sens le plus élevé et la responsabilité. En assumant cette lourde charge, le pouvoir est confronté à une série de devoirs. À l’origine, la responsabilité envers le peuple romain est subordonnée à une série de valeurs antérieures à la naissance même de l’Urbs, comme celle de la fides, le respect des règles.Tous les grands hommes de Rome sont contraints de se rattacher au concept d’imperium. Camille, à qui l’on attribue une première définition du droit naturel ; Scipion, le premier imperator, qui proclame la supériorité de l’individu sur les structures ; Sylla, l’idéaliste en quête d’impossibles retours au passé. Il irrigue les théories de Cicéron ; est revendiqué par César pour lui-même ; structure l’oeuvre d’Auguste dans le nouveau pacte avec les dieux (la pax Augusta) d’où naîtra la monarchie. Tout le cours de l’histoire impériale est alors le théâtre d’un débat permanent, qui engage aussi bien les stoïciens que la propagande de cour, les empereurs-soldats que la pensée chrétienne. »
Parution le 19 janvier
Bénédicte Savoy, À qui appartient la beauté ?, La Découverte

« La beauté n’appartient sans doute à personne. Mais qu’en est-il des objets que les musées ont élevés au rang d’art et qui font leur orgueil ? Appartiennent-ils au lieu qui les a vus naître ? À la culture dont ils incarnent le génie ? Aux esthètes éclairés qui se les sont appropriés ? À l’humanité entière qui y accéderait par l’intermédiaire d’institutions dédiées à leur conservation ? Mais comment alors justifier que certains jouissent de ce patrimoine réputé universel quand d’autres en sont tenus éloignés ? Peut-être faut-il d’abord se demander comment ces objets sont concrètement parvenus jusqu’à nous et ce que leurs pérégrinations révèlent de notre histoire, de ses violences et asymétries, symboliques ou réelles. S’ils ont suscité là où ils sont arrivés des fécondations esthétiques inattendues, ils ont aussi creusé là où ils manquent des blessures encore vives.
Le buste de Néfertiti, l’Autel de Pergame, le retable de L’Agneau mystique, la Madone Sixtine, les têtes de bronze du Palais d’été de Pékin, L’Enseigne de Gersaint, la statue de la “reine Bangwa” du Cameroun, le Portrait d’Adele Bloch-Bauer, les “trésors royaux” du Bénin : à travers les déplacements — qui sont aussi des voyages fascinants — de ces œuvres emblématiques, Bénédicte Savoy déploie une réflexion sur le désir et la domination, sur la rupture et la réparation, sur les émotions qu’éveille la beauté et la transformation de l’héritage qu’il nous importe de transmettre. »
Parution le 18 janvier
Olivier Dard, Jean Philippet, Février 34. L’Affrontement, Fayard

« Le spectre des années trente plane sur la France d’aujourd’hui. Des mobilisations de masse récentes comme les gilets jaunes ont ravivé la mémoire de l’émeute sanglante du 6 février 1934, largement assimilée à une tentative de coup de force fasciste des ligues. La réalité fut bien plus complexe.
Olivier Dard et Jean Philippet s’appuient sur un dépouillement systématique des sources pour replacer cette journée au cœur d’une séquence de deux ans, de “l’hiver du malaise” de 1932-1933 à l’échec de “l’union nationale” autour de Doumergue à l’automne 1934. Ils racontent au plus près du terrain, entre Paris et la province, l’affaire Stavisky et ses multiples rebondissements, les coulisses et le déroulement de la manifestation meurtrière du 6 février, de même que ses répliques, tout aussi violentes, des 7 et 9 ainsi que du 12, marqué par une grève générale.
En examinant les multiples acteurs de ces journées — membres des ligues, communistes, forces de l’ordre ou simples passants —, cette somme propose une lecture renouvelée du 6 février 1934, par-delà les mythes et les récupérations. »
Parution le 24 janvier
Manuel Disegni, Critica della questione ebraica. Karl Marx e l’antisemitismo, Bollati Boringhieri
« Qu’est-ce que l’antisémitisme ? Pourquoi n’a-t-il pas été éradiqué par les Lumières et les révolutions modernes, comme tant d’autres préjugés et superstitions traditionnels, et pourquoi est-il réapparu, plus barbare que jamais, au cœur de la société moderne ? Comment expliquer sa persistance spectrale jusqu’à nos jours ? Quel mystérieux attrait lui permet encore de s’immiscer dans le cœur des classes dirigeantes comme dans celui des opprimés, de droite comme de gauche ?

Manuel Disegni relit Marx à partir de ces questions. Son intention n’est pas seulement de mettre fin une fois pour toutes aux rumeurs sur le prétendu antisémitisme du révolutionnaire de Trèves, né juif et converti au christianisme dès son plus jeune âge. Cette enquête sur la relation entre la théorie marxienne et le phénomène antisémite vise à proposer une remise en question radicale de l’une et de l’autre. La discussion sur Marx et l’antisémitisme tourne traditionnellement autour du tristement célèbre, jamais bien compris et toujours scandaleux article de 1844 sur la question juive. Disegni y voit un témoignage du fait que Marx lui-même aurait été le premier à reconnaître dans les régurgitations antisémites de son temps un phénomène spécifiquement moderne : non seulement le résidu d’une ancienne rancœur religieuse, mais en même temps un produit de la nouvelle société née de l’émancipation bourgeoise et de la révolution industrielle. Mais bien au-delà de cet écrit de jeunesse, le projet de faire une “critique définitive de la question juive” traversera de manière souterraine toute l’œuvre de Marx, jouant un rôle décisif dans toutes les étapes de son itinéraire critique, depuis sa confrontation de jeunesse avec la philosophie allemande jusqu’à ses confrontations ultérieures avec le socialisme français et l’économie politique britannique. Entre textes connus et moins connus, reconstructions historiques et anecdotes, controverses théoriques, batailles politiques et excursions littéraires, la reconstruction de Disegni met en lumière ce thème comme l’un des principaux éléments de continuité entre les deux Marx présumés, le jeune philosophe et l’économiste à la barbe blanche ; comme le véritable garant de la cohérence méthodologique entre le matérialisme historique et la théorie du capital.
Alors que les études marxiennes et le marxisme ont toujours sous-estimé, pour ne pas dire négligé, le sujet de l’antisémitisme, la recherche sur l’antisémitisme n’a jusqu’à présent pas reconnu la contribution de ce classique de la pensée critique à la compréhension de la nature et des causes de son objet. »
Parution en janvier
Richard Sakwa, The Lost Peace. How the West Failed to Prevent a Second Cold War, Yale University Press
« La fin de la guerre froide a été une opportunité — notre incapacité à la saisir a conduit à la nouvelle ère de rivalité entre grandes puissances que nous connaissons aujourd’hui.
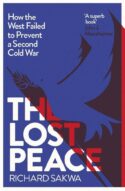
L’année 1989 annonçait une perspective unique de paix mondiale durable, alors que les divisions et les conflits idéologiques graves commençaient à être résolus. Aujourd’hui, trois décennies plus tard, cette paix a été perdue. Avec la guerre en Ukraine et les tensions croissantes entre la Chine, la Russie et l’Occident, la politique des grandes puissances domine à nouveau la scène mondiale. Mais aurait-il pu en être autrement ?
Richard Sakwa montre comment les années qui ont précédé la première invasion massive de l’Ukraine ont représenté une pause dans le conflit plutôt qu’un accord durable — et comment, depuis lors, nous sommes entrés dans une “deuxième Guerre froide”. Retraçant les erreurs commises de part et d’autre qui ont conduit à la crise actuelle, M. Sakwa examine la résurgence de la Chine et de la Russie, ainsi que les perturbations et les ambitions de l’ordre libéral qui ont ouvert de nouvelles lignes de conflit catastrophiques.
Il s’agit d’un compte rendu essentiel et solidement argumenté sur la façon dont le monde a perdu sa chance de paix et a vu, à la place, le retour de la guerre en Europe, des rivalités mondiales et de la politique de la corde raide nucléaire. »
Paru le 28 novembre 2023
Ramón González Férriz, Los años peligrosos, Debate

« Ces dernières années, la politique s’est radicalisée. De nouveaux partis extrémistes sont apparus, certains partis traditionnels ont adopté des positions intransigeantes et une grande partie de la société est durablement mécontente des élites traditionnelles. La démocratie a changé, tout comme les relations entre les citoyens. Dans ce livre, le journaliste Ramón González Férriz revient sur les événements et les idées qui ont motivé cette radicalisation.
Ce processus a commencé il y a quinze ans, avec l’émergence de deux mouvements antagonistes : le Tea Party aux États-Unis et le 15M en Espagne. Malgré leurs nombreuses différences, tous deux exigeaient que les autorités corrompues cèdent la place aux véritables représentants du peuple et que la justice économique soit rendue. Tous deux sont partis de la conviction que l’ancien système politique et économique était moribond. Tous deux ont atteint une grande popularité grâce à la conjonction des réseaux sociaux et des téléphones mobiles, à la transformation des médias traditionnels et à l’émergence de nouveaux médias. Mais tous deux ont commencé à muter rapidement et à adopter des caractéristiques plus identitaires que les revendications démocratiques traditionnelles. Ils ont bouleversé les conventions idéologiques qui régissaient les sociétés occidentales depuis la Seconde Guerre mondiale.
Les Années dangereuses rend compte de cette mutation qui, sous l’impulsion de millions de personnes réellement en colère contre le système, mais aussi de ceux qui aspiraient à rejoindre la nouvelle élite, d’intellectuels jusqu’alors inconnus et d’opportunistes médiatiques, a transformé ces mouvements en Podemos, Brexit, Trumpisme, Indépendance catalane, Vox, Alternative pour l’Allemagne, Syriza ou Frères d’Italie, parmi tant d’autres. Tous ces mouvements, qui font appel à des notions de culture d’éveil d’une part et de nationalisme réactionnaire d’autre part, ont transformé notre politique en un affrontement amer entre des tribus polarisées et une lutte irrésolue d’identités conflictuelles. Après quinze ans d’un climat violent et radicalisé, nous sommes toujours insatisfaits de la politique et n’avons pas réussi à donner naissance à un nouveau système. Nous avons fait de l’instabilité et de la paranoïa un nouveau mode de vie.
Mais ce livre est aussi une réflexion sur l’évolution de la transmission des idées politiques et culturelles et sur une question dérangeante qui domine notre époque : pourquoi sommes-nous devenus dépendants du radicalisme et jusqu’où peut-il nous mener ? »
Parution le 18 janvier 2024

Simone Attilio Bellezza, Identità ucraina. Storia del movimento nazionale dal 1800 a oggi, Laterza
« L’Ukraine a longtemps été une “simple expression géographique” sur la carte de l’Europe, un territoire disputé entre des empires puissants et concurrents.
Pourtant, depuis le XIXe siècle, une conscience nationale s’est développée qui, après 1989, a donné un sens et une identité à l’État nouvellement indépendant. Ce livre reconstruit son histoire et montre comment ce processus influence le conflit actuel avec la Russie. »
Parution le 12 janvier 2024
L’article 20 livres à lire en janvier 2024 est apparu en premier sur Le Grand Continent.
