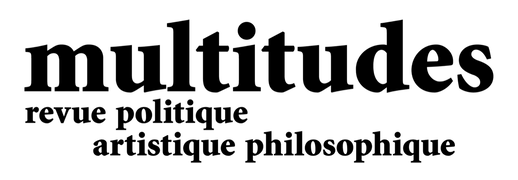09.06.2025 à 17:31
Perspective historique sur la dette écologique
Perspective historique sur la dette écologique
Ce texte bref apporte une perspective historique sur la dette écologique, que les nations colonisatrices dites « développées » ont accumulée (sans jamais l’avoir jamais formellement contractée) envers leurs environnements, ainsi qu’envers les populations du « Tiers-Monde ». Cette perspective est d’autant plus intéressante que ce texte originellement rédigé en 2002 reste dramatiquement actuel vingt-trois ans plus tard, attestant l’immobilisme tragique qui a caractérisé des décennies pourtant souvent perçues comme emportées dans une « accélération » ingérable.
A Historical Perspective on Ecological Debt
This brief text provides a historical perspective on the ecological debt that so-called “developed” colonizing nations have accumulated (without ever having formally contracted it) towards their environments, as well as towards the populations of the “Third World”. This perspective is all the more interesting given that this text, originally written in 2002, remains dramatically topical twenty-three years later, attesting to the tragic immobility that has characterized decades that are often perceived as having been swept along by an unmanageable “acceleration”.
L’article Perspective historique sur la dette écologique est apparu en premier sur multitudes.
Texte intégral (1464 mots)
Ce texte a été rédigé par l’auteur en 2002, mais il nous semble poser un cadre qui reste plus pertinent que jamais, en particulier avec le recul de la non-prise en compte de son argument central au cours des deux dernières décennies. Nous le republions donc avec l’accord de l’auteur.
La dette écologique du Nord envers le Sud est de beaucoup supérieure à la dette extérieure financière du Sud envers le Nord. Ce fait est cependant difficilement quantifiable car cette dette écologique – qui s’ajoute aux dettes historiques dues aux siècles de colonisation et d’exploitation – résiste au calcul en valeur monétaire. Comment estimer en numéraire les catastrophes démographiques induites par les invasions européennes en Amérique et en Océanie ? Les guerres contre les peuples autochtones ? Les « génocides » culturels ? Le travail forcé et le travail des esclaves ? Le pillage des ressources naturelles depuis le XVIe siècle ?
De nos jours, ce pillage continue et la dette écologique du Nord envers le Sud s’accroît. Les États-Unis, comme bien d’autres pays au centre du système capitaliste, pratiquent encore aujourd’hui la politique du Lebensraum1 : ils agissent comme s’ils étaient propriétaires du milieu naturel et des ressources naturelles des autres. Etant donné que le Fonds monétaire international (FMI) et la Banque mondiale ne s’expriment qu’en termes monétaires quand ils exigent le remboursement de la dette extérieure, il convient de leur répondre dans ces mêmes termes pour ce qui concerne la dette écologique.
Certains aspects de la dette écologique sont traduisibles en termes chrématistiques, par exemple les dommages environnementaux et sociaux causés par les exportations : les contaminations dues aux extractions minières et pétrolières que subissent les populations locales ne sont dédommagées par personne. Autre exemple : le Nord est redevable pour ses actes de « biopiraterie », c’est-à-dire l’utilisation, sans rémunération, des connaissances sur les plantes médicinales ou certaines semences agricoles. Dernier exemple : les exportations de déchets dangereux et l’utilisation gratuite des océans, des sols, de la végétation et de l’atmosphère pour y déposer le dioxyde de carbone produit par la combustion du carbone, des gaz et du pétrole, contribuent à cette dette.
Les discussions sur la dette écologique due au Sud par le Nord ont commencé vers 1990. À l’époque, l’Institut d’écologie politique du Chili a publié un document expliquant que la production de CFC2 des pays riches diminuait la couche d’ozone, filtre des radiations solaires, que cela provoquerait des cancers de la peau chez les humains et d’autres affections chez les animaux et que c’était donc une « dette écologique ». Peu après, en juin 1992, au cours des réunions alternatives de Rio de Janeiro, des groupes d’écologistes approuvèrent un « document de référence » où le thème de la dette extérieure (due par les pays du Sud aux créanciers du Nord) était lié à celui de la dette écologique, dette dont les débiteurs sont les citoyens et les entreprises des pays riches, et les créditeurs les habitants des pays appauvris. On y parlait déjà des flux commerciaux Sud-Nord de matières premières et énergétiques sous-payées, thème déjà relativement connu en Amérique latine, de par le nombre d’expériences historiques et grâce aux écrits comme celui d’Eduardo Galeano, Les veines ouvertes de l’Amérique latine. On y parlait également de l’utilisation disproportionnée de l’environnement – par les pays riches – pour stocker les gaz à effet de serre.
En 1994, J. M. Borrero, de Cali (Colombie), publiait un livre sur la dette écologique, écrit à partir de questions posées à des écologistes du monde entier. En 1997, nous avons participé à un séminaire sur ce sujet, organisé à Quito par Aurora Donoso de l’association équatorienne Acción Ecológica. Depuis lors, le débat s’est amplifié, notamment à partir de l’an 2000 où quelques militants (Andrew Simms à Londres, Beverly Keene à Buenos Aires etc.) – des campagnes Jubilée 2000 et Jubilée Sud contre la dette extérieure qui opprime tant de pays appauvris – ont défendu vigoureusement la revendication de la dette écologique, largement supérieure à la dette extérieure.
La fédération internationale des Amis de la Terre qui mène une campagne au sujet de la dette écologique due au Sud par le Nord a tenu une grande réunion, fin 2001, au Bénin, avec la participation de groupes africains. La campagne s’est poursuivie, notamment à Johannesburg, en août 2002, où le thème de la dette écologique fut abordé principalement par la société civile. L’idée de la dette écologique a également été reprise en Asie : en Indonésie en raison de la destruction des forêts et les dommages causés par des entreprises minières comme Freeport MacMoran, ou encore en Inde, notamment en relation avec les plaintes contre Union Carbide, la multinationale responsable de la catastrophe de 1984 à Bhopal. La CONACAMI3 (coordination des communautés affectées par les industries minières) du Pérou insiste sur les passifs environnementaux (« pasivos ambientales ») des entreprises minières, expression synonyme de dette écologique.
Ce bref historique des campagnes liées à la dette écologique n’a pas pour intention d’établir des priorités académiques, mais d’aider le lecteur à comprendre les divers aspects de la dette écologique.
1L’expression Lebensraum (« espace vital » en allemand) a été forgée par le géographe allemand Friedrich Ratzel puis repris et adapté par des géopoliticiens de la première moitié du XXe siècle. Adolf Hitler utilisait cette expression pour justifier la nécessité pour le IIIe Reich de conquérir de nouveaux territoires afin de s’approprier les ressources naturelles indispensables au bien-être du peuple allemand.
2Chlorofluorocarbone : Composé chimique constitué de carbone, de fluor et de chlore. Les chlorofluorocarbones (CFC) ont été utilisés dans les aérosols comme agents propulseurs, dans les réfrigérateurs et les climatiseurs comme frigorigènes, ainsi que dans les mousses et les matières isolantes.
L’article Perspective historique sur la dette écologique est apparu en premier sur multitudes.