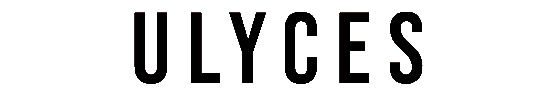29.01.2021 à 00:01
Le monde sera-t-il sauvé par des adolescents ?
Les résultats sont éloquents. D’après un sondage mené auprès d’1,2 million de personnes dans 50 pays par le Programme des Nations unies pour le développement et l’université d’Oxford, les jeunes sont de loin la population la plus convaincue que le monde fait aujourd’hui face à une « urgence climatique ». C’est notamment le cas de […]
L’article Le monde sera-t-il sauvé par des adolescents ? est apparu en premier sur Ulyces.
Texte intégral (4502 mots)
Les résultats sont éloquents. D’après un sondage mené auprès d’1,2 million de personnes dans 50 pays par le Programme des Nations unies pour le développement et l’université d’Oxford, les jeunes sont de loin la population la plus convaincue que le monde fait aujourd’hui face à une « urgence climatique ». C’est notamment le cas de 83 % des jeunes Canadiens et Allemands, 82 % des Australiens, 81 % des Japonais, 77 % des Français et 75 % des Américains. C’est aussi aux jeunes qu’il appartiendra de sauver le monde.
Climate Fridays
C’est une fille seule au milieu de l’eau. Avec son visage rond et ses nattes, Greta Thunberg semble un peu perdue devant l’imposante façade baroque du parlement suédois, sur l’île de Helgeandsholmen, dans le centre de Stockholm. Ce matin d’août 2018, elle s’est levée comme d’habitude, a pris son petit-déjeuner, quelques prospectus, et s’est postée à l’entrée du Riksdag, copiant l’action des étudiants de Parkland contre les armes à feu aux États-Unis. L’adolescente fait le siège d’un dérèglement climatique meurtrier. Depuis qu’un instituteur lui a montré des photos de monceaux de plastique dans l’océan et d’ours polaires cacochymes, elle ne le supporte pas.
« Et puis quelques médias ont commencé à parler de moi », raconte-t-elle. « Le deuxième jour, des gens m’ont rejoint. Depuis, je ne suis presque plus jamais seule. » La Suédoise de 16 ans raconte son histoire dans un documentaire qui sort ce 23 mai 2019, à l’occasion d’un nouveau jour de grève mondiale en faveur du climat. La mobilisation a lieu à 1594 endroits dans 118 pays, annonçait-elle hier sur Twitter. En mars, le dernier « vendredi pour le futur » avait rassemblé 1,6 million de personnes dans 125 pays. L’affluence monte irrémédiablement, comme le niveau des océans. Pour faire barrage, les jeunes sont au premier rang.
« Depuis maintenant plusieurs mois », écrit un communiqué partagé en amont des manifestations du 24 mai, et signé par 77 organisations, « la jeunesse, consciente des dangers qu’elle encourt pour son avenir, se mobilise massivement partout dans le monde : Youth For Climate et Fridays For Future à l’international sont devenus le symbole du passage à l’action d’une génération déjà pleinement consciente des changements à effectuer dans notre modèle sociétal. » En France, des rassemblements doivent avoir lieu place de l’Opéra à Paris, à 13 heures, et dans des dizaines d’autres villes.

À Davos, en janvier, Greta Thunberg s’inquiétait que « les adultes n’arrêtent pas de dire qu’ils nous sont redevables de leur donner de l’espoir. Mais je ne veux pas de votre espoir. Je ne veux pas que vous voyez plein d’espoir, je veux que vous paniquiez. J’aimerais que vous ressentiez la peur que je ressens chaque jour. Et ensuite je veux que vous agissiez. » Car, s’il fallait encore le dire, la situation est particulièrement critique. Les 11 et 12 mai derniers, le température a atteint un pic extraordinaire de 29°C à l’entrée de l’océan Arctique, au nord-ouest de la Russie. Ce week-end-là, l’observatoire de Mauna Loa en Floride relevait une concentration de dioxyde de carbone dans l’atmosphère de 415 parties par million, soit le plus haut niveau sur 800 000 ans, voire sur trois millions d’années.
« Si nous continuons comme ça, en 2030 nous entraînerons une réaction en chaîne irréversible dont les événements échapperont à tout contrôle », prévient Greta Thunberg. « Ce sera sans retour. » Mise en couverture par le magazine Time la semaine dernière, la Suédoise entend maintenant « parler au monde » au nom de sa génération. Elle réclame le respect de l’Accord sur le climat de Paris et la proclamation d’un état d’urgence climatique. Sa voix porte d’autant plus qu’elle trouve un écho impressionnant chez les jeunes qui l’accompagnent.
De Johannesburg à Séoul en passant par Londres et New Delhi, la planète est tenue à bout de bras par des enfants et des adolescents. Sur leurs pancartes, à l’occasion de la grève du 15 mars, le globe bleu était accompagné d’une phrase digne d’un film de super-héros : « Sauvez le monde. » Fait-on slogan plus fédérateur ? Face à une pollution en forme de tache d’huile, contre laquelle l’innocuité des dirigeants apparaît chaque jour davantage, le mouvement gagne du terrain. C’est un moindre mal pour Greta Thunberg.
La Suédoise de 16 ans était revenue déprimée de la conférence pour le climat qui s’est tenue fin novembre en Pologne. « J’ai réalisé à quel point les gens dont dépend notre futur ne semblent pas prendre la question au sérieux », soufflait-elle. Alors des jeunes gens qui partagent son inquiétude l’ont rejoint. « Make the world Greta again », scandent-ils aujourd’hui pour contrer le négationnisme climatique de Donald Trump. Le président américain rêve de recevoir le prix Nobel de la paix mais c’est bien Greta Thunberg qui a été proposée sur une liste portant 304 noms. Les adultes sont-ils prêts à entendre le cri d’alarme de sa génération ?
L’île aux oiseaux
Derrière des torrents de houle, la silhouette d’un volcan se découpe au milieu de la brume. Après 18 jours de navigation au départ de Cape Town, à l’extrême sud-est de l’Afrique, l’archipel de Tristan da Cunha montre sa roche noire tapissée d’herbe verte. Autour des sommets culminant à 2 000 mètres de hauteur, des colonies de volatiles orbitent à l’infini, toisant les petites maisons rouge et vert déposées sur le bord comme des galets par la marée. Habitée depuis 1811, cette possession britannique qui a la réputation d’être l’île la plus reculée du monde compte aujourd’hui 260 résidents. Réfugiés en Angleterre lors de l’éruption de 1961, ils sont revenus deux ans plus tard pour planter des pommes de terre et élever des vaches, des moutons, des canards et des poulets.

L’archipel de Tristan da Cunha
Leurs jardins proprets semblent s’être détachés du Kent pour dériver dans l’Atlantique et se confondre avec le monde sauvage. Par bonheur, l’homme s’est intégré à ce rocher sans le souiller par ses usines et ses autoroutes. Mais cela a suffi pour tout bousculer. Depuis son arrivée, trois espèces d’oiseaux ont disparu : la gallinule de Tristan (Gallinula nesiotis), l’albatros de Tristan (Diomedea dabbenena) et le nésospize de Tristan (Nesospiza acunhae acunhae). « Nous estimons que ces trois espèces se sont éteintes entre 1869 et 1880 après une période de dégradation de leur environnement et de surexploitation humaine [des ressources], seul l’albatros avait une chance de survie lorsqu’en 1882 les rats noirs sont arrivés, et ont finalement entraîné l’extinction des trois espèces », notent les chercheurs Alexander L. Bond, Kevin R. Burgio et Colin J. Carlson dans un article publié par le Journal of Ornithology en janvier 2019.
Cette « petite équipe informelle », dixit Carlson, développe aussi spatExtinct, un programme permettant d’évaluer les dates d’extinctions à venir espèce par espèce. Elle s’intéresse notamment à des animaux méconnus. « Alors que les chercheurs se sont concentrés sur des extinctions fameuses comme celle du dodo, ou sur des régions très étudiées comme l’Amérique du Nord et Hawaï, les travaux sur les extinctions dans les îles sont moins nombreux », observent-ils. Or, indistinctement, la disparition des animaux les moins visibles met en danger ceux qui prennent le plus de place. Au cours de précédents travaux, Colin J. Carlson soulignait que l’ensemble de la chaîne alimentaire allait être affectée par la disparition d’un tiers des parasites dans le siècle à venir.
Aujourd’hui, il se sert de Twitter pour alerter. « Au moins 7 % des invertébrés sont probablement déjà éteints, ce qui est sans doute suffisant pour que la biosphère s’effondre », indiquait-il le 6 février 2019. La veille, le chercheur partageait des memes et des vidéos de danse depuis son compte, illustré par la photo d’un jeune homme glabre aux cheveux roux et aux lunettes rectangulaires. C’est bien lui. Colin J. Carlson est un scientifique un peu spécial. À 23 ans, cela fait plus d’une décennie qu’il cherche des solutions pour la planète. Diplômé de Stanford à 11 ans, le garçon du Connecticut a fait l’objet d’un portrait du New York Times quand il en avait 12 et, l’année suivante, il a attaqué son université en justice pour infléchir son refus de l’envoyer en travaux pratiques en Afrique du Sud.

Colin J. Carlson
En 2018, une blague du biologiste a été retweetée plus de 33 000 fois : « Vous n’êtes jamais vraiment seul le jour de la Saint-Valentin quand vous pensez à tous ces micro-organismes qui cohabitent avec vous à travers vos vaisseaux sanguins », plaisantait-il. En génie précoce, Colin J. Carlson s’est longtemps senti isolé, ou du moins en décalage. C’est désormais un exemple pour une génération d’enfants préoccupés par l’environnement. En novembre, des bataillons d’adolescents ont occupé le bureau de la nouvelle présidente de la chambre des représentants, la Démocrate Nancy Pelosi, afin de l’enjoindre à prendre des mesures en faveur de la planète. « Quel est votre plan ? » demandaient-ils à l’aide de pancartes orange, avec le soutien de la plus jeune femme élue députée, Alexandria Ocasio-Cortez, 29 ans.
« Nous cherchons à constituer une armée de jeunes gens pour faire du changement climatique une priorité politique », explique un des organisateurs, membre du 200 Sunrise Movement, Garrett Blad, 25 ans. « Nous voulons dénoncer l’industrie pétrolière et ses lobbyistes, et élire une nouvelle génération de décideurs qui défendra l’intérêt général, pas seulement une poignée de riches. » Le défi est grand. En janvier 2019, un tribunal du Colarado a débouté la demande d’associations visant à suspendre la fracturation hydraulique menée par les compagnies pétrolières dans la région. L’un des plaignants, Xiuhtezcatl Martinez, s’est fait connaître en pressant les Nations Unies (ONU) de protéger sa génération en péril en 2015, alors qu’il n’avait que 15 ans.
En décembre, la Suédoise Greta Thunberg, âgée de seulement 16 ans, a alerté contre une « menace existentielle » lors du sommet de l’ONU sur les changements climatiques (COP24). « Les jeunes comprennent les enjeux environnementaux », assure Garrett Blad. « Même ceux qui sont en sixième. Récemment, un professeur a demandé à ses élèves à quoi ressemblait le changement climatique. “Les ouragans Irma, Maria ou les incendies du sud de la Californie”, ont-ils répondu. » Colin J. Carlson n’a même pas attendu d’être au collège pour se préoccuper du problème.
Colin, 11 ans
Depuis Washington, où il vit aujourd’hui, Colin J. Carlson mesure le chemin parcouru. Pendant que les jeunes de son âge visaient le bac, il a tour à tour étudié les arts, l’environnement, l’écologie, l’évolution biologique, la philosophie, la politique et le management. Ce parcours l’a conduit à faire un stage à l’Agence nationale de protection de l’environnement et à donner des cours de biologie. À présent doctorant à l’université de Georgetown, il retourne régulièrement voir sa mère, dans le Connecticut. « J’ai grandi dans un village à la campagne où le changement climatique était un sujet très tabou », raconte-t-il. « Et je pense que ça l’est toujours. C’est d’ailleurs l’une des choses qui m’ont poussé à conduire ce genre de recherches. » Et ses capacités intellectuelles hors du commun ont aidé.
Né un 31 juillet comme Harry Potter, Colin J. Carlson sait articuler des phrases entières à un an et demi. Lorsque son père se suicide, alors qu’il a deux ans, sa mère ne le suspecte pourtant pas encore d’être en avance. « Je me rendais compte de ce qu’il faisait mais pas qu’aucun autre enfant n’en était capable », se souvient la psychologue. Lecteur de l’hebdomadaire Newsweek à 4 ans, son fils finit par faire un test qui révèle un score de QI de 145, quand la moyenne tourne autour de 100. L’homme qui l’a mis au monde avant de disparaître prématurément était lui aussi quelqu’un de brillant. Torturé par ce que les autres pensaient de lui, Cory Carlson est tombé en dépression. Colin a dû composer sans lui et sans beaucoup d’amis, tant sa différence le classait à part.
« À six ans, j’ai dessiné une carte pour mon institutrice », se remémore le jeune homme. « Je lui ai demandé de me donner des choses plus compliquées à faire mais elle a refusé de peur que j’aie ensuite encore envie de faire autre chose. » Alors il quitte l’établissement privé et se met à suivre des cours en ligne. Avant neuf ans, le jeune homme apprend le français, l’histoire européenne et la physique environnementale grâce à l’université du Connecticut, Uconn. Cela lui permet de remporter un concours organisé par le magazine National Geographic, dont le prix est un séjour aux îles Galápagos, un archipel équatorien situé dans le Pacifique.
« Si vous demandiez à un enfant de 13 ans s’il voulait jouer avec moi, la réponse était non »
« Je m’attendais à voir beaucoup de pingouins mais il n’y en avait que cinq », souffle-t-il. « J’ai appris que le nombre se réduisait à cause de la fréquence croissante du phénomène climatique El Niño, dont le changement climatique est responsable. » De retour chez lui, Colin J. Carlson s’inscrit à des cours de biologie et dévore le documentaire d’Al Gore, Une Vérité qui dérange. Sur ces entrefaites, il crée le Cool Coventry Club, une association vouée à sensibiliser aux conséquences de la pollution. En un an, elle initie 50 événements et touche 2 000 personnes, vante-t-il.
Aux sceptiques, le garçon tente calmement d’exposer la situation. « Il ne faut pas dire à ceux qui sont impossibles à convaincre qu’ils se trompent », philosophe-t-il. « J’essaye donc de trouver un terrain d’entente, en partant du fait que tout le monde veut économiser de l’énergie et de l’argent, par exemple. » Après avoir décroché un diplôme de Stanford par correspondance, le militant en herbe est invité à plaider la cause de la planète devant les élus de son État.
Colin J. Carlson a emmagasiné suffisamment de confiance en lui pour vouloir fréquenter les amphithéâtres où les problèmes sont abordés avec un certain détail. Il écrit donc une lettre à la fac. « J’ai 11 ans et j’en aurai 12 d’ici mon inscription », présente-t-il. « Ne prenez pas peur, en vérité je suis quelqu’un de très mature. » Recalé par plusieurs institutions, il est finalement accepté à Uconn, où certaines salles de classe lui demeurent toutefois inaccessibles, de même que les dortoirs. Il lui faut donc faire la navette entre la maison et le campus. À 13 ans, ne pouvant prendre part à un cours prévoyant un voyage en Afrique du Sud, il traîne l’université en justice, attirant ainsi l’attention de la presse.

Crédits : SESYNC
Les États-Unis apprennent alors à apprécier ce bourreau de travail, féru de piano et de randonnée, qui écrit des scénarios ou observe les oiseaux en dehors des cours. « Je suis irritable quand je ne travaille pas », souffle-t-il. Contrairement à la plupart des adolescents, il joue plus volontiers aux échecs qu’aux jeux vidéo et préfère la musique classique que les tubes de la radio. « Si vous demandiez à un enfant de 13 ans s’il voulait jouer avec moi, la réponse était évidemment non », remet-il. Colin J. Carlson est déjà dans la cour des grands.
Les gouvernements en procès
Tout génie qu’il est, Colin J. Carlson a encore besoin d’une calculatrice pour les opérations compliquées, et de sa mère pour l’acheter. En arrivant au centre commercial, en ce début d’année scolaire 2012, un étudiant qui passe là l’interpelle. « Hey Colin, on m’a dit que tu étais un aimant à filles », sourit-il. Le jeune homme s’est bien fait des amies mais la remarque paraît trop intéressée pour le flatter. Il dit de toute manière ne pas trop se soucier du regard des autres : « Je ne cherche ni à devenir célèbre ni à rester en retrait, je veux continuer à faire ce que je fais sans que tout le monde soit en train de m’épier. Et pour le moment, j’aimerais que personne ne se mette sur mon chemin. » Derrière cet esprit brillant se cache une volonté de fer. Des qualités qui ont poussé Business Insider à le citer parmi les 16 enfants les plus intelligents de leur génération aux côtés de Mozart, Picasso et le champion d’échecs Bobby Fischer en 2011.
Cette année-là, après avoir vu le documentaire d’Al Gore, Une Vérité qui dérange, une avocate de l’Oregon enceinte de sept mois entreprend de plaider en faveur de la planète. Julia Olson en discute alors avec une collègue qui dirige le programme juridique de l’environnement et des ressources à l’université, Mary Christina Wood. Par sa bouche, elle apprend que le militant philippin Antonio Oposa a attaqué l’État au nom de 43 enfants pour lutter contre la déforestation et la pollution de la baie de Manille. Les générations qui arrivent en seront les principales victimes, a-t-il dénoncé au début des années 1990, obtenant finalement gain de cause de la part de la Cour suprême. « Ce cas a inspiré beaucoup de juristes dans le monde », avance le directeur du Center for International Environmental Law (CIEL), Daniel Magraw. « Il était concentré sur un territoire local mais a entraîné une théorie en droit international. »

Alec Loorz
Julia Olson décide de décalquer ce types d’actions aux États-Unis en fondant l’association Our Children’s Trust. Le spécialiste du climat James Hansen, de la NASA, lui présente un adolescent prêt à ferrailler devant les tribunaux. Lui aussi frappé par le documentaire d’Al Gore, Alec Loorz s’est engagé dès 12 ans. Avec son organisation Kids vs. Global Warming comme plateforme, il a donné près de 200 conférences dans des écoles du monde entier. À l’en croire, les enfants sont bien plus inquiets de la pollution que ce que peuvent penser leurs parents. « Le fait de devenir grand-père m’a poussé à manifester », explique d’ailleurs James Hansen, qui assure à Alec Loorz que le pire peut encore être évité. « Beaucoup de jeunes réalisent qu’il est urgent d’agir et que nous n’allons pas résoudre le problème simplement en préférant le vélo à la voiture », juge le jeune homme d’aujourd’hui 18 ans.
« Aujourd’hui, c’est l’existence même de ma génération qui est en jeu », abonde un jeune homme dont les longs cheveux bruns tombent sur un costume marine. Ce 29 juin 2018, Xiuhtezcatl Martinez s’adresse d’abord aux Nations Unies dans la langue du peuple nahuatl, dont vient son prénom, puis en anglais. Il n’a que 15 ans mais est déjà parfaitement à l’aise. « C’est vrai qu’il y a peu de gens de cet âge qui discourent devant l’ONU », reconnaît-il. « Mais je parle en public depuis que j’ai six ans dont je ne suis plus vraiment stressé. Par rapport à d’autres discours que j’ai donnés, celui-là était très stérile. Tout ces gens en costume-cravate jouaient sur leur téléphone. Personne n’était intéressé. » Baptisé à l’âge de six ans selon l’alignement des étoiles, Xiuhtezcatl Martinez dit venir d’un peuple qui fait de la conservation de la planète sa mission. « Enfant, je cherchais les grenouilles et les serpents avec mon père, ça m’a fait me sentir important dans le monde », explique-t-il.
Deux mois plus tard, avec 20 autres jeunes gens, âgés de 8 à 19 ans, il porte plainte contre l’État. Ce procès « Juliana v. United States » lancé dans l’Oregon doit permettre de démontrer que le gouvernement, par ses actions responsables du dérèglement climatique, viole les droits constitutionnels des jeunes générations à la vie, à la liberté et à la propriété, et qu’il manque à son devoir de protéger les ressources publiques essentielles. « Nous ne demandons pas d’argent », précise la plaignante qui donne son nom au cas, Kelsey Juliana, « mais nous voulons que le tribunal ordonne au gouvernement de développer et de mettre en place un plan national de protection du climat basé sur les meilleurs ressources scientifiques. » C’est là que les travaux actuellement menés par Colin J. Carlson ont leur importance.

Xiuhtezcatl Martinez
Crédits : Earth Island Institute
« Le changement climatique va presque certainement entraîner des millions de mort », regrette-t-il. Dans un article publié fin 2018 par la revue Nature Climate Change, le jeune chercheur étudie les promesses de la géo-ingénierie pour corriger les désordres de la pollution en manipulant le climat. La gestion du rayonnement solaire propose par exemple d’injecter des particules d’aérosols dans la stratosphère tandis que d’autres approches préconisent de trouver un moyen pour retirer le dioxyde de carbone de l’atmosphère.
Dans tous les cas, « il est trop tôt pour savoir si ces technologie peuvent sauver des vies », prévient-il. « À l’heure actuelle, nous savons que le climat et les maladies sont étroitement liées ce qui soulève de nombreuses questions à propos de la géo-ingénierie. » En d’autres termes, la manipulation de l’environnement présente le risque d’entraîner des maladies imprévues. En faisant tomber les températures aux tropiques, la gestion du rayonnement solaire pourrait notamment favoriser la propagation de la malaria.
Les recherches sur le sujet doivent donc être complétée. En attendant, Colin J. Carlson apporte tout son soutien à Kelsey Juliana, Xiuhtezcatl Martinez, Garrett Blad et Greta Thunberg.
Couverture : We The Future / Are Earth Guardians. (Obey)
L’article Le monde sera-t-il sauvé par des adolescents ? est apparu en premier sur Ulyces.
28.01.2021 à 00:00
Que se passe-t-il avec le sperme ?
Une nouvelle fois en ce début d’année 2021, des chercheurs sont arrivés à la conclusion que les mâles de notre espèce perdent progressivement leur capacité à se reproduire. D’après une étude de chercheurs américains rendue publique le 24 janvier, les phtalates et Bphénol A, présents dans les plastiques, les cosmétiques et les emballages alimentaires, seraient […]
L’article Que se passe-t-il avec le sperme ? est apparu en premier sur Ulyces.
Texte intégral (1995 mots)
Une nouvelle fois en ce début d’année 2021, des chercheurs sont arrivés à la conclusion que les mâles de notre espèce perdent progressivement leur capacité à se reproduire. D’après une étude de chercheurs américains rendue publique le 24 janvier, les phtalates et Bphénol A, présents dans les plastiques, les cosmétiques et les emballages alimentaires, seraient à l’origines de nombreux troubles : un nombre croissant de bébés nés avec des pénis plus petits, des taux plus élevés de dysfonctions érectiles, une baisse de la fertilité ou encore l’érosion des différences sexuelles chez certaines espèces animales. Une terrible découverte qui affirme une tendance initiée il y a plusieurs décennies.
L’étude des études
Le taux de spermatozoïdes des hommes nord-américains, européens, australiens et néo-zélandais a diminué de plus de 50 % entre 1973 et 2011. C’est le constat que fait une étude publiée en juillet dernier dans la Oxford University Press, par une équipe de chercheurs de l’université hébraïque de Jérusalem, qui a passé en revue plusieurs milliers de travaux réalisés dans une cinquantaine de pays. « Nous avons utilisé le type de méta-analyse spécifique à la fine pointe de la technologie – une méthode de “méta-régression” pour modéliser les tendances de la concentration de sperme et des spermatozoïdes de 1973 à 2011 », explique l’épidémiologiste Hagai Levine, principal auteur de l’étude.
Cette méthode a permis d’étudier les propriétés des semences de 42 935 hommes. Et si le déclin du taux de spermatozoïdes qu’elle met au jour se poursuit au même rythme dans les prochaines années, les hommes occidentaux auront tout simplement perdu l’intégralité de leurs capacités de reproduction d’ici 2060. D’autant que ce déclin s’est accéléré après l’année 1995. « Nos résultats reflètent un problème de santé publique majeur en termes de fertilité masculine, et de santé masculine en général », insiste Hagai Levine. « Des études récentes ont montré qu’un faible taux de spermatozoïdes est un signe prédictif d’un taux de mortalité, de morbidité et d’hospitalisations plus élevé », ajoute-t-il. « Il est cependant nécessaire de faire davantage de recherche pour comprendre l’utilité du taux de spermatozoïdes en tant que mesure de santé et du mécanisme que cela implique. » Shaun Roman, scientifique de l’université de Newcastle, estime néanmoins que « nous ne sommes pas encore dans une situation de crise » : « Nous devrions souligner le fait qu’il suffit d’un spermatozoïde pour fertiliser un ovule et, en moyenne, les hommes occidentaux en produisent encore 50 millions par éjaculation ». Orly Lacham-Kaplan, de l’Université catholique australienne, ne juge donc pas nécessaire d’inquiéter ses « gars ». Kelton Tremellen, de l’université Flinders, en Australie toujours, pense au contraire que les hommes devraient prendre les résultats de l’étude de l’université hébraïque de Jérusalem comme « un réveil pour adopter un mode de vie sain ». « Bien que nous n’ayons pas exploré les causes du déclin du taux de spermatozoïdes, nous savons que la fertilité masculine est affectée par l’environnement, au sens large, tout au long de la vie, et surtout pendant la période critique du développement du fœtus au début de la grossesse –probablement de la 8e à la 14e semaine », affirme Hagai Levine. « L’exposition aux produits chimiques ou au tabagisme maternel au cours de cette période a une incidence négative sur les résultats masculins chez les animaux et les humains. Puis les habitudes de vie tels que le manque d’activité physique et l’exposition aux produits chimiques tels que les pesticides contribuent à réduire le nombre de spermatozoïdes dans la vie adulte. »

Crédits : Ulyces.co
Quant à Christopher Barrat, professeur de médecine reproductive à l’université de Dundee, en Écosse, il rappelle que « la question de l’éventuel déclin du taux de spermatozoïdes est un vieux débat parmi les scientifiques ». En effet, ces derniers sont conscients de la baisse du taux de spermatozoïdes depuis 1992, mais les résultats de leurs recherches ont longtemps prêté à controverse. L’étude de l’université hébraïque de Jérusalem, elle, se distingue par la qualité de son analyse, selon Christopher Barrat. « Elle a été menée de manière systématique, en tenant compte des défauts relevés sur les précédentes recherches (la méthode utilisée pour compter les spermatozoïdes, par exemple) et en comparant des études pourtant distantes de plusieurs décennies. La plupart des experts s’accordent donc à dire que les données présentées sont d’une grande qualité et que leurs conclusions, bien qu’alarmantes, sont fiables. »
Du sperme artificiel
L’étude de l’université hébraïque de Jérusalem ne relève aucun déclin du taux de spermatozoïdes chez les hommes asiatiques, africains ou sud-américains. Mais comme le note Christopher Barrat, « les données en provenance de ces régions sont, il est vrai, peu nombreuses ». Pour lui aussi, l’explication la plus rationnelle au déclin du taux de spermatozoïdes chez les hommes occidentaux est à chercher du côté de l’environnement, mais il appelle à poursuivre les recherches sur ce sujet. « Des différences existent (…) en fonction des zones géographiques », souligne-t-il. « La détermination des facteurs – génétiques ? environnementaux ? – à l’origine de ces différences sera primordiale pour parvenir à un traitement susceptible de limiter les effets négatifs de la chute du taux de spermatozoïdes. »  Parmi les polluants incriminés par le professeur de médecine reproductive se trouve le bisphénol A, composant de plastiques et de résines par ailleurs suspecté de favoriser les maladies cardiovasculaires, l’obésité et l’hyperactivité.
Parmi les polluants incriminés par le professeur de médecine reproductive se trouve le bisphénol A, composant de plastiques et de résines par ailleurs suspecté de favoriser les maladies cardiovasculaires, l’obésité et l’hyperactivité.
En 2013, une équipe de chercheurs français de l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm) a maintenu des testicules fœtaux dans des boites de culture, en exposant certains à du bisphénol A. Il est alors apparu que ces testicules produisaient moins de testostérone que les autres, ce qui a conduit les chercheurs à penser que le bisphénol A pourrait être au moins en partie responsable de la chute de la production spermatique, ainsi que de l’augmentation de l’incidence des défauts congénitaux de masculinisation et du cancer testiculaire observées au cours des dernières décennies. Mais Christopher Barrat recommande également de ne pas fumer de cigarettes, lesquelles ne contiennent pas moins de 4 000 substances potentiellement toxiques pour les spermatozoïdes, dont la cotinine, le cadmium, la nicotine, ou encore les hydrocarbures polyaromatiques. Les spermatozoïdes des fumeurs vont moins vite, sont moins nombreux dans un volume donné, et ont une forme atypique qui leur rend difficile l’accès à l’ovule. C’est ce que montre une étude menée en 2016 par une équipe de chercheurs internationale qui a recensé l’ensemble des publications scientifiques portant sur le lien entre tabac et qualité du sperme pour en sélectionner 20, incluant près de 6 000 participants. Seules deux d’entre elles suggèrent que l’arrêt du tabac est associé à une amélioration de la qualité du sperme…
« D’une manière générale, conserver un mode de vie sain a son importance », affirme Christopher Barrat. La relation entre surpoids et réduction du taux de spermatozoïdes a par exemple été démontrée par une étude conduite en 2010 par des chercheurs français sur 1 940 personnes. Selon cette étude, plus le surpoids est important, plus la qualité du sperme diminue, particulièrement en ce qui concerne la concentration et le nombre total de spermatozoïdes. La concentration en spermatozoïdes baisse de 10 % pour les patients en surpoids par rapport à ceux de poids normal, et de 20 % pour les obèses, chez qui la mobilité des spermatozoïdes baisse de 10 %. Le nombre total de spermatozoïdes, de 184 à 194 millions par millilitre (M/ml) chez les gens de poids normal, baisse à 164-186 M/ml chez ceux en surpoids, et à 135-157 M/ml chez les obèses. Et si tabac et junk food vous semblent indispensables, vous aurez peut-être bientôt la possibilité de vous procurer un sperme humain de qualité artificiel. Après tout, il existe déjà du sperme de souris de qualité artificiel. Ce sont des chercheurs chinois de l’université médicale de Nanjing qui sont parvenus à le créer à partir de cellules souches, dans le cadre d’une étude publiée dans la revue Cell Stem Cell datée de janvier 2016. Une technologie qui pourrait aider les scientifiques à étudier plus directement le développement des spermatozoïdes chez les mammifères et renforcer les efforts dans la mise au point de traitements de l’infertilité masculine chez les humains. D’autant que ce sperme artificiel a permis d’engendrer des souriceaux sains.
Couverture : Le sperme triste. (Ulyces.co)
L’article Que se passe-t-il avec le sperme ? est apparu en premier sur Ulyces.
25.01.2021 à 00:13
Poutine va-t-il diriger la Russie pour l’éternité ?
Plus de 85 millions de paires d’yeux sont rivées sur un somptueux palais construit sur les bords de la mer Noire. La magnifique demeure de près de 18 000 m², aux faux airs de Versailles, serait officieusement la propriété de Vladimir Poutine, dénonce une vidéo publiée le 19 janvier 2021 sur la chaîne YouTube d’Alexeï […]
L’article Poutine va-t-il diriger la Russie pour l’éternité ? est apparu en premier sur Ulyces.
Texte intégral (2871 mots)
Plus de 85 millions de paires d’yeux sont rivées sur un somptueux palais construit sur les bords de la mer Noire. La magnifique demeure de près de 18 000 m², aux faux airs de Versailles, serait officieusement la propriété de Vladimir Poutine, dénonce une vidéo publiée le 19 janvier 2021 sur la chaîne YouTube d’Alexeï Navalny, le plus véhément opposant à l’actuel gouvernement de la Fédération de Russie.
L’enquête prétend démasquer un vaste système de corruption organisé autour du président russe pour la construction de ce projet, qui se chiffre à plus d’un milliard d’euros. Une « bombe » qui menace de faire vaciller le trône sur lequel Vladimir Poutine compte rester assis encore de longues années.
Le coup d’État incolore
Sous l’aigle à deux têtes des armoiries russes, Vladimir Poutine dépose une chemise jaune au pupitre de la Douma. Après avoir enchaîné les poignées de main à la tribune, devant un Parlement levé comme un seul homme, il lui fait face. Ses cheveux taupes, qui ne tirent que légèrement vers le gris, semblent avoir arrêté de tomber depuis quelques années. Le président n’a guère vieilli. Et il est peut-être là pour un moment. Ce 10 mars 2020, l’ancien membre des services secrets est venu donner sa vision de la révision constitutionnelle qu’il a impulsée en janvier. « Les Russes doivent avoir une alternative dans n’importe quelle élection », plaide-t-il, avant d’ajouter que « la stabilité est peut-être plus importante et doit être prioritaire ».
Après son intervention, les députés russes votent un amendement constitutionnel pour remettre ses compteurs à zéro. Le nombre de mandats présidentiels sera bien limité à deux, qu’ils soient successifs ou non, là où ils sont actuellement plafonnés à deux d’affilée. Mais les quatre règnes de Poutine, entre 2000 et 2008 puis de 2012 à aujourd’hui, ne compteront plus. En clair, il pourra se représenter en 2024. Cet amendement voté par 380 parlementaires et repoussé par les 44 communistes a été voté définitivement le 22 avril dernier. Poutine pourra ainsi continuer à gouverner la Russie jusqu’en 2036.
•
Le dernier écho d’un orchestre résonne contre les dorures de la salle Andreïevski, au Kremlin. Une voix grave s’élève alors d’un homme mince au visage anodin, presque effacé. Il jure sa fidélité à la constitution, la main posée sur le texte de 1993. Au-dessus de son crâne, l’aigle à deux têtes des armoiries nationales plane au milieu d’un rideau bleu roi. Ce 7 mai 2000, devant une salle levée comme un seul homme, Vladimir Poutine devient président de la fédération de Russie.
Vingt ans plus tard, sous le même aigle à deux têtes et devant une salle plus droite encore, l’ancien membre des services secrets s’engage à revisiter une loi fondamentale qui n’a guère bougé depuis lors. Devant les parlementaires, ce mercredi 15 janvier 2020, il commence par promettre l’extension de l’allocation maternité aux famille n’ayant qu’un enfant, alors qu’il fallait jusqu’ici en avoir deux pour en bénéficier. Puis, ayant écarté la perspective d’une nouvelle constitution, Poutine fait part de son désir de l’amender.
Aussitôt, un vaste pan de la presse internationale s’en prend à une réforme qui « pourrait le maintenir au pouvoir » selon Reuters, est « conçue pour perpétuer son pouvoir », écrit l’universitaire britannique Richard Sakwa dans The Conversation, ou « ouvre la voie à son règne indéfini », à en croire le Financial Times. Pour le Guardian, il ne fait aucun doute que Poutine « prévoit de rester au pouvoir après 2024 », qui marquera la fin de son deuxième et dernier mandat consécutif autorisé par la constitution. N’a-t-il pas déjà contourné cette règle en cédant la place à un affidé, Dmitri Medvedev entre 2008 et 2012, pour mieux revenir à la présidence ensuite ?
Cette fois, explique une tribune du New York Times, « le leader russe manœuvre pour rester au pouvoir indéfiniment ». Certes prévoit-il de limiter le nombre de mandats présidentiels à deux, qu’ils soient successifs ou non, ce qui empêcherait tout retour. Mais voilà, il « n’a pas besoin d’être Président pour rester au sommet », ajoute le Washington Post. Le principe de la réforme est d’ailleurs approuvé par l’intégralité des 432 membres de la Douma (chambre basse) jeudi 23 janvier, et Dmitri Medvedev a été sèchement congédié, le poste de Premier ministre revenant au discret Mikhaïl Michoustine.

Crédits : Kremlin
« C’était un homme usé, accusé d’enrichissements douteux et dont la cote de popularité était mauvaise », observe Jean Radvaniy, professeur émérite à l’Institut national des langues et civilisations orientales (Inalco) spécialisé dans la géopolitique russe. Le vice-Premier ministre Vitali Moutko, le ministre de la Culture Vladimir Medinski et la ministre de l’Éducation Olga Vassilieva payent aussi leur impopularité. En revanche, des piliers du régime comme Sergueï Lavrov (Affaires étrangères), Sergueï Choïgou (Défense) et Vladimir Kolokoltsev (Intérieur) restent.
En phase avec les titres anglo-saxons suscités, l’opposant Leonid Volkov, chef de cabinet d’Alexei Navalny, estime qu’il « est clair pour tout le monde que tout est fait pour remettre le pouvoir à Poutine à vie ». Le chef du Parti du changement, à la Douma de 2011 à 2016, Dmitri Goudkov, en parlent même comme d’un « coup d’État constitutionnel ». Seulement rien, dans les plans affichés par Poutine le 15 janvier 2020, ne ressemble à une manœuvre pour se maintenir au pouvoir.
Le président russe souhaite réviser la constitution afin de graver la suprématie de la loi russe sur le droit international dans le marbre, donner au Parlement le prérogative de nommer les membres du gouvernement, soumettre la nomination des chefs des agences de sécurité à une consultation du Conseil de la fédération et donc limiter le nombre de mandats présidentiels à deux au lieu de deux consécutifs. « Des commentateurs pensent qu’ils veut garder le pouvoir pour lui, en fait on n’en sait rien », tique Jean Radvaniy. « Il n’est pas exclu qu’il abandonne tout à condition qu’il ait mis en place une succession qu’il considère comme suffisamment stable et assurée. » Mais sont intervention à la Douma le 10 mars montre qu’il n’est pas encore décidé à céder la main.
Mentor mentor
Sous l’aigle à deux têtes projeté dans son dos, Vladimir Poutine poursuit le discours marathon dont il a le secret. « Il est important d’assurer un meilleur équilibre entre les différentes branches de l’État », déclare-t-il devant quelques mines circonspectes ce 15 janvier 2020. Si la réforme va à son terme, le Conseil de la fédération (chambre haute) aura le pouvoir de révoquer les juges de la Cour suprême et de la Cour constitutionnelle en cas d’actes déshonorants. La procédure sera initiée par le Président. Il pourra aussi mettre en branle une étude de la constitutionnalité des lois fédérales, par la Cour constitutionnelle, avant leur ratification. Enfin et surtout, le Conseil d’État deviendra une agence gouvernementale dont la fonction sera garantie par la constitution.
Rassemblement de leaders nationaux et régionaux présidé par Poutine, cet organe ne dispose pour le moment que d’un pouvoir consultatif. La réforme prévoit de lui confier la définition des « orientations de politique interne et étrangère de la Fédération de Russie et des principaux domaines de développement socio-économique ». À l’instar de Masha Gesse, journaliste au New Yorker et auteure du livre The Future Is History: How Totalitarianism Reclaimed Russia, certains imaginent donc Poutine en prendre la tête après y avoir déplacé le centre du pouvoir et « laissé une présidence éviscérée pour son successeur ».
Lors d’une interview à la télévision, le chef d’État a cependant réprouvé la perspective de devenir le « mentor » du prochain président en 2024, dans la mesure où elle entraînera la coexistence de deux centres de pouvoir, « une situation néfaste pour un pays comme la Russie » selon lui. Alors, quel rôle entend-il donner au Conseil d’État ? Sur ce mystère quasi-complet, le passé jette une lumière timide. En novembre 2000, un président encore vert réactive ce comité issu de la période soviétique. Poutine veut lui donner le rôle « stratégique » de prendre des positions sur « des sujets clés du développement du pays », « sans se substituer au travail du Parlement et du gouvernement ».

Crédits : Kremlin
À cette période, le moral du pays est loin d’être au beau fixe. « Plus de 40 % de nos citoyens vivaient sous le seuil de pauvreté, le système de sécurité sociale était en ruine, sans parler des forces armées qui avaient pratiquement cessé d’exister », retraçait-il dans le documentaire Conversations avec Monsieur Poutine, sorti en 2017. « Le séparatisme dominait. Je ne vais pas m’étendre là-dessus mais je veux juste dire que la constitution russe ne s’appliquait pas partout sur le territoire et une guerre faisait rage au Caucase – une guerre civile qui était alimentée par des éléments radicaux de l’étranger. » L’ex-officier du KGB fait là référence au conflit en Tchétchénie, pour lequel il avait promis que les « terroristes » seraient tués jusque « dans les chiottes ».
Une offensive impitoyable est aussi lancée contre certains oligarques. C’est la fin d’un règne pour ce qu’on a appelé la Semibankirchtchina sous l’ère de Boris Eltsine (1991-1999), autrement dit le gouvernement des sept banquiers : Boris Berezovski (Logovaz et Obiédinionni), Vladimir Goussinski (Most), Alexandre Smolenski (Stolitchni), Vladimir Potanine (Onexim), Mikhaïl Khodorkovski (Menatep), Piotr Aven et Mikhaïl Fridman (Alfa). L’économie russe reste toutefois centrée autour de mastodontes, puisque 23 groupes contrôlaient un tiers de son industrie en 2005.
Poutine n’en finit ni avec les oligarques ni avec la corruption, mais fait le ménage pour imposer son joug. « La politique de Poutine n’a pas eu pour but de réguler l’activité des oligarques, d’encadrer leur extension, mais de régner par des mesures discrétionnaires », juge Christof Ruehl, à cette période économiste en chef de la Banque mondiale à Moscou. Il devient ainsi petit à petit une figure non seulement incontournable mais aussi irremplaçable.
Prolongement
Deux mois après avoir juré de respecter la constitution, sous l’aigle à deux têtes, Vladimir Poutine donne son premier discours annuel à la nation. Comme il le fera vingt ans plus tard, le président russe commence, ce 8 juillet 2000, par s’inquiéter de la démographie. La population a chuté de 750 000 individus en moyenne depuis quelques années, ce qui risque, à un tel rythme, d’entraîner une perte de 22 millions de personnes dans les 15 ans à venir. À la faveur d’une embellie économique, facilitée par la reprise en main des hydrocarbures par l’État et une simplification du droit des entreprises, le taux de natalité repart à la hausse dans la seconde moitié de la décennie.
Poutine réussit donc à instiller un semblant de stabilité dans une société russe marquée par une décennie de troubles. Eltsine a donc bien choisi son successeur, après avoir longtemps tâtonné. À partir du moment où il a commencé à préparer son départ, en 1998, ce dernier a éprouvé trois Premiers ministres avant de nommer Poutine, Sergueï Kiriyenko, Yevgueniy Primakov et Sergueï Stepashin. Quand il s’est enfin décidé, il a présenté son successeur à Bill Clinton comme « un homme solide, au courant des différents sujets relevant de sa compétence. C’est aussi quelqu’un de rigoureux, fort et très sociable. »
Échaudé par l’instabilité de la décennie précédente, Poutine commence par assurer ses arrières. En 2001, une loi accorde au président russe l’immunité une fois son mandat terminé et une retraite de 580 035 roubles par mois, soit 8 460 euros. Puis la création du parti Russie unie lui assure une base parlementaire confortable, en sorte qu’il juge en mai 2003 que le gouvernement peut procéder de la majorité issue des législatives. Trois ans plus tard, le chef d’État change légèrement d’opinion.
« Je suis intimement convaincu qu’à l’ère post-soviétique, alors que notre économie se développe et que notre indépendance se consolide, de manière à définir les principes du fédéralisme, nous avons besoin d’un pouvoir présidentiel fort », affirme-t-il lors d’une conférence de presse. « Pour le moment, nous n’avons pas développé de partis politiques stables. Comment parler d’un gouvernement issu des partis dans ces conditions ? Ce serait irresponsable. »

Crédits : Kremlin
À la fin de son deuxième mandat, Poutine est si puissant qu’il est libre de choisir son successeur. Alors que certains observateurs redoutent un changement de la constitution de nature à lui permettre de rester en poste, comme Loukachenko et Karimov l’ont fait en Biélorussie et en Ouzbékistan, il assure vouloir respecter la loi fondamentale. « J’ai certaines idées sur la manière de faire évoluer la situation du pays pour ne pas le déstabiliser, pour ne pas faire peur aux gens et aux entreprises », déclare-t-il. Son choix se porte sur Medvedev, qui le nomme dans la foulée Premier ministre.
Poutine a beau avoir choisi son homme, des tensions apparaissent en 2011. Le pouvoir est contesté par de grandes manifestations de rue. Surtout, l’équipe de Dmitri Medvedev a laissé passer des résolutions aux Nations unies autorisant l’intervention d’une coalition internationale en Libye, entraînant le renversement de Mouammar Kadhafi. Cet épisode aurait convaincu Poutine de la nécessité de revenir à la présidence et aurait contribué à préciser sa stratégie au Moyen-Orient. Il s’est du reste montré résolument offensif sur la scène internationale, en annexant la Crimée en 2014. Depuis, la chute des cours du pétrole a en revanche entraîné une baisse du pouvoir d’achat.
Les mesures sociales annoncées le 15 janvier 2020 doivent contre-balancer ce bilan économique contrasté. La réforme de la constitution prévoit à ce titre une indexation du salaire minimum et des prestations sociales sur l’évolution du seuil de pauvreté. Avec le nouveau Premier ministre, Mikhaïl Michoustine, il possède quelqu’un qui « connaît très bien l’économie, s’est avéré compétent et est visiblement apprécié », remarque Jean Radvaniy. D’ici 2024, le chef d’État « va essayer différentes personnes à différents postes comme l’avait fait Eltsine ». Sauf qu’il n’est semble-t-il pas prêt à lâcher le pouvoir.
Couverture : Kremlin
L’article Poutine va-t-il diriger la Russie pour l’éternité ? est apparu en premier sur Ulyces.
22.01.2021 à 00:10
À quoi ressemblera la première colonie spatiale ?
À une palourde, voilà à quoi pourrait bien ressembler la première colonie spatiale humaine. Et elle pourrait voir le jour – ou plutôt la nuit éternelle des espaces infinis qui nous entourent – d’ici à peine une quinzaine d’années, à en croire son concepteur l’astrophysicien finlandais Pekka Janhunen, qui la dévoilait en novembre 2020. Le […]
L’article À quoi ressemblera la première colonie spatiale ? est apparu en premier sur Ulyces.
Texte intégral (4467 mots)
À une palourde, voilà à quoi pourrait bien ressembler la première colonie spatiale humaine. Et elle pourrait voir le jour – ou plutôt la nuit éternelle des espaces infinis qui nous entourent – d’ici à peine une quinzaine d’années, à en croire son concepteur l’astrophysicien finlandais Pekka Janhunen, qui la dévoilait en novembre 2020.
Le scientifique a imaginé une station spatiale énergétiquement autonome grâce à deux miroirs géants, déployés de part et d’autre d’une base circulaire capable d’accueillir 50 000 humains, veaux, vaches, cochons et végétaux. Ce n’est pas sa seule originalité, puisqu’elle serait placée en orbite autour de la planète naine Cérès, dans la ceinture d’astéroïdes, et construite à partir de matériaux extraits directement de sa surface.
Autant dire que 15 ans semble irréaliste pour la concrétisation d’un tel projet, mais son existence ravive la soif de colonisation spatiale de l’espèce humaine, et nous amène à nous interroger sur la forme que prendra notre première véritable incursion dans l’espace, détachés de notre chère planète bleue.

Blue Moon
De la Terre, l’Homme verra bientôt une autre planète bleue scintiller comme en miroir dans le ciel. C’est la promesse faite par Jeff Bezos. Sur la scène du Convention Center de Washington, jeudi 9 mai 2019, le patron d’Amazon a présenté « Blue Moon », un appareil de 15 tonnes qui se posera sur la Lune en 2024. « Il est temps de retourner là-haut, mais cette fois pour y rester », lance-t-il à une foule de journalistes triés sur le volet. Capable de transporter 3,6 tonnes de matériel, cet alunisseur posera la première pierre de la route que l’homme le plus riche du monde veut créer dans l’espace. Il devrait atteindre le pôle sud de la Lune afin d’exploiter l’eau glacée qui s’y trouve, de manière à la transformer en hydrogène. À partir de ce carburant, il sera ensuite possible d’explorer le système solaire. « Et des choses incroyables se produiront », promet le patron d’Amazon.
Pour ne pas présenter cette mission comme un fantasme de milliardaire, Bezos assure qu’étant donnée la croissance démographique, « nous allons manquer d’énergie. C’est un problème mathématique, ça va arriver. » Alors que les ressources s’épuiseront selon lui sur Terre, le reste du système solaire est riche. « Voulons-nous stagner et rationner ou voulons-nous le dynamisme et la croissance ? » interroge-t-il. « Le choix est vite fait. Nous savons ce que nous voulons, il ne reste plus qu’à nous mettre au travail. » Pour aider la NASA à envoyer des astronautes sur la Lune, comme le veut Donald Trump, sa société Blue Origin est la mieux placée, vante-t-il : elle a été fondée en 2000, soit deux ans avant SpaceX, l’entreprise d’Elon Musk.

Crédits : Blue Origin
« Oh arrête de nous titiller Jeff », a tweeté le créateur de Tesla en apprenant la nouvelle. Le 20 juin prochain, Musk devrait donner plus de détails sur les moyens mis en œuvre dans le projet Starship pour bâtir une base habitable et autonome sur Mars. La planète rouge possède l’avantage de se situer « assez loin de la Terre », ce qui lui donne plus de chance de survie qu’une structure sur la Lune. Elle pourrait alors représenter la première de nombreuses colonies à venir.
Quant à Jeff Bezos, il ne vise pas seulement la Lune. Le patron d’Amazon songe à construire des stations spatiales orbitales géantes, dont la rotation serait source de gravité. De telles structures, imaginées par le physicien de Princeton Gerard K. O’Neill, pourraient accueillir un billion de personnes dans un cadre aussi élaboré que bucolique. « Ce serait une civilisation incroyable », s’émeut Jeff Bezos. On y vivrait constamment comme aux « meilleurs jours de Maui », une île d’Hawaï, tout en pouvant revenir sur Terre. Cette perspective n’excite d’ailleurs pas seulement le PDG. Il existe même déjà une nation spatiale avant l’heure.
Asgardia
Igor Ashurbeyli tient la Terre entre ses mains. « Aujourd’hui, Asgardia est le foyer de citoyens de plus de 200 pays », se rengorge ce quinquagénaire russe en manipulant le globe de la taille d’un enfant qui trône dans son bureau. Le « père fondateur » est un bonhomme rond à la moustache et aux cheveux blancs. Son regard céruléen perce derrière des verres sans monture et un cillement incessant. Ce 12 janvier 2017, plein de flegme, il s’adresse aux « hommes du futur » de la « nation spatiale » créée trois mois auparavant.
Pendant la première année du calendrier asgardien, lui et ses 100 000 compatriotes ont beaucoup à faire : « Approuver une constitution, élire un gouvernement, choisir un drapeau, un hymne, un insigne et beaucoup d’autres choses. » Ainsi affranchi des lois terrestres, le nouvel État pourra commencer à prévoir son installation dans l’espace. Mardi 13 juin 2017, lors d’une conférence de presse organisée à Hong Kong, Igor Ashurbeyli a annoncé le lancement d’un satellite contenant des données en septembre, une première étape avant de quitter ce monde. À terme, Asgardia doit envoyer un appareil réunissant les conditions propices à la vie. Comme dans le film Elysium (2013), cette station spatiale pourrait prendre la forme d’un gigantesque anneau tapissé de végétation et sillonné d’eau. C’est du moins le modèle à l’étude, doté de suffisamment de gravité et de ressources pour que l’espèce se perpétue loin du berceau.
Conquête
Du haut du plus grand immeuble de Hong Kong, les Asgardiens cherchent un nouveau pied-à-terre sur la voûte céleste. Mardi 13 juin, dans un gratte-ciel de la péninsule asiatique, Igor Ashurbeyli organisait la deuxième conférence de presse de la « nation spatiale ». À partir de « ce lieu qui est presque le plus proche de l’espace », il a donné à chacun de ses citoyens le droit de charger 300 kilobits de données personnelles dans le cargo orbital ATK Cygnus, qui partira pour la Station spatiale internationale (ISS) en septembre. Qu’il s’agisse d’une photo de « votre chaton, de votre voisin, de votre mère ou de votre enfant », a précisé le Russe, « vos données seront conservées pour toujours dans la mémoire de la nouvelle humanité spatiale puisqu’elles seront réinstallées dans chaque satellite d’Asgardia, pas seulement dans l’espace proche mais sur la Lune et ailleurs dans l’univers. » Quel intérêt ?
Pour John Strickland, membre du directoire de la National Space Society, la conservation d’information revêt un intérêt stratégique : « Nous sommes essentiellement entouré par des données génétiques. Elles peuvent être transportées ailleurs et restaurées dans le futur. » En cas de catastrophe, leur conservation empêcherait l’extinction des espèces connues actuellement. « Les progrès en biologie laissent augurer des vies plus longues, ce qui pourrait engendrer des problèmes économiques et sociaux », ajoute-t-il. Sans parler du risque nucléaire. Igor Ashurbeyli cite à dessein la Lune comme une première étape car l’Agence spatiale européenne (ESA) veut y installer un village. Pour faire avancer cette idée qu’il porte depuis son arrivée à la présidence de l’ESA, en juillet 2015, Johann-Dietrich Woerner a réalisé une vidéo de promotion en mars 2016 dans laquelle il vante les missions qui pourraient y être menées « dans la science, les affaires, le tourisme ou même l’exploitation minière ». Construite à l’aide des ressources de sa planète par des robots grâce à l’impression 3D, la base viendrait remplacer la Station spatiale internationale, dont le programme doit prendre fin en 2024. D’ici là, dès 2018, la Chine enverra une sonde sur le pôle sud de la Lune afin de chercher de l’eau et les États-Unis analyseront la composition du sol de Mars grâce à la mission In Sight. L’Europe a elle a dû reporter l’envoi de son rover Exomars à 2020.
« La prochaine étape logique », d’après Woerner, est la création d’une colonie évoluant en dehors de la Terre. Mais cette ambition que fait sienne Elon Musk à travers SpaceX soulève quelques questions. Pour répondre aux plus immédiates d’entres elles, un groupe de de l’ESA et de l’agence spatiale russe Roscosmos s’est mis dans les condition d’un voyage vers la Planète rouge en 2010. Baptisé Mars500, ce projet reproduisait les conditions rencontrées durant un vol spatial. « La question principale », indique l’un des participants, l’ingénieur français Romain Charles, « était de savoir si l’homme est psychologiquement et physiologiquement capable d’endurer le confinement d’un voyage vers la planète Mars, en estimant que cela prendrait huit mois à l’aller, un mois sur place et huit mois au retour ».
Après ce long périple cloué à un simulateur de l’Institut des problèmes bio-médicaux de Moscou, la réponse donnée a été oui. Mais deux facteurs extrêmement importants n’ont pas été analysés : le manque de gravité et les radiations. À mesure que l’on s’éloigne d’un astre, l’effet de son champ de pesanteur se réduit. Sujet à un flottement dans l’espace, le corps d’un cosmonaute perd des muscles et de la résistance osseuse. Il est ainsi bien plus fragile. Or, les radiations émises par l’explosion d’étoiles lointaines le mettent aussi à l’épreuve. « Quand on quitte la proche banlieue terrestre, ces dernières peuvent produire des dégâts dans le corps humain », prévient Romain Charles. À une distance raisonnable du champ magnétique de la Terre qui les dévient, les dommages ne sont pas trop graves. Mais au large, tout indique qu’elles sont mortelles. Pour s’en protéger, « on a pensé à une coque en plomb, mais c’est très lourd », explique Romain Charles. « L’eau est un bon bouclier, mais ça pose plein de problème techniques. » La NASA étudie, elle, une solution à base de nanotubes de nitrure de bore hydrogénées (BNTT). « Cette matière est très résistante, même à très haute chaleur », observe Sheila Thibeault, une chercheuse de l’agence spatiale. À l’aune des progrès techniques, la colonisation de Mars apparaît « possible » à John Strickland. « C’est une planète qui ressemble assez à la Terre, il y a certes des choses à régler, mais ça pourrait être fait en 200 ans. »
En cas d’échec du processus de terraformation, c’est-à-dire de transformation de la Planète rouge en une planète bleue, l’option d’un vaisseau auto-suffisant serait à creuser. Elle présenterait l’avantage de permettre aux Hommes d’aller d’une orbite à l’autre, en quête d’autres formes de vie. « On peut imaginer faire tourner une station cylindrique par rapport à un axe central pour créer une gravité artificielle », détaille Romain Charles. « Des systèmes à deux stations reliées par un long filin autour duquel elles pivotent ont aussi été imaginées. On a testé de petites centrifugeuses dans les stations pour créer une gravité artificielle, cela fonctionne. » Seulement, « nous sommes actuellement incapables de lancer une fusée de plus de cinq mètres de largeur », tempère John Strickland. Avant d’imaginer un cylindre où nous reproduire, il faut donc déjà savoir comment quitter la Terre. 
Tore
Un nuage de poussière avale la capsule Soyouz dès son atterrissage dans une plaine du Kazakhstan. Après six mois dans l’espace, Thomas Pesquet et Oleg Novitski retrouvent la planète qu’ils ont observée avec tant de plaisir depuis la Station spatiale internationale, à 400 kilomètres d’altitude. Ce vendredi 2 juin 2017, ils peuvent enfin retirer les combinaisons sur mesure qui les empêchaient de grandir, l’absence d’apesanteur engendrant un allongement de la colonne vertébrale. Comme si l’Homme n’était pas tout à fait préparé à prendre une telle hauteur. Il ne peut pourtant s’en empêcher. « La Terre est le berceau de l’humanité, mais on ne passe pas sa vie entière dans un berceau », disait Constantin Tsiolkovski en 1911. Auteur d’œuvres visionnaires sur l’exploration spatiale, ce scientifique russe a ouvert la voie aux avionneurs puis aux astronautes. Pour se propulser à la verticale, et donc se libérer de l’attraction, l’homme doit utiliser la réaction, théorise-t-il en 1883 dans L’Espace libre. Après avoir dessiné un « train-fusée » et un « ascenseur cosmique », il lance l’idée d’une installation spatiale rotative produisant sa propre gravité dans la nouvelle de science-fiction Au-delà de la Terre.
Une véritable ville pourrait s’y développer autour de productions industrielles et agricoles. Parmi ses inspirations, Tsiolkovski cite Jules Verne, dont les romans d’anticipation passent de main en main dans les milieux scientifiques. Inspiré par De la Terre à la Lune (1865), le physicien allemand Hermann Oberth se met à imaginer des appareils à plusieurs étages. « S’il y a une petite fusée au-dessus d’une grande et que la grande est propulsée alors que la petite est allumée, leur vitesse sera plus grande », écrit-il dans le livre La Fusée dans l’espace interplanétaire. Il y mentionne pour la première fois le mot Raumstation, c’est-à-dire « station spatiale » en allemand. L’un de ses disciples, Wernher von Braun, le reprend dans À travers la frontière spatiale en 1952.  Sur un modèle élaboré en 1928 par l’ingénieur slovène Herman Potočnik, von Braun conceptualise une roue de 76 mètres de diamètre, en orbite à 1 700 mètres autour de la Terre, dont la rotation à trois tours par minute créerait un phénomène de gravité artificielle. Vendu à quatre millions d’exemplaires, le numéro du magazine Collier’s dans lequel est publié son article en 1952 « fait grandement évoluer l’état de l’opinion publique à propos des voyages dans l’espace », souligne l’historien de la NASA Mike Wright. « Il rend réaliste l’idée d’une exploration spatiale pacifique. » L’idée se diffuse également au travers des fictions réalisées par les studios Disney, avec lesquelles il collabore. Fasciné par les étoiles des pages du magazine Astounding Stories, le fils de fermier anglais Arthur C. Clarke pense à la même époque qu’aller sur Mars prendra 100 jours dans les années 1990. D’échanges à la British Interplanetary Society, il en est venu à écrire des articles puis des livres au sujet d’invasions extraterrestres (La Fin de l’enfance en 1953) et de conquêtes spatiales (La Cité et les Astres, en 1956). Dans un registre plus terre à terre, les Soviétiques envoient Spoutnik en orbite en 1957.
Sur un modèle élaboré en 1928 par l’ingénieur slovène Herman Potočnik, von Braun conceptualise une roue de 76 mètres de diamètre, en orbite à 1 700 mètres autour de la Terre, dont la rotation à trois tours par minute créerait un phénomène de gravité artificielle. Vendu à quatre millions d’exemplaires, le numéro du magazine Collier’s dans lequel est publié son article en 1952 « fait grandement évoluer l’état de l’opinion publique à propos des voyages dans l’espace », souligne l’historien de la NASA Mike Wright. « Il rend réaliste l’idée d’une exploration spatiale pacifique. » L’idée se diffuse également au travers des fictions réalisées par les studios Disney, avec lesquelles il collabore. Fasciné par les étoiles des pages du magazine Astounding Stories, le fils de fermier anglais Arthur C. Clarke pense à la même époque qu’aller sur Mars prendra 100 jours dans les années 1990. D’échanges à la British Interplanetary Society, il en est venu à écrire des articles puis des livres au sujet d’invasions extraterrestres (La Fin de l’enfance en 1953) et de conquêtes spatiales (La Cité et les Astres, en 1956). Dans un registre plus terre à terre, les Soviétiques envoient Spoutnik en orbite en 1957.
Lancé quatre ans plus tard, le programme Apollo aboutit en 1969, quelques mois après la parution de 2001, L’Odyssée de l’espace. Son scénario est rendu célèbre par le film éponyme de Stanley Kubrick. On y découvre une station formée d’une double-roue. Au début des années 1970, alors que Soviétiques et Américains mettent sur pied des satellites en forme de tubes hérissés de panneaux solaires et thermiques, ceux des futuristes conservent le modèle cylindrique. En 1973, la NASA parvient à envoyer une espèce de moulin baptisé Skylab au voisinage de la Terre, là où Arthur C. Clarke imagine un immense vaisseau rond se déployer dans Rendez-vous avec Rama. Des concepts de roues ou de tores sont aussi esquissés à la demande de l’agence spatiale américaine par Don Davis et Rick Guidice. À l’université de Stanford, le physicien Gerard K. O’Neill reprend les sphères élaborée par John Desmond Bernal en 1929 pour proposer son propre schéma de 500 mètres de diamètre tournant à 1,9 tour par minute. Il inspirera plus tard Jeff Bezos.
Une usine spatiale
Si la station Mir (1986-2001) et la Station spatiale internationale (ISS, lancée en 1998) ressemblent plus à un étendoir qu’aux énormes donuts pensés pour accueillir une colonie, c’est que leur proximité avec la Terre ne les exposent pas aux conditions extrêmes de l’espace lointain. « La protection du champ magnétique terrestre est encore assez présente dans l’ISS, donc les astronautes subissent plus de radiation que nous sur Terre mais ça reste dans des proportions correctes », explique Romain Charles. Une micropesanteur existe ainsi dans les stations qui gravitent autour du globe. Mais la forme des satellites est surtout contrainte par la taille réduite des objets que nous sommes en mesure d’envoyer. Bâtir un anneau à l’image de celui d’Elysium réclame donc d’établir une usine dans l’espace. « Vous avez besoin de robots », explique John Strickland. « Ils pourraient œuvrer sur des rails pour ne pas avoir à se soucier de la gravité. Rendre cela soutenable financièrement nécessitera l’emploi de fusées réutilisables. » La société de Jeff Bezos, Blue Origin, œuvre en ce sens en construisant une usine de fusées en Floride.
La conquête spatiale s’industrialise. Une fois l’usine installée, elle aura comme objectif de produire un cylindre dont la rotation engendre une gravité artificielle où l’air est respirable. « Cela fait 40 ans que nous construisons des vaisseaux adaptés à la respiration humaine », rappelle un autre directeur de la National Space Society, Al Globus. « Nous avons juste besoin de les faire plus grands. » Différents filtres absorbent l’humidité dans les stations spatiales et capturent le dioxyde de carbone rejeté par la respiration, dont la toxicité à haute dose peut être mortelle. Ce système en circuit fermé engendre également de l’eau. Son autonomie repose néanmoins pour le moment sur certains composants comme le silice, régulièrement réapprovisionnés depuis la Terre.
Par conséquent, l’environnement de l’ISS présente des caractéristiques propices au développement de plantes. Sauf que faute de gravité suffisante, leurs racines, tiges et feuilles poussent en tout sens, à moins d’être guidées par de la lumière. Un jardinage méticuleux a permis à l’astronaute américain Scott Kelly de faire pousser deux fleurs de zinnia dans la Station spatiale internationale. En février 2017, des algues sont même revenues sur Terre après avoir passé 530 jours à l’extérieur de l’appareil, exposées aux radiations et aux basses températures. Or, remarque Romain Charles, « des systèmes à base d’algues microscopiques permettent de produire de l’oxygène. Ils ne fonctionnent cependant plus si elles mutent sous l’effet des radiations. » Depuis une vingtaine d’années, des chercheurs de l’université autonome de Barcelone tablent sur un écosystème pouvant fonctionner en vase clos. Basé sur le recyclage, le projet Melissa est censé se réapprovisionner en eau, en nourriture et en oxygène sans apport extérieur. Il est expérimenté sur des rats qui vivent dans l’un des cinq compartiments où les composants nécessaires se renouvellent de manière indépendante. Une ingénierie complexe : « Connecter deux compartiments, c’est gérable », relève le responsable de cette expérience menée pour le compte de l’ESA, Christophe Lasseur. « Mais lorsque nous passerons à trois, puis quatre et cinq, la complexité s’amplifiera. » En attendant, « il n’y a pas encore de système clos complet qui donne satisfaction », admet Romain Charles.
Dans l’espace, l’Homme peut en tout cas raisonnablement espérer pouvoir se reproduire. Malgré une exposition à des radiations cent fois plus élevées que celles atteignant la Terre, le sperme de douze souris ayant séjourné 288 jours dans la Station spatiale internationale a pu donner la vie. Les altérations de l’ADN n’ont pas eu d’effet néfaste sur le développement de leur progéniture, ont constaté les chercheurs japonais de l’université de Yamanashi à Kofu, en juin 2017. La nouvelle a dû réjouir le « père de la nation spatiale » Igor Ashurbeyli. Mais elle ne profitera au mieux qu’à ses petits-enfants. 
Couverture : Bienvenue sur Kalpana One. (Bryan Versteeg)
L’article À quoi ressemblera la première colonie spatiale ? est apparu en premier sur Ulyces.
21.01.2021 à 00:01
L’endroit le plus mystérieux du monde : la vraie histoire de la Zone 51
Matty Roberts est un mec sympa. Ce Californien de Bakersfield au visage bonhomme, encadré par un bouc épais et de longs cheveux châtains, affiche ses passions au vu de tous sur Internet : les grosses cylindrées, le metal, les séries B et les teckels. Ses potes l’adorent, c’est un marrant. Tout a d’ailleurs commencé par […]
L’article L’endroit le plus mystérieux du monde : la vraie histoire de la Zone 51 est apparu en premier sur Ulyces.
Texte intégral (4722 mots)
Matty Roberts est un mec sympa. Ce Californien de Bakersfield au visage bonhomme, encadré par un bouc épais et de longs cheveux châtains, affiche ses passions au vu de tous sur Internet : les grosses cylindrées, le metal, les séries B et les teckels. Ses potes l’adorent, c’est un marrant. Tout a d’ailleurs commencé par une blague sur Facebook.
Le 27 juin 2019, Matty a créé le groupe « Storm Area 51, They can’t stop all of us », où il invite la communauté à envahir la célèbre Zone 51 pour en révéler les secrets. L’idée est simple : « Ils ne pourront pas tous nous arrêter. » Étrangement séduisante. Pendant trois jours, la blague n’a fait rire que 40 personnes. Et puis le feu a pris d’un coup.
Aujourd’hui, ce sont près de deux millions de personnes qui disent vouloir se rendre sur le mystérieux site pour « voir les extraterrestres » le 20 septembre 2019. La blague ne fait pas rire l’US Air Force. « Nous décourageons quiconque de tenter de pénétrer dans une zone où nous entraînons les Forces armées américaines », a déclaré un porte-parole de l’US Air Force.

La couverture du groupe Facebook
Mais les militaires ne sont pas les seuls à s’inquiéter. Avec 184 chambres d’hôtel, deux stations-service, un supermarché et un hôpital, le comté de Lincoln, dans le Nevada, n’est pas fait pour accueillir 1,9 million de personnes. Oh bien sûr, la plupart des « participant(e)s » ne viendront pas, « mais si 500 ou 1000 personnes débarquent, nous aurons des problèmes », a confié le shérif du comté Kerry Lee au Las Vegas Sun. Les 26 policiers qu’il a sous ses ordres sont bien d’accord.
Pourtant, malgré les mises en garde, le 20 septembre prochain risque de voir un nombre étonnant de gens affluer sur les terres arides qui entourent le terrain de l’armée américaine, qui fascine le monde entier depuis 72 ans. Crash d’ovni, avions espions et photographies classées Secret Défense : voici tout ce qu’on sait vraiment de la Zone 51.
Secret Défense

William Colby
19 avril 1974. William Colby est assis devant son bureau de Langley, en Virginie, au quartier général de la CIA. Cheveux impeccablement coiffés, allure sévère et tiré à quatre épingles, le directeur de l’Agence centrale de renseignement américaine est soucieux. Il vient de recevoir un mémo faisant état d’un « petit problème » concernant une zone interdite, une portion de territoire totalement dissimulée aux civils. Le dos droit dans son fauteuil en cuir sombre, William Colby a raison de ne pas être serein : une photographie des activités de la Zone 51 pourrait avoir fuité.
En cause, les astronautes de la dernière mission Skylab, l’ancêtre de la Station spatiale internationale, réalisé par la NASA. Ils ont pris plus de 19 400 photos lors de leur dernier voyage dans l’espace. L’une d’entre elles donne à voir la base secrète la mieux gardée des États-Unis dans ses plus détails les plus intimes. L’acte était-il intentionnel ? S’agissait-il d’une simple maladresse des astronautes de la NASA ? La réponse n’a jamais été dévoilée. Mais pour William Colby, la seule existence du cliché pourrait entraîner de graves conséquences : le risque que l’image tombe aux mains des Soviétiques est trop important. Elle doit absolument être classée Secret Défense, et vite.
William Colby organise immédiatement une réunion entre les différentes agences américaines pour demander sa classification. La NASA et le département de l’Intérieur s’y opposent sans détour. Un cas classique de concurrence entre agences gouvernementales. Pourtant, un accord existe entre la NASA et les services secrets américains : toute photo prise par un satellite ou des astronautes doit d’abord passer par le Centre national d’interprétation photographique (NPIC), basé à Washington. Au sein de ce service dirigé par la CIA, on vérifie et interprète toutes les photos aériennes et satellites. Dans ce cas précis, la question est de savoir si une photo prise par un programme non classé Secret Défense peut être classifiée. La CIA obtiendra finalement gain de cause.
Plus de 40 ans plus tard, le contenu de cette image reste un mystère absolu. La photo a été retirée des dossiers Skylab 4. Face à l’influence de la CIA et à la puissance des secrets entourant la base militaire, la NASA et l’Intérieur n’ont pas eu leur mot à dire. Cette base, on l’appelle Dreamland, Watertown, The Ranch, Paradise Ranch, The Farm, The Box, Groom Lake… ou encore Zone 51. Elle conservera donc tous ses secrets. Colby peut dormir tranquille.
Groom Lake Road
Au beau milieu du désert du Nevada, dans la vallée de Tikaboo, la ville de Rachel est la seule commune à des kilomètres à la ronde. Perdue dans le comté de Lincoln à trois heures de route au nord de Las Vegas, Rachel et sa cinquantaine d’habitants sont plantés là, dans le désert du Grand Bassin des États-Unis. Un no man’s land où règne sans partage une chaleur ardente. Rachel est une ancienne ville minière de tungstène dont la plupart des habitants vivent dans des ranchs. Ici, il n’y a pas de mairie, pas de station essence, pas même de supermarché ou d’épicerie, seulement le « Little A’Le’Inn », une petite auberge qui accueille les voyageurs audacieux ou égarés.
C’est l’unique village qui donne sur la route 375, une interminable voie goudronnée qui mène droit vers les mines. Et au-delà ? Une portion de sentier terreux appelé Groom Lake Road, qui semble ne mener nulle part. Enfin, pas tout à fait. Au bout de ce chemin poussiéreux s’étend une zone interdite d’accès. La voie terreuse laisse à nouveau place à une route goudronnée qui s’enfonce et grimpe plus avant dans ces collines désertiques et inhospitalières. À la frontière entre terre et goudron, pas de barrière ou de poste de garde, juste une paire intimidante de panneaux d’interdiction d’aller plus loin, accompagnés de pancartes sommant les voyageurs de rebrousser chemin.
De multiples interdictions y sont placardées, telles que « NO DRONE ZONE » ou « PHOTOGRAPHIE INTERDITE ». Toute transgression expose l’imprudent à un maximum de 1 000 dollars d’amende et six mois d’emprisonnement.  Si un touriste un peu trop curieux s’avance près de la limite indiquée, un 4×4 blanc ou beige banalisé apparaît. En sortent deux soldats en treillis couleur sable, armes chargées aux mains, qui intiment vigoureusement le voyageur de reprendre sa route dans le sens inverse. Comment ont-ils pu s’apercevoir d’une présence intrusive ?
Si un touriste un peu trop curieux s’avance près de la limite indiquée, un 4×4 blanc ou beige banalisé apparaît. En sortent deux soldats en treillis couleur sable, armes chargées aux mains, qui intiment vigoureusement le voyageur de reprendre sa route dans le sens inverse. Comment ont-ils pu s’apercevoir d’une présence intrusive ?
Dans le ciel immense, pas un drone en vue. Le désert semble mort. Mais d’une manière ou d’une autre, tout est enregistré sur cette route. Les habitants de Rachel racontent à mi-voix que des détecteurs de mouvements se terrent partout dans la zone qui encercle Groom Lake. Jusqu’en 2013, les autorités américaines se refusaient à tout commentaire sur les activités de la Zone 51, accentuant les spéculations et le climat de mystère sur la région.
« Tous les interdits qui entourent la Zone 51 font que les gens veulent savoir ce qui s’y passe », explique l’historien Peter Merlin. Spécialisé dans l’aéronautique, il a enquêté pendant plus de 30 ans sur Groom Lake et ses énigmes. Pour lui, une seule certitude ressort des nombreux mythes qui l’entourent : la Zone 51 existe bel et bien et elle est encore active aujourd’hui. « Il est absolument certain qu’il s’y passe des choses », conclut-il. Mais quoi ?
Avions espions
La nuit du mercredi 2 juillet 1947, un orage s’abat sur la région environnant Roswell, une petite ville du Nouveau-Mexique. Dans une zone désertique et difficile d’accès, battue par une pluie diluvienne, une explosion terrible se fait entendre, accompagnée d’un arc lumineux qui traverse le ciel. Ça ne ressemble pas à un coup de tonnerre. Le lendemain, alors qu’il promène ses chèvres, William « Mac » Brazel découvre sur son terrain des débris éparpillés sur une vaste surface. Mac, chapeau de cowboy vissé sur la tête, est propriétaire d’un ranch. Comme plusieurs de ses voisins, il a déjà retrouvé sur ses terres des débris de ballons météorologiques, mais cette fois, il est surpris par l’aspect de sa trouvaille. Il en ramasse quelques-uns qu’il ramène chez lui.
Quelques jours plus tard, il se décide à faire part de sa trouvaille à George Wilcox, le shérif du comté de Chaves. Celui-ci appelle le Roswell Army Air Field, le camp militaire basé à côté de la ville. Deux soldats se rendent sur les lieux pour inspecter les fameux débris et, dès le lendemain, le colonel Blanchard fait boucler le périmètre du crash. En moins de temps qu’il n’en faut pour le dire, les débris sont ramassés et emmenés par camion à la base de Roswell.
Le jour-même, le colonel annonce, via un communiqué, que les débris retrouvés proviennent d’une « soucoupe volante ». En un rien de temps, toute la presse du pays est en effervescence et se rue dans le région. Mais quelques heures plus tard, le brigadier-général Roger Ramey annonce que le colonel Blanchard s’est trompé. Il s’agirait non pas d’une soucoupe volante, mais des restes d’un ballon météorologique couplé à un réflecteur radar.
C’est dans la Zone 51, à en croire les plus fervents ufologues, que seraient entreposés les vestiges du crash de Roswell. À les en croire, ils constitueraient la preuve de la relation secrète qu’entretient l’armée américaine avec des espèces extraterrestres.
En 2013, un rapport officiel sur l’histoire du programme d’avions espions U-2 entre 1954 et 1974, rédigé par deux historiens de la CIA, a été entièrement déclassifié. Il relate en des termes détaillés l’histoire de la Zone 51 et ce qu’on y aurait réalisé pendant ces deux décennies de secrets. D’après ce document de plus 400 pages, c’est en 1955 que débute véritablement l’histoire de la Zone 51.
À l’époque, la CIA est à la recherche d’un site pour procéder aux essais du U-2, le nouvel avion espion mis au point par l’entreprise Lockheed Martin, leader mondial dans le domaine de la défense et de la sécurité. L’appareil doit être testé à l’abri des regards indiscrets, alors que les États-Unis sont en pleine guerre froide contre l’URSS. La zone doit offrir une piste suffisamment longue et résistante pour supporter le poids du nouvel appareil, des réserves de carburant considérables et la proximité d’une administration militaire, pour la logistique.
Le lieu choisi par la CIA se situe dans une région administrative que d’anciennes cartes du gouvernement appellent la « Zone 51 ». Elle se trouve à côté de Groom Lake, un lac asséché coincé entre les montagnes. Sa situation géographique est parfaite puisque la zone est déjà largement interdite d’accès au public. La petite base, qui sera ensuite rénovée et agrandie, est entourée de la zone militaire de Nellis et du site d’essais nucléaires du Nevada (NTS), en service de 1951 à 1992. L’endroit est inhospitalier, et pour convaincre les ingénieurs et les militaires de venir travailler au sein de cette nouvelle base, Kelly Johnson, un des ingénieurs en chef du projet U-2, décide de renommer l’endroit Paradise Ranch – un des premiers surnoms de la zone.
De 1955 à 1974, les projets d’avions espions se sont enchaînés.
À partir de 1955 et des premiers tests de l’avion espion U-2, des témoignages faisant état observations d’ovnis dans la zone commencent à apparaître. « Les vols à haute altitude du U-2 ont rapidement entraîné un effet secondaire inattendu : l’augmentation phénoménale des signalements d’objets volants non-identifiés », racontent les deux historiens de la CIA. À l’époque, les avions de ligne volent à une hauteur de 3 000 à 6 000 mètres, quand les U-2 se déplacent à plus de 20 000 mètres. « De tels signalements arrivaient fréquemment en début de soirée, de la part de pilotes commerciaux volant d’est en ouest », disent-ils.
À cette heure de la journée, le Soleil était bas sur l’horizon, plongeant les avions « dans l’ombre » et rendant difficile leur identification à l’œil nu. Quand un U-2 volait dans les environs à très haute altitude, le Soleil se reflétait sur ses ailes métalliques, ce qui donnait l’impression aux pilotes de voir des objets enflammés, écrivent-ils. Le phénomène était également observé sur la terre ferme. « À cette époque, personne n’imaginait qu’un vol habité était possible à cette altitude, ce qui fait que personne ne s’attendait à voir un objet si haut dans le ciel », poursuivent les deux historiens. Toujours d’après le rapport, le caractère ultra-secret du programme U-2 empêchait les membres de l’Air Force chargés d’enquêter sur les signalements d’ovnis d’expliquer les véritables raisons de ces phénomènes.
De 1955 à 1974, les projets d’avions espions se sont enchaînés. Avant même que le U-2 ne soit totalement développé, le projet OXCART a été lancé par la CIA en 1962. Cet appareil de reconnaissance à haute altitude était capable d’atteindre la vitesse de Mach 3, soit trois fois la vitesse du son. Kenneth Collins a aujourd’hui 80 ans. Cet ancien pilote d’essais de la CIA a effectué de nombreux vols avec le U-2 et l’OXCART dans les années 1960. Il se souvient en détail du 24 mai 1963, le jour de son crash avec l’OXCART, dans l’Utah.
« Trois hommes sont arrivés en pick-up et m’ont proposé de l’aide. Je leur ai dit de ne pas s’approcher de l’avion, que j’avais une charge nucléaire à bord », se souvient-il. La CIA a fait signer à tous les témoins un engagement de confidentialité et déguisé l’accident en expliquant qu’il s’agissait d’un simple avion de l’US Air Force. Après avoir été récupéré, le pilote a subi un interrogatoire de la CIA, dont les agents lui ont administré un sérum de vérité : « Ils voulaient s’assurer que je n’avais rien oublié de leur dire des circonstances de l’accident. »
Quelques jours plus tard, le dimanche soir, trois agents l’ont ramené chez lui. « L’un d’eux conduisait ma voiture, les deux autres m’ont porté à l’intérieur et m’ont jeté sur le lit. J’étais défoncé à cause des médicaments. Ils ont donné les clefs de voiture à Jane, mon épouse, et sont repartis sans dire un mot. »
La vérité est ailleurs
Robert Scott Lazar a tout du scientifique des années 1970. D’imposantes lunettes posées sur le nez, les cheveux châtains mi-longs recouvrant ses oreilles. Il se fait connaître pour la première fois dans le Los Alamos Monitor, un journal local du Nouveau-Mexique, en 1982. L’article parle d’un dragster qu’il aurait construit avec un scientifique de la NASA. Le journal présente alors « Bob » Lazar, qui dit être diplômé du MIT et du California Institute of Technology (Caltech), comme « un physicien travaillant au centre de recherche de Physics Facility (LAMPF) ».
Mais c’est le 13 mai 1989 que Bob Lazar accède à une notoriété mondiale : lors d’une interview donnée à une chaîne télévisée de Las Vegas, le scientifique affirme avoir travaillé dans la très secrète Zone 51.  Lazar explique avoir été ingénieur et scientifique durant un an, entre 1988 et 1989, dans la base de la CIA. Et il n’est pas avare de détails : devant son interlocuteur médusé, il raconte avoir été attribué au secteur 4, proche de Groom Lake et caché sous la montagne, à Papoose Lake.
Lazar explique avoir été ingénieur et scientifique durant un an, entre 1988 et 1989, dans la base de la CIA. Et il n’est pas avare de détails : devant son interlocuteur médusé, il raconte avoir été attribué au secteur 4, proche de Groom Lake et caché sous la montagne, à Papoose Lake.
Au cours de ses diverses missions, Bob Lazar dit avoir travaillé sur la propulsion d’un nouveau genre d’appareils militaires. Mais après des recherches poussées sur le matériel qu’on mettait à sa disposition, il parvient à la conclusion que les neufs engins gardés dans le Secteur 4 ne sont pas d’origine terrestre. Dans son témoignage, Bob Lazar explique s’en être rendu compte après être monté à bord d’un des appareils. Pour lui, l’engin était « construit pour une personne à la morphologie différente de celle d’un pilote humain ».
Une enquête du Los Angeles Times de 1993 montre qu’il n’y a aucune trace de son passage au MIT et à Caltech. Le docteur en physique David L. Morgan a également remis en question les propos de Bob Lazar. Ce dernier s’est défendu en affirmant que le gouvernement américain, ou une « autorité plus haut placée », avait effacé les traces pour lui faire perdre tout crédibilité. C’est pour se protéger qu’il aurait réalisé l’interview du 13 mai 1989.
Quoi qu’il en soit, cette interview et le témoignage de Bob Lazar ont connu une diffusion mondiale, et relancé, au début des années 1990, le mythe qui entoure la Zone 51. En quelques années, elle a été happée Hollywood qui a fini de graver son nom dans l’imaginaire collectif avec X-Files (1993) et Independence Day (1996). Celui de Bob Lazar, en revanche, est presque tombé aux oubliettes – un documentaire Netflix lui était consacré en 2018.
~
Peter Merlin porte la raie sur le côté, les cheveux courts au niveau des tempes et une fine moustache qui épouse les contours de sa lèvre supérieure. Il se montre le plus souvent affublé d’un grand chapeau beige et d’un blouson en cuir. Après avoir travaillé si longtemps sur la Zone 51 et ses mystères, il en parle aujourd’hui avec beaucoup de calme et de sérénité : « Le seul véritable mystère qui entoure la Zone 51 aujourd’hui concerne la nature des programmes qui n’ont pas encore été déclassifiés. »
Lorsqu’on lui demande si Bob Lazar dit vrai, il n’hésite pas une seconde : « En plus de trente ans de recherches, je n’ai trouvé aucune preuve crédible, si ce n’est les avions espions militaires et les armes qui ont été testés dans la Zone 51. Malgré cela, le mythe persiste. » Pour lui, les récentes divulgations de la CIA n’y feront rien car les gens aiment le mystère. « Moins on en sait sur la Zone 51, plus il est facile de remplir les blancs avec son imagination », conclut-il.

Peter W. Merlin
Mais un événement récent est venu secouer le monde des ufologues. En 2015, le Dr Robert Krangle, physicien et consultant régulier du laboratoire de Los Alamos, a affirmé se souvenir parfaitement de Bob Lazar. Son témoignage inattendu a donné une nouvelle dimension aux propos de celui qui, plus de 25 ans plus tôt, disait avoir travaillé sur des appareils extraterrestres dans l’enceinte de la Zone 51.
« Bob Lazar était aussi physicien que moi : ça se voyait tout de suite à la rangée de stylos de couleur qui dépassaient de sa chemise », dit-il sur le ton de la plaisanterie. Le physicien ajoute plus sérieusement que Bob Lazar participait aux réunions de sécurité « durant lesquelles on nous donnait le briefing habituel, qui exigeait qu’on ne dise rien à l’extérieur de ce qu’on allait voir ou faire à Los Alamos ». Robert Krangle est à ce jour la seule personne à avoir publiquement validé le passé et les travaux de Bob Lazar…
~
En octobre 2016, deux hommes se sont un peu trop approchés du site secret de Groom Lake Road. Joe et Garrett McCullough ne sont pas des chasseurs d’ovnis, ni des théoriciens du complot. Ce père et son fils sont des aventuriers vlogueurs dont l’activité favorite est d’explorer le monde sur leurs motos. Dans leur vidéo publiée le 10 octobre 2017, ils tentent de s’introduire sur la Zone 51. Pour ce faire, ils ont étudié en détail de nombreuses cartes de la région et de ses alentours, afin de trouver un chemin détourné. Les deux motards s’élancent sur le chemin de traverse en filmant leur avancée avec des caméras embarquées.
Tandis qu’ils roulent roulent sur un chemin de terre non balisé, un 4×4 blanc les dépasse dans un nuage de poussière, deux hommes en treillis derrière le volant. Stupéfaits, les deux pilotes décident néanmoins de continuer leur route jusqu’aux panneaux interdisant d’aller plus loin. Ils font halte et c’est alors que le 4×4 blanc surgit sur la piste avant de s’arrêter. Les deux soldats en sortent en braquant leurs armes sur eux. Après les avoir fouillés sans ménagements, ils les somment de rebrousser chemin immédiatement. Loin de la Zone 51 et de ses secrets.
Couverture : Groom Lake vu du ciel.
BIENVENUE À ROSWELL, CAPITALE MONDIALE DES OVNIS
Depuis 1947, la ville de Roswell est un lieu sacré pour tous les amateurs d’OVNI. Chaque année, des milliers de personnes accourent à son festival.
Chaque été, des milliers de personnes déferlent dans la ville de Roswell, au Nouveau-Mexique. Ils viennent assister au festival annuel des OVNI, le UFO Festival. L’événement a lieu pour l’anniversaire du fameux crash de vaisseau extraterrestre que le gouvernement américain aurait cherché à passer sous silence, durant l’été 1947. Pendant quatre jours et quatre nuits, cette petite ville d’ordinaire tranquille et old fashion accueille une effusion carnavalesque de food trucks, de concours de costumes, de spectacles de son et lumière et de stands débordant de babioles en tout genre pour fanas d’extraterrestres.

Le musée de Roswell
Crédits : Gabriela Campos
Cette année, un alien de six mètres de haut se dresse sur Main Street et veille sur les festivités. Sous ses grands yeux noirs et luisants se déverse un flot régulier de visiteurs, dont bon nombre sont vêtus de costumes futuristes. Cette lente procession fait route vers le concours de costumes du samedi, organisé dans la grande salle municipale. « C’est comme Mardi Gras, mais avec des extraterrestres », résume Janet Jones, la propriétaire du Roswell Space Center. C’est l’une des six boutiques permanentes de la ville. Elle y vend toutes sortes d’objets et de vêtements en rapport avec les OVNI et les extraterrestres.
IL VOUS RESTE À LIRE 80 % DE CETTE HISTOIRE
L’article L’endroit le plus mystérieux du monde : la vraie histoire de la Zone 51 est apparu en premier sur Ulyces.