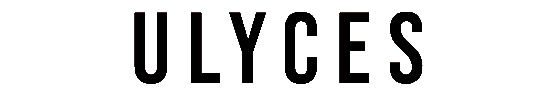15.01.2021 à 01:56
Le difficile combat de Netflix pour se faire accepter de l’industrie cinématographique
« Nous aimons vraiment les films », plaide Ryan Reynolds. « On adore ça, mais ce qu’on aime encore plus, c’est faire des films pour les fans [de cinéma ?] que vous êtes », renchérit Dwayne Johnson. Les deux stars hollywoodiennes font partie de la horde d’acteurs.trices et réalisateurs.trices qui vont rejoindre l’écurie Netflix en […]
L’article Le difficile combat de Netflix pour se faire accepter de l’industrie cinématographique est apparu en premier sur Ulyces.
Texte intégral (2465 mots)
« Nous aimons vraiment les films », plaide Ryan Reynolds. « On adore ça, mais ce qu’on aime encore plus, c’est faire des films pour les fans [de cinéma ?] que vous êtes », renchérit Dwayne Johnson. Les deux stars hollywoodiennes font partie de la horde d’acteurs.trices et réalisateurs.trices qui vont rejoindre l’écurie Netflix en 2021. Le 12 janvier, la reine des plateformes de streaming a annoncé la sortie de 71 films dans l’année, à raison d’un nouveau long-métrage par semaine.
À la faveur de la pandémie, en réponse à la multiplication des plateformes et dans l’espoir de conserver son avance sur le géant Disney+, Netflix n’a jamais autant déployé d’efforts pour se faire accepter de l’industrie cinématographique. Le chemin est long, difficile, et il reste encore bien des obstacles à surmonter pour que les studios, le public et la critique lui reconnaissent sa légitimité. Un combat qui sera peut-être gagné en 2021, ou pas.
Tapis rouge
La tapis rouge va être foulé par les plus grands noms du cinéma, la 91e cérémonie des Oscars va commencer sur les notes d’un medley de Queen, et Steven Spielberg n’a qu’un titre à la bouche : Green Book. C’est dans une véritable campagne en faveur du film de Peter Farrelly que se lance le réalisateur, auprès des 6 000 membres de l’Académie des arts et sciences du cinéma. S’il a probablement succombé au charme de cet Americana moderne, Steven Spielberg a une idée bien précise derrière la tête lorsqu’il vante ainsi les mérites de Green Book.

Crédits : Oscars
Pour le cinéaste, voter en faveur du film distribué par Universal Pictures revient surtout à voter contre Roma, le film d’Alfonso Cuarón distribué par Netflix. Car s’il y a bien un invité qui n’a selon lui pas sa place aux Oscars, c’est la plateforme de streaming, et donc son contenu. Pourtant favori pour recevoir la statuette du meilleur film, Roma s’incline effectivement face à Green Book, mais repart tout de même avec trois Oscars. Netflix n’a pas tout perdu, et cette conclusion semble insoutenable pour Spielberg, qui n’attend que quelques heures après la fin de la cérémonie pour déclarer la guerre à la plateforme.
Non content de la victoire de son protégé, Steven Spielberg s’engage ainsi fin février à évincer Netflix de toutes les cérémonies des Oscars à venir. Le réalisateur est en en effet « persuadé qu’il y a une différence entre la diffusion en streaming et la diffusion au cinéma », comme le rapporte un porte-parole d’Amblin, la société de production du cinéaste. « Il serait heureux que les autres membres du comité de l’Académie rejoigne sa campagne [contre Netflix] », précise-t-il.
Du côté de l’Académie, on confirme qu’une « discussion sur les règles d’attribution des Oscars est en cours et que le comité abordera la question lors de la réunion du mois d’avril ». Prudent sur sa stratégie de communication, Netflix ne répond à ces attaques qu’à travers un tweet, n’ayant besoin de citer personne pour se faire comprendre. « Nous aimons le cinéma. Voilà d’autres choses que nous aimons : en offrir l’accès à ceux qui ne peuvent pas toujours se permettre d’y aller, ou qui vivent dans des villes non équipées. Laisser absolument tout le monde profiter des nouvelles sorties au même moment. Donner plus de moyens aux cinéastes pour partager leur art », rétorque la plateforme le 4 mars 2019.

Concrètement, Steven Spielberg et les studios de cinéma traditionnels ont une longue liste de reproches à faire à Netflix. Le site de streaming aurait ainsi dépensé un budget faramineux dans sa campagne pour les Oscars, estimé à 50 millions de dollars, quand Green Book se serait contenté d’une somme estimée entre 5 et 25 millions. L’un des autres principaux reproches faits aux films de la plateforme est leur faible, voire inexistante, diffusion dans les salles de cinéma. Netflix ne fait pas non plus état de son « box office », et les films sont bien sûr accessibles aux 137 millions d’abonnés à tout moment. Autant d’implications qui sont synonymes de concurrence déloyale pour certains observateurs, et qui déséquilibrent le poids des films dans la course aux récompenses.
Pour d’autres, ces arguments sont infondés et frisent même l’hypocrisie, quand on sait que Jurassic Park, signé Steven Spielberg, est présent dans le catalogue Netflix depuis le 1er mars 2019, comme d’autres de ses films avant. Les chiffres du box office n’ont par ailleurs aucun impact sur les qualifications des films aux Oscars et, chaque année, des longs-métrages n’ayant bénéficié que d’une seule semaine de diffusion cinématographique sont nommés par l’Académie. Avec le développement des plateformes de streaming telles qu’Amazon Prime Video, Hulu et prochainement Disney +, certains affirment donc que ce n’est pas à ces nouveaux acteurs de s’adapter à une industrie cinématographique à la traîne, mais bien aux studios et distributeurs de se réinventer pour continuer d’exister… et pourquoi pas de les concurrencer.
Têtes d’affiche
Las de voir le monopole de Netflix s’affirmer, Disney et AT&T (le propriétaire de chaînes câblées et du studio WarnerMedia, auquel est rattaché HBO) ont annoncé leur arrivée sur le marché du streaming. Des démarrages tardifs, mais qui pourraient bien poursuivre la mue de l’industrie du cinéma. Les studios commencent ainsi doucement à vouloir récupérer leurs contenus, obligeant Netflix à trouver une parade à l’amaigrissement inéluctable de son catalogue. La volonté du site de produire plus de films et de séries apparaît dès lors comme un moyen de palier cette désaffection. Début 2019, la plateforme annonçait la production de 90 films dans l’année, avec un budget total de huit milliards de dollars. Un moyen d’assurer le renouvellement constant de son catalogue, mais aussi d’attirer de grands noms du cinéma, en mettant l’accent sur une liberté de création qu’ils ne trouveraient plus au sein des studios traditionnels.

Dans les bureaux de Netflix
Crédits : Netflix
À l’ère du binge-watching sur smartphone, où l’on n’attend plus d’être installé dans les fauteuils des salles obscures pour regarder un film, Netflix dépasse de loin les capacités de production des studios historiques tels que Warner, Disney ou la Twentieth Century Fox. Quand la plateforme de streaming annonce 90 films, Disney n’en promet que 10 et Warner 23 en 2019. Est-ce à dire qu’elle privilégie la quantité à la qualité ? Contre cette idée, le site de streaming promet au moins 20 longs-métrages « premium », avec Martin Scorsese, Steven Soderbergh, Noah Baumbach ou encore Guillermo del Toro derrière la caméra. Avec en plus 35 films de genre et 35 documentaires et films d’animation, Netflix place ses pions, produit des contenus variés, et satisfait une audience toujours plus large, « des plus petits aux grands-parents », quand les grands studios peinent parfois à financer un nombre annuel de productions bien inférieur.
« Quel grand studio aurait produit un film comme Okja, de Bong Joon-ho, qui met en scène un super-cochon et une petite-fille, avec un budget de 50 millions de dollars ? Aucun. Eux ne se préoccupent que du fait de ne pas perdre d’argent. Pas nous », affirme ainsi Ted Sarandos, responsable du contenu chez Netflix. Un argument validé par Martin Scorsese, qui a pu mettre en scène The Irishman, avec Robert DeNiro, grâce à la plateforme de streaming. « Le cinéma des 100 dernières années a disparu. Netflix sait prendre des risques et The Irishman est un film risqué. Pendant cinq ou sept ans, personne n’a voulu le financer… et on se fait tous vieux ! Netflix a pris le risque », déclarait ainsi Martin Scorsese au festival international du film de Marrakech en 2018, alors que Paramount Pictures s’était retiré du projet un an plus tôt.
Triomphe
Soutenir un film tel que Roma était ainsi pour l’entreprise de Los Gatos l’occasion de s’offrir un carton d’invitation au sein des meilleurs festivals de cinéma internationaux. Maintenant que l’œuvre d’Alfonso Cuarón a raflé trois Oscars et deux Golden Globes à Los Angeles, quatre BAFTA à Londres, un Goya en Espagne, le Lion d’Or à la Mostra de Venise, Netflix a réussi un coup qui lui permet presque de faire l’unanimité… sauf en France, où le différend qui oppose le Festival de Cannes à Roma est loin d’être artistique, mais bien économique.
L’exception française est intenable pour Netflix.
Ce récent succès a donné le signe que le site de streaming pouvait aussi soutenir un cinéma d’auteur ambitieux. Une vision que partage naturellement Cannes. Mais le festival est une institution historique qui entretient des liens plus qu’étroits avec les exploitants français. Mécontents de l’épisode cannois de 2017, les distributeurs français ont fait pression pour que l’expérience Okja et The Meyerowitz Stories ne se renouvelle pas en 2018. En compétition officielle, les deux films ne sont jamais sortis en salles, Netflix faisant fi de la réglementation française, et plaçant Thierry Frémaux, le délégué général du Festival de Cannes, dans une position extrêmement délicate. « J’ai été lourdement critiqué. J’ai failli perdre mon poste. C’était très violent », confiait-il en avril 2018, alors que la sélection officielle des films en compétition vinait d’être dévoilée, et ne faisait état d’aucun film Netflix.
Cette année-là, suite au scandale de 2017, le Festival de Cannes réclame que les studios dont les longs-métrages sont en compétition s’engagent formellement à les sortir dans les salles françaises. Une prérogative sur laquelle Netflix aurait pu céder, si elle n’impliquait pas un délai de carence de trois ans avant que les films ne puissent être diffusés sur une quelconque plateforme de vidéo à la demande, selon la chronologie des médias française. « Ils auraient pu dire : “Pas de problème, nous allons faire une exception pour le film d’Alfonso Cuarón et accepter qu’il sorte en France.” J’aurais adoré ça, et je continue à les supplier pour qu’ils le fassent. Ils seraient passés pour des héros », déplore Thierry Frémaux, bien qu’il qualifie d’ « absurde » la réglementation sur les trois ans de délai. « D’un point de vue personnel, je pense qu’il est temps de changer cela », précise-t-il.
L’exception française est intenable pour Netflix, qui ne peut se permettre de bouleverser son modèle économique en privant ses abonnés de son propre contenu. « Le Festival de Cannes a choisi de célébrer la distribution plutôt que l’art cinématographique. Nous sommes à 100 % en faveur de l’art cinématographique, comme tous les autres festivals du monde. Nous espérons qu’il va se moderniser, mais s’il choisit de rester coincé dans l’histoire du cinéma, tant pis », lâche alors, cinglant, Ted Sarandos.

OKJA, de Bong Joon-ho, premier long-métrage ambitieux de la plateforme
Si les discussions entre la plateforme et le festival sont toujours en cours, une entente parfaite sera probablement difficile à établir pour l’édition 2019, qui se déroulera du 14 au 25 mai prochains. Le Festival de Cannes pourrait exiger de Netflix qu’il ne sorte en salles que les films récompensés, ou présenter les œuvres telles que The Irishman hors-compétition, puisque la règle de la distribution en salles ne s’impose pas pour cette catégorie.
« J’aime beaucoup Ted Sarandos. Un jour, nous serons de nouveau ensemble sur le tapis rouge. Beaucoup de choses vont changer », promettait Thierry Frémaux à l’aube de l’édition 2018 du festival.
Couverture : Netflix.
L’article Le difficile combat de Netflix pour se faire accepter de l’industrie cinématographique est apparu en premier sur Ulyces.
14.01.2021 à 01:00
Voici comment le prince héritier d’Arabie saoudite change radicalement le royaume
La ville du futur verra le jour en Arabie saoudite. C’est l’engagement qu’a pris le prince Mohammed ben Salmane en annonçant la construction imminente de The Line, une ville inédite qui s’étendra sur une ligne droite de 170 km, sans rues ni voitures, et sans émissions. Pour l’économiste saoudien Mazen Al-Sudairi, « c’est une nouvelle […]
L’article Voici comment le prince héritier d’Arabie saoudite change radicalement le royaume est apparu en premier sur Ulyces.
Texte intégral (3951 mots)
La ville du futur verra le jour en Arabie saoudite. C’est l’engagement qu’a pris le prince Mohammed ben Salmane en annonçant la construction imminente de The Line, une ville inédite qui s’étendra sur une ligne droite de 170 km, sans rues ni voitures, et sans émissions. Pour l’économiste saoudien Mazen Al-Sudairi, « c’est une nouvelle ère de civilisation, un nouveau modèle pour une ville propre, convenable et sans carbone ».
The Line n’est que le dernier d’une longue série de projets innovants et d’apparentes transformations apportées au royaume par le prince héritier, depuis son arrivée au pouvoir en 2017.

The Line
L’homme pressé
Il y a des hommages dont on se passerait volontiers. Sous son foulard blanc tacheté de rouge, Mohammed ben Nayef dissimule mal la peine qu’il a, ce mercredi 22 juin 2017, à recevoir le baisemain de Mohammed ben Salmane. Par cette révérence, la couronne d’Arabie saoudite qui était promise au premier passe sur la tête de son jeune cousin, elle aussi coiffée par la traditionnelle shemagh. Le désaveu porte les habits du respect. Après deux ans et demi de règne, le roi a décidé d’écarter son neveu au profit de son fils. Malade, l’octogénaire remet les clés du royaume entre les mains d’un homme de 32 ans. Présenté comme quelqu’un de fougueux, sinon d’impétueux, le nouveau prince héritier compte bien régner sans partage.
Près de trois ans plus tard, le 7 mars 2020, le New York Times et le Wall Street Journal annoncent l’arrestation de plusieurs membres de la famille royale. Jusqu’ici placé en résidence surveillée, Mohammed ben Nayef est désormais en détention aux côtés du prince Ahmed ben Abdulaziz al Saud, qui est aussi le frère du roi Salmane. Selon une source citée par CNN, ils ont rejoint le fils du roi, Turki bin Abdullah, en prison. Autant dire que Mohammed ben Salmane (MBS) a fait le ménage autour de lui.
En novembre 2017, MBS avait fait arrêter quatre ministres, dix anciens membres du gouvernement et au moins onze princes dont Turki bin Abdullah et le milliardaire Al-Walid ben Talal, un des hommes les plus puissants du royaume. Pour assurer le succès de cette opération menée par le nouveau comité anti-corruption, le Ritz Carlton – où la famille royale à ses habitudes – a été évacué et l’aéroport privé fermé.
Plus jeune prince à diriger le pays depuis sa fondation en 1932, Mohammed ben Salmane est un « homme pressé », juge la journaliste Clarence Rodriguez. Il « ne semble pas manifester un respect excessif pour les personnages âgées de la famille », juge son confrère Olivier Da Lage. Porteur d’un projet économique libéral et ambitieux, Visions 2030, il montre un visage offensif sur la scène internationale et autoritaire en interne. Après avoir annoncé la délivrance de visas de tourisme et un assouplissement du code vestimentaire en septembre 2019, MBS a levé l’interdiction de la Saint-Valentin en février dernier. Et en pleine épidémie de coronavirus (Covid-19), il a décidé de baisser les prix du pétrole national, ce qui n’a fait qu’approfondir la déstabilisation de l’économie mondiale.
Pour ce pays ultra-conservateur, sa nomination était bien plus qu’une révolution de palais.

Salmane ben Abdelaziz Al Saoud, suivi du prince Mohammed ben Salmane
Crédits : vision2030.gov.sa
Le renouveau
Le long des autoroutes qui traversent le désert saoudien, la même pancarte revient de loin en loin. « Remercie Dieu », est-il écrit entre Médine et La Mecque, les deux villes saintes de l’islam, et jusqu’à la capitale, Riyad. Depuis l’unification des tribus de la péninsule sous le sabre de la famille Al Saoud, en 1934, chaque cérémonie de succession offre l’occasion de renouveler le pacte entre les pouvoirs politique et religieux, forgé par le fondateur de la dynastie, Mohammed Ibn Saoud, à la fin du XVIIIe siècle. La dernière intronisation ne fait pas exception.
Lors de son arrivée sur le trône, le roi Salmane s’est posé en garant de la pérennité du régime. « Nous resterons, avec la force de Dieu, sur le chemin droit que cet État a suivi depuis sa création par le souverain Abdel Aziz ben Saoud et par ses fils après lui », déclare le sixième de la lignée à la mort de son frère, Abdallah, en janvier 2015. À peine trois mois plus tard, il renverse pourtant l’ordre de succession en privant son demi-frère, Moukrine, du statut de prince héritier au profit de son neveu, le ministre de l’Intérieur Mohammed ben Nayef (MBN).
Nommé ministre de la Défense, son fils, Mohammed ben Salmane (MBS), arrive en deuxième place. MBS « est l’homme de confiance de son père », remarque le journaliste de RFI Olivier Da Lage, auteur du livre Géopolitique de l’Arabie saoudite. « Quand il était gouverneur de Riyad (de 1955 à 1960 et de 1963 à 2011) puis lorsqu’il est devenu ministre de la Défense (2011-2015) et enfin prince héritier (2012-2015), Salmane a nommé son fils chef de cabinet. » Une fois au pouvoir, il en fait un ministre de la Défense aux attributions élargies. À ce poste, le jeune homme engage l’armée saoudienne au Yémen afin de contrer la rébellion houthiste qui s’y déploie avec l’aide de l’Iran. Cette opération, « Tempête décisive », coalise l’Égypte, la Jordanie, le Soudan, le Maroc et les membres du Conseil de coopération du Golfe (Oman excepté).

Mohammed ben Nayef
Alors encore numéro 2 et prince héritier, le « Monsieur sécurité » du royaume donne son accord à l’intervention. Fils d’un ancien ministre de l’Intérieur, MBN lui a succédé en 2012, après des formations auprès du FBI et de Scotland Yard. Réputé pour sa participation au démantèlement de groupes terroristes et sa politique de réinsertion de djihadistes, il est aussi connu pour son travail de sape de l’opposition. En 2011, « Ben Nayef est intervenu pour éviter que le Printemps arabe ne souffle en Arabie saoudite », résume Clarence Rodriguez, journaliste française qui a passé 12 ans dans le pays, auteure du livre Révolution sous le voile.
Il apporte aussi tout son soutien à la répression meurtrière employée par le gouvernement du Bahreïn contre les contestataires. Depuis, le blogueur Raif Badawi croupit en prison, de même qu’Ali Mohammed al-Nimr, condamné à mort pour avoir participé à des manifestations dans l’est du pays. Son oncle, le clerc chiite Nimr Baqr al-Nimr passe par l’épée en janvier 2016. En réaction, l’ambassade d’Arabie saoudite en Iran est incendiée, ce qui entraîne la rupture des relations diplomatiques entre les deux États. « Comment avoir un dialogue avec un régime basé sur une idéologie extrémiste ? » se défend MBS, en qualité de ministre de la Défense du si modéré royaume wahhabite…
Ce conflit ouvert n’arrange rien. Pour ne pas céder des parts de marché à son rival, Riyad maintient le volume de sa production de pétrole, ce qui a pour effet d’entraîner le prix du baril au-dessous des 35 dollars. Une situation difficilement tenable puisque plus de 70 % des revenus proviennent de l’or noir. En avril, Ben Salmane présente son projet « Visions 2030 » pour diversifier et réformer l’économie saoudienne sur un modèle « thatchérien ». L’annonce crée quelques remous dans un pays où 3 des 5,5 millions d’employés seraient fonctionnaires.

Crédits : CEDA
Vision 2030
L’Arabie saoudite est construite sur des sables mouvants. Garantes de sa prospérité, les énormes réserves de pétrole découvertes dans les années 1930 ont une valeur qui fluctue en fonction des prix du marché. Voilà bientôt trois ans qu’ils sont bas. Mais l’érosion de cette manne essentielle au fonctionnement de l’État est surtout due à une lame de fond : la croissance démographique. Alors qu’il n’utilisait que 5 % de sa production dans les années 1970, le pays en consommait 25 % en 2012. En seulement cinq ans, de 2008 à 2013, la part du brent vendu à l’étranger est passée de 93 % à 84 % du total des exportations. Aujourd’hui, « 65 % de la population a moins de 25 ans », souligne Clarence Rodriguez. Si bien qu’à rythme d’extraction constant, le pays pourrait devenir importateur de pétrole d’ici 2037. Il ne restera alors plus rien des 2 000 milliards de dollars de revenus puisés dans le sol entre 1973 et 2002.
Pour récolter la même somme, le plan Vision 2030 envisage de vendre 5 % des actifs de Saudi Aramco, la compagnie nationale d’hydrocarbures. Sa supervision est assurée par MBS en qualité de président du Conseil des affaires économiques et de développement. « La question de la privatisation de va pas de soi », tempère Olivier Da Lage. « La date d’introduction en bourse du capital est repoussée en permanence. » Clarence Rodriguez invite aussi à la prudence : « Ça paraît compliqué de vendre alors qu’on parle de pénurie du pétrole à venir. Est-ce que vous investiriez sachant que dans quelques dizaines d’années il y aura une raréfaction ? »
Par ailleurs, tous les membres de la famille royale ne sont pas convaincus de l’intérêt de la cession d’une partie de ce fleuron national qui concourt pour 45 % à la richesse du Royaume. Face à la chute des cours, le régime s’était déjà lancé, fin 2015, dans un « plan de transformation nationale » à même d’éviter l’assèchement de son budget. Ayant dû ponctionner 700 milliards dans ses réserves pour couvrir ses pertes au printemps, il avait engagé des mesures comprenant le rapatriement d’avoirs investis à l’étranger, la suspension de chantiers d’infrastructures, et le gel des embauches ainsi que des promotions.
Des coupes sombres avaient également été données dans les subventions de l’eau, de l’électricité et de l’essence, dont les prix ont sensiblement augmenté. « Cette population qui était sous perfusion étatique l’est aujourd’hui beaucoup moins », observe Clarence Rodriguez. « On lui demande de se serrer la ceinture alors que la guerre du Yémen coûte quasiment sept milliards par mois. » Or, et la guerre et l’austérité vont se poursuivre.

Des jets saoudiens au-dessus du Yémen
Crédits : Hassan Ammar/AP
Le plan Vision 2030 « a été rédigé par des cabinets de consultants occidentaux », signale Olivier Da Lage. Pour réduire la dépendance de l’État à sa ressource fossile, il parie sur une industrie minière jusqu’ici délaissée et le développement des énergies renouvelables. Le pays assure qu’il couvrira 10 % de ses besoins énergétiques grâce aux éléments d’ici 2023. En parallèle, la construction d’un nouvel aéroport et d’une route entre Médine et La Mecque devrait participer au doublement du nombre de touristes.
Ces projets s’accompagneront d’une « diminution du nombre de fonctionnaires, des subventions et des allocations diverses ainsi que d’une privatisation des entreprises d’État », selon Olivier Da Lage. Des sacrifices qui auront d’autant plus de mal à passer que, si la famille royale mène grand train, c’est loin d’être le cas de tous. Sur le million d’emplois créés dans le secteur privé entre 2004 et 2014, beaucoup sont occupés par des étrangers. En octobre 2016, l’achat d’un yacht de 500 millions de dollars par le prince Ben Salmane a fait des vagues. « Le mécontentement de la population a amené les autorités à annuler des réductions d’allocations », explique Olivier Da Lage.
Mais depuis, le roi Salmane a réduit tous les contre-pouvoirs qui semblaient pouvoir s’opposer à son fils. Afin de lui donner les coudées franches, il a ainsi remercié le ministre du Pétrole Ali al-Nouaïmi en mai 2017, en poste depuis deux décennies. « Les princes et responsables plus âgés et plus expérimentés qui auraient pu lui faire de l’ombre ont été écartés », constate Olivier Da Lage.
Délesté de certaines entraves, MBS risque d’entrer dans un rapport de force avec sa population. « La remise en cause de l’économie rentière et de l’État-providence peut potentiellement bouleverser les grands équilibres de la société saoudienne », avertit le chercheur David Rigoulet-Roze, auteur lui aussi d’un livre intitulé Géopolitique de l’Arabie saoudite. « Dans les ctrois prochaines années, si rien n’est fait, il peut y avoir une implosion », estime Clarence Rodriguez. Tout dépendra de la capacité du prince à répondre aux aspirations de la jeunesse.

Le prince Ben Salmane
Crédits : AFP/HO/MISK
Une jeune voix
Plus à l’aise que Donald Trump lors de la danse du sabre, le roi Salmane était moins en verve pendant le reste de la visite du président américain à Riyad, en mai 2017. S’aidant d’une canne pour marcher, l’homme de 81 ans est apparu fatigué. « Son discours n’était pas très audible », se souvient Clarence Rodriguez. Tout le contraire de celui de son fils, dont la voix porte dans le monde. En mars 2017, il s’était rendu aux États-Unis pour préparer la venue de Trump. « Il avait aussi rencontré Vladimir Poutine et François Hollande, à une époque où il ne cachait pas, en privé, vouloir devenir roi », confie la journaliste. Même s’il parle très mal l’anglais, le prince « a donné des interviews à la presse occidentale – ce qui n’est pas très habituel pour les dirigeants saoudiens », pointe Olivier Da Lage. «Ilse présente comme l’incarnation de la modernité, de l’avenir de l’Arabie saoudite. »
En 2016, MBS a conseillé à son père de donner moins d’importance aux oulemas, c’est-à-dire aux théologiens du royaume. Sa nomination est néanmoins intervenue un jour de fête religieuse, une manière de leur donner des gages. « Pour diriger le pays, il faut parvenir à un consensus entre les responsables religieux, les tribus et les hommes d’affaires », indique Clarence Rodriguez. « Il a besoin de l’islam pour asseoir son autorité, c’est l’ADN du pays. » Le pouvoir de la Mutawa, la police religieuse, a été considérablement réduit la même année. Ses officiers « ne peuvent plus arrêter ou détenir des personnes, ni demander leurs cartes d’identité, ni les suivre ».
Selon des témoignages, certains n’hésitaient pas à porter des coups aux femmes en raison de leur tenues. Celles-ci ont désormais le droit de tenir un volant et ont pu voter et se présenter aux élections municipales de 2015. Mais seules 20 candidates ont été élues sur les plus de 2 000 sièges à pourvoir. En mai 2017, le roi a émis un décret autorisant les femmes à se passer de l’autorisation de leur « tuteur » pour voyager, étudier et avoir accès à certains soins. Un aval est toujours indispensable dans l’optique de se marier, porter plainte, travailler, consulter un médecin.

Riyad devra incarner le futur du pays
Pour modéré qu’il soit, le changement « va très vite aux yeux des caciques », relativise Clarence Rodriguez, qui précise par ailleurs que MBS « ne peut pas balayer toute son éducation conservatrice ». Une indication sur les changements à venir sera donnée par son implication dans la Commission de la condition de la femme des Nations unies dont l’Arabie saoudite est membre jusqu’en 2022. Il s’est en tout cas engagé à faire passer de 22 à 30 % le taux de femmes parmi les travailleurs en 15 ans.
Autre illustration de cette politique des petits pas, un concert dans la capitale, en mars 2017, a été autorisé par le pouvoir pour la première fois depuis trente ans. Il fallait toutefois être un homme pour s’y rendre. Deux mois plus tard, lors du remaniement gouvernemental, un ministère du Divertisement a été créé, pavant le chemin à des spectacles de théâtre ou des projections de cinéma, toujours interdits. Si cet élan venait à se conforter, il serait « plutôt une bonne chose pour la jeunesse qui ne voit pour l’heure son salut que sur les réseaux sociaux », considère Clarence Rodriguez.
Aussi, le prince jouit-il d’une bonne réputation auprès des jeunes, ternie par la détérioration de l’économie. « Certains l’idolâtrent, d’autres doutent », dit la journaliste. « Vous avez presque 30 % de chômage dans la jeunesse. » Maintenant qu’il s’est mis une partie des dignitaires religieux à dos et que la guerre au Yémen s’enlise de façon catastrophique dans les affres de la famine et du choléra, le futur souverain n’a pas le droit à l’erreur. « S’il vient à apparaître faible, tout le monde lui tombera dessus », prévient Olivier De Lage.
Conscient de ne pas faire l’unanimité, Mohammed ben Salmane est donc en train d’écarter les hommes de pouvoirs qui pourraient entraver ses plans. Le prince Al-Walid ben Talal est visiblement de ceux-là. Après avoir participé à l’acquisition du Plaza Hotel new-yorkais de Donald Trump, le milliardaire s’en était pris, en décembre 2015 au futur président américain en le traitant de « honte pour les États-Unis. » À quoi, l’intéressé avait répondu : « Ce crétin de Ben Talal veut contrôler nos politiciens américains avec l’argent de papa. Il ne pourra pas le faire quand je serai élu. » Le cas échéant, Trump a développé de bonnes relations avec MBS. Et, en octobre 2017, trois officiels de la Maison Blanche, dont le gendre du chef d’État, Jared Kushner, ont été vus en Arabie Saoudite. À croire que Washington ne voit pas d’un mauvais œil la montée en puissance du nouvel homme fort.
Ces signes d’ouverture ne sont pas synonyme de démocratie, comme en atteste le meurtre du journaliste Jamal Khashoggi en 2018. Depuis, tandis que le pays annonçait la délivrance inédite de visas de tourismes et un assouplissement du code vestimentaire, plus de 30 opposants ont été arrêtés selon les chiffres de l’association Human Rights Watch. « Mohammed ben Salmane a permis la création d’un secteur des loisirs et a autorisé les femmes à voyager et à conduire, mais sous sa supervision, les autorités saoudiennes ont également emprisonné un grand nombre des principaux intellectuels et activistes réformistes du pays, dont certains avaient précisément milité en faveur de ces changements », a déclaré Michael Page, directeur adjoint de la division Moyen-Orient à Human Rights Watch, en novembre 2019. « Une Arabie saoudite réellement réformiste ne soumettrait pas ses principaux activistes à des actes de harcèlement, à la prison et aux mauvais traitements. »
Début mars 2019, en pleine campagne d’arrestations, l’Arabie saoudite a décidé d’augmenter sa production de pétrole en pleine crise économique. Alors que l’épidémie de coronavirus (Covid-19) faisait plonger les bourses mondiales, la mesure a entraîné une baisse du cours de brut de 30 %. Riyad préservait ainsi ses parts de marché au détriment des grandes compagnies pétrolières, qui voyaient leurs valeurs dévisser. Pour Mohammed ben Salmane c’était là-encore un moyen d’affirmer la puissance de sa stratégie résolument offensive.
Couverture : Riyad, de nuit. (Ulyces.co)
L’article Voici comment le prince héritier d’Arabie saoudite change radicalement le royaume est apparu en premier sur Ulyces.
12.01.2021 à 07:16
Ces nanorobots vont peut-être vaincre le cancer
Robots autonomes Dans les laboratoires de l’Institut Max-Planck, à Stuttgart, des mouvements minuscules font avancer la science à grand pas. Mercredi 20 mai, les chercheurs allemands ont présenté un robot microscopique qui ressemble à un leucocyte. Produit dans la moelle osseuse, ce globule blanc qui circule dans le sang joue un rôle primordial dans la […]
L’article Ces nanorobots vont peut-être vaincre le cancer est apparu en premier sur Ulyces.
Texte intégral (1250 mots)
Robots autonomes
Dans les laboratoires de l’Institut Max-Planck, à Stuttgart, des mouvements minuscules font avancer la science à grand pas. Mercredi 20 mai, les chercheurs allemands ont présenté un robot microscopique qui ressemble à un leucocyte. Produit dans la moelle osseuse, ce globule blanc qui circule dans le sang joue un rôle primordial dans la défense de l’organisme face aux infections. En copiant la forme, la taille et les capacités du leucocyte, le nanorobot pourrait révolutionner les traitements de certaines maladies, et même guérir des cancers.
Pour cela, le nanorobot va naviguer directement dans les couches profondes des tissus de l’organisme, comme seul le leucocyte en est capable. Il accédera ainsi à des chemins actuellement hors d’atteinte, explique Metin Sitti, directeur du département des systèmes intelligents de l’Institut Max-Planck. Grâce à ses propriétés magnétiques, le robot peut être téléguidé par les scientifiques une fois propulsé dans les vaisseaux sanguins. Élaboré à partir de micro-particules de verre, l’appareil a un diamètre de 8 micromètres. D’un côté, il est recouvert d’une fine pellicule de nickel et d’or, tandis que l’autre face est dotée de molécules spécifiques qui peuvent reconnaître et combattre des cellules cancéreuses.
« Grâce aux champs magnétiques qu’ils utilisent, nos nanorobots peuvent naviguer à contre-courant dans un vaisseau sanguin artificiel, ce qui est difficile vu la puissance du flux sanguin et l’environnement rempli de cellules. Nos robots peuvent aussi reconnaître des cellules cancéreuses de façon totalement autonome, grâce à leur revêtement qui leur permet de libérer des molécules spécifiques tout en étant en mouvement », explique Yunus Alapan, chercheur et auteur de l’étude. Jusqu’ici, les nanorobots ont permis d’identifier et de localiser plusieurs cancers dans des organismes artificiels.

En 2018, des chercheurs de l’université de l’Arizona avaient déjà développé des nanorobots capables de détruire les tumeurs cancéreuses. L’étude avait permis de tester l’efficacité d’un système robotique autonome sur des souris ayant développé un cancer du sein, de l’ovaire, du poumon ou du mélanome. Le but était d’interrompre le flux sanguin en direction des tumeurs afin de les affaiblir à l’aide d’une protéine responsable de la coagulation sanguine : la thrombine.
Les nanorobots ont provoqué des lésions tissulaires sur les cellules tumorales dans les 24 h après l’injection, sans altérer les tissus sains. L’organisme a ensuite éliminé la tumeur naturellement, mais au bout de trois jours, tous les vaisseaux tumoraux présentaient un thrombus (caillot) qu’il fallait ensuite retirer. La méthode a donc de bonnes chances de fonctionner chez l’être humain mais les chercheurs allemands pensent avoir trouvé une meilleure solution.
Les limites de l’infiniment petit
Le secteur des nanorobots charrie autant d’espoirs que de dollars. En République tchèque, le directeur de l’Institut de technologie et de chimie de Prague Martin Pumera a déjà levé 11,5 millions d’euros dans le développement de nanorobots. Sa société, Advanced Functional Nanorobotics, espère pouvoir traiter de nombreuses maladies, incluant les problèmes de fertilité, grâce à ses robots tueurs de cancers dont l’efficacité a déjà été prouvée sur des souris. En France, la start-up Eligo Bioscience a levé près de 25 millions d’euros depuis sa fondation en 2014. Cela lui a permis de développer un robot d’une taille de 40 nanomètres, capable de cibler et de tuer certaines souches spécifiques d’une bactérie dans l’intestin. Il s’y connecte puis leur injecte de l’ADN afin de les annihiler.
Si ces sociétés on tout intérêt à vanter leurs solutions révolutionnaires, les scientifiques font preuve de prudence. À l’Institut Max-Planck de Stuttgart, ils prennent quelques pincettes pour évoquer l’efficacité des nanorobots. S’ils ont pu repérer leurs appareils dans des vaisseaux sanguins artificiels grâce à des microscopes, et les guider en utilisant des bobines électromagnétiques, « la résolution des technologies d’imagerie clinique n’est pas assez développée pour traquer les micro-robots à l’intérieur d’un organisme humain », explique Ugur Bozuyuk, coauteur de l’étude. Un seul robot ne serait du reste pas suffisant pour traiter une infection et il faudrait donc en contrôler un multitude pour que l’effet thérapeutique soit suffisant. « Nous en sommes encore loin », reconnaît Ugur.
Pour le moment, les micro-robots ne sont capables de circuler qu’à travers certains tissus faciles d’accès comme l’œil ou le tube digestif. L’environnement y est moins hostile que dans les vaisseaux, où le flux sanguin peut perturber le travail de ces appareils. Or pour atteindre des zones plus profondes de l’organisme, il n’y a qu’un seul chemin : la circulation sanguine, où les capacités de mouvement des robots sont plus restreints.

Les équipes d’Eligo
Ces problèmes ne paraissent pas insurmontables à Martin Pumera et Xavier Duportet, le PDG d’Eligo. Le premier rêve d’un « porteur de médicaments qui traque les cellules malades et, lorsqu’il les atteint, libère des traitements, s’auto-détruit et disparaît. Vous utiliserez mille fois moins de médicaments et limiterez les effets secondaires avec une meilleure qualité de vie des patients soignés. » Le procédé serait le même du côté d’Eligo : « Nos nanorobots pourraient être emballés dans des pilules et être délivrés dans le système digestif où ils pourront bouger librement pour se connecter à la bactérie ciblée », explique Xavier Duportet.
De la même manière, un nanorobot capable de se mouvoir dans les vaisseaux sanguins pourrait approcher une cellule cancéreuse afin d’y injecter de quoi la tuer. Une équipe de chercheurs saoudiens et espagnols vient de montrer comment les tumeurs pouvaient être détruites par un minuscule fil de fer qui dissémine un médicament anti-cancer tout en perforant la membrane de leurs cellules. Ce n’est donc plus qu’une question de temps avant que ces scientifiques saoudiens, espagnols, allemands, américains, français ou tchèques ne trouvent un moyen d’appliquer leur procédé à l’être humain.
Couverture : Shutterstock
L’article Ces nanorobots vont peut-être vaincre le cancer est apparu en premier sur Ulyces.
08.01.2021 à 00:44
Les secrets de l’école qui forme les futurs Jeff Bezos et Elon Musk
La scène Dans le hall de Corus Quay, le long d’un mur végétal, un parterre d’étudiants attend impatiemment, assis sur une pelouse artificielle. Derrière eux, par les murs transparents de ce grand bloc de vitres, on peut voir les quais de Toronto, au bord du lac Ontario. À droite d’un toboggan en spirale blanc, Nadeem […]
L’article Les secrets de l’école qui forme les futurs Jeff Bezos et Elon Musk est apparu en premier sur Ulyces.
Texte intégral (2905 mots)
La scène
Dans le hall de Corus Quay, le long d’un mur végétal, un parterre d’étudiants attend impatiemment, assis sur une pelouse artificielle. Derrière eux, par les murs transparents de ce grand bloc de vitres, on peut voir les quais de Toronto, au bord du lac Ontario. À droite d’un toboggan en spirale blanc, Nadeem Nathoo monte soudain sur scène, déclenchant une salve d’applaudissements. En ce mois de mai 2018, le directeur du TKSummit souhaite la bienvenue à « des gens de Google, Microsoft, la NASA, Instagram, Facebook, Tesla, ou encore Oculus. Nous avons de la chance car cela n’arrive nulle part ailleurs dans le monde ». Les yeux des adolescents brillent. Après lui, ce sera leur tour de prendre le micro.

Ananya contrôle un robot par la pensée
Crédits : Ananya Chadha
Malgré leur jeunesse, les élèves de la Knowledge Society parlent savamment d’intelligence artificielle, de voitures sans conducteur, de réalité virtuelle, d’édition génétique, de cryptomonnaies ou d’exploration spatiale. À 14 ans, Sabarish Gnanamoorthy est non seulement le plus jeune développeur de casques HoloLens soutenu par Microsoft, mais il figure aussi parmi les dix acteurs de la réalité virtuelle à suivre selon le site VeeR. Un autre élève, Andrew Been, prétend avoir construit un modèle réduit de réacteur nucléaire dans son garage. Il n’a que 12 ans. Leur aîné, Tommy Moffat, 17 ans, se passionne pour les calculateurs quantiques.
Certains, comme Ananya Chadha, ont encore un appareil dentaire. Pour commencer sa présentation, déjà rompue à l’art du storytelling, la jeune fille raconte une anecdote de sa prime jeunesse. « Je me souviens que quand j’avais neuf ans, j’ai vu le film Mathilda. Ça parle d’une petite fille super intelligente qui peut contrôler des objets à l’aide de son cerveau. » Dès la projection terminée, la Canadienne a essayé de déplacer un stylo sans le toucher pendant 20 minutes. Rien n’a bougé. Il lui a fallu attendre l’âge de 16 ans pour réaliser le tour.
« Prochaine diapo », demande-t-elle, sur quoi on lui apporte une télécommande. Ça, elle ne sait pas encore le maîtriser par la pensée. En revanche, la vidéo projetée à l’écran la montre en pleine séance de magie. Reliée à un ordinateur par des câbles, des électrodes fixées sur son crâne, elle fait avancer une petite voiture téléguidée sans bouger. La salle applaudit. Une fois descendue de scène, parée pour un entretien individuel, la jeune femme brune de Toronto s’épanche sur d’autres prouesses. Elle a aussi utilisé l’outil d’édition génomique CRISPR-Cas9 pour traiter des maladies chez les souris, et a étudié la blockchain ainsi que la réalité augmentée. Elle est capable d’expliquer simplement ces différentes technologies. Pourtant, relativise Navid Nathoo, « elle avait peur de parler aux gens » il n’y a pas si longtemps. C’est sa rencontre avec lui, au sein de la Knowledge Society, qui l’a transformée.

Crédits : Ananya Chadha
Fondée en mai 2016 par Navid Nathoo et son frère, Nadeem, cette école qui n’ouvre que le week-end « forme des jeunes gens de 13 à 17 ans à devenir leur être optimal », explique Navid. Venus de l’univers des start-ups et de la finance, ils ont eu l’idée d’appliquer leurs schémas à l’enseignement. Ainsi, la Knowledge Society est un incubateur de personnes plutôt que d’entreprises, une pépinière de jeunes talents plutôt que de jeunes pousses. « Au lieu d’essayer de lancer des sociétés qui vaudront des milliards de dollars, elle tente de former les gens qui créeront ces sociétés », résume Ananya Chadha. « Ils veulent refondre le système éducatif. Ça a changé ma vie. »
Ravi de ce satisfecit, Navid Nathoo considère néanmoins qu’il reste beaucoup à faire. Il voit plus grand. Avec l’argent récolté par la vente de sa start-up, Airpost, au géant de l’informatique Box, en 2015, il ne souhaite pas simplement aider des adolescents à développer leur potentiel. L’objectif est surtout – vaste programme –, de « résoudre les problèmes les plus importants au monde ». Pour cela, le vingtenaire a besoin de lever un bataillon de super-entrepreneurs sur le modèle de Steve Jobs ou Elon Musk, dont le succès s’est selon lui construit « en dépit du système éducatif ». Navid et son frère sont convaincus qu’un pas de côté mène aux meilleures idées. Et ils ont des raisons de le croire.
Exil
Tout le monde n’aime pas la Knowledge Society autant qu’Ananya Chadha. Certaines écoles apprécient son travail. Mais pour nombre de professeurs, le cursus classique prime sur ces cours facultatifs, qui ne sont pas reconnus par le ministère de l’Éducation canadien. Pire, des établissements n’hésitent pas à sanctionner leurs élèves s’ils sont absents à cause d’une activité en lien avec cette deuxième école, comme à l’occasion d’une conférence donnée au Web Summit. D’après Navid Nathoo, il y a une véritable inertie dans l’enseignement moderne, tandis que l’univers des start-ups est en perpétuelle ébullition. Les diplômés d’aujourd’hui savent pondérer le risque, moins optimiser le succès, juge-t-il : « Avec mon frère, nous cherchons toujours le meilleur scénario, pas à éviter le pire. Ça vient de nos parents. »

Nadeem et Navid Nathoo
Crédits : TKS
Ces derniers ont grandi dans des pays africains limitrophes, sans jamais s’y croiser. Tous deux ont été contraints à l’exil. Originaire d’Ouganda, la mère de Navid et Nadeem a dû fuir le régime fou d’Amin Dada. Par chance, elle suivait les préceptes de l’ismaélisme, un courant de l’islam chiite dont les membres étaient aidés par la riche famille Agha Khan. Sans cela, elle n’aurait jamais pris d’avion pour Vancouver. Le maire actuel de la ville de Calgary, Naheed Nenshi, a aussi bénéficié de ce soutien. Lui était originaire de Tanzanie, comme le père de Navid. Mais ce dernier a emprunté un chemin plus sinueux. Dépossédé de ses terres par une nationalisation, il a atterri en Angleterre avant d’avoir 15 ans. Privé de lycée, l’adolescent travaillait comme contrôleur aérien la nuit et vendait du pain le jour. Il fallait au moins ça pour aider deux sœurs et autant de frères.
Après avoir racheté la boulangerie où il travaillait, le père Nathoo décide de lancer son entreprise au Canada, où il rencontre sa femme. Elle aussi a dû mettre un terme à ses études prématurément, à l’université, pour aider ses proches. « Ils n’ont pas de diplômes mais sont très intelligents », observe Navid. « Ils m’ont transmis leur ténacité, leur persévérance, cet état d’esprit peu conventionnel. Ils ont eu du succès en dépit des conventions. C’est aussi le cas d’Elon Musk et Steve Jobs. » Afin d’éviter les sentiers battus et de suivre les préceptes altruistes des Agha Khan, le jeune homme quitte Calgary aussi souvent que possible. Son frère et lui se rendent au Bangladesh pour aider à la mise en place de micro-crédits, puis au Tadjikistan, afin de développer l’éducation dans les régions montagneuses situées dans le nord du pays.
Voilà pour les excentricités. Car à côté de ces expériences hors du commun, les deux frères étudient le commerce. « Il est difficile d’avoir un impact sans comprendre les chiffres », justifie Navid. Ça tombe bien, ils n’ont guère de secret pour lui. Pendant que Nadeem entre dans la grand cabinet de conseil McKinsey, Navid fait de son entreprise, Airpost, un spécialiste reconnu de la sécurisation des données hébergées sur le cloud pour les professionnels. À son rachat par Box, l’homme d’alors 25 ans devient responsable d’une équipe composée d’anciens étudiants de Stanford, Berkeley, Harvard, du MIT et d’autres grandes universités. Mais comme l’expérience de ses parents le lui a appris, « un diplôme ne garantit pas le succès et ne définit pas l’intellect ».
Dopamine
Le Bangladesh a vu passer Ananya Chadha avant Navid Nathoo. Elle arrivait alors du Bahreïn et s’apprêtait à continuer un long périple, faisant étape à Madagascar, au Vietnam et à Dubaï pour finalement arriver au Canada à l’âge de trois ans. Elle avait alors déjà vu beaucoup de choses, au gré des déplacements de ses parents. Son père participait à la mise en place d’usines de vêtements dans différents pays. Et parce qu’elle travaillait pour une multinationale dotée de bureaux partout dans le monde, sa mère était elle aussi très mobile. Pourtant, la famille serait arrivée sans grandes ressources à Toronto. « Nous n’étions pas riches, mais mes parents m’ont porté beaucoup d’attention », raconte Ananya. « Eux-mêmes en avaient reçu dans leur enfance. »

Démonstration à la TV
Pour faire plaisir à leur fille unique, nouvelle venue à Toronto, les parents d’Ananya Chadha l’inscrivent à diverses activités. Elle s’essaye à la gymnastique, au skateboard, au ski, au chant, à la danse, aux échecs, aux maths ou encore à la natation. Dès que l’ennui la guette, la jeune Indienne est libre de s’arrêter, et elle ne s’en prive pas. Finalement, les sciences restent toujours dans le paysage. « Je n’ai jamais été exceptionnelle en sport », explique-t-elle. « Je n’étais pas mauvaise mais pas extraordinaire. En revanche, au CE1, j’étais capable de faire de longues divisions alors que mes camarades en étaient encore aux additions. » Ananya trouve là un moyen de se faire remarquer. Elle confie même avoir reçu « un afflux de dopamine » dû à la reconnaissance de sa qualité.
À 12 ans, la spécialiste des maths rejoint une colonie de vacances consacrée aux sciences à Toronto. Elle est complètement fascinée par les maquettes et autres réalisations qu’on lui demande de faire. Son intérêt pour les cours d’aéronautique est tout aussi aigu. Le simple fait de devoir trouver la forme optimale à donner à un avion en papier la réjouit. « J’ai toujours aimé faire des choses, les partager et avoir de la reconnaissance. OK, c’est un peu égoïste, mais bon j’imagine que c’est comme ça que fonctionne mon cerveau », sourit-elle. Souhaitant rejoindre une autre classe enseignant la théorie du vol, à 14 ans, elle en parle à son père. « Il m’a demandé s’ils me donneraient des cours de vol à proprement parler et je lui ai répondu que non. Le jour-même, nous étions à l’aéroport pour m’inscrire à un véritable cours de vol. Avec ma licence de pilote en poche à 14 ans, je me suis dit que je pouvais faire ce que je voulais. »
Alors qu’elle est en quatrième, Ananya Chadha participe à un concours scientifique. Au déjeuner, elle discute avec une neuroscientifique spécialisée dans l’étude des neuro-transmetteurs, thème qu’Ananya avait « un peu étudié ». L’enseignante lui propose alors de venir à son laboratoire. Au retour de sa première visite, l’adolescente « saute littéralement de joie » – elle y décroche un stage et la secondera dans ses recherches. Elle est sur de bons rails pour entrer à la Knowledge Society, au moment de sa création, en 2016, avec encore une fois une joie non dissimulée. « À chaque cours, une fois par semaine, on nous présente une nouvelle technologie », décrit-elle. « Si quelque chose nous plaît, on est encouragés à l’approfondir seuls. »
La deuxième partie du programme est consacrée au développement humain, pour se comprendre soi-même, et une troisième à la compréhension du monde. Ananya Chadha change. Elle se détache d’anciens amis qui ont fini par la trouver « bizarre » et passe davantage de temps avec ses camarades de la Knowledge Society. « Je me sens beaucoup plus intégrée qu’avant », assure-t-elle. « Nous avons beaucoup de choses en commun, comme notre ambition ou notre goût de l’apprentissage. » La confiance suit peu à peu.
À la fin d’un événement avec l’école, tandis qu’elle est prête à partir, Navid Nathoo l’interpelle : « Tu vas où ? Tu n’as parlé à personne. » Devant son étudiante devenue de marbre, le fondateur du projet pointe cinq participants au hasard et lui intime d’aller les voir pour se présenter. Depuis, Ananya Chadha n’a plus peur de parler. Elle confie même volontiers les « choses stupides » qu’elle a coutume de faire. « Je fais beaucoup de choses pour me sentir unique », avoue-t-elle. « Je n’ai jamais bu de soda, ni de café, je n’ai jamais mâché de chewing-gum, je mange sans sauce, et sans épice. Je veux me sentir différente. » Comme si le pas de côté était indispensable.

Elle vient en paix
Crédits : Ananya Chadha
Justement, Navid Nathoo ne reste pas en place. Développée en Amérique du Nord pour des raisons pratiques, la Knowledge Society sera exportée en 2019, promet-il. « J’étais à Dubaï la semaine dernière et je pense que beaucoup de choses intéressantes se passent là-bas », cite-t-il en exemple. « Je préfère me concentrer sur les villes où l’on parle anglais car il est plus facile d’adapter les programmes mais je reste très ouvert. » Ses étudiants les plus âgés sont déjà en stage chez des partenaires tels que Google, Microsoft, Airbnb ou Facebook. Ainsi, « nous n’avons plus seulement à croiser les doigts en attendant le prochain Elon Musk », assure-t-il. À supposer qu’Elon Musk aurait aimé la formation.
Couverture : The Knowledge Society. (TKS)
L’article Les secrets de l’école qui forme les futurs Jeff Bezos et Elon Musk est apparu en premier sur Ulyces.