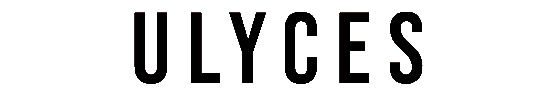03.02.2021 à 00:57
Comment on a perdu le sommeil et comment le retrouver
La tête délicatement penchée vers le micro de droite, sa longue queue de cheval légèrement balancée sur le côté, Rosalía jette tour à tour des coups d’œil rieurs à la caméra et au groupe qui l’observe dans un silence amusé. À voix basse, la chanteuse barcelonaise alterne entre les deux bonnettes noires, à tel point que […]
L’article Comment on a perdu le sommeil et comment le retrouver est apparu en premier sur Ulyces.
Texte intégral (3242 mots)
La tête délicatement penchée vers le micro de droite, sa longue queue de cheval légèrement balancée sur le côté, Rosalía jette tour à tour des coups d’œil rieurs à la caméra et au groupe qui l’observe dans un silence amusé. À voix basse, la chanteuse barcelonaise alterne entre les deux bonnettes noires, à tel point que l’auditeur·rice la sent presque tourner autour de sa tête. Les franges de diamants qui lui coulent des épaules et des bras accrochent la lumière des projecteurs et parachèvent ce tableau hypnotisant.
« Il y a un autre son que j’adore faire quand je danse », susurre Rosalía en joignant les doigts. « Le public ne l’entend peut-être pas, mais il le voit, vous savez, il le sent. » L’air concentré, elle claque des doigts d’un micro à l’autre, avant de terminer sa performance par un petit rire enchanté. En proposant dès 2016 à des célébrités de s’improviser youtubeur·euse ASMR le temps d’une vidéo, W Magazine surfait sur la popularité sur YouTube de ces « massages cérébraux », propices à la relaxation et à l’endormissement.
Les chercheurs·euses Emma Barratt et Nick Davis ont étudié ce phénomène encore méconnu et sont arrivés à la conclusion que la majorité des participant·e·s regardaient des vidéos ASMR pour se détendre ou pour dormir. Iels ont en outre observé une amélioration temporaire des symptômes liés à la dépression. En définitive, l’ASMR est symptomatique d’une partie de la population qui ne sait plus qui vers qui se tourner pour trouver le sommeil.
Pour certains toutefois, le sommeil semble être une nuisance chronophage, alors que la médecine continue à marteler ses vertus. « On ne dort pas assez, mais on pense aller bien », souligne Jöran Albers, co-fondateur de Shleep, une start-up d’experts du sommeil qui veut inciter les entreprises à prendre en compte les nuits de leurs employé·e·s. « Il y a quelques années, je bossais comme un fou et j’en étais donc le parfait exemple, puis j’ai réalisé que quelque chose n’allait pas. »

Crédits : Eight Sleep
Quatre milliards de cernes
Après avoir travaillé pendant plusieurs années au sein du cabinet international de conseil en stratégie et management Bain & Company, Jöran Albers s’est senti empreint d’une grande lassitude. Ses collègues, si intelligent·e·s et préoccupé·e·s de leur santé qu’iels fussent, ne semblaient pas heureux·euses. « J’ai démissionné et je sentais que quelque chose n’allait pas dans le monde de l’entreprise », raconte Albers au Web Summit à Lisbonne, début novembre.
Un ancien camarade de l’Institut européen d’administration des affaires (Insead) lui a alors suggéré d’entrer en contact avec Els van der Helm, une experte du sommeil, passionnée depuis l’adolescence par le sujet. Après un doctorat en psychologie à l’université de Californie à Berkeley, celle-ci a travaillé comme consultante en management pour McKinsey & Company. Le peu de considération donné au sommeil et à ses bienfaits pour les employé·e·s l’a stupéfaite. Quand sa route a croisé celle de Jöran Albers, en 2016, elle avait déjà quitté McKinsey.

Jöran Albers et Els van der Helm ont créé Shleep en 2016
Crédits : Shleep
Tou·te·s deux ont comparé leurs expériences et échangé leurs connaissances. « Au début, j’étais sceptique à l’idée de monter un business autour du sommeil », sourit Jöran Albers. « Mais on a commencé à passer en revue des recherches sur le sujet, et c’est là que j’ai réalisé que c’était un problème majeur, dont personne ne parlait, alors que cela empire chaque année. » Shleep était né.
Selon les fondateurs·rices de Shleep, le problème est toujours royalement ignoré à ce jour. « Deux milliards de personnes continuent de ne pas dormir assez », appuie Albers. Si les données sur lesquelles s’appuient Shleep sont principalement américaines, elles sont la preuve d’une situation que la start-up a décidé de globaliser : nous dormons moins en comparaison avec les décennies précédentes. D’après Shleep, près de 8 % de la population essayait de vivre avec six heures ou moins de sommeil par nuit en 1942. L’année dernière, cette part atteignait 50 %.
En outre, les jeunes sont particulièrement exposé·e·s aux troubles du sommeil. Selon une étude rendue publique en mars 2018 par l’Institut national du sommeil et de la vigilance (INSV) et la mutuelle MGEN, 82 % des jeunes entre 15 et 24 ans ont déclaré être fatigués durant la journée et 38 % ont admis dormir moins de sept heures par nuit. En outre, selon l’Inserm, 13 % des 25-45 ans considérairent le sommeil comme une perte de temps en 2017.
Pourtant, « le sommeil est crucial pour de nombreuses parties de notre corps et de notre esprit », déclare Aric Prather, scientifique du sommeil à l’université de Californie à San Francisco (UCSF), qui étudie les causes et les conséquences des nuits trop courtes. « Le sommeil est comme le lave-vaisselle du cerveau », explique Prather.

Crédits : Eight Sleep
Non seulement il renforce le système immunitaire, mais il aide à réguler le métabolisme. De plus, il sert à éliminer les toxines qui s’accumulent dans le cerveau et peut prévenir les maladies neurodégénératives, comme Alzheimer ou Parkinson. L’Inserm rappelle en outre qu’un « sommeil insuffisant chez les adolescent·e·s est corrélé à un plus petit volume de matière grise. »
Seulement, il ne suffit pas de se coucher pour se reposer. Chez les jeunes, les chercheurs·euses de l’INSV ont expliqué cette dette de sommeil à la fois par des difficultés à s’endormir et par des réveils impromptus durant la nuit. Ces troubles sont causés non seulement par une exposition intense aux écrans, mais également par un manque d’activité physique et par des rythmes décalés de sommeil entre les jours de la semaine et le week-end.
« Les raisons sont multiples », approuve Albers. « Bien sûr, la technologie joue un rôle majeur dans cette diminution. » Les écrans peuvent avoir des effets nocifs sur le sommeil. D’après une étude menée par des chercheurs de l’université d’Haïfa en 2017, une exposition intense à leur lumière bleue peut entraîner un endormissement retardé et avoir un impact sur la qualité du sommeil. « La solution doit être l’utilisation de filtres qui empêchent l’émission de cette lumière », explique Abraham Haim, l’un des auteurs de l’étude.
Albers rappelle que la plupart des êtres humains ont besoin de dormir sept à neuf heures par jour; une nuit de plus de huit heures de sommeil est par ailleurs conseillée pour les jeunes entre 15 et 24 ans. Une perte de sommeil n’est pas sans effet sur le corps humain, les études sont toutes d’accord sur ce point. Il existe bien des personnes capables de continuer à vivre normalement avec moins de six heures de sommeil mais, d’après Albers, leur nombre ne correspond qu’à 1 % de l’humanité. « Et il est inutile de vous entraîner, vous ne pouvez rien changer à cela car c’est déterminé génétiquement », poursuit le co-fondateur de Shleep.

Crédits : Matthew T Rader
Shleep vend à ses clients des plateformes de coaching du sommeil à destination de leurs employé·e·s et les accompagne dans leur déploiement. Outre l’application qui se charge de guider l’utilisateur·rice dans sa quête du sommeil, ce·tte dernier·ère dispose d’outils pouvant l’aider à se relaxer ou encore d’accès à des webinars sur différents sujets. « Nous mettons également en contact les personnes avec un expert du sommeil si leurs troubles sont importants », ajoute Albers. « Après huit semaines, on observe qu’on peut diminuer la perte de sommeil de 40 % en 8 semaines, et augmenter la qualité du sommeil de 50 % », ajoute-t-il.
Même si les bénéfices d’un sommeil plus long ne sont pas facile à mesurer, « on demande à nos clients de nous communiquer leur productivité et leur performances, avec en moyenne une amélioration notée de 15 % en 8 semaines », ajoute l’entrepreneur – car évidemment, les entreprises s’intéressent davantage au bien-être de ses employé·e·s quand celui-ci les rend plus productif·ve·s.
Shleep part du principe qu’une entreprise a tout à gagner en s’adaptant aux besoins de ses employé·e·s, que ce soit en termes d’efficacité, de bien-être au travail et de productivité. Chacun·e dispose d’une horloge biologique du sommeil différente, et c’est justement cette particularité qui intéresse une autre start-up, Eight Sleep, qui a justement mis la technologie au service du sommeil.
La tech comme antidote
Le monde de la tech n’est pas désarmé face au manque de sommeil. Puisque, selon la formule du poète Hölderlin, « là où croît le péril croît aussi ce qui sauve », Eight Sleep a créé un lit intelligent. La co-fondatrice de la start-up, Alexandra Zatarain, affirme sentir « une énorme différence » depuis qu’elle s’en sert.
« Quand nous avons commencé il y a quelques années, le concept-même de lit intelligent n’existait pas », rappelle Alexandra Zatarain, qui observe un intérêt grandissant pour les technologies du sommeil.
Aujourd’hui, Eight Sleep voit le nombre d’acteurs dans ce domaine se multiplier. Apparaissent des objets connectés (comme des couettes ou des oreillers), des applications proposant de la méditation guidée, des simulateurs d’aube pour permettre un réveil progressif, et bien d’autres solutions. « On observe le développement d’un mouvement autour du fait que le sommeil améliore la performance, qu’il est naturel, qu’il est gratuit, et que si vous arrivez à l’optimiser vous noterez des bénéfices élevés », conclut Zatarain.

Crédits : Eight Sleep
Eight Sleep est née en 2014 des troubles de sommeil de son PDG, Matteo Franceschetti, par ailleurs conjoint d’Alexandra Zatarain. À l’époque, l’ancien avocat désormais entrepreneur jonglait entre différentes entreprises et voyageait d’un bout à l’autre de la planète. Son sommeil s’en est trouvé affecté. « Il a commencé à étudier différentes solutions, comme le fait de suivre des données liées à son sommeil », raconte Zatarain.
Après avoir essayé toute une série d’applications, qui proposaient par exemple de laisser son téléphone sur son matelas, Franceschetti a réalisé qu’il y avait « un énorme décalage sur le marché ». Il s’est rendu compte « qu’il n’y avait pas de produit permettant d’analyser le sommeil d’un individu avec précision pour changer le comportement ou le facteur qui pouvait l’affecter ». L’idée du projet Eight Sleep a commencé à germer.
L’objectif originel était de pister l’état du sommeil et de collecter des données. Eight Sleep a tout d’abord planché sur la conception d’un accessoire pouvant être placé sur n’importe quel matelas : Smart Tracker, un protège-matelas à la pointe de la technologie, tentant de répliquer ce qui est réalisé au niveau médical. Voyant l’engouement suscité par son premier produit, Eight Sleep a intégré sa technologie directement dans un lit, proposant en outre à l’utilisateur·rice de suivre ses données grâce à une application.

Crédits : Eight Sleep
Le couple voulait à tout prix éviter à l’utilisateur·rice de devoir charger, brancher ou porter quoi que ce soit. « Les prototypes que nous avions faits permettaient simplement d’aller au lit pour recevoir différentes informations », ajoute Zatarain. Quatre ans après le lancement du premier produit, grâce à des capteurs logés dans le matelas, ce dernier est capable de calculer le temps total de sommeil, celui des phases de sommeil, la température du lit, la fréquence cardiaque ou encore la fréquence respiratoire. « Il s’agit une image complète de votre sommeil », résume-t-elle.
Selon Zatarain, la clé du lit est sa capacité à réguler la température. « Même les lits les plus confortables absorbent en général la chaleur du corps beaucoup plus rapidement et celle-ci ne se propage pas dans l’environnement », explique-t-elle. Cette chaleur trouble le sommeil du·de la dormeur·euse. « Vous vous réveillez plus, vous ne pouvez pas rester en sommeil profond aussi longtemps que vous le pourriez », poursuit-elle.
Avec son lit hi-tech, la start-up se targue de résoudre ce problème, car son produit phare, le matelas haut de gamme The Pod (disponible aux États-Unis pour 2 295 dollars), dispose d’une régulation de température personnalisée. Loin des outils technologiques proposés par certaines start-ups, et parce que l’innovation n’a pas toutes les réponses aux problèmes de sommeil, des spécialistes proposent également des solutions simples faciliter l’endormissement.
Loin de toute technologie
Si différentes techniques peuvent fonctionner en fonction du profil, de la méditation à la relaxation des muscles un à un, pour remédier à la dette du sommeil chez les jeunes, l’Institut national du sommeil et de la vigilance leur propose une série d’astuces, loin de toute technologie. La pratique quotidienne d’une activité physique, à raison de trente minutes par jour, est tout d’abord vivement conseillée, toutefois pratiquée entre 4 h et 8 h avant de se coucher. Selon le médecin du sport et spécialiste du sommeil Fabien Sauvet, « ceux qui font du sport s’endorment mieux et plus tôt […], les bénéfices du sport se font sentir quand les séances sont régulières ».
Selon l’INSV, il faudrait en outre « adopter des rythmes réguliers » permettant de synchroniser le rythme veille-sommeil et l’horloge biologique, « en limitant grasse matinée et sieste prolongée » et instaurer « couvre-feu digital » une heure avant de dormir, préférant des activités d’autant plus relaxantes, « comme la lecture ou la musique ». De plus, les excitants comme le café ou le thé retardant l’endormissement, l’Institut recommande de les limiter après 15 h.

La co-fondatrice de la start-up Eight Sleep, Alexandra Zatarain.
Enfin, l’environnement doit être propice au sommeil; de la lumière au bruit, rien ne doit lui nuire au cours de la nuit et maintenir une température de 19°C dans la chambre est idéal en ce sens. De plus, « le lit doit être réservé au sommeil », alerte la pneumologue Maria Pia d’Ortho pour l’INSV. « Ce type de comportement favorise l’ insomnie sur le long terme ».
Enfin, changer ses mauvaises habitudes de sommeil est un processus long qui se réalise pas à pas. « Si vous avez été vous coucher à 1 h pendant des années, il ne faut pas vous attendre à vous endormir à 21 h comme par magie », explique Albers. « Cela ne marchera pas pour tout le monde. » Pour lui, nous sommes sur le point d’entrer dans une révolution du sommeil. Pour le prouver, il tente un parallèle avec la série Mad Men, dans laquelle des publicitaires machistes aux réflexions cyniques ne travaillent jamais sans leurs clopes ou leur verre de whisky.
« Complètement normale dans les années 1960, une situation pareille serait difficilement acceptable aujourd’hui », explique Albers, qui pense entrevoir un chemin similaire pour le sommeil. « Dans 5, 10, 15 ans, on regardera en arrière en se demandant à quoi on pensait à ne dormir pas assez, car c’est la chose la plus bête qui soit. »
Couverture : Ben Blennerhassett
L’article Comment on a perdu le sommeil et comment le retrouver est apparu en premier sur Ulyces.
01.02.2021 à 00:21
À quoi ressemblera la Birmanie du futur ?
Aung San Suu Kyi a été arrêtée par l’armée birmane. C’est ce qu’affirme ce lundi 1er février le porte-parole du parti au pouvoir : la dirigeante a été placée en détention, aux côtés de plusieurs hauts représentants de la Ligue nationale pour la démocratie (NLD), et les militaires ont transféré le pouvoir à leur commandant […]
L’article À quoi ressemblera la Birmanie du futur ? est apparu en premier sur Ulyces.
Texte intégral (1868 mots)
Aung San Suu Kyi a été arrêtée par l’armée birmane. C’est ce qu’affirme ce lundi 1er février le porte-parole du parti au pouvoir : la dirigeante a été placée en détention, aux côtés de plusieurs hauts représentants de la Ligue nationale pour la démocratie (NLD), et les militaires ont transféré le pouvoir à leur commandant en chef avant de déclarer le pays en état d’urgence pour un an.
Selon Myo Nyunt, Aung San Suu Kyi serait détenue dans la capitale, Naypyidaw, et l’armée aurait organisé un véritable « coup d’État ». Une tempête soudaine qui drape l’avenir de la Birmanie un peu plus dans le flou. Pour avoir une idée de ce qui peut advenir, il faut regarder dans son passé, récent et plus lointain.
La fosse
Avec une régularité glaçante, les coups de pelles retournent la terre birmane. À côté du groupe de bouddhistes occupé à creuser, dix de leurs voisins rohingyas attendent la mort attachés les uns aux autres. En cette fin août 2017, un « nettoyage ethnique » démarre selon les Nations Unies dans l’État d’Arakan, à l’ouest du pays. Une semaine après le début de l’offensive des forces de sécurité du Myanmar, quelque 47 000 personnes ont déjà fui vers le Bangladesh voisin. À Inn Din, non loin de la frontière, dix corps sont retrouvés dans une fosse commune le matin du 2 septembre. Deux ont été battus à mort par des civils, et le reste a été tué par les balles de l’armée.
Il y avait « une tombe pour dix personnes », décrit Soe Chay, un soldat à la retraite de la communauté bouddhiste du village qui dit avoir été témoin de cet affreux enterrement. D’après lui, les soldats ont tiré sur chaque homme deux ou trois fois. « Alors qu’ils étaient inhumés, certains faisaient encore du bruit, d’autres étaient déjà morts. » Son témoignage a été recueilli par deux journalistes birmans de l’agence Reuters, Wa Lone et Kyaw Soe Oo. Au moment de la parution de leur article, en février 2018, 690 000 Rohingyas ont fui. Il ne reste aucun des 6 000 membres de cette communauté à Inn Din, mais le duo est parvenu à mettre un visage et un nom sur les dix hommes enterrés. Ils s’appelaient Abul Hashim, Abdul Malik, Nur Mohammed, Rashid Ahmed, Habizu, Abulu, Shaker Ahmed, Abdul Majid, Shoket Ullah et Dil Mohammed.
Lorsque le monde les découvre, Wa Lone et Kyaw Soe Oo croupissent en prison. Arrêtés le soir du 12 décembre, ils ont été transportés vers un centre d’interrogatoire avec des cagoules noires sur le visage. D’après leurs témoignages, ils ont été privés de sommeil pendant trois jours et Kyaw Soe Oo raconte avoir été forcé à rester à genoux trois heures durant. La police nie. Puis, un an et un jour après la découverte de la fosse d’Inn Din, les reporters sont condamnés à sept ans de prison par un tribunal de Yangon (ex-Rangoun). La justice les accuse notamment d’avoir été en possession de « documents confidentiels » pouvant être utilisés par « des ennemis de l’État et des organisations terroristes ». Au cours de l’enquête, un témoin a raconté avoir vu la police glisser des documents sur eux pour leur tendre un « piège ».
Mardi 7 mai 2019, après plus de 500 jours de détentions ponctués par une campagne internationale en leur faveur, Wa Lone et Kyaw Soe Oo ont finalement été libérés dans le cadre d’une procédure d’amnistie. Encerclé par une nuée de confrères à sa sortie de prison, le premier a déclaré avoir « hâte de retourner à la rédaction » et de « revoir [s]a famille et [s]es collègues ». La tâche devrait lui être facilitée par le prix Pulitzer qu’il a reçu avec son collègue pour l’enquête sur Inn Din. Célébrés par l’Unesco, les deux hommes figurent aussi parmi les personnalités de l’année 2018 du magazine Time. Et la grâce qui leur a été accordée marque « un pas vers une plus grande liberté de la presse et un signe de l’engagement du gouvernement en faveur de la transition démocratique en Birmanie », se félicitent les Nations Unies.
Toutes les barrières ne sont néanmoins pas levées pour que la Birmanie emprunte un chemin démocratique, loin s’en faut. Selon l’Assistance Association for Political Prisoners, 25 prisonniers politiques sont encore derrière les barreaux et 283 autres attendent un jugement. L’association en faveur de la liberté d’expression Athan déplore du reste que 173 affaires de diffamation soient passées devant les tribunaux en vertu d’une loi votée en 2013 qui est utilisée pour « étouffer les critiques des autorités de la part des journalistes et des citoyens », juge l’ONG Human Rights Watch. Or, 140 de ces procès ont été ouverts sous le gouvernement d’Aung San Suu Kyi, une Prix Nobel de la paix au pacifisme aujourd’hui bien relatif.
Étrangère aux affaires
L’exode birman n’en finit plus. Au Bangladesh voisin, où 700 000 personnes ont afflué depuis le 25 août 2017, il y avait déjà près de 26 000 réfugiés dans des camps en 1997. À l’époque, le régime militaire en place à Rangoun impose son joug sans partage. Contraint d’organiser des élections en 1990, après un soulèvement, il en a invalidé les résultats et mis la vainqueure, Aung San Suu Kyi, en résidence surveillée. Lauréate du prix Nobel de la paix en 1991, cette fille d’un acteur de l’indépendance profite de sa libération pour prendre la plume en 1997. Pour mettre en lumière l’autoritarisme de la junte, le New York Times lui ouvre ses colonnes.
« Ceux d’entre nous qui ont décidé de travailler pour la démocratie », écrit-elle dans la tribune, « ont fait ce choix avec la conviction que le danger de se soulever pour les droits humains élémentaires dans une société répressive était préférable à la sécurité offerte par une vie silencieuse dans la servitude ». Tête de proue d’un mouvement non-violent, elle croit savoir que « la cause de la liberté et de la justice trouve des échos favorables dans le monde. Partout, peu importe les couleurs de peau ou les croyances, les gens comprennent le besoin humain pour une vie qui va au-delà de la satisfaction de désirs matériels. » Cet appel à la communauté internationale est donc baptisé « s’il vous plaît, utilisez votre liberté pour promouvoir la nôtre ».
Une décennie de lutte plus tard, la junte accepte sous la pression de la rue de réformer la constitution de manière à organiser des élections. Aung San Suu Kyi devient ainsi députée en 2012. À ce poste, alors que l’association Human Rights Watch dénonce une « campagne de nettoyage ethnique », elle refuse de qualifier ainsi les violences contre les musulmans. Comme elle a été mariée à un étranger, la constitution empêche l’ancienne opposante de briguer le poste de présidente. En 2016, elle devient donc conseillère spéciale de l’État et ministre des Affaires étrangères.
Les diplomates étrangers qui plaidaient la cause de Wa Lone et Kyaw Soe Oo n’ont donc guère été étonnés de sa réticence à les soutenir. Irritée par leur lobbying, elle s’est longtemps bornée à s’en remettre à la justice pour tout ce qui concerne ce qu’elle appelle pudiquement « le problème d’Arakan ». Après leur condamnation, le 13 septembre 2018, l’ancienne opposante a assuré, lors du Forum économique mondial de l’Association des Nations d’Asie du Sud-Est à Hanoï, qu’ « ils n’ont pas été emprisonnés parce qu’ils étaient journalistes ».
Alors que l’on pouvait s’attendre à ce que des tensions apparaissent au sommet de l’État entre Aung San Suu Kyi et l’armée, leurs positions semblent au contraire s’aligner, en sorte que la presse américaine ne cesse de pointer sa « déchéance » et qu’Amnesty International lui a retiré un prix. À en croire le journaliste Aung Naing Soe, les critiques qui la visent ou qui visent son parti, La Ligue nationale pour la démocratie (LND), « exposent à des problèmes, surtout quand il est questions des Rohingyas ». Au Comité de protection des journalistes birmans, on souligne même que les reportages sur les violations des droits humains par les militaires entraînent plus de « problèmes » que par le passé.

Un camp de l’État d’Arakan
Crédits : DFID – UK Department for International Development
Alors que 700 000 personnes ont maintenant fui l’Arakan, les élections qui doivent se tenir fin 2020 ont peu de chance d’apaiser les tensions. « Parce que le rapatriement des Rohingyas est largement impopulaire, le sujet sera politisé par les partis qui chercheront à capitaliser sur les conflits latents qui conduisent à la violence », pressentent les chercheurs Mary Callahan et Myo Zaw Oo, dans un rapport publié par l’American Institute for Peace en avril. Vainqueure de 79 % des sièges lors du scrutin de 2015, la LND a d’autant plus de chance de conserver sa majorité qu’elle réalise ses moins bons scores dans les zones où vivent beaucoup de minorités, comme l’Arakan. Lequel Arakan a été déserté par ses musulmans.
Dans cet État où une guérilla s’organise, la Chine fait pression pour reprendre le chantier de barrage qu’elle a lancé avec l’appui d’Aung San Suu Kyi. Avant les élections de 2020, les sujets ne manquent pas pour Wa Lone et Kyaw Soe Oo.
Couverture : Chinh Le Duc
L’article À quoi ressemblera la Birmanie du futur ? est apparu en premier sur Ulyces.
29.01.2021 à 00:01
Le monde sera-t-il sauvé par des adolescents ?
Les résultats sont éloquents. D’après un sondage mené auprès d’1,2 million de personnes dans 50 pays par le Programme des Nations unies pour le développement et l’université d’Oxford, les jeunes sont de loin la population la plus convaincue que le monde fait aujourd’hui face à une « urgence climatique ». C’est notamment le cas de […]
L’article Le monde sera-t-il sauvé par des adolescents ? est apparu en premier sur Ulyces.
Texte intégral (4502 mots)
Les résultats sont éloquents. D’après un sondage mené auprès d’1,2 million de personnes dans 50 pays par le Programme des Nations unies pour le développement et l’université d’Oxford, les jeunes sont de loin la population la plus convaincue que le monde fait aujourd’hui face à une « urgence climatique ». C’est notamment le cas de 83 % des jeunes Canadiens et Allemands, 82 % des Australiens, 81 % des Japonais, 77 % des Français et 75 % des Américains. C’est aussi aux jeunes qu’il appartiendra de sauver le monde.
Climate Fridays
C’est une fille seule au milieu de l’eau. Avec son visage rond et ses nattes, Greta Thunberg semble un peu perdue devant l’imposante façade baroque du parlement suédois, sur l’île de Helgeandsholmen, dans le centre de Stockholm. Ce matin d’août 2018, elle s’est levée comme d’habitude, a pris son petit-déjeuner, quelques prospectus, et s’est postée à l’entrée du Riksdag, copiant l’action des étudiants de Parkland contre les armes à feu aux États-Unis. L’adolescente fait le siège d’un dérèglement climatique meurtrier. Depuis qu’un instituteur lui a montré des photos de monceaux de plastique dans l’océan et d’ours polaires cacochymes, elle ne le supporte pas.
« Et puis quelques médias ont commencé à parler de moi », raconte-t-elle. « Le deuxième jour, des gens m’ont rejoint. Depuis, je ne suis presque plus jamais seule. » La Suédoise de 16 ans raconte son histoire dans un documentaire qui sort ce 23 mai 2019, à l’occasion d’un nouveau jour de grève mondiale en faveur du climat. La mobilisation a lieu à 1594 endroits dans 118 pays, annonçait-elle hier sur Twitter. En mars, le dernier « vendredi pour le futur » avait rassemblé 1,6 million de personnes dans 125 pays. L’affluence monte irrémédiablement, comme le niveau des océans. Pour faire barrage, les jeunes sont au premier rang.
« Depuis maintenant plusieurs mois », écrit un communiqué partagé en amont des manifestations du 24 mai, et signé par 77 organisations, « la jeunesse, consciente des dangers qu’elle encourt pour son avenir, se mobilise massivement partout dans le monde : Youth For Climate et Fridays For Future à l’international sont devenus le symbole du passage à l’action d’une génération déjà pleinement consciente des changements à effectuer dans notre modèle sociétal. » En France, des rassemblements doivent avoir lieu place de l’Opéra à Paris, à 13 heures, et dans des dizaines d’autres villes.

À Davos, en janvier, Greta Thunberg s’inquiétait que « les adultes n’arrêtent pas de dire qu’ils nous sont redevables de leur donner de l’espoir. Mais je ne veux pas de votre espoir. Je ne veux pas que vous voyez plein d’espoir, je veux que vous paniquiez. J’aimerais que vous ressentiez la peur que je ressens chaque jour. Et ensuite je veux que vous agissiez. » Car, s’il fallait encore le dire, la situation est particulièrement critique. Les 11 et 12 mai derniers, le température a atteint un pic extraordinaire de 29°C à l’entrée de l’océan Arctique, au nord-ouest de la Russie. Ce week-end-là, l’observatoire de Mauna Loa en Floride relevait une concentration de dioxyde de carbone dans l’atmosphère de 415 parties par million, soit le plus haut niveau sur 800 000 ans, voire sur trois millions d’années.
« Si nous continuons comme ça, en 2030 nous entraînerons une réaction en chaîne irréversible dont les événements échapperont à tout contrôle », prévient Greta Thunberg. « Ce sera sans retour. » Mise en couverture par le magazine Time la semaine dernière, la Suédoise entend maintenant « parler au monde » au nom de sa génération. Elle réclame le respect de l’Accord sur le climat de Paris et la proclamation d’un état d’urgence climatique. Sa voix porte d’autant plus qu’elle trouve un écho impressionnant chez les jeunes qui l’accompagnent.
De Johannesburg à Séoul en passant par Londres et New Delhi, la planète est tenue à bout de bras par des enfants et des adolescents. Sur leurs pancartes, à l’occasion de la grève du 15 mars, le globe bleu était accompagné d’une phrase digne d’un film de super-héros : « Sauvez le monde. » Fait-on slogan plus fédérateur ? Face à une pollution en forme de tache d’huile, contre laquelle l’innocuité des dirigeants apparaît chaque jour davantage, le mouvement gagne du terrain. C’est un moindre mal pour Greta Thunberg.
La Suédoise de 16 ans était revenue déprimée de la conférence pour le climat qui s’est tenue fin novembre en Pologne. « J’ai réalisé à quel point les gens dont dépend notre futur ne semblent pas prendre la question au sérieux », soufflait-elle. Alors des jeunes gens qui partagent son inquiétude l’ont rejoint. « Make the world Greta again », scandent-ils aujourd’hui pour contrer le négationnisme climatique de Donald Trump. Le président américain rêve de recevoir le prix Nobel de la paix mais c’est bien Greta Thunberg qui a été proposée sur une liste portant 304 noms. Les adultes sont-ils prêts à entendre le cri d’alarme de sa génération ?
L’île aux oiseaux
Derrière des torrents de houle, la silhouette d’un volcan se découpe au milieu de la brume. Après 18 jours de navigation au départ de Cape Town, à l’extrême sud-est de l’Afrique, l’archipel de Tristan da Cunha montre sa roche noire tapissée d’herbe verte. Autour des sommets culminant à 2 000 mètres de hauteur, des colonies de volatiles orbitent à l’infini, toisant les petites maisons rouge et vert déposées sur le bord comme des galets par la marée. Habitée depuis 1811, cette possession britannique qui a la réputation d’être l’île la plus reculée du monde compte aujourd’hui 260 résidents. Réfugiés en Angleterre lors de l’éruption de 1961, ils sont revenus deux ans plus tard pour planter des pommes de terre et élever des vaches, des moutons, des canards et des poulets.

L’archipel de Tristan da Cunha
Leurs jardins proprets semblent s’être détachés du Kent pour dériver dans l’Atlantique et se confondre avec le monde sauvage. Par bonheur, l’homme s’est intégré à ce rocher sans le souiller par ses usines et ses autoroutes. Mais cela a suffi pour tout bousculer. Depuis son arrivée, trois espèces d’oiseaux ont disparu : la gallinule de Tristan (Gallinula nesiotis), l’albatros de Tristan (Diomedea dabbenena) et le nésospize de Tristan (Nesospiza acunhae acunhae). « Nous estimons que ces trois espèces se sont éteintes entre 1869 et 1880 après une période de dégradation de leur environnement et de surexploitation humaine [des ressources], seul l’albatros avait une chance de survie lorsqu’en 1882 les rats noirs sont arrivés, et ont finalement entraîné l’extinction des trois espèces », notent les chercheurs Alexander L. Bond, Kevin R. Burgio et Colin J. Carlson dans un article publié par le Journal of Ornithology en janvier 2019.
Cette « petite équipe informelle », dixit Carlson, développe aussi spatExtinct, un programme permettant d’évaluer les dates d’extinctions à venir espèce par espèce. Elle s’intéresse notamment à des animaux méconnus. « Alors que les chercheurs se sont concentrés sur des extinctions fameuses comme celle du dodo, ou sur des régions très étudiées comme l’Amérique du Nord et Hawaï, les travaux sur les extinctions dans les îles sont moins nombreux », observent-ils. Or, indistinctement, la disparition des animaux les moins visibles met en danger ceux qui prennent le plus de place. Au cours de précédents travaux, Colin J. Carlson soulignait que l’ensemble de la chaîne alimentaire allait être affectée par la disparition d’un tiers des parasites dans le siècle à venir.
Aujourd’hui, il se sert de Twitter pour alerter. « Au moins 7 % des invertébrés sont probablement déjà éteints, ce qui est sans doute suffisant pour que la biosphère s’effondre », indiquait-il le 6 février 2019. La veille, le chercheur partageait des memes et des vidéos de danse depuis son compte, illustré par la photo d’un jeune homme glabre aux cheveux roux et aux lunettes rectangulaires. C’est bien lui. Colin J. Carlson est un scientifique un peu spécial. À 23 ans, cela fait plus d’une décennie qu’il cherche des solutions pour la planète. Diplômé de Stanford à 11 ans, le garçon du Connecticut a fait l’objet d’un portrait du New York Times quand il en avait 12 et, l’année suivante, il a attaqué son université en justice pour infléchir son refus de l’envoyer en travaux pratiques en Afrique du Sud.

Colin J. Carlson
En 2018, une blague du biologiste a été retweetée plus de 33 000 fois : « Vous n’êtes jamais vraiment seul le jour de la Saint-Valentin quand vous pensez à tous ces micro-organismes qui cohabitent avec vous à travers vos vaisseaux sanguins », plaisantait-il. En génie précoce, Colin J. Carlson s’est longtemps senti isolé, ou du moins en décalage. C’est désormais un exemple pour une génération d’enfants préoccupés par l’environnement. En novembre, des bataillons d’adolescents ont occupé le bureau de la nouvelle présidente de la chambre des représentants, la Démocrate Nancy Pelosi, afin de l’enjoindre à prendre des mesures en faveur de la planète. « Quel est votre plan ? » demandaient-ils à l’aide de pancartes orange, avec le soutien de la plus jeune femme élue députée, Alexandria Ocasio-Cortez, 29 ans.
« Nous cherchons à constituer une armée de jeunes gens pour faire du changement climatique une priorité politique », explique un des organisateurs, membre du 200 Sunrise Movement, Garrett Blad, 25 ans. « Nous voulons dénoncer l’industrie pétrolière et ses lobbyistes, et élire une nouvelle génération de décideurs qui défendra l’intérêt général, pas seulement une poignée de riches. » Le défi est grand. En janvier 2019, un tribunal du Colarado a débouté la demande d’associations visant à suspendre la fracturation hydraulique menée par les compagnies pétrolières dans la région. L’un des plaignants, Xiuhtezcatl Martinez, s’est fait connaître en pressant les Nations Unies (ONU) de protéger sa génération en péril en 2015, alors qu’il n’avait que 15 ans.
En décembre, la Suédoise Greta Thunberg, âgée de seulement 16 ans, a alerté contre une « menace existentielle » lors du sommet de l’ONU sur les changements climatiques (COP24). « Les jeunes comprennent les enjeux environnementaux », assure Garrett Blad. « Même ceux qui sont en sixième. Récemment, un professeur a demandé à ses élèves à quoi ressemblait le changement climatique. “Les ouragans Irma, Maria ou les incendies du sud de la Californie”, ont-ils répondu. » Colin J. Carlson n’a même pas attendu d’être au collège pour se préoccuper du problème.
Colin, 11 ans
Depuis Washington, où il vit aujourd’hui, Colin J. Carlson mesure le chemin parcouru. Pendant que les jeunes de son âge visaient le bac, il a tour à tour étudié les arts, l’environnement, l’écologie, l’évolution biologique, la philosophie, la politique et le management. Ce parcours l’a conduit à faire un stage à l’Agence nationale de protection de l’environnement et à donner des cours de biologie. À présent doctorant à l’université de Georgetown, il retourne régulièrement voir sa mère, dans le Connecticut. « J’ai grandi dans un village à la campagne où le changement climatique était un sujet très tabou », raconte-t-il. « Et je pense que ça l’est toujours. C’est d’ailleurs l’une des choses qui m’ont poussé à conduire ce genre de recherches. » Et ses capacités intellectuelles hors du commun ont aidé.
Né un 31 juillet comme Harry Potter, Colin J. Carlson sait articuler des phrases entières à un an et demi. Lorsque son père se suicide, alors qu’il a deux ans, sa mère ne le suspecte pourtant pas encore d’être en avance. « Je me rendais compte de ce qu’il faisait mais pas qu’aucun autre enfant n’en était capable », se souvient la psychologue. Lecteur de l’hebdomadaire Newsweek à 4 ans, son fils finit par faire un test qui révèle un score de QI de 145, quand la moyenne tourne autour de 100. L’homme qui l’a mis au monde avant de disparaître prématurément était lui aussi quelqu’un de brillant. Torturé par ce que les autres pensaient de lui, Cory Carlson est tombé en dépression. Colin a dû composer sans lui et sans beaucoup d’amis, tant sa différence le classait à part.
« À six ans, j’ai dessiné une carte pour mon institutrice », se remémore le jeune homme. « Je lui ai demandé de me donner des choses plus compliquées à faire mais elle a refusé de peur que j’aie ensuite encore envie de faire autre chose. » Alors il quitte l’établissement privé et se met à suivre des cours en ligne. Avant neuf ans, le jeune homme apprend le français, l’histoire européenne et la physique environnementale grâce à l’université du Connecticut, Uconn. Cela lui permet de remporter un concours organisé par le magazine National Geographic, dont le prix est un séjour aux îles Galápagos, un archipel équatorien situé dans le Pacifique.
« Si vous demandiez à un enfant de 13 ans s’il voulait jouer avec moi, la réponse était non »
« Je m’attendais à voir beaucoup de pingouins mais il n’y en avait que cinq », souffle-t-il. « J’ai appris que le nombre se réduisait à cause de la fréquence croissante du phénomène climatique El Niño, dont le changement climatique est responsable. » De retour chez lui, Colin J. Carlson s’inscrit à des cours de biologie et dévore le documentaire d’Al Gore, Une Vérité qui dérange. Sur ces entrefaites, il crée le Cool Coventry Club, une association vouée à sensibiliser aux conséquences de la pollution. En un an, elle initie 50 événements et touche 2 000 personnes, vante-t-il.
Aux sceptiques, le garçon tente calmement d’exposer la situation. « Il ne faut pas dire à ceux qui sont impossibles à convaincre qu’ils se trompent », philosophe-t-il. « J’essaye donc de trouver un terrain d’entente, en partant du fait que tout le monde veut économiser de l’énergie et de l’argent, par exemple. » Après avoir décroché un diplôme de Stanford par correspondance, le militant en herbe est invité à plaider la cause de la planète devant les élus de son État.
Colin J. Carlson a emmagasiné suffisamment de confiance en lui pour vouloir fréquenter les amphithéâtres où les problèmes sont abordés avec un certain détail. Il écrit donc une lettre à la fac. « J’ai 11 ans et j’en aurai 12 d’ici mon inscription », présente-t-il. « Ne prenez pas peur, en vérité je suis quelqu’un de très mature. » Recalé par plusieurs institutions, il est finalement accepté à Uconn, où certaines salles de classe lui demeurent toutefois inaccessibles, de même que les dortoirs. Il lui faut donc faire la navette entre la maison et le campus. À 13 ans, ne pouvant prendre part à un cours prévoyant un voyage en Afrique du Sud, il traîne l’université en justice, attirant ainsi l’attention de la presse.

Crédits : SESYNC
Les États-Unis apprennent alors à apprécier ce bourreau de travail, féru de piano et de randonnée, qui écrit des scénarios ou observe les oiseaux en dehors des cours. « Je suis irritable quand je ne travaille pas », souffle-t-il. Contrairement à la plupart des adolescents, il joue plus volontiers aux échecs qu’aux jeux vidéo et préfère la musique classique que les tubes de la radio. « Si vous demandiez à un enfant de 13 ans s’il voulait jouer avec moi, la réponse était évidemment non », remet-il. Colin J. Carlson est déjà dans la cour des grands.
Les gouvernements en procès
Tout génie qu’il est, Colin J. Carlson a encore besoin d’une calculatrice pour les opérations compliquées, et de sa mère pour l’acheter. En arrivant au centre commercial, en ce début d’année scolaire 2012, un étudiant qui passe là l’interpelle. « Hey Colin, on m’a dit que tu étais un aimant à filles », sourit-il. Le jeune homme s’est bien fait des amies mais la remarque paraît trop intéressée pour le flatter. Il dit de toute manière ne pas trop se soucier du regard des autres : « Je ne cherche ni à devenir célèbre ni à rester en retrait, je veux continuer à faire ce que je fais sans que tout le monde soit en train de m’épier. Et pour le moment, j’aimerais que personne ne se mette sur mon chemin. » Derrière cet esprit brillant se cache une volonté de fer. Des qualités qui ont poussé Business Insider à le citer parmi les 16 enfants les plus intelligents de leur génération aux côtés de Mozart, Picasso et le champion d’échecs Bobby Fischer en 2011.
Cette année-là, après avoir vu le documentaire d’Al Gore, Une Vérité qui dérange, une avocate de l’Oregon enceinte de sept mois entreprend de plaider en faveur de la planète. Julia Olson en discute alors avec une collègue qui dirige le programme juridique de l’environnement et des ressources à l’université, Mary Christina Wood. Par sa bouche, elle apprend que le militant philippin Antonio Oposa a attaqué l’État au nom de 43 enfants pour lutter contre la déforestation et la pollution de la baie de Manille. Les générations qui arrivent en seront les principales victimes, a-t-il dénoncé au début des années 1990, obtenant finalement gain de cause de la part de la Cour suprême. « Ce cas a inspiré beaucoup de juristes dans le monde », avance le directeur du Center for International Environmental Law (CIEL), Daniel Magraw. « Il était concentré sur un territoire local mais a entraîné une théorie en droit international. »

Alec Loorz
Julia Olson décide de décalquer ce types d’actions aux États-Unis en fondant l’association Our Children’s Trust. Le spécialiste du climat James Hansen, de la NASA, lui présente un adolescent prêt à ferrailler devant les tribunaux. Lui aussi frappé par le documentaire d’Al Gore, Alec Loorz s’est engagé dès 12 ans. Avec son organisation Kids vs. Global Warming comme plateforme, il a donné près de 200 conférences dans des écoles du monde entier. À l’en croire, les enfants sont bien plus inquiets de la pollution que ce que peuvent penser leurs parents. « Le fait de devenir grand-père m’a poussé à manifester », explique d’ailleurs James Hansen, qui assure à Alec Loorz que le pire peut encore être évité. « Beaucoup de jeunes réalisent qu’il est urgent d’agir et que nous n’allons pas résoudre le problème simplement en préférant le vélo à la voiture », juge le jeune homme d’aujourd’hui 18 ans.
« Aujourd’hui, c’est l’existence même de ma génération qui est en jeu », abonde un jeune homme dont les longs cheveux bruns tombent sur un costume marine. Ce 29 juin 2018, Xiuhtezcatl Martinez s’adresse d’abord aux Nations Unies dans la langue du peuple nahuatl, dont vient son prénom, puis en anglais. Il n’a que 15 ans mais est déjà parfaitement à l’aise. « C’est vrai qu’il y a peu de gens de cet âge qui discourent devant l’ONU », reconnaît-il. « Mais je parle en public depuis que j’ai six ans dont je ne suis plus vraiment stressé. Par rapport à d’autres discours que j’ai donnés, celui-là était très stérile. Tout ces gens en costume-cravate jouaient sur leur téléphone. Personne n’était intéressé. » Baptisé à l’âge de six ans selon l’alignement des étoiles, Xiuhtezcatl Martinez dit venir d’un peuple qui fait de la conservation de la planète sa mission. « Enfant, je cherchais les grenouilles et les serpents avec mon père, ça m’a fait me sentir important dans le monde », explique-t-il.
Deux mois plus tard, avec 20 autres jeunes gens, âgés de 8 à 19 ans, il porte plainte contre l’État. Ce procès « Juliana v. United States » lancé dans l’Oregon doit permettre de démontrer que le gouvernement, par ses actions responsables du dérèglement climatique, viole les droits constitutionnels des jeunes générations à la vie, à la liberté et à la propriété, et qu’il manque à son devoir de protéger les ressources publiques essentielles. « Nous ne demandons pas d’argent », précise la plaignante qui donne son nom au cas, Kelsey Juliana, « mais nous voulons que le tribunal ordonne au gouvernement de développer et de mettre en place un plan national de protection du climat basé sur les meilleurs ressources scientifiques. » C’est là que les travaux actuellement menés par Colin J. Carlson ont leur importance.

Xiuhtezcatl Martinez
Crédits : Earth Island Institute
« Le changement climatique va presque certainement entraîner des millions de mort », regrette-t-il. Dans un article publié fin 2018 par la revue Nature Climate Change, le jeune chercheur étudie les promesses de la géo-ingénierie pour corriger les désordres de la pollution en manipulant le climat. La gestion du rayonnement solaire propose par exemple d’injecter des particules d’aérosols dans la stratosphère tandis que d’autres approches préconisent de trouver un moyen pour retirer le dioxyde de carbone de l’atmosphère.
Dans tous les cas, « il est trop tôt pour savoir si ces technologie peuvent sauver des vies », prévient-il. « À l’heure actuelle, nous savons que le climat et les maladies sont étroitement liées ce qui soulève de nombreuses questions à propos de la géo-ingénierie. » En d’autres termes, la manipulation de l’environnement présente le risque d’entraîner des maladies imprévues. En faisant tomber les températures aux tropiques, la gestion du rayonnement solaire pourrait notamment favoriser la propagation de la malaria.
Les recherches sur le sujet doivent donc être complétée. En attendant, Colin J. Carlson apporte tout son soutien à Kelsey Juliana, Xiuhtezcatl Martinez, Garrett Blad et Greta Thunberg.
Couverture : We The Future / Are Earth Guardians. (Obey)
L’article Le monde sera-t-il sauvé par des adolescents ? est apparu en premier sur Ulyces.
28.01.2021 à 00:00
Que se passe-t-il avec le sperme ?
Une nouvelle fois en ce début d’année 2021, des chercheurs sont arrivés à la conclusion que les mâles de notre espèce perdent progressivement leur capacité à se reproduire. D’après une étude de chercheurs américains rendue publique le 24 janvier, les phtalates et Bphénol A, présents dans les plastiques, les cosmétiques et les emballages alimentaires, seraient […]
L’article Que se passe-t-il avec le sperme ? est apparu en premier sur Ulyces.
Texte intégral (1995 mots)
Une nouvelle fois en ce début d’année 2021, des chercheurs sont arrivés à la conclusion que les mâles de notre espèce perdent progressivement leur capacité à se reproduire. D’après une étude de chercheurs américains rendue publique le 24 janvier, les phtalates et Bphénol A, présents dans les plastiques, les cosmétiques et les emballages alimentaires, seraient à l’origines de nombreux troubles : un nombre croissant de bébés nés avec des pénis plus petits, des taux plus élevés de dysfonctions érectiles, une baisse de la fertilité ou encore l’érosion des différences sexuelles chez certaines espèces animales. Une terrible découverte qui affirme une tendance initiée il y a plusieurs décennies.
L’étude des études
Le taux de spermatozoïdes des hommes nord-américains, européens, australiens et néo-zélandais a diminué de plus de 50 % entre 1973 et 2011. C’est le constat que fait une étude publiée en juillet dernier dans la Oxford University Press, par une équipe de chercheurs de l’université hébraïque de Jérusalem, qui a passé en revue plusieurs milliers de travaux réalisés dans une cinquantaine de pays. « Nous avons utilisé le type de méta-analyse spécifique à la fine pointe de la technologie – une méthode de “méta-régression” pour modéliser les tendances de la concentration de sperme et des spermatozoïdes de 1973 à 2011 », explique l’épidémiologiste Hagai Levine, principal auteur de l’étude.
Cette méthode a permis d’étudier les propriétés des semences de 42 935 hommes. Et si le déclin du taux de spermatozoïdes qu’elle met au jour se poursuit au même rythme dans les prochaines années, les hommes occidentaux auront tout simplement perdu l’intégralité de leurs capacités de reproduction d’ici 2060. D’autant que ce déclin s’est accéléré après l’année 1995. « Nos résultats reflètent un problème de santé publique majeur en termes de fertilité masculine, et de santé masculine en général », insiste Hagai Levine. « Des études récentes ont montré qu’un faible taux de spermatozoïdes est un signe prédictif d’un taux de mortalité, de morbidité et d’hospitalisations plus élevé », ajoute-t-il. « Il est cependant nécessaire de faire davantage de recherche pour comprendre l’utilité du taux de spermatozoïdes en tant que mesure de santé et du mécanisme que cela implique. » Shaun Roman, scientifique de l’université de Newcastle, estime néanmoins que « nous ne sommes pas encore dans une situation de crise » : « Nous devrions souligner le fait qu’il suffit d’un spermatozoïde pour fertiliser un ovule et, en moyenne, les hommes occidentaux en produisent encore 50 millions par éjaculation ». Orly Lacham-Kaplan, de l’Université catholique australienne, ne juge donc pas nécessaire d’inquiéter ses « gars ». Kelton Tremellen, de l’université Flinders, en Australie toujours, pense au contraire que les hommes devraient prendre les résultats de l’étude de l’université hébraïque de Jérusalem comme « un réveil pour adopter un mode de vie sain ». « Bien que nous n’ayons pas exploré les causes du déclin du taux de spermatozoïdes, nous savons que la fertilité masculine est affectée par l’environnement, au sens large, tout au long de la vie, et surtout pendant la période critique du développement du fœtus au début de la grossesse –probablement de la 8e à la 14e semaine », affirme Hagai Levine. « L’exposition aux produits chimiques ou au tabagisme maternel au cours de cette période a une incidence négative sur les résultats masculins chez les animaux et les humains. Puis les habitudes de vie tels que le manque d’activité physique et l’exposition aux produits chimiques tels que les pesticides contribuent à réduire le nombre de spermatozoïdes dans la vie adulte. »

Crédits : Ulyces.co
Quant à Christopher Barrat, professeur de médecine reproductive à l’université de Dundee, en Écosse, il rappelle que « la question de l’éventuel déclin du taux de spermatozoïdes est un vieux débat parmi les scientifiques ». En effet, ces derniers sont conscients de la baisse du taux de spermatozoïdes depuis 1992, mais les résultats de leurs recherches ont longtemps prêté à controverse. L’étude de l’université hébraïque de Jérusalem, elle, se distingue par la qualité de son analyse, selon Christopher Barrat. « Elle a été menée de manière systématique, en tenant compte des défauts relevés sur les précédentes recherches (la méthode utilisée pour compter les spermatozoïdes, par exemple) et en comparant des études pourtant distantes de plusieurs décennies. La plupart des experts s’accordent donc à dire que les données présentées sont d’une grande qualité et que leurs conclusions, bien qu’alarmantes, sont fiables. »
Du sperme artificiel
L’étude de l’université hébraïque de Jérusalem ne relève aucun déclin du taux de spermatozoïdes chez les hommes asiatiques, africains ou sud-américains. Mais comme le note Christopher Barrat, « les données en provenance de ces régions sont, il est vrai, peu nombreuses ». Pour lui aussi, l’explication la plus rationnelle au déclin du taux de spermatozoïdes chez les hommes occidentaux est à chercher du côté de l’environnement, mais il appelle à poursuivre les recherches sur ce sujet. « Des différences existent (…) en fonction des zones géographiques », souligne-t-il. « La détermination des facteurs – génétiques ? environnementaux ? – à l’origine de ces différences sera primordiale pour parvenir à un traitement susceptible de limiter les effets négatifs de la chute du taux de spermatozoïdes. »  Parmi les polluants incriminés par le professeur de médecine reproductive se trouve le bisphénol A, composant de plastiques et de résines par ailleurs suspecté de favoriser les maladies cardiovasculaires, l’obésité et l’hyperactivité.
Parmi les polluants incriminés par le professeur de médecine reproductive se trouve le bisphénol A, composant de plastiques et de résines par ailleurs suspecté de favoriser les maladies cardiovasculaires, l’obésité et l’hyperactivité.
En 2013, une équipe de chercheurs français de l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm) a maintenu des testicules fœtaux dans des boites de culture, en exposant certains à du bisphénol A. Il est alors apparu que ces testicules produisaient moins de testostérone que les autres, ce qui a conduit les chercheurs à penser que le bisphénol A pourrait être au moins en partie responsable de la chute de la production spermatique, ainsi que de l’augmentation de l’incidence des défauts congénitaux de masculinisation et du cancer testiculaire observées au cours des dernières décennies. Mais Christopher Barrat recommande également de ne pas fumer de cigarettes, lesquelles ne contiennent pas moins de 4 000 substances potentiellement toxiques pour les spermatozoïdes, dont la cotinine, le cadmium, la nicotine, ou encore les hydrocarbures polyaromatiques. Les spermatozoïdes des fumeurs vont moins vite, sont moins nombreux dans un volume donné, et ont une forme atypique qui leur rend difficile l’accès à l’ovule. C’est ce que montre une étude menée en 2016 par une équipe de chercheurs internationale qui a recensé l’ensemble des publications scientifiques portant sur le lien entre tabac et qualité du sperme pour en sélectionner 20, incluant près de 6 000 participants. Seules deux d’entre elles suggèrent que l’arrêt du tabac est associé à une amélioration de la qualité du sperme…
« D’une manière générale, conserver un mode de vie sain a son importance », affirme Christopher Barrat. La relation entre surpoids et réduction du taux de spermatozoïdes a par exemple été démontrée par une étude conduite en 2010 par des chercheurs français sur 1 940 personnes. Selon cette étude, plus le surpoids est important, plus la qualité du sperme diminue, particulièrement en ce qui concerne la concentration et le nombre total de spermatozoïdes. La concentration en spermatozoïdes baisse de 10 % pour les patients en surpoids par rapport à ceux de poids normal, et de 20 % pour les obèses, chez qui la mobilité des spermatozoïdes baisse de 10 %. Le nombre total de spermatozoïdes, de 184 à 194 millions par millilitre (M/ml) chez les gens de poids normal, baisse à 164-186 M/ml chez ceux en surpoids, et à 135-157 M/ml chez les obèses. Et si tabac et junk food vous semblent indispensables, vous aurez peut-être bientôt la possibilité de vous procurer un sperme humain de qualité artificiel. Après tout, il existe déjà du sperme de souris de qualité artificiel. Ce sont des chercheurs chinois de l’université médicale de Nanjing qui sont parvenus à le créer à partir de cellules souches, dans le cadre d’une étude publiée dans la revue Cell Stem Cell datée de janvier 2016. Une technologie qui pourrait aider les scientifiques à étudier plus directement le développement des spermatozoïdes chez les mammifères et renforcer les efforts dans la mise au point de traitements de l’infertilité masculine chez les humains. D’autant que ce sperme artificiel a permis d’engendrer des souriceaux sains.
Couverture : Le sperme triste. (Ulyces.co)
L’article Que se passe-t-il avec le sperme ? est apparu en premier sur Ulyces.
25.01.2021 à 00:13
Poutine va-t-il diriger la Russie pour l’éternité ?
Plus de 85 millions de paires d’yeux sont rivées sur un somptueux palais construit sur les bords de la mer Noire. La magnifique demeure de près de 18 000 m², aux faux airs de Versailles, serait officieusement la propriété de Vladimir Poutine, dénonce une vidéo publiée le 19 janvier 2021 sur la chaîne YouTube d’Alexeï […]
L’article Poutine va-t-il diriger la Russie pour l’éternité ? est apparu en premier sur Ulyces.
Texte intégral (2871 mots)
Plus de 85 millions de paires d’yeux sont rivées sur un somptueux palais construit sur les bords de la mer Noire. La magnifique demeure de près de 18 000 m², aux faux airs de Versailles, serait officieusement la propriété de Vladimir Poutine, dénonce une vidéo publiée le 19 janvier 2021 sur la chaîne YouTube d’Alexeï Navalny, le plus véhément opposant à l’actuel gouvernement de la Fédération de Russie.
L’enquête prétend démasquer un vaste système de corruption organisé autour du président russe pour la construction de ce projet, qui se chiffre à plus d’un milliard d’euros. Une « bombe » qui menace de faire vaciller le trône sur lequel Vladimir Poutine compte rester assis encore de longues années.
Le coup d’État incolore
Sous l’aigle à deux têtes des armoiries russes, Vladimir Poutine dépose une chemise jaune au pupitre de la Douma. Après avoir enchaîné les poignées de main à la tribune, devant un Parlement levé comme un seul homme, il lui fait face. Ses cheveux taupes, qui ne tirent que légèrement vers le gris, semblent avoir arrêté de tomber depuis quelques années. Le président n’a guère vieilli. Et il est peut-être là pour un moment. Ce 10 mars 2020, l’ancien membre des services secrets est venu donner sa vision de la révision constitutionnelle qu’il a impulsée en janvier. « Les Russes doivent avoir une alternative dans n’importe quelle élection », plaide-t-il, avant d’ajouter que « la stabilité est peut-être plus importante et doit être prioritaire ».
Après son intervention, les députés russes votent un amendement constitutionnel pour remettre ses compteurs à zéro. Le nombre de mandats présidentiels sera bien limité à deux, qu’ils soient successifs ou non, là où ils sont actuellement plafonnés à deux d’affilée. Mais les quatre règnes de Poutine, entre 2000 et 2008 puis de 2012 à aujourd’hui, ne compteront plus. En clair, il pourra se représenter en 2024. Cet amendement voté par 380 parlementaires et repoussé par les 44 communistes a été voté définitivement le 22 avril dernier. Poutine pourra ainsi continuer à gouverner la Russie jusqu’en 2036.
•
Le dernier écho d’un orchestre résonne contre les dorures de la salle Andreïevski, au Kremlin. Une voix grave s’élève alors d’un homme mince au visage anodin, presque effacé. Il jure sa fidélité à la constitution, la main posée sur le texte de 1993. Au-dessus de son crâne, l’aigle à deux têtes des armoiries nationales plane au milieu d’un rideau bleu roi. Ce 7 mai 2000, devant une salle levée comme un seul homme, Vladimir Poutine devient président de la fédération de Russie.
Vingt ans plus tard, sous le même aigle à deux têtes et devant une salle plus droite encore, l’ancien membre des services secrets s’engage à revisiter une loi fondamentale qui n’a guère bougé depuis lors. Devant les parlementaires, ce mercredi 15 janvier 2020, il commence par promettre l’extension de l’allocation maternité aux famille n’ayant qu’un enfant, alors qu’il fallait jusqu’ici en avoir deux pour en bénéficier. Puis, ayant écarté la perspective d’une nouvelle constitution, Poutine fait part de son désir de l’amender.
Aussitôt, un vaste pan de la presse internationale s’en prend à une réforme qui « pourrait le maintenir au pouvoir » selon Reuters, est « conçue pour perpétuer son pouvoir », écrit l’universitaire britannique Richard Sakwa dans The Conversation, ou « ouvre la voie à son règne indéfini », à en croire le Financial Times. Pour le Guardian, il ne fait aucun doute que Poutine « prévoit de rester au pouvoir après 2024 », qui marquera la fin de son deuxième et dernier mandat consécutif autorisé par la constitution. N’a-t-il pas déjà contourné cette règle en cédant la place à un affidé, Dmitri Medvedev entre 2008 et 2012, pour mieux revenir à la présidence ensuite ?
Cette fois, explique une tribune du New York Times, « le leader russe manœuvre pour rester au pouvoir indéfiniment ». Certes prévoit-il de limiter le nombre de mandats présidentiels à deux, qu’ils soient successifs ou non, ce qui empêcherait tout retour. Mais voilà, il « n’a pas besoin d’être Président pour rester au sommet », ajoute le Washington Post. Le principe de la réforme est d’ailleurs approuvé par l’intégralité des 432 membres de la Douma (chambre basse) jeudi 23 janvier, et Dmitri Medvedev a été sèchement congédié, le poste de Premier ministre revenant au discret Mikhaïl Michoustine.

Crédits : Kremlin
« C’était un homme usé, accusé d’enrichissements douteux et dont la cote de popularité était mauvaise », observe Jean Radvaniy, professeur émérite à l’Institut national des langues et civilisations orientales (Inalco) spécialisé dans la géopolitique russe. Le vice-Premier ministre Vitali Moutko, le ministre de la Culture Vladimir Medinski et la ministre de l’Éducation Olga Vassilieva payent aussi leur impopularité. En revanche, des piliers du régime comme Sergueï Lavrov (Affaires étrangères), Sergueï Choïgou (Défense) et Vladimir Kolokoltsev (Intérieur) restent.
En phase avec les titres anglo-saxons suscités, l’opposant Leonid Volkov, chef de cabinet d’Alexei Navalny, estime qu’il « est clair pour tout le monde que tout est fait pour remettre le pouvoir à Poutine à vie ». Le chef du Parti du changement, à la Douma de 2011 à 2016, Dmitri Goudkov, en parlent même comme d’un « coup d’État constitutionnel ». Seulement rien, dans les plans affichés par Poutine le 15 janvier 2020, ne ressemble à une manœuvre pour se maintenir au pouvoir.
Le président russe souhaite réviser la constitution afin de graver la suprématie de la loi russe sur le droit international dans le marbre, donner au Parlement le prérogative de nommer les membres du gouvernement, soumettre la nomination des chefs des agences de sécurité à une consultation du Conseil de la fédération et donc limiter le nombre de mandats présidentiels à deux au lieu de deux consécutifs. « Des commentateurs pensent qu’ils veut garder le pouvoir pour lui, en fait on n’en sait rien », tique Jean Radvaniy. « Il n’est pas exclu qu’il abandonne tout à condition qu’il ait mis en place une succession qu’il considère comme suffisamment stable et assurée. » Mais sont intervention à la Douma le 10 mars montre qu’il n’est pas encore décidé à céder la main.
Mentor mentor
Sous l’aigle à deux têtes projeté dans son dos, Vladimir Poutine poursuit le discours marathon dont il a le secret. « Il est important d’assurer un meilleur équilibre entre les différentes branches de l’État », déclare-t-il devant quelques mines circonspectes ce 15 janvier 2020. Si la réforme va à son terme, le Conseil de la fédération (chambre haute) aura le pouvoir de révoquer les juges de la Cour suprême et de la Cour constitutionnelle en cas d’actes déshonorants. La procédure sera initiée par le Président. Il pourra aussi mettre en branle une étude de la constitutionnalité des lois fédérales, par la Cour constitutionnelle, avant leur ratification. Enfin et surtout, le Conseil d’État deviendra une agence gouvernementale dont la fonction sera garantie par la constitution.
Rassemblement de leaders nationaux et régionaux présidé par Poutine, cet organe ne dispose pour le moment que d’un pouvoir consultatif. La réforme prévoit de lui confier la définition des « orientations de politique interne et étrangère de la Fédération de Russie et des principaux domaines de développement socio-économique ». À l’instar de Masha Gesse, journaliste au New Yorker et auteure du livre The Future Is History: How Totalitarianism Reclaimed Russia, certains imaginent donc Poutine en prendre la tête après y avoir déplacé le centre du pouvoir et « laissé une présidence éviscérée pour son successeur ».
Lors d’une interview à la télévision, le chef d’État a cependant réprouvé la perspective de devenir le « mentor » du prochain président en 2024, dans la mesure où elle entraînera la coexistence de deux centres de pouvoir, « une situation néfaste pour un pays comme la Russie » selon lui. Alors, quel rôle entend-il donner au Conseil d’État ? Sur ce mystère quasi-complet, le passé jette une lumière timide. En novembre 2000, un président encore vert réactive ce comité issu de la période soviétique. Poutine veut lui donner le rôle « stratégique » de prendre des positions sur « des sujets clés du développement du pays », « sans se substituer au travail du Parlement et du gouvernement ».

Crédits : Kremlin
À cette période, le moral du pays est loin d’être au beau fixe. « Plus de 40 % de nos citoyens vivaient sous le seuil de pauvreté, le système de sécurité sociale était en ruine, sans parler des forces armées qui avaient pratiquement cessé d’exister », retraçait-il dans le documentaire Conversations avec Monsieur Poutine, sorti en 2017. « Le séparatisme dominait. Je ne vais pas m’étendre là-dessus mais je veux juste dire que la constitution russe ne s’appliquait pas partout sur le territoire et une guerre faisait rage au Caucase – une guerre civile qui était alimentée par des éléments radicaux de l’étranger. » L’ex-officier du KGB fait là référence au conflit en Tchétchénie, pour lequel il avait promis que les « terroristes » seraient tués jusque « dans les chiottes ».
Une offensive impitoyable est aussi lancée contre certains oligarques. C’est la fin d’un règne pour ce qu’on a appelé la Semibankirchtchina sous l’ère de Boris Eltsine (1991-1999), autrement dit le gouvernement des sept banquiers : Boris Berezovski (Logovaz et Obiédinionni), Vladimir Goussinski (Most), Alexandre Smolenski (Stolitchni), Vladimir Potanine (Onexim), Mikhaïl Khodorkovski (Menatep), Piotr Aven et Mikhaïl Fridman (Alfa). L’économie russe reste toutefois centrée autour de mastodontes, puisque 23 groupes contrôlaient un tiers de son industrie en 2005.
Poutine n’en finit ni avec les oligarques ni avec la corruption, mais fait le ménage pour imposer son joug. « La politique de Poutine n’a pas eu pour but de réguler l’activité des oligarques, d’encadrer leur extension, mais de régner par des mesures discrétionnaires », juge Christof Ruehl, à cette période économiste en chef de la Banque mondiale à Moscou. Il devient ainsi petit à petit une figure non seulement incontournable mais aussi irremplaçable.
Prolongement
Deux mois après avoir juré de respecter la constitution, sous l’aigle à deux têtes, Vladimir Poutine donne son premier discours annuel à la nation. Comme il le fera vingt ans plus tard, le président russe commence, ce 8 juillet 2000, par s’inquiéter de la démographie. La population a chuté de 750 000 individus en moyenne depuis quelques années, ce qui risque, à un tel rythme, d’entraîner une perte de 22 millions de personnes dans les 15 ans à venir. À la faveur d’une embellie économique, facilitée par la reprise en main des hydrocarbures par l’État et une simplification du droit des entreprises, le taux de natalité repart à la hausse dans la seconde moitié de la décennie.
Poutine réussit donc à instiller un semblant de stabilité dans une société russe marquée par une décennie de troubles. Eltsine a donc bien choisi son successeur, après avoir longtemps tâtonné. À partir du moment où il a commencé à préparer son départ, en 1998, ce dernier a éprouvé trois Premiers ministres avant de nommer Poutine, Sergueï Kiriyenko, Yevgueniy Primakov et Sergueï Stepashin. Quand il s’est enfin décidé, il a présenté son successeur à Bill Clinton comme « un homme solide, au courant des différents sujets relevant de sa compétence. C’est aussi quelqu’un de rigoureux, fort et très sociable. »
Échaudé par l’instabilité de la décennie précédente, Poutine commence par assurer ses arrières. En 2001, une loi accorde au président russe l’immunité une fois son mandat terminé et une retraite de 580 035 roubles par mois, soit 8 460 euros. Puis la création du parti Russie unie lui assure une base parlementaire confortable, en sorte qu’il juge en mai 2003 que le gouvernement peut procéder de la majorité issue des législatives. Trois ans plus tard, le chef d’État change légèrement d’opinion.
« Je suis intimement convaincu qu’à l’ère post-soviétique, alors que notre économie se développe et que notre indépendance se consolide, de manière à définir les principes du fédéralisme, nous avons besoin d’un pouvoir présidentiel fort », affirme-t-il lors d’une conférence de presse. « Pour le moment, nous n’avons pas développé de partis politiques stables. Comment parler d’un gouvernement issu des partis dans ces conditions ? Ce serait irresponsable. »

Crédits : Kremlin
À la fin de son deuxième mandat, Poutine est si puissant qu’il est libre de choisir son successeur. Alors que certains observateurs redoutent un changement de la constitution de nature à lui permettre de rester en poste, comme Loukachenko et Karimov l’ont fait en Biélorussie et en Ouzbékistan, il assure vouloir respecter la loi fondamentale. « J’ai certaines idées sur la manière de faire évoluer la situation du pays pour ne pas le déstabiliser, pour ne pas faire peur aux gens et aux entreprises », déclare-t-il. Son choix se porte sur Medvedev, qui le nomme dans la foulée Premier ministre.
Poutine a beau avoir choisi son homme, des tensions apparaissent en 2011. Le pouvoir est contesté par de grandes manifestations de rue. Surtout, l’équipe de Dmitri Medvedev a laissé passer des résolutions aux Nations unies autorisant l’intervention d’une coalition internationale en Libye, entraînant le renversement de Mouammar Kadhafi. Cet épisode aurait convaincu Poutine de la nécessité de revenir à la présidence et aurait contribué à préciser sa stratégie au Moyen-Orient. Il s’est du reste montré résolument offensif sur la scène internationale, en annexant la Crimée en 2014. Depuis, la chute des cours du pétrole a en revanche entraîné une baisse du pouvoir d’achat.
Les mesures sociales annoncées le 15 janvier 2020 doivent contre-balancer ce bilan économique contrasté. La réforme de la constitution prévoit à ce titre une indexation du salaire minimum et des prestations sociales sur l’évolution du seuil de pauvreté. Avec le nouveau Premier ministre, Mikhaïl Michoustine, il possède quelqu’un qui « connaît très bien l’économie, s’est avéré compétent et est visiblement apprécié », remarque Jean Radvaniy. D’ici 2024, le chef d’État « va essayer différentes personnes à différents postes comme l’avait fait Eltsine ». Sauf qu’il n’est semble-t-il pas prêt à lâcher le pouvoir.
Couverture : Kremlin
L’article Poutine va-t-il diriger la Russie pour l’éternité ? est apparu en premier sur Ulyces.