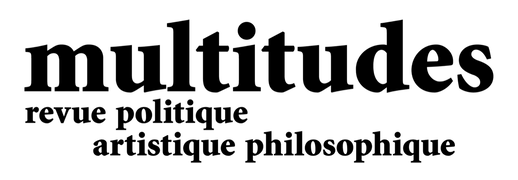20.12.2025 à 15:03
Les retraites, la dette, le déficit de la France Bis repetita ?
Moulier Boutang Yann
Sur le fond1, les derniers débats parlementaires des trois gouvernements qui ont suivi la dissolution de juin 2024 n’ont guère fait avancer le schmilblick des retraites. On suspend en renvoyant aux calendes présidentielles. Ce n’est plus une course en sacs de pommes de terre, c’est du super surplace, car si les gains de productivité qu’on … Continuer la lecture de Les retraites, la dette, le déficit de la France Bis repetita ? →
L’article Les retraites, la dette, le déficit de la France <br>Bis repetita ? est apparu en premier sur multitudes.
Texte intégral (3558 mots)
Sur le fond1, les derniers débats parlementaires des trois gouvernements qui ont suivi la dissolution de juin 2024 n’ont guère fait avancer le schmilblick des retraites. On suspend en renvoyant aux calendes présidentielles. Ce n’est plus une course en sacs de pommes de terre, c’est du super surplace, car si les gains de productivité qu’on peut attendre de l’application massive de l’IA sont une composante de rééquilibrage des comptes de financement des retraites, la répercussion sera forte sur l’emploi et sur le nombre de cotisants. On a donc toutes les chances de se trouver ramené à un déficit sérieux de financement du régime des retraites.
La fiction de l’âge pivot
On en est seulement à suspendre jusqu’en 2028 l’application de la réforme Elisabeth Borne après cinq réformes depuis la réforme Balladur. La détérioration de l’équilibre des tranches d’âges au détriment des actifs par rapport aux babyboomers arrivés à l’âge de la retraite fait que, dès 2035, l’aggravation du déficit impliquera une énième réforme. Nous commençons à payer la solution de facilité qui a consisté à encourager l’apprentissage et l’entrée des jeunes dès 24 ans sur le marché du travail. Comme le soulignaient Jean-Hervé Lorenzi et Benjamin Coriat dans un débat sur LCI, le 1er novembre dernier, comme il faudra avoir cotisé 43 années (172 trimestres) pour avoir une retraite à taux plein (réforme Marisol Touraine), ces jeunes devront donc travailler jusqu’à 67 ans même si la réforme Borne est abrogée. Donc, les travailleurs entrés le plus tôt sur le « marché » du travail, occupant les postes les moins qualifiés et souvent les plus pénibles, ont déjà basculé dans les 67 ans. Quant à ceux qui commencent à travailler vers 27 ans, c’est à 70 ans qu’ils pourront partir à taux plein.
Un autre problème crucial concernant la question des départs à taux plein n’est toujours pas réglé : la rémunération à l’ancienneté conduit mécaniquement les entreprises à se débarrasser de leurs salariés dès 50-55 ans pour alléger la masse salariale. Un grand nombre d’entre eux qui ne retrouvent pas de travail, n’atteignent pas les 43 ans de cotisations pour bénéficier d’une retraite à taux plein. Pourtant, il aurait été facile au Parlement de « cogner » impitoyablement sur les entreprises qui ont ce comportement (par une amende très dissuasive par exemple).
Avant de revenir à la recherche des recettes miracles, venons-en à la question de la réduction du déficit budgétaire par coupe dans les dépenses de l’État, plutôt que par augmentation de la pression fiscale. On n’évoque plus le pavé dans la mare, lancé par Jean-Louis Borloo, d’une fédéralisation de l’administration de l’État le plus centralisé d’Europe depuis l’Ancien Régime et qui coûte pourtant « un bras ». Prenons-en les vrais exemples, pas la dentelle de la suppression des comités Théodule qui ne se traduirait pas par de grosses économies. Évoquons plutôt la suppression des départements, et celle de plus de la moitié ou des 2/3 des 36 000 communes (et par voie de conséquence, du nombre de sénateurs). Et enfin, suggérons un principe sans lequel l’introduction de la proportionnelle est une joyeuse plaisanterie : le principe pour la Chambre basse que chaque député soit élu par le même nombre d’électeurs, ce qui revient à remonter le nombre de députés élus dans les circonscriptions urbaines et péri-urbaines et à baisser considérablement le nombre de députés issus de la « ruralité », ces modernes « bourgs pourris » dont l’Angleterre avait dû se débarrasser à la fin du XVIIIe siècle. Cette question très lourde, révolutionnaire même, ne se pose pas qu’en France. Elle correspond à l’émergence d’une simplification encore souterraine opérée par l’Union européenne qui n’a pas encore réalisé un saut fédéral dans son découpage administratif, même si l’échelle des régions (de taille très différente selon les pays) est d’ores et déjà l’unité de mesure des politiques structurelles qui sont les seules dépenses fédérales avec la Politique agricole commune. Elle explique largement l’impasse électorale observée dans de plus en plus de pays en butte à la montée d’une ruralité réactionnaire et identitaire de type Gilets jaunes, Ordre de Saint-Georges en Angleterre, ou des prurits hongrois et tchèques couplés souvent à un déclassement des cols bleus dans les anciens bassins industriels.
Ni Exit taxe ni taxe sur les holdings
Mais l’essentiel est sans doute ailleurs. Terminons cette course à l’échalote du gouvernement dans son sac de pommes de terre à propos du prélèvement fiscal. On est assez stupéfait, quand on connaît la réputation de la France pour son inventivité fiscale (la TVA) et alors qu’on discute des risques de la fuite à l’étranger (l’Italie est la dernière marotte, après la Belgique) des très riches et des entrepreneurs, de découvrir qu’aucune exit taxe (même restreinte à l’Union européenne) n’a été évoquée alors qu’elle existe aux États-Unis depuis 1862. De même que la taxe sur les holdings qui y existe depuis 1930.
Détricotage LR de la taxe sur les holdings et repli sur le patrimoine improductif, « les biens de luxe » ou somptuaires taxés à 20 % (œuvres d’art, bijoux, biens immobiliers qui n’ont pas d’usage « productif ») ; refus de la taxe Zucman de 2 % des patrimoines de plus de 100 millions d’euros, ainsi que de sa version allégée proposée par les socialistes de 3 % étendue aux fortunes de plus de 10 millions d’euros, mais avec exemptions pour les entreprises familiales possédant 51 % au moins du capital, et les entreprises innovantes. Voici le menu des débats parlementaires dans sa dernière version. Le Premier ministre a réaffirmé l’hostilité des macronistes mais aussi de la droite à toute taxe systématique sur les milliardaires. Thomas Piketty et Gabriel Zucman ont eu beau souligner le vertigineux enrichissement des très très riches (500 % en vingt ans) ; le Parti socialiste a eu beau en faire une de ses conditions pour ne pas censurer le gouvernement, rien n’y a fait. Sébastien Lecornu, fragile Premier ministre d’une Vème République qui se dirige tout droit vers la VIIème République (le pire de la IVe et le pire de la Ve sans le rêve LFIste de la VIe) a eu ce mot qui fleure bon le retour à la terre, toujours très coté en France : « Il ne faut pas tuer la vache si nous voulons son lait ». Un condensé de la sagesse paysanne très apprécié chez les députés du terroir ! En même temps une expression révélatrice de la mentalité rentière : faire son beurre avec le lait de la vache sans tuer la poule aux œufs d’or.
C’est à l’Assemblée nationale qu’il adressait son prêche. Une Assemblée dont la compétence économique n’est pas nécessairement le fort. Le problème est qu’il visait aussi les économistes, et non des moindres, qui ont renchéri bruyamment sur la protection de l’outil de production, Philippe Aghion, Alain Minc et tant d’autres. Une usine vaut bien un peu de laxisme fiscal ! Le problème est qu’innovation ou pas, la richesse économique, le bien-être, la croissance, sont ramenés finalement à un surplus digne des physiocrates d’avant la révolution industrielle, à une ignorance des mécanismes de la financiarisation moderne.
Et si les impasses de l’Assemblée nationale n’étaient que le reflet du grand désordre sous le ciel (celui notamment de l’écologie) comme dans les têtes qui règne aujourd’hui sur des questions simples : qu’est-ce que finalement la production ? Qui est productif ? Comment s’évalue la richesse ? Quel rôle joue l’argent, la finance ?
Le grand renversement du productif
Dans des économies développées, à l’heure du numérique et de l’IA, la qualité de la population (niveau d’éducation, santé, protection sociale, défense, niveau d’interactivité dans le marché mais aussi hors marché) est une variable qui l’emporte sur la quantité de la force de travail mobilisée dans les entreprises (le travail mesuré par le taux de chômage). La croissance inexorable de la dépense publique depuis la seconde guerre mondiale (entre 42 et 48 % du PIB dans les pays européens, à peine moins aux États-Unis) traduit cette réalité, mais aussi, le poids de l’économie sociale et solidaire qu’on s’obstine à confondre avec la charité publique. Voilà pourquoi les programmes néo-libéraux de réduire ce secteur décisif de la production d’une économie de bien-être ont finalement été tenus en échec malgré les apprentis tronçonneurs.
Un second élément, la révolution écologique, a complètement bouleversé notre représentation du travail productif. Dans la vulgate de la théorie industrielle de la valeur travail, l’entreprise était le sanctuaire intouchable de la valeur. L’entrepreneur, le capitaliste, soumis au défi permanent et parfois stimulant de la lutte de classe de leurs travailleurs dépendants et généralement salariés, en étaient les acteurs décisifs, les prêtres du culte de l’« enrichissez-vous » de Guizot. Son alpha et son oméga. Aujourd’hui, premier changement de la donne : l’entreprise ne produit pas que de la valeur, elle en détruit beaucoup. Son bilan écologique pour la survie de la planète et des écosystèmes complexes est très souvent négatif. Et ce, dans des proportions gigantesques.
Les industries, autrefois parangon ricardien de la lutte contre la rente précapitaliste dans nombre de secteurs, notamment les industries extractives, sont devenues rentières et provoquent des externalités négatives qui aggravent les déséquilibres écologiques. Même la production de biens censés corriger la crise écologique (éoliennes, voitures électriques) passés au rasoir d’Ockham écologique de l’émission totale de gaz à effet de serre sur l’ensemble du cycle de vie, ont une durée d’utilisation trop courte pour amortir les émissions de gaz à effet de serre que provoquent leur production, leur éventuel recyclage ou leur traitement comme déchet. La terre elle-même, exploitée sous forme de production des forêts de plantation ou de monoculture (agro-industrie même avec un usage limité des engrais ou de l’irrigation), est détruite comme ressource durable se reproduisant2.
Last but not least, lorsque l’on prend en compte un bilan total (analogue aux travaux de Léontiev sur la matrice des échanges inter-industriels) des externalités positives et négatives, on découvre que l’agent « productif » historique détruit plus de valeur qu’il n’en produit, tandis que de nouveaux agents producteurs d’externalités positives apparaissent. C’est ce que j’ai appelé le « paradigme de la pollinisation » qui produit entre 700 et 5 000 fois plus que la production enregistrée par le marché (par exemple, le miel de l’abeille).
On peut élargir le paradigme de la pollinisation à celui de la productivité stupéfiante des écosystèmes complexes. Quand la production humaine prend pour modèle la réalisation d’équivalents à des écosystèmes complexes, elle atteint un degré de productivité sans précédents historiques. Les rôles sont renversés par rapport à l’âge de l’industrie ricardienne et de la valeur travail qui deviennent, à leur insu, des expressions de la nouvelle forme de rente. Rente à combattre car elle conduit tout droit à l’extinction de la vie terrestre.
Économie pollinisatrice, productivité de la société
Reste un dernier point dans ce grand renversement dans lequel nous sommes entrés : l’argent et la finance, loin d’être ce repoussoir sale, miment en fait la pollinisation, le référent réel de la production étant fait d’externalités positives plusieurs centaines ou plusieurs milliers de fois supérieures en valeur à l’économie dite « réelle ». C’est du côté de cette économie pollinisée qu’il faut regarder et construire des modèles de prélèvements construits sur une assiette la plus large possible et à un niveau faible, presque indolore. Non pour taxer (au sens de punir) ou handicaper les forces productives pollinisatrices, mais parce qu’elles seules recèlent les ressources gigantesques nécessaires à la production, à l’entretien et à la survie d’une humanité pollinisatrice (la véritable qualité de la population).
Entre 1980 et 2024, le poids du commerce mondial, donc du développement des transactions financières et du secteur financier de l’économie, a été multiplié par 8,1 tandis que le PIB ne s’était accru que de 4,3. Après la crise de 2008, le rythme s’est aligné sur la croissance du PIB, a repris jusqu’à 2020, a baissé durant la période du Covid, mais a repris une croissance très rapide en 2024. La financiarisation de tout n’est pas un simple ajustement à une nouvelle donne, mais un régime de croissance spécifique d’une économie de pollinisation qui fait face aux énormes besoins de financement d’une économie de la transition écologique complexe. Rappelons qu’il faudrait investir peu ou prou en France plus de 1 500 milliards par an pour réduire les externalités négatives de la croissance polluante et restaurer les écosystèmes. Comment le faire ? Quand la France, comme le reste de l’Union européenne, fait face à la dette du système des retraites, à celle de la protection sociale, à la montée des dépenses de défense et enfin aux nécessités, soulignées par le rapport Draghi, d’investir beaucoup plus dans la recherche, la démocratisation de l’éducation, les technologies de pointe dont celle de l’IA ?
Ce problème n’est pas insoluble, contrairement aux « nouveaux cris de Cassandre » qui évoquent un gouffre et l’effondrement final. Car si la dette publique représente 120 % du PIB de 3 200 milliards, le patrimoine de l’État et des ménages est proche de 24 000 milliards et l’épargne des Français approche les 6 000 milliards. Le problème est que cette épargne française se place pour une moitié dans le financement de la dette américaine ! Et une bonne partie du reste figure dans les assurances-vie (ce qui traduit le souci des Français âgés à l’égard du montant de leur retraite).
Il faudrait donc attirer cette épargne dans l’écologie, les technologies de pointe, la défense (dont celle de l’Ukraine). C’est certes une affaire d’attractivité des taux servis à cette épargne, mais la caution d’État diminue le risque encouru. Et surtout, comme chaque fois qu’il est question de mobilisation de ressources financières en vue de financer un ou plusieurs gros projets, la monnaie est le lien avec le futur, nous a appris Keynes, et le type de monnaie créée est étroitement corrélé à la croyance : foi dans la transition écologique, confiance entre les générations dans un système de retraite par répartition, croyance en un futur européen sûr, adhésion résolue au pouvoir positif de transformation des technologies, en particulier la mutation numérique. La crise budgétaire (un vieil avatar de la Monarchie française de Philippe IV le Bel à Louis XV ou moment critique des diverses Républiques) ne peut se résoudre que si la finance est sollicitée à la fois comme ressource fiscale prioritaire, comme vecteur d’innovation et de confiance dans l’avenir.
Taxe homéopathique sur les transactions financières
Le vieil appareil de prélèvement fiscal est usé jusqu’à la corde. Une conception rétrograde de la valeur et de l’économie fétichise comme une zone taboue l’entreprise, un secteur productif (autrefois le seul), alors que la productivité de la société, une société pollinisatrice en bonne santé écologique, est vitale. L’invention de la TVA, adoptée mondialement, avait considéré l’appareil productif comme un flux global. Dans une économie de pollinisation de plus en plus financiarisée, il faut instaurer une taxe très faible de 0,2 à 0,5 % sur toutes les transactions financières y compris celles qui s’opèrent à travers les opérations à très haute fréquence intra-journalière, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui. La majeure partie de l’augmentation de la fortune des très très riches vient d’un placement de leurs revenus et profits dans divers marchés boursiers (ceux des actions des holdings qu’ils contrôlent en particulier) ou financiers (ceux des dettes des entreprises, de l’État) qui varient quotidiennement, mais également heure par heure et seconde par seconde.
Il reste, pour faire face à l’échec de l’État-providence, à régler la question de la pauvreté (entre 12 et 16 % de la population), à instaurer un revenu d’existence universel inconditionnel et cumulable et redessiner ainsi complètement la cartographie des aides sociales.
Mesdames et Messieurs les député·es, Monsieur le Premier ministre, il y a du pain sur planche au lieu de refaire la énième course à l’échalote !
1Le 23 mars 2023 en pleine bagarre sur la réforme des retraites où Elisabeth Borne fit passer grâce à l’article 49.3 l’âge de départ à 64 ans (« âge pivot ») contre l’opposition majoritaire à la Chambre des députés, j’avais adressé à la direction du parti des Verts (à l’époque, Europe, Écologie, les Verts) une lettre assez sévère sur le spectacle affligeant donné par le Gouvernement, les partenaires sociaux, les partis politiques de gauche, de droite et des centres. Nous conseillons aux lecteurs de s’y reporter avant de lire cet HO. Il se trouve sur multitudes.net sous le titre « La lutte sur les retraites : une course en sacs de pommes de terre ? ».
2Voir les travaux pionniers de Lydia et Claude Bourguignon, fondateurs du LAMS, Laboratoire d’analyse microbiologique des sols.
L’article Les retraites, la dette, le déficit de la France <br>Bis repetita ? est apparu en premier sur multitudes.
20.12.2025 à 14:50
Consulter les œuvres de Bianca Dacosta
multitudes
L’article Consulter les œuvres de Bianca Dacosta est apparu en premier sur multitudes.
Texte intégral (843 mots)























L’article Consulter les œuvres de Bianca Dacosta est apparu en premier sur multitudes.
20.12.2025 à 14:27
Voyage au Centre de la Terre
multitudes
Avec son film Interior da terra1 tourné en 2022 en Amazonie, tout en remontant le fleuve Madeira, Bianca Dacosta2 nous invite à un voyage au centre de la Terre. Toutefois, à la différence de Jules Verne, on n’y arrive pas par un volcan situé en Islande mais par la forêt amazonienne… Comme l’expriment des activistes … Continuer la lecture de Voyage au Centre de la Terre →
L’article Voyage au Centre de la Terre est apparu en premier sur multitudes.
Texte intégral (3868 mots)
Avec son film Interior da terra1 tourné en 2022 en Amazonie, tout en remontant le fleuve Madeira, Bianca Dacosta2 nous invite à un voyage au centre de la Terre. Toutefois, à la différence de Jules Verne, on n’y arrive pas par un volcan situé en Islande mais par la forêt amazonienne… Comme l’expriment des activistes comme Eliane Brum, « à l’aube de l’effondrement climatique et de la sixième extinction massive d’espèces provoquée par l’action humaine, la plus grande forêt tropicale de la planète est le centre du monde3 » au même titre que des villes telles que Washington, Londres, Paris, Francfort, Hong Kong, Moscou, Pékin. Pour l’anthropologue Francy Baniwa (2023), il s’agirait de son nombril même, d’où proviendrait une humanité composée de tous les peuples. C’est donc par cette voie-là, par les territoires de la forêt amazonienne, si disputés par des acteurs liés à des activités d’agriculture et d’extractivisme à la légalité variable, que Bianca nous emmène connaître les entrailles de notre planète Terre ainsi que les luttes des peuples indigènes du Brésil pour leurs territoires. Pour ce faire, Bianca s’empare d’une panoplie de technologies d’image : la géolocalisation avec l’application « Avenza », les données de l’INPE – Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais – qui permettent de localiser et voir la déforestation, un drone offrant d’amples prises de vues macro de ces territoires et puis, tout à coup, grâce à un microscope électronique, nous plongeons dans un sol mélangé à des fragments de bois brûlé.
Ces jeux d’échelle – du micro au macro, du plus haut au plus ras – n’est pas tout à fait nouveau. Le film Powers of Ten de Charles et Ray Eames nous initiait déjà en 1977 à ces voyages multiscalaires. Le film de Bianca Dacosta vise à matérialiser, par l’image, un voyage au cœur même de la forêt et au sein de ses multiples matérialités et mémoires. Ces couches d’histoire restent présentes dans la mémoire de Marcia Mura qui, tout en fumant une pipe, chante et raconte l’effacement de son peuple. Expulsés de ces territoires, iels ne vivent plus là mais leurs traces restent inscrites dans les strates terrestres comme une mémoire de la matière4.
Tout récemment, l’archéologue Eduardo Goes Neves a démontré en étudiant les propriétés des sols que des populations autochtones y vivent depuis 11 000 ans, au début de l’Holocène. Ces sols sont donc des « archives » de ces vies, des archives vivantes. Durant son séjour en Amazonie pour le tournage de ce film, Bianca Dacosta a également réalisé en parallèle la série photographique Traga Terra (Avalez la Terre, 2022) qui montre le contexte plus général de l’extraction de l’or, ainsi que Dorsale 5 qui met en lumière, au plus près des éléments, les cicatrices produites sur les arbres à caoutchouc. Elle réunit quelques-unes de ces photos dans la boîte à tiroir Mémoires de Nazaré (2022) pour signaler les liens profonds entre les mémoires des populations d’humains et celles des non-humains de la forêt.
Ce que montre cette panoplie d’images macroscopiques et microscopiques, est l’ambivalence même des technologies contemporaines : les technologies qui permettent de lutter contre la déforestation sont également celles qui favorisent la destruction des forêts. L’usage de ces moyens d’observation terrestre crée de véritables confrontations entre technophiles et technophobes. Comment faire ce voyage à travers les techniques les plus sophistiquées de notre modernité tardive sans perdre notre sensibilité ? Le terraforming 6 anthropogénique est mis sous tension par des terraformations terrestres ainsi que par des anthropophagies technologiques. Toutefois, l’invitation faite par Bianca semble démontrer qu’il est possible d’accomplir ce voyage par une technicité développée sans doute dans de nombreux allers-retours entre deux continents, entre le vieux monde et le nouveau monde. Ces allers-retours sont eux-mêmes une technique anthropologique et artistique qui nous affectent toustes durant ces parcours.
De l’anthropophagie des Tupinambás aux technophagies contemporaines
En effet, les voyages entre deux continents impliquent eux-mêmes un arsenal technologique, depuis les caravelles d’autrefois jusqu’aux avions d’aujourd’hui – énormes oiseaux bravant les cieux et leurs turbulences. Les relations entre le Brésil et la France sont tissées par des intérêts économiques bien évidemment, mais aussi par des amitiés intellectuelles et culturelles de longue date7 que le travail artistique de Bianca ravive tout en rappelant des épisodes oubliés et souvent troublants. C’est le cas d’une colonie française de courte durée à Rio de Janeiro, la France Antarctique, qui a existé de 1555 à 1560 grâce à une alliance entre Français et autochtones.
Tout récemment, Bianca Dacosta a démarré un travail d’appropriation d’images archivées à la BnF (Bibliothèque nationale de France). Ces images ont été sélectionnées, d’une part, dans Les singularités de la France Antarctique (1557) et La Cosmographie Universelle (1575) écrits par André Thévet, cosmographe du roi de France, catholique et d’autre part, dans Histoire d’un Voyage fait en la terre du Brésil autrement dite Amérique de Jean de Léry (1536-1613), un Français envoyé en 1556 par Jean Calvin avec treize Genevois en France Antarctique, qui revint de ce voyage en 1560 et dont le livre fut publié en 1578.
Les deux voyageurs ont été en contact avec des autochtones : les Tamoios mais aussi les Tupinambás connus pour leur anthropophagie. Les récits que les deux voyageurs rapportent sont tout à fait opposés en ce qui concerne l’anthropophagie : André Thévet condamne les pratiques des Tupinambás comme les plus cruelles au monde alors que Jean de Léry cherche à les comprendre. André Thévet prétend justifier, au nom de la propagation de la foi chrétienne, tout à la fois les atrocités des conquistadores contre les autochtones du Nouveau Monde et les atrocités des catholiques contre les protestants durant la Saint Barthélémy dans le Vieux Monde. Tandis que Jean de Léry considère ces atrocités religieuses plus sauvages encore que les coutumes anthropophages.
Quelque quatre cents ans plus tard, le fait anthropophagique a été reformulé culturellement par Oswald de Andrade dans son manifeste Anthropophage de 1928. À travers l’expression « Tupy or Not Tupy, telle est la question ! » Oswald refuse à la fois l’idée du « bon sauvage » mais, également, celle d’un indigène sauvage tout court. Les indigènes du Brésil sont modernes, ou plutôt, sont avides voire gourmands de modernité. Aujourd’hui, nombreux sont les artistes et intellectuel·les indigènes revendiquant une « ré-anthropophagie ». Cent ans après Le manifeste Anthropophage, l’anthropophagie revient sur scène, revue par les véritables protagonistes : un banquet dont le plat principal sont les technologies et les connaissances de la Terre et des terres.
Technologies synthétiques, technologies organiques
Ces technologies de la Terre et des terres proviennent également des quilombolas8. C’est le cas d’Antonio Bispo dos Santos lorsqu’il appelle à contredire les mots coloniaux afin de les affaiblir : « Pour affaiblir le développement durable, nous avons introduit la bio-interaction ; pour la coïncidence, nous avons introduit la confluence ; pour le savoir synthétique, le savoir organique ; pour le transport, la transfluence ; pour l’argent (ou l’échange), le partage ; pour la colonisation, la contre-colonisation… et ainsi de suite ». Selon Dos Santos, si les savoirs des peuples quilombolas confluent aisément avec ceux des peuples indigènes, ils ne peuvent établir qu’un rapport de contre-colonisation avec les savoirs coloniaux.
Dans La Pensée Sauvage, Claude Lévi-Strauss démontrait déjà les différences entre savoirs scientifiques et savoirs traditionnels. Plus récemment, dans Savoir traditionnel, droits intellectuels et dialectique de la culture, Manuela Carneiro da Cunha raconte comment deux groupes d’une même ethnie ont établi différents rapports avec l’industrie pharmaceutique et l’Université dans le cas d’échanges concernant leurs savoirs. Savoirs synthétiques et savoirs organiques ont, par confluences et contre-colonisations, des rapports intriqués qui se complexifient encore avec l’appel à la décolonisation. Or Dos Santos affirme ne pouvoir comprendre le suffixe « dé » que comme signifiant « déclin, détérioration, décomposition » du colonialisme (2025). Il affirme que, dès lors, les favelas – les quilombos urbains contemporains – doivent pirater les technologies, pirater tout ce qui est possible, à partir des technologies et des savoirs de son peuple. Ne serait-ce pas une autre façon de convoquer d’autres « dé » tels que dévoration, déglutition, dévolution ? Si l’anthropophagie est toujours là, désormais, ce sont d’autres technophagies qui émergent.
À propos de digestion… le manioc est une plante présente depuis toujours dans l’alimentation autochtone en Amérique du Sud et qui a été pleinement intégrée à la cuisine brésilienne. Bianca Dacosta réutilise ainsi deux illustrations du livre Singularités de la France antarctique d’André Thevet pour créer son installation « Racines de Manioc ». Libérée du livre qui témoigne de cette rencontre en France Antarctique, la gravure a été agrandie sur du lin recyclé et cohabite, dans l’espace d’exposition, avec des grappes de « fruits de la terre » en céramique et de « fruits du manioc » en bioplastique – matériau obtenu à partir d’ingrédients naturels – dont les couleurs, textures et odeurs composent une image du monde complexe qu’il nous faut créer pour sortir de l’âge des énergies fossiles fournies par les entrailles de la Terre.
Dévorer archives et icônes : de la chair aux codes
De l’ouvrage, Les singularités de la France Antarctique, Bianca Dacosta extrait la gravure d’« arbre nommé acajou » et y expérimente quelques « effacements » par IA. Dans Histoire d’un Voyage fait en la terre du Brésil autrement dite Amérique, elle isole la gravure représentant les esprits malins tourmentant des Indiens du Brésil. Jean de Léry considère que, malgré leur ignorance, les indigènes croient en l’immortalité des âmes : ceux qui auraient vécu vertueusement « c’est-à-dire selon eux, qui se sont bien vengés, et ont beaucoup mangé de leurs ennemis » (Léry, p. 216-217) iront dans les hautes montagnes où ils danseront avec leurs ancêtres, tandis que ceux qui n’auraient pas vécu de manière appropriée iront avec Aygnan, le diable.
Bianca décompose cette image, la dispose en différentes plaques de verre et « zoome » sur certains éléments dont les « esprits malins ». Cette fois-ci, l’installation met en rapport non pas la tension entre savoirs scientifiques (synthétiques) et savoirs traditionnels (organiques), mais plutôt le conflit entre religions monothéistes et cosmologies autochtones. Thévet a proposé une appropriation culturelle sous le schéma dichotomique d’un affrontement entre le Bien et le Mal… Bianca Dacosta – tel un esprit malin – joue avec les ambiguïtés, les transparences, les calques, les passages d’une couche à l’autre par la technique du sablage sur verre, les enchevêtrements de matières, formes et structures.
Au-delà du travail sur l’image elle-même, différents dispositifs de visualisation se trouvent expérimentés, des loupes aux lecteurs de microfilms présents à la BnF 9, pour, suivant la leçon de Jonathan Crary ou John Berger, observer les observateurs. Bianca Dacosta creuse cette modernité visuellement appareillée et cherche à donner à voir au-delà de ladite objectivité scientifique. Encore une fois, toute une panoplie technologique permet de sonder non plus les sols mais les archives, de s’approprier non plus des chairs mais des codes. Ces explorations archivistiques réveillent des fantômes, révèlent des strates de mémoires oubliées mais permettent surtout de réinventer des avenirs. Une puissance créatrice réinventant des temps par l’image fait irruption au sein même de l’institution chargée de conserver l’histoire dans sa quiétude… une puissance iconophage.
Revenons à Lévi-Strauss. Il cite les mythes du lynx (un félin) et du coyote (un canidé) pour expliquer la formation des sociétés amérindiennes selon le « modèle d’une série de bipartitions » – le ciel et la terre, le haut et le bas, le brouillard et le vent – à partir desquels les indigènes créent un rapport à l’autre (les non indigènes) au sein même de leur existence. Que cela soit au Canada, au Mexique, au Pérou, ou au Brésil, il démontre une extraordinaire capacité d’ouverture du point de vue matériel et symbolique. « Les traditions indigènes se sont largement ouvertes à celles des nouveaux arrivants, et les mythes de la région ont été si profondément imprégnés par les contes populaires français qu’il est devenu difficile de séparer les éléments autochtones des emprunts » (2022 : 70). L’anthropologue insiste sur le dynamisme du dualisme amérindien : « ce dualisme, toutefois, n’est pas statique. Quelle que soit la manière dont il se manifeste, ses termes sont toujours en équilibre instable. D’où le dynamisme d’une ouverture à l’autre qui s’est traduit par l’accueil que les indigènes ont réservé aux Blancs, même lorsque ces derniers ont fait preuve de dispositions tout à fait contraires. » (2022)
La France Antarctique comme tentative de colonisation française s’est terminée en 1560 mais, dynamique, la « tradition » anthropophage a continué à se déployer entre le Brésil et la France entre technophagies et iconophagies délicieuses, avec toute une gamme d’amitiés et d’animosités. Bonne dégustation !
Bibliographie
Antonio Bispo dos Santos, La terre donne, la terre veut, Marseille : Éditions Wild Project, 2025.
https://wildproject.org/auteurs/antonio-bispo-dos-santos
Antonio Bispo dos Santos, A terra dá, a terra quer. São Paulo : Ubu Editora / Piseagrama, 2024.
Benjamin Bratton, La Terraformation. Dijon, Paris: Les Presses du Réel, Artec, 2021: www.lespressesdureel.com/ouvrage.php?id=8741&menu=0
Claude Lévi-Strauss. Somos todos canibais. São Paulo : Editora 34, 2022.
Nous sommes tous des cannibales. Paris : Éditions du Seuil, 2013.
Eduardo Góes Neves, Sob os tempos do Equinócio – oito mil anos de história na Amazônia Central. São Paulo : Ubu Editora / Editora da Universidade de São Paulo, 2022.
Eliana Brum, Banzeiro Òkòtó – uma viagem à Amazônia centro do mundo. São Paulo : Companhia das Letras, 2021.
Francy Baniwa, O umbigo do mundo. Rio de Janeiro : editora Dantes, 2023.
Jean de Léry. Le voyage au Brésil de Jean de Léry 1556‑1558 avec une introduction de Charly Clerc. Paris : Payot, 1927.
Manuela Carneiro da Cunha. Cultura com aspas e outros ensaios. São Paulo: Cosac Naify, 2009.
Savoir traditionnel, droits intellectuels et dialectique de la culture [2006]. Paris : Éd. de l’Éclat, 2010.
1https://openprocess.lefresnoy.net/interior-da-terra
2Bianca Dacosta est actuellement en pré-doctorat à la Plateforme Art, Design et Société coordonnée par Francesca Cozzolino : Plateformeartdesignsociete.ensadlab.fr
3Brum, Eliane, Banzeiro Okotò – Uma viagem à Amazônia centro do mundo. São Paulo : Companhia das Letras, 2021, p. 341.
4www.bnf.fr/fr/jecoute-ce-que-les-archives-ont-me-dire
5www.artcena.fr/sites/default/files/medias/Bianca_Dacosta_2023-terra-perdida-presentation_.pdf
6Bratton, Benjamin, La Terraformation. Dijon, Paris: Les Presses du Réel, Artec, 2021: www.lespressesdureel.com/ouvrage.php?id=8741&menu=0
7Nombreux sont les Français ayant séjourné à São Paulo et à Rio (Claude Lévi-Strauss et Michel Foucault parmi d’autres), et les Brésiliens ayant séjourné à Paris (Oswald de Andrade et Tarsila do Amaral parmi d’autres).
8Au Brésil, le terme quilombola désigne les descendants des communautés formées par des esclaves fugitifs pendant la période de l’esclavage et qui, aujourd’hui, revendiquent la propriété de ces territoires.
9www.bnf.fr/fr/jecoute-ce-que-les-archives-ont-me-dire
L’article Voyage au Centre de la Terre est apparu en premier sur multitudes.
20.12.2025 à 14:10
Les soulèvements de la génération Z
multitudes
Le 25 juin 2025 au Kenya, un an jour pour jour après une manifestation dont la répression par la police du président William Ruto avait fait seize morts, des milliers de jeunes marchent à nouveau, en mémoire de ces victimes et pour réclamer plus de justice sociale. Le 25 août 2025, c’est dans une vingtaine … Continuer la lecture de Les soulèvements de la génération Z →
L’article Les soulèvements de la génération Z est apparu en premier sur multitudes.
Texte intégral (2475 mots)
Le 25 juin 2025 au Kenya, un an jour pour jour après une manifestation dont la répression par la police du président William Ruto avait fait seize morts, des milliers de jeunes marchent à nouveau, en mémoire de ces victimes et pour réclamer plus de justice sociale.
Le 25 août 2025, c’est dans une vingtaine de villes d’Indonésie que la jeunesse se soulève, pour une troisième vague de révoltes suscitant là aussi une réplique mortelle du pouvoir.
Entre le 8 et le 13 septembre 2025, le Népal s’enflamme après l’interdiction des réseaux sociaux par le Gouvernement, avec là encore des étudiants et de jeunes citoyens en première ligne.
Peu après, entre le 25 septembre et le 14 octobre 2025, se succèdent les manifestations à Madagascar, contre la corruption et les trop fréquentes coupures d’eau et d’électricité.
À partir du 30 septembre et pendant le mois d’octobre dernier, c’est au Maroc qu’un mouvement baptisé GenZ-212 (le 212 étant l’indicatif téléphonique du pays), s’étend dans plusieurs villes pour protester contre les investissements pharaoniques pour les stades de football1, la pauvreté galopante, l’état déplorable des hôpitaux et plus largement des services publics.
Et le 16 octobre au Pérou, sur le continent américain cette fois, le soulèvement naît d’une même jeunesse qui transmet un même message de ras-le-bol social et d’exigences démocratiques… Avec, en réponse, une même violence du pouvoir, marquée par le décès très symbolique d’un rappeur de 32 ans, mais aussi, une promesse dont la portée dépasse les frontières des nations : « La jeunesse unie ne sera jamais vaincue. »
Le Kenya, l’Indonésie, le Népal, le Maroc, Madagascar, le Pérou, mais aussi, depuis plus d’un an, le Bangladesh, les Philippines ou encore, la Serbie : partout sur la planète semble se révolter ce que d’aucuns appellent la génération Z, c’est-à-dire, des jeunes âgés de 13 à 28 ans.
À chaque fois, les manifestants se lèvent contre la corruption du pouvoir, pour plus de justice sociale et des actions tangibles pour la santé, l’éducation ou l’emploi. La répression est systématique, mais les conséquences varient évidemment en fonction des situations et contextes politiques de chaque pays.
Des mouvements aux horizons disparates d’un pays à un autre
À l’instar de la loi de finance que prévoyait d’imposer le président du Kenya à fin 2024 et dont la mise en place a été annulée, les gouvernements reculent ici et là, histoire de rester en place malgré la colère des populations.
En Serbie, par exemple, trois mois après la mort de quatorze personnes suite à l’effondrement d’un auvent de la gare de la ville de Novi Sad le 1er novembre 2024, le premier ministre démissionne suite aux manifestations, tandis que s’accroche à son fauteuil doré le président de droite nationaliste, Aleksandar Vucic.
Parfois, ce sont des militaires qui prennent le relais. C’est ce qui s’est passé à Madagascar le samedi 11 octobre 2025 à 5 heures du matin, lorsque les soldats du Corps d’armée des personnels et services administratifs ont ouvertement pris le parti des protestataires de la génération Z contre le président Andry Rajoelina…
Au Maroc, le mouvement populaire est parti de la mort de jeunes femmes lors de complications suite à leurs accouchements. La jeunesse exprime dans les cortèges sa colère au travers d’un message intergénérationnel : « Nous défendons nos mères ». Ce slogan, à la fois spontané et réfléchi, s’ancre dans l’évolution récente du paysage médical au Maroc, marqué par un fort processus de privatisation. Focalisée sur les « services publics », cette mobilisation raccourcit dès lors la distance entre les enjeux du Maghreb, voire de l’Afrique, et le contexte social des démocraties européennes.
Cas de figure tout autre au Bangladesh : motivés par le refus d’une loi réservant 30 % des postes de fonctionnaires aux descendants des combattants indépendantistes, les soulèvements de juillet 2024 ont provoqué la création du Parti national des citoyens (le NCP) par les étudiants… Mais la suite pose question. En effet, en novembre 2025, les élections ne sont plus à l’ordre du jour et le Jamaat-i-islami, Parti islamiste historique, courtise ce nouveau parti pourtant issu d’un élan protestataire. De fait, le Bangladesh poursuit son évolution vers toujours plus de réislamisation, au détriment du droit des femmes, depuis la fin en 2024 du règne corrompu et violent de Sheikh Hasina, qui s’était elle-même alliée aux islamistes…
Contre la corruption, culture pop et vigilance démocratique
Les soulèvements de ladite génération Z seraient-ils « destituants », mais jamais réellement « constituants » d’alternatives politiques solides sur le long terme ? Sans doute faut-il se méfier de conclusions trop hâtives.
Peut-être convient-il aussi, avant toute analyse forcément partielle et partiale, en particulier depuis quelque salon parisien, de se féliciter d’une tendance planétaire pouvant être interprétée comme une réponse salutaire à l’incurie de pouvoirs bunkérisés, violents et corrompus partout dans le monde, mais également comme un contrepoint bienvenu à la montée des populismes d’extrême-droite.
La politique se construit par des flux et des reflux de moments de régression et d’élans émancipateurs, des allers et retours le plus souvent imprévisibles entre soumissions et protestations, réactions et rébellions, vagues conservatrices et courants libérateurs. Sous ce regard, les soulèvements pluriels de ladite jeunesse, d’évidence toujours accompagnée d’acteurs plus âgés et d’origines diverses, sont des indéniables signes d’espoir démocratique. Ils méritent d’être analysés en tant que tels, dans leurs différences comme dans leurs points de convergence.
L’une de leurs spécificités communes est l’absence de leaders autoproclamés ou reconnus auprès des médias ou décideurs, ainsi que la volonté de préserver la dimension collégiale de leur gouvernance – pour peu que celle-ci existe ouvertement. Ces mouvements se revendiquent « autonomes ». C’est pourquoi les jeunes, lorsqu’ils se mobilisent, cultivent dès les premières manifestations une méfiance vis-à-vis des syndicats et des partis institués – que cette mise à distance perdure comme en Serbie ou s’effiloche peu à peu comme au Bangladesh.
Cette défiance vis-à-vis des institutions et cette rébellion contre les élites de leur pays pourrait avoir comme symbole l’utilisation, par les révoltés, de Tananarive à Madagascar à Lima au Pérou, du pavillon des pirates au chapeau de paille de Monkey D. Luffy, figure majeure de la série d’animation japonaise One Piece. Cet emblème hybride la tête de mort sur fond noir, étendard hors-la-loi des pirates des mers, et clin d’œil aux hackers, au couvre-chef modeste des travailleurs de la terre, héritier d’une mémoire collective des paysans en lutte contre leur exploitation. Il incarne l’histoire d’un personnage qui, s’envolant sur son navire pour une chasse au trésor, en vient à fédérer un collectif de soutien aux laissés-pour-compte. À militer et à agir pour un changement de société. De fait, ce drapeau noir détourné du manga One Piece est la plus signifiante des références à une culture populaire mondialisée que mobilisent les jeunes dans les rues. Il est le symptôme d’une tentative de revitalisation des codes de la protestation – et d’une volonté de dialogue à l’échelle internationale qui semble plus manifeste encore qu’au début des années 2010.
Dernier détail d’importance : non seulement les imaginaires, mais aussi les outils du numérique sont très « naturellement » utilisés par les jeunes récalcitrants en quête de démocratie. C’est l’un des points communs avec les « printemps arabes » de 2011. Sauf que cette fois, Facebook est, pour de multiples raisons, de surveillance notamment, moins prisé : le principal outil est la plateforme de messagerie Discord, très largement adoptée par le monde du jeu vidéo, et qui compte tout de même plus de 600 millions d’utilisateurs dans le monde.
Des perspectives sociales et politiques en devenir
Qui sait si de tels mouvements de la « Gen Z » ne pourraient contaminer demain d’autres pays, de l’Afrique aux Amériques en passant par l’Europe ? Pourquoi pas la France, le Canada, le Brésil, etc. ?
Les soulèvements récents, du Kenya au Pérou en passant par Madagascar, n’ont aucun rapport direct avec les mobilisations des jeunes lycéens et étudiants – de cette même génération Z donc – en Europe et aux États-Unis, d’une part contre le réchauffement climatique au travers de grandes manifestations, d’autre part contre le « génocide » de tout un peuple à Gaza, en particulier par l’occupation de campus. Ils s’engagent moins sur des enjeux écologiques et politiques globaux que, plus prosaïquement, sur des problèmes sociaux, contre la précarité et contre la corruption qui bloquent toute amélioration de leurs conditions de vie au quotidien. Mais au-delà de causes et de modalités d’engagement différentes, ces deux types de mouvement partagent, outre le jeune âge de leurs acteurs majeurs, une façon vive et résolue de s’opposer au silence, voire au mépris des élites et des gouvernements.
Rien n’interdit donc d’envisager la potentialité de convergences futures entre les problématiques sociales, écologiques et politiques des uns et des autres.
L’enjeu n’est pas d’idéaliser la jeunesse, qui, bien sûr, ne peut intégralement se retrouver dans de tels soulèvements, et ce d’autant qu’elle doit composer avec des régimes politiques le plus souvent aussi délétères dans leur propagande et leur dispositif répressif que peu disposés à laisser quelque place pour plus de démocratie.
Force est néanmoins de reconnaître la lucidité des mouvements qui se développent grâce à la jeunesse de la Serbie au Maroc et du Népal au Pérou, tant sur le fond que sur la forme horizontale de leur démarche. L’exemple des longues marches des jeunes Serbes, de villes comme Novi Sad aux villages qu’ils souhaitent également toucher, est à ce titre très instructif. Si les principes qu’ils revendiquent semblent bien éloignés du populisme xénophobe qui semble faire florès dans les pays de l’ex-Europe de l’Est, ils ne répondent pas aux provocations d’un pouvoir les accusant d’être pilotés par l’étranger : le 1er novembre 2025, même si l’envie ne manquait pas, il n’y avait pas de drapeau européen dans la manifestation en hommage aux victimes d’il y un an…
Ces soulèvements ne vont pas changer le monde du jour au lendemain. Leurs revendications sont moins révolutionnaires que pragmatiques, dans l’ici et le maintenant des lieux où ils naissent. Ils vont encore et toujours se heurter à la violence de la répression – comme hier en Iran et ailleurs. Les désillusions ne manqueront pas, à l’instar de la façon dont la réaction islamiste semble avoir récupéré la vague rebelle au Bangladesh. Mais ces soulèvements, qui s’étendent et perdurent sans perdre leur sens dans la majorité des pays concernés, ont la capacité à se constituer demain en de véritables contre-pouvoir, en particulier s’ils trouvent des alliés qu’ils réussissent à maintenir à bonne distance. Parier sur eux n’est pas vain. Car ils sèment aujourd’hui des graines pour des lendemains plus lumineux.
1Coupe d’Afrique des nations au Maroc du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026, mais aussi Coupe du monde de football de 2030 coorganisée par le Maroc, le Portugal et l’Espagne.
L’article Les soulèvements de la génération Z est apparu en premier sur multitudes.
20.12.2025 à 14:02
Sortir l’IA des nuages Vers une utilisation locale des IA LLM
multitudes
Comment lutter contre la destruction de l’environnement par le numérique alors que les géants de la tech envisagent de construire des data centers de la taille de Manhattan ? Que faire face au péril écologique et politique de l’IA ? Le désespoir ne manque pas. Légion sont ceux qui s’enveniment l’esprit de passions tristes, et dont le … Continuer la lecture de Sortir l’IA des nuages Vers une utilisation locale des IA LLM →
L’article Sortir l’IA des nuages <br>Vers une utilisation locale des IA LLM est apparu en premier sur multitudes.
Texte intégral (2730 mots)
Comment lutter contre la destruction de l’environnement par le numérique alors que les géants de la tech envisagent de construire des data centers de la taille de Manhattan ? Que faire face au péril écologique et politique de l’IA ? Le désespoir ne manque pas. Légion sont ceux qui s’enveniment l’esprit de passions tristes, et dont le sommeil dogmatique paralyse l’action. Réveillez-vous ! Ni enfer ni paradis ne vous attendent. Les générations futures attendent de vous un sursaut d’intelligence collective vers un monde durable. Il est temps de s’engager ensemble dans la dynamique de réappropriation de nos données, de nos immatériels et de nos IA.
De quelle manière ? Peut-être pourrait-on commencer par changer nos usages en utilisant les IA en local sur nos ordinateurs. De fait, on peut par exemple utiliser des plateformes comme Docker Model Runner1 pour faire tourner sa propre IA sur son ordinateur et ainsi contrôler son impact environnemental tout en préservant la confidentialité de ses données personnelles. C’est dans cette visée que cet « À chaud » se propose d’introduire le lecteur à une utilisation de l’IA en local en montrant avant tout le bénéfice écologique et politique que cela apporterait.
Pourquoi est-il urgent de changer nos usages de l’IA ?
Le numérique, dont le greenwashing ne fait plus illusion, est aujourd’hui rattrapé par le poids de sa matérialité. Loin d’alléger sa part dans la crise climatique, il représente aujourd’hui environ 3,9 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre (ce qui est équivalent au transport aérien) et suit une trajectoire de croissance que les estimations jugent deux fois plus rapide que la moyenne mondiale des autres secteurs2.
La frénésie de l’IA s’inscrit précisément dans cette dynamique d’emballement, où chaque avancée technologique est immédiatement absorbée par une infrastructure toujours plus énergivore et carbonée3. Aussi, malgré d’impressionnants gains d’efficacité, la consommation énergétique des data centers n’a été que marginalement contenue (+6 % entre 2010 et 2020), alors que leur capacité de calcul a explosé de 550 %. On est aujourd’hui face à un effet rebond directement lié à la course au développement de l’IA dont l’usage se généralise et dont les perspectives de progrès reposent sur l’extension des jeux de données et l’augmentation de la taille des paramètres.
Le marché spécule sur des modèles toujours plus « larges ». Seulement, à mesure que les jeux de données s’élargissent, les corrélations fallacieuses augmentent dans le paramétrage. On en arrive à produire des « IA dégénératives » accumulant du bruit dans leur système dont le progrès vers « l’IA générale » rêvée est en l’état inconcevable. La loi d’échelle appliquée à l’amélioration des IA LLM4, c’est-à-dire, à la diminution du taux d’erreur, représente un coût astronomique en taille, données et énergie des modèles5. Chaque division par dix du taux d’erreur requiert une multiplication des ressources d’apprentissage (paramètres et données) par 1010 (dix puissance 10). Cette même division par dix du taux d’erreur implique une augmentation par 10²⁰ (dix puissance vingt) de la consommation énergétique. L’IA générale à l’abri de l’erreur est inconcevable du point de vue énergétique et pourtant, elle fait spéculer le marché qui s’endette jusqu’à 3 000 milliards de dollars pour la faire naître6. En attendant, l’entraînement d’un seul modèle d’IA générative, type ChatGPT, peut émettre jusqu’à 284 000 kg de CO₂, soit cinq fois l’empreinte carbone d’une voiture sur toute sa durée de vie7. Entre 2012 et 2018, la puissance de calcul nécessaire pour ces entraînements a été multipliée par 300 000.
Au-delà du carbone, l’impact se mesure en eau. Pour fonctionner, les data centers consomment des quantités astronomiques d’eau, prélevée directement sur des territoires parfois déjà en stress hydrique8. Google a ainsi consommé près de 25 milliards de litres d’eau en 2023. L’entraînement d’un seul modèle comme GPT-3 a requis 700 000 litres d’eau, tandis que chaque requête individuelle vers une IA hébergée sur le cloud consomme environ un demi-litre d’eau. Ces chiffres, loin d’être anecdotiques, déclenchent déjà des conflits d’usage qui demandent d’attaquer les géants de la tech compte tenu des externalités négatives générées, comme aux Pays-Bas où un data center de Microsoft a consommé 84 millions de litres d’eau en un an, contre les 12 à 20 millions de litres initialement prévus par la compagnie9.
Vers une écologie politique de l’IA
Une chose est sûre, l’utilisation de l’IA en local constitue un levier puissant pour réduire l’impact environnemental du numérique. Une exécution locale de l’IA plutôt que dans le cloud permettrait, à tâche équivalente, une réduction approximative de 25 à 40 % de la consommation électrique, de 60 à 90 % de la consommation d’eau, et de 50 à plus de 90 % de l’empreinte carbone10. De plus, le local soustrait le calcul énergétique à l’opacité des géants de la tech et évite les surcoûts matériels des data centers et des serveurs, comme ceux d’Azure Microsoft, qui tournent à plein temps pour alimenter une IA comme ChatGPT. Ces infrastructures imposent ainsi une consommation structurelle massive en continu (refroidissement, conversion d’énergie, redondance), une forte pression sur des ressources critiques comme l’eau, et des coûts invisibles pour l’utilisateur.
Alors, comment faire ? Pour reprendre la main sur notre consommation énergétique liée à l’IA, il faut avant tout se doter d’un ordinateur ayant une puce M1, M2, M3, ou M4 Apple ou installer un processeur graphique (GPU, graphics processing unit) Nvidia sur un ordinateur PC. Le coût n’est pas marginal (pas moins de 500€) et la production des puces participe de l’extractivisme des mines (cuivre, silicium etc.) notamment au Congo. Il convient donc d’associer cette pratique à celle de l’extension de la durée de vie de son ordinateur, notamment à partir du reconditionnement des GPU.
Une fois l’ordinateur en état de faire fonctionner une IA, vous devez télécharger une plateforme comme Docker Model Runner.
Étape 1 : Ouvrez Docker Desktop.
Allez dans Settings > Features in Development > Beta.
Cochez la case « Enable Docker Model Runner ».
Cliquez sur « Apply and restart » pour que les changements prennent effet.
Étape 2 : Téléchargez le Modèle d’IA Llama 3.2. et/ou Gemma 3.
Ouvrez votre terminal et tapez « docker model pull ai/llama3.2:1B-Q8_0 » ou « docker model pull ai/gemma3 ».
Une fois le téléchargement terminé, vous pouvez voir le modèle dans le tableau de bord de Docker Desktop, dans la section « Models ».
Étape 3 : Lancez l’application complète.
Lancez la commande suivante : « docker compose up -d –build ».
Attendez quelques instants que tous les contenus démarrent. Vous pouvez vérifier leur statut dans Docker Desktop.
Étape 4 : Utilisez le Chatbot et explorez l’observabilité du modèle. Une fois que tout est lancé, vous pouvez interagir avec l’application et ses outils de monitoring.
Pour accéder au Chatbot, ouvrez votre navigateur et allez à l’adresse : http://localhost:3000.
Vous verrez une interface de chat type ChatGPT où vous pourrez commencer à envoyer des messages au modèle Llama 3.2. ou Gemma 311.
L’IA est maintenant installée sur votre ordinateur. Pour ensuite améliorer ses performances, il faudra la nourrir en data à partir d’un modèle d’embedding (intégration) disponible sur Hugging Face (compatible Llama ou Gemma) permettant de traduire vos données dans le langage de l’IA. Vous pourrez également insérer des tokens à partir de la fonction expand de la plateforme Docker et modifier les codes de votre IA en les générant, par exemple, avec une IA !
Voilà donc, en quelques clics, une IA qui tourne sur votre ordinateur en local sans besoin de se connecter au réseau wifi, avec vos données qui restent sur votre ordinateur et en prime, une lisibilité de votre consommation énergétique. Cette approche locale permet, grâce à des outils logiciels de mesure fine, de quantifier précisément l’énergie consommée par chaque composant (GPU, CPU, RAM). L’utilisateur reprend ainsi le contrôle : il peut choisir des plages horaires à faible émission, optimiser ses algorithmes, et surtout, prolonger la durée de vie de son matériel, limitant ainsi l’empreinte carbone « embarquée » liée à la fabrication et au renouvellement incessant des serveurs des géants de la tech. En somme, l’IA locale permet de réinstaurer un lien direct et mesurable entre l’usage numérique et ses conséquences écologiques, transformant ainsi une consommation opaque en pratique durable.
2C. Freitag, M. Berners-Lee, K. Widdicks, et al., « The real climate and transformative impact of ICT: A critique of estimates, trends, and regulations », Patterns, volume 2, issue 9, 2021.
3L. F. Wolff Anthony, B. Kanding, R. Selvan, « Carbontracker: Tracking and Predicting the Carbon Footprint of Training Deep Learning Models », 2020, arXiv preprint, arXiv:2007.03051.
4Large language model ou « large » modèle linguistique : technologie avancée de l’IA capable de saisir la complexité du langage naturel.
5Coveney, P.V. & Succi, S., « The wall confronting large language models », (2025), arXiv preprint, arXiv:2507.19703.
7E. Strubell, A. Ganesh, A. McCallum, « Energy and policy considerations for deep learning in NLP » (2019), arXiv preprint, arXiv:1906.02243.
8S. Bouveret, A. Bugeau, A.-C. Orgerie, S. Quinton, « De l’eau dans les nuages », Annales des Mines – Enjeux numériques, 27(3), 2024, p. 41-48.
9DATA CENTER DYNAMICS (DCD) (2022), « Drought-stricken Holland discovers Microsoft data center slurped 84m liters of drinking water last year », www.datacen-terdynamics.com/en/news/drought-stricken-holland-discovers-microsoft-data-center- slurped-84m-liters-of-drinking-water-last-year
10Pourcentage obtenu à l’aide de l’IA à partir des éléments des articles cités dans l’article.
11Tous les éléments indiqués ont été traduits à partir de la page www.docker.com/blog/how-to-make-ai-chatbot-from-scratch. On y trouve également des captures d’écran permettant d’aider l’utilisateur à installer son IA.
L’article Sortir l’IA des nuages <br>Vers une utilisation locale des IA LLM est apparu en premier sur multitudes.
20.12.2025 à 13:57
« Il n’y a pas de race blanche »
multitudes
« Il n’y a pas de race blanche » À partir du livre le plus récent d’Hervé Le Bras, cet entretien porte sur l’histoire des catégorisations raciales, depuis l’époque de l’esclavage jusqu’à aujourd’hui, ainsi que sur les complexités des phénomènes d’identification. “Il n’y a pas de race blanche” Based on Hervé Le Bras’s most recent book, this interview focuses on the history of racial categorization, from the era of slavery to the present day, as well as the complexities of identification phenomena.
L’article « Il n’y a pas de race blanche » est apparu en premier sur multitudes.
Texte intégral (4561 mots)
Yann Moulier Boutang : Dans votre dernier livre, Il n’y pas de race blanche (Grasset, 2025), vous faites un long détour (chapitres 1 à 11), soit pas loin des quatre cinquièmes du livre, pour illustrer la constante tentative depuis les Lumières et la constitution des sciences de l’Homme, de classer les différents type d’humains entre eux, de chercher une ou des origines, d’établir des hiérarchies. Ceci débouche sur les « théories » des races et de la supériorité de la « race blanche ». Au passage, vous citez d’effarants passages de Kant, qu’il est urgent de faire connaître à tous les élèves en philosophie. Vous déconstruisez brillamment la vanité de ces constructions qui se veulent « scientifiques » et qui vont pourtant déboucher sur l’invention de la race blanche avec quelques conséquences catastrophiques.
J’ai une première question. Je n’ai pas vu de référence dans votre analyse (peut-être n’y en a-t-il pas du tout car la question ne s’est pas posée) à la catégorie des « castes » et des « hors-caste » au plus bas de l’échelle en Inde (toujours en vigueur y compris au Japon avec les Burakumins). Les castes à l’intérieur de populations de même « couleur » (blanches ou dravidiennes ou asiatiques) créent des hiérarchies sociales et des barrières aux mariages intercastes et a fortiori avec les hors castes. Est-ce que le tamis analytique et le discriminant de la catégorie de caste ne constitue pas le lien entre le niveau social (rapports de domination, d’exclusion) et le niveau anthropologique ou ethnique (les règles des rapports de parenté et d’appariement) ?
Hervé Le Bras : Le point que vous soulevez caractérise la transformation de la notion de race au XVIIIe siècle européen. Jusqu’alors fondée sur l’ascendance et la descendance comme l’écrit Jaucourt dans la grande Encyclopédie, la race devient définie par l’apparence physique. Les exclusions du type des hors-castes en Inde ou des Burakumins au Japon sont refoulées au début des théorisations modernes de la race. On considère parfois que l’opposition entre Gaulois et Francs, plaquée sur celle entre nobles et tiers-état dans les écrits de Boulainvilliers, s’apparentait à celle de castes (les ordres, en fait). Mais il s’agissait d’une opposition politique, Boulainvilliers voulant restaurer les prérogatives supposées de la noblesse à l’époque mérovingienne et reprochant au roi d’avoir fait alliance avec le peuple, mettant à l’écart la noblesse. Sieyès s’en est saisi dans un célèbre passage où il propose qu’on renvoie « dans les forêts de Franconie » les nobles, mais précise ensuite que seuls sont visés ceux qui veulent conserver leurs privilèges.
Le rapprochement du racial et du social est amorcé beaucoup plus tard lorsque la prétendue race blanche est divisée en sous-races autres que nationales, donc après Gobineau. Plusieurs membres de la société d’anthropologie dont Broca commencent à comparer les mensurations de squelettes appartenant à différentes classes sociales pour émettre des jugements sur leurs capacités mentales, puis les anthropo-sociologues dont Vacher de Lapouge, s’en saisissent en continuité avec les données des conseils de révision qu’ils utilisent : dolichocéphales et brachycéphales, homo alpinus et homo europaeus sont mis en rapport avec les classes sociales. Le rapprochement devient complet chez Carrel quand il écrit : « Il est indispensable que les classes sociales soient des classes biologiques ».
L’attribution de races à des continents (Linné, Kant), puis à des nations a donc retardé leur rapprochement avec les classes sociales. Les basses castes indiennes et les Burakumins japonais, divisions fondées sur la notion de métiers impurs, n’ont donc pas d’équivalents dans l’anthropologie raciale européenne dont le principe est physique et non généalogique, même si ce dernier en découle ultimement.
Y. M. B. : Vous commencez votre long détour par un fait divers en novembre 2023 : la rixe de deux bandes de jeunes au village de Crépol près de Romans-sur-Isère, dont l’une composée de seconde, voire de troisième génération de migrants. Le retentissement de cet incident violent pourtant assez classique avait été national. Un terme nouveau était apparu quelques années auparavant, celui de « racisme anti-blanc » qui menacerait la France de « submersion », de « grand remplacement » des Blancs et de l’Occident par les immigrés, les autres, les inassimilables, pour des raisons de couleur, de religion, de préférence sexuelle. Ces élucubrations auraient pu être dédaignées comme des borborygmes ultra-minoritaires, mais quand Donald Trump et les populistes victorieux du MAGA ont réinvesti le vieux concept de « racisme inversé » (mobilisé dès les années 1950 par les réactionnaires opposés aux droits civiques des africains-américains), l’idée d’un « racisme contre les Blancs » s’est déployée à une échelle immédiatement opérationnelle, aussi opérationnelle que les lynchages perpétrés autrefois à l’encontre les Noirs par le Klu Klux klan dans les États sudistes des États-Unis. Bagatelles en Europe ? Les scores électoraux de l’extrême-droite que vous avez bien décortiqués dans un précédent livre (Serons-nous submergés ? Epidémies, migrations, remplacement, Éditions de l’Aube, 2020) n’incitent pas à l’optimisme.
Vous établissez par A + B que la race blanche n’existe pas. On vous suit. On veut vous suivre. Mais que se passe-t-il quand les Blancs s’autodéfinissent comme « blancs » et comble du comble, renversent le combat anti-raciste des personnes racisées (ce que vous abordez dans les derniers chapitres de votre livre) en s’estimant attaqués par un racisme anti-blanc ? Un patron qui déclare qu’il est exploité par ses ouvriers et qui se met en grève, cela fait s’esclaffer, tout au plus. Un Blanc qui se dit attaqué, menacé, nié existentiellement par les différentes gammes de différents (y compris les femmes), cela n’est plus drôle du tout. Comme disait l’autre, que faire à votre avis, en dehors de la vox clamans in deserto ?
H. L. B. : J’ai donné de l’importance à l’affaire de Crépol pour souligner le rôle du vocabulaire dans l’endoctrinement de l’opinion en matière de race. Le livre est mis à l’intérieur d’une double parenthèse. La première s’ouvre et se clôt sur des citations de Viktor Klemperer, tirées de LTI, ouvrage montrant comment la langue nazie s’est imposée et ce qu’elle était, cela pour souligner l’importance, non des concepts mais de simples mots. À l’intérieur, une seconde parenthèse s’ouvre et se ferme sur les termes employés par les médias et les politiques pour décrire le crime survenu à Crépol. Au sein de cette seconde parenthèse, le reste de l’ouvrage tente de montrer que ces termes ont été élaborés à un moment ou à un autre de l’histoire des théories raciales à prétention scientifique.
Ma thèse principale porte sur le changement brutal de sens du terme de « race » au XVIIIe siècle (Linné, Kant, Blumenbach notamment), qui comme je l’ai dit plus haut, passe de la conception généalogique à la conception physique. Mais il y a une seconde thèse pour répondre à votre question. Elle porte sur le langage ou plutôt sur sa rémanence. Les théories des races se sont succédé à la manière des théories scientifiques, par changements de paradigme. Les scories après chaque changement se sont accumulées dans la langue alors qu’elles étaient écartées du dernier état de la théorie. Une comparaison avec l’histoire des sciences peut illustrer l’idée ou le mécanisme : Ptolémée a consacré un livre à l’astronomie, l’Almageste et un autre à l’astrologie, le Tetrabiblos. À l’époque, astrologie et astronomie faisaient bloc. Après Copernic, Galilée, Newton, la partie astrologique a été rejetée de la science, mais elle a continué d’exister et sert encore de guide à l’astrologie actuelle avec son zodiaque et ses sept astres. Il ne s’agit pas d’antiscience, mais de pseudo-science pour reprendre le titre d’une revue actuelle. Science et pseudo-science sont confondues au départ. Puis la science s’en dégage. Le résidu, s’il disparaît de la science, continue cependant d’exister et de s’accumuler dans une pseudo-science au fur et à mesure que les théories se succèdent. Je pense que le même phénomène s’est produit avec les théories raciales, même s’il serait plus juste de parler en la circonstance de pseudo-science et pseudo-pseudo-science. J’ai conscience que des démonstrations sur l’inexistence des races ou l’ineptie du grand remplacement ou encore, l’examen raisonné de statistiques n’ont aucun impact sur ceux qui continuent de croire en l’existence de races. Faut-il alors baisser les bras ? Certes, on peut suivre la devise kantienne du « il n’est pas nécessaire d’espérer pour entreprendre », mais il m’a semblé que porter l’attaque sur le langage pouvait être tenté, le mettre à nu, montrer le détournement des termes en restituant leur sens et leur histoire, en reconstituant comment s’est formé l’amoncellement de scories laissées par les théories raciales successives.
Y. M. B. : C’est aussi historiquement que vous procédez pour introduire le terme de racisme anti-blanc.
H. L. B. : Dans un de mes précédents livres sur le grand remplacement, une grande partie du travail consistait à rechercher comment le terme de « grand remplacement » avait été fabriqué. Je m’étais inspiré (à petite échelle) du livre de Jean-Pierre Faye sur le langage totalitaire où le philosophe montrait comment s’était construite l’expression national-socialisme. Une sorte d’oxymore, qu’est d’ailleurs aussi l’expression de racisme anti-blanc, puisque l’on s’y sert d’un nom de race pour le qualifier. On parle rarement de racisme anti-noir, mais généralement de racisme tout court.
Cette façon de combattre les formes du racisme est-elle autant vouée à l’échec que la production de statistiques, de connaissances biologiques et de modèles ? Je sais qu’il est impossible de convaincre les racistes, enfermés dans leur langage-scorie, mais j’espère pouvoir peut-être toucher ce qu’on peut appeler le halo du racisme comme on parle du halo du chômage.
Y. M. B. : De l’esclavage moderne de plantation à la colonisation de l’Afrique, la barrière de couleur s’est avérée, dans des sociétés de classe mais sans castes, un instrument terriblement efficace pour que tout bouge sans que rien ne bouge. Autrement dit, le vocable « race » bien que terriblement discrédité par les fantasmes scientifiques de Linné à Alexis Carrel et linguistiquement mis hors-jeu après le nazisme, est réapparu dans le combat anti-discrimination des Noirs aux États-Unis puis s’est propagé dans les luttes anti-coloniales pour désigner le phénotype de « couleur ». Le degré de coloration par rapport à la blancheur est devenu un résumé des diverses formes d’inégalité dans toute société, et les politiques « de quota » sont une façon de chercher à résorber ces inégalités. Comment résumeriez-vous le sac de nœuds auxquels se heurtent les partisans résolus de la conquête d’une égalité réelle promise par l’espérance démocratique, face à toute forme de gel ou d’hypostase identitaire de la racialisation, ou colorisation de la lutte de classes ? Et, question dans la question : la réponse « française » à ces questions de « couleur », mais aussi de « genre » invoquant l’universalisme, vous paraît-elle suffisante et effective ?
H. L. B. : Il me semble qu’il ne faut pas confondre le cas américain et le cas européen. En Europe, les théories raciales ont précédé la colonisation. Le suédois Linné n’en avait pas la moindre idée et le prussien Kant guère plus, à moins qu’il n’ait apprécié les ordres teutoniques dans les pays baltes. En Amérique, au contraire, l’esclavage a précédé les théories raciales importées d’Europe par Morton qui y avait fait ses études, et Agassiz qui en venait. Les premiers penseurs noirs à avoir pu laisser des textes ont aussi adopté les théories européennes, quitte à les retourner. W.E.B. Dubois, Blyden, Garvey en offrent quelques exemples importants. Les théories raciales sont venues fournir après coup ou contester « une relation de domination qui se présente comme naturelle » pour citer Colette Guillaumin. Au contraire, en Europe, les colonisateurs disposaient de la théorie avant même de mettre le premier pied sur leurs bateaux.
La question des statistiques ethno-raciales doit être examinée sous cet angle. Aux États-Unis, la race s’est inscrite directement dans la question de l’esclavage, dès le premier recensement après l’Indépendance qui utilise déjà la catégorie White. Paul Schorr et tout récemment Denis Lacorne ont exposé avec un grand détail cette histoire.
En Europe, la plupart des auteurs et des premiers anthropologues faisaient profession d’anti-esclavagisme et s’ils en parlaient, comme dans l’un des livres de l’Esprit des lois, ils le traitaient depuis les débuts de l’histoire sans spécification particulière sur le nouveau monde. On cherchera en vain chez Montesquieu, Voltaire ou Rousseau une mention du Code noir. Bordeaux et Nantes étaient des ports négriers, mais les esclaves ne transitaient pas massivement par eux. L’universalisme, non pas seulement français, mais européen, professé par les Lumières a été définitivement imprimé en Europe par la Révolution. D’un côté, l’esclavage, de l’autre l’universalisme.
Mais on peut remonter plus haut, à la situation religieuse des deux côtés de l’Atlantique au XVIIe siècle. À l’issue de la guerre de trente ans, le principe cujus regio ejus religio s’impose presque partout en Europe, une religion unique patronnée par l’État hobbesien. L’Amérique du nord devient au contraire le refuge des sectes persécutées en Europe. La liberté qui y est affirmée n’est pas premièrement celle des individus, mais celle des sectes protestantes. Les deux terrains sont donc préparés, l’un à l’universalisme, l’autre à ce qu’on qualifiera plus tard de multiculturalisme.
Y. M. B. : Parfois des termes nés pour stigmatiser sont retournés par ceux qui en sont victimes pour être revendiqués et devenir constitutifs d’une identité de combat. Ainsi, le terme de « gauchisme » dénoncé par Lénine est devenu un étendard pour les « conseillistes » critiques de gauche du léninisme comme du stalinisme (Gorter, Pannekoek) puis, cinquante ans plus tard, la revendication de la génération de Mai-68. Vous montrez que le terme de « Noir », terme péjoratif et raciste des planteurs esclavagistes a fini par être reconnu et retourné comme l’affirmation de soi et de sa véritable « classe » sous la forme d’un groupe spécifiquement discriminé, comme on le retrouve chez les féministes et les minorités sexuelles. Il y a donc une part d’autodésignation, « historiquement déterminée » bien entendu, par une hétéro désignation : tout Noir ou Blanc ne se voit pas naturellement comme tel (en particulier les enfants). Vous montrez dans votre avant dernier chapitre que le repérage et le décompte statistique des « minorités » ethniques, étrangères voire nationales deviennent très vite « complexes » (euphémisme). Faut-il, à l’exemple des quotas, concevoir les statistiques ethniques dans les recensements comme provisoires une fois l’objectif d’égalité atteint dans des domaines jugés les plus fondamentaux (éducation, accès à la santé, non-discrimination dans l’emploi, revenu, patrimoine etc.) ? Faut-il demander au recensement français, par exemple, l’origine des parents (naissance, nationalité) ?
H. L. B. : Dans mon dernier chapitre, je discute l’utilité d’acclimater en France des statistiques ethno-raciales de type états-unien. Au départ, aux États-Unis, les anti-
abolitionnistes se sont servis de ces statistiques pour gérer la ségrégation. Puis, les droits civiques en ont inversé l’usage dans le but de réduire les discriminations qui demeurent cependant à un niveau élevé. Ces statistiques ont simultanément solidifié l’appartenance à une race. Blancs, Noirs, Indiens existent sur les bulletins du recensement et sur les actes d’état civil au même titre que l’âge et le nom.
En France la question qui se pose est : le bénéfice attendu de la lutte contre les discriminations compenserait-t-il l’identification de chacun à un groupe ethno-racial ? Je pense que non, d’autant que beaucoup d’informations sont déjà disponibles pour lutter contre les discriminations, notamment grâce à l’échantillon démographique permanent de l’INSEE qui a, entre autres, servi aux études sur le chômage de la seconde génération de l’immigration.
L’idée qu’une simple assignation à un groupe ethno-racial permet de traiter n’importe quel type de discrimination est en outre contestable. Pour les contrôles policiers, seul le faciès compte, pour les CV d’embauche, le nom et le domicile discriminent plus que la photo. Les enquêtes de Lévy et Jobard sur les contrôles au faciès ne recourent donc pas aux mêmes catégories que les enquêtes par CV fictifs.
Plus généralement, je pense que les catégories ethno-raciales ont servi à alimenter la crainte d’une « submersion » de la population d’origine, qualifiée de blanche, par celle venue d’autres continents. J’en donne plusieurs exemples, mais l’un d’entre eux mérite d’être rappelé. Celui du New York Times mettant en une de son édition du 17 mai 2012 le titre « Les naissances blanches sont devenues minoritaires aux États Unis ». D’après le Bureau of Census, elles ne constituaient plus que 49 % du total. Mais qu’est-ce qu’une « naissance blanche » ? Le tableau publié par le Census la définit comme « white only non-hispanic ». Les naissances hispaniques ne sont pas considérées comme blanches. Or, les hispaniques doivent répondre comme les autres à la question de la race. Un tableau indique que 95 % d’entre eux se rangent dans la race blanche. D’autre part, « only » signifie que ceux qui ont coché plusieurs cases à la question de la race, même si l’une des cases est la blanche, ne sont pas considérés comme blancs. Enfin, pour les naissances, il s’agit de la mère, mais le père peut n’être pas white only non-hispanic, étant donné une certaine mixité des unions. Si l’on restreint le terme de blanc aux parents n’ayant coché aucune case autre que white, seules 45 % des naissances sont blanches. Si l’on considère inversement comme blancs tous ceux qui ont coché au moins une case white, le pourcentage s’élève à 83 %. Le choix des 49 % n’est donc pas anodin. Il est utilisé pour faire peur à la prétendue race dominante d’être submergée. La vieille raison profonde des théories raciales se maintient, mais au lieu de justifier la domination, elle est utilisée pour faire craindre de la perdre.
Dernier point que vous soulevez : ne pourrait-on pas introduire à titre temporaire les statistiques ethno-raciales, puis les retirer quand la discrimination aurait été réduite ou aurait disparu ? Tous les exemples connus prouvent que l’on ne peut pas revenir en arrière, mais au contraire, que l’on complexifie pour pallier les inévitables dysfonctionnements, tout comme les théories raciales l’ont fait. Un ancien directeur du Bureau of census, Kenneth Prewitt, paradoxalement hostile à la pratique de son administration, l’a étudiée dans son ouvrage What is « your race » (Princeton U.P., 2013). L’Afrique du sud, qui avait supprimé les statistiques raciales à la chute de l’apartheid, les a rétablies dix ans plus tard avec les mêmes intitulés car les Sud-africains continuaient de se percevoir en fonction de leur ancienne catégorie raciale.
En résumé, les statistiques ethno-raciales s’inscrivent en continuité avec les théories raciales du passé, d’où la succession des chapitres de mon livre.
L’article « Il n’y a pas de race blanche » est apparu en premier sur multitudes.
20.12.2025 à 13:54
Une théorie du fascisme contemporain Vers une vie anti-fasciste
multitudes
Une théorie du fascisme contemporain Vers une vie anti-fasciste Cet article donne une synthèse des principales thèses guidant l’analyse que le dernier livre de l’auteur propose du fascisme contemporain illustré par la personnalité médiatique de Donald Trump. Quinze points brefs fournissent un vocabulaire et des outils critiques qui renouvellent considérablement les compréhensions courantes du fascisme. A Theory of Contemporary Fascism Towards an Anti-Fascist Life This article summarizes the main theses guiding the author’s analysis of contemporary fascism, as illustrated by the media personality of Donald Trump. Fifteen brief points provide a vocabulary and critical tools that significantly renew current understandings of fascism.
L’article Une théorie du fascisme contemporain <br>Vers une vie anti-fasciste est apparu en premier sur multitudes.
Texte intégral (4666 mots)
Préambule
Le développement de l’État-nation moderne a coïncidé avec une avancée du devenir immanent du pouvoir dans le domaine social1. Des concepts tels que le pouvoir disciplinaire, la gouvernementalité et le biopouvoir – pour ne citer que ces trois forgés par Michel Foucault – ont été développés pour décrire la dispersion du pouvoir dans les moindres veines du corps social. Des canaux de communication de plus en plus interconnectés innervent le champ de la vie et acheminent des provocations qui jouent avec le système nerveux des citoyens comme avec les cordes d’une harpe abstraite : ajustements, coups, amorçages. Ces empiètements [impingements] interrompent incessamment le flux de la vie quotidienne, micro-segmentant l’attention. Dans les interstices entre les sollicitations de l’attention, le corps est agité par les incursions du dehors et de l’autre. La pensée naissante qui commence à se manifester à chaque vague de sensations est attisée par chaque coup successif, pour se trouver court-circuitée par le saut au suivant : l’agitation simultanée [co(m)motion] du sentir imprégné de pensée naissante. Dans ces à-coups, le corps qui ressent-pense est à la fois tendu et assoupli. Piégé au milieu, le corps risque d’être capturé, induit [inducted] et annexé. Les modalités du pouvoir qui balayent le champ social ont une prise sur laquelle se brancher : la vie du corps au niveau infra, en dessous de ses capacités à exécuter des actions et à diriger la pensée avec souveraineté et auto-suffisance, lesquelles pourtant, selon ce qu’on nous a fait croire, nous définiraient en tant que sujets autonomes de décision.
L’immanence du pouvoir a désintégré la souveraineté et la décision, les dispersant aux quatre coins du champ social. Le pouvoir devient diffus [distributive]. De nombreuses voix annoncent l’obsolescence de l’État et la mort du souverain, décapité depuis longtemps. Elles parlent trop vite. Au moment même où le devenir-immanent du pouvoir franchit le seuil où il s’impose avec force, un phénomène étrange se produit. Le chef de l’État – dont l’évidence s’avère tout aussi forte – est de retour sur les épaules d’une personne prééminente. Une prééminence qui fascine par le timbre nostalgique de sa voix hollywoodienne, en contrepoint d’un corps débonnaire et vacillant ; elle saisit l’attention par le rythme de son image oscillant entre l’athlétique et le maladroit, entrecoupée d’hésitations linguistiques ; ou elle émet des pulsations de ressentiment à travers des yeux vengeurs qui scrutent, avec les mâchoires serrées et les sourcils froncés, avec l’expression assurée d’un plaignant-en-chef exempté des règles du discours argumenté. De Reagan à Trump en passant par George W. Bush, le centre impérial est réoccupé, avec une pompe qui rappelle de manière trompeuse le monarchisme divin qui a précédé et préparé la voie à l’État-nation moderne.
Le pouvoir revient à la personne prééminente. Au premier plan, la personnalité du pouvoir fait son retour. Avec vengeance. Mais aussi avec une différence. La lignée qui va de Reagan à Trump passe également d’un acteur de films de série B à une star de téléréalité ultra-kitsch – caractérisée par un exceptionnalisme qui l’exonère des rigueurs d’un discours cohérent et d’une politique bien raisonnée prétendant respecter une norme de vérité. Cela est symptomatique d’une variation étonnamment nouvelle d’un régime ancien. La personnalité du pouvoir est un archaïsme doté d’une fonction contemporaine.
Point 1
Toutes les formations contemporaines de pouvoir étatique n’ont d’autre choix que de naviguer entre ces deux dynamiques inverses, la dissémination du pouvoir et sa re-concentration. Chacune doit inventer une solution à cette ambivalence. Le fascisme contemporain doit être compris sous cet angle, comme inventant sa propre résolution fonctionnelle de ce qui, dans l’abstrait, est une contradiction.
Point 2
La solution apportée par le fascisme contemporain, incarnée par Trump, consiste à faire de la personne prééminente à la tête de l’État un nœud central dans la circulation des signes, dans une configuration très particulière, pour un effet très particulier. Trump est le perturbateur-en-chef : il lance un flux continu de provocations qui frappent des corps anxieux tendus dans tout le champ social, empiétant sur le niveau infra-émergent de leur penser-sentir naissant, dans les interstices de leur attention spasmodique. L’objectif est éparpillé, comme celui de missiles non guidés volant au hasard. L’espoir est que les coups génèreront des résonances, créant des ondulations qui se propageront, peut-être jusqu’à atteindre leur apogée, s’amplifiant d’elles-mêmes jusqu’au point de basculement d’un événement enregistrable, relativement petit ou grand, se propageant largement ou de manière plus localisée dans des bulles. Les frappes tombent sur le terrain sensible d’un champ social quasi chaotique en perpétuel bouillonnement communicationnel. Dans ce quasi-chaos, les points de basculement font remonter à la surface agitée des effets d’ordre. La politique [policy] ne dirige pas les frappes. Elle les suit, capturant les effets d’ordre à partir du chaos et en tirant profit.
Point 3
L’émission de signes n’est pas unidirectionnelle. Ce qui émane du centre de la personne du leader lui revient. Une chambre d’échos se forme entre les tweets (ou truths) de Trump et ceux de ses partisans. Trump reprend une provocation de Fox News ou de l’infosphère de droite et la retweete. Elle lui revient ensuite. En boucle, en spirale. Dans ce tourbillon, il devient impossible d’attribuer une source définie. Le sujet du discours s’estompe à travers une multiplicité de corps. Le discours devient effectivement indirect, sans sujet d’énonciation déterminable pour les déclarations. Il devient irréductiblement collectif. Trump devient le nœud central d’un agencement collectif d’énonciation de grande envergure. Son œil prééminent domine le champ. Son moi gonflé s’arroge les effets émergents qui ondulent à sa surface. On sait que des foules en adoration reprennent ses paroles en chœur, en conservant la diction à la première personne. Il crie « je », et elles reprennent son « je » dans leur chant, produisant la formation bizarre d’un chœur de discours rapporté à la première personne.
Point 4
La personne de Trump est cette première personne plurielle. Trump ne se réduit pas à Donald, l’hominidé masculin en cravate rouge et costume bleu. Le statut individuel de sa personne est supplémenté par le cycle et le relais, le tourbillon et le retour, qui remuent le bouillonnement. Trump est une personne collective, sans exagération ni métaphore. On pourrait qualifier sa personnalité collective de figure médiatique, à condition de ne pas oublier que Trump n’a pas d’existence en dehors de son complément médiatique fondé sur autrui. Il ne se contente pas de se délecter de l’adulation de la foule. Il en a besoin pour se maintenir en tant que personne. Tout ce qu’il fait est conçu pour préserver sa centralité nodale, comme s’il s’agissait d’une question de vie ou de mort. En témoigne son attachement désespéré à la présidence, depuis la fin ignominieuse de son premier mandat jusqu’à son aspiration à son troisième mandat. Son moi se nourrit de l’énergie des autres. Les autres sont des sous-personnes par rapport à sa sur-personne nodale, reliées à elle par une dynamique en spirale, qui connecte le centre à la périphérie et ramène la périphérie vers le centre, dans une incessante agitation collective.
Point 5
La circulation des signes qui tourbillonnent autour de la personne prééminente revêt une tonalité affective : la peur, ainsi que la colère contre toute personne ou toute chose suscitant la peur. En d’autres termes, la réactivité. Le pistolet du corps social est armé, toujours prêt à tirer en réaction à l’atmosphère de menace qui règne, prêt à se déclencher face aux signes-empiètements provenant du dehors et de l’autre. Le fascisme contemporain est agité par un régime affectif de réaction. Le régime de réaction ne peut pas être expliqué en termes psychologiques. Les déclencheurs de réaction frappent dans les interstices, dans les fissures de l’attention, en dessous du niveau psychologique, dans les trefonds du penser-sentir. Ils se situent dans l’infra, sous les actions exécutives et les cogitations réfléchies propres à la personne, les déconcertant de l’intérieur, dans leur phase d’émergence. Ils se transmettent ensuite à travers les réseaux médiatiques de manière transindividuelle, d’un infra à l’autre, dans ce qui équivaut à une « communication directe des subconsciences » en tant que force constitutive de la personne. De nouveaux outils conceptuels doivent être affinés pour comprendre la dynamique infra-/trans-individuelle constitutive du régime de réaction qui pousse le millefeuille complexe de la personne collective vers des directions fascistes.
Point 6
Les réactions déclenchées sont orientées à l’avance vers certaines directions à travers la saturation de cette atmosphère par des présupposés et des postures racistes, sexistes, anti-LGBTQ+, anti-immigrés – en un mot, anti-autres – qui remplissent le discours social. Ces jugements ambiants, prêts à mordre, sont une partie nécessaire du mécanisme. Mais ils n’en constituent pas une condition suffisante. Leur déclenchement est principalement provoqué, corrélé et coordonné dans son ensemble, par une certaine opération performative actionnée depuis le centre occupé par la personne prééminente.
Point 7
Cette opération performative peut être simplement appelée décision : décision souveraine, dans le vocabulaire du juriste nazi Carl Schmitt. La décision, dit-il, est une « attribution » [ascription] purement performative du statut d’ennemi, qui prend effet simplement par le fait d’être énoncée. Cet acte performatif ne repose pas sur un sentiment ou un jugement personnel, et ne suit aucune norme ni chaîne de raisonnement préliminaire. Cet acte se situe en dehors de la loi, dans et comme un état d’exception à celle-ci. Il capte un sentiment collectif de menace. La personne prééminente en est le capteur, comme un transducteur qui reçoit un signal faible pour le retransmettre chargé et amplifié. Dans ce mouvement, la personne prééminente coïncide avec le collectif. Elle n’agit pas en tant qu’individu, mais en tant que canal singulier de l’affect collectif. Sa personne, absorbée dans ce mouvement, est une personnalité du pouvoir singulière, et non une personnalité particulière dotée de pouvoir. Les décisions que Schmitt avait à l’esprit étaient grandioses et la menace existentielle. L’attribution de l’ennemi marquait une transition entre le statu quo et une situation dans laquelle les citoyen·es sont amené·es à accepter de tuer ou de mourir pour défendre leur mode de vie, annexé à la dynamique performative. Trump est une imitation farcesque [knock-off] du souverain schmittien. Pendant son premier mandat, ses tweets incessants et mesquins, pleins de griefs et de condamnations, ont attisé l’atmosphère de peur et de colère, semant dans les nuages des réseaux sociaux une pluie constante de mini-attributions d’inimitiés. L’effet performatif s’est répandu, goutte à goutte. Il pouvait toutefois confluer en un courant plus important, grâce à la spirale de réactions autour de Trump. Il peut se propager comme une contagion, parfois sous forme de tourbillons, et s’amplifier jusqu’à provoquer des débordements dramatiques, comme ceux du 6 janvier 2021.
Point 8
La décision trumpienne est « fascisante ». Elle attise les tendances réactives, les propage et les amplifie. Elle attribue les inimitiés, durcit les frontières contre les ennemis désignés et prépare le terrain pour des éruptions offensives. Elle est un paratonnerre pour les tendances fascisantes. Dans des conditions favorables, à un certain point de convergence, ces tendances peuvent franchir un point de basculement vers un fascisme à part entière. Le second mandat de Trump a fait un pas important vers ce point de basculement : celui où le gouvernement par exception devient la règle.
Point 9
Le gouvernement par tweet s’accompagne désormais d’une avalanche tout aussi improvisée de décrets présidentiels, qui contournent de manière autocratique, dans la mesure du possible, les pouvoirs législatif et judiciaire, en invoquant des exceptions à la loi et à la Constitution. Les décrets présidentiels ramènent au centre du jeu la force attributive [ascriptive] du mouvement centrifuge des réseaux sociaux trumpiens, comme un tourbillon atmosphérique dans l’œil d’un ouragan. Les vents de la réaction prennent de la force. L’attribution performative du statut d’ennemi souffle avec la force de la loi. Cela ajoute une dimension franchement dictatoriale à la fonction nodale de la personnalité de pouvoir de Trump. Ainsi se réduit l’écart entre la décision trumpienne, qui consiste à semer la zizanie sur les réseaux sociaux par des déluges de plaintes, et la canalisation performative directement dictatoriale de Schmitt. Le pouce qui appuie sur le clavier et le trait de stylo sur le papier souverain s’entremêlent dans une étroite étreinte opérationnelle, pour produire une spirale réactive dont l’orage tourbillonnant se renforce par son mouvement même. La nature exceptionnelle et personnelle de cet effet de renforcement est attestée par le fait que, si moins d’un tiers des Républicains se déclarent favorables à un régime autoritaire en général, 57 % d’entre eux soutiennent le régime autoritaire de Trump.
Point 10
Trump, le décideur, ne légitime pas ses politiques par des arguments convaincants et des appels à la raison d’État. Il ne cherche pas à se légitimer. Il prend des libertés [takes licences]. Il prend des libertés en se basant sur son exceptionnalisme personnel : « je suis le seul à pouvoir le faire ». Trump est la loi. Faisant écho à Napoléon, il déclare : « celui qui sauve le pays ne viole aucune loi ». Lorsque ses partisans adhèrent à ses actions, ce n’est pas par conviction idéologique. C’est par annexation affective à la dynamique de sa personnalité de pouvoir. Ils ne l’acclament pas depuis une distance médiée. Ils vibrent directement à son rythme : leur sentir-penser est modulé par son agitation au niveau infra-constitutif de ce qui fait d’elleux ce qu’iels sont. Iels ne s’identifient pas à lui, mais reconnaissent plutôt leur propre exceptionnalisme dans le sien. Le fait qu’il prenne des libertés leur donne le droit d’en prendre à leur tour. Iels se façonnent en mini-centres de décision trumpiens orbitant autour de sa centralité nodale prééminente et résonnant avec elle. Iels s’épanouissent en tant que nœuds de dispersion dans une individuation collective tourbillonnant à travers et autour de lui. Il s’ensuit une contagion d’attribution d’inimitiés, qui peut s’intensifier jusqu’à la guerre civile.
Point 11
La situation générale est post-normative. Cela ne signifie pas que la norme disparaît. Au contraire, elle se durcit et son application aux corps et aux vies devient d’autant plus impitoyable. Ici, « post-normatif » signifie que la norme ne garantit plus une véritable correspondance entre son contenu et celui des vies qu’elle sur-code. Cette relation de vérité n’est plus ce qui compte. La norme est l’étalon-Homme [Man-Standard ] (blanc, mâle, hétérosexuel, d’ascendance européenne, né dans le pays, parlant une langue majeure, incarnant le capital humain). Les protagonistes de cette époque trumpienne présentent souvent des anomalies. Elle est incarnée, par exemple, par un nombre surprenant de femmes prééminentes qui, loin d’être des trad wives, sont des carriéristes influentes sous les feux de la rampe. Parmi les défenseurs de la « manosphère », on trouve Milo Yiannopoulos. Loin d’être hétérosexuel, puisqu’il est marié à un autre homme. Andrew Tate est un cas particulièrement affligeant. Il n’est pas blanc, mais bi-racial. Les commentateurs soulignent souvent que Trump intègre dans sa personne ce qui est stéréotypiquement considéré comme des traits féminins, comme la méchanceté et la vulnérabilité, au point que sa masculinité a été qualifiée d’« ornementale ». Il n’incarne pas le modèle stoïque, respectueux des lois et moralement irréprochable de la virilité traditionnelle. La norme peut actuellement se réconcilier avec ce qui, à la lettre, serait en déviation par rapport à ses prescriptions conformistes. Du côté de ceux à qui on impose l’étalon-Homme, il n’est pas requis non plus qu’ils présentent les traits correspondant au statut d’ennemi qui leur est assigné. Des milliers d’immigrant·es sont arrêté·es en vue d’être expulsé·es, certain·es pour être envoyé·es dans des sites obscurs [black sites] à l’étranger, sans la moindre tentative de vérifier leur statut. Des détenteurs de visas légitimes et même des citoyens américains sont clairement pris dans les filets. Il ne s’agit tout simplement pas d’appliquer la norme de manière véritable et cohérente. Il s’agit plutôt de poursuivre de manière réactive la punition et la vengeance après l’application du statut d’ennemi. Cette opération n’est pas politico-morale. Elle est politico-affective. Il s’agit d’une complaisance collective envers la réactivité. La norme vacille et en même temps elle se renforce. C’est comme si le centre de la courbe en cloche oscillait entre un pôle hypo, où elle englobe les déviances de ses exécutants, et un pôle hyper, où elle glisse vers des performances exagérées, voire caricaturales, que l’on pourrait prendre pour de l’autodérision. Dans l’ensemble, les partisans de Trump ne s’identifient pas à lui comme à l’image droite de la normativité de l’étalon-Homme. Ils annexent leur vie à l’oscillation post-normative qui pivote autour de lui, réglant leur registre affectif sur une échelle mobile : à leur convenance.
Point 12
Le fascisme intégral s’installe lorsque les deux mouvements s’intensifient de concert : le mouvement centrifuge de diffusion vers des mini-centres adjacents de pouvoir décisionnel répartis dans tout le champ social et le reflux centripète vers le perturbateur-en-chef post-normatif occupant la zone rayonnante d’exception au centre prééminent. Une exacerbation se produit en raison d’une tension inhérente à la réaction offensive déclenchée par l’attribution du statut d’ennemi. Le champ de la vie a été reconfiguré en un environnement de menace infinie. Les ennemis potentiels abondent. Des présences vagues et hostiles pullulent. Le moindre soupçon d’empiétement provenant du dehors et de l’autre est accueilli avec peur et agressivité. S’ensuit une chasse effrénée aux ennemis qui se cachent dans l’ombre. Dans le brouillard d’un environnement de menaces, les connexions ténues et les jugements performatifs sont tout ce dont le corps dispose pour avancer. Les théories du complot prolifèrent, alimentant la manie d’attribuer le statut d’ennemi. Les voisins deviennent des ennemis en attente, et l’espace au-delà des frontières de la nation devient un réservoir vaguement perçu mais intensément ressenti d’infiltrations et d’incursions nuisibles qui s’approchent. La spirale centrifuge-centripète s’enflamme en un cycle d’attaques frénétiques contre les ennemis intérieurs, associé à des attaques extérieures visant à pacifier ce qui se trouve au-delà des frontières par une agression expansionniste. À mesure que ce double mouvement s’intensifie, se nourrissant de ses propres énergies comme un feu attisé par les vents de réaction qui se renforcent, la violence meurtrière visant l’élimination du danger peut devenir suicidaire. À son extrême, l’État fasciste est un État suicidaire.
Point 13
L’aspect de la dynamique fasciste qui concerne la production de mini-centres réactifs de licence décisionnelle adossée à l’étalon-Homme est le microfascisme. Le microfascisme est une caractéristique fondamentale d’une situation fascisante. Il est toujours présent dans le domaine social et s’agite même en l’absence d’un centre prééminent auquel se rattacher. Quand il n’y a concrètement aucun centre, il y a toujours l’attracteur virtuel d’un centre potentiel qui attire efficacement l’émergence d’une tendance vers lui. Cet attrait régit la tendance fascisante. Son attraction se fait sentir partout où est en vigueur l’axe réactif, qui attelle la commotion de l’infra-réaction aux empiètements de signes perturbateurs au service de l’attribution acharnée du statut d’ennemi. Cela s’étend partout. Tout le temps.
Point 14
Tout le monde veut être fasciste. Personne n’est à l’abri de la réaction. Les tendances fascisantes ne respectent pas la dichotomie droite-gauche. Il existe autant de microfascisme à gauche qu’à droite. Le fascisme accompli, cependant, est la spécialité de la droite. Cela s’explique par son couplage préférentiel avec le capitalisme déréglementé, avec le culte de la propriété privée et du profit. Mais cela s’explique aussi par sa capacité à annexer les personnes à sa dynamique à travers la prévalence actuelle de la forme du capital humain – c’est-à-dire le fait de se considérer soi-même comme une unité à investir dans les flux de capitaux, comme une personnification du capital. Lorsque les tendances fascisantes de la gauche prennent l’envol, elles ont tendance à émerger sous d’autres formes de centralisme autoritaire.
Point 15
Compte tenu de l’omniprésence des tendances fascisantes, aucune période historique et aucun pays n’en sont totalement immunisés. Le fascisme est toujours au moins microprésent, dispersé ici et là par bribes et morceaux, attendant avec impatience qu’une personnalité exceptionnelle vienne le catalyser. Son apparition est toujours conjoncturelle, et la conjoncture comprend toujours une bonne dose de hasard. La catalyse des tendances fascisantes vers un fascisme accompli ne peut être prédite avec précision. De plus, la forme que prendra le fascisme à maturité présentera toujours des caractéristiques uniques. Il n’existe pas de typologie établie du fascisme permettant de le juger. Il ne peut pas être modélisé à partir d’un gabarit dérivé d’exemples historiques. Son étude empirique ne peut pas se traduire en un système d’alertes. C’est pourquoi tant de personnes, y compris des spécialistes du fascisme, n’ont pas vu venir Trump. Le problème du fascisme est qu’il n’est pas empirique. Il est supra-empirique : il se cristallise autour d’un attracteur virtuel d’une manière qui dépasse les conditions données. Le fascisme a tendance à réapparaître, mais (comme toutes les formations historiques) toujours sous une forme nouvelle et émergente. L’antidote consiste à rechercher en permanence des outils diagnostiques permettant de détecter le microfascisme dès ses premiers signes, et à s’exercer collectivement et sans relâche à créer les conditions favorables à une vie antifasciste, c’est-à-dire les conditions qui contrecarrent la réaction en accueillant la force constitutive des empiètements venant de l’extérieur et d’autrui.
Traduit de l’anglais (USA) par
Yves Citton & Jacopo Rasmi
sous la supervision de l’auteur
1Les thèses exposées dans ce texte constituent une synthèse des travaux publiés récemment par Brian Massumi dans The Personality of Power. A Theory of Fascism for Anti-Fascist Life, Duke University Press, 2025, ainsi que dans Toward a Theory of Fascism for Anti-Fascist Life. A Process Vocabulary, Minor Compositions, 2025. Cet article est à paraître en anglais dans la revue Critical Inquiry, que nous remercions, ainsi que l’auteur, pour nous avoir autorisés à le traduire et publier en français.
L’article Une théorie du fascisme contemporain <br>Vers une vie anti-fasciste est apparu en premier sur multitudes.
20.12.2025 à 13:51
Problèmes de blanchités
multitudes
Comment combattre le racisme (socio-politique) quand on sait que « les races » (biologiques) n’existent pas ? Comment en parler en focalisant l’analyse sur l’une de ses sources (certaines sensibilités et certains comportements des populations dites « blanches ») plutôt que sur ses conséquences discriminatoires (auprès des populations racisées) ? Telles sont les questions autour desquelles tourne le dossier qui suit, … Continuer la lecture de Problèmes de blanchités →
L’article Problèmes de blanchités est apparu en premier sur multitudes.
Texte intégral (1015 mots)
Comment combattre le racisme (socio-politique) quand on sait que « les races » (biologiques) n’existent pas ? Comment en parler en focalisant l’analyse sur l’une de ses sources (certaines sensibilités et certains comportements des populations dites « blanches ») plutôt que sur ses conséquences discriminatoires (auprès des populations racisées) ? Telles sont les questions autour desquelles tourne le dossier qui suit, consacré à une notion éminemment problématique, discutée depuis une trentaine d’années dans le monde anglo-saxon, mais commençant à peine à gagner en visibilité en France : la blanchité.
Une première contribution, rédigée par les coordinatrices du dossier (Emma Bigé, Yves Citton & Léna Dormeau), formule huit questionnements pour tenter de désamorcer certains malentendus qui entourent les références multiples faites aux phénomènes de blanchité. Un article de Bayo Akomolafe, écrit en réaction aux manifestations et meurtres suprématistes de Charlottesville en 2017, mobilise le mythe d’Icare et les savoirs yorubas pour imaginer un espace de guérison des violences racistes caractérisant depuis des siècles les espaces blancs. Dans leur conversation, Léna Dormeau et le sociologue et politiste Félicien Faury, spécialiste de l’extrême droite contemporaine, interrogent les enquêtes de terrain de ce dernier pour tenter de comprendre de quoi les blancs ont peur.
Deux textes traduits pour la première fois en francais proposent ensuite des phénoménologies de la blanchité : celui de Sara Ahmed qui décrit avec finesse son expérience d’entrer dans une salle de réunion universitaire où la blanchité fait bloc et refuse de laisser la place ; celui de George Yancy qui explore ce qu’impliquerait de retourner la scène fameuse décrite par Frantz Fanon (où un enfant le pointe du doigt), en faisant porter cette fois l’attention ailleurs : « Regarde, un blanc ! ».
Une fois précisés les paramètres principaux de l’analyse de la blanchité, les articles suivants en déclinent quelques applications, transformations ou perversions possibles. Rachele Borghi et Tal Dor interprètent à cette lumière les positionnements (et les silences) qui ont entouré, au sein de l’université française, les crimes contre l’humanité commis récemment par le gouvernement israélien contre le peuple palestinien. Jean-Christophe Goddard applique à la figure du Mundele et du Bula-matari (désignations des colons dans le bassin du Congo) son approche contre-anthropologique du monde blanc par les colonisés-racisés pour, en inversant l’objectivation ethnographique coloniale, produire un concept critique de blanchité qu’aucune auto-analyse occidentale ne saurait formuler. Cette tératologie de la blanchité se déplace ensuite au Canada, où Erin Manning étudie les stratégies et fabulations par lesquelles des Prétendiens vont retrouver dans leur génome, à l’aide de tests à bon marché, quelques gouttes de sang supposé « indien » pour prétendre bénéficier à la fois des privilèges blancs et des politiques de remédiation aux discriminations raciales. Ary Gordien réfléchit pour sa part à la notion de « racisme anti-blanc », pour revenir sur des formes de violences qui ont été retournées contre certains blancs au moment de la colonisation, mais surtout pour recontextualiser les références actuelles à cette notion.
Dans la dernière section du dossier, Giuseppe Cocco rejette certaines prémisses des analyses sur lesquelles se fondent les articles précédents, en considérant que la blanchité est un concept qui fait le jeu du racisme. Emma Bigé et Léna Dormeau tentent pour leur part de mieux comprendre les résistances que suscitent les études critiques de la blanchité, en les resituant à la fois dans des débats au long cours et dans le contexte de certains conflits sociaux actuels.
Cet ensemble d’articles est complété en ligne par quatre fiches de lecture, qui résument en quelques paragraphes des publications classiques (Denise Ferreira da Silva, Toward a Global Idea of Race, 2007 ; Arun Saldanha, Psychedelic White: Goa Trance and the Viscosity of Race, 2007) et contemporaines (Nicholas Mirzoeff, White Sight. Visual Politics and Practices of Whiteness, 2023 ; Jo Masco, Tim Choy, Jake Kosek et M. Murphy, Fear of A Dead White Planet, 2025), apportant chacune une contribution à l’élargissement du champ des études critiques de la blanchité (histoire de la philosophie moderne, ethnologie du tourisme, études visuelles, écologie…).
Comme on s’en rendra peut-être compte à la lecture de l’ensemble de ses articles, cette majeure a suscité des débats nourris, et fortement contradictoires, au sein du collectif de rédaction de la revue Multitudes. Tandis que certaines voix en portaient le projet, d’autres manifestaient leur désaccord envers sa visée première ou certaines de ses tonalités. Comme cela avait déjà été le cas avec la majeure du no 98 consacrée aux réflexions actuelles sur les guerres en cours, il nous semble important de ménager collectivement un espace où des désaccords de fond et de forme peuvent s’exprimer – ce qui passe parfois par la publication, au sein d’un dossier, d’articles allant à l’encontre de ce que cherchent à promouvoir les responsables dudit dossier.
L’article Problèmes de blanchités est apparu en premier sur multitudes.
20.12.2025 à 13:49
Comprendre et trahir Huit raisons de mettre en cause les blanchités
multitudes
Comprendre et trahir Huit raisons de mettre en causes les blanchités Cet article présente huit raisons d’interroger de manière critique les « blanchités » (au pluriel) dans le cadre d’un projet collectif mené par des auteurices blanc·hes et non-blanc·hes. Les auteurices soutiennent que le racisme est fondamentalement un « problème blanc » exigeant que les personnes blanches démantèlent activement les structures coloniales et privilèges plutôt que de laisser la lutte antiraciste aux seules personnes racisées. Mettant en garde contre le risque que les études sur la blanchité deviennent contre-performatives – permettant simplement aux Blanc·hes de laver leur conscience sans engager de transformation – les auteurices positionnent leur travail comme un appel à la « traîtrise », s’appuyant sur la devise du magazine Race Traitor : « la trahison de la blanchité est la loyauté à l’humanité ». Understand & Betray Eight Reasons to Unsettle Whiteness This article presents eight reasons for critically examining “whitenesses” (in the plural) as a collective project undertaken by both white and non-white authors. The authors argue that racism is fundamentally a “white problem” requiring white people to actively dismantle colonial structures and privileges rather than leaving anti-racist struggle to racialized populations alone. Warning against the risk that whiteness studies might become counter-performative—merely allowing whites to declare awareness without enacting change—the authors position their work as a call to “betrayal,” drawing on Race Traitor’s motto that “treason to whiteness is loyalty to humanity.”
L’article Comprendre et trahir <br>Huit raisons de mettre en cause les blanchités est apparu en premier sur multitudes.
Texte intégral (4859 mots)
Un problème que pose la question des blanchités est de savoir qui elle recouvre – et plus particulièrement, à partir de quel nous il est possible d’en parler.
Nous qui avons organisé ce dossier (E.B., Y.C., L.D.) sommes inégalement marqué·es comme « blanc·hes » – plus ou moins, selon nos ascendances, selon les façons dont nos épidermes, nos visages, nos noms, nos façons de parler, de bouger, ou tout simplement d’exister sont reçues par celles et ceux avec qui nous interagissons. Malgré ces nuances, nous faisons ensemble ce dossier pour dire que les problèmes de blanchités (à conjuguer au pluriel) sont des problèmes à poser ensemble, blanc·hes et non-blanc·hes, et que c’est ensemble qu’il incombe de s’en préoccuper, de faire notre possible pour en traiter les causes et les effets toxiques. Ensemble, c’est aussi de cette façon qu’il nous faut appréhender les différentes formes d’alliances possibles, ce qu’elles recouvrent, ce qu’elles visent, et ce qu’elles disent de nos modes de pensées et d’organisation. Écrire à six mains une telle proposition, c’est donc nous réunir derrière un « nous » qui n’est pas une simple coquetterie de style.
Écrire ensemble (blanches et non-blanches), ce n’est pas pour autant non plus un geste de métissage performatif qui viendrait dire « vous voyez, la France black-blanc-beur, c’est aussi chez les intellos de gauche et ici nous sommes toutes sœurs ». Nous venons dire que ce que certain·es souhaiteraient tantôt naturel tantôt irréductible – vivre et penser ensemble dans le respect et l’égalité pures, sans « voir les couleurs » – n’est pas, n’a jamais été, et n’est peut-être même pas souhaitable. En tous cas, pas tant que le capitalisme racial n’aura pas été aboli. Notre nous est un rapport de force et le lieu de nos propres incapacités et désirs de compréhension. C’est un nous qui a été négocié et qui se négocie, encore et encore.
Tentons, à partir de ce nous en négociation, d’expliciter quelques-unes des raisons qui nous poussent à mettre en causes les blanchités – en une mise en cause(s) qui sera elle-même à entendre de multiples façons (à la fois remettre en question, dénoncer, identifier des causes, mais aussi poser des questions et informer des causeries).
1. Renverser « le problème noir ».
Si l’enjeu est de trahir la blanchité (et son projet monolithique de solidarité suprématiste blanche), c’est d’abord au sens où il s’agit de renverser la lumière du projecteur. Tout au long du XXe siècle, des hommes politiques blancs ont parlé du « problème noir » (aujourd’hui réactualisé en « problème migrant », ou en « problème latinx » aux États-Unis) ou des « problèmes des banlieues » (généralement identifiés aux populations maghrébines en France), alors que le racisme et ses conséquences sont d’abord un problème blanc1 : ce sont des populations européennes (de pigmentations inégalement mais généralement claires) qui ont colonisé (exterminé, esclavagisé, opprimé) des populations lointaines (de pigmentations inégalement mais généralement plus sombres), qui les ont soumises à des formes d’exploitation et de réglementations dont sont issus les codes raciaux (le Code noir de Colbert au XVIIe siècle), les structures économiques (la plantation, l’industrialisation extractiviste, le capitalisme néolibéral), les flux de capitaux, de matières premières et de corps humains aujourd’hui désignés par le terme de globalisation ; et ce sont encore aujourd’hui les héritages de ces distinctions opérées par des colons blanc·hes qui exposent les vies racisées à des inégalités et des brutalités quotidiennes.
Donc, première raison de parler de blanchités : les problèmes relatifs aux discriminations raciales sont historiquement des problèmes générés par une « ethno-classe bourgeoise blanche2 » et au profit d’un statu quo politico-économique qui entérine la domination d’une classe de possédants qui utilisent la blanchité à leur profit. Démanteler l’héritage de la modernité/colonialité, c’est donc démanteler le bloc blanc qui a contribué à informer le développement du capitalisme industriel – bloc qui doit être démantelé par les membres qui le composent.
2. Éclairer les persistances des dominations racistes.
Étudier les blanchités, c’est se confronter aux persistances dans le présent de modes de domination qui sont certes issus du passé mais qui continuent à avoir des effets dans nos réalités contemporaines. Les questions qu’elles posent ne touchent pas (seulement) au passé, mais à des responsabilités et remédiations présentes, ainsi qu’à des réparations futures. Même si les lois ont énormément évolué au cours du XXe siècle, même s’il faut s’en réjouir (et veiller à prévenir les retours en arrière), de très nombreuses discriminations et stigmatisations continuent à diviser nos sociétés sur des bases ethniques et raciales (comme sur des différences de genre ou sur des critères validistes).
Deuxième raison de parler de blanchités : il est irresponsable – au double sens d’indéfendable et de dangereux – pour les personnes blanches en particulier, de laisser les luttes contre les inégalités raciales à celleux qui les subissent directement : l’indifférence blanche envers les inégalités et les injustices raciales a de quoi susciter la colère ; et nous avons collectivement besoin d’apprendre à écouter celleux qui, face aux mensonges blancs/incolores de la prétendue égalité raciale, protestent avec une véhémence justifiée.
3. Mettre en causes les privilèges blancs.
Le noyau radioactif des blanchités est à identifier dans ce qu’il est désormais convenu d’appeler « les privilèges (ou avantages) blancs ». On désigne par ce terme des possibilités et des modalités d’action qui semblent parfaitement « naturelles » et universellement humaines à certains groupes sociaux (identifiables comme « blancs »), alors qu’elles sont entravées, rendues difficiles, dangereuses ou impossibles, pour d’autres groupes sociaux (relégués de ce fait au statut de « non-blancs »). Exemple historique : certain·es historien·nes montrent que le racisme est né dans les colonies du besoin de pouvoir contenir la fuite de la main d’œuvre, et qu’une équation sommaire entre « afrodescendant·e = peau noire = esclave » permettait de réprimer toute personne identifiée comme noire surprise hors de la plantation3. Dans un tel contexte, marcher librement dans une forêt relève d’un privilège blanc.
Exemple contemporain : les statistiques montrent que les contrôles d’identité et les violences policières frappent de façon disproportionnée les populations identifiées comme non-blanches, aux États-Unis comme en France4. Dans un tel contexte, marcher sans peur de la police relève d’un privilège blanc.
La notion de privilège renvoie généralement à l’idée de pouvoir économique et politique. Celleux qu’on appelle « privilégié·es », ce sont plutôt les personnes qui vivent de leurs rentes, qui possèdent de grands appartements ou des biens dès la naissance. Et de fait, un petit nombre de personnes (souvent blanches) sont, davantage que les autres, bénéficiares de tels privilèges. Mais pouvoir se promener en forêt ou marcher dans une rue sans craindre d’être inquiété·e par la police est lui aussi un privilège (une possibilité limitée à certaines personnes) : le privilège de l’anonymité, le privilège de pouvoir passer sans être arrêté·es, voire abattu·es.
Troisième raison de parler de blanchités : le privilège blanc intrastructure de nombreuses formes d’interactions sociales, causant des rejets, des frustrations, des injustices et des violences que nos sociétés auraient intérêt à prévenir et neutraliser.
4. Questionner les représentations de la pigmentation.
Il y a bien entendu de nombreuses formes de privilèges (au sens d’avantages tirés d’une situation inégalitaire) autres que ceux qui définissent les blanchités. La spécificité de ces dernières tient à ce qu’elles sont en rapport étroit, mais néanmoins variable, avec nos perceptions communes des pigmentations de nos peaux et de certains traits corporels. « Blanc » ou « noir » ou « rouge » ou « jaune » ou « métis » sont des couleurs-fantasmes, proprement façonnées à partir d’affects racistes, et pas (ou pas seulement) des couleurs-optiques, où entre en composition une Gestalt où se mêlent couleurs et formes des cheveux, formes du visage, mais aussi accents, vêtements, gestes, attitudes – le tout se synthétisant (lexicalement mais aussi perceptivement) dans la désignation de la pigmentation de la peau. La racialisation impose ainsi une violence coloriste au continuum des variations corporelles.
Or si la race n’est qu’un fantasme, cela n’empêche pas qu’elle ait des effets (au sens politique et psychologique). Quantité de choses « inexistantes » ont des effets réels : les narrations, les représentations, les mythes, nous font agir « comme si » ils existaient réellement, que nous y croyions ou pas. Ainsi, d’« inexistantes », les races deviennent pourtant structurantes, définissant parfois très frontalement et plus souvent en creux l’intégralité des relations sociales racialisées. Interroger ces représentations (et en premier lieu les nôtres), c’est nous offrir davantage de lucidité, et des ouvertures précieuses dans nos horizons relationnels.
D’où une quatrième raison de parler de blanchités : dès lors qu’on observe que la distinction blanc/non-blanc opère comme marqueur structurant de certaines représentations dans les espaces sociaux contemporains, questionner les corrélations entre perceptions de pigmentation et sentiment-de-pouvoir-faire ne relève ni d’essentialisations identitaristes, ni de politiques jouant la carte raciale, mais du B-A-BA de l’analyse socio-politique.
5. Expliciter la phénoménologie du capitalisme racial.
Lorsque Sara Ahmed esquisse une « phénoménologie de la blanchité5 », elle ne commence pas par observer des couleurs de peau ou des formes de visage : elle tente de comprendre comment différents corps sont conduits à occuper différemment l’espace dans lequel ils se trouvent. Les blanchités se constituent socialement à travers des modes de comportements qui sont vécus comme « naturels » par leurs agents, mais qui s’avèrent résulter de différentiations racialisées et racialisantes. Exemple : si l’on équipait d’une caméra et d’un micro de surveillance l’un de nous (Y. C.) identifiable comme un mâle-blanc-universitaire-bien-payé-au-seuil-de-la-retraite, on s’apercevrait que dans tous les espaces où il entre avec confiance, où il est reçu avec bienveillance et où il se comporte avec aisance, il tend à parler beaucoup plus abondamment et plus longuement que la plupart des autres personnes présentes. Il n’est certainement pas simple de savoir dans quelle mesure exacte c’est en tant que blanc (plutôt qu’en tant que mâle, universitaire, bien payé, senior) qu’il parle et est écouté autant. Mais plusieurs décennies d’enquêtes en sciences sociales permettent de mesurer statistiquement que toutes ces caractéristiques de sa personne (ainsi que bien d’autres) concourent à son sentiment-de-pouvoir-parler-en-public en escomptant une écoute bienveillante qui tend à se confirmer au fil de ses expériences.
Cinquième raison d’en parler : parce que les phénoménologies de la blanchité échappent aux agents qui en bénéficient, travailler à l’explicitation de ces phénomènes de surface peut aider à la remédiation de leurs causes structurantes.
6. Nuancer les vertus du métissage et les hypocrisies de la diversité.
Il faut saluer le démantèlement progressif de la plupart des discriminations légales qui ségrégaient les populations des siècles et des décennies passées. On peut ainsi se réjouir qu’il ne soit plus interdit et qu’il soit même légal, pour des personnes de différentes nationalités (ou catégories raciales) de faire familles, tendant à rendre de plus en plus absurde et illisible toute possibilité d’apartheid fondée sur le phénotype ou le génotype. En ce sens, métissage et créolisation sont de remarquables agents de corrosion des injustices liées à la blanchité et au colorisme, qui se sont longtemps maintenues au travers de lois interdisant la « miscégénation ». Similairement, des progrès significatifs ont été obtenus par les politiques d’« action affirmative » (maltraduites en « discrimination positive ») recommandant notamment des quotas de représentation combattant l’exclusion systémique de certaines minorités. (Et l’on peut se demander pourquoi l’évidence actuellement partagée en France sur les bienfaits de la parité de genre ne parvient pas à accélérer l’attention et le désir de remédier à la blanchité (écrasante) dans la composition des corps enseignants des universités.)
De nombreuses voix s’élèvent toutefois pour souligner certaines insuffisances ou certains effets pervers des mots d’ordre de métissage et de diversité6. Non qu’il faille les jeter avec l’eau du bain : il est plus important que jamais de défendre les politiques de diversité, d’équité et d’inclusion attaquées frontalement par les suprématistes qui occupent actuellement la Maison (bien nommée) Blanche, entre autres lieux de pouvoir. Mais quelque chose résiste encore profondément à ce que l’on espérait de ces dispositifs – et ce quelque chose pourrait bien s’éclairer à la lumière des questions de blanchités7, telles que les posent des mouvements comme l’anti-assimilationisme (qui refuse le recrutement des minorités racialisées dans le projet moderne/colonial et appelle à l’invention de contre-espaces8) et l’afropessimisme (qui ne voit aucun espoir dans la réforme cosmétique du monde qui a rendu l’esclavage possible et en réclame l’abolition9).
D’où une sixième raison de parler de blanchités : le métissage et la diversité ont peut-être été des réponses inventives à des situations impossibles, mais elles ne signent pas la fin de l’effort anti-raciste, et il existe encore de nombreux noyaux de résistance à l’avènement d’une société qui ne permettrait pas aux suprématismes blancs de faire retour.
7. Comprendre et désarmer la montée réactionnaire du suprématisme blanc.
En 2025, on le constate chaque jour à la surface du bruit médiatique et des résultats électoraux que ce bruit conditionne, notre période est celle d’un regain de vigueur et de fierté de ce qui n’hésite plus à se revendiquer comme suprématisme blanc.
Il est peu probable que les travaux sur la blanchité soient lus par ces droites identitaires. Mais ils peuvent contribuer à en éclairer l’essor, et à interroger la manière dont certaines pratiques (universitaires notamment) pourraient bien en être, malgré elles, solidaires. Arun Saldanha parle d’une certaine « viscosité » ou « solidarité des corps blancs » qui, par exotisme, semble pousser les Blanc·hes à coller entre elleux quand ielles se rendent à l’étranger10. Tout en se disant « anti-racistes », certain·es Blanc·hes se réunissent parfois de la même manière : exclusivement ou en majorité écrasante entre Blanc·hes, fût-ce pour parler, ou pour traduire, ou pour éditer, voire pour « lutter » pour, mais pas tellement « avec », les non-Blanc·hes. De cette glu, on peut se demander si elle ne serait pas en partie de la même nature que celle qui fait se solidariser les suprématistes faisant des saluts fascistes, ou le passant blanc qui se rapproche imperceptiblement d’autres personnes blanches quand il croise une personne racisée dans la rue.
D’où une septième raison de parler de blanchités (dans leur pluralité) : il est plus crucial aujourd’hui que jamais de trancher (souvent au scalpel) ce qui unit encore les blanchités porteuses de volontés anti-racistes aux blanchités suprématistes porteuses de nouvelles formes d’apartheid.
8. S’inquiéter des effets pervers pouvant émaner d’études universitaires sur la blanchité.
Les études critiques de la race sont, depuis leur naissance, soucieuses des manières dont l’enquête sur les concepts de race et de blanchité peut se retourner contre celleux qui les emploient. La philosophe Sara Ahmed nomme quelques-uns de ces dangers dans un article particulièrement cinglant sur ce qu’elle appelle « la non-performativité de l’antiracisme11 ». En voici quelques exemples : 1. l’étude de la blanchité, en donnant une occasion de plus (aux Blanc·hes) de parler des Blanc·hes, court le risque de « devenir un spectacle de pur reflet de soi, renforcé par l’insistance sur l’idée que la blanchité “est aussi une identité” » ; 2. l’étude de la blanchité, en prétendant rendre la blanchité visible (comme si elle n’était pas déjà extrêmement visible, en tous cas aux yeux des sujets non-blancs), fait courir le risque aux sujets blancs de s’en dédouaner en se disant « conscients de la blanchité », sur le mode « si je vois la blanchité, alors je ne suis pas blanc·he, puisque les Blanc·hes ne voient pas leur blanchité » ; 3. l’étude de la blanchité, en conduisant les sujets à s’auto-déclarer comme blancs, voire à se déclarer honteux d’êtres blancs, peut avoir pour effet paradoxal de ne pas engager de transformation, mais de confirmer la position sociale blanche, voire de « repositionner le sujet blanc comme idéal social » ; 4. l’étude de la blanchité pourrait bien finir par « produire une identité blanche positive, une identité qui fait se sentir le sujet blanc satisfait de lui-même » (satisfait d’être conscient de lui-même en tant que coupable).
C’est pour mettre en garde contre ces risques de dérives et de récupération – faisant potentiellement le jeu du suprématisme blanc – que Sara Ahmed décrit les déclarations anti-racistes de blanchité comme des performatifs malheureux (unfelicitous). La déclaration de blanchité (« je suis une personne blanche privilégiée ») peut ainsi faire l’inverse de ce qu’elle prétend dire, c’est-à-dire devenir un énoncé contre-performatif : dire (la blanchité) devient ainsi NE PAS faire (acte anti-raciste), parce que les conditions de félicité ne sont pas réunies pour que l’énonciation suffise à produire ses effets (nos sociétés, nos institutions et nos habitudes continuent à maintenir en place des ségrégations multiples) :
« Ce que je voudrais remettre ici en question est l’idée selon laquelle le fait d’apprendre à voir le signe des privilèges impliquerait le fait de désapprendre ce privilège. […] La déclaration de sa blanchité, voire l’“aveu” de son propre racisme, conçu comme “preuve” d’un engagement antiraciste, ne fait pas ce qu’elle énonce. En d’autres termes, faire de la blanchité un objet de discours, aussi critique soit-il, n’est pas une action antiraciste, et n’engage pas nécessairement un État, une institution ou une personne dans une forme d’action que nous pourrions qualifier d’antiraciste. […] Le discours antiraciste dans un monde raciste est un performatif “malheureux” : les conditions de félicité ne sont pas réunies pour que ce “dire” puisse “faire” ce qu’il “dit” ».
On a ainsi une huitième raison de parler des blanchités : les problèmes bien réels posés par le recours à cette notion offrent une occasion de réfléchir sur les conditions d’efficacité, d’inefficacité ou de récupération des diverses formes d’actions ou de positionnements anti-racistes.
Si nous mettons en avant les blanchités dans l’espace de ce dossier, ce n’est donc bien entendu pas pour nous en réclamer, mais ce n’est pas non plus pour en faire des ennemies contre lesquelles il s’agirait de partir en guerre, pas plus que dans l’idée que la critique de la blanchité, par elle-même, permettrait de lutter contre ses effets délétères.
Dans la continuité de John Garvey et Noel Ignatiev lançant en 1992 le magazine Race Traitor qui accueillit les premières publications sur les blanchités, nous nous donnons plutôt pour but « d’explorer comment les gens qui ont été éduqués comme des blancs pourraient se déblanchir (become unwhite) ». La blanchité est un vestige de régimes périmés et néfastes, envers lesquels la trahison est plus appropriée que la lutte. Si, comme le veut la devise du magazine, « la trahison de la blanchité est la loyauté à l’humanité », ce dossier peut être envisagé comme un petit manuel de traîtrise, pour nous aider collectivement à déserter et saper aussi bien les illusions du racisme ordinaire que les tentations des suprématismes.
1Frantz Fanon, Peau noire, masques blancs, Seuil, 1952 ; George Yancy (dir.), White Self-Criticality Beyond Anti-Racism: How Does It Feel To Be A White Problem?, Lexington Books, 2014.
2Sylvia Wynter, « Unsettling the coloniality of being/power/truth/freedom », CR: The New Centennial Review, vol. 3.3, 2003.
3Voir Cedric J. Robinson, Marxisme noir, trad. Selim Nadi et Sophie Coudray, Entremonde, (1983) 2023 ; Yann Moulier Boutang, De l’esclavage au salariat. Économie historique du salariat bridé, PUF, 1998, p. 179-195.
4Voir Sarah Mazouz, Race, Anamosa, 2020.
5Sara Ahmed, « Une phénoménologie de la blanchitude », trad. collective, editionslesgrillages.noblogs.org, (2007) 2019.
6Voir Solène Brun, Derrière le mythe métis. Enquête sur les couples mixtes et leurs descendants en France, La Découverte, 2024 ; Ariana González Stokas, Reparative Universities. Why Diversity Alone Won’t Solve Racism in Higher Ed, Johns Hopkins, 2023.
7Leonora Miano, Afropea. Utopie post-occidentale et post-raciste, Grasset, 2020 et L’opposé de la blancheur. Réflexion sur le problème blanc, Seuil, 2023.
8Voir Fred Moten et Stefano Harney, All Incomplete. Alternatives au capitalisme logistique, Les Liens qui libèrent, 2025.
9Voir Norman Ajari, Noirceur. Race, Genre, Classe et Pessimisme dans la pensée africaine-américaine au XXIe siècle, Divergences, 2022.
10Voir le concept de viscosité blanche chez Arun Saldanha, Psychedelic White: Goa Trance and the Viscosity of Race, Univ of Minnesota Press, 2007.
11Sara Ahmed, « Déclarations de blanchité : la non-performativité de l’antiracisme », Mouvements, (2004) 2020.
L’article Comprendre et trahir <br>Huit raisons de mettre en cause les blanchités est apparu en premier sur multitudes.
20.12.2025 à 13:46
Homo Icarus Mettre la blanchité hors service, ouvrir un espace de guérison
multitudes
Homo Icarus Mettre la blanchité hors service, ouvrir un espace de guérison Écrivant en réponse au rassemblement suprématiste blanc de Charlottesville en 2017, Bayo Akomolafe propose de dépasser la condamnation morale pour examiner la blanchité comme projet colonial-capitaliste de désincarnation. S’appuyant sur les cosmologies yoruba de l’intersectionnalité (asé, croisées des chemins) et retraçant des trahisons historiques comme le Code esclavagiste de Virginie (1705), il analyse comment la blanchité a créé « Homo Icarus » : l’humain déraciné, coupé de la Terre et de la communauté. Akomolafe appelle à « mettre la blanchité hors service » par des pratiques de ré-autochtonie et en entrant dans des « trous blancs » – espaces liminaux où l’identité blanche peut être récupérée séparément du projet de la blanchité, permettant à toustes de renouer avec le lieu et la réciprocité relationnelle. Homo Icarus The Depreciating Value of Whiteness and the Place of Healing Writing in response to the 2017 Charlottesville white supremacist rally, Bayo Akomolafe proposes moving beyond moral condemnation to examine whiteness as a colonial-capitalist project of disembodiment. Drawing on Yoruba cosmologies of intersectionality (asé, crossroads) and tracing historical betrayals like the 1705 Virginia Slave Codes, he analyzes how whiteness created “Homo Icarus”: the rootless human severed from Earth and community. Akomolafe calls for “decommissioning whiteness” through re-indigenization practices and entering “white holes”—liminal spaces where white identity can be recovered separately from the whiteness project, allowing all peoples to reconnect with place and reciprocal relationality.
L’article Homo Icarus </em>Mettre la blanchité hors service, ouvrir un espace de guérison est apparu en premier sur multitudes.
Texte intégral (6568 mots)
Ce texte est dédié à toustes celleux qui mettent leurs corps en danger pour protéger les sans voix, les invisibles et les empêché·es1 ; et à mon « père-oncle », l’ingénieur Tokundo Obayan, décédé il y a quelques jours.
Des torches flamboyantes et leurs traînées de fumée s’insinuent dans le noir de la nuit, jetant un éclat ambré sur des visages en colère.
Les corps blancs se déplacent de-ci de-là dans un unisson vengeur.
Des hommes trapus, agrémentés de tatouages, de moustaches rampantes, de battes de baseball et de bandanas se mêlent à d’autres plus discrets qui pourraient passer pour des voisins attentionnés.
Des drapeaux portant la croix gammée et le X bleu des Confédérés flottent au vent mollement.
Des poings frappent l’air qui les entourent et des saluts nazis perforent l’atmosphère épaisse et menaçante.
Des chants gutturaux tels que « Les Juifs ne nous remplaceront pas », « Vous ne nous remplacerez pas » et « Le sang et le sol » – slogans des ultranationalistes agraires allemands de la fin du XIXe siècle repris par le Troisième Reich d’Hitler – planent au‑dessus de la foule.
Entouré de journalistes qui tentent de donner du sens à la dénonciation très peu enthousiaste qu’il vient de prononcer, le président des États-Unis se vante de la taille de son vignoble à Charlottesville.
Tout cela ressemble à un rêve étrange. Les images d’un cauchemar alcoolisé.
Tandis que je regarde ces scènes à faire froid dans le dos défiler sur mon écran de télévision, je me demande si ce sont les fragments filmés d’une époque ancienne, quand le racisme était flagrant et évident.
Non.
Ce sont bien les États-Unis d’aujourd’hui. Terre de liberté. Pays des braves2.
Charlottesville, Virginie. 11 août 2017. Après Jésus-Christ.
Que se passe-t-il ici ?
Lorsque j’étais très jeune, j’ai vu quelques épisodes de la mini-série Roots [racines] à l’occasion de sa rediffusion à la télévision nationale nigérienne. Avant de regarder la série, mes ami·es et l’un de mes oncles m’avaient averti : le feuilleton livrait un triste spectacle – des êtres humains, nos ancêtres, considérés comme rien de plus que des animaux ramasseurs de coton et enchaînés à des arbres comme des chiens. Il aurait été impossible de le regarder sans pleurer, m’avait-on dit, même privé·e de conduits lacrymaux. Je me souviens en avoir regardé quelques extraits lorsque je n’étais pas occupé par mes devoirs d’école. Impossible pour moi de comprendre comment quiconque pouvait traiter une autre personne de cette manière. Mon jeune esprit innocent n’avait aucune explication, mais n’en avait pas tellement besoin non plus à l’époque : […] heureusement, le monde s’était depuis amélioré. Grâce à Martin Luther King. Grâce à Nelson Mandela. Le racisme n’existait que dans les livres d’histoire. Maintenant toustes pouvaient vivre et circuler sans craindre la réprimande.
Avec l’âge, apparaît plus clairement la réalité nuancée et perturbante d’un monde qui ne s’est pas encore débarrassé de ses troublantes injustices liées à la race et à la classe. Un monde hanté par des fantômes qui n’enchantent pas – des fantômes figures de problèmes irrésolus. Voir les membres de ce nouveau mouvement de la « droite alternative », ou alt-right, prendre les rues de Charlottesville pour consolider la défense d’un nationalisme blanc aux États-Unis et pour manifester contre la diversité et le multiculturalisme, a ravivé les sentiments de terreur de mon enfance – la même terreur inexplicable que j’ai ressentie lorsque Kunta Kinte [personnage principal de la série télé Roots], son corps en sueur menotté par des chaînes rouillées, apparaissait à l’écran.
Bien sûr, j’ai vécu de courts éclats de micro-agressions racistes, mais rien d’aussi notable… rien d’une violence sans gêne telle qu’elle fût susceptible d’arracher le vernis fragile de la bienséance publique. Une sensation étonnamment nouvelle. Il semblerait que j’aie perdu l’innocence des années passées et le luxe qui consistait à attribuer grossièrement cela au « mal » ou à la « cruauté ». Quelque chose d’autre cherche à être remarqué ; quelque détail recouvert par les débris de ces presque-sagesses flottant à la surface qui tente d’attirer notre attention.
Oui. C’est un sentiment nouveau. Même avec Trayvon Martin, Freddie Gray, Eric Garner, Ezell Ford, Tamir Rice et les 611 personnes noires déjà tuées par la police aux États-Unis en 2017 au moment où j’écris ces lignes, le spectacle choquant des lumières, croix gammées et haine déchaînée dépasse vraiment les limites. Du moins pour celleux d’entre nous qui sommes à l’étranger […], Charlottesville est ressenti comme un moment charnière – de même que la recrudescence inquiétante du néonazisme, du Ku Klux Klan et du nationalisme blanc des États-Unis de Donald Trump. La ligne qui instrumentalise la politique précaire des États-Unis dans une binarité dangereuse se transforme peu à peu en gouffre béant – une zone infranchissable. […]
Les fantômes qui gémissent
Alors, comment donner du sens à tout ça ? Qu’est-ce que cela signifie ? Est-il possible de comprendre pourquoi un homme de 20 ans s’est senti en sécurité et autorisé à foncer avec sa voiture dans une foule – tuant l’une des contre-manifestanz et en blessant 35 autres ? Peut-être que le plus simple c’est encore de le nommer tel que cela apparaît, à la manière de John Pavlovitz :
« Cela s’appelle racisme.
Cela s’appelle terrorisme domestique.
Cela s’appelle extrémisme religieux.
Cela s’appelle sectarisme.
Une haine aveugle la plus vile (sic) qui soit.
Cela ne représente pas l’Amérique.
Cela ne représente pas Jésus.
Ce n’est pas la voix de la majorité des personnes blanches états-uniennes.
C’est une maladie cancéreuse, terrible et putride qui représente le pire de ce que nous sommes3. »
[…] Quand celleux à la droite du spectre politique états-unien évitent de parler de la problématique du racisme ou de la normativité blanche, nient les effets réels et délétères de l’oppression structurelle d’un revers de main ou prétendent que le monde est un terrain de jeu équitable où chaque personne a les mêmes opportunités et la même possibilité « d’atteindre le sommet », je ressens la colère de Pavlovitz et son besoin urgent de nommer la bête. […]
Mais alors, une pulsion étrange s’empare de moi… peut-être un fantôme triste qui espère attirer l’attention sur les liens qui l’enchaînent à des lieux blessés. Je n’arrive pas à me défaire de l’idée que trafiquer avec les essentialismes et les appellations réductionnistes – même lorsqu’elles ont du sens culturellement et qu’elles sont peut-être aussi profondément apaisantes pour notre sensibilité morale et notre sens collectif d’indignation – fasse partie de l’échafaudage qui empêche que la reconnaissance et la prise de responsabilités se produisent à un niveau moins superficiel aux États-Unis. […]
Ma question est donc la suivante : est-ce suffisant ? Est-ce que qualifier ce phénomène de « mal » ou de « maladie » comme nous avons coutume de le faire – qu’il s’agisse d’un geste rhétorique ou d’une tentative sincère d’objectivité – nous permet de rencontrer les fantômes qui gémissent, les voix exclues dont les peaux écorchées sont suspendues dans l’attente de quelque résolution ? […] Au risque de passer pour un sympathisant du suprématisme blanc, et avec un espoir vif de guérison [de la blessure raciale], je veux joindre ma voix à celles du chœur doux et à peine audible qui ruisselle maintenant sur les rives des arguments bruyants du courant dominant. Une mélodie difficile à décrypter qui parle cependant d’autres lieux du pouvoir – où la blanchité est composée de toutes les couleurs dont elle n’a jamais vraiment été séparée.
Un détour à la croisée des chemins
[…] Les sagesses autochtones du peuple yoruba nous invitent à considérer le monde en termes de chemins qui se croisent. Comme une émergence en cours de la multitude par l’intermédiaire d’intersections et d’intra-actions surprenantes.
Au moment d’offrir une prière ou une libation, le mot asé est généralement prononcé à voix haute, en réponse à un appel de la personne qui officie. […] Asé est la musique à la croisée des chemins et la fragilité de toute chose. Le concept de moi et d’identité, dont la philosophie queer de asé donne une nouvelle description, ne peut concevoir « l’autre » comme ce qui serait « négatif, manque, [ou] étranger » […]
Toutes les routes sont des croisements de chemins ; chaque autoroute une jonction d’intra-sections. Matière-esprit… réalité… toute « chose » est déjà un édredon assemblé par des multitudes de couturièr∙es, humain∙es et non humain∙es, éparpillé∙es dans l’espace-temps – chaque objet est un nœud dans la circulation cosmopolitique et matério-discursive des choses qui s’entrecroisent, s’entremêlent, se biffent et s’écorchent. Les croisées de chemins nous aident à apprécier notre entre-existence/intra-devenir et à réaliser que quelque chose d’intéressant est toujours en train de se produire aux frontières et aux limites des choses, pas seulement à leur cœur ou à leur centre.
Le dispositif socio-économico-politico-scientifique de la modernité prescrit la séparation et proscrit l’intrication ; nous rendant aveugles à l’étonnante réciprocité qui lie ensemble valeurs, objets, discours, corps, idées et toutes sortes de phénomènes si intimement que nous ne pouvons plus dire que les choses précèdent les interactions qu’elles ont les unes avec les autres […] En tant que sujets d’un agencement nouveau des choses, nous avons tendance à voir les choses comme indépendantes les unes des autres et non comme des agentivités intra-agissantes. […]
Il s’agit d’une affirmation radicale et d’une notion des plus dangereuses à admettre : que d’une manière qui n’a rien de mystique, je suis concrètement intriqué avec ces personnes que je préférerais diaboliser sous le nom de suprématistes blanc∙hes et sympathisant∙es nazi∙es. Le cadre de pensée dualiste nous permet de séparer les « racistes » des « non racistes » […] Toutefois, un cadre de pensée non dualiste, tel que celui décrit par la notion autochtone de croisée des chemins mentionnée plus haut, mettant l’accent sur les intrications, l’intersectionnalité, la diffraction et l’intra-action […] parle de la manière dont nous avons été brisé·es et réclame une analyse du pouvoir différente – une manière soigneuse de rendre des comptes qui fait de nous les complices de ce dont nous souhaitons justement nous débarrasser. […] [A]u lieu de penser au passé comme ce qui vient avant, les cosmologies qui se situent à la croisée des chemins considèrent le passé comme ce qui est encore à venir et la responsabilité comme une action, encapacitante ou incapacitante, qui se partage entre co-participanz dans une mangrove compliquée. Le principe du cause-à-effet passe par la fenêtre ; celui du bien contre le mal devient naïf. […]
Essayer de clore le débat à coups de conversations emphatiques sur la dépravation morale de celleux qui commettent le péché [du racisme], cela a un coût : celui de réprimer ce qui souhaite s’exprimer, celui d’empêcher que la guérison advienne […]. Alors que le sacré et le profane s’engageaient dans une conversation ritualisée, leur dialogue était interrompu par la précision assassine des balles tirées par le fusil colonial. Ce qui s’est passé à Charlottesville (en Virginie) est le symptôme de la dépréciation continue de la blanchité et du trauma associé de l’identité blanche. Cela va au-delà de quelques nationalistes blanc∙hes néfastes qui perturbent la sérénité du projet états-unien et dont on aimerait bien pouvoir se débarrasser, et cela dépasse les fondations mêmes d’un État-nation qui était (et a toujours été) un incubateur tout à la fois pour la lutte des classes raciales et pour l’homme désincarné, celui que je propose d’appeler Homo Icarus.
La rébellion de Bacon
« Tous les serviteurs importés ou amenés dans le Pays… qui n’étaient pas Chrétiens dans leurs Pays d’origine… seront considérés et faits esclaves. Tous les esclaves nègres, mulâtres et indiens de ce dominion… seront considérés comme des biens. Si un esclave résiste à son maître… et que, le corrigeant, il advient qu’il le tue… le maître sera libre de tout châtiment… comme si l’incident ne s’était jamais produit. »
Par ces mots, l’Assemblée Générale de Virginie de 1705 codifie la suprématie blanche. Les serviteur·es noir·es ou de couleur, qui pouvaient être considéré·es comme employé·es et doté·es de certains droits, deviennent des esclaves noir·es ou de couleur. Celleux qui s’identifient comme blanc∙hes sont placé·es sur un piédestal au-dessus des autres – en vertu de leur couleur de peau. Les Noir·es ne peuvent plus porter des armes, participer à des manifestations, posséder quelque propriété que ce soit (une propriété ne peut être propriétaire) ou participer à la société comme le feraient des hommes libres. Démuni·es de toute agentivité, les personnes noires des générations à venir allaient être traitées comme des fractions d’hommes, et les personnes blanches en viendraient à occuper une plateforme socio-politique qui leur garantirait une place dans l’ordre cosmique des choses que seule la réincarnation aurait permis aux personnes noires d’atteindre.
Les attitudes que nous observons aujourd’hui à l’égard des minorités aux États-Unis… les sentiments imprévus qui se glissent derrière les meilleures intentions, au point de distordre l’idée que l’on pourrait se faire de notre capacité à contrôler nos propres actions, au point de mener les officiers de police à tirer en l’absence de danger réel, peuvent trouver des ancêtres dans ces moments où l’État est devenu un agent du contrôle racial. Mais l’histoire de la suprématie blanche et des relations raciales négatives est plus nuancée que la seule proclamation d’une loi [par l’Assemblée Générale de Virginie codifiant la suprématie blanche en 1705]. Ce qui mène la première assemblée législative des États-Unis, la Chambre des Bourgeois de Virginie, à proclamer cette loi peut être associé à un incident qui se produit quelques années plus tôt. En 1676, la première révolte [d’esclaves] avait balayé les colonies américaines, à commencer par celle de Virginie. Nathaniel Bacon, membre de la classe dirigeante, orchestre une ruse, qui entraîne serviteur·es blanc·hes comme esclaves noir·es à s’opposer au gouverneur, William Berkeley, qu’il accuse de trahir les communs et le bien public […]. Berkeley finit par remporter la bataille et par mater la rébellion des partisans de Bacon, mais l’idée d’une alliance noire et blanche pour la justice économique allait continuer de hanter les nuits de la classe dirigeante. La logique du Code esclavagiste que la Virginie promulgue en 1705 était la suivante : si les Noir·es sont abaissé·es dans l’ordre général du monde, les personnes blanches pourront orienter leur attention vers le maintien d’un statu quo qui leur bénéficie. […]
Progressivement l’identité blanche s’accrocha avec force au projet de la blanchité qui était pourtant aussi nocif pour les communautés diverses de personnes qui finirent par être subsumées sous une prétendue « race blanche » homogène par le fait de la recherche anthropologique ultérieure. La blanchité elle-même, distincte de l’identité blanche, est le projet colonial-capitaliste d’extraction, de conversion et d’occupation qui – tiré des activités et pratiques des Européen∙nes qui explorèrent des terres « découvertes » pour en extraire les ressources – en est venu à s’établir en ordre mondial dominant. À défaut de satisfaire la promesse fabuleuse de la conquête de l’or sur ces terres, les élites britanniques décidèrent de débarrasser les rues de Londres de leurs pauvres. Orphelin∙es, alcooliques et paresseux∙ses furent capturé·es, amassé·es sur des navires et envoyé·es aux Amériques. Dans un effort anticipant sur le Rêve Américain et les pratiques des banques actuelles qui refourguent leurs prêts en échange du rêve de posséder maison et voiture, les chasseurs de tête vendaient le rêve de posséder d’importants morceaux de la terre de ce nouveau royaume. En Angleterre, les personnes qui adhérèrent à ce rêve se figuraient en riches propriétaires fonciers, avec de nombreux·ses ouvrier·es à leur service. Bien sûr, arrivé·es aux Amériques, débarquant en Virginie, il s’avéra rapidement qu’il n’y avait guère de terres que pour une poignée de riches. Ces Blanc·hes déplacé·es commencèrent à errer en direction de l’ouest, à la recherche des paradis promis, sans jamais les trouver. Leurs progénitures, qu’on appelle aujourd’hui white trash, « déchets blancs », portent la marque de la rage bouillonnante des promesses non tenues.
[…] En un certain sens, on pourrait dire que la blanchité a été une ruse pour couper les gens de leurs relations avec le sol et la boue, une ruse pour les couper des mouvements du monde matériel et des rituels par lesquels iels se lient avec la planète. Pour nous couper des créatures dysfonctionnelles et modestes que nous sommes avec (et non sur) cette planète qui n’est ni morte ni un simple outil pour nos fantasmes de croissance.
La blanchité, prêche de la désincarnation, est la condition pour la migration forcée et intergénérationnelle qui conspire contre les corps blancs, noirs, indigènes et métisses. La blanchité, c’est le mythe d’Homo Icarus – l’homme qu’elle a façonné. Celui dont les pieds ne touchent pas le sol, qui craint de se déposer par terre de peur que la terre ne l’enveloppe. […]
Le néolibéralisme et les conditions changeantes de la blanchité
Secouez un instant la toile où s’entretissent la fragilité blanche et la xénophobie – celle exprimée dans la manifestation « Unite the Right » à Charlottesville –, vous réveillerez des peurs profondément ancrées concernant le manque d’espace.
Il n’y a jamais assez de place dans les espaces blancs. C’est pourquoi la blanchité s’est toujours efforcée de se rassembler, de s’agglutiner autour de l’ethos du même et de bannir « l’autre » culturel-phénotypique à ses marges. Ce qui se présente faussement comme de la haine pure n’a en fait rien de pur – rien n’est pur quand on se tient à la croisée des chemins des rencontres. La « haine », dans ce cas précis, est plutôt un écosystème d’angoisses non résolues, des siècles de déplacements forcés et d’errance, de sombre animosité et de joie maligne tirée de la maltraitance d’autres conçu·es comme ontologiquement inférieur·es et de l’aspiration à voir nos turpitudes reconnues et embrassées par un monde en tourment. Dénoncer sommairement cette haine – même si cela peut nous paraître aligné avec nos valeurs morales –, c’est, assez ironiquement, perdre une opportunité d’excaver les histoires communes, les espoirs mutilés et les désirs désespérés qui continuent d’insister sous la surface.
Et si nous nous donnions la chance de rester un peu plus longtemps avec la haine ? Et si nous nous efforcions d’accorder à celleux qui haïssent un peu plus d’humanité ? […]
Alors que des changements climatiques radicaux sont en train d’interrompre la période tempérée de stabilité météorologique qui a rendu la croissance industrielle possible, et alors que de nouvelles technologies sociales et de nouveaux moyens de transports remettent en cause les frontières nettes qui opposent l’« ici » au « là » et le « moi » au « toi », nous devons collectivement faire face à de nouvelles questions concernant la viabilité des futurs qui nous sont annoncés. Les personnes blanches – si une telle chose a jamais existé comme un tout homogène – portent les marques initiales d’un rêve moribond inscrit à même leurs os. À même « leurs » corps. Et je devrais dire à même « nos » corps et non pas les « leurs », parce que même si je suis un homme noir-noir d’Afrique de l’Ouest, je suis blanc (où « blanc » ne veut pas nécessairement dire identifié-comme-blanc ou caucasien, mais renvoie plutôt à une description qui concerne la plupart d’entre nous qui avons été forcé·es de vivre séparé·es de toute terre et de toute communauté, qui avons été déplacé·es par le projet moderne).
Le désir de passer à autre chose, de résoudre cette histoire, est là. Une rage insupportable face au vide existentiel, un néant qui désire se remplir de couleurs et de racines et d’appartenances qui peinent encore à être articulées. L’identité blanche – intimement liée au projet d’expansionnisme capitaliste, d’ascension civilisationnelle, d’exclusivité et de luxe – est mise en tension par l’ordre qu’elle a contribué à créer. La blanchité elle-même est en train de faire face à ses traumatismes les plus profonds : au milieu de son universalisme, une spécificité effarante d’éléments viennent la confronter ; au milieu de sa quête pour l’homogénéité et le fondamentalisme, elle fait face au vide du précipice. Une cavalcade de couleurs, noires et brunes et mouchetées de blanc et de pas-si-blanc, font proliférer son angoisse constitutive et perturbent son obsession monofocale – celle qui ne désire que refaire le monde à son image, et qui qualifie d’insensée toutes les autres opérations de fabrication du sens, ou qui n’accepte que celles qui sont approuvées (du bout des lèvres) et momifiées par l’institution.
Mettre la blanchité hors service
Faire face à Charlottesville, c’est prendre de plein fouet l’implosion de l’ordre et de la normativité blanches. […] C’est aller à la rencontre de celleux qui sont brisé·es, de celleux qui – comme le reste d’entre nous qui nous disons peut-être « sain·es » ou « bon·nes », qui nous considérons comme étant « du bon côté de l’histoire », qui nous pensons peut-être comme progressistes et « pour la diversité » – ne sont pas encore à la maison.
C’est rencontrer la blanchité dans son agentivité diffractée et sophistiquée, et écouter les énigmes qu’elle nous pose.
[…] Qui traînerons-nous devant les tribunaux pour avoir trahi les personnes blanches déplacées qui devinrent esclaves plutôt que propriétaires des 50 acres de terre qu’on leur avait promis sur le nouveau continent ? Et la justice rendue dans ces tribunaux sera-t-elle capable de prendre en compte les déplacements de celleux qui habitaient les Amériques avant l’arrivée des colons ?
Cela vaut la peine d’être répété : le cœur de la haine, c’est l’univers de relation qu’elle exclut. Voilà ce que les croisées de chemins ont à nous apprendre. Rien n’est jamais singulièrement soi-même. […]
Ce n’est que dans un sens cartésien et chrétien que la haine se réfère à un « mal » intérieur impénétrable qui évoque la construction théo-psychologique du choix et du libre arbitre. Je crois plutôt que le traumatisme intergénérationnel des déplacé·es, la peur du remplacement et les involutions de l’espace-temps sont des absences qui attestent d’un bouillonnement dont nous ne sommes pas aussi quittes que nous l’imaginions. Le passé irrésolu fait un retour inattendu, même s’il n’en est pas à sa première fois. […] L’espace culturel pour réellement « rester avec le trouble » […] appartient nécessairement aux espaces frontaliers. Et ce sont ces espaces qu’il nous faut apprendre à écouter.
[…] La guérison [raciale] ne demande pas que nous bannissions les monstres ; elle exige que nous embrassions nos alter egos – les « herbes folles » que nous cherchons trop souvent à tenir de l’autre côté de nos clôtures.
Certain·es universitaires sont en train de s’en aviser. […] [N]ous assistons au compostage de la blanchité – un soin palliatif apporté à l’entreprise globale qui a co-opté l’identité blanche comme lieutenant pour défendre les intérêts d’une société fondée sur l’épiderme et l’exclusion de l’altérité.
Je pense ce travail […] [comme] une régénération d’espaces pour deuiller, pour célébrer, pour manger ensemble et pour apprendre à nouveau comment nous lier aux mondes qui nous entourent.
Mettre la blanchité hors service, voilà la décolonisation. Une occasion pour nous refamiliariser avec les racines – ces choses tentaculaires qui nous lient à la terra firma dont nous croyons, comme Icare, nous être libéré·es. Souvenons-nous que la blanchité était/est l’invitation à oublier les racines, à rejeter la signification de la multitude des herbes folles dont les radicules nous tiennent ensemble. […] La blanchité est un mensonge parce qu’elle affirme que celleux qui acceptent de se joindre au projet des personnes identifiées-comme-blanches ne sont pas autochtones. […]
La décolonisation, c’est la réhabilitation et la fabrication de « nouvelles » connexions. Il ne s’agit pas de restaurer l’originaire proprement. Même l’ancestral dont on se souvient est nouveau. Se souvenir, c’est nécessairement se re/souvenir, se re/membrer, se reconfigurer. Le passé est toujours à venir. Plus avant, la mise hors service de la blanchité est ainsi l’œuvre du monde lui-même – un souci pour un soi élargi, quelque chose de plus ancien que les êtres humains, mais qui les enveloppe. Il ne s’agit pas simplement de se débarrasser des structures, de se débarrasser des racistes, de fustiger les personnes identifiées-comme-blanches. Il ne s’agit pas de l’emporter sur l’autre camp, ni même d’arrêter celleux qui portent les discours de haine. […] L’impulsion de mettre un terme à la blanchité est elle-même un produit de la blanchité. Du pain béni pour celleux qui pensent encore que le monde peut être dirigé par leurs intentions, qu’il attend passivement leur intervention. Mais la blanchité n’est pas un choix individuel4 ; il n’y a pas d’interrupteur qui permettrait d’activer/désactiver les maîtres. La blanchité n’est pas un choix et sa « rédemption » ne nous emmènera pas devant les portes du paradis.
Entrer dans des trous blancs : récupérer l’identité blanche
Mettre la blanchité hors service implique de récupérer l’identité blanche. Récupérer l’identité blanche, c’est dé-cadrer la blanchité et détromper les personnes identifiées-comme-blanches de l’idée qu’elles seraient elles-mêmes comme des pages blanches, seules, sans espoir, sans autre secours ou réconfort que la performance de la blanchité. Mettre la blanchité hors service, c’est tenir ces corps, devenir allié·es avec ces autres radicalisé·es, apprendre à rendre compte de nos autochtonies et à développer une hospitalité musclée pour la haine. Mettre la blanchité hors service, c’est habiter d’autres lieux de pouvoir, apprendre à faire pousser notre nourriture, à dîner chez les voisaines et se partager nos cadeaux.
Caractériser la sorte de travail nécessaire à la réhabilitation d’une identité blanche n’est pas simple. Mais il pourrait être utile de mobiliser la figure du « trou blanc » pour le faire. […] Les trous blancs sont moins communs [que les trous noirs], mais ils n’en ont pas moins des conséquences tragiques et remarquables. Un trou blanc est une anomalie, un orifice qui s’ouvre à même le tissu de l’expansionnisme blanc, qui déchire sa broderie délicate – quelque chose qui se tient en dehors des paramètres du sens pour celleux qui sont impliqué·es dans le projet de la blanchité (et qui peuvent inclure des personnes dont les épidermes sont blancs, noirs, bruns ou mouchetés de blanc). Les trous blancs se tiennent au bord de la blanchité, à leur frontière liminale. Ils évoquent la terreur, une peur morbide. Et c’est en eux que tient notre plus grand espoir.
Approcher un « trou blanc » : c’est ainsi que j’aimerais raconter l’histoire de la manière dont nous toustes – celleux qui sommes en gestation dans le ventre de la blanchité, blanc·hes, brun·es, noir·es ou jaunes – pourrions devenir capables de retrouver une autochtonie respectueuse de la terre et de rencontrer, pour de bon, les fantômes qui nous appellent depuis si longtemps à nous asseoir et à rester avec le trouble qui est la condition de notre émergence.
Conclure : nous sommes en train d’atterrir
[…] Les relations raciales ne se transformeront pas à coups de grands gestes et d’événements retentissants. Elles ne feront pas, comme on dit, la une des journaux télévisés. Ce qui doit se produire – ce qui se produit déjà – est petit et apparemment insignifiant […] et ce dont nous sommes capables se tisse déjà dans le tissu du cosmique et du monumental.
Charlottesville […] montre l’impuissance des modes conventionnels de réponse aux problèmes.
La grande histoire – celle qui ne sera pas racontée par les médias dominants – est l’histoire d’Homo Icarus l’orphelin, le vagabond, celui qui a les pieds suspendus dans le vide et dont les angoisses intergénérationnelles cherchent un refuge, celui dont les nombreuses peaux cherchent à s’éloigner des autres, et dont le seul espoir de s’envoler réside dans sa chute… une descente vers la terre, une explosion en une multitude de morceaux brisés. Et quand il sera suffisamment brisé et prêt, alors seulement le sol pourra commencer son œuvre sacrée.
Traduit de l’anglais
par Emma Bigé & Mabeuko Oberty
1NdT : Ce texte de Bayo Akomolafe est paru le 19 août 2017, quelques jours après les « événements de Charlottesville », une ville moyenne de Virginie où un rassemblement d’extrême-droite « Unite the Right » (« unir la droite », autour du maintien de la statue équestre du général Lee, un soldat de l’armée confédérée qui luttait pour le maintien de l’esclavagisme) est l’occasion d’un attentat à la voiture-bélier par le militant suprématiste blanc J. A. Fields. L’attentat, qui prend pour cible les anti-fascistes venus protester contre la manifestation, coûte la vie à Heather Heyer, une assistante juridique de 32 ans, et blesse 35 autres personnes. En juin 2019, Fields est condamné à la prison à perpétuité pour meurtre avec préméditation.
2NdT : Référence à un vers de l’hymne national états-unien : « Oh dites-moi ! La bannière étoilée flotte-t-elle déjà / Au-dessus de la terre de la liberté et du pays des braves ? »
3NdT : « Yes, this is racism », johnpavlovitz.com, 12 août 2017.
4Je ne suis donc pas d’accord avec l’idée de Baldwin selon laquelle la blanchité serait un choix puisque celleux à qui elle est vendue pourraient aussi bien s’en départir. Je considère plutôt que le « choix » n’est pas le seul facteur à participer au phénomène de racialisation des personnes identifiées comme blanches. Sans compter que la blanchité ne signifie pas la même chose pour toustes celleux qui « l’adoptent ».
L’article Homo Icarus </em>Mettre la blanchité hors service, ouvrir un espace de guérison est apparu en premier sur multitudes.
- GÉNÉRALISTES
- Ballast
- Fakir
- Interstices
- Issues
- Korii
- Lava
- La revue des médias
- Time [Fr]
- Mouais
- Multitudes
- Positivr
- Regards
- Slate
- Smolny
- Socialter
- UPMagazine
- Le Zéphyr
- Idées ‧ Politique ‧ A à F
- Accattone
- À Contretemps
- Alter-éditions
- Contre-Attaque
- Contretemps
- CQFD
- Comptoir (Le)
- Déferlante (La)
- Esprit
- Frustration
- Idées ‧ Politique ‧ i à z
- L'Intimiste
- Jef Klak
- Lignes de Crêtes
- NonFiction
- Nouveaux Cahiers du Socialisme
- Période
- ARTS
- L'Autre Quotidien
- Villa Albertine
- THINK-TANKS
- Fondation Copernic
- Institut La Boétie
- Institut Rousseau
- TECH
- Dans les algorithmes
- Framablog
- Gigawatts.fr
- Goodtech.info
- Quadrature du Net
- INTERNATIONAL
- Alencontre
- Alterinfos
- AlterQuebec
- CETRI
- ESSF
- Inprecor
- Journal des Alternatives
- Guitinews
- MULTILINGUES
- Kedistan
- Quatrième Internationale
- Viewpoint Magazine
- +972 mag
- PODCASTS
- Arrêt sur Images
- Le Diplo
- LSD
- Thinkerview