
05.11.2025 à 11:24
Mamdani : New York envoie un souffle d’espoir à la gauche mondiale
la Rédaction
Texte intégral (1552 mots)
La newsletter du 5 novembre 
Dans un monde où l’extrême droite a le vent en poupe, la victoire du socialiste dans la capitale économique américaine résonne comme une déflagration d’espoir.
Enfin une bouffée d’air, enfin une victoire qui donne envie d’y croire à nouveau. Dans ce monde où la droite radicale prospère sur les ruines du désespoir, où les fascistes se sentent pousser des ailes, la victoire de Zohran Mamdani à New York résonne comme un soulagement, presque comme une respiration politique. Pas une de ces semi-victoires à la Pyrrhus dont on ne sait si on les a vraiment gagnées : non, une victoire populaire, claire, incarnée — plus de 50 % des voix, une participation record depuis 1969. Et quelle claque pour les puissants, quelle gifle pour Donald Trump, qui a immédiatement compris le danger. Car Mamdani n’est pas simplement un élu de plus à gauche : il est le visage d’une Amérique que la droite veut faire disparaître — une Amérique métisse, populaire, queer, musulmane, fière, combative et de gauche.
Trump l’a désigné comme adversaire, parce qu’il sent bien le souffle de l’histoire. Mamdani parle le langage que la gauche a trop souvent oublié : celui du quotidien, du logement inaccessible, des transports publics délabrés, de l’école vidée de moyens. Et il en parle sans fard, sans jargon, sans excuses. Il dit ce que tout le monde sait et que trop de politiques n’osent affirmer : qu’une ville comme New York n’appartient pas aux milliardaires mais à celles et ceux qui la font vivre, la nettoient, la conduisent, l’enseignent, l’aiment. Car c’est bien l’abandon de ce langage-là, celui des gens ordinaires, qui a ouvert un boulevard à l’extrême droite. Chaque fois que la gauche a renoncé à défendre la vie concrète, elle a préparé le terrain à ceux qui promettent de parler vrai pour mieux frapper les plus faibles. Mamdani reprend ce terrain perdu et c’est pour cela qu’il inquiète tant.
Dans des Etats-Unis traversés par les haines raciales et religieuses, Mamdani ose être ce qu’il est : musulman et progressiste, fier de sa culture, à l’aise dans les boîtes gay où il fait campagne comme dans les mosquées où il prie. En cela, il fait bien plus que gagner une élection : il rend visible une génération entière d’enfants de migrants, d’exploité, de jeunes précaires qui refusent de choisir entre leur identité et leur engagement politique.
Son New York n’est pas celui des rooftops et des hedge funds, c’est celui des quartiers, des familles immigrées, des travailleuses du métro et des jeunes sans assurance santé. Il s’inscrit dans cette histoire longue des migrations qui fait la force et la beauté de la ville. Et c’est précisément ce monde-là que Trump et consorts veulent éradiquer, au nom d’une Amérique blanche, virile et propriétaire.
La victoire de Zohran Mamdani est un signal mondial. Elle nous dit que la gauche n’est pas morte : elle doit réapprendre à parler vrai, à incarner la dignité, à refuser la honte. Elle nous dit que face aux droites identitaires, face aux fascismes rampants et triomphants, ce ne sont pas les renoncements mais les affirmations qui gagnent : être pleinement soi, sans s’excuser, sans se cacher. Elle nous dit, enfin, qu’on peut être musulman, féministe et de gauche, new-yorkais et décolonial… et que cette multiplicité, loin d’être un fardeau, est la promesse d’un monde à venir. Zohran Mamdani n’est pas une exception : il est un début. Le début d’une lutte qu’il va devoir mener en tant que maire. Le début de quelque chose qui dépasse sûrement les frontières de sa ville et de son pays aussi. Et ça, ça fait du bien.
 SCANDALE DU JOUR
SCANDALE DU JOUR
Shein au BHV : quand tout le monde s’y oppose, mais que ça ouvre quand même
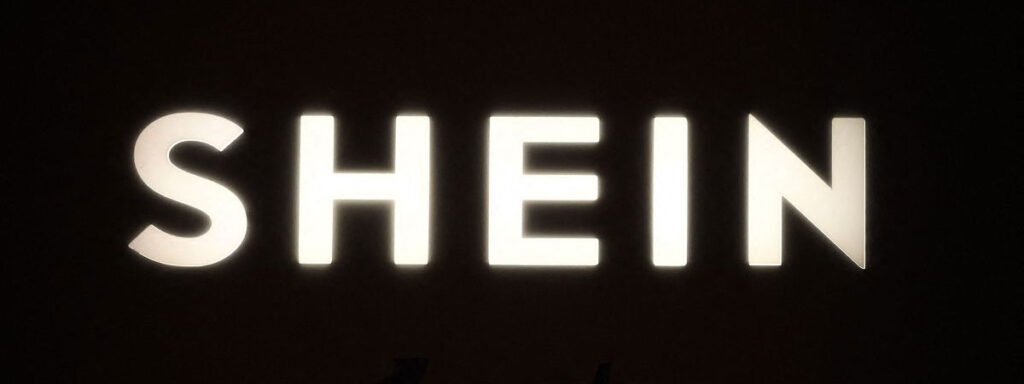
Le gouvernement s’indigne, la mairie de Paris s’y oppose, les marques françaises désertent, les syndicats protestent, les associations alertent. Et pourtant, Shein ouvre sa première boutique pérenne à Paris, au BHV. Ce géant de l’ultra fast-fashion, visé par une enquête pour avoir vendu des poupées sexuelles à l’apparence d’enfants, accusé de travail forcé, de dumping social et écologique, et de transformer la planète en décharge à vêtements. Tout le monde est contre. Et rien ne change. Le ministre du logement Vincent Jeanbrun parle d’« erreur stratégique », la mairie dénonce un « danger » et dit « entrer en guerre », des dizaines de marques claquent la porte, et même les Galeries Lafayette, dans le même groupe, cherchent à s’en désolidariser. Mais à 13 heures, ce mercredi, les portes s’ouvrent quand même. C’est tout un symbole : celui d’un pouvoir politique spectateur du désastre marchand, impuissant à empêcher ce qu’il prétend condamner. On régule les pauvres, pas les multinationales. On moralise les jeunes, mais pas les marques qui détruisent leur avenir. On débat sur la longueur des jupes à l’école, mais on autorise la fast-fashion. Dans ce BHV devenu vitrine du cynisme globalisé, la question n’est plus de savoir ce que veulent les Français mais ce que les puissances économiques veulent faire de nous. Et apparemment, elles veulent qu’on continue à consommer, même l’horreur.
P.P.-V.
ON VOUS RECOMMANDE…

Le dessous des images – Zohran Mamdani : la conquête de New York. Un petit décryptage made in Arte de la communication du nouveau maire de la Grosse Pomme. Musique rap et montage survolté : le socialiste américain dépoussière l’exercice du clip électoral avec une image populaire qui résonne avec la culture et l’histoire de New York.
C’EST CADEAU 


La scène d’ouverture du film Do the Right Thing de Spike Lee, sorti en 1989, qui raconte une journée étouffante à Brooklyn où la tension raciale, attisée par un simple différend dans une pizzeria, dégénère en émeute après la mort d’un jeune Noir tué par la police. À travers l’exploration du microcosme urbain tourbillonnant de New York, Spike Lee signe un portrait explosif et toujours actuel de l’Amérique fracturée, entre colère, injustice et quête de dignité. Un écho vibrant à la campagne victorieuse de Zohran Mamdani.
ÇA SE PASSE SUR REGARDS.FR
Pour recevoir cette newsletter quotidiennement (et gratuitement) dans votre boîte mail, suivez le lien : regards.fr/newsletter !
04.11.2025 à 12:13
Ce désordre a-t-il une fin ?
Catherine Tricot
Texte intégral (794 mots)
Sous couvert de parlementarisme et d’esprit de compromis, le projet de budget se transforme en une expérience déconcertante voire imbuvable.
À peine nommé, en gage de rupture avec la gouvernance autoritaire des années précédentes, le premier ministre Sébastien Lecornu a renoncé à l’usage du 49.3 et vanté une nouvelle méthode faite de dialogue et de compromis. Le gouvernement serait désormais sous le contrôle du parlement. Les députés socialistes ont dit vouloir donner sa chance à cet engagement et refusé de censurer. Admettons.
TOUS LES JOURS, RETROUVEZ L’ESSENTIEL DE L’ACTU POLITIQUE DANS NOTRE NEWSLETTER
Où en sommes-nous un mois plus tard ? Absolument tout le monde est perdu. La politique ne se fait plus au grand jour, devant les citoyens mais dans des réunions « loin des micros », à la buvette de l’Assemblée et dans les interruptions de séances. Les amendements se suivent et se contredisent. Tout ceci est un jeu de rôle. Ce travail des députés pourrait bien être effacé par le repêchage des sénateurs, suivi des négos de la commission mixte paritaire et, enfin, le possible usage des ordonnances.
Mais au-delà de cette déconsidération des élus, ce qui est mis à mal, c’est l’idée même de compromis. Pourtant, celui-ci est nécessaire quand on croit que les minorités détiennent une part d’un réel complexe. Refuser de bouger, prétendre tout anticiper et tout savoir, tout imposer est folie. En revanche, intégrer la nuance ne signifie pas renoncer à la cohérence. Et c’est bien ainsi que Sébastien Lecornu le voit. Il accepte de reporter, reculer, assouplir mais la cohérence du budget reste : il entend faire des économies sur le développement humain – santé et éducation – ; surseoir aux adaptations au changement climatique ; poursuivre la politique de compétitivité par la baisse des coûts du travail ; attendre le ruissellement
Les socialistes éludent cette réalité : ce budget est mauvais pour les Français et pour la France ; il est délétère pour aujourd’hui et pour demain. Sébastien Lecornu a fait des compromis sur la mise en œuvre de sa politique mais pas sur sa politique.
Les socialistes ont minoré l’importance primordiale de la base de discussions. Ils ont accepté de négocier à partir du budget Bayrou-Lecornu. Ce faisant, ils ont endossé le rôle de ceux qui obtiennent des petites victoires. Certaines seront réelles : nous ne parlons pas ici du report de la réforme des retraites, qui apparaît pour ce qu’elle est : un symbole, une entourloupe. Nous ne parlons pas non plus des chiffons rouges agités pour être retirés, comme la fiscalisation des pourboires et des tickets restaurants. En revanche, l’année blanche sur les minima sociaux et les retraites aurait été douloureuse et créerait un précédent inacceptable. Les socialistes ont obtenu ces reculs mais l’équilibre global demeure.
Tout à leur préoccupation de vanter leurs victoires, les socialistes éludent cette réalité : ce budget est mauvais pour les Français et pour la France ; il est délétère pour aujourd’hui et pour demain. Sébastien Lecornu a fait des compromis sur la mise en œuvre de sa politique mais pas sur sa politique. Comment le lui reprocher ? Sans cohérence, la politique n’est rien. Et il semble savoir que la cohérence ne signifie pas la raideur, contrairement à beaucoup de députés macronistes issus de la « société civile », de la haute-fonction publique et de l’entreprise… sans expérience politique.
En continuant de faire « comme si » les compromis avaient bougé les logiques politiques du budget, les socialistes perturbent et divisent la gauche. On les soupçonne de retomber dans les anciens travers sociaux-libéraux qui les ont mis à terre… Tout aussi grave, ils brouillent l’idée que la politique, c’est choisir entre des logiques. Ils nourrissent l’idée que les désaccords ne sont que désordres et qu’il faut un chef fort.
L’alternative se doit d’être une proposition claire, lisible, cohérente et constante. Et sincèrement démocratique.
04.11.2025 à 12:13
🔴 APPEL DU JOUR
la Rédaction
Lire + (145 mots)
Chère lectrice, cher lecteur,
Tout Regards est en libre accès : newsletters, site, vidéos… financé par les abonnés de la revue et par vos dons. Nous allons continuer d’évoluer : rendre accessible des infos en provenance de la gauche américaine, se prémunir des folies trumpiennes en quittant notre hébergeur historique AWS.
Ainsi, si vous le pouvez, participez par un versement ponctuel ou, mieux, par un (petit) versement mensuel.
Votre don est défiscalisé à 66%. Contribuez ici !
On compte sur vous. Merci infiniment.
04.11.2025 à 12:10
Ce désordre a-t-il une fin ?
la Rédaction
Texte intégral (1704 mots)
La newsletter du 4 novembre 
par Catherine Tricot
Sous couvert de parlementarisme et d’esprit de compromis, le projet de budget se transforme en une expérience déconcertante voire imbuvable.
À peine nommé, en gage de rupture avec la gouvernance autoritaire des années précédentes, le premier ministre Sébastien Lecornu a renoncé à l’usage du 49.3 et vanté une nouvelle méthode faite de dialogue et de compromis. Le gouvernement serait désormais sous le contrôle du parlement. Les députés socialistes ont dit vouloir donner sa chance à cet engagement et refusé de censurer. Admettons.
Où en sommes-nous un mois plus tard ? Absolument tout le monde est perdu. La politique ne se fait plus au grand jour, devant les citoyens mais dans des réunions « loin des micros », à la buvette de l’Assemblée et dans les interruptions de séances. Les amendements se suivent et se contredisent. Tout ceci est un jeu de rôle. Ce travail des députés pourrait bien être effacé par le repêchage des sénateurs, suivi des négos de la commission mixte paritaire et, enfin, le possible usage des ordonnances.
Mais au-delà de cette déconsidération des élus, ce qui est mis à mal, c’est l’idée même de compromis. Pourtant, celui-ci est nécessaire quand on croit que les minorités détiennent une part d’un réel complexe. Refuser de bouger, prétendre tout anticiper et tout savoir, tout imposer est folie. En revanche, intégrer la nuance ne signifie pas renoncer à la cohérence. Et c’est bien ainsi que Sébastien Lecornu le voit. Il accepte de reporter, reculer, assouplir mais la cohérence du budget reste : il entend faire des économies sur le développement humain – santé et éducation – ; surseoir aux adaptations au changement climatique ; poursuivre la politique de compétitivité par la baisse des coûts du travail ; attendre le ruissellement.
Les socialistes ont minoré l’importance primordiale de la base de discussions. Ils ont accepté de négocier à partir du budget Bayrou-Lecornu. Ce faisant, ils ont endossé le rôle de ceux qui obtiennent des petites victoires. Certaines seront réelles : nous ne parlons pas ici du report de la réforme des retraites, qui apparaît pour ce qu’elle est : un symbole, une entourloupe. Nous ne parlons pas non plus des chiffons rouges agités pour être retirés, comme la fiscalisation des pourboires et des tickets restaurants. En revanche, l’année blanche sur les minima sociaux et les retraites aurait été douloureuse et créerait un précédent inacceptable. Les socialistes ont obtenu ces reculs mais l’équilibre global demeure.
Tout à leur préoccupation de vanter leurs victoires, les socialistes éludent cette réalité : ce budget est mauvais pour les Français et pour la France ; il est délétère pour aujourd’hui et pour demain. Sébastien Lecornu a fait des compromis sur la mise en œuvre de sa politique mais pas sur sa politique. Comment le lui reprocher ? Sans cohérence, la politique n’est rien. Et il semble savoir que la cohérence ne signifie pas la raideur, contrairement à beaucoup de députés macronistes issus de la « société civile », de la haute-fonction publique et de l’entreprise… sans expérience politique.
En continuant de faire « comme si » les compromis avaient bougé les logiques politiques du budget, les socialistes perturbent et divisent la gauche. On les soupçonne de retomber dans les anciens travers sociaux-libéraux qui les ont mis à terre… Tout aussi grave, ils brouillent l’idée que la politique, c’est choisir entre des logiques. Ils nourrissent l’idée que les désaccords ne sont que désordres et qu’il faut un chef fort.
L’alternative se doit d’être une proposition claire, lisible, cohérente et constante. Et sincèrement démocratique.
 BRÈVE DU JOUR
BRÈVE DU JOUR
Parier sur l’actualité : comment la marchandisation de l’information transforme notre présent

Fondée en 2020 aux États-Unis par Shayne Coplan (qui a aujourd’hui rejoint le sympathique club des milliardaires techno-fascistes), Polymarket est une plateforme qui permet de parier de l’argent sur des sujets d’actualité. À première vue, rien de bien méchant. Sauf que voilà : spéculer en cryptomonnaie sur l’élection de Zohran Mamdani, la situation politique en France, les élections au Chili ou encore… les bombes à Gaza, ça pose problème. Polymarket a été financée et encouragée par les libertariens autoritaires comme Peter Thiel, Elon Musk ou encore Donald Trump Jr. Déjà, les paris ne sont plus uniquement des jeux mais influencent directement les médias et… le cours des choses. Numerama relève que « CNBC ou Reuters citent régulièrement ces pourcentages prédictifs pour éclairer les tendances politiques, au détriment des sondages traditionnels ». Des paris qui façonnent donc un certain récit où l’opinion règne sur l’information, la désinformation et la diffamation sur la vérité. À noter qu’en France, la plateforme a été interdite… car elle n’avait pas d’agrément valide pour pratiquer les jeux d’argent. Comme si c’était ça le problème.
E.S.
ON VOUS RECOMMANDE…

« Le New Deal… mais pas pour tous », sur Arte. Pour déconstruire le mythe de la politique de Roosevelt qui aurait sauvé l’économie, voire la société américaine. Car il est une composante du peuple américain, et pas des moindres, qui aura été privé de ce New Deal : les Noirs.

Taxe Zucman : même les Américains l’ont fait
Aux États-Unis aussi, la bataille pour taxer les riches avance… et pas seulement dans les discours. Le Massachusetts a mis en place une « taxe sur les millionnaires » en 2023 sans que cela ne suscite un exode fiscal. D’autres États, la Californie en tête, préparent un impôt sur la fortune inspiré des travaux de Gabriel Zucman et Emmanuel Saez. à lire ici
à lire ici
C’EST CADEAU 


Le 4 novembre 1988 était donnée au Burgtheater de Vienne, la première de Place des héros de Thomas Bernhard. Une pièce qui fit scandale car elle décrivait une Autriche aussi antisémite en 1988 que ce jour de 1938 où Adolf Hitler avait été accueilli triomphalement dans la capitale sur cette Place des héros. Politiques et autres puissants avaient essayé de faire interdire la pièce. En vain.
ÇA SE PASSE SUR REGARDS.FR
Pour recevoir cette newsletter quotidiennement (et gratuitement) dans votre boîte mail, suivez le lien : regards.fr/newsletter !
04.11.2025 à 11:25
Taxe Zucman : même les Américains l’ont fait
Robert Reich
Texte intégral (893 mots)
Aux États-Unis aussi, la bataille pour taxer les riches avance… et pas seulement dans les discours. Le Massachusetts a mis en place une « taxe sur les millionnaires » en 2023 sans que cela ne suscite un exode fiscal. D’autres États, la Californie en tête, préparent un impôt sur la fortune inspiré des travaux de Gabriel Zucman et Emmanuel Saez.
Sur son blog, le sociologue Robert Reich, ancien secrétaire d’État de Bill Clinton et fin observateur de la « sécession sociale des élites », raconte comment les États américains taxent (ou vont taxer) les plus riches. Et, oh surprise !, ceux-ci n’ont pas fui et les recettes ont afflué. Évidemment, tout cela ne renverse pas le capitalisme américain, mais cela montre qu’un volontarisme fiscal existe, même au pays de Donald Trump.
Traduction assurée par Baptiste Orliange
Un impôt sur la fortune qui fonctionnera
Comment nous construisons un avenir meilleur malgré Trump
Amis,
Nous ne pouvons pas compter sur le gouvernement fédéral, ni sur le Congrès contrôlé par les républicains, ni sur la Cour suprême, et encore moins sur ce fou de président, pour faire avancer un programme progressiste. C’est donc aux États de prendre le relais.
Je me suis récemment associé à l’un des syndicats les plus puissants de Californie et à l’un des économistes les plus respectés du pays, Emmanuel Saez de Berkeley, pour proposer à l’État de Californie de mettre en place le premier impôt sur la fortune du pays.
Il s’agit d’une taxe exceptionnelle sur les milliardaires pour compenser les coupes budgétaires de Trump de 100 millions de dollars infligées au programme Medicaid (l’assurance-maladie, ndlr) de la Californie. Trump réduit les impôts principalement pour les riches et le finance en réduisant les crédits fédéraux pour Medicaid.
Si la mesure est promulguée, cela mettrait un impôt de 5% sur la richesse des quelque 200 milliardaires de l’État. 90% des fonds récoltés iraient vers les bénéficiaires de Medicaid en Californie et les institutions qui les servent (les 10% restants allant aux écoles de l’État). Mais cela pourrait avoir des conséquences importantes dans un pays où la fortune des ultra-riches explose, où les revenus médians stagnent et où le financement public diminue.
En effet, des propositions visant à augmenter les impôts des ultra-riches pour financer ce dont les travailleurs ont besoin émergent – notamment à New York, où le candidat démocrate à la mairie Zohran Mamdani (qui pourrait être élu prochain maire de la ville demain) veut augmenter de 2% les impôts des résidents dont les revenus annuels dépassent 1 million de dollars.
De telles propositions ont suscité l’indignation des riches, qui menacent de déménager. Doit-on les prendre au sérieux ? Pas vraiment : lorsque le Massachusetts a adopté une « taxe sur les millionnaires » en 2023, les conservateurs ont affirmé que les riches fuiraient. Deux ans plus tard, ce n’est pas le cas et cela a permis de collecter 5,7 milliards de dollars pour les infrastructures et l’éducation publique.
Il faut noter qu’en Californie, la proposition de taxe unique serait prélevée exclusivement sur la valeur nette actuelle des milliardaires en 2025. Ainsi, même s’ils décident de déménager dans les îles Vierges, ils seront toujours redevables de 5% de leur richesse en 2025. Mieux : la taxe ne réduira pas la fortune des milliardaires qui s’installeront en Californie l’année prochaine ou l’année suivante, car elle ne s’appliquera qu’aux milliardaires vivant dans l’État cette année.
Les revenus des milliardaires américains ont augmenté en moyenne de 7,5% par an depuis le covid, un contraste avec l’augmentation moyenne de 1,5% pour les Américains au revenu médian. Ainsi, même avec un impôt à 5%, les ultra-riches continueront de s’enrichir.
72% de la richesse des milliardaires réside dans leurs actions cotées en bourse. Il est donc facile d’estimer leur fortune et de les taxer. Et n’oubliez pas que cette taxe ne concerne que 200 milliardaires.
Ce n’est pas la réponse finale aux inégalités honteuses des États-Unis, bien sûr, mais c’est un début. Cela pourrait ouvrir la voie à d’autres efforts pour limiter l’obscénité des riches. Espérons que l’élection de Mamdani demain en ouvrira une autre.
Ces efforts sont essentiels non seulement pour financer ce dont la plupart des gens ont besoin, mais aussi pour préserver la démocratie américaine.
Ces exemples sont également de puissants rappels que, même avec Trump régnant sur l’Amérique comme une limace géante, des changements positifs peuvent et, même, vont se produire.
03.11.2025 à 12:11
Zohran Mamdani, le socialiste qui rêve New York autrement
Pablo Pillaud-Vivien
Texte intégral (718 mots)
Favori pour remporter la mairie de New York ce mardi, il incarne une gauche américaine qui s’assume et qui veut rassembler largement.
Voir surgir à New York, capitale mondiale du capitalisme financier, vitrine des inégalités les plus criantes, un jeune élu socialiste, c’est plus qu’un paradoxe : c’est un séisme politique. Dans la ville où l’argent est roi, Zohran Mamdani parle de classe. Car New York, ce n’est pas seulement le cœur battant de la finance. Une étude de 2023 le rappelait : un quart des New-Yorkais vit sous le seuil de pauvreté. Le Bronx, Queens, Staten Island… ces noms sont devenus synonymes de galère autant que de fierté. Et c’est là que Zohran Mamdani s’enracine.
TOUS LES JOURS, RETROUVEZ L’ESSENTIEL DE L’ACTU POLITIQUE DANS NOTRE NEWSLETTER
À 34 ans, il coche tout ce que le progressisme américain n’osait plus incarner : jeune, cultivé, urbain, diasporique et profondément socialiste. Né en Ouganda, fils d’un intellectuel marxiste ougandais et d’une cinéaste indo-américaine, élevé dans le Queens, il incarne cette Amérique du tiers-monde intérieur. Zohran Mamdani a tout compris du pouvoir contemporain : une communication léchée, un sourire ravageur, une éloquence qui claque, le tout au service d’un discours de fond. Il parle de lutte des classes avec les mots de tous les jours. De dignité comme d’un mot d’ordre. De race et de classe comme d’un même combat.
Ses propositions sont simples, concrètes, radicales : geler les loyers, rendre les transports publics gratuits, imposer les géants de l’immobilier, soutenir les travailleurs immigrés, repenser la police et la fiscalité, s’opposer de front aux milliardaires. Loin des abstractions, Zohran Mamdani parle de vie chère, de logements insalubres, de salaires minables. Son socialisme, c’est celui de la cuisine, du bus et du quartier. « Ce que nous faisons à New York, dit-il, c’est démontrer que la gauche peut gouverner sans renier ses idéaux. »
Zohran Mamdani ne s’oppose pas seulement à la droite trumpiste, mais aussi à l’ancien appareil démocrate. Il défie de front un parti embourgeoisé, coupé de la rue, des travailleurs, des loyers impayés. Alors il reconstruit une gauche de masse, patiente, concrète, joyeuse.
Zohran Mamdani ne s’oppose pas seulement à la droite trumpiste, mais aussi à l’ancien appareil démocrate. Il défie de front le maire sortant, l’ex-démocrate auquel Donald Trump a apporté son soutien. Dans cette trahison, Zohran Mamdani voit la confirmation d’un diagnostic : le Parti démocrate s’est embourgeoisé, coupé de la rue, des travailleurs, des loyers impayés. Alors il reconstruit une gauche de masse, patiente, concrète, joyeuse.
Aujourd’hui, sa candidature à la mairie de New York est un test : le socialisme peut-il conquérir la ville-monde ? Autre marqueur de courage politique : son soutien sans détour au peuple palestinien. Ce n’est pas un geste marginal, c’est un acte fondateur. Zohran Mamdani avance, sans hargne ni haine. Avec une élégance rare. Et s’il réussissait ?
Une question demeure : que dit le reste des États-Unis d’une telle victoire ? Ceux des champs de maïs et des usines fermées, des Walmart et des diners ? Pour offrir une perspective crédible, il faut parler à tous et à toutes. C’est là que se jouera la véritable épreuve du feu : parler aussi aux travailleurs de la Rust Belt, aux caissières de l’Ohio, aux ouvriers du Michigan, aux paysans du Kansas. À tous ceux qui, un jour, ont cru à Donald Trump faute d’avoir entendu autre chose.
03.11.2025 à 11:52
Zohran Mamdani, le socialiste qui rêve New York autrement
la Rédaction
Texte intégral (1581 mots)
La newsletter du 3 novembre 
Favori pour remporter la mairie de New York ce mardi, il incarne une gauche américaine qui s’assume et qui veut rassembler largement.
Voir surgir à New York, capitale mondiale du capitalisme financier, vitrine des inégalités les plus criantes, un jeune élu socialiste, c’est plus qu’un paradoxe : c’est un séisme politique. Dans la ville où l’argent est roi, Zohran Mamdani parle de classe. Car New York, ce n’est pas seulement le cœur battant de la finance. Une étude de 2023 le rappelait : un quart des New-Yorkais vit sous le seuil de pauvreté. Le Bronx, Queens, Staten Island… ces noms sont devenus synonymes de galère autant que de fierté. Et c’est là que Zohran Mamdani s’enracine.
À 34 ans, il coche tout ce que le progressisme américain n’osait plus incarner : jeune, cultivé, urbain, diasporique et profondément socialiste. Né en Ouganda, fils d’un intellectuel marxiste ougandais et d’une cinéaste indo-américaine, élevé dans le Queens, il incarne cette Amérique du tiers-monde intérieur. Zohran Mamdani a tout compris du pouvoir contemporain : une communication léchée, un sourire ravageur, une éloquence qui claque, le tout au service d’un discours de fond. Il parle de lutte des classes avec les mots de tous les jours. De dignité comme d’un mot d’ordre. De race et de classe comme d’un même combat.
Ses propositions sont simples, concrètes, radicales : geler les loyers, rendre les transports publics gratuits, imposer les géants de l’immobilier, soutenir les travailleurs immigrés, repenser la police et la fiscalité, s’opposer de front aux milliardaires. Loin des abstractions, Zohran Mamdani parle de vie chère, de logements insalubres, de salaires minables. Son socialisme, c’est celui de la cuisine, du bus et du quartier. « Ce que nous faisons à New York, dit-il, c’est démontrer que la gauche peut gouverner sans renier ses idéaux. »
Zohran Mamdani ne s’oppose pas seulement à la droite trumpiste, mais aussi à l’ancien appareil démocrate. Il défie de front le maire sortant, l’ex-démocrate auquel Donald Trump a apporté son soutien. Dans cette trahison, Zohran Mamdani voit la confirmation d’un diagnostic : le Parti démocrate s’est embourgeoisé, coupé de la rue, des travailleurs, des loyers impayés. Alors il reconstruit une gauche de masse, patiente, concrète, joyeuse.
Aujourd’hui, sa candidature à la mairie de New York est un test : le socialisme peut-il conquérir la ville-monde ? Autre marqueur de courage politique : son soutien sans détour au peuple palestinien. Ce n’est pas un geste marginal, c’est un acte fondateur. Zohran Mamdani avance, sans hargne ni haine. Avec une élégance rare. Et s’il réussissait ?
Une question demeure : que dit le reste des États-Unis d’une telle victoire ? Ceux des champs de maïs et des usines fermées, des Walmart et des diners ? Pour offrir une perspective crédible, il faut parler à tous et à toutes. C’est là que se jouera la véritable épreuve du feu : parler aussi aux travailleurs de la Rust Belt, aux caissières de l’Ohio, aux ouvriers du Michigan, aux paysans du Kansas. À tous ceux qui, un jour, ont cru à Donald Trump faute d’avoir entendu autre chose.
 SONDAGE DU JOUR
SONDAGE DU JOUR
Pour contrer le RN, il n’y a pas 36 solutions

Le dernier sondage présidentiel Elabe sonne une fois de plus l’alarme. Une extrême droite au-dessus de 40%, une droite en morceaux et une gauche façon puzzle. Jean-Luc Mélenchon, Raphaël Glucksmann et Édouard Philippe sont loin derrière le RN. L’ancien premier ministre est le mieux placé pour atteindre le second tour, mais il accuse un recul. La faiblesse du total gauche est sans appel : Jean-Luc Mélenchon Raphaël Glucksmann sont au coude-à-coude mais la seule façon pour la gauche d’accéder sûrement au second tour est de s’unir. Reste à savoir quel est le meilleur candidat pour dynamiser la gauche et faire face à une extrême droite qui aura des réserves pour gagner l’élection…
R.M.
Que demande le peuple ! La parole est aux relégué.e.s

« Que demande le peuple ? » est une série de podcasts qui fait entendre la parole des oubliés, entre colère et solidarité. Proposé par les journalistes Pauline Maucort et Rémi Dybowski Douat, « Que demande le peuple ? » se veut un tour de France sonore, à hauteur de femmes et d’hommes, pour donner à entendre ce qui se dit loin des micros des plateaux télé. Mais pour que ce projet avance, ils ont besoin de vous. Et ça se passe par ici !
ON VOUS RECOMMANDE…

« Franco, le dernier dictateur », sur France TV. Il y a 50 ans disparaissait Franco, dernier dictateur d’Europe de l’Ouest… mais son ombre plane encore. 39 ans de pouvoir absolu, un régime national-catholique bâti sur la peur, la censure et la bénédiction de l’Église : Franco incarne la figure du tyran sans éclat, froid et tenace, qui préfère l’ordre à la gloire. Ce documentaire en deux parties retrace son ascension et sa survie politique, jusqu’à son intégration tacite dans le camp occidental pendant la guerre froide. Une plongée dans l’Espagne franquiste, qui interroge aussi nos présents : la mémoire refoulée de la dictature, la complaisance envers les héritiers de l’extrême droite et la résurgence des discours autoritaires sous couvert de religion ou de tradition.
C’EST CADEAU 


André Malraux, né le 3 novembre 1901, demeure l’un de ceux qui ont le plus profondément façonné notre rapport à la culture et à l’art. La vision qu’il a donnée à la France continue d’imprégner ce que nous sommes aujourd’hui. Ministre des affaires culturelles sous la présidence du général de Gaulle, il initia dans les années 1960 la création des Maisons de la culture, destinées à rendre l’art et le savoir accessibles à tous, sur tout le territoire. Voici son discours prononcé lors de l’inauguration de celle d’Amiens, en 1966.
ÇA SE PASSE SUR REGARDS.FR
Pour recevoir cette newsletter quotidiennement (et gratuitement) dans votre boîte mail, suivez le lien : regards.fr/newsletter !
01.11.2025 à 12:00
Comment le RN digère la droite
la Rédaction
Texte intégral (1581 mots)
Comme chaque semaine, le débrief politique de Catherine Tricot et Pablo Pillaud-Vivien !
31.10.2025 à 12:30
Un jeudi qui acte la reddition morale de la droite
la Rédaction
Texte intégral (699 mots)
Marine Le Pen a raison : ce jeudi fut une journée historique. Pour la première fois, un texte du Rassemblement national a été adopté à l’Assemblée nationale. Pour la première fois, la République a validé, par un vote, une proposition issue du parti fondé par les héritiers de l’OAS.
La résolution du RN dénonçait l’accord franco-algérien de 1968 qui réglemente les déplacements et les conditions d’installation des Algériens en France. Au fil des années, cet accord avait fait l’objet de révisions, rapprochant ces conditions du droit commun des étrangers. Contrairement à ce qu’écrivent de nombreux journaux, même bien intentionnés, les Algériens sont soumis à l’obtention de visas depuis 1986. Il existe même un organisme dédié, Capago, qui fait payer ses prestations en sus du coût du visa. Hocine Zeghbib, maître de conférences honoraire à la faculté de droit de l’Université Montpellier fait le point dans l’Humanité à ce sujet. Ce n’est pas à une situation d’exception que le RN a voulu s’attaquer mais à un symbole. Il n’avait qu’une valeur : continuer le combat politique commencé dès les années 1950 dans les guerres contre les indépendances.
TOUS LES JOURS, RETROUVEZ L’ESSENTIEL DE L’ACTU POLITIQUE DANS NOTRE NEWSLETTER
Cet accord de décembre 1968 constitue un héritage diplomatique d’une histoire longue et complexe : celle de 132 ans de colonisation et d’une guerre faite de massacres et d’humiliations. Il tient compte de l’intensité des liens humains entre les deux pays. On estime que près d’un Français sur quatre a des liens familiaux ou a vécu en Algérie. Notre pays est le fruit de millions d’ouvriers algériens venus construire la France, de harkis, de pieds noirs, de coopérants et de pieds rouges, de mariages mixtes. C’est cette histoire-là que l’extrême droite veut piétiner. Pour les héritiers du tortionnaire mais vaincu Jean-Marie Le Pen, l’Algérie doit expier. Ce pays a conquis son indépendance et soutenu les autres pays dans leur lutte anticoloniale. Plus que tout autre, l’Algérie est l’obsession du RN. Et c’est pourquoi ses députés ont choisi de mettre cette résolution en première ligne de leur niche parlementaire. A ceux qui prétendent que le RN a changé, qu’il a fait son aggiornamento, ce texte vient l’infirmer et même confirmer le fil ininterrompu de ce parti d’extrême droite : xénophobe, raciste, nostalgique de l’empire colonial.
Circonstance particulièrement aggravante, le RN est accompagné dans sa croisade depuis des mois. Par le président de LR Bruno Retailleau qui a fait de ses provocations agressives contre l’Algérie un identifiant politique. Par le président de Renaissance Gabriel Attal et celui d’Horizons Édouard Philippe qui avaient eux aussi enfourché ce combat d’extrême droite. Hier, ce glissement s’est traduit dans l’hémicycle. Tous les députés d’Horizons et de LR présents ont voté en faveur du texte d’extrême droite. Les députés Modem et Renaissance faisaient, eux, la politique de la chaise vide.
Le RN a été porté, accompagné, légitimé. L’extrême droite remporte bien plus qu’un vote : elle impose son tempo idéologique. Toutes les finesses pour ou contre l’alliance des droites se résolvent en une vérité : la droite est en train de se faire manger par l’extrême droite.
31.10.2025 à 12:28
Un jeudi qui acte la reddition morale de la droite
la Rédaction
Texte intégral (1383 mots)
La newsletter du 31 octobre 
par Catherine Tricot et Pablo Pillaud-Vivien
Marine Le Pen a raison : ce jeudi fut une journée historique. Pour la première fois, un texte du Rassemblement national a été adopté à l’Assemblée nationale. Pour la première fois, la République a validé, par un vote, une proposition issue du parti fondé par les héritiers de l’OAS.
La résolution du RN dénonçait l’accord franco-algérien de 1968 qui réglemente les déplacements et les conditions d’installation des Algériens en France. Au fil des années, cet accord avait fait l’objet de révisions, rapprochant ces conditions du droit commun des étrangers. Contrairement à ce qu’écrivent de nombreux journaux, même bien intentionnés, les Algériens sont soumis à l’obtention de visas depuis 1986. Il existe même un organisme dédié, Capago, qui fait payer ses prestations en sus du coût du visa. Hocine Zeghbib, maître de conférences honoraire à la faculté de droit de l’Université Montpellier fait le point dans l’Humanité à ce sujet. Ce n’est pas à une situation d’exception que le RN a voulu s’attaquer mais à un symbole. Il n’avait qu’une valeur : continuer le combat politique commencé dès les années 1950 dans les guerres contre les indépendances.
Cet accord de décembre 1968 constitue un héritage diplomatique d’une histoire longue et complexe : celle de 132 ans de colonisation et d’une guerre faite de massacres et d’humiliations. Il tient compte de l’intensité des liens humains entre les deux pays. On estime que près d’un Français sur quatre a des liens familiaux ou a vécu en Algérie. Notre pays est le fruit de millions d’ouvriers algériens venus construire la France, de harkis, de pieds noirs, de coopérants et de pieds rouges, de mariages mixtes. C’est cette histoire-là que l’extrême droite veut piétiner. Pour les héritiers du tortionnaire mais vaincu Jean-Marie Le Pen, l’Algérie doit expier. Ce pays a conquis son indépendance et soutenu les autres pays dans leur lutte anticoloniale. Plus que tout autre, l’Algérie est l’obsession du RN. Et c’est pourquoi ses députés ont choisi de mettre cette résolution en première ligne de leur niche parlementaire. A ceux qui prétendent que le RN a changé, qu’il a fait son aggiornamento, ce texte vient l’infirmer et même confirmer le fil ininterrompu de ce parti d’extrême droite : xénophobe, raciste, nostalgique de l’empire colonial.
Circonstance particulièrement aggravante, le RN est accompagné dans sa croisade depuis des mois. Par le président de LR Bruno Retailleau qui a fait de ses provocations agressives contre l’Algérie un identifiant politique. Par le président de Renaissance Gabriel Attal et celui d’Horizons Édouard Philippe qui avaient eux aussi enfourché ce combat d’extrême droite. Hier, ce glissement s’est traduit dans l’hémicycle. Tous les députés d’Horizons et de LR présents ont voté en faveur du texte d’extrême droite. Les députés Modem et Renaissance faisaient, eux, la politique de la chaise vide.
Le RN a été porté, accompagné, légitimé. L’extrême droite remporte bien plus qu’un vote : elle impose son tempo idéologique. Toutes les finesses pour ou contre l’alliance des droites se résolvent en une vérité : la droite est en train de se faire manger par l’extrême droite.
Catherine Tricot et Pablo Pillaud-Vivien
 CHIFFRE DU JOUR
CHIFFRE DU JOUR
Derrière le storytelling de la réindustrialisation, 444 plans sociaux en 2 ans

Dans un dossier accablant, la CGT recense 444 plans de suppressions d’emplois entre septembre 2023 et octobre 2025 : plus de 100 000 postes supprimés ou menacés, dont près de la moitié dans l’industrie. En comptant les effets indirects, le syndicat évalue à 102 675 emplois menacés ou supprimés. Il en a fait une cartographie précise secteur par secteur. Pendant que l’Élysée vante les 13 000 créations promises par Choose France, le syndicat décrit une vague de casse industrielle : chimie, auto, métallurgie, papier, commerce, santé… rien n’y échappe. Voilà le résultat de 10 années de politique pro-business conduite par Emmanuel Macron.
P.P.-V.
ON VOUS RECOMMANDE…

Male America Great Again, une solide réflexion de la députée Clémentine Autain : face à l’internationale réactionnaire qui fait du genre son champ de bataille, elle rappelle que le féminisme est une force centrale de l’émancipation. Contre le virilisme et le ressentiment, elle appelle à un féminisme populaire, global, capable de répondre à la vague brune.
C’EST CADEAU 


Puissante prise de parole de la députée communiste Elsa Faucillon à l’Assemblée nationale qui dit les termes concernant la proposition de résolution du RN dénonçant l’accord franco-algérien de 1968.
ÇA SE PASSE SUR REGARDS.FR
Pour recevoir cette newsletter quotidiennement (et gratuitement) dans votre boîte mail, suivez le lien : regards.fr/newsletter !
- GÉNÉRALISTES
- Ballast
- Fakir
- Interstices
- Lava
- La revue des médias
- Le Grand Continent
- Le Diplo
- Le Nouvel Obs
- Lundi Matin
- Mouais
- Multitudes
- Politis
- Regards
- Smolny
- Socialter
- The Conversation
- UPMagazine
- Usbek & Rica
- Le Zéphyr
- Idées ‧ Politique ‧ A à F
- Accattone
- Contretemps
- A Contretemps
- Alter-éditions
- CQFD
- Comptoir (Le)
- Déferlante (La)
- Esprit
- Frustration
- Idées ‧ Politique ‧ i à z
- L'Intimiste
- Jef Klak
- Lignes de Crêtes
- NonFiction
- Nouveaux Cahiers du Socialisme
- Période
- Philo Mag
- Terrestres
- Vie des Idées
- ARTS
- Villa Albertine
- THINK-TANKS
- Fondation Copernic
- Institut La Boétie
- Institut Rousseau
- TECH
- Dans les algorithmes
- Framablog
- Gigawatts.fr
- Goodtech.info
- Quadrature du Net
- INTERNATIONAL
- Alencontre
- Alterinfos
- CETRI
- ESSF
- Inprecor
- Journal des Alternatives
- Guitinews
- MULTILINGUES
- Kedistan
- Quatrième Internationale
- Viewpoint Magazine
- +972 mag
- PODCASTS
- Arrêt sur Images
- Le Diplo
- LSD
- Thinkerview
- Fiabilité 3/5
- Slate
- Fiabilité 1/5
- Contre-Attaque
- Issues
- Korii
- Positivr