Abonnés Articles en accès libre Hebdo Articles
14.05.2024 à 18:05
Quand l'éphémère devient tangible avec les collages renversants d'Anja Brunt
L'Autre Quotidien
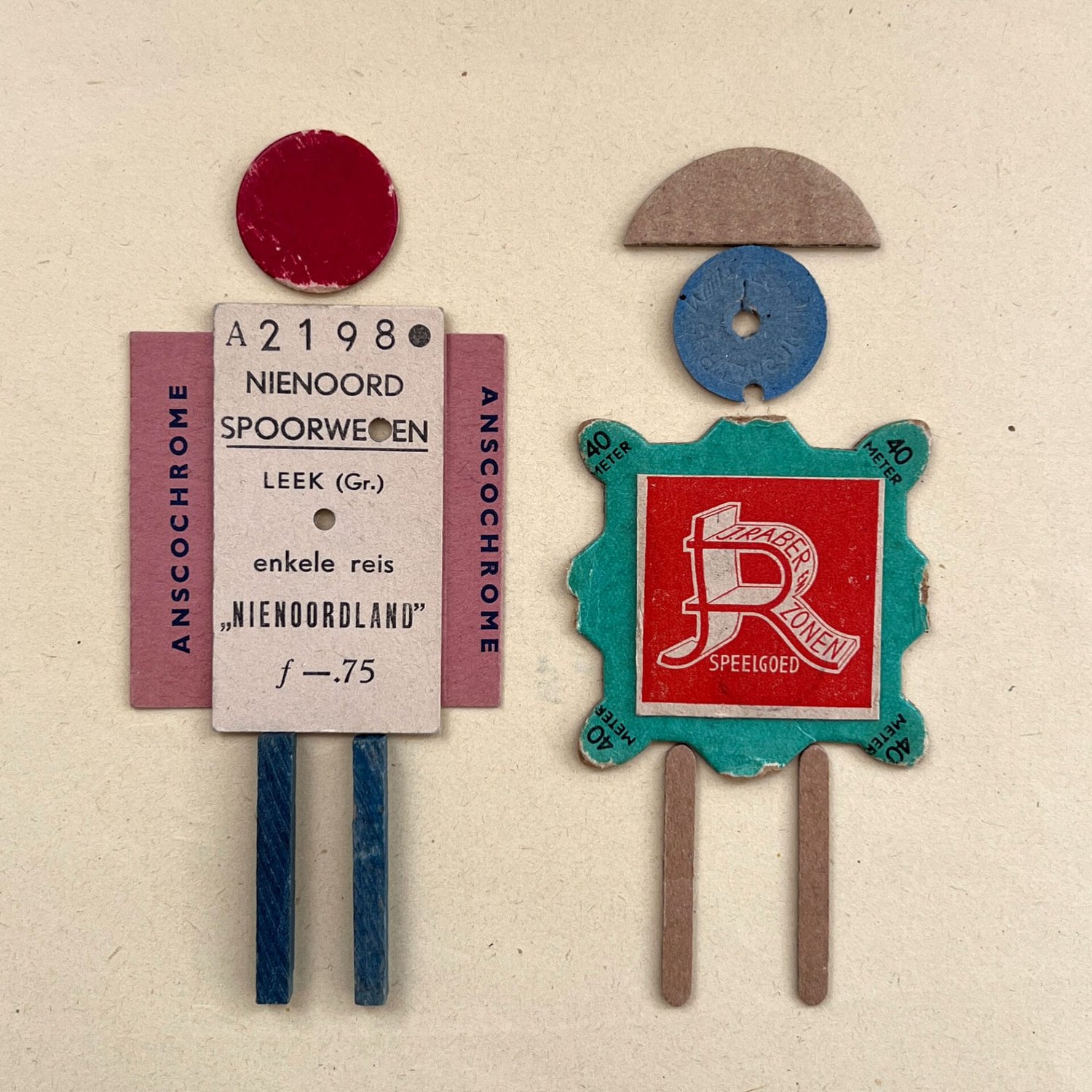
Texte intégral (1397 mots)
Inspirés par Dada et le surréalisme, les assemblages instinctifs de papier d'Anja Brunt évoquent un sentiment de fantaisie, de spontanéité et d'aléatoire. Cette graphiste basée à Amsterdam crée des assemblages depuis six ans pour se détendre.

All images © Anja Brunt
Après être tombée amoureuse des nombreuses possibilités du support, elle a commencé à travailler intuitivement, en découpant et en arrangeant des documents éphémères vintage pour en faire des itérations de corps, de bâtiments et de textes audacieux. Et ça marche carrément bien !

Brunt collecte des matériaux dans tous les endroits imaginables. Des papiers qu'elle trouve dans les boîtes de chocolat aux cartes à jouer antiques, en passant par les brochures d'instruction et les billets de train, l'artiste se procure à la fois des pièces anciennes et des supports contemporains issus de sa vie quotidienne. Au fur et à mesure qu'elle accumule des bouchées prometteuses, elle organise chaque fragment dans des boîtes et de vieux albums de timbres, où ils attendent d'être ajoutés à un montage.

En ce moment, Brunt développe l'animation par le collage. Vous pouvez découvrir ses nouveaux projets sur son site et sur Instagram. Affaire à suivre. DEprès !
Jean-Pierre Simard, le 15/05/2024
Anja Brunt - Collages renversants

14.05.2024 à 17:40
Amphétamine Africa où la vitesse du singeli tanzanien booste le son
L'Autre Quotidien

Texte intégral (973 mots)
Hier encore confidentiel, le son futuriste des ghettos de Dar Es-Salaam s’exporte à présent sur les dancefloors du monde entier. Quatorze ans après sa naissance, le singeli est passé du rang de paria à celui de fierté nationale.
Le studio éponyme de Dar es Salaam du producteur tanzanien Sisso est à la pointe du genre singeli. Le singeli n'est plus guère underground en Tanzanie, mais ses vitesses implacables de plus de 200 BPM laissent une large place à l'expérimentation et, grâce aux efforts du label ougandais Nyege Nyege - lancé par deux expatriés européens pour faire la chronique de l'underground électronique fertile d'Afrique de l'Est -, ses représentants les plus extrêmes ont pris de l'ampleur à l'étranger par rapport à des artistes relativement pop comme Msaga Sumu. Des disques comme Poaa de Bamba Pana, Mr. Mixondo de DJ Travella ou Mateso de Sisso ont mis en évidence le côté Terminator du genre, mais Singeli Ya Maajabu, la nouvelle collaboration de Sisso avec la claviériste Maiko, sonne plus comme une collaboration informelle et extrêmement bizarre jam session. D’où l’éveil de notre intérêt.
Les boucles de la batterie-machine galopent avec l'élan d'une proie curieuse, tandis que les sons de gobstopping esquissent des motifs musicaux simples. "Kivinje" s'ouvre sur une explosion de sirènes et de synthétiseurs à la sonorité de corne, et il faut quelques écoutes pour s'apercevoir qu'ils jouent une série classique de changements d'accords, I-IV-V-IV, les mêmes que les classiques du rock comme "Louie Louie" et "Wild Thing". Plus tard, le duo évite complètement les indices "musicaux", enrichissant le paysage d'effets aqueux ("Mizuka") et de bruits de bulles ("Kazi Ipo"). Les pistes de synthé de Maiko s'élèvent à une beauté presque néoclassique, trouvant de nouvelles façons simples de tracer des progressions d'accords familières.
Alors que les scènes régionales comme singeli sont souvent louées à l'étranger pour leur futurisme supposé sui generis, Sisso et Maiko puisent dans une large palette, entretenant une conversation permanente avec d'autres scènes de clubs expérimentales. L'influence du juke est indéniable sur "Kiboko" ; "Mizuka" est une étendue désolée de sons de verre et de grincements de film d'horreur qui n'est pas très éloignée de "The Tunnel" de Marie Davidson ; et la minute "Mangwale" colle des échantillons de chœurs flottants dans le seul répit ambiant de l'album. Pourtant, ces distinctions tendent à disparaître sous l'assaut de la musique. Même avec un peu moins de 40 minutes, cet album est un véritable maelström, et dans un environnement dépourvu d'opportunités d'aller aussi loin que la foule typique de Singeli, écouter Singeli Ya Maajabu pourrait ressembler à une randonnée sur une montagne à travers une tempête de grêle, ou peut-être à un jeu N64 basé sur Obscura de Gorguts.
Il n'y a rien de comparable à l'implacabilité presque charlemagne-palestinienne de "Biti Three" de Bamba Pana, mais Singeli Ya Maajabu exige tout de même une grande tolérance pour les aigus et l'abrasion. C'est le cas d'une grande partie de la musique pop la plus avant-gardiste de ces dernières années, du rage-rap explosif d'Opium aux breakdowns ahurissants du funk brésilien en passant par les fantaisies de chipmunk de l'hyperpop. L'ennui est peut-être l'une des dernières frontières que l'auditeur moderne doit franchir pour trouver la musique la plus vitale du monde, mais à l'époque, le rock'n'roll sonnait comme du bruit pour Frank Sinatra. Vos parents n'apprécieront probablement pas l’album, mais une fois qu'il vous aura appris à l'écouter, il vous fera tourner le cerveau comme rien d'autre. Pari tenu !
Jean-Pierre Simard, le 15/05/20,24
Sisso & Maiko – Singeli Ya Maajabu - Nyege Nyege Tapes

14.05.2024 à 17:20
“Animas animus fricat” d'Andreas Graziosi
L'Autre Quotidien

Texte intégral (1389 mots)
Au centre de la Sardaigne, dans différents villages du territoire de la Barbagia, vivent bien ancrés des étranges et archaïques traditions. Pratiqués par les habitants, des anciens cultes, représentent un rapport intense et brutal que l’homme entretien avec le sauvage et portent une valeur mystique, spirituelle et sacrée, dans un but cathartique et libératoire.

Ces costumes appartiennent à un temps qui ne nous appartient pas, se masquer est un destin, le trait d’union d’une relation inquiétante entre l’être-animal et la divinité ; porter un masque signifie se métamorphoser sous la forme d’une entité autre. Le menaçant et le perturbant que produisent ces masques n’a pas la fonction de faire peur à l’autre, mais c’est provoquer une relation avec l’autre. Les habitants, de cette région, utilisent l’expression Animas pour définir quelque chose que n’a pas ni de temps, ni de corps, de fois inquiétante, sauvage, est ce qui est spécifiquement non-humain et sert à vivre une expérience.

Andrea Graziosi est un photographe italien basé à Marseille. Il accomplit ses recherches autour des corrélations que l’être humain entretient avec les autres formes de vie. Évoquant et travaillant sur des notions ontologiques reliées aux concepts du devenir animal, de dimensions parallèles, de fracture, d’étrangeté, il vise à réaliser des travaux photographiques, dont la place de l’objet imprimé est déterminante.
PRIX Honorable Mention Hariban Award 2023, (Japon) / Lauréat Prix Maison Blanche 2023, (France) / 3° Prix, GOMMA Grant Photography, 2022 (UK) / Prix Polyptyque 2022, (France)
En savoir plus sur son travail ici
Jean-Pierre Simard, le 15/05/2024
Andreas Graziosi - Animas 2023

14.05.2024 à 17:03
Le boit sans soif de Rivers Solomon pour “Soif de Sang”
L'Autre Quotidien
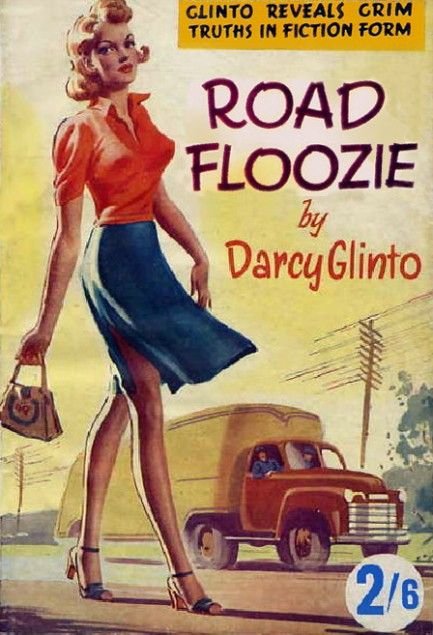
Texte intégral (4450 mots)
Huit récits autobiographiques et nouvelles qui éclairent et prolongent la superbe colère investigative et poétique de Rivers Solomon

Dans une maison en bois sur une petite ferme, non loin d’un bois touffu, au bord d’une rivière sinueuse, à l’ouest d’un bourg, loin de ce déchaînement de fureur que l’on appelle la guerre, vivaient la Maîtresse, ses deux filles d’âge adulte Adélaïde et Catherine, sa sœur Bitsy, sa mère valétudinaire Anna, et son esclave, Sully, une fille de quinze ans qui avait des crocs dans le cœur. Dès qu’elle apprit qu’Albert, le mari de la Maîtresse, était mort au champ d’honneur, elle donna l’assaut à la famille qui l’avait élevée : elle versa subrepticement quelques gouttes d’essence de valériane dans leur tasse de lait chaud et, pendant la nuit, leur trancha la gorge.
L’au-delà, qui observe le monde des vivants avec une attention soutenue, remarqua cet événement. Il était possible d’exploiter ces importants dérèglements, de s’en servir pour frayer un chemin entre notre domaine et le leur. Quand une fille si jeune assassinait une famille entière, un lien d’une effroyable puissance se créait entre ces royaumes – car un tel geste va contre l’ordre naturel des choses, et l’au-delà prospère lorsque règne le désordre.
Sully, hors d’haleine, sa respiration un murmure rauque, regardait les cadavres à ses pieds. Du sang tachait ses vêtements, ses cheveux, sa peau. Elle en avait même dans la bouche, il avait giclé lorsqu’elle avait coupé l’artère de Bitsy. Elle en sentait le goût sur sa langue, mais Sully refusait d’avaler, ne pouvait pas supporter l’idée d’incorporer le fluide salé de cette horrible femme à son propre sang. La salive s’accumulait dans sa bouche, et elle finit par cracher sur le tapis de la seconde chambre, celle où dormaient Bitsy et la Maîtresse.
Elle descendit au rez-de-chaussée en titubant, sortit, se dirigea vers la grange. D’une boîte en fer-blanc, dans laquelle elle avait mis toutes ses possessions, Sully tira un pain de savon. Elle en frotta énergiquement sa langue, puis le mordit et avala le morceau, au cas où une goutte ou deux du sang de Bitsy seraient entrées en elle : il fallait tout éradiquer.
Sa respiration sibilante, précipitée, faisait penser aux râles d’un coyote à l’agonie, ou aux premiers souffles d’un poulain qui vient de naître, ou aux appels guerriers d’une chouette de chasse, ou au rugissement des vents de tempête. Sully ferma les yeux. Dans le calme et l’obscurité de la grange, elle pouvait entendre les bruits de la nuit, tout aussi distinctement qu’elle aurait entendu une femme chanter à tue-tête en travaillant aux champs. C’était comme une musique, dont elle se laissa pénétrer. Elle perdit connaissance. Quand elle retrouva ses esprits, sa respiration avait repris un rythme normal. elle ouvrit les yeux. Après quelques instants, elle se sentit assez forte pour retourner dans la maison.
Elle prit tous les draps et les porta jusqu’à la rivière, afin de les laver du sang qui les souillait. Elle avait l’habitude de ce genre de travail, parce que l’une de ses corvées avait été de récurer, chaque mois, les dessous ensanglantés de la Maîtresse, de la fille de la Maîtresse et de la sœur de la Maîtresse.
Le vif courant était très froid, un vent aigre soufflait ; quand elle eut les mains gelées au point de ne plus pouvoir remuer les doigts, Sully alla accrocher les draps aux branches dénudées d’un arbre. Le vent faisait bouger les étoffes de lin, qui se balançaient, comme possédées. Elle rentra dans la maison pour se réchauffer les mains près du poêle, puis elle sortit un à un, en les portant à l’épaule, les cadavres des esclavagistes. Elle entreprit de creuser une fosse – elle creusa toute la nuit, et le jour suivant, et toute la nuit d’après, sans dormir. Au fond de cette plaie béante dans la terre, Sully fit glisser la Maîtresse, Adélaïde, Catherine, Bitsy et Anna, puis elle combla le trou.
Elle aurait dû éprouver de douloureuses émotions en pensant à ces femmes – elle vivait avec elles depuis l’âge de six ans – mais son cœur restait insensible. Sa colère n’avait pas du tout diminué, elle avait peut-être augmenté, parce qu’elle avait espéré en vain que ces meurtres, que cet acte radical de rébellion lui apporterait une forme de soulagement. Ces femmes avaient été des Goliath, des menaces constantes, et elles avaient fait subir à Sully tous les sévices que leur imagination avait pu concevoir – mais elles ne valaient guère plus qu’un épi de maïs, désormais. Leurs âmes étaient devenues creuses, et n’avaient plus la moindre importance. Comment cela était-il possible ? Comment des géantes, des créatures immenses, avaient-elles pu être réduites à néant à la suite d’un simple coup de couteau ? (« Soif de sang », 2019)
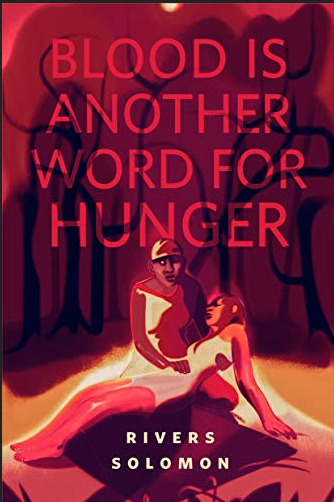
En deux redoutables romans, « L’incivilité des fantômes » en 2017 et « Sorrowland » en 2021, et une novella océanique et électrique, « Les abysses » en 2019, Rivers Solomon s’est imposée ces dernières années comme l’une des figures littéraires majeures faisant vivre, comme son aînée Nalo Hopkinson, même si c’est sous une forme bien distincte, l’héritage de la grande Octavia Butler et d’une littérature afrofuturiste pionnière qui assume l’héritage, loin d’être totalement dissipé, de l’entreprise esclavagiste – mais qui sait projeter cet héritage dans un contre-récit plus global des différences et des collectifs de toute nature, résolument orienté vers l’avenir (je vous laisse vous reporter aux notes de lecture concernées sur ce blog pour davantage de détails).
Regroupant six nouvelles (l’une d’elles, la nouvelle-titre, « Soif de sang », nettement plus longue que les autres) et deux récits supposés subtilement autobiographiques, textes parus en revue, en anthologie ou en édition autonome entre 2016 et 2022, ce recueil, traduit par Francis Guèvremont pour Aux Forges de Vulcain début 2024, éclaire d’un jour particulièrement lumineux – et efficace – l’œuvre en cours de Rivers Solomon.
– Maman ? a demandé Agnès, les mains jointes derrière le dos.
Elle avait lu, dans le dernier numéro du magazine Lure, que se tenir droite avait un effet amincissant, et cette idée lui avait plu immensément – comme si ses flancs se faisaient raboter, peu à peu, jusqu’à ce qu’il ne reste plus d’elle qu’un étroit ruban. Elle ne serait plus une fille avec un corps, elle serait une ligne, et une ligne est comme une corde, et une corde peut étrangler.
– Oui, ma chérie ? Qu’est-ce que tu veux ? a répondu maman.
Elle étendait la lessive, dehors, dans le jardin. Elle portait un fin débardeur, qui laissait voir le galbe athlétique de ses bras. Sur le devant était inscrite la devise de son club de fitness : DES MUSCLES, PAS DES MOLLUSQUES ! Quand elle la regardait, Agnès pensait toujours à une statue de dieu grec.
– Tu veux manger un truc ? a dit maman. Dans mon portefeuille, il y a un billet de cinq, tu peux le prendre et aller t’acheter du poisson.
Agnès a secoué la tête en remuant les orteils dans l’herbe jaune et rêche. Elle avait le sentiment que sa mère savait exactement ce qu’elle voulait, mais espérait, priait pour que ce soit autre chose. Pourquoi, sinon, lui proposer autant d’argent ? – J’ai déjà mangé des céréales, a répondu Agnès.
Ce n’était pas vrai. Elle suivait un régime qui consistait à ne manger que le soir. Mais là n’était pas la question. Elle n’avait pas envie de poisson. Ce qu’elle voulait, c’était l’intuition artistique de sa mère.
Le bas du débardeur d’Agnès avait remonté, laissant apercevoir son ventre bosselé. Des vergetures ondulaient sur les bourrelets. Les cicatrices d’une césarienne, désormais presque invisibles, rappelaient l’époque où elle était deux personnes à la fois.
– Tu veux quoi, alors ?
Agnès s’est arc-boutée mentalement avant de répondre :
– J’ai des questions pour un de mes projets.
Maman attachait avec une pince un bas de pyjama à la corde à linge. Elle a soupiré, en baissant la tête comme si elle voulait demander à l’herbe : « Pourquoi est-ce qu’elle est comme ça, ma fille ? » Agnès connaissait bien cette mine ; au cours des trois dernières années, elle s’était quelque peu adoucie, mais on sentait toujours, derrière, un jugement critique.
– Bon, je finis ça et j’arrive.
– Il faut que tu viennes tout de suite, a dit Agnès. C’est important.
Elle s’est hâtée de retourner à l’intérieur pour ne pas laisser à sa mère le temps de répondre, courant sur la pointe de ses pieds nus pour éviter de marcher sur les cailloux et les branches.
La porte s’est refermée bruyamment derrière maman quand elle est rentrée. Elle portait le panier de linge sale, rose comme des viscères, et l’a posé par terre.
Agnès lui a fait signe de regarder la table, sur laquelle reposait sa dernière création.
– Quoi ?
– Quand je façonne le ventre d’un être humain avec de la viande hachée, la texture est complètement différente d’un vrai ventre. Pourquoi ? La chair humaine, c’est de la viande, la chair d’une vache aussi, alors quand on les regarde, quand on les touche, ça devrait être plus ou moins pareil, non ?
Avec le dos d’une cuillère en bois, Agnès a creusé la cavité des yeux de sa sculpture de viande et, la considérant désormais comme achevée, l’a présentée à sa mère. Elle a décidé de l’appeler, après un moment de réflexion : Fille dans la mer, avant d’être avalée. Elle avait accidentellement mis les bras de travers et la silhouette avait par conséquent l’air de se contorsionner, comme une proie, pensait Agnès, qui cherche désespérément à échapper à son prédateur.
– Je ne comprends pas ta question, ma chérie, a dit la mère d’Agnès, sourcils froncés.
Comme presque toujours quand elle était confrontée à une œuvre de sa fille, elle paraissait inquiète, les lèvres étirées en un rictus. (« Avant d’être avalée », 2018)

Corps multiple et éclaté, liens familiaux salutaires ou délétères, devenir ou vécu cyborg (Donna Haraway n’est jamais très loin dans plusieurs des textes du recueil), propulsion des héritages individuels et collectifs, pour le meilleur et / ou pour le pire, identités ne pouvant se réduire à une essence, quelle qu’elle soit – mais ne pouvant non plus ignorer leurs farouches et diverses composantes : « Soif de sang » bien entendu, mais aussi les sublimes et joliment déroutantes « Flux », « Avant d’être avalée » ou « Certains d’entre nous sont des pamplemousses », parcourent avec un brio évident et une forme rare de sombre allégresse l’ensemble des thématiques qui hantent en beauté l’œuvre de Rivers Solomon. De surcroît, « Des réceptacles damnés et abîmés », « La Fureur d’une jeune femme noire », « En appuyant sur la détente » et « De la prudence des jeunes filles » nous offrent une série de zooms, savamment multi-angulaires, sur les formes de cette colère fondamentale – projetée et concassée dans un somptueux fantastique par la longue nouvelle qui ouvre le recueil, « Soif de sang ».
On y trouvera notamment une série de prolongements naturels et surnaturels qui viennent étayer toutes les contre-narrations (au sens de John Keene) développées ailleurs par l’autrice, et qui viennent aussi toujours mieux donner à ressentir à la lectrice ou au lecteur pourquoi certaines luttes existentielles, à l’heure toujours actuelle de « Black Lives Matter » et d’offensives sans précédent contemporain contre les droits, des femmes d’abord et des humains en général ensuite, à disposer de son corps le plus librement possible, ne peuvent être balayées d’un revers de main agacé et d’une expression américaine mal comprise telle que « woke » par les bien-assis et bien-traités toujours si prompts à s’offusquer de la colère des moins bien lotis qu’eux.
Trois ans auparavant, maman avait décidé de ne plus laisser Agnès aller à l’école – décision que son père n’avait jamais acceptée. Quand elle venait chez lui, dans son appartement, il exigeait qu’elle apporte avec elle des manuels scolaires. Cette fois, elle avait pris un volume de biologie, niveau sixième.
– Mais je sais déjà tout ça, a-t-elle dit à son père d’un ton geignard. Tu peux pas me donner un peu de bœuf haché ? Ou du porc, du poulet ? Ou même des protéines végétales, si tu en as. Ça me va aussi. Je peux aussi faire une sorte de terre glaise avec des fèves cuites. C’est pas aussi bien, mais bon… Tiens, si tu veux, je peux m’en servir pour faire un modèle réduit du système digestif. Tu vois, pour montrer que j’ai tout bien appris.
Son père lui a arraché le manuel des mains.
– Comment appelle-ton le système qui transmet les messages du cerveau au reste du corps ? a-t-il demandé.
– Le système nerveux, a répondu Agnès en levant les yeux au plafond et en posant ses bras croisés sur la table. Celui-ci se divise en deux parties, le système nerveux central et le système nerveux périphérique. Tu veux que je donne plus de détails ? Tu veux que je te décrive le développement évolutionnaire des tissus neuronaux ?
Agnès était incollable sur l’anatomie, grâce à son amour pour les films d’horreur. Quand elle s’était installée dans la maison avec sa mère, elle en avait regardé des tonnes, de façon obsessionnelle. C’était à ce moment-là qu’elle avait décidé qu’elle deviendrait maquilleuse cinématographique professionnelle, spécialisée dans le gore.
En regardant des films d’horreur, elle pouvait revivre le traumatisme du viol dans un environnement sécurisé, elle pouvait commencer à l’aborder, à l’appréhender, de loin, avec la possibilité de s’arrêter quand elle le voulait. C’était ce qu’elle avait entendu une psychologue dire à sa mère. Agnès n’était pas d’accord avec cette interprétation. Elle aimait juste beaucoup voir des êtres se faire éviscérer, qu’ils soient des zombies, des monstres, des extra-terrestres ou des êtres humains. Ils paraissaient si fragiles, elle se sentait plus solide par contraste.
Elle avait regardé tous les films d’horreur qu’elle avait pu trouver, elle les avait vus plusieurs fois, puis sa passion pour la biologie, la physiologie et l’anatomie avait changé de forme, retombant plutôt sur un jeu vidéo appelé DigiPaws, dans lequel il fallait s’occuper d’un animal virtuel. Agnès avait téléchargé un pack de maladies réalistes créé par les utilisateurs, et avait ainsi beaucoup appris sur les différentes formes de souffrance que pouvaient subir les corps. Elle avait aussi appris qu’il existait plus de façons de souffrir que de soulager la douleur. « Il y a plus de maladies qu’il n’y a de remèdes », avait-elle dit à sa mère. Pour nourrir cet intérêt, maman l’avait inscrite au zoo, à un programme pour zoologistes en herbe ; Agnès s’y rendait une fois par semaine.
Pourquoi alors son père s’acharnait-il à lui faire étudier un bouquin débile pour les petits enfants, où les corps sont dessinés sans les parties génitales et où les intestins sont représentés comme s’ils étaient en plastique ? (« Avant d’être avalée », 2018)
Hugues Charybde, le 15/05/2024
Rivers Solomon - Soif de sang - éditions Aux Forges de Vulcain
l’acheter chez Charybde, ici

14.05.2024 à 14:15
“Extinction Internet”, étirer le temps, revendiquer et squatter l’avenir d’Internet
L'Autre Quotidien
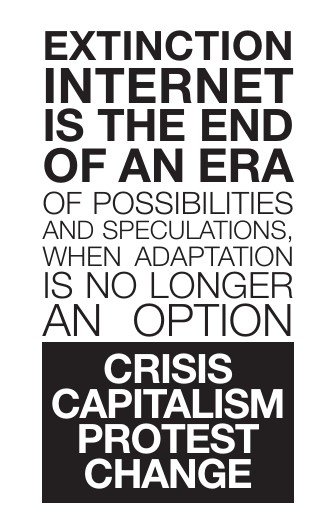
Texte intégral (10652 mots)
Extinction Internet n’est pas simplement un fantasme de technologie numérique de fin du monde qui sera un jour anéanti par une impulsion électromagnétique ou la coupure de câbles. Extinction Internet marque plutôt la fin d’une ère de possibilités et de spéculations, où l’adaptation n’est plus une option. Au cours de la décennie perdue d'Internet, nous avons réorganisé les transats du Titanic sous la direction inspirante de la classe de consultants. Que faire pour maintenir l’inévitable ? Nous avons besoin d’outils qui décolonisent, redistribuent la valeur, conspirent et organisent. Rejoignez l'exode de la plateforme. Il est temps de faire la grève de l'optimisation. Il y a de la beauté dans la panne.
Geert Lovink

La culture Internet, dans son état actuel, peut-elle résister à l’entropie et échapper à l’enregistrement infini tout en étant confrontée à sa propre disparition sans fin ? C'est la question que nous a léguée le philosophe français Bernard Stiegler, décédé en août 2020. Une anthologie sur ce sujet, intitulée Bifurquer : « Il n'y a pas d'alternative » , a été écrite durant les premiers mois du COVID-19 : Achevée peu avant sa mort, il est basé sur son travail et écrit en consultation avec la génération de Greta Thunberg. Bifurcate est aussi un projet de justice climatique et d'analyse philosophique, signé collectivement sous le pseudonyme Internation. « Bifurquer » signifie diviser ou diviser en deux branches. C’est un appel à se diversifier, à créer des alternatives et à cesser d’ignorer le problème de l’entropie, une question classique de la cybernétique. Nous connaissons le trouble dans le contexte de la critique d’Internet comme un problème dû à une surcharge cognitive, associée à des symptômes psychiques tels que la distraction, l’épuisement et l’anxiété, aggravés à leur tour par les architectures subliminales des médias sociaux extractivistes. Stiegler a appelé notre condition l'Entropocène par analogie avec l'Anthropocène : une ère caractérisée par «l'augmentation massive de l'entropie sous toutes ses formes (physiques, biologiques et informationnelles)». Comme le soulignaient déjà Deleuze et Guattari : « Nous ne manquons certainement pas de communication, nous en avons même trop ; nous manquons de création ». Notre tâche est donc de créer un nouveau langage pour comprendre le présent avec l’aspiration d’arrêter et de surmonter l’avènement de multiples catastrophes, illustré par le concept multiple d’Extinction Internet.
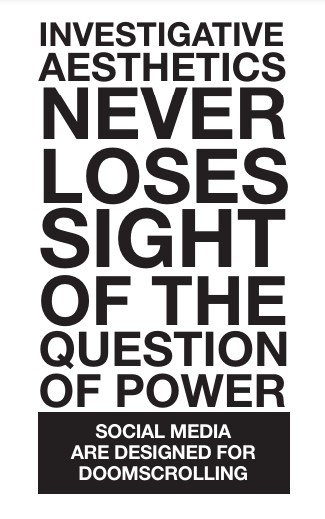
Alors que Bernard Stiegler et d’autres ont souligné combien le désastre écologique doit être théorisé à la fois sur le plan physique, biologique et psychologique, l’accent doit désormais être mis sur la réduction du savoir à l’information, aux conséquences sur les habitudes, les pratiques et les dispositions psychosociales. Dernièrement, je me suis intéressé à l’impact politique et esthétique du bruit et de l’inattention sur les états psychiques (et cela est particulièrement vrai pour les jeunes générations). Il reste encore à voir si ces études sur l’anxiété, la colère et la tristesse en ligne peuvent fournir des outils de départ pour créer des alternatives valables.
Récemment, j’ai commencé à douter de ma thèse selon laquelle une analyse critique de la désolation psychique des utilisateurs du numérique peut constituer un premier pas crucial vers l’organisation, la mobilisation et, à terme, le changement. Ma génération a rapidement découvert que – pour reprendre la terminologie de Derrida et Stiegler – Internet est un pharmakon : toxique et curatif. La critique des hypothèses implicites d’Internet, à commencer par l’idéologie californienne , est donc à la fois une répudiation et une affirmation. Alors, comment pouvons-nous rassembler l’analyse et la critique dans des réseaux de communication radicaux et fonctionnels pour faire la différence en termes de recherche, de politique et de développement d’alternatives ?

D'abord le diagnostic, puis la rééducation. Ce sont les deux étapes fondamentales pour entreprendre le processus de guérison. En ce qui me concerne, ces idées me ramènent à deux œuvres qui ont défini mon Werdegang intellectuel . Tout d'abord, les Fantasmes Virils de Klaus Theweleit , en relation avec les dommages psychiques de la classe ouvrière allemande et comment cela a rendu les travailleurs vulnérables aux promesses du parti nazi de retrouver leur dignité perdue. Et deuxièmement, Masse et Puissance d’Elias Canetti , un classique de la discipline aujourd’hui disparue de la « psychologie de masse » […]. Pour tous deux, la question antifasciste historique est, une fois de plus, la question d’aujourd’hui : comment démolir l’armure psychique du fascisme ? Pourquoi les gens sont-ils de plus en plus sensibles aux théories du complot, aux fausses nouvelles et aux mythes sur l’immigration ? Fournir des informations « objectives » et correctes n’induit pas la démystification. Le néopositivisme ne nous mène nulle part, mais se limite à reproduire les modes dominants de suprématie. Il y a une leçon amère qui vient du passé : le dialogue ne vaincra pas le fascisme.
Essayer de déchiffrer le code fasciste était l’une des nombreuses tâches de ma génération : la génération intermédiaire qui a grandi dans l’ombre de la Seconde Guerre mondiale, de la guerre froide et de l’héritage de 1968. Le fascisme a peut-être été vaincu (à un coût élevé) militairement, mais ses racines demeurent. Lors de la reconstruction d’après-guerre, marquée par la guerre froide et l’entente entre les classes, les racines du fascisme n’ont pas été correctement nommées, encore moins éradiquées. Ce n’est pas un hasard si la question de savoir comment planifier et vivre une « vie antifasciste », comme l’a formulé Michel Foucault, a émergé dans les années 1970, lorsque la récession et l’austérité étaient de retour en Occident . Cinquante ans plus tard, la question peut être reformulée ainsi : quels types de « technologies numériques du soi » devront être conçues pour nous connaître nous-mêmes d’une manière antithétique aux régimes normatifs ? Comment vivre hors plateforme tout en bénéficiant des avantages des réseaux sociaux ?

L’un des éléments fondamentaux d’une critique de l’état techno-social actuel sera une version radicalement révisée de la psychanalyse du XXIe siècle. Dans Le Troisième Inconscient , le théoricien italien Franco Berardi propose une psychanalyse qui doit « prendre cet horizon de chaos et d’extinction comme point de départ d’une nouvelle réflexion ». Il écrit ensuite sur la découverte de l'inconscient aux XVIIIe et XIXe siècles et comment elle a conduit à la fondation de la psychanalyse en tant que thérapie et outil d'analyse culturelle. Contrairement à l’accent que ses pères fondateurs mettaient sur la négation et la sublimation, la deuxième version de l’inconscient associée à Lacan, et plus encore à Deleuze et Guattari, mettait l’accent sur l’élément de production : non pas la répression mais la surexpression. Pour ce dernier, en effet, l'inconscient n'était pas un théâtre mais une usine, lancée "à la poursuite d'une joie qui échappe continuellement, stimulant des tentatives frénétiques de vainqueur, généralement frustrées par la réalité".
Comment sauver le « techno-social » des mains de la Silicon Valley et du contrôle étatique sans nécessairement retomber dans un romantisme hors ligne ou dans un communautarisme défensif et replié sur lui-même ?
Cinquante ans après la libération du désir, Berardi propose de regarder les choses sous un nouvel angle : un troisième inconscient qui s'articule autour de l'analyse de la dimension techno-sociale du psychisme, dans un monde qui n'est plus centré sur la croissance et (schizo )productivité, mais sur l’extinction, l’anxiété et la décroissance. Kétamine mélangée à Instagram et punk live. L’esprit humain a atteint un état de saturation. Berardi analyse et approuve le développement de nouveaux outils critiques qui peuvent aider à comprendre le spectre actuel de la sensibilité mentale et de l'attention émotionnelle. Nous devons nous entraîner à « suivre la dynamique du désastre », qui, selon lui, est une description précise de « notre état mental pendant le tremblement de terre actuel, qui est aussi un tremblement de terre de l’âme et un tremblement de terre mental ». Selon Berardi, « le fascisme est une réaction psychotique à l'impuissance », comme Theweleit l'a déjà démontré dans son Männerphatasien . La transition en douceur du COVID à la guerre en Ukraine, l’inflation et la crise énergétique n’ont fait qu’exacerber l’effondrement du circuit bio-info-psychique sous le poids de la pile de crise. À chaque nouveau choc, nous montons et descendons, feuilletant « l’ atlas vertical » des conflits.
Dans ma lecture du Troisième Inconscient , les technologies médiatiques sont entrées dans le corps de telle manière que le corps et l’âme ne peuvent plus être séparés de l’infosphère sémiotique. Il n'y a pas que la physionomie qui a changé. Pensons par exemple aux neurones de notre cerveau qui réorganisent la possibilité même de notre façon de penser, ou encore à la fatigue que nous ressentons dans nos yeux, nos doigts et dans tout notre corps après une énième séance de Zoom. C’est ainsi que les technologies d’extinction fonctionnent d’une manière qui se répercute dans toute la société.
Franco Berardi reste l'un des rares intellectuels européens dotés d'une sensibilité sismographique phénoménale pour les états d'esprit sombres des dernières générations, collées à leurs appareils. Lire le pouls de cette manière, en phase avec la génération Z – la première génération à expérimenter Internet comme une sphère donnée et fixe – est une chose que Berardi partage avec Bernard Stiegler. Une stratégie mondiale commune est en jeu : une ferme conviction que la société doit avant tout faire face à l’abîme. C’est là que le mécontentement politique est destiné, au cœur de l’inconscient social. Il est certain que le déni accélérera encore les crises en cours – mais dans l’intérêt de qui ? L’optimisme du Nouvel Âge va de pair avec le contrôle de la perception du public. C’est pourquoi « pilule rouge ou pilule bleue » est le thème central de notre époque. Au lieu d’administrer à nouveau des procédures dysfonctionnelles, une issue pourrait être de représenter – et de mettre en pratique – l’acte grotesque de disparition et de réapparition (mais sans enregistrement).
Il est temps de vivre une procédure circulaire de début et de fin, par opposition au retour sans fin des tropes de l’optimisation et de l’austérité. Selon Berardi, le « circuit bio-info-psychique » doit être élaboré avant même de franchir le seuil dans lequel nous nous trouvons. Un traitement collectif est nécessaire qui traite « des signaux, des gestes linguistiques, des suggestions subliminales, des convergences subconscientes. C'est l'espace de la poésie, l'activité qui façonne les nouvelles dispositions de la sensibilité" exprimées dans des mèmes aux tons ironiques, des vidéos drôles, des danses et des gestes, reçus dans des moments d'ivresse extatique, qui nous entraînent toujours plus profondément dans le vortex de la musique et du visuel. expérience.
Quels types de pratiques artistiques font la différence dans ce contexte ? À mon avis, l'esthétique d'investigation, visant à cartographier les preuves recueillies, à inventer des concepts et des critiques à partir de la réorganisation de la réalité, ne peut exister qu'au début d'un processus de transformation radicale. Par la suite, tout cela contribuera à un mouvement plus large d’écriture et d’analyse de l’histoire de l’art dans les sciences humaines : un nouveau paradigme, si l’on veut, qui ne se limitera pas à répliquer le mouvement des Humanités numériques, mais se distinguera de la tendance de ce mouvement à se concentrer sur la numérisation des archives, en plus de l'analyse des données, amoureux des chiffres, des graphiques et des échelles de valeurs. Nous avons dépassé l’époque des « compétences numériques » au service des œuvres caritatives et nous sommes immergés dans la politique mondiale des besoins numériques. Dans cette phase, le projet d’esthétique d’investigation ne perd pas de vue la question du pouvoir : en réorientant le débat politique sur la vérité, en opposant les récits sur l’autorité et l’expédient hégémonique à la véracité des opprimés, il se matérialise finalement à travers une approche computationnelle. esthétique s’articulant autour d’axes spatiaux et temporels.

Il existe une esthétique de l’effondrement que la culture Internet transmet, représente et reproduit. Hâtons-nous d’écrire l’histoire de la culture en ligne labile : les autres ne le feront pas à notre place
Le « moi numérique » peut-il échapper au piège du vanity marketing ? Est-il possible de faire l’expérience d’une coopération libre et d’une action collective pour échapper à la cage de l’ego ? Comment sauver le « techno-social » des mains de la Silicon Valley et du contrôle étatique sans nécessairement retomber dans un romantisme hors ligne ou dans un communautarisme défensif et replié sur lui-même ? Il s'agit d'un projet politique et passionné de nombreux amis italiens avec lesquels j'ai le privilège de travailler, parmi lesquels Donatella Della Ratta, Tiziana Terranova et d'innombrables autres. Le point de départ est d’abord une inversion dialectique assez convaincante. Le social est considéré comme une force catalysatrice principale : un pouvoir souverain qui, à son tour, déclenche des inventions et de nouvelles formes de production et de reproduction, plutôt que d'être présenté comme le produit de mouvements historiques à grande échelle, tels que le capitalisme, l'industrialisation, l'impérialisme, le patriarcat ou le colonialisme. A partir de là, le réseau social peut être mieux défini comme le véritable moteur de technologies imaginaires – de temps en temps la cible d’expropriations capitalistes – par nature réactives, mais qui forcent finalement le social à se rendre. Ensemble, nous devons inverser cette tendance et restaurer l’autonomie et la détermination sociales. Malgré les batailles perdues, le techno-social conserve son pouvoir de transformation et est loin d’être une victime impuissante. C'est un point important si nous voulons freiner la société technologique lors de la mouvementée « deuxième crise pétrolière », par exemple en allant au-delà du désastre énergétique que sont les centres de données, en concevant de nouvelles architectures de redistribution informatique capables de compléter le droit exclusif de parcourir nos bibliothèques. hors ligne.
Les Italiens nous apprennent à prendre cette question très au sérieux : qu’est-ce qui est social aujourd’hui ? Il y a quarante ans, nous aurions répondu : les « mouvements sociaux autonomes ». Il y a trente ans, les communautés inspirées par les médias tactiques; il y a vingt ans, les réseaux sociaux et le Web 2.0; et il y a dix ans la plateforme. Qu’y a-t-il d’autre à offrir, sinon un appel bien intentionné au retour aux valeurs du logiciel libre ? Sur le plan relationnel, Franco Berardi propose une « conversion psycho-culturelle en faveur de la frugalité et de l'amitié ». Avec mon ami de Sydney, Ned Rossiter, j'ai réfléchi aux « réseaux organisés » ; nous étions certains que ces réseaux avaient des liens forts avec une esthétique distribuée et développée à travers de nombreux nœuds et emplacements, par opposition aux structures de réseau classiques qui ont des liens faibles et ont tendance à se désintégrer facilement. Les réseaux organisés restent encore une promesse, tout comme le potentiel non exploité d'une « critique d'Internet ». Un retour à l’adhésion à des organisations telles qu’un parti, comme moyen de reconquérir le pouvoir politique, semble encore plus improbable qu’il y a quarante ans, lorsque j’étudiais ce sujet. Comment transformer le mécontentement et la contre-hégémonie en une transition efficace du pouvoir à la fin de l’ère des plateformes ? La question de l’organisation reste toujours très actuelle, non seulement pour les différents mouvements de protestation, mais aussi, dans notre cas, pour les artistes et designers et autres travailleurs nomades et précaires.
« Convainquez-moi que nous ne sommes pas à l’âge des ténèbres du numérique », a commencé Regina Harsanyi sur Twitter en 2022. La perte d’espace privé semble réelle. Et c’est le cas à bien des égards. Nous avons été entraînés dans un trou noir virtuel. Pourtant, il y a de la beauté dans l’effondrement. La recherche sur les mèmes radicaux nous l’enseigne depuis des années. Il existe une esthétique de l’effondrement que la culture Internet transmet, représente et reproduit. Hâtons-nous d'écrire l'histoire de la culture en ligne labile : d'autres ne le feront pas à notre place. Après trois décennies, un sentiment encore plus pressant nous pèse, qui va au-delà des cartographies passées de régression et de stagnation, y compris leurs états sombres respectifs. Comme le disait Brecht : « Parce que les choses sont ce qu’elles sont, les choses ne resteront pas telles qu’elles sont. » La possibilité d’une disparition d’Internet est désormais envisageable. C’est le moment de notre vérité qui dérange. Non seulement des possibilités infinies ont implosé à cause du réalisme numérique, mais nous sommes également confrontés à l’horizon existentiel de la finitude. Mais ce n’est pas celui des protocoles TCP/IP ou de la commutation de paquets. Extinction Internet marque la fin d’une ère d’imagination collective qui, à bien des égards, a démontré à quel point les organisations technologiques verticales et horizontales constituaient des alternatives possibles. Pas une pile mais plusieurs étages.

La stagnation et la récession ont été cartographiées en détail ; il s’agit maintenant d’en théoriser la fin. La destruction succède à la déconstruction. L’optimisme institutionnel ne récompensera personne pour son alarmisme en cas de catastrophe, tout comme les critiques à l’égard d’Internet et de ses alternatives sont tombées dans l’oreille d’un sourd dans la période pré-apocalyptique. Il est temps d’insuffler à l’approche managériale froide de la gouvernementalité algorithmique la hantologie de Mark Fisher. Nous devons nous réveiller et comprendre que le black-out est devenu systémique. Les modes crypto-nihilistes de « l’argent facile » sont des technologies récentes. Mais que se passe-t-il une fois que l’invisible est devenu visible et que nous avons dépassé le vide de nos pensées ? L’odeur de l’extinction flotte dans l’air. Le réalisme darwinien dit que c’est votre choix de rester pauvre et déconnecté, dans le froid, la chaleur, la sécheresse ou les inondations. Il est temps de faire grève, une grève contre l'optimisation. Apportez simplement des améliorations. Arrêtons d'augmenter l'efficacité et d'augmenter la productivité. Il est temps d'enseigner la conception de problèmes . Il est temps d'inventer des provocateurs .
Consultons //substack.com/@cashedcobrazhousewriter " target="_blank" rel="noreferrer noopener">Angelicism01, ma nihiliste Greta Thunberg, e-girl poète, théoricienne et personnage virtuel à la fois, qui écrit : « Internet C'est impossible, je n'y pense pas parce que ça m'écrase. Je ne peux pas dire si Internet va finir. L'extinction elle-même est en train de changer. C'est ce que disent les machines de transformation. C'est ce que signifie vivre la mutation. Internet et l’extinction sont inextricablement liés. »
Qu’est-ce qui pourrait occuper le vide dans notre psychisme défragmenté une fois qu’Internet aura quitté la scène ? Et à quoi pourrait ressembler la vie une fois que nos esprits fragiles ne seront plus assaillis par les effets engourdissants et déprimants du défilement catastrophique ?
La technique en tant que telle n’exclut pas les questions. Ce n’est pas parce que nous sommes immergés dans ce système que nous sommes capturés par sa prétendue totalité. Les médias sociaux sont conçus pour faire défiler la catastrophe. La désautomatisation d’Internet dans ce contexte suffirait à briser les habitudes répétitives qui pénètrent dans les entrailles des corps connectés. Il y a quelque chose de libérateur à perdre son profil à cause d’un acte d’oubli. Qu’est-ce qui pourrait occuper le vide dans notre psychisme défragmenté une fois qu’Internet aura quitté la scène ? Et à quoi pourrait ressembler la vie une fois que nos esprits fragiles ne seront plus assaillis par les effets engourdissants et déprimants du défilement catastrophique ? Les neurones post-Internet constituent le domaine d’un nouveau réservoir durable d’imagination et de réinvention de la cognition, les éléments fondamentaux de la société. C'était la leçon de Stiegler.
Extinction Internet n’est pas simplement un fantasme apocalyptique selon lequel la technologie numérique serait un jour anéantie par une impulsion électromagnétique déclenchée par une arme de destruction massive en un bref instant. Extinction Internet marque la fin d’une ère de possibilités et de spéculations, où l’adaptation n’est plus une option. Le deuil de la disparition d’Internet a commencé bien avant, lorsque la plateforme a évincé l’imaginaire collectif. Il semble qu’un autre Internet ne soit plus possible. L'utilisateur-programmeur est condamné à vivre comme un zombie, swipant et scrollant sans réfléchir : il n'est plus maître de sa propre activité. Alors que dans un passé récent j'avais décrit ce comportement à un niveau subliminal ou subconscient, à l'étape suivante, l'intermédiaire est déclaré en état de mort cérébrale. Alors qu’un état de sommeil profond apparaît rapidement, nos gestes informatiques quotidiens fonctionnent toujours automatiquement.
Il s’agit d’étirer le temps, de revendiquer et de squatter l’avenir d’Internet, et de concevoir ensemble des configurations spatio-temporelles autonomes permettant de développer des réflexions et des activités inutiles. Le post-Internet sera vendu comme une technologie irréversible. En guise de contre-attaque, nous devons repenser les systèmes actuels qui provoquent un déficit de mémoire et de connaissances. Le projet n’est pas seulement d’affirmer l’extinction du protocole Internet, mais en même temps de surmonter la dépression programmée correspondante.
« Les crises, qu'elles soient celles du capitalisme ou de la protestation, écrit Matt Colquhuon, ne génèrent plus aucun changement ; la négativité détruit l’ancien mais ne produit plus le nouveau. » De même, j’ai dû prouver par moi-même que ni la critique du réseau ni la psychanalyse collective du moi numérique ne mèneront au changement. Notre tâche sera, pour reprendre les mots de Bernard Stiegler , de « mettre les automatismes au service d'une désautomatisation néguentropique ». La stratégie pour vaincre l’entropie peut inclure la désautomatisation de tout, de l’exode des médias sociaux à la démolition des centres de données, au réacheminement des câbles à fibre optique, jusqu’au retrait de Siri et Alexa.
Au lieu de rejeter la faute sur des disciplines académiques déjà établies, il faut aller plus loin et faire une analyse amorale de la situation actuelle, dans laquelle on aura préfiguré la disparition d’Internet. « Internet n'existe pas », écrit Angelicism01. « Peut-être que cela existait il y a peu de temps, comme il y a deux jours. Mais maintenant il ne reste que flou, miroir, doxa , expiration, redirection, 01. Si jamais il existait, nous ne pourrions pas le voir. Internet a disparu, personne ne peut nous emmener avec lui. Quand vous n’existez pas, l’espace en vous continue de faire semblant d’exister. »
Paul Virilio et Jean Baudrillard m'ont appris dès le début l'existence d'une esthétique de la disparition. Nous devons trouver comment organiser une extinction électronique alternative et radicale au lieu de nous précipiter pour déclarer : « Internet est mort, vive Internet » ! Une autre fin est possible. Cela ne se produira pas en prenant simplement d'assaut les générateurs d'électricité comme le font les envahisseurs russes en Ukraine ou en installant, supprimant et réinstallant l'une des connexions Star Link d'Elon Musk. Peut-être avons-nous déjà épuisé le temps qui nous restait pour effectuer des recherches essentielles ; la moindre des choses est d'apporter son soutien aux artistes, d'écouter attentivement leur imaginaire cosmotechnique et « cli-fi ».
Non seulement dans la biosphère, mais aussi dans l’infosphère, la perte de diversité est entropique, stérilisante et fragile : elle s’effondre sur elle-même. Les réseaux sociaux au service de la critique en ligne, l'informatique au service de la détox numérique et la conception d'applications alternatives au nom de la prévention des données, pas seulement de leur protection. Qu’est-ce que la décroissance d’Internet, le désapprentissage automatique, l’idiotie artificielle ? C’est ainsi que la pensée pharmacologique et les flux de réflexion peuvent être reconvertis en pratiques fonctionnelles de conception. Le défi, dans l’esprit de Stiegler, est donc d’introduire des bifurcations improbables et incalculables dans l’enseignement supérieur pour mettre en pratique les concepts, protocoles et prototypes de récupération. Avec Anaïs Nin, on peut dire que le canal de communication que nous aimons « doit être un hache pour briser la mer de glace qui est en nous ».
La proposition concerne une conception des réseaux sociaux mettant l'accent sur les soins, ainsi que des outils d'informatique intergénérationnelle qui sont à leur tour utiles pour résoudre des problèmes à chaque niveau de la pile de crise. C’est le genre de réflexion intégrée où la question n’est plus de savoir quoi faire avec le flux incessant d’applications téléchargeables qui vont et viennent, de TikTok, Ethereum, Dall-E, Zoom et Clubhouse à BeReal et leurs arrière-pensées informatiques liées à l’exploitation minière. . Arrêtons de construire des solutions Web3 pour des problèmes qui n'existent pas et promouvons des outils qui décolonisent, redistribuent les sens, conspirent et organisent. Comme Bogna Kronior l'a expliqué dans un tweet : « Je ne veux pas de liberté d'expression. Je veux un réseau qui ne soit pas connecté au Meatspace et qui ne fasse pas de tout un concours de popularité et un narcissisme accablé par la dépendance à la dopamine. Il faut dépersonnaliser, rendre maîtres nos yeux et notre système nerveux ; Assez avec l’économie identitaire. Ne dépend plus de plateformes, contrôlées par des autorités invisibles et distantes. »
Notre tâche en tant que théoriciens, artistes, activistes, designers, développeurs, critiques et autres irréguliers sera d’aller au-delà de la partition et de développer une modestie radicale quant au potentiel du numérique. Il faut bifurquer pour avancer vers de nouveaux horizons
Quel est le déclin d’Internet alors que le nombre de ses utilisateurs a dépassé les cinq milliards ? Jean Baudrillard nous a appris que l'explosion informationnelle est vécue comme une implosion. Que se passe-t-il lorsque les villes intelligentes s’effondrent dans le trou noir du métaverse ? Quand les sociétés post-Covid feront-elles face au refus de travailler ? Qu’est-ce que cela signifie lorsque nous rappons sur le thème « dire la vérité à la plateforme » et que nous partageons des vidéos de « propagande climatique » ? Que signifie la parrêsia dans le contexte d’Internet, au-delà de la liberté d’expression démocratique ? Quelles sont nos préoccupations environnementales au-delà de la consommation d’électricité des centres de données et des pratiques de crypto-minage extrêmement économes en énergie ?
Notre état cosmotechnique actuel, comme l’appelle Yuk Hui , est défini par un enchevêtrement inquiétant d’événements historiques accélérés et de stagnation sociale. La cosmotechnique a lieu alors qu’il n’y a pas de retour à la phase innocente de la mondialisation, et s’y ajoute l’incertitude sur la question de la résistance à l’isolationnisme géopolitique. Cet état de confusion conduit à des techno-monstruosités : de l’idéologie crypto de la droite libertaire, aux fausses nouvelles et deep fakes, en passant par les biais de l’intelligence artificielle. L’espoir que les décisions politiques guideront et maintiendront ces avancées technologiques à distance a été pratiquement abandonné. Les marchés non plus. Avec Pieter Lemmers, Yuk Hui écrit : « La vérité de notre époque est une vérité sur laquelle, selon Stiegler, pratiquement tout le monde préfère fermer les yeux parce qu'elle est trop traumatisante, inconcevable et effrayante. Cela parle non seulement de la fin possible, mais aussi de la fin plutôt probable et imminente de l’humanité, ou du moins de la civilisation humaine telle que nous la connaissons. Même les quelques riches « préparateurs » qui se réfugient dans des bunkers enterrés en Nouvelle-Zélande ou se préparent à un exode dans l’espace sont également condamnés. Personne n’échappe à l’effondrement de la civilisation combiné au désastre climatique. La nouvelle de l’extinction d’espèces est un fait incontestable.
La fin de l’Internet tel que nous le connaissons, ou plus précisément, la fin des cultures de réseau telles que nous les avons connues (et étudiées), sont de plus en plus proches. Au cours de la dernière décennie, Internet est rapidement passé d’un stade froid et positif à celui de partie intégrante du problème, incapable d’inverser ses tendances destructrices. Peut-être avons-nous déjà dépassé le point de non-retour. Faire taire les non-humains ne fonctionne plus comme avant. Comment répondre à la question rhétorique de Douglas Rushkoff (« programmer ou être programmé ») maintenant que l'open source et le logiciel libre sont moralement en faillite en raison de leur braderie et, par conséquent, ont perdu de leur attrait au fil des générations futures ? Que se passe-t-il lorsque même les Allemands ne peuvent pas faire face à leurs tempêtes de merde et que les Français ramènent les enseignements de la collapsologie ? Bref, qu’est-ce que cela veut dire quand on dit qu’Internet a pris une tournure catastrophique et est devenu irréparable ?
Pensons un instant à Infinite Detail de Tim Maughan , une histoire de science-fiction dans un futur proche développée autour du concept de kill switch. Une cyberattaque ferme définitivement Internet, entraînant la fin du monde tel que nous le connaissons . Les coupures de câbles océaniques et les attaques contre les télécommunications et les centres de données se produisent en ce moment même. Nous revenons aux origines militaires de la cybernétique et d'Internet, aux travaux de Paul Virilio et de Friedrich Kittler qui ont déterminé jusqu'à aujourd'hui mes fondements intellectuels. Si Internet promettait la résilience, l’effondrement est désormais réel.
Extinction Internet parle de décroissance, de fin de l'exploration de données et, oui, même de ces moments où les écrans deviennent noirs et où le défilement funeste s'arrête net. Mais c’est aussi une question de conception d’urgence, une promesse radicale qui affirme que la mise en œuvre des principes de prévention des données dans les appareils et les applications est encore possible si l’on suppose que nous atteindrons bientôt le « pic de données » et que des mesures en cours telles que l’intelligence artificielle « éthique » et les « bonnes données » ne pourront produire ni la justice sociale, ni la fin du capitalisme racial, ni l’aversion à la catastrophe climatique. Pour le dire en termes post-apocalyptiques et de science-fiction : pas du punk solaire mais du punk lunaire .
Au niveau des états psychiques, ces derniers temps, nous nous sommes principalement concentrés sur le déficit d'attention induit par la plate-forme, l'impuissance réflexive et l'hédonie dépressive, comme les a décrits Mark Fisher . Cette situation alarmante a trouvé son pendant dans la solastalgie , « une forme émergente de dépression et de détresse causée par des changements environnementaux, tels que le changement climatique, les catastrophes naturelles, les conditions météorologiques extrêmes et/ou d'autres altérations négatives ou bouleversantes de l'environnement ou de votre maison. » Avec des millions de réfugiés climatiques, nous sommes mis au défi de réfléchir ensemble à une « pile de crise » où la dépendance aux plateformes n’est qu’une de nos nombreuses préoccupations urgentes.
Le fait qu'Internet accélère les problèmes mondiaux et en fait de plus en plus partie intégrante fait l'objet d'un consensus général. Les soi-disant « bons » protocoles et la décentralisation par le biais de « réseaux de réseaux » se sont révélés incapables de résister aux plates-formes centralisées et au contrôle autoritaire. Au lieu de cela, ces approches se sont révélées susceptibles d’un examen plus approfondi, inadaptées pour « tourner autour » de la politique mondiale et « l’interpréter comme nuisible », comme on l’a autrefois scandé dans les années 1990. Alors que les organes directeurs sont administrés par des ingénieurs et des fonctionnaires bien intentionnés des ministères des télécommunications, il est triste de penser que, même si Facebook et Google occupent des positions de leader, les chances d'une révolution structurelle sont minimes. Il est donc de plus en plus nécessaire d’élaborer des feuilles de route comportant des initiatives concrètes sur la manière de reprendre Internet. Surtout ici, à Amsterdam, avec ses centres fintech, le stratégique Amsterdam Internet Exchange et ses bâtiments extravagants . Après tout, attendre Bruxelles, c’est comme attendre Godot. Par ailleurs, comment les universités peuvent-elles se libérer de leur dépendance à l’égard de Google et de Microsoft ? Comment les artistes peuvent-ils espérer s’affranchir d’Adobe et d’Instagram ?

Dans la conclusion de The Platform Marshes, j’ai décrit comment un exode hors de la plateforme pourrait être entrepris. À cette fin, j'ai utilisé le terme « stacktivisme », une forme d'activisme Internet qui prend conscience des dépendances interconnectées de ses propositions alternatives et de sa forme en couches, depuis les référentiels publics jusqu'aux infrastructures décentralisées et aux systèmes d'exploitation sur des logiciels libres et ouverts. . jusqu'aux interfaces non manipulatrices, aux filtres IA et aux forums avec des pratiques de prise de décision libres. Nous allongeons et ouvrons le temps, nous concevons des configurations spatio-temporelles autonomes capables de laisser place à la réflexion. Il est crucial que tout cela ne paraisse pas énigmatique ou utopique. En effet, je ne soutiens pas les fantasmes mondiaux de « calcul à l’échelle planétaire » et de « terraformation » promulgués par Benjamin Bratton, l’auteur de The Stack , et encore moins la métaphysique de ce qu’on appelle la « théorie numérique ».
La disparition de la possibilité de changement est en cours depuis une décennie ou plus : à sa place se trouvent des interfaces utilisateur faciles à naviguer et des vidéos de chatons.
Alors, comment pouvons-nous « déranger les fauteurs de troubles » ? Premièrement, nous devons nous assurer que nos concepts et nos conceptions peuvent réellement être mis à l’échelle et mis en pratique. C'est le cas de la transition d'un modèle économique extractiviste vers ce que Bernard Stiegler et ses collaborateurs ont défini comme « l'économie contributive ». Le modèle, par exemple, dans lequel les paiements peer-to-peer s’ajoutent à une économie circulaire, durable et mondiale qui œuvre à la redistribution des richesses et des ressources, tant au niveau local que mondial. Je suis convaincu que c'est là la dimension décoloniale du problème cyber, un domaine qui nécessite encore de travailler sur l'empreinte carbone, sur l'extraction de matières rares et sur la question des déchets électroniques produits par le monde numérique.
Comme le dit Michael Marder dans Philosophy for Passengers : « Après la fin du voyage dans le monde, le voyage de la compréhension commence. » Comprendre Internet . Notre tâche en tant que théoriciens, artistes, activistes, designers, développeurs, critiques et autres irréguliers sera d’aller au-delà de la partition et de développer une modestie radicale quant au potentiel du numérique. Nous devons bifurquer pour pouvoir avancer vers de nouveaux horizons, ouvrant la voie à ce que Stiegler appelle le Néganthropocène. Comparé au désastre climatique actuel et aux inégalités sociales croissantes, l’effort de calcul est relativement mineur. Après tout, le code peut être réécrit, de nouveaux systèmes d’exploitation construits, des câbles et des signaux réacheminés, des centres de données décentralisés et des infrastructures publiques installées.

Comme l’avait observé Walter Benjamin : « C’est une catastrophe que les choses continuent ainsi. » Le problème ici n’est pas qu’Internet s’effondrera à tout moment – et que la thèse sur son extinction sera réfutée d’une manière ou d’une autre. Il y a déjà suffisamment de pannes de courant dans le monde, comme me le rappellent mes amis ukrainiens . Aux « délestages automatiques » s’ajoutent les filtres, les paywalls, les algorithmes et l’intelligence artificielle, la censure d’État, les piratages, les correctifs défectueux et la modération du contenu, tout cela grâce à une main-d’œuvre bon marché. Nous serons confrontés à de plus en plus d’« événements improbables », au-delà de la cyberguerre des hackers du passé. Ce monde post-naturel est sur le point de faire d’étranges pas de géant. Le mystère cosmotechnique surprendra ceux qui croient en une connectivité fluide et stable. Mais ce qui est réellement en jeu, c'est l'effondrement de l'imagination collective d'un système technologique qui joue un rôle si crucial dans la vie quotidienne de milliards de personnes et qui peut néanmoins être façonné, gouverné, conçu et plié en vertu de fins non officielles. . La disparition de la possibilité de changement est en cours depuis une décennie ou plus : à sa place se trouvent des interfaces utilisateur faciles à naviguer et des vidéos de chatons.
Des progrès lents mais réguliers ont été réalisés dans le développement d’applications en ligne alternatives. En plus de Linux, Wikipedia et Firefox déjà consolidés, il y a DuckDuckGo, Signal, Telegram, Mastodon et Fediverse, deepl, OpenStreetMap, Jitsi et Cryptpad ; la liste s'allonge. Cependant, les outils de réseaux sociaux, plus que jamais nécessaires, se sont révélés extrêmement difficiles à déchiffrer. Au cours de la décennie perdue d’Internet, nous avons réorganisé les transats sur le Titanic sous la direction inspirante des entreprises. Malheureusement, l’optimisme systémique a pris le pas sur les critiques. C'est la véritable tragédie de la critique sur Internet, faite en Europe . Où est notre résilience maintenant que nous en avons besoin ? Alors que l’attention s’est tournée vers la cryptographie, la blockchain et les systèmes de paiement, le techno-social a été négligé. Est-il possible de revenir des plateformes aux protocoles ? Est-il encore temps d’écrire du code et de créer de nouveaux scripts de connexion ? Face à l’augmentation des niveaux de détresse et de colère, nombreux sont ceux qui estiment que trop peu sera fait, trop tard. Il ne reste plus beaucoup de patience pour les diverses cérémonies bureaucratiques de consensus, maintenant que les solutions ont été à nouveau déléguées aux responsables des relations publiques, aux « marchés » et aux ingénieurs (qui ne sont pas si « neutres ») qui étaient censés résoudre le problème. .
Je n’ai aucune ambition de devenir la Cassandre de la plateforme, et je ne meurs d’envie d’écrire l’éloge funèbre de mon médium bien-aimé. Pourtant, la peur liée à sa disparition semble si répandue que son nom même est rarement évoqué en signe de respect envers le défunt. « Nous utilisons les réseaux sociaux, plus les i-… ». En 1995, Bruce Sterling, écrivain cyberpunk, avait déjà préparé le terrain avec son Dead Media Project – comme on peut s'y attendre de la part d'un auteur de science-fiction de cette trempe. Le site Internet visait à rassembler les technologies de communication obsolètes et oubliées, annotées dans un guide des échecs, des effondrements et des erreurs désastreuses des médias. Sterling et ses collaborateurs ont désormais ajouté des fonctionnalités de texte telles que telnet, Gopher et groupes de discussion à leur nécrologie de médias disparus. Tôt ou tard, Internet pourrait également être ajouté à la liste ; il est fort probable que cette nouveauté nous soit vendue au nom du progrès et du confort des utilisateurs.

Augmenter l'entropie, renverser les mèmes, faire danser et défiler les écrans toute la nuit. À l’aube, l’humanité s’inquiétera de choses plus urgentes. Certains renégats se souviendront du « court été d’Internet », suivi d’un long règne des Titans, jusqu’à ce qu’une rupture recouvre les cultures en réseau d’une épaisse couche de cendres sémiotiques, étouffant le dialogue et les échanges restants. Comme nous le rappelle Walter Benjamin dans ses Thèses sur la philosophie de l’histoire , écrites peu avant sa mort fuyant les nazis, il est de notre devoir, en tant que reporters, de réciter les actes mineurs de cet épisode marquant de l’histoire de la communication. Il nous invite ainsi à « saisir un souvenir tel qu'il surgit à l'instant du danger ». Laisser derrière nous la brève période de liberté sur Internet, avec toutes ses bizarreries et ses défauts, n’est pas le signe d’un progrès irrépressible. Il y a des tas de déchets informatiques devant nous. Il est de notre devoir de refuser de nous ranger du côté des milliardaires et d'autres dirigeants autoritaires, de lutter contre la techno-nostalgie et de poursuivre une fois de plus « notre tâche de faire passer l'histoire par le contrepoint ».
En revendiquant la fin, l'énergie est libérée pour la création de nouveaux départs.
Geert Lovink

Télécharger le texte en .pdf (english)
Je tiens à remercier Ned Rossiter, David Berry, Patricia de Vries, Nadine Roestenburg, Niels ten Oever, Chloë Arkenbout et Sabine Niederer pour leurs précieuses corrections et commentaires. Publié initialement sur networkcultures.org .
Geert Lovink : Théoricien des médias et spécialiste d'Internet. Il est l'auteur, entre autres, de Uncanny Networks (2002), Dark Fiber (2002) et Digital Nihilism. L'autre côté des plateformes (2019). Co-créateur de la liste de diffusion Nettime et d'ADILKNO ( Fondation pour l'avancement des connaissances illégales ), il fonde en 2004 l'Institut des Cultures en Réseau à l'Université des Sciences Appliquées d'Amsterdam. Pour la série Not de NERO, il a publié Le paludi della platform. Reprenons Internet .
13.05.2024 à 12:42
“Et puis, tu avais disparu” d'Arrayah Loynd
L'Autre Quotidien

Texte intégral (3692 mots)
Travaillant à partir d'archives de vieux négatifs, Arrayah Loynd invite le spectateur à une aventure luxuriante et vibrante dans l'œil de son esprit, alors qu'elle construit une alternative à la "mémoire photographique". Photographies d'Arrayah Loynd et essai de Magali Duzant.

Stall for time #1 © Arrayah Loynd
La photographe Arrayah Loynd a une longue routine dans la petite ville où elle vit depuis près de 20 ans. Tous les mercredis, elle se rendait au magasin de charité, examinait les articles et discutait avec les femmes qui s'y trouvaient. Lorsque l'Australie s'est retrouvée en situation de confinement au début de la pandémie, elle a changé de routine. Un jour, alors qu'elle allait prendre un café, elle est tombée sur deux femmes qui ont commencé à lui parler comme si elles la connaissaient.
"Normalement, je pense pouvoir le masquer, mais comme je n'avais pas l'habitude d'être isolée, j'avais un air de panique sur le visage. Et puis c'était si agréable.” Elles m'ont dit : "Oh, vous savez, de la boutique de charité". “J'ai poussé un soupir de soulagement parce que je n'avais pas à essayer de comprendre qui elles étaient. Mais je me suis demandé comment cela avait pu se produire. Je vois ces femmes toutes les semaines, mais elles étaient hors contexte, à une centaine de mètres seulement", se souvient-elle.

Object impermanence #1 © Arrayah Loynd
Le lendemain, elle est tombée sur une émission de télévision qui allait lui apporter une réponse. Le documentaire présentait un artiste qui photographiait des "super-reconnaisseurs" et leurs opposés, des personnes atteintes de prosopagnosie, également connue sous le nom de cécité faciale. Les personnes atteintes de prosopagnosie ne peuvent pas reconnaître les visages familiers et s'appuient souvent sur le contexte pour situer les personnes. Tout à coup, Loynd a trouvé un nom pour un problème qui l'avait tourmentée toute sa vie.
L'inspiration artistique se présente sous de nombreuses formes : une bribe de conversation, un souvenir, un morceau de musique, un fait divers ou un passé à exploiter et à explorer. Parfois, il s'agit d'une série de choses qui s'accumulent au fil du temps, parfois d'une comète qui traverse le ciel : un moment qui force une nouvelle compréhension du monde. Pour Loynd, le fait de mettre un nom sur son expérience a ouvert les vannes de la créativité.

Object impermanence #2 © Arrayah Loynd
La photographie est tellement associée au concept de souvenir - "des photos ou ce n'est pas arrivé" - qu'elle a donné naissance à l'expression "mémoire photographique", qui désigne la capacité à visualiser une image de mémoire avec une telle précision que l'on pourrait tout aussi bien avoir la photo dans la main. Mais que se passe-t-il si votre mémoire photographique a disparu ?
Après une conversation avec un ami qui travaillait avec la photographie analogique, Loynd a décidé de revoir ses vieux négatifs. "Des étincelles se sont allumées dans mon esprit. Je me suis dit que c'était ce que j'allais faire et que j'étais prête à le faire", se souvient-elle. "Les négatifs étaient tous des ratés, ceux que l'on jette. Ils étaient tous flous, sous-exposés ou surexposés ; il y en avait certains dont on ne pouvait pas faire d'images. Ces bouts d'images et ces moments allaient devenir les éléments constitutifs du projet de Loynd. "Les gens parlent toujours de mémoire photographique. Mais pour moi, ce n'est pas le cas. J'ai l'inverse avec la prosopagnosie, l'impermanence des objets et mon diagnostic de neurodivergence. C'est un énorme désordre dans ma tête, et rien n'est linéaire, rien n'est bloqué. Ma mémoire est en désordre".

Sparkly things © Arrayah Loynd
C'est justement ce "fouillis" qui rend l'œuvre si séduisante. Les images de Loynd marchent sur la corde raide entre la simplicité austère et la richesse des détails, regorgeant de textures et de superbes lavis de couleurs vives. En parcourant les photographies, on est poussé entre le silence et le bruit. On a l'impression que les souvenirs remontent à la surface et rencontrent des moments du présent. Les photographies défilent devant les yeux et parcourent l'esprit : un manteau à motif pied-de-poule, une jambe tendue, une main coupée, une multitude de lumières qui se lisent comme des lucioles radioactives.
"C'est l'expression la plus pure de ce que c'est que d'être dans mon esprit", explique-t-elle. Et puis vous avez disparu. Lorsqu'il est lu à haute voix, le titre du projet traduit également ce sentiment, suscitant la sensation physique de "cligner des yeux et on le rate" ou le rapide retournement de tête qui signale une perplexité momentanée. Qui ou quoi était-ce ? Où est-il passé ?

Beyond my control © Arrayah Loynd
Les photographies de Loynd sont présentées sous forme de diptyques, un format qu'elle a déjà utilisé par le passé pour la manière dont les images communiquent entre elles. Elle a commencé son travail en prenant des photos d'elle-même en tenant les négatifs devant différentes sources de lumière, que ce soit devant un téléviseur, vers le ciel ou contre des arbres.
"Je travaille de manière obsessionnelle et assez rapide lorsque je suis accrochée à une idée. Beaucoup de ces images sont très directes, à l'exception des inclusions de couleurs. Pour d'autres, j'ai utilisé beaucoup de matériel d'archives pour intégrer des portraits ou des corps, mais la majorité des images sont des négatifs", explique-t-elle. "Elles ont l'air hautement traitées, mais ce n'est pas le cas. Je vois le monde d'une manière presque électrifiée et intense, et j'adore la couleur. Je me lance à fond dans la création. C'est un mécanisme qui me permet de traiter les choses que je ne peux pas traiter en interne.”

Imprinting onto my mind © Arrayah Loynd
Pour la photographe, le fait de mieux comprendre comment et pourquoi elle voit le monde comme elle le fait a été libérateur sur le plan créatif. "Cela m'a permis d'être honnête. Chaque fois que je publie un travail qui est assez vulnérable, je peux le masquer de moins en moins parce qu'il est publié. Je n'ai pas besoin d'expliquer tout le temps", explique Loynd. "Les gens n'ont qu'à regarder mon travail et à lire mes mots. Je me comprends mieux, mais je comprends aussi mieux les gens qui font partie de ma vie. C'est comme si un poids était enlevé chaque fois que vous expliquez quelque chose sur vous-même de cette manière. Lorsque j'ai commencé à tourner la caméra vers moi, j'ai laissé tomber tous ces sentiments d'inadéquation parce que personne ne pouvait me dire que quelque chose n'allait pas, parce qu'il s'agissait de moi".
En s'investissant pleinement dans cette série, Arrayah Loynd a créé un ensemble d'œuvres qui, bien qu'elles soient construites à partir d'images passées, ont l'effet irrésistible d'une immédiateté chatoyante et intuitive.
La série d'Arrayah Loynd, And Then You Were Gone, a remporté le deuxième prix du LensCulture Art Photography Awards 2024. Nous vous encourageons à découvrir tous les autres gagnants et finalistes - le travail inspirant de 40 photographes travaillant dans 19 pays sur six continents.
Magali Duzant pour Lens Culture, édité par la rédaction le 15/05/2024
Arrayah Loynd - Et puis, tu avais disparu/And Then You Were Gone

In the right context © Arrayah Loynd
13.05.2024 à 11:59
Inspirations #64
L'Autre Quotidien

Texte intégral (645 mots)

Victor Burgin, “Any Moment,” (1970). Lire notre article.
L’air du temps
Arab Strap - Here Comes Comus !

Le haïku de dés
Une chenille -
Je voudrais survivre
Même en rampant par terre.
Sumitaku Kenshin
L'éternel proverbe
La pierre s'érode, l'homme ne change pas.
Proverbe yéménite
Les mots qui parlent
Regarder n'est pas indifférent. Il ne peut jamais être question de "simplement regarder".
Victor Burgin

Victor Burgin, “Any Moment,” (1970). Lire notre article.
13.05.2024 à 11:58
Quand la conquête spatiale s'avère plus que spéciale, voici son histoire
L'Autre Quotidien
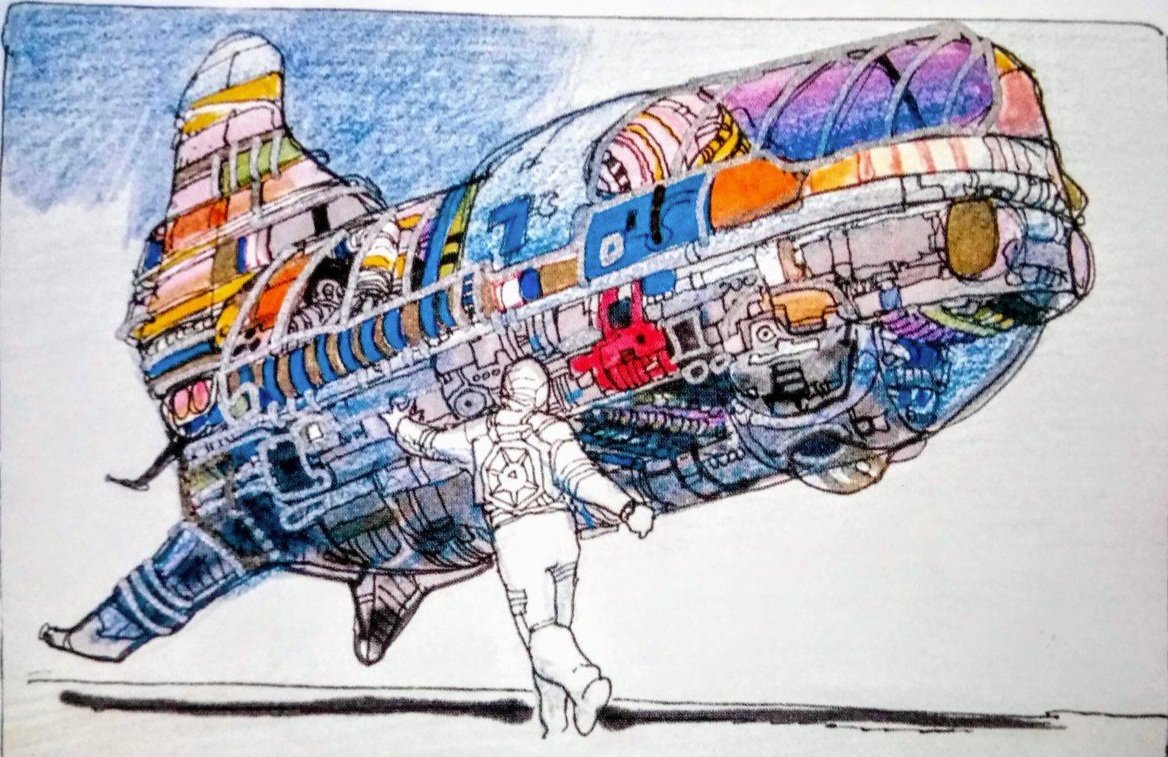
Texte intégral (4975 mots)
Décapante et ultra-documentée, une histoire de la conquête spatiale qui met à mal les récits dominants militaristes et capitalistes, comme la vraie-fausse mystique humaniste et scientifique dont ils aiment à déployer le charme fumigène autour d’eux

16 novembre 2022, Cap Canaveral, Floride. La fusée Space Launch System (SLS) de la NASA décolle devant une foule de 100 000 à 200 000 fans dont les caméras scrutent le pas de tir, après une première tentative avortée à l’été et plusieurs reports. Culminant à 98 mètres de hauteur pour 2 628 tonnes au décollage, le SLS est littéralement un monstre et, pour quelques mois encore, la plus grosse fusée du monde. Véritable relique de la Guerre froide (qui hérite des moteurs-fusées et des propulseurs à poudre de la navette spatiale, à la retraite depuis 2011), elle est une pièce essentielle du programme Artemis dont l’objectif est de ramener un équipage sur le sol lunaire d’ici 2025 – en plusieurs étapes. Un tremplin vers la planète rouge peut-être, et surtout un écho non dissimulé au programme Apollo, dont Artémis, fille de Zeus, est la soeur jumelle. A ce moment cependant, la mégafusée n’est pas encore habitée : le seul passager à bord de la capsule Orion (conçue par Lockheed Martin) qui la coiffe est un mannequin bardé de capteurs qui mesureront les effets de l’accélération au décollage et de la décélération lors de la rentrée atmosphérique, après 25 jours de mission dans l’espace et un survol de la Lune. L’événement prend indéniablement des allures de remake d’une séquence qui s’est étalée sur la décennie 1960, avec à son paroxysme les premiers pas de Neil Armstrong et Edwin « Buzz » Aldrin sur l’astre sélène le 21 juillet 1969.
On relève cependant au moins trois différences notables qui singularisent la période actuelle. D’abord, la concurrence n’est plus la même. La Chine s’est substituée à l’URSS, avec le programme Chang’e – double maléfique d’Artemis aux yeux des États-uniens – dont l’objectif est là aussi ambitieux : poser des « Taïkonautes » sur la Lune officiellement en 2029, pour le 80e anniversaire de la République populaire de Chine. Deuxième différence : la place des acteurs privés. Aux États-Unis surtout qui, en plus de la kyrielle de sous-traitants contribuant au programme, pourraient compter sur l’apport du vaisseau Starship de la société SpaceX pour mener à bien la mission vers la Lune. L’explosion en vol du vaisseau le 20 avril 2023 – date à laquelle il a volé au SLS le titre de plus grosse fusée du monde – laisse cependant planer un doute sur sa fiabilité : des concurrents pourraient le remplacer. Dans tous les cas, la NASA ne récolterait pas seule les fruits symboliques d’une nouvelle épopée lunaire, mais les partagerait avec certains protagonistes du « New Space », nouvelle phase de l’histoire du spatial, qui voit l’émergence d’acteurs privés supposés dynamiser un secteur encroûté. Troisième différence : il ne serait plus question de fouler la lune quelques instants – disons le temps d’une partie de golf – mais bien de s’y installer. D’y bâtir des bases, d’y miner des métaux, bref, d’aller au bout d’un processus resté inachevé au détour des années 1970, alors que les budgets lunaires s’évaporaient aux États-Unis. De quoi relancer dans un mélancolique élan rétrofuturiste une « conquête » spatiale trop longtemps mise au rebut, au regret de toute une communauté d’amateurs de l’espace (les « space enthusiasts ») lassés des atermoiements et coupures budgétaires. En 2022, le coût estimé du programme Artemis était évalué à 93 milliards de dollars (en comptant SLS et Orion) pour la période 2012-2025 : l’effort économique consenti par les États-Unis est énorme.
Bien sûr, cette lecture des affaires spatiales comporte quelques limites. La Chine n’est pas l’URSS, et les acteurs du New Space censés « privatiser » l’espace sont moins nouveaux qu’ils n’en ont l’air : ils s’inscrivent plutôt dans un projet marchand débuté dès les années 1960. L’occupation humaine de l’espace en revanche (le « vol habité ») concentre encore et toujours une bonne partie des commentaires dans la presse généraliste, quand bien même elle ne représente que la partie émergée des activités entrant dans la case « astronautique ». Cette diversion s’est illustrée dès la création de la NASA en 1958. La « course à la Lune » est alors érigée en spectacle pop par un président Kennedy qui cherche à démontrer la suprématie technologique et idéologique de l’Amérique contre l’URSS. Les deux Blocs s’affrontent ainsi sur une scène géostratégique et spectaculaire, rythmée par les grandes premières des astronautes et cosmonautes. Au même moment pourtant, les malins génies des armées planchent sur le scénario de « l’holocauste nucléaire » et font exploser des bombes atomiques dans l’espace. Et alors que la foule regarde le ciel, les fusées sont bien plus nombreuses sous terre, prêtes à transporter leurs charges nucléaires vers l’ennemi.
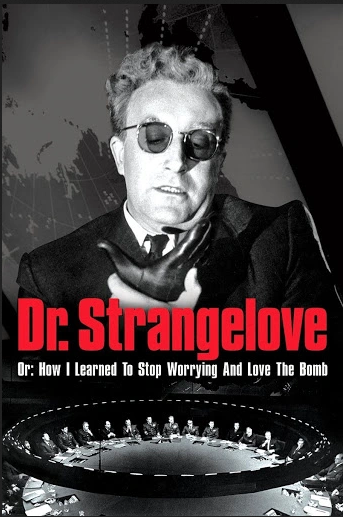
Publié en février 2024 à La Fabrique, l’ouvrage salutaire de Irénée Régnauld et d’Arnaud Saint-Martin manquait cruellement à l’histoire française contemporaine des sciences et techniques – et de leur contenu de facto éminemment politique. Comme le souligne aussitôt le sous-titre, à dessein légèrement provocateur (« Des fusées nazies aux astrocapitalistes du New Space »), cette histoire-là de la conquête spatiale n’entend pas s’en laisser conter par toutes les voix si promptes à défendre vivement, dans l’ordre ou le désordre, destinée manifeste et rêve étoilé, profits mirifiques envisageables et nécessités de la défense nationale, ou encore retombées technologiques civiles et sauvegarde d’un mode de vie fossile et extractiviste si gourmand en ressources que notre bonne vieille Terre ne pourra plus longtemps produire.
Il était important de rappeler – et de documenter soigneusement, ce que permettent bien les 40 pages de notes serrées et de sources détaillées en fin d’ouvrage -, d’abord, les péchés originels de l’idéologie dominante de la conquête spatiale : des racines nazies jamais véritablement digérées, dont l’inquiétante figure de Wernher von Braun constitue le principal – mais non le seul, loin de là – emblème, tel qu’il trônait dès 1964 au cœur de l’immense « Dr. Folamour » de Stanley Kubrick, ou tel qu’il était distillé dans le précieux « Mojave épiphanie » d’Ewen Chardronnet en 2016, mais aussi une inscription forte et précoce au sein d’un combat prétendûment technologique dont les enjeux sont avant tout idéologiques et financiers (affrontement du « capitalisme » et du « communisme » dont bénéficient d’abord les actionnaires – ou équivalents – des complexes militaro-industriels respectifs des deux camps en présence – que l’on songe au tableau incisif dépeint par exemple par un Kim Stanley Robinson dans « La Côte Dorée » en 1988, et davantage encore aux satires incisives conduites par le Barry N. Malzberg – celui-là même qui avait dû démissionner de la rédaction en chef de la revue des auteurs de science-fiction américains (SFWA) après un éditorial de 1969 critiquant la NASA… – de « Apollo, et après ? » en 1972, côté américain, ou par le Viktor Pelevine de « Omon Ra » – que l’on rêverait de voir un jour réédité – en 1992, côté soviétique).
Un drapeau étoilé sur la Lune ou le fantasme martien réitéré d’un milliardaire mégalomane ne devraient pas pouvoir faire oublier aussi aisément, in fine, les tunnels concentrationnaires de Dora dont ils sont assez directement issus : Irénée Régnauld et Arnaud Saint-Martin nous le rappellent avec une insistance salutaire.
À rebours de l’histoire classique des technologies spatiales, faite par et pour les convaincus, la trame que nous proposons assume un cadrage politique d’ensemble. Il s’agira de mettre en série des faits établis dans les recherches historiques récentes, mais souvent ignorés de l’histoire des « affaires spatiales » – et pour cause, ces faits étaient encore classés « secret-défense » il y a encore peu de temps, ou bien étaient confidentiels car mettant en jeu des secrets industriels. À cette fin, nous documenterons et synthétiserons les histoires spatiales en passant par des éléments biographiques, l’histoire des programmes emblématiques, et d’autres programmes passés sous les radars. Ce travail permet de lever le voile sur le cours des événements, comme on gratterait un palimpseste : un parchemin où les couches d’écriture ont été superposées les unes aux autres, de sorte que toute profondeur historique est masquée. Or ce sont bien les continuités que nous nous efforcerons de révéler. Aussi, ce livre donne une place importante aux sources que nous mobilisons, et laisse la possibilité au lecteur d’aller butiner plus en détail dans notre frise : d’autres ouvrages ont documenté plus précisément certains de ces détails dans des champs aussi divers que l’astroculture, l’espionnage ou encore la conquête de Mars.
L’histoire que nous brossons permet d’appréhender ce paradigme de la conquête de l’espace sous un angle critique, de déconstruire les discours d’enchantement et de reconstituer les dynamiques de fabrication d’une évidence spatiale en tout point conforme aux récits de science-fiction utopiques. On constatera à ce titre que les « rêves » de l’astronautique n’ont rien d’universel ni d’assuré : non seulement ils bénéficient à certains plus qu’à d’autres mais en plus, la plupart du temps, ils ne se réalisent pas, à l’instar de la conquête de Mars. Les arguments qui soutiennent cette « évidence spatiale », apportés sur un plateau par les porte-parole des organisations et lobbies du champ de l’astronautique (l’espace, ce serait l’esprit d’aventure, et/ou la science, et/ou la croissance sans limites, ou encore une quête spirituelle, etc.), tournent souvent à vide et n’emportent in fine l’adhésion qu’au prix de malentendus durables et de récits tronqués. L’attester demande d’interrompre le cycle de la croyance, tellement exacerbée dans le cas des vols habités, dont l’industrie anime les communautés de passionnés se disant prêts à sacrifier leur vie à la conquête du cosmos.

Il fallait ensuite montrer dans toute leur ampleur les programmes de propagande directe ou indirecte qui ont environné dès l’origine ou presque le récit projeté de la conquête spatiale.
À travers son choix de figures publiques ou un peu moins publiques mais toujours hautement significatives, parmi lesquelles se distinguait, au premier rang, l’astronaute Neil Armstrong, Hugues Jallon nous écrivait, avec ce mélange détonant d’humour noir et de sérieux tongue in cheek qui le caractérise au moins depuis « Zone de combat » et « Le début de quelque chose », en quoi pouvait consister « La conquête des cœurs et des esprits » (2015) en la matière et ailleurs. Irénée Régnauld et Arnaud Saint-Martin ont su décrypter pour nous, un peu à marches forcées dans leur deuxième chapitre, l’incroyable disneylandisation de l’astrofuturisme à laquelle se sont prêtées aussi bien la science-fiction des « space enthusiasts » que sa version édulcorée à destination d’un plus grand public à convertir.
On ne soulignera d’ailleurs jamais assez l’importance dans ce domaine, au tournant dangereux et décevant (du point de vue du complexe militaro-spatial) des années post-Apollo avant l’arrivée au pouvoir de Ronald Reagan, d’un Jerry Pournelle, ingénieur aéronautique de haut niveau chez Boeing et chez Rockwell pendant plus de trente ans, reconverti en auteur de survivalisme et de science-fiction à succès (même s’il n’y atteindra jamais la renommée mondiale de son ami Larry Niven, il fut tout de même président de la SFWA sus-citée en 1973) et en influenceur politique (défendant des vues qu’il qualifiait lui-même de paléo-conservatisme) – on lui doit notamment la création et l’animation du Citizen’s Advisory Council on National Space Policy, think tank très actif dans les années 1980 (jusqu’à rédiger une grande partie des discours de Reagan à propos de l’Initiative de Défense Stratégique, plus connue, justement, sous son surnom de guerre des étoiles), dans lequel il était parvenu à enrôler, au côté d’astronautes et de militaires de haut rang retraités, ainsi que de cadres dirigeants de l’aéronautique et des industries de défense, des auteurs beaucoup plus influents que lui auprès du lectorat, tels que Poul Anderson, Greg Bear, Robert A. Heinlein, Gregory Benford ou encore – naturellement – Larry Niven.
Les chapitres III et IV se concentrent sur le lien indéfectible, au fil des années comme aujourd’hui, entre l’espace (même marketé comme « civil ») et les militaires des grandes puissances, ainsi que sur la marchandisation de moins en moins rampante qui, sous couvert d’initiative privée, est néanmoins alimentée principalement par la dépense publique (les chiffres en sont particulièrement édifiants). Là comme ailleurs, la sorcellerie capitaliste du partenariat public-privé, affectant à long terme le profit au privé et la perte ou le risque au public, opère à plein régime.
Le chapitre V est celui qui permet de laisser résonner (discrètement toutefois) une forme d’espoir dans cette histoire toute de doom & gloom. : oui, en matière d’espace, chez les scientifiques comme chez les praticiens, chez les politiques comme chez les autrices et auteurs de science-fiction ou de vulgarisation fictionnelle, il a existé et il existe des pratiques qui se démarquent nettement de cette pente cruelle (et pas uniquement, bien sûr, en renommant les faits et les choses, ou en adoucissant certains angles trop saillants et donc trop visibles – ce dont l’industrie des relations publiques attachée de près ou de loin au « Militainment Inc. » – pour reprendre le titre d’un ouvrage de Roger Stahl – s’est fait une spécialité au fil des années). C’est bien ici, aux côtés des actions presque enchantées telles que celle de l’Association des Astronautes Autonomes et de quelques autres , que l’on trouvera les ferments actifs d’une conception de l’espace qui ne soit pas que conquête (même déguisée) – et qui, à l’image de l’évolution d’un Kim Stanley Robinson sur ce thème, de « La trilogie martienne » à « 2312 » puis à « Aurora », sache concilier curiosité scientifique authentique et sens des priorités planétaires actuelles.
L’ouvrage est en tous points remarquable, et vous captivera même si vous croyez ne vous intéresser ni à l’espace ni à la science-fiction, soyez-en sûres et sûrs.
En marge du paradigme de la conquête de l’espace, de ses discours d’accompagnement propagandistes, de la longue histoire militaire dans laquelle il s’inscrit et des incessantes tentatives de marchandisation du milieu, des pratiques scientifiques, des critiques et des contre-récits ont de longue date émergé. Ceux-ci ébranlent l’idée préconçue d’un désir d’espace uniforme et consensuel, à rebours d’une doxa qui a non seulement imposé une lecture trop apaisée de l’histoire de l’astronautique, mais a aussi arbitrairement dessiné son futur. Car les utopies cosmiques et expansionnistes ont la vie dure, dans les discours des multimilliardaires perfusés à la science-fiction comme dans les effets d’annonce des agences et des industriels qui peinent à s’en extirper, voire cultivent le flou si cela peut concourir à légitimer certaines de leurs activités. Le caractère performatif de ces récits imposés est tout relatif – nous avons pu voir que l’économie de l’espace, par exemple, repose en grande partie sur la commande publique – mais ces derniers n’en demeurent pas moins dominants, au point d’écraser tous les autres. C’est pourquoi un travail de dévoilement d’autres espaces – d’actions et de réflexions – est nécessaire.
Ce travail implique en premier lieu de ne pas sacrifier les technologies du spatial sur l’autel de leur histoire contrariée. L’historienne et sociologue des sciences Susan Lindee a bien montré que l’essor des sciences et des techniques modernes tire souvent ses racines des guerres, véritables « laboratoires » venant alimenter accidentellement l’accroissement des connaissances en produisant çà et là ce qu’elle nomme des « données collatérales » (en référence aux « dommages collatéraux »). Ainsi en va-t-il, entre autres choses, des industries chimique et biologique (dont les usages militaires ont été traumatisants), du nucléaire (de la bombe à la centrale), de la balistique, de la statistique ou encore de l’astronautique. Il n’y a dans ce constat aucune fatalité bien sûr, et encore moins matière à légitimer la guerre elle-même : les progrès scientifiques peuvent tout à fait s’en passer. De même que Lindee fait de l’étude de ces laboratoires une contribution plus générale à l’histoire des sciences, nous avons froidement documenté celle de l’astronautique et souligné sa violence. Il nous faut tout aussi froidement rappeler l’importance capitale du milieu et des technologies spatiales dans le monde qui est le nôtre. Non pas dans l’idée d’applaudir l’ensemble des usages qui en découlent (par exemple, l’accélération des flux marchands ou militaires permise par les « mégaconstellations »), mais avant tout pour redire son intérêt scientifique. À double titre : celui d’une quête de connaissance qui concerne notre univers mais aussi l’amélioration de notre compréhension du changement climatique dont les satellites fournissent des preuves cruciales. Ces activités essentielles ne continueront pas à se faire sans fusées, sans bases de lancement ni sans les savoir-faire des ingénieurs qui bâtissent et maintiennent ces systèmes techniques.
Cet ultime chapitre fournira aussi des éléments pour une histoire davantage sociale et culturelle de l’espace. Une histoire ponctuée de critiques, mais également d’imaginaires sociotechniques qui tranchent avec les récits de conquête et les velléités de colonisation d’espaces vierges dans le registre du Far West. Nous ne devrions pas doucher les rêves d’exploration et de contemplation de l’espace au prétexte qu’ils ont été happés par la rhétorique des astrocapitalistes. Ils n’en sont pas les dépositaires. D’autres perspectives culturelles, d’autres cosmologies leur ont fait face et continuent de le faire, dans des domaines aussi variés que l’ingénierie, la lutte pour la démilitarisation, la culture populaire, la science-fiction ou les revendications décoloniales.
Hugues Charybde, le 15/05/2024
Irénée Regnauld et Arnaud Saint-Martin - Une histoire de la conquête spatiale - Des fusées nazies aux astrocapitalistes du New Space - La Fabrique éditions
L’acheter chez Charybde ici

06.05.2024 à 12:34
Flûte, un nouveau Shabaka, avec moins de saxo, mais plus de convives
L'Autre Quotidien

Texte intégral (1660 mots)
J’aurais aimé faire une chronique croisée de Kamasi (Washington) et de Shabaka( Hutchings) - mais comme le premier me tombe des oreilles, c’est du second qu’on va surligner quelques attraits. Le saxophone ténor de Shabaka n'apparaît qu'une seule fois sur cet album ; une dizaine de minutes avant la fin. L’idée de changer de trajectoire se posant là pour renouveler le propos.
Après sa décision de 2023 d’abandonner son ténor, suite à un sentiment d'épuisement dû à un calendrier de tournées chargé qui l'a maintenu "sur la route en traitant constamment l'exécution d'une pratique spirituelle comme une marchandise à vendre de manière répétée" ; voici donc surgir une quête pour générer "de l'énergie sans tension", qui l'a plutôt conduit vers diverses flûtes, dont le shakuhachi japonais et la clarinette, son instrument d'origine et, à ses yeux, son principal instrument. Mais un album de Shabaka presque sans ténor peut-il avoir le même impact que ses précédents ? La réponse est oui, absolument, et c'est principalement parce que sur Perceive Its Beauty, Acknowledge Its Grace, la première déclaration complète de l'artiste dans cette veine, après un EP de 2022, Afrikan Culture, Shabaka n'a pas simplement remplacé un instrument signature par un autre ; au contraire, il a refait sa musique de fond en comble.
Les travaux antérieurs de Shabaka tenaient autant de la dance music que du jazz. On ne peut s'empêcher de bouger sur l'électro-funk entêtant de Comet Is Coming, sur les puissants grooves afro-caribéens de Sons of Kemet, ou sur les échanges intercontinentaux richement stratifiés de Shabaka and the Ancestors. Perceive Its Beauty, en revanche, se concentre sur la tranquillité, un sentiment de communion méditative avec une variété de chanteurs et d'instrumentistes invités. Bien entendu, Shabaka n'est pas le seul musicien à penser de la sorte ces derniers temps. New Blue Sun, l'album d'André 3000, qui fait appel à la flûte et au shakuhachi de Shabaka, a marqué l'arrivée dans le grand public d'une vague qui n'a cessé de s'amplifier au cours de la dernière décennie et qui s'appuie sur divers sons en quête des années 1970, d'Alice Coltrane à Steve Reich en passant par Pharoah Sanders, Brian Eno et les New Agers de la presse privée comme Iasos - ont tourbillonné ensemble dans un panache d'encens, traversant les décennies pour informer les artistes travaillant dans et autour du jazz, de la musique électronique, et plus encore. Voilà pour l’arrière-plan.
Mais, malgré un chevauchement significatif du personnel entre Perceive Its Beauty et New Blue Sun-André lui-même apparaît sur une piste ici, tout comme son collaborateur de New Blue Sun Surya Botofasina, tandis que le catalyseur créatif de ce projet, Carlos Niño, apparaît tout au long de l'album, les deux albums ont peu en commun. Alors que New Blue Sun proposait des environnements sonores tentaculaires, Perceive Its Beauty présente des épisodes plus ciblés, judicieusement séquencés pour passer de l'abstraction et de l'espace à la pulsation et au rythme, et vice-versa. (Il faut aussi le dire : En tant qu'instrumentiste, André 3000 est un fier novice, tandis que Shabaka est un praticien de formation classique avec des années d'expérience professionnelle et un profond dévouement à l'art).
Le défilé de stars invitées sur l'album pourrait sembler une distraction si chacun de ces artistes n'était pas si bien intégré à la vision globale de Shabaka. Le premier morceau, "End of Innocence", et le cinquième, "The Wounded Need to Be Replenished", sont interprétés par des pianistes différents (respectivement Jason Moran, connu pour ses brillantes réimaginations de l'histoire du jazz, et Nduduzo Makhathini, chef d'orchestre sud-africain et membre des Ancestors), mais chacun d'eux atteint une beauté pensive similaire. Sur le premier, la clarinette de Shabaka trace des arcs liquides sur les textures sombres et abstraites de Moran et du batteur Nasheet Waits, tandis que sur le second, la flûte du leader flotte parmi les phrases dépouillées de Makhathini, les percussions de Niño et le synthé de Botofasina renforçant l'impression de suspension aqueuse. Dans les deux cas, même si le ton de Shabaka sur ces instruments diffère de ses projections d'acier au ténor, l'équilibre artistique de son phrasé reste totalement intact.
Parmi les nombreuses pistes vocales de l'album, les plus émouvantes sont celles qui traitent les chanteurs invités comme des instrumentistes à part entière. Sur "Insecurities", Moses Sumney semble canaliser le timbre de la flûte de Shabaka en rejoignant le leader et le harpiste Charles Overton avec des lignes sans paroles. Sur "Kiss Me Before I Forget", Lianne La Havas mêle sa voix à la clarinette de Shabaka, créant un charmant tressage de tons, et sur "Living", le chant multipiste d'Eska Mtungwazi s'unit aux cordes de Miguel Atwood-Ferguson pour créer une ambiance orchestrale luxuriante.
Les morceaux mettant en scène les poètes Saul Williams (qui contribue par un monologue serein à "Managing My Breath, What Fear Had Become") et Anum Iyapo (le père de Shabaka, qui déclame tendrement sur le dernier morceau de l'album "Song of the Motherland", faisant référence au titre de son propre album de 1985), ainsi que le rappeur Elucid (qui apporte des vers incisifs à "Body to Inhabit") semblent un peu moins interactifs, les voix étant placées à l'avant de l'ensemble. Mais chaque morceau laisse place à une interaction fascinante entre la flûte de Shabaka et la harpe de Charles Overton, avec Brandee Younger, une harpiste qui a apporté à l'instrument une nouvelle vague d'attention dans le jazz ces dernières années, ajoutant à la richesse de "Body to Inhabit", ainsi qu'Esperanza Spalding, qui contribue à une ligne de basse insistante. Sur "I'll Do Whatever You Want", la flûte d'André 3000 a moins d'impact que le producteur Floating Points, qui donne au morceau sa pulsation de synthé psychédélique, et le précurseur de l'ambient Laraaji, qui ajoute des excursions vocales drolatiques et un rire caractéristique à la fin.
Au milieu de ce personnel changeant, c'est l'assurance de la vision de Shabaka et la puissance de son jeu qui laissent l'impression la plus forte ( en gros, objectif atteint!) . Tout au long de Perceive Its Beauty, on l'entend sortir avec assurance des frontières non seulement du jazz, mais aussi de tout genre facilement défini, et trouver une base solide. En écoutant un morceau qui défie les catégories comme "As the Planets and the Stars Collapse" - un autre instrumental remarquable, avec son lit luxuriant de harpes et de cordes, et Shabaka soufflant dans sa flûte avec autant de muscle que de grâce - on ne regrette pas le moins du monde le ténor brillant et bruyant, ou le son d'ensemble inimitable d'un groupe tel que Sons of Kemet. L'incarnation est peut-être nouvelle, mais l'esprit sous-jacent de la musique, sa force d'animation, est tout à fait la même. Evolution bienvenue qui rouvre d’autres et plus méconnues thématique au Spiritual Jazz, mais vu d’ici et maintenant. Bon plan !
Jean- Pierre Simard, le 8/05/2024
Shabaka Hutchings - Perceive Its Beauty, Acknowledge Its Grace - Impulse

06.05.2024 à 11:14
L'Altar Ninho Cabin par Natulareza Urbana envisage autrement l'hôtellerie
L'Autre Quotidien

Texte intégral (3614 mots)
Ninho est le dernier résultat du partenariat entre Altar et Natureza Urbana, unissant leurs efforts pour créer un refuge immergé dans les paysages naturels de la Serra da Mantiqueira. Destiné à offrir une expérience unique d'hébergement et de décompression, le projet suit le principe d'Altar consistant à construire des hôtels décentralisés connectés à la nature, au style glamping et à tirer parti de la technologie pour promouvoir des pratiques durables dans les opérations hôtelières.


La collaboration entre les entreprises suit la ligne de petits espaces « O Altar » de Tok&Stok, lancée en 2022, qui comprend des meubles, des objets et des objets de décoration signés Natureza Urbana. Parallèlement, la conception, les projets de base et d'exécution et le suivi de la construction de Ninho étaient en cours d'élaboration, dans un processus qui a abouti au début de ses opérations en juillet 2023.

Située à la Fazenda Pedra Alta, à Joanópolis-SP, la maison est stratégiquement proche de deux autres unités d'autel : la Flutuante, ancrée dans les eaux du réservoir de Joanópolis, et la Prainha, avec la plus grande superficie parmi les opérations de l'entreprise. L'organisation spatiale permet une dynamique d'intégration entre les maisons tout en respectant l'intimité et l'expérience de décompression inhérente à chacun.

Le cadre de la cabane Altar Ninho est la grande différence, car elle est située au sommet d'un terrain en pente et élevée à 4 mètres du sol, créant une image et un champ affectif corrélatifs à la cabane dans les arbres. Les deux lits sont positionnés à côté d'une grande ouverture, qui donne à l'espace de repos de belles vues sur le réservoir, et rejoignent d'autres environnements fonctionnels, de vie et de contemplation, internes et externes, valorisant les visuels libres et améliorant l'expérience d'immersion.

À la recherche d'une volumétrie rationnelle et innovante, le projet exprime la matérialisation d'un design et de matériaux simples et sophistiqués, capables de promouvoir l'intégration entre l'architecture et l'environnement et de placer la nature et ses éléments comme protagonistes des espaces et des expériences. Le résultat est un refuge unique, un refuge de pratiques d'immersion et de connexion avec la nature, de bien-être et de reconnexion à soi.

Il s'agit d'un domaine de recherche d'un grand intérêt pour Natureza Urbana, qui cherche à établir dans ses pratiques la responsabilité à l'égard du territoire. Considérer le lieu comme faisant partie d'un système vivant et complexe, reconnaître ses vocations et ses pouvoirs et promouvoir des solutions pour minimiser l'impact des actions humaines, sont quelques-unes des prémisses du Regenerative Design. Si le développement est l'utilisation de ressources pour améliorer la qualité de vie d'une société (Gabel, 2005), les pratiques régénératives se présentent comme la prochaine étape vers la durabilité, déjà insuffisante, en appliquant des ressources pour améliorer la qualité de vie et constituer des capacités de régénération. et le maintien des conditions nécessaires à l'évolution des éléments vivants, humains ou non.

La conception, dans ce cas, se développe à partir de la préfabrication des principaux éléments de la maison - la structure métallique, les solutions de façade et les fermetures - qui ont été transportés en un seul voyage et rapidement mis en œuvre dès leur arrivée sur le chantier. Élevé sur des colonnes métalliques - ce qui garantit un impact minimal au sol - et accompagné d'une généreuse terrasse en bois naturel, l'abri rassemble dans 20 m² les programmes de vie, cuisine et chambre dans un environnement unique, à côté de toilettes naturellement éclairées par une ouverture zénithale. Dans l'environnement extérieur, les clients profitent d'un espace de loisirs avec des meubles, une douche et un espace pour faire un feu de joie et contempler les belles vues.


Parmi l'eau, la végétation abondante et d'autres éléments naturels du paysage, Ninho apparaît comme un abri élevé jusqu'à la cime des arbres, avec une volumétrie sobre et intéressante. Il rassemble des éléments de façade, des ouvertures stratégiques et des solutions d'éclairage et de confort thermique, dans un ensemble d'attributs chargés de maximiser l'expérience du visiteur et d'assurer la transformation des espaces de manière consciente et responsable.

Cabanes et lodges, Architecture résidentielle • Joanópolis, Brésil
Architectes : Naturaleza Urbana
Superficie : 40 m²
Année : 2023
Photographies : Maira Acayaba
Architectes principaux : Pedro Lira, Manoela Machado, Pedro Borba
Équipe : Breno Pilot, Julia Ximenes, Maria Luiza Torres
Stagiaire en architecture : Luan Neske, Maria Caterina Di Spigna
Ingénierie et construction : cubiqueset Conseil en aménagement paysager : Gabriella Ornaghi Arquitetura da Paisagem Ville: Joanópolis Pays : Brésil
Edité par la rédaction, le 8/05/2024
06.05.2024 à 11:06
“Freak Parade” : les monstres d’Hollywood ne sont pas ceux que l’on croit
L'Autre Quotidien

Texte intégral (1511 mots)
Relecture ambitieuse et malicieuse de Freaks, le film culte de Tod Browning, cet album revisite le mythe en imaginant les coulisses de cette œuvre majeure du merveilleux moderne. Remise en ligne de cet article & de la rencontre en vidéo avec Joëlle Jolivet & Fabrice Colin pour parler des coulisses de Freak Parade.

Si vous n’avez jamais vu le film La Monstrueuse Parade (ou Freaks en V.O.) sorti en 1932, je vous le conseille vivement, mais avec une mise en garde, ce n’est pas pour tous les publics et vous devez vous attendre à un long-métrage étrange à la fois féérique & monstrueux, enchanteur & trivial, saisissant & terrifiant. Une histoire d’amour, de vengeance et d’acceptation de soi où les monstres ne sont pas toujours ceux qu’on imagine.
C’est le cas de Fabrice Colin & Joëlle Jolivet qui en imaginent les coulisses et les mystères entourant ce tournage qui a marqué Hollywood dans l’entre-deux guerre. En appuyant sur l’autre grande particularité de ce film : la mise en scène de personnes qui ne sont pas des acteurs. Même si beaucoup ont l’habitude de la scène, ces comédiens improvisés ont été recrutés pour leurs physiques ou leurs particularités. On y croisera aussi les éminences noires du showbiz portant dans leurs sillons affaires de mœurs, de drogues ou de corruption, l’industrie du cinéma reste loin du conte de fées des magazines. La bande dessinée exprime à merveille cette dualité d’un film atypique, de cette réunion de talents et de personnalités qui tourne au récit initiatique pour le spectateur/lecteur, que nous vivons à travers les yeux de son héros curieux Harry Monroe.
Un réalisateur a écumé les USA pour rassembler des “freaks” des personnes présentant des malformations physiques, des particularités qui les ont conduits à se produire dans des cirques ou d’être présentés comme monstres de foires. Avec ce casting jamais vu et jamais revu dans l’histoire du cinéma, le film n’a pas fait l’unanimité à sa sortie effrayant les spectateurs et signant la fin de la carrière de son mystérieux réalisateur. Pourtant cette fiction qui ne ressemble à aucune autre va être redécouverte et acquérir le statut d’œuvre culte, de jalon important dans l’histoire du cinéma et de référence créative pour bon nombre d’artistes.
Romancier prolifique et scénariste Fabrice Colin s’était déjà illustré en bande dessinée sur quelques “monstres” avec la Brigade chimérique ou sur les ombres de l’industrie du spectacle avec Nowhere Island ou Gordo.
Au dessin, Joëlle Jolivet, illustratrice qui signe son premier projet de BD après plusieurs dizaines de livres jeunesses dont le très prisé en librairies Costumes ou plus décalés comme Os court ! & 10 p’tits pingouins avec Jean-Luc Fromental. Son trait se fait plus acéré et charbonneux pour représenter cet univers, collant à cette noire féérie. Pour nous tenir au plus près des personnages et garder cette aura de malaise, elle a choisi un découpage très dense, avec un jeu de cases élevées qui fourmillent de détails et qui ne respirent que par la couleur. Des couleurs surannées en aplats qui révèlent ou masquent certains détails.
Un conte noir très maîtrisé, envoûtant et perturbant. Histoire dans l’histoire, relecture éclairante ou prolongement de la rêverie de 1932, cet album intrigant est une des très bonnes surprises de ce début d’année.
Thomas Mourier, le 8/05/2024
Fabrice Colin & Joëlle Jolivet - Freak Parade - Denoël Graphic
-> Les liens renvoient sur le site Bubble où vous pouvez vous procurer les ouvrages évoqués

02.05.2024 à 11:42
Réflexions sur les violences sexuelles dans le cinéma et la place de l'auteur, par David Fonseca
L'Autre Quotidien

Texte intégral (15124 mots)
Que faire à l'heure des scandales sexuels au cinéma ? Aller à contre-pente, remonter le courant, faire un état des lieux pour espérer l'habiter autrement. Contre la possibilité du chef-d'œuvre, se débarrasser de l'idée de toute-puissance du réalisateur. Passer d'un cinéma de la création à la décréation car la création sera toujours une diminution, jamais un acte d’expansion : filmer, c'est toujours borner le champ des possibles. Un cinéaste qui voudrait tout dire, tout saisir, ne ferait plus du cinéma. Il encarterait le monde dans son tombeau publicitaire. Un film n'est jamais terminé, autrement dit réalisé. La notion d’auteur est donc à revoir. Il serait peut-être temps de dire que réaliser, c’est trouver sa richesse hors de soi.
Dans la famille, l’homme est le bourgeois, la femme joue le rôle du prolétariat.
Le cinéma à l'heure des scandales sexuels : Passer d'un cinéma de la création à la décréation
La famille cinéma, comme toutes les familles : havre de sécurité, lieu de la violence extrême. Un cercle parfois maudit où des enfants et des femmes ont été trop longtemps encerclées sur les lieux de tournage. Il fallait en sortir. Rendre les petits carnivores. Manger ses parents, légitimement, ne plus être l'enfant, Saturne le dévorant. Agressions sexuelles, viols, emprises, humiliations, racisme, abus de toutes sortes, ont ainsi réveillé la famille en bois cinéma, belle qui dormait. Un annuaire n'y suffirait plus : Bedos, Berry, Besson, Depardieu, Doillon, Garrel, Jacquot, Ruggia... Des révélations ponctuées par des prises de paroles, des petites mains aux joyaux de la couronne, paroles fortes, d'Adèle Haenel à Judith Godrèche, en passant par Anna Mouglalis, Anouk Grinberg, Isabelle Adjani... autant de mots qui ont formé un essaim, d'ici et d'ailleurs : #MeToo (sous forme de reprise), Time's Up, Balance ton porc... comme donnés naissance à des collectifs d'action en France, de l'Association Des Acteur.ices (ADA) à 50/50.
Trouble dans le genre cinéma
Mais quel est donc ce « système de silence et de complicité » qui a permis, encouragé les violences sexuelles au cinéma, qu'Adèle Haenel a voulu dénoncer, ce silence qui « joue toujours en faveur des coupables » ? Depuis la diffusion d’images montrant Gérard Depardieu – mis en examen pour « viol » et accusé par treize femmes d’agressions sexuelles – tenir des propos abjects sur une fillette de dix ans avant d’être porté aux nues par le chef de l’État et défendu par une cinquantaine d’artistes dans une tribune orchestrée par l’extrême droite, un « backlash » inattendu aurait eu lieu selon certains observateurs. Selon eux, le retour de bâton ne se serait pas cette fois abattu sur les militantes féministes mais sur leurs adversaires : plusieurs textes rassemblant, eux, des milliers de signataires, parmi lesquels de très grands noms de la culture, femmes et hommes, appelant à mettre fin à l’impunité des agresseurs dans le milieu du cinéma ; des rassemblements féministes dans plusieurs villes de France, notamment à Paris, en présence d’actrices comme Anna Mouglalis. De même, certaines figures proches de Depardieu ont brillé par leur absence, à l’image de Catherine Deneuve. À l’inverse, des comédien(nes) célèbres ont apporté leur soutien aux plaignantes, à l'instar de Daniel Auteuil. Autre signe d’une évolution : seules 56 personnalités ont signé la tribune Depardieu, loin des 700 qui avaient soutenu Roman Polanski lors de son arrestation en Suisse, en 2009. Et, chose inédite, pas moins de six contre-tribunes sont parues.
Dans le même temps, quatre années après la prise de parole d’Adèle Haenel dans les colonnes de Mediapart, une autre comédienne, célèbre aussi, Judith Godrèche, aurait éveillé encore et autrement les consciences. En évoquant publiquement « l’emprise » et la « manipulation » exercées sur elle par le réalisateur Benoît Jacquot alors qu’elle avait quatorze ans, lui quarante, mais aussi par Jacques Doillon, elle a accusé le premier de viols sur mineur de moins de quinze ans, le deuxième pour viol sur mineur de quinze ans par personne ayant autorité. Une prise de parole qui avait été précédée d'une série, Icon of French Cinema, où y était évoquée la puissance de la domination masculine, sans que le nom des réalisateurs incriminés par la suite soit mentionné.
Pour certains commentateurs, on assisterait désormais à une prise de conscience nettement plus large du caractère systémique du harcèlement et des agressions sexuelles sur les plateaux de tournage. Naîtrait alors l'envie de tout remettre en cause, de s'acculer au pire. Cela traduit-il pour autant et réellement un changement dans l'accueil de cette parole ?
À l’époque, tandis qu’aux États-Unis n'était pas débattu le principe de #MeToo mais seulement de ses limites, en France, le mouvement suscitait des débats où « pour » et « contre » s’affrontent encore aujourd'hui. Le chroniqueur Éric Zemmour comparait ainsi « #BalanceTonPorc » à « Balance ton juif ». Emmanuel Macron déclarait, tout en lançant son plan de lutte contre les violences faites aux femmes, qu’il « ne veu[t] pas d’une société de la délation », tandis que son ministre de l’économie, Bruno Le Maire, expliquait qu’il ne dénoncerait pas un responsable politique s’il avait connaissance de faits de harcèlement sexuel – avant de rétropédaler.
Trois mois plus tard, quand le discours aux Golden Globes de la présentatrice noire Oprah Winfrey – qui annonçait une « aube nouvelle » pour les femmes, « devenues l’Histoire » – faisait le tour des États-Unis, la France se réveillait avec la tribune « Deneuve », qui défendait une « liberté d’importuner » face au « puritanisme », et les propos choquants de deux de ses signataires (« On peut jouir lors d’un viol » (Brigitte Lahaie) ; « Mon grand regret est de n’avoir pas été violée [pour montrer que] du viol, on s’en sort » (Catherine Millet).
Deux ans après, l’actrice Adèle Haenel quittait, bien seule, la cérémonie des César pour protester contre le triomphe de Roman Polanski, accusé de viol par six adolescentes. S’ensuivit une forte polémique et une tribune de cent avocates fustigeant « le triomphe du tribunal de l’opinion publique » et l’« inquiétante présomption de culpabilité » qui pèserait sur les hommes mis en cause. La comédienne a, depuis lors, fait ses adieux au monde du cinéma qui l’a vue réussir.
En septembre 2020, lorsque le chef cuisinier japonais Taku Sekine, accusé de violences sexuelles par plusieurs femmes, met fin à ses jours, le mouvement #MeToo est à nouveau sur le banc des accusés. « Les balances ont gagné. [...] Dites-nous : combien de corps voulez-vous ? », s’indigne l’avocate Marie Burguburu dans une tribune fustigeant « le verdict qu’a rendu le mouvement de libération de la parole des femmes ».
Cinq mois plus tard, une avalanche d’affaires médiatiques (le présentateur Patrick Poivre d’Arvor, le comédien Richard Berry, le producteur Gérard Louvin, l’artiste Claude Lévêque) suscite une nouvelle tribune d’avocats dénonçant « un tribunal médiatique ». « Aux États-Unis, il y a eu réactivité ; en France, il y a eu réaction », résume alors l’historienne française Laure Murat, autrice en 2018 d’un essai sur l’après-Weinstein[i].
Selon l’historienne, l’histoire de #MeToo en France se serait d’abord faite par sa « contre-histoire » : ce sont les résistances à ce mouvement qui en auraient structuré le rythme et l’avancée, « contre la censure », « contre le lynchage », etc. Ce serait donc une contre-histoire de #MeToo qui ferait d'abord exister #MeToo en France. Pour Geneviève Sellier, professeure émérite en études cinématographiques, animatrice du site collectif de critique féministe Le genre et l’écran, les résistances au mouvement #MeToo seraient encore à chercher dans le culte voué à l’artiste masculin en France. L’écosystème du cinéma français reposerait sur une structure objective de hiérarchie sociale, au sommet de laquelle producteur et réalisateur seraient en responsabilité pleine. Dans le même temps, perdurerait cette idée d’une espèce de mystique inspiratrice qui flouterait les rapports de pouvoir, donnant blanc-seing au cinéaste au nom de la possibilité du chef-d'œuvre.
Au plan économique, les résistances à #MeToo seraient également systémiques. Ce qui fait la grandeur comme l'exception culturelle française, soit son système de financement du cinéma, celui de l’avance sur recettes, prédisposerait aux abus. Un film n'y est pas financé s’il est rentable mais s’il est légitime culturellement. Articulé sur le principe de l’avance sur recettes, il n'est pas demandé le moindre remboursement en cas d'échec commercial. Dans les pays anglo-saxons, il est au contraire entendu, indique insiste Geneviève Sellier, que le cinéma est une entreprise capitaliste comme les autres, qui s'accompagne de son lot d'abus comme dans toutes les entreprises capitalistes.
De la même façon, le cinéma français est également tenu par des institutions puissantes, qui ont résisté à #MeToo, tout en ayant l’air de faire quelques concessions : la Cinémathèque française, le Festival de Cannes, l’Institut Lumière. Pour exemple, le Festival de Cannes, lors de la 76e édition, sous la houlette de son délégué général, Thierry Frémaux, en a été une nouvelle illustration. Sous le feu des critiques d’abord, le choix d’ouvrir le festival avec le film de Maïwenn Le Besco, Jeanne du Barry. La réalisatrice avait en effet pris publiquement la défense de Roman Polanski – accusé de viol par six adolescentes au fil des années – et dénigré le mouvement féministe et Adèle Haenel. Elle avait surtout choisi Johnny Depp pour interpréter Louis XV, accusé de violences conjugales par l’actrice Amber Heard, disparue depuis lors des écrans de cinéma. Victime d’une campagne mondiale de cyberharcèlement, comme l’a rapporté un documentaire de France 5, elle aurait quitté les États-Unis pour vivre discrètement en Espagne.
Un second choix a été reproché à Thierry Frémaux : celui de retenir finalement, dans la prestigieuse sélection du festival, le long-métrage de Catherine Corsini, Le Retour, connue pour ses engagements à gauche et féministes. Le film s’était pourtant vu retirer ses aides publiques accordées par le CNC, d’un montant de 680 000 euros, pour infraction à la législation sur la protection des comédiens mineurs. En cause, comme l’ont révélé Le Parisien et Télérama : la production n’avait pas déclaré à la Commission des enfants du spectacle, chargée d’étudier les demandes de tournage avec des enfants, une scène sexuelle impliquant une actrice de moins de seize ans (la séquence, tournée, avait été coupée au montage).
De plus, en novembre 2022, le parquet de Paris avait été saisi d’un signalement dénonçant des scènes sexualisées mettant en scène des adolescents. Ce signalement avait été transmis à la brigade de protection des mineurs. Par ailleurs, un signalement relatif aux conditions de travail était remonté pendant le tournage à l’instance paritaire du cinéma chargée de ces sujets, qui avait enquêté et rédigé un rapport. Enfin, le journal Libération avait révélé une plainte pour agression sexuelle émanant d’une jeune actrice, finalement remerciée par la réalisatrice, qui visait le « coach » qui la préparait au jeu.
Interrogé par la presse, Thierry Frémaux, était resté aussi droit dans ses bottes qu’Alain Juppé face au puissant mouvement social de 1995 en France. Adèle Haenel ? Elle « ne pensait pas en ces termes lorsqu’elle venait à Cannes en tant qu’actrice, tout au moins j’espère qu’elle n’y souffrait pas de dissonance. » Johnny Depp ? « Je ne connais pas l’image de Johnny Depp aux États-Unis. » Catherine Corsini ? « On est quand même entre le procès en sorcellerie et la rumeur d’Orléans. » De toute façon, avait prévenu Thierry Frémaux devant les journalistes : « Si vous pensiez vraiment que notre festival célébrait les violeurs, vous ne seriez pas aussi nombreux ici, à m’écouter et à être accrédités. »
Jusqu’à présent, le prestige et le mythe du cinéma français comme fleuron de sa culture contemporaine auraient donc réussi à colmater les brèches. Pour preuve, le renoncement au cinéma d'Adèle Haenel serait éloquent, soit l'indice que la famille cinéma aurait réussi à se protéger, notamment, considère Laure Murat, dans le cinéma d’auteur. En effet, selon l'historienne, tout comme pour la comédienne Anna Mouglalis, ce cinéma serait encore plus protégé que le cinéma grand public. Le mythe du génie solitaire, au-dessus des lois, y fonctionnerait à plein. Les pratiques de séduction/harcèlement sexuel dans les rapports entre les cinéastes et leurs actrices, comme l’épisode Jacquot l’aurait illustré, y seraient structurelles. Ce système autoriserait à exercer un pouvoir discrétionnaire et à généraliser les abus de pouvoir. Le cinéma d’auteur, qui se présenterait comme subversif, serait en fait le milieu le plus réactionnaire et le plus archaïque dans son fonctionnement. Le droit de cuissage légitimé par la puissance de l’art.
A contrario, en réponse à cet argument, l’actrice Emmanuelle Devos, questionnée dans l’émission « 28 minutes », sur Arte, avait associé le comportement de Depardieu à sa vulgarité et au cinéma grand public où les enjeux financiers sont importants, lui opposant le cinéma d’auteur, dépeint comme un lieu protégé de tels agissements où nul n'aurait l'idée de « vous coincer entre deux portes ».
Qui a raison, s'il fallait en décider ? En vérité, à bien entendre chacun, ni le cinéma d'auteur, ni le cinéma grand public ne seraient, au fond, épargnés par une logique de domination où il faudrait s'en remettre non pas aux règles du droit du travail, mais à la bienséance comme à la politesse, soit à des normes de comportements individuels régentées par une morale de la civilité. En outre, si Gérard Depardieu a profité de cette complaisance très française tandis qu’une partie des agissements étaient sous les yeux des observateurs, cela s'expliquerait encore par sa position de go-between entre cinéma d’auteur et cinéma grand public, selon Delphine Chedaleux, spécialiste des études de genre et des Cultural Studies, historienne du cinéma. D'une part, il aurait manifestement bénéficié d’une impunité artistique, car n'est pas qui voudrait « monstre sacré » prêtant son corps hors norme comme sa voix à la « grande » culture française en interprétant Barbara. D'autre part, les agressions dont il est accusé seraient associées, dans un certain nombre de discours médiatiques, à sa vulgarité toute « populaire » et aux excès qui la caractérisent.
La diffusion récente du « Complément d’enquête » sur Gérard Depardieu modifierait-elle donc la donne ? Au vrai, de manière générale, la profession est restée bien silencieuse concernant la révélation par Mediapart de treize témoignages de femmes, de gravité différente, accusant Gérard Depardieu de violences sexuelles. Dans Le Parisien, cinq réalisateurs et producteurs qui ont travaillé avec le plus célèbre acteur français ont même estimé que ces accusations et sa mise en examen pour « viols » ne changeaient pas la donne, et qu’ils tourneraient à nouveau avec lui. De surcroît, dans le cas Depardieu, si bascule il y a eu, ce serait pour s'en être pris à une jeune enfant. Le vrai scandale consisterait donc à s’attaquer aux enfants quand, à l'inverse, il y aurait toujours un doute sur le consentement des femmes, comme s'il y avait une incapacité à passer à l’âge adulte en matière d'abus et violences sexuelles. De fait, en France, les affaires les plus retentissantes ont souvent concerné des révélations concernant des accusations de pédocriminalité, telles que les révélations d’Adèle Haenel à propos de Christophe Ruggia, les livres de Vanessa Springora (Le Consentement) au sujet de Gabriel Matzneff ou de Camille Kouchner à propos de l'inceste commis par le politologue Olivier Duhamel (La Familia Grande). C’est de nouveau le cas avec le témoignage de Judith Godrèche. De surcroît, en ce qui concerne Adèle Haenel, la sociologue Laure Bereni note encore à quel point l’écho exceptionnel rencontré par la prise de parole de la comédienne était dû à des conditions sociales « improbables » : celles d’une actrice devenue plus puissante que le réalisateur qu’elle accuse – un renversement des rapports de pouvoir extrêmement rare. Mais quatre ans après sa prise de parole, force est de constater qu’Adèle Haenel a dû quitter le monde du cinéma, plus souverain qu'elle.
Il est dès lors douteux que l'affaire Depardieu puisse réellement bouleverser la famille cinéma tant les forces hostiles au changement auraient encore des réserves.
État des lieux
Question, dès lors : qu'espérer encore du cinéma quand il serait faussement avant-gardiste, considéré à tort comme précurseur de tendance, lieu de l'élaboration comme de l'expression du pire ? Pour s'en dédouaner, les accusateurs misent sur plusieurs stratégies. D'abord, certains jouent la culture de la main aux fesses, la France chiraquienne, déboutonnée, la pensée comme débauche, sorte d'ethos, le tournage comme lieu d'expression de la gauloiserie, à propos de Depardieu encore, quand les complaisants rétorquent que « Gérard fait du Gérard » (dixit son avocat), quand d'autres répondent par l'exceptionnalité du « monstre sacré » à qui il faudrait tout pardonner, et qu’en le mettant en cause, « c’est l’art que l’on attaque ». Ensuite, d'autres, joueraient la carte psychologique du syndrome Lolita de Kubrick : en un retournement spectaculaire, la faute à la jeune femme de les avoir séduits. Ainsi Benoît Jacquot s'est-il considéré d'abord et avant tout sous l'emprise de Judith Godrèche, mineure de quatorze ans. Ce sera encore Roman Polanski qui, dans le dossier de presse de J'accuse, expliquera combien il connaît les mécanismes de l'accusation pour avoir été lui-même accusé injustement par de nombreuses femmes. Enfin, en bout de parcours, évoquée par tant de commentateurs, l'omerta, le silence des familles, des producteurs – qui ont pourtant l'obligation de sécurité de cette petite ou grande entreprise - aux critiques de cinéma. Ces derniers, pour parler chapelle, ne feraient pas, au fond, de la critique. Ils se livreraient à un culte. Un travail critique sur le cinéma qui ferait défaut, ni fait par les médias, ni dans les universités, instruments par lesquels se prolongerait le culte de l’auteur en se contentant la plupart du temps de faire l’exégèse des œuvres pour, le plus souvent, montrer combien les « auteurs » choisis seraient géniaux.
Conclusion : tous plus ou moins complices. Et à force de situations qui, quoiqu'il faudrait distinguer, se répéterait, une certitude se fait : rien ne serait le produit du hasard si ces affaires ont lieu au cinéma. Entre, d’un côté, des producteurs, réalisateurs ou comédiens influents, et de l’autre, des actrices désireuses d’obtenir des rôles dans un milieu très concurrentiel, et des intermittents contraints d’atteindre leur quota d’heures, la relation serait d'abord forcément asymétrique. À ce constat universel s’ajouterait une spécificité française, liée à la fois au rapport particulier au cinéma en France, à la configuration spécifique du champ cinématographique hexagonal et à une forme d’« exception culturelle » : la sacralisation de la figure du grand réalisateur ou de l'acteur de renom.
Pour comprendre cette particularité, il faudrait encore plonger dans l’héritage du cinéma d’auteur français. « Il y a un lien étroit entre la façon dont s’est constitué le champ cinématographique en France depuis les années 1960 et le système de prédation qu’il constitue », analyse Delphine Chedaleux. La « politique des auteurs », inventée dans les années 1950 par de jeunes critiques masculins (François Truffaut, Jean-Luc Godard…) qui deviendront les réalisateurs phares de la Nouvelle Vague, auraient consacré « la puissance du réalisateur », explique l’universitaire. Finie la position prédominante des scénaristes et des techniciens, les réalisateurs auraient pris le pouvoir : la valeur d’un film ne se mesurerait plus « à sa qualité technique ou à son succès », mais « au geste artistique du réalisateur, désormais considéré comme un créateur solitaire, à la manière des peintres ou des écrivains. »
Les violences, le harcèlement ou la maltraitance seraient ainsi souvent masqués ou justifiés par la liberté artistique ou l’intérêt supérieur de l’œuvre. Sur le tournage du Dernier Tango à Paris (1972), le réalisateur Bernardo Bertolucci et l’acteur Marlon Brando avaient ainsi piégé l’actrice Maria Schneider en simulant par surprise une scène de viol avec du beurre qui a traumatisé à vie la comédienne. « Est-ce que ce n’est pas le prix à payer pour les chefs-d’œuvre ? », avait justifié en 2018 le critique de cinéma Éric Neuhoff dans l’émission « Le Masque et la Plume », sur France Inter ? Cet alibi artistique va de pair avec la prétendue « séduction à la française », une « exception culturelle » souvent brandie par les voix hostiles à #MeToo et au « puritanisme américain ». « En France, il y a les trois G : galanterie, grivoiserie, goujaterie », avait dénoncé Isabelle Adjani au moment de l’affaire Weinstein, expliquant que « glisser de l’une à l’autre jusqu’à la violence en prétextant le jeu de la séduction est une des armes de l’arsenal de défense des prédateurs et des harceleurs ». Ce mythe est autant alimenté par des critiques de cinéma comme des metteurs en scène, qui théorisent la « relation particulière » qu’ils devraient entretenir avec « leurs » comédien-nes. Ainsi, le cinéaste Philippe Garrel, dont cinq femmes ont dénoncé dans Mediapart des propositions sexuelles lors de rendez-vous pour des rôles, avait expliqué : « Comme beaucoup de réalisateurs de la Nouvelle Vague, j’aimais tourner avec la femme dont j’étais amoureux et la filmer. » Le réalisateur et producteur Luc Besson, accusé de violences sexuelles par neuf femmes, avait lui aussi insisté, lors de son audition par la police en 2018, sur la relation pleine d’« affect » avec les actrices et expliqué qu’il avait besoin d’être amoureux de ses comédien-nes pour travailler.
Sept ans plus tôt, le cinéaste Benoît Jacquot avait revendiqué, dans un documentaire réalisé par Gérard Miller (lui-même visé depuis par des accusations de violences sexuelles), cette « relation d’ordre amoureux » qui doit « nécessairement » exister avec ses comédiennes. Mais il était allé plus loin, en expliquant que « faire du cinéma » était « une sorte de couverture » pour certaines « mœurs », de la même manière qu’il existe des couvertures « pour tel ou tel trafic illicite ». Évoquant sa relation avec Judith Godrèche, il parlait alors de « transgression » et se disait bien conscient « qu’au regard de la loi », « on n’a pas le droit en principe ». « Mais ça, j’en avais rien à foutre », souriait-il, en ajoutant d’ailleurs que cette pratique suscitait, « dans le landerneau cinématographique », « une certaine estime » et « admiration ».
Le fonctionnement du cinéma français reposerait donc sur un non-dit pathogène : l’expression du génie passerait par un rapport amoureux extrêmement éphémère entre le cinéaste et ses actrices. Les exemples de Godard et Truffaut montreraient bien qu'il s'agit d'un modèle ancien, à la fois légitime et délétère, d'autant plus structurel. Le système reposerait sur la figure du Pygmalion comme un aveuglement total sur ce que cela emporterait en termes de domination masculine. Le mythe du génie servirait à masquer le fait que la domination masculine continue à s’exercer. Le cinéma serait l'un des derniers bastions où cette domination se manifeste sans être pointée du doigt, d'autant plus qu'elle y serait légitimée et même valorisée.
Effet de puissance, effet de nuisance
Que faire face à cet état des lieux ? Il faudrait d'abord répondre de l'argument du « monstre sacré », de l'exceptionnalité des lieux comme des acteurs tête de gondole qui s'y expriment, pour redire que le cinéma n'est pas le lieu de la monstruosité, où ceux qui y travaillent s'excepteraient de la condition humaine pour déroger à ses règles. Il faudrait encore répondre à ceux qui se défendent en inversant la situation bourreau/victime, qu'il y a là une manière de nier les faits, soit la réalité. Dire encore et surtout qu'il n'y a pas de hasard à cette situation, pour deux raisons. Tout d'abord, le cinéma est un agrandissement de ce que nous vivons et voyons. Ensuite, le cinéma n'est pas le lieu du divertissement. C'est un laboratoire, le lieu où s'expérimentent nos existences, ce que beaucoup de spectateurs et critiques de cinéma ont du mal à concevoir encore : tout ce qui se passe dans la société est déjà là, à l'avance, au cinéma.
Hélène Frappat, dans son ouvrage sur le « gaslighting » ou l'art de faire taire les femmes, en a fait le centre de son analyse. Le cinéma a montré très tôt, dès 1944, dans un film de Georges Cukor, qui s'intitule précisément Gaslight, comment les femmes ont été effacées de l'écran (dans le film, par un mari, qui fait passer pour folle sa femme en abaissant peu à peu la lumière de leur maison), soit la manière dont elles ont été violentées par un procédé singulier, une logique d'effacement, qui sera actualisée ensuite dans le film d'Hitchcock, Une femme disparaît. Avec le film de Georges Cukor se mettrait en place un continuum entre la violence conjugale que subit l’héroïne interprétée par Ingrid Bergman et ce qui se passe en dehors des murs, soit la guerre, la déshumanisation entraînée par le nazisme. Le film aurait donc eu la prescience de ce qui devrait être questionné aujourd'hui : le pouvoir, plus précisément, le type de pouvoir que les individus voudraient.
Dans le comportement d'humiliation à l'égard des femmes de Gérard Depardieu, décrié par de nombreuses actrices comme Anouk Grinberg, son racisme quand il singe la langue coréenne et le pays où il est invité, qui a trait avec une forme de discrimination, s'exprime en effet un rapport de pouvoir comme de classe. Prendre la défense de Gérard Depardieu comme a pu le faire Emmanuel Macron, qui, désavouant sa ministre de la culture d’alors, a dénoncé une « chasse à l’homme » et estimé que le comédien « rend[ait] fière la France », procède également d'une logique d'affichage, une manière de maquiller ce qui est en jeu, un procédé de gaslighting qui maquille un rapport de pouvoir qu'Adorno aurait qualifié d'autoritaire, visant à humilier l'autre, comme de ne pas respecter les lois en vigueur. Le gaslighting, en cette occasion, a pour but de maquiller un état d'exception en régime normal de production dans le domaine du travail au cinéma. Ce comportement ne doit pas être singularisé en raison de la personnalité, l'aura de l'acteur. Il doit conduire à s'interroger. Car si le cinéma reproduit ces comportements, c'est que par-devers lui il illustre ce que ce pouvoir fait aux individus. Le cinéma nous met en images ce phénomène devant les yeux, version panoramique. Il nous le renvoie : nous sommes face à des films et un acteur qui nous regarde. La question est de savoir ce que nous faisons de ce regard comme de cette image du pouvoir qui aurait installé un régime de regard typiquement ostracisant, le « male gaze », selon la théoricienne du cinéma Laura Mulvey.
L'autrice a proposé une vision genrée du septième art à travers le concept de « male gaze », développée dans un article devenu culte : « Plaisir visuel et cinéma narratif » (« Visual Pleasure and Narrative Cinema ») paru en 1975. Selon Laura Mulvey, « L'homme contrôle la part fantasmatique du film et apparaît ainsi comme le représentant du pouvoir. Il est le relais du regard du spectateur, assurant le transfert de celui-ci à l'écran. » Et cet objet du désir serait destiné au seul plaisir de l'homme. « Jamais contestés, les films grand public ont codé l'érotisme selon le langage de l'ordre patriarcal dominant », dénonce la théoricienne. À dessein, elle utilise donc la psychanalyse comme « arme politique », notamment les concepts de fétichisme et de voyeurisme. Pour elle, le plaisir du spectateur passerait par l'objectivation voyeuriste de la femme à l'écran. Plaisir scopique, selon le terme freudien, le « male gaze » désignerait cette pulsion sexuelle où l'individu prend plaisir à posséder l'autre par le regard (scopophilie), que le corps dénudé, selon Iris Brey, soit féminin ou masculin[ii]. Et c'est ainsi qu'il faudrait, selon la philosophe Manon Garcia, revisiter toute notre cinématographie, revoir la main de Belmondo dans la culotte de Jean Seberg, la contraignant à un rapport sexuel initialement non-consenti. À bout de souffle installerait ce climat de violence sexuelle autant que Hollywood serait responsable de ce récit imaginaire mis en place par les hommes agresseurs, violeurs, lequel romantiserait leur violence, mettrait en place un imaginaire romantique, multipliant les scènes de femmes plaquées contre un mur, non consentante[iii], finissant par se rendre à la logique du plus fort comme de son irrésistible pouvoir de séduction, à l'instar du Facteur sonne toujours deux fois version Bob Rafelson lors d'une scène entre Jessica Lange et Jack Nicholson, ou bien encore After Hours de Scorsese, dont Rosanna Arquette[iv] a dénoncé les implicites dans un documentaire récent, Brainwashed, de Nina Menkes, quand Blow Up d'Antonioni reposerait sur un viol hautement problématique.
Ce rapport de domination conduit autant à Shelley Duval, épuisée par Kubrick pour obtenir des situations d'hystérie qui ne s'en remettra jamais, ou encore à Hitchcock qui sadise ses actrices et acteurs. Des réalisateurs qui font rejouer vingt fois une scène afin que l'acteur oublie qu'il est acteur, qu'il joue pour ne plus être acteur et, au fond ne plus faire cinéma, pour de faux, comme l'actrice de Romance, de Catherine Breillat, sortira traumatisée de son tournage, pour des scènes de rapports sexuels qui n'allaient pas être simulées. Un rapport hystérique qui aurait conduit à une nouvelle forme de servage dans le cas d'Hitchcock, possédant un droit de vie et de mort sur une actrice, Tippi Hedren, pour lui avoir fait signer un contrat d'exclusivité pendant sept ans, lui conférant un pouvoir de monopole sur sa carrière. Et c'est ainsi qu'en 2017, un an avant #MeToo, elle signalera un viol dans ses mémoires. Faut-il donc souffrir pour être un bon acteur ? Ne pas faire cinéma pour faire cinéma ? Par où passe donc la limite ?
Au fond, pour en revenir à Depardieu, exemple paradigmatique, il est à la fois un symptôme, tout comme il n'est pas simplement comme acteur ce morceau de cire de Descartes, capable de se transmuer en permanence comme il serait traversé par tous les rôles qui ont été les siens. Il est traversé aussi, comme disait Flaubert, d'une dimension impersonnelle qui est celle du cinéma, de l'art. Le cinéma parle en lui. Est-ce une manière de le déresponsabiliser ? Au contraire, cela revient à en faire une grande figure de l'art, traversée comme Weinstein, ou DSK dans un autre contexte, par une forme de pouvoir qui ne serait pas juste le leur, mais la conception que nous en avons tous en tant que citoyens, qui devrait conduire chacun à s'interroger. En attendant, que va-t-il se passer ?
Il y aura bien évidemment un volet répressif, judiciaire. Mais comment s'en satisfaire quand, de manière générale, pour ne s'intéresser qu'au seul sort réservé au viol, seules 17% des plaintes finissent par une mise en accusation en France ? Reste le volet préventif, volant d'action le plus important aux regards des enjeux sociétaux.
De toutes ces affaires il en ressort surtout un rapport de domination, celui de l'abus de pouvoir du pater familias. Or, chacun y consent, le cinéma est un lieu où d'abord tout le monde se connaît. Il devient difficile de dénoncer des comportements outranciers sans ruiner sa carrière de sorte que dans les nombreux reportages faits à l'origine des révélations, ce sont le plus souvent des petites mains, maquilleuses, actrices le plus souvent sans renommée, qui ont pris la parole. Le cinéma est encore le lieu où le rapport de force est inégal entre producteur-réalisateur et intermittents du spectacle, nombreux, précaires.
Pourtant, sur le terrain du rapport de force, les choses ont un peu changé. Ainsi le CNC conditionne désormais les subventions à certaines conditions de tournage, grâce au travail d'association comme 50/50 ou l'ADA, avec la mise en place de plans de lutte contre les violences, comme la mise en place de référents harcèlements sur certains tournages, mais aussi un financement de la part du CNC conditionné par des formations sur les situations de violence (ubuesque, parfois, puisque Luc Besson, à l'époque sous enquête pour viol, assistera à ces formations). Le système comporte toutefois des limites : les enquêtes internes pour faits de harcèlement se produisent lorsque le tournage est souvent terminé, sans compter que les référents harcèlement sont internes, souvent liés à la production, sans considérer encore que la présence de ces référents, qui génèrent un surcoût, ne concernera pas encore le cinéma dit d'auteur.
Au plan préventif, ce serait bien sûr proposer d'autres récits, faire image autrement, opposer au « male gaze » un « female gaze », redresser les regards féminins, comme l'explique Iris Brey, dans son ouvrage Le regard féminin, Une révolution à l'écran. Cette théoricienne du cinéma, critique et réalisatrice d'une série diffusée sur France 2, Split, entend ainsi continuer le travail d'Alice Guy, Jane Campion, Céline Sciamma, Agnès Varda, Barbara Loden, Paul Verhoeven, Chantal Akerman, Marie-Claude Treilhou... : développer davantage une nouvelle façon d'appréhender les images, proposer un « regard féminin [qui] filme les corps comme sujets de désir », non plus comme des objets, avec ce regard qui réifie.
Dans cette perspective, est apparu un nouveau métier de cinéma : le coordinateur d'intimité. Dans un documentaire intitulé Sex is comedy, diffusé sur France Télévisions,y intervient précisément Iris Brey sur les lieux de tournage de sa série.
Ce nouveau métier existe depuis des années aux États-Unis. L'objectif de ce consulting est d'assister acteurs comme réalisateurs dans le tournage de scènes intimes et sexuelles. Ce ne sont donc pas des story tellers mais des conseillers, qui n'ont, a priori, pas vocation à modifier les projets du cinéaste comme de son équipe technique, mais « coacher » acteurs/actrices en vue de préparer lesdites scènes d'intimité comme d'être les médiateurs d'une situation conflictuelle le cas échéant. Ses détracteurs y voient une menace à l'expression de la liberté artistique made in America où tout se résumerait à un sourire sans personne derrière, selon la formule de Jean Baudrillard. Ses laudateurs l'encouragent, notamment les nombreux collectifs féministes auxquels est appariée Iris Brey, dont le documentaire se fait le porte-voix.
Clairement orienté, donc, vers la cause féministe, Sex is Comedy n'en révèle pas moins les ambiguïtés propres aux conditions de tournage quand il s'agit de penser les coins du cinéma : filmer en l'occurrence une scène de sexe. Cette difficulté est redoublée dans la série d'Iris Brey, la cinéaste souhaitant filmer une scène inédite (à la télévision) d'éjaculation féminine entre deux jeunes femmes interprétées par Alma Jodorowsky et Jehnny Beth, soit une scène de squirt. Cette scène y devient la pierre d'achoppement sur laquelle se réfracte tous les enjeux du cinéma contemporain : la place du réalisateur dans le cinéma français, la pertinence d’un certain romantisme qui le rend tout-puissant, la position symbolique des comédiennes dans notre société, et enfin le fait que le cinéma est aussi un lieu de travail, donc de lutte des genres et des classes.
A priori, la documentariste, en faisant le choix d'Iris Brey pour illustrer son propos (la nécessité de faire intervenir désormais des coordinateurs d'intimité sur les lieux de tournage), ne prenait guère de risque. Connue pour son engagement féministe, une femme tournant une scène avec deux actrices : le sentier semblait à ce point balisé que la pertinence de l'hypothèse « coordinateur d'intimité » était d'emblée invalidée, d'autant plus qu'Iris Brey coordonne elle-même théoriquement l’intimité le long du film. Pourtant, malgré lui, le documentaire finit par mettre au jour ce qu'il entendait faire disparaître, soit les rapports de pouvoir comme de domination. À force de mises au point avec les deux comédiennes comme la réalisatrice, chacun des acteurs s'enferre dans des discussions qui s'éternisent. Et bientôt Iris Brey doit elle-même réprimer son impatience, puis, n'y tenant plus, dire à la coordinatrice combien les délais comme la pression ne lui sont plus supportables : il va falloir avancer. Il lui faut décider. Trancher, c'est-à-dire souverainement, le souverain, dit un célèbre juriste nazi – Carl Schmitt – mais aussi un philosophe libéral – John Locke –, étant celui-là seul en mesure de décider de la situation exceptionnelle : filmer une scène de squirt.
Par-devers lui, ce documentaire dit donc une chose et son contraire : ce serait finalement un leurre de céder à l'époque, toute cette philosophie qui voudrait remplacer les rapports d'autorité par des relations d'échange, la décision par la négociation. La chose serait impossible. Et sans doute est-ce au cœur de cette contradiction que se logerait le risque d’abus, quand le documentaire est d'une ironie étrange : Sex is comedy est d'abord et surtout le titre d’un film de Catherine Breillat, cinéaste dénoncée par l'une de ses comédiennes précisément pour une scène de sexe avec l'acteur porno Rocco Siffredi, dans un cinéma obsédé par la question du sexe, de la honte, du sale.
Sortir du stade anthropologique de la domination
À la puissance répondre par la puissance, à la domination répondre par une contre-domination, donc ? Ce documentaire, au fond, est un opérateur métonymique, par le négatif, de ce qu'il faudrait faire, mais par le tissu noir, par ce que chacun ne veut pas voir. Il nous propose une image inversée de ce qui est comme l'est un négatif ou un miroir reflétant une image à l'envers : or, c'est à partir du négatif – photographique – que l'on va pouvoir développer une image. Ce que montre ce documentaire, in fine, est que le rapport de justice qu'il faudrait instaurer repose lui même sur un coup de force.
La vérité de ce documentaire, et peut-être du cinéma, est d'abord ce qu'il cache et non pas simplement ce qu'il montre comme le considère Hélène Frappat : ce que cache le cinéma, ce n'est pas simplement un rapport inégal de domination, mais de manière plus complexe, comme pour la personnalité autoritaire selon Adorno, que le cinéaste repose sur un mélange d'ambivalence, dont Iris Brey est la symbolisation dans le documentaire : il y aurait à la fois un désir de soumission chez lui comme de se soumettre soi-même à une certaine conception du cinéma, de la mise en scène, de l'esthétique... Le/la cinéaste serait un type singulier, une sorte de rebelle conservateur : à la fois lui faut-il composer dans un cadre contraint tout en souhaitant installer son propre univers dont il s'est fait la vérité à coups de politique des auteurs.
Si révolution il doit y avoir, elle doit alors se juger non seulement d’après la légitimité de son combat, mais aussi à partir des moyens qu’elle se donne et des voies qu’elle emprunte. Un mouvement d’émancipation qui prolongerait certains réflexes de l’ordre dominant (indifférence aux inégalités sociales et ethniques, centralité de la répression et de la punition, phénomènes d’ostracisation…) oublierait la fameuse phrase prononcée il y a bientôt un demi-siècle par la poète noire féministe et lesbienne Audre Lorde lors d’une conférence dédiée au livre fondateur de Simone de Beauvoir Le Deuxième Sexe : « On ne détruit pas la maison du maître avec les outils du maître. »
Ainsi, l'un des seuls collectifs existant aujourd'hui est le collectif 50-50. Son objectif, viser l’égalité homme-femme au cinéma, mais sans remettre en cause la liberté de création. Mais tant que le cinéma sera engoncé dans l'état d’esprit d’une liberté de création sacralisée, rien ne se produira. Car derrière ce mythe se diffuse une culture individualiste et bourgeoise de la création, qui empêche de se poser la question des représentations. Si faire remarquer que, dans le cinéma, la plupart des rôles féminins valorisés ne dépassent pas trente ans, que la plupart des rôles professionnellement intéressants sont masculins, que les « minorités » dites « visibles » y sont quasi invisibles, ce serait écorner la liberté de création, alors se pose un problème idéologique. S'il n'est pas possible de pointer les stéréotypes racialistes et sexistes qui imprègnent le cinéma de fiction, la terre ne tremblera pas. Le réalisateur est la star, un culte de l’auteur propre à la France. Sans doute n'est-il pas anodin d'y voir tourner Roman Polanski ou Woody Allen quand ils sont bannis des États-Unis.
Où se situe donc le nœud du problème ? En France, si la logique laïcarde a relégué Dieu au ban de l'intime, elle a mis en lumière le créateur : Dieu est mort, vive l'artiste ! Le cinéma sera une religion de substitution, celle du réalisateur providentiel, seul auteur de son œuvre, suffisamment doué de tact et de sagacité comme le disait Aristote de son Prudent pour s'autoriser soi de sa légitimité à dire et faire la loi, sa loi. Ainsi Benoît Jacquot a-t-il sans doute pu se sentir suffisamment protégé pour revendiquer publiquement ses relations avec des comédiennes mineures. Rien d'autre que ce que faisait Éric Rohmer quand l'un des copains de la Nouvelle Vague confiait qu’il faisait les sorties des lycées pour draguer, retranscrit dans son cinéma. Plus il vieillissait, plus ses actrices étaient jeunes. La plupart des cinéastes, à commencer par Jean-Luc Godard avec Anna Karina, auraient ainsi fantasmé sur la figure de la femme-enfant, sous couvert de culte de la beauté. Des anthropologues et éthologues répondraient que certains grands singes, comme le cerveau reptilien de l'homme, auront plutôt tendance à choisir de jeunes femmes quand a contrario lesdites jeunes se tourneraient vers le gorille de service, chacun étant le plus prompt à la perpétuation de l'espèce. La nature en cause, donc ? Trop simple : chez les chimpanzés, nulle trace de filiation fondée sur l'ascendance paternelle (patrilinéaire) mais au contraire maternelle (matrilinéaire), le rang de chacun dépendant de son lien avec la femelle dominante. La culture, dès lors, l'arrachement à la nature ?
La culture n'aide guère davantage dans notre affaire, engoncée dans des perspectives ethnologiques lointaines qui remontent au néolithique où la révolution agricole devient un moyen politique de contrôler les femmes, d'asseoir le socle de la domination masculine selon Paola Tabet. Quand les hommes s'apercevront que la procréation est la seule possibilité de surmonter la mort de l'espèce[v], ils priveront les femmes d'accès à la nourriture, les excluront de la maîtrise des outils, les assigneront à résidence, les condamnant à la reproduction forcée. Interdites de chasse, domaine réservé des hommes, elles seront confinées aux tâches domestiques. Privées de nourriture, elles deviendront plus petites que les hommes, quand elles faisaient la même taille qu'eux lorsque l'accès à la nourriture était illimité, en atteste l'évolution au sein du règne animal[vi]. Interdits et obstacles leur empêcheront la maîtrise de l'art par les outils comme l'éloignement de la hutte – elles auront les doigts coupés dans certaines tribus de Nouvelle-Papouasie quand leurs pieds seront entravés pour la marche. Voilà le moment qui fit basculer l'humanité dans des rapports de domination, son âge criminel. L'impasse métaphysique, c'est la mort. Comment la conjurer ? En contrôlant l'accès à la nourriture et les naissances. La manière d'enjamber la mort : par la conscience reproductive. En portant l'enfant dans son ventre, la femme devient l'objet de toutes les attentions comme des proscriptions : elle permet à l'homme de chevaucher la mort. De quel droit le lui refuserait-elle ? À coups d'interdits, d'une violence symbolique et physique, elle portera le fils, le nom qui continuera la lignée par laquelle les hommes s'héroïsent. S'invente la filiation patrilinéaire, l'ascendant paternel quand il n'était pas du tout évident que le sexe puisse donner naissance à des enfants. La conscience reproductive devient un instrument de pouvoir et de domination[vii]. Voilà la grande impasse. L'obstacle devient métaphysique si la seule manière d'enjamber la mort est la procréation. Le moment où l'homme sait comment contrer la mort, il la donne.
Il faudrait dès lors commencer par revisiter l'histoire des sociétés, simplement, se demander : quand ce régime de domination a-t-il débuté ? Où se trouve son point zéro ? Refaire l'éducation de chacun, fille, garçon, réviser les programmes scolaires. Dire : la révolution néolithique, ce sursaut de l'humanité, est dans le même temps le signe de sa régression. S'en dégage une règle, inscrite en filigrane dans la tradition artistique : à la femme le cercle, la ligne pour l'homme. La femme, prise dans le cercle du cycle et de sa domination : menstruel, maternel, une vie autour de la hutte. L'horizon pour l'homme, phallusien, les grands panoramas qui ouvrent son champ d'action pour un homme qui va toujours droit, loin de la hutte, chasse, fabrique des armes qu'il lance pour bientôt gagner les cieux jusqu'à faire croire qu'il soit seul capable de les atteindre en organisant les rites à vocation religieuse, dont sont exclus les femmes : elles mettent bas, elles seront privées du très-haut comme de l'accès au paradis, plus tard, dans les religions monothéistes.
Par ricochet, la tradition française cinématographique en fera sa culture, s'arc-boute sur la masculinisation du génie, qui remonte au XVIIe siècle[viii]. Elle s’accentue avec le romantisme, ce génie solitaire dans sa tour d’ivoire ou face à cette mer de nuages qui a forgé le modèle français de l’artiste, repris en chœur par les cinéastes de la Nouvelle Vague. Voici ce qu'il faudrait questionner, cette transposition faite au cinéma à partir de considérations sur la littérature quand un film est une œuvre forcément collective, contrairement à un livre (quoi que : l'auteur de littérature pense-t-il à partir de nulle part, soit le point zéro de son génie créateur ?).
Cette notion romantique du génie solitaire a un poids considérable. Elle s'articule sur la logique des grands récits, du grand récit par excellence, celui de vouloir conjurer la fin de l'espèce. Si l'on prend au sérieux le fait têtu que nous sommes des êtres pour la mort (Heidegger), définis par cette seule condition, cela induit un rapport au temps de type schizophrénique. Nous sommes là, ici et maintenant, dans cette vie, affairés avant d'être énucléé de tout ce qui nous importait : si nous pensons la fin – la mort –, le risque est la folie. Les grands récits ont alors pour vocation de nous rassurer, pour nous accompagner au mieux vers la mort qui nous attend, soit en nous en détournant, version pascalienne du divertissement, soit pour donner du sens à une existence dont on sait qu'elle est vouée à l'extinction. Donner du sens, donc, à l'échelle individuelle, mais aussi créer des communautés de sens, depuis la famille jusqu'à la nation ou chacun se met en récit pour se raconter à soi comme aux autres. Il nous a toujours fallu des récits de donation et de dotation de sens, dont le cinéma serait l'un des pourvoyeurs. Cette nécessité d'avoir des raisons d'adhésion. La question est de savoir quel récit nous voulons dans notre rapport à l'autre ? Le problème de l'auteur à prétention géniale est que ce grand récit est lui-même entée sur un récit pré-moderne, celui de l'occident chrétien, soit d'une providence à l’œuvre, dont la seule présence justifierait tout, le bien comme le mal.
Ce providentialisme est redoutablement efficace, comme au cinéma, puisque tout événement se justifie, économique, social, politique jusqu'au sort des individus. Cette faculté qu'a Dieu de prévoir l'avenir, de vouloir l'avenir, met en place une théodicée, soit la justice de Dieu, cette manière de tout justifier par la bénévolence, sa seule volonté : si le sens nous échappe, Dieu en est le gardien. Dieu devient cette espèce de grand ordinateur façon Leibniz au 17e siècle : quand Dieu calcule, le monde advient, Dieu calculant à l'instant T une multitude de mondes possibles dont il choisit l'optimum, le meilleur des mondes possibles. Si une certaine modernité, sous le coup des révolutions, en est sortie, le cinéma en demeure empreint dans sa conception de l'artiste.
Il serait temps de faire l'histoire et non plus être fait par l'histoire. Dénoncer ce système, mais non pas simplement en étant du bon côté, c'est-à-dire évidemment des victimes : n'être que cela, c'est écrire l'histoire dont ceux qui en profitent ont besoin. Être solidaire des victimes d'un système comme système, c'est le justifier en tant que système en s'en exceptant. C'est un confort dont on ne peut s'assurer.
D'un cinéma de la création à la décréation
Il serait temps d'en sortir. Mais pour le faire, encore faudrait-il qu'à l'échelle collective nul ne s'excipe. Car il y a un impensé majeur dans toute la littérature sur le sujet : celui de la place du spectateur, vous, moi, soit notre part de responsabilité. Il faudrait donc élargir le cercle de la famille cinéma. Rappeler d'abord que #MeToo n'est pas une initiative intellectuelle née au cinéma. #MeToo vient de la rue, d'une travailleuse social afro-américaine, Tarana Burke, d'un quartier de New York qui, à force d'entendre les mêmes récits de violences faites aux femmes noires (les « minorités visibles » dit la langue policée jusqu'à effacer toute forme de singularité) décide un jour d'écrire : Me Too. Ensuite, dire combien cet attrait pour le réalisateur star est hautement problématique et fait autant signe, au plan anthropologique, vers une certaine conception de la politique qui nous engage tous, cette pente chez les individus que La Boétie avait si bien désignée, ce goût immodéré pour la servitude volontaire. Ce désir profond, rassurant, enfantin, de se placer sous l'autorité d'un seul, sans y être contraint par une force majeure, mais parce qu'il y aurait de la fascination, « et pour ainsi dire, fascinés par le seul nom d'un ». À ne pas l'admettre, ce sera demeurer dans le cercle de la domination. Ce sera, comme pour la logique néo-libérale, s'efforcer simplement d'intervenir à la marge, réguler le système, au mieux le normer, sans jamais en changer.
Il faudrait peut-être en revenir à une autre conception du cinéma, si l'on espère encore qu'il soit un « art subversif » (Amos Vogel), à tout le moins, le lieu d'une expérience où se réinventeraient les rapports entre chacun de ses acteurs. Pour emprunter une autre voie, s'il fallait encore, pour Sigfried Kracauer, le cinéma aurait une qualité particulière. Il serait en avance sur son temps. Prophétique, annonciateur du pire comme porteur de la petite lumière. Mais pour être annonciateur, Sigfried Kracauer, ce démasqueur, comme le prénommait Walter Benjamin, a pensé le cinéma autrement que dans le registre de celui de la politique des auteurs. Le cinéma serait un art collectif qui, engageant toute une équipe technique autour du réalisateur, donnerait à voir sur l'écran une mentalité, un mouvement collectif. C'est ainsi que dans l'un de ses ouvrages majeurs, De Caligari à Hitler, il voit dans de nombreuses œuvres du premier quart du 20e siècle, Le Cabinet du docteur Caligari de Robert Wiene, Metropolis/M. le Maudit/Docteur Mabuse de Fritz Lang, Nosferatu de Murnau, des personnages hypnotiseurs face auxquels une masse est agrégée où les individus, en tant qu'individu, n'existent plus et n'expriment plus simplement que le désir d'un assujettissement par un homme autoritaire. Soit le cinéma comme art oraculaire, décelant dans le présent les signes à venir du nazisme.
Godard, parmi bien d'autres, mis en accusation – mais comme il faudrait chacun se questionner – apporte un autre élément de réponse : l'image ne peut advenir qu'à partir d'une autre image, et à l'infini. C’est bien d’un autre type de cinéma dont parle Godard : celui de son manque à être, sa faiblesse originelle, son incomplétude, son incapacité à se sentir plein et entier. Autrement dit, réalisé. La notion d’auteur est peut-être à revoir. En paraphrasant Alain, il serait peut-être temps de dire que réaliser, c’est trouver sa richesse hors de soi[ix]. Le cinéma maniériste en atteste : quand François Truffaut aurait proposé de véritables sujets sans véritable mise en scène, certains de ses meilleurs films épigones les auraient revisités, forme nouvelle à l'appui, de Fight Club de Fincher en passant par le récent Challengers de Luca Guadagnino pour Jules et Jim à Kill Bill de Tarantino pour La mariée était en noir. Et c'est peut-être tout le cinéma qu'il faudrait revisiter de ce point de vue maniériste, chez les classiques Sirk, Powell, Hitchcock, Peckinpah... les contemporains Jarmusch, Lynch, Monteiro, De Palma, Argento, Almodovar, Greenaway..., comme les genres de la comédie musicale, le western, le giallo, le policier... (Du maniérisme au cinéma, (ss. dir.) de Véronique Campan et Gilles Menegaldo, PUR, La Licorne, 2003, 292 p.) pour montrer combien chacun pratique l'anamorphose, la citation, la reprise autant que le cinéma serait maniériste dans son ensemble pour se consacrer à ses propres formes, lorsqu'il travaille à leur célébration comme leur arrangement, en témoignent les différentes versions d'un film proposées lors de ressortie en salles, en DVD, Apocalypse Now de Coppola en tête d'affiche : les cinéastes ne créeraient pas, ils décréeraient en permanence, ce qu'il faudrait encore expliciter.
Le philosophe Henri Gouhier le théorisait pour le théâtre, auquel il faudrait emprunter en élargissant ses vues : une œuvre d’art (hors la sculpture/la peinture, disait-il, sur quoi il faudrait encore répondre) est toujours constituée de deux moments. Le premier, celui de l’écriture, qui appartient à l’artiste, fait surgir l’œuvre du néant – et encore, le cubisme et autres avatars comme éclairs de génie ne consistent qu'en des reprises, des phénomènes de cristallisation qui passe par l'imitation, la reproduction, jusqu'à la recréation. Le second, celui de sa lecture, qui appartient à tout le monde, l’empêche d’y retourner. En clair, une œuvre d’art – plus modestement un film – n’est constituée que si ces deux moments sont réunis. Et, comme un monde en suspens, de la salle à l’écran, tout le monde a compris l’enjeu : chacun s’espère, acteurs du film, spectateurs. Pourquoi ? D'abord, parce que le film n’est pas donné ab initio. Ensuite, parce qu'il met en jeu un cogito plural pour que se construise à quatre mains comme en autant de paires d'yeux sa propre réalité. Ainsi nous regardons ces films. Nous attendons qu’ils parlent. Nous nous émerveillons même des réponses qu’ils apportent parfois. Sans nous douter que de proche en proche ceux qui sont derrière la caméra attendent aussi de nos nouvelles. Car réaliser est un acte solitaire répété d’une même voix souterraine. Un répons de fous ardents. Pour le comprendre, la pellicule et le grain ne suffisent plus, fussent-ils numérisés. Il faut aussi des yeux, les leurs, les nôtres, sorte de devins pour examiner nos entrailles de victimes, en sortir tous les présages pour dériver nos corps arables d’un lieu à l’autre, dans l’espoir que se produise cette improbable rencontre autour de laquelle se noue l’intrigue du film. Un drame qui se joue toujours en deux temps.
C'est une autre conception de l'individu qui se délivrerait alors à travers cette façon de faire cinéma. Dans un univers où l’homme n’est plus soumis à une quelconque autorité extérieure, pour devenir l’auteur de ses actes et de ses représentations mentales, de ses règles et de ses principes, l’autonomie est devenue une référence cardinale. Elle est l’expression nécessaire d’une modernité voulue et assumée. L’homme est enfin lavé de ses scories, en charge de son propre avenir. Mais le processus qui emprunte les formes du narcissisme hédoniste et du pur souci de soi mènent inexorablement à la destruction de soi. La maîtrise et la toute puissance en sont les ressorts. Au contraire, le visage de l’individu qui pourrait prendre forme et sens sur la pellicule rappelle que cette modernité n’a pas vu seulement l’émergence d’une figure unique de la subjectivité. À la toute puissance du solipsisme répond point par point la faiblesse d’une conscience qui a compris qu’elle n’existe que parmi d’autres hommes. Le cinéma est aussi une épreuve de l’intersubjectivité. C’est la part manquante de chacun qui permet de travailler par abstraction et l’espace et le temps. Et si l’on doit sortir réjoui d'une salle, c’est pour avoir compris que la vie est ailleurs, c’est-à-dire toujours loin de nous, de l’idée qu’on se fait de la perfection et de la toute puissance. Regardons bien : l’harmonie est nécessairement dissymétrique, sauf à s'en remettre à la logique des fractales, préférer l'auto-similarité à la possibilité des rencontres anfractueuses comme dans Gerry, de Gus Van Sant. Ce météore filme l'amitié entre deux types perdus dans le désert – le désert comme retour impossible à une forme de pureté du cinéma des premiers temps, une quête rédemptrice, mais un désert pour nous inviter aussi à rejoindre la marche des amis –, deux individus perdus dans la limpidité de la lumière comme de la musique fluide de Beethoven et Arvo Pärt, un film qui propose un sens sans jamais l'imposer, pour faire du cinéma une cité perdue comme une terre d'exil. Gerry, ou la reprise du thème de personnages en quête d'auteur pirandellien, repris au cinéma par Antonioni, qui filmait déjà la disparition de personnages dans L'Avventura comme Blow Up, pour faire un cinéma de l'enfouissement de toute forme de réalité objectivée tout comme il n'y aura plus de point de vue humain derrière la caméra dans 2001, l'odyssée de l'espace de Kubrick : le point de vue d'une personne qui serait personne, un extra-terrestre.
Le film espère aussi sa rencontre du troisième type comme les deux amis dans Gerry, son spectateur. L’œuvre d’art, quelle que soit son support, est un jeu qui ne s’accomplit que dans l’accueil que lui réserve justement le spectateur. Alors n’allons pas trop vite en besogne. Ce n’est que dans l’épreuve de la réception que le film se fait. Avant il ne s’agit que d’images mises en boîte, de couleurs imprimées sur la pellicule, d’une bande-son gravée sur différentes pistes. On ne peut pas encore appeler cela un film, parce que le film, comme objet, est lui aussi l’enjeu d’une communication. Comme l’écrit Barthes, il y a un donateur du récit, un destinataire du récit[x]. En art, comme en amour, il faut cesser de croire à l’expression de l’unilatéralité. Il faut redonner à chacun sa chance : aux êtres de se rencontrer, au film d’exister.
Qu’attend donc de nous le film ? Simplement qu’on lui tende dans l’obscurité nos bras pour l'accueillir en effaçant le mot « fin » du générique. La parole de l’auteur sera toujours en effet différée dans le temps par le processus de lecture. Derrida : il n’y a plus de hiérarchie entre l’acte d’écriture et l’acte de lecture, ces deux moments forment un tout indissociable[xi]. Si bien que le terme même de film devient inopérant, car ce terme évoque quelque chose de fini, d’accompli. Mais le film n’est jamais terminé, il est au contraire sans cesse relancé par le procès de lecture. Mieux : il est toujours en train de se faire. Le film n’est donc pas un événement qui s’est produit lors de sa réalisation. C’est un événement qui est toujours en train de s’accomplir. Plutôt que parler de processus de création, il faudrait emprunter et importer le terme de décréation de l’univers philosophique de Simone Weil[xii]. Un néologisme qui ne saurait se réduire à un pauvre artifice de philosophe car il en va de la solution d’un problème épineux, celui de la création du monde, le nôtre.
Simone Weil pose sans ambages la question aux religions du Livre : pourquoi Dieu, qui est parfait dans les religions monothéistes, irait-il créer quoi que ce soit, puisqu’il est lui-même tout l’être et le bien possibles[xiii] ? Comment rajouter de l’être à l’Être infini ? Du bien au Bien absolu ? Cela n’est pas possible. Pour sortir de l’impasse, il faut faire un effort conceptuel, dit Simone Weil, penser la question sur ses arêtes vives en renonçant tout simplement à cette idée saugrenue de toute-puissance. Ce concept est absurde. S'il ne permet pas de résoudre la question, il faut donc le dissoudre.
En effet, créer n’a de sens, dans cette logique de toute-puissance, qu’à la condition d’améliorer au moins un peu la condition initiale. Mais c’est ce que Dieu même tout-puissant ne saurait faire : puisque la situation initiale, étant Dieu lui-même, est absolument infinie et parfaite. Mieux : Dieu, aussi puissant soit-il, ne pourrait pas faire mieux que ce qu’il est (puisqu’il faudrait se créer soi et donc faire mieux que soi – soit s'auto-destituer, faire en sorte, donc, que Dieu ne soit plus Dieu) ni même aussi bien que soi (puisqu'il faudrait alors se renier en tant que divinité, Dieu étant l'absolu souverain, qui ne souffre pas d'équivalent). Dieu, s’il veut créer autre chose que soi, c’est-à-dire créer tout simplement, ne peut donc faire que moins bien que soi. Mais pourquoi avoir créé ce monde, étant entendu que tout le bien possible existait déjà en Dieu ? Par amour, répond Simone Weil. Dieu n’a pas créé autre chose que l’amour et les moyens de l’amour, mais non pas par un acte de puissance (puisque Dieu est le temps et l'espace) mais en s'absentant du monde afin de laisser l'espace vacant pour que le monde advienne. Le processus est dès lors enclenché, le néologisme peut prendre forme puisqu’au bout du compte rien n'est jamais créé mais toujours décréé. Le monde n’est advenu que parce que Dieu a su s’effacer, se retirer, s’absenter, comme L'homme s'évapore chez Shoei Imamurai, Une Femme disparaît chez Hitchcock. Il n’est dès lors pas le fruit d’un acte d'expansion, mais d’un retrait. Tout le contraire d’un plus d’être, de joie ou de force. Autrement dit, une diminution, une faiblesse, un renoncement.
Transposé à l’univers cinématographique, on pourrait dire que le cinéma est ce qui en creux célèbre « la formidable absence, partout présente[xiv] ». Simplement parce qu’ « il faut être dans un désert, car celui qu’il faut aimer est absent[xv] », autant que la réalité sera toujours faite d'une part manquante au cinéma : filmer, c'est nécessairement désertifier la réalité. Il faudrait alors partir en quête d'un nouveau Zabriskie Point au cinéma, reparcourir les paradis perdus de l'Amérique de Gerry comme la netteté des images du disparu dans Blow Up d'Antonioni faisait déjà signe vers une autre conception du cinéma : plus les images s'y agrandissaient, plus elles devenaient floues. Ainsi, plus le cinéma voudrait s'augmenter dans les images de son cinéaste, plus il (s')icôniserait, plus il deviendrait écrasant jusqu'à rendre invisible la réalité qu'il entendait pourtant faire surgir de son objectif. Dans chacun de ces films, le point de vue unique est éclaté au profit d'une multitude de perspectives, un thème rejoué variation après variation dans Smoking/No Smoking d'Alain Resnais où deux comédiens nous proposent plusieurs versions de leur vie. Il serait donc temps de renoncer à la logique objectiviste du réalisateur omniscient et omniprésent, sortir de la vision du cinéaste panoptique en mesure de capter objectivement la vie comme elle va dans son ruissellement. Envisager autrement la création cinématographique : elle ne sera jamais le produit d’un acte de puissance, mais celui d’un retrait, d’un renoncement., d’un renoncement. Pour une raison évidente : l’activité de l’objet « film » infini et parfait est une absurdité à l’état pur. À trop se remplir un tel cinéma finirait par se dévorer. Un cinéma anthropophage qui deviendrait le contraire de ce qu’il célébrait : un cinéma de non vie. Autant dire un cinéma mort. C’est au contraire sous la forme de l’absence, du secret, du retrait, que le cinéma peut advenir. La signature en est la trace qui témoigne dans un même geste, mais par un vide, de la présence, du passage de l’auteur, mais aussi de son absence.
Pour sortir du dilemme, il faut alors accepter l’idée que créer ne consiste pas simplement à remplir la pellicule, c’est creuser le sillon du vide. Filmer, c'est poser un cadre : éliminer des images par d'autres images, non pas créer, mais bien décréer. Il n'existe pas de vue possible sur la réalité sans point de vue. La création est toujours une diminution, jamais un acte d’expansion, insistait Paul Valéry[xvi]. Et si tout le monde a ses raisons, disait La Régle du jeu de Renoir, le cinéma ne saurait toute les embrasser. Le cinéaste peut alors être pensé autrement, comme ne commandant pas partout où il en a le pouvoir : quand il décide de cadrer, décadrer, recadrer, sa décision est toujours une vacillation entre plusieurs options. Un cinéaste n'ignore pas qu'il devra toujours libérer de la place pour faire espace et durée dans son film, une manière de ne pas craindre le passage du témoin au spectateur afin que se mette en place une écriture à plusieurs mains comme les témoins d'une scène de crime se multiplient dans Rashômon d'Akira Kurosawa. Une relativité du point de vue retranscrite cinématographiquement par la disposition de différentes caméras, de sorte que le spectateur puisse participer à l'enquête, y trouver sa place comme son lieu d'être. Entre chacun, il y a dès lors la promesse d’une rencontre, non plus seulement l’espoir d’un film à rencontrer. L’aveu même de cette faiblesse, de ce manque, de cette impuissance, de ce cinéma éparpillé, mis en morceaux, ne serait plus alors le signe d’un échec. Il deviendrait au contraire l’indice d’une vie possible. Le paradoxe n’est plus qu’apparent. Cette contradiction devient « l’obstacle tremplin » qu’il faut sans cesse affronter pour que se déclenche le processus de décréation. Un processus qui permet finalement de répondre en filigrane à la question qui sourd du récit cinématographique : qu’est-ce qu’un film, sinon une certaine idée de l’absence, son retrait, sa distance (qu’on nomme l’espace), son attente (qui convie le temps), son empreinte (qu’on appelle la beauté) ? Soit le contraire même de la pesanteur que Simone Weil appelait la grâce.
Si l’impossible du cinéma, c’est le cinéma lui-même, il faut alors aller vers un cinéma qui le rend un peu plus impossible encore comme Citizen Kane recueillait cinq point de vue différents pour connaître impossiblement la vérité sur Charles Foster Kane. Un cinéma qui doit « mieux rater » (Beckett) que ce qu'il n'a fait jusqu'à présent. Encore faudrait-il que le spectateur trouve sa place, encore faudrait-il qu'il se responsabilise. À nous de construire nos récits. À nous, aussi, de faire image autrement.
Puissance de l'image
Le cinéma possède en lui son antidote. Il est son propre pharmakon, le remède au poison du magistère tout-puissant du réalisateur. Le cinéma, depuis sa technique afférente, interdit d'héroïser le cinéaste. L’œil caméra emporte avec lui une telle multiplicité de points de vue possibles qu'il s’accompagne de l’impossibilité de tous les adopter dans la simultanéité. Comme l'indique François Laplantine dans son article, Penser en images, « Dès le début du cinéma, une multitude d’options se mettent en place qui seront par la suite affinées : de près/de loin ; en vision rapprochée (Rosetta des frères Dardenne)/en vision éloignée (Theo Angelopoulos) ; en accéléré/en ralenti ; en plans fixes (Manoel de Oliveira)/en plans éclatés et saccadés (de Dziga Vertov à Jean-Luc Godard) ; de manière frontale/latérale ; avec des images nettes/floues ; sombres et sous-exposées/claires et surexposées ; et évidemment en noir et blanc/en couleurs.»[xvii]
Le cinéma contient son contre-champ comme son hors-champ, ajoute l'auteur : « Entre le plan entier ou coupé, il existe encore le « plan américain » (à la hauteur des hanches). Entre le frontal et le latéral, il est possible de réaliser des prises de vues inclinées, caméra à l’épaule (Lars Von Trier). Entre les images volontairement surexposées, comme dans beaucoup de films du cinéma novo brésilien, et le noir absolu de Blanche-Neige de João Cesar Monteiro, il est possible de faire osciller la luminosité qui, chez Friedrich W. Murnau ou Kenji Mizoguchi, tend vers le clair-obscur. En revanche, ce qui est matériellement impossible est de filmer à la fois en plan large (John Ford) et en gros plan (Carl T. Dreyer), en ralenti et en accéléré, alors que l’on a pu réaliser cette prouesse technique (pour la première fois dans Citizen Kane) consistant à filmer avec netteté dans un plan unique ce qui est proche et ce qui est loin, soit la profondeur de champ, procédé existant aussi en photographie.»[xviii]
La totalisation des points de vue est donc pratiquement une impossibilité. Le cinéaste, aussi stakhanoviste qu'il soit, ne sera jamais le petit dieu du peuple. Du réel il n’existe que des perspectives fragmentaires, parcellaires, non totalisables. Contrairement à ce qui se passe au théâtre, le cadre est un cache qui limite le champ visuel de celui qui regarde. Le cinéma est une expérience des limites du voir. Il nous incite à renoncer à l’illusion de la toute-puissance du voir. Dans le voir il y a du non-voir, du ne pas tout voir, du ne pas bien voir, du non-visible, de l’ombre (Brassaï, Murnau ou Fritz Lang)[xix].
Un cinéma qui voudrait tout dire, tout saisir, ne serait plus du cinéma. Il encarterait le monde dans son panneau publicitaire, en ferait son tombeau. Il ne proposerait que des images d'où la faim aurait disparue, des images où il ne manquerait rien. C'est toute la différence que faisait Serge Daney entre le visuel et l'image[xx]. « Le visuel, écrit François Laplantine à cet égard, c’est la saturation du voir, la plénitude, la vision immédiate, totale, transparente, absolue et pour ainsi dire obscène. Il n’y manque rien (voir les plans bien léchés des Aventuriers de l’arche perdue de Steven Spielberg) »[xxi]. Le cinéma fait au contraire cinéma quand il trouble le champ des représentations possibles, complexifie le réel, obstrue la clarté des concepts. Il devient un art de la résistance, antipode à ce cinéma pop-corn façon Seydoux : un cinéma de la digestion, qui avale, boulotte, ingurgite, mais ne rend pas. Qui occupe tout l'espace, procède par assomption. Un cinéma dont, paradoxalement, la netteté efface. L’image, en revanche, ne montre pas tout. Elle met en appétit. Il y demeure de l’incomplétude et de l’inachèvement, soit la possibilité de donner du sens au temps, de la durée, comme de l'espace au spectateur, afin qu'il cherche à comprendre. Mais sans jamais perdre de vue que nul ne peut rien comprendre. Ou qu’il n’y a rien à comprendre, sauf à se substituer au réalisateur, s'auréoler d'une majesté particulière. C’est constamment qu’il faut créer sa vérité. Nous ne pensons qu’obliquement, de façon fragmentaire, confuse, bafouillante. Notre seule manière d’avancer, c’est de tourner en rond dans les mêmes questions. De ressasser. Constamment. Et les images de nous y aider.
Il s'en dégage une conception indissociablement anthropologique et démocratique du rapport aux images qui suppose qu'il y ait en elle de l’altérité et de l’hétérogénéité, ce qui ne peut exister s’il n’y a dans l’image que de la positivité éliminant les contradictions. La plupart des images diffusées par les médias aujourd’hui interdisent de voir. Le cinéma y pourvoit. Il nous réapprend à regarder.
Pas de désespoir, finalement. La Flor, de Mariano Llinas, pour donner un exemple paradigmatique récent, resynchronise le temps, l'espace, où des femmes longtemps prisonnières reviennent de leur désert. Trop longtemps flouté, le film fait la mise au point. Treize heures au cinéaste pour déployer un monde baroque qui mêle les amours et les aventures de quatre femmes à l’histoire du cinéma, donc du monde. Un Frankenstein cinématographique composé à partir de milliers de cadavres ramenés à la vie par un docteur fou parce que l'histoire des femmes et des hommes est faite d'horreur, de poésie aussi. On a trop longtemps soufflé sur une fleur de pissenlit, qui a fini par s'envoler.

Pilar Gamboa, Elisa Carricajo, Valeria Correa et Laura Paredes dans "La Flor" - © ARP Selection.
Quel cinéma choisir, donc ? Un cinéma du vide contre toute forme les formes de satiété. Un cinéma qui ferait sien la dénonciation du moi, cet épieu constitutif de la conception de l'artiste, cette mythologie inhérente au langage et à la métaphysique immanente à la structure de la phrase régie par le sujet, qui « pose » la réalité. Avec la supposition que derrière toute forme d'interprétation (imagière, scénaristique...), il y a un sujet, un interprète précis : le cinéaste. Cette histoire-là, qui a jusqu’alors organisé autour du sujet et de sa propre unité les significations du monde, il faudrait en dissoudre son unité monolithique et rigide dans le flot proliférant de ses pulsions centrifuges. Si l’unité de ce moi-là est le produit d’une illusion millénaire mais anthropologique particulière, un changement de cap radical est possible. Comme le disaient Adorno et Horkheimer, le moi occidental est symbolisé par Ulysse, qui construit péniblement son identité et sa domination – sur Ithaque, sur son équipage et sur lui-même – en renonçant aux sirènes, à Calypso et à la fleur de lotus, autrement dit en résistant à la tentation de s’abandonner à l’indifférence béate dans le sein de la nature. Nietzsche en appellera au contraire à une inversion de ce processus. Il aspire à la dissociation du moi. Il en appelle alors à l’ivresse et à la puissance [xxii], qui ne doivent pas être identifiées à la domination, mais à la dispersion de ce moi dans le flux des sensations. La perception d’une infinité de choses minuscules et éphémères que sait si bien rendre le cinéma fait alors voler en éclats toute unité et toute hiérarchie, émancipe les détails de toute totalité et confère à chacun d’eux comme aux femmes, aux hommes, délivré de tout lien, une autonomie sauvage, des droits, enfin, égaux pour tous.
Ces éléments, il faudrait les laisser comme jalons du chemin qu'il faut s'ouvrir dorénavant. Car ce qui est donné ici, s'il faudra encore à coup sûr le conquérir, est peut-être en train d'advenir. Ce qui fait la valeur d’un discours, celui sur les abus et violences sexuelles, le racisme/la racisation (dans une moindre mesure et à regrets), sa puissance nutritive, ce n’est bien évidemment pas son volume, ni sa richesse apparente, mais l’âpreté de la faim, du manque d’être dont elle est née. La charge énergétique que cette tension irrassasiable a accumulée, il faudrait simplement la saisir aujourd'hui. Entendre ce discours, le laisser se confondre avec la tension qui l'habite, tâcher simplement de remonter à ses nombreuses sources, s'adjoindre le torrent dont il vient contre toutes les absurdités qui, sinon, nous ferons nous effondrer sur place.
David Fonseca
NOTES
[i]Une révolution sexuelle ? Réflexions sur l'après-Weinstein, Stock, Paris, 2018, 176 p.
[ii]Le regard féminin. Une révolution à l'écran, Editions de l'Olivier, Les Feux, Paris, 2020, p. 12.
[iii]La psychiatrie apprend au contraire que le violeur n'ignore pas l'absence de consentement de sa victime mais cherche à la réifier.
[iv]Sa sœur, Patricia Arquette, dénonçait il y a quelques jours, lors du festival Séries Mania, les insultes et grossièretés proférées par l'équipe technique sur le tournage de Lost Highway, réprimandées par David Lynch, mais continuées à être tournées dans la difficulté.
[v]P. Tabet, Les doigts coupés, La Dispute, Paris, 2018, 291 p.
[vi]P. Touraille, Hommes grands, femmes petites. Une évolution coûteuse : Les régimes de genre comme force sélective de l'adaptation biologique, MSH, Paris, 2008, 441 p.
[vii]Depuis 2012, il est devenu possible de décoder le génome fossile, ce qui a montré que les primates n'ont pas la conscience reproductive, ont installé des sociétés matrilinéaires : un chimpanzé peut tuer sa descendance (il copule hors sa tribu) quand il protégera toujours ceux de sa sœur, à laquelle il appartient.
[viii] J.-A. Perras, L’Exception exemplaire. Inventions et usages du génie (XVIe-XVIIIe siècle), Paris, Classiques Garnier, coll. Lire le XVIIe siècle. Série Discours historique, discours philosophique, Paris, 2015.
[ix]Quatre-vingt-un chapitres sur l’esprit et les passions, V, 4, Bibl. de la Pléiade, Les passions et la sagesse, p. 1199.
[x]Introduction à l’analyse structurale des récits, in Communication n°8, 1966, réed. Seuil 1981, p. 24.
[xi]La dissémination, Seuil, Coll. Tel Quel, Paris, 1972.
[xii]Voir par exemple La pesanteur et la grâce, pp. 42, 112-113 de la réed. UGE, « 10-18 », 1979, ou encore Attente de Dieu, Fayard, 1966, réed. « Livre de vie » 1977, p. 106, ou Cahiers, III, p. 91, Plon, 1994.
[xiii] Voir G. Kempfner, La philosophie mystique de Simone Weil, Nataraj, Paris, 2000.
[xiv]Alain, Les dieux, IV, 2, Bibl. de la Pléiade, p. 1324.
[xv]La pesanteur et la grâce, Folio Essais, Paris, 2002, p.112.
[xvi] Charmes, pp. 167-168, Gallimard.
[xvii] Ethnologie française, 2007/1, vol. 37, pp. 47-56, https://www.cairn.info/revue-ethnologie-francaise-2007-1-page-47.htm.
[xviii] Ibid..
[xix] Cf. J.Aumont, Doublures du visible. Voir et ne pas voir en cinéma, Presses Universitaires du Septentrion, Paris, 2023, 202 p.
[xx]Rapporté par François Laplantine, « Penser en images », ibid.
[xxi]ibid.
[xxii] Fragments 14 (117), in Fragments posthumes, Œuvres philosophiques complètes, T. XIV, tr. fr. J.-C. Hémery, Gallimard, Paris, 1977, p. 85..
POURSUIVRE LA LECTURE
David Fonseca, « Brainwashed de Nina Menkes : Réflexions sur le male gaze », Le Rayon Vert, 12 novembre 2023.
Cet article est d’abord paru dans l’excellente revue de cinéma belge “Le Rayon vert”, que nous vous recommandons sans la moindre hésitation.
30.04.2024 à 12:05
George Rodriguez réinvente le zodiaque en version mexicaine
L'Autre Quotidien

Texte intégral (2047 mots)
Le sculpteur mexicain George Rodriguez s’est inspiré du zodiaque chinois pour réaliser un zodiaque mexicain dans une série de sculptures intitulée Mexican Zodiac. S’il a commencé en créant les animaux du zodiaque chinois, il a eu ensuite l’idée d’en faire une version parallèle liée à sa culture d’origine.

« Lunar Vessel »
Son zodiaque mexicain a pris plusieurs formes, l’artiste modifiant les styles et les matériaux (bois, poterie,…), collaborant parfois avec d’autres créateurs également. Jouant à traduire les animaux asiatiques dans des animaux d’Amérique centrale, l’année du rat devient l’Año del Chapulín (sauterelle) et l’Année du Tigre el Año del Jaguar. Et ainsi de suite. On se croirait presque dans un vieux Jodorowski fiancé par John Lennon; genre El Topo !

« El Chapulin. »

«El Cacomixtle»

« Venado Azul. »
Plus de ses créations sur le site web de l’artiste ici
Jean-Pierre Simard avec Colossal le 1/05/2024
Le Zodiaque mexicain de George Rodriguez

Quetzacoal
24.04.2024 à 11:37
La regrettable/inopinée disparition de Serge Hesse
L'Autre Quotidien

Texte intégral (2456 mots)
Serge Hesse et son image au noir. Suite à la disparition du photographe Serge Hesse, survenue dramatiquement, dans l’invisibilité de tout un milieu très parisien de la photographie, d’une certaine photographie, il y avait celui qui archivait, déplaçait cette invisibilité d’un réel qui échappe toujours aux représentations reconnues et publiées, parce que non photographiables soi-disant, dans l’investissement et l’actualité d’un autre visage de nos sociétés, en le confrontant à ce qui le déterminait dans sa fonction politique et sociale, dans l’urgence du masque des solitudes « modernes », de l’aberration de ce qui fait faussement société, dans la mise au jour de tous ses artefacts. On peut considérer que ce travail au NOIR était une sorte d’épreuve de vérité et d’anthropologie sociale, rappelant l’inscription des Situationnistes et de leur énergie révolutionnaire, reprise dans un exercice quotidien du Voir contre la clôture du regard.

Serge Hesse – Boltanski
L’image est lente, sombre, mettant en avant, dans l’infra seconde de la prise de vue, cette prise de vies, à la multiplicité égrenante, redoublant, par sa fixité, la portée du fascinum, faisant parler tout le corps de l’image par le retentissement sombre des voix chères qui se sont tues, mémorial qui hante, en fantôme, le regard de Serge Hesse, pour en redoubler l’effroi, la beauté funèbre, la puissance d’évocation. L’image est faite par celui qui regarde, donnant une mesure à la proposition boltanskiene et à sa réception.
Un passage de témoins s’opère alors que, dédié au vent, à la mémoire, à l’histoire, à toutes les fragilités qui sont, de fait, l’histoire d’un trait, dans sa vibration somnolente, son impermanence, à l’érosion certaine, la voix devient comme Une, entre le plasticien et le photographe, passe le silence, pour évoquer les disparitions, mailles constitutives de tout une conscience funèbre, au travail, hier, aujourd’hui, demain, encore et encore dans le travail du deuil.
Voilà ce que je vois de cette photographie, ce qu’elle m’évoque, double objet du voir et de l’entendre, au silence répond le cri enfui, indicible. Reste l’image et la fascination qu’elle exerce sur ma perception, dans un interdit, un dédoublement, un voyage intérieur, un piège au regard, une fascination.
L’apparition d’une perspective à l’intérieur d’un visage doublé de sa propre perspective intérieure, sur fond de mer, dans un soleil de minuit, réfracte ce regard qui voit, et dont l’intensité ne peut qu’être méta-physique, mémorielle; évocation des forces qui paraissent parfois dans l’image et l’imaginaire, ici, afin d’emprisonner le regardant … déjà dans une forme que la photographie de Serge Hesse conçoit, dans une attitude surréalisante, pour garder, regarder comment l’installation use de l’image et l’utilise. ( la photographie est un plan à deux dimensions, alors que l’espace de l’installation se fait dans un co-présent et dans l’espace partagé du Musée, par le spectateur, qui vit en même temps l’installation et son mouvement. )
Ceci est d’une importance majeure, cette image est aussi référentielle au « système » de représentation du photographe…. Et si on la prend comme telle, sans avoir à se référer à l’œuvre source, elle apparaît alors, dans cette autre mesure, comme une image à la charge symbolique lourde, mobilisant un regard, qui, s’enfonçant dans l’image, ne peut se détacher du mouvement qui revient au point de départ, dans une boucle sans fin. Le regard semble pris au piège, fasciné.
Un voile s’entre-ouvre sur une perte instantanée des repaires, icône plus qu’image, où se concentre le fantôme, l’apparition, le visage d’un féminin, pur, intact, dans une concentration idéale, idéelle, comme un sable mémoriel, propre à engloutir dans ce mouvement intérieur, tout regard. S’agit-il d’un cérémonial sacrificiel, par ce qui n’est plus et est toujours, malgré tout, permanent, arrêté, bloqué, signifiant l’impossibilité du deuil?
Cette photographie est un voyage impassible vers l’impossible oubli, un mouvement qui ne peut trouver de résolution, une nécessité vitale, entre ce qui est tombé et ce qui relèverait l’espoir, entre un ciel et une terre qui s’engloutissent dans un épuisement du regard, et reviennent au point de départ, comme une programmation d’un non sens.
Ce voyage s’assume comme un rêt, (ret*) qui tient éveillé et qui emprisonne, c’est une sorte de Fascinum, fascination, à la part invisible, devant ce qui a été nié, détruit, sacrifié dans l’abject, (l’installation source) et la fusion des plans de l’image photographique, rendant impossible le mouvement physique de traversée de l’installation, le passer à travers, dans une liberté qui assume la part du devoir de mémoire.
Tout se tient ensuite dans l’œil. On y retrouve la fascination ostentatoire de ce qui en disparaissant s’affirme encore plus réellement, dans ce qui flue, flux, de l’autre côté du miroir, comme dans un crépuscule, quand le soleil s’embrase et descend à l’horizon, laissant le jour disparaître; un entre deux mondes arrêté au crépuscule d’un passage qui disparaît graduellement, en ne cessant de signifier qu’il disparaît et qu’il émet toujours, même après sa disparition, toujours plus intensément, le point silencieux qui l’a porté à être, et qui ne peut se résoudre à disparaître, tenant dans ses rais ce qui fait humanité.
Pour autant un visage féminin s’impose dans un regret de ce qui attire et repousse le regard, revient sans cesse à la conscience, semblant y trouver une sorte de pacification tutélaire; un visage féminin à la beauté sourde et secrète, familière, dont le regard ne cesse de flotter, puis de s’agrandir, devient une sorte d’interrogation métaphysique devant ce qui a été sacrifié, hors de ce qui fit jusqu’alors Humanité…travail d’un deuil impossible à faire, confronté à ce mutisme de l’impossibilité d’un Dire…
D’où, vient, notre perception d’une disparition? …. dans la morsure et la trace qu’elle laisse en nous et qui survient ensuite comme réalité perceptible de ce qui a été. Une interrogation profonde se fait. Tout est devenu ambivalent, au point de faire mentir ce qui se dit dans la douceur apparente du visage; l’Histoire confronte l’abject à un certain point d’incandescence pour devenir trou noir, impossibilité de la représentation, conséquemment impossibilité de comprendre. La raison se trouve engloutie; se réfractent les soleils anciens dans une figure du sacrifice, dans un au delà, après le voile, où curieusement une proposition apaisante se fait par une évocation du sublime, du subliminal.
Ici, Serge Hesse touche à l’immémorial de la mer et du soleil, en arrière plan, résonances magnétiques, passage du voile, contamination à rebours de la Paix impossible, but avéré d’une traversée, d’un voyage, d’un rappel à l’enfer de Dante.
Est ce bien là le point ultime du plan, répondant à ces vers de Rimbaud qui me viennent “c’est quoi l’éternité, c’est la mer allée avec le soleil” dans une analogie, ou une métaphore, ici implicite.
On imagine que le photographe, grand lecteur de poésie vit ces vers dans leurs réalités plurielles et que ceux ci ont toujours une action secrète, quand le faiseur d’images se nourrit de l’expérience et des héritages qui font en particulier et en singularité, actes de création, évocations, passages, retours sur soi, retours à l’Histoire, ici vécue dans son impossibilité rationnelle.
Dans ce voyage de l’Ultime, de l’Absurde, de l’indicible, toute parole, semble devenue vaine, ne s’étend, comme un paysage brulé que l’étendue de ce regard de femme, dans son incertaine proposition, femme d’ici et d’ailleurs, ou vierge sacrificielle consacrée ?
Un ici et maintenant opère, également une certaine lecture des figures mythologiques, vécues intérieurement, approchées dans leurs forces à imposer des liens subtils dans une création, qui vit en dedans de soi et qui tourne son regard vers cette unité fragile, hypnotique, aux sources indicibles, dans une sorte d’inconscience qui parle, tout de même, au delà du voile, dans cette division du plan, pour évoquer un visage qui s’éclaire intérieurement et qui appelle toute la magie ancienne de Circé à Pluton. Les temps de l’apocalypse sont une concrétion et se déplacent, se répondent.
Voyage au pays de Cérès aussi, puisque l’espoir luit doublement par l’étoile (le soleil est une étoile) mais voilé. Comment retrouver ce qui est vivant en soi, sans passer par la décomposition du visage même de la mort. Ce Travail au Noir, remarquable, trouve dans cette image une part de ce qu’il est, entre inconscient et conscient, entre visible et invisible, entre connu et inconnu, dans une sidération.
Serge Hesse parvient par cette image à pousser les portes d’une conversation secrète avec lui même, dans une objectivation sensible versée à la perte et au recouvrement de l’obscur; travail des profondeurs et de l’intensité dramatique dont il se charge, aux portes du conscient d’où il parle silencieusement, en fabriquant une poétique conjointe de l’enfouissement et du surgissement, du domaine des ombres à la figure miraculeuse de la mère divine, ici funèbre et sacrée, interdite, impénétrable en vérité, évoquant la Mère divine, Isis, Marie, Mère, Épouse, Vierge douloureuse, figures irréductibles, ouvrant sur une proposition plus actualisante que déréalisante, plus englobante, dans son rapport au numineux et à la vie, car ce « touché » est le signe funèbre d’une grâce qui délie et lie en même temps, provoquant le Souffle dans sa Raison au point de surgissement d’un espoir de rédemption. Tout voyage est amer, aurait écrit le poète.
Le photographe marche en lui et dans le monde, sans séparation, quand une inquiétante étrangeté advient, en commuant le deuil impossible par une réfraction de ce fascinum, propre à établir, dans l’intimité profonde de l’être, un bord du dire, ce dont l’indicible, l’innommable, l’absurde, serviraient ici à imposer déréliction et forclusion .
Au delà, en deçà, est et reste cette photographie, autonome, à l’imparité de la raison impossible à rendre, dont le fascinum reste un envoutement funèbre qui ne cesse d’osciller entre l’ici et maintenant et l’ailleurs, un autre temps sans fond, sans âge, pourtant datable historiquement par le passage du miroir menant à cette paix impossible, dont tout le mérite est déjà d’avoir mené le retour de cette femme impassible, Joconde interdite, beauté énigmatique et mystérieuse, aux limbes d’une possibilité d’un Dire et dont le secret est déjà celui de regarder intensément ce regardant, ce récipiendaire du temps présent.
Reste cette photographie qui situe le mouvement incessant d’une Fascination, dans un flux permanent, s’attache au constat de notre actualité en cette guerre contre l’Ukraine, et si Poutine osait l’enfer pour nous occidentaux, ne seraient on pas plongés en pleine stupeur, en plein interdit, au cœur du Drame?
Pascal Therme, le 2 Mars 2022.
Serge Hesse et son image au noir
** aussi, Ret est une abréviation, qui signifie : Reticulum, Reticuli, le nom latin et son génitif de la constellation du Réticule …
Reticuli est une étoile double qui peut être résolue à l’œil nu à condition d’avoir une excellente vue et de disposer de bonnes conditions d’observation car les deux étoiles qui la composent sont à la limite de la visibilité
23.04.2024 à 20:06
Daldam réinvente le tatouage asiatique à la verticale
L'Autre Quotidien

Texte intégral (1720 mots)
La tatoueuse coréenne Dami Nam alias Daldam réalise de magnifiques tatouages asiatiques verticaux jouant avec une forme rectangulaire. Sur un espace de peau très réduit, elle créé des motifs complexes et raconte des histoires inspirées par la culture de l’est de l’Asie. Etonnant à plus d’un titre. Voyez …

Passionnée depuis toujours par le dessin et la peinture, Nam rêvait de trouver un emploi dans un domaine lié à l’art. Malheureusement, elle a été déçue lorsque son travail en entreprise ne lui a pas permis de dessiner.
Par chance, un ami du secteur de l’art corporel lui a suggéré de devenir tatoueuse pour renouer avec sa passion pour l’art. Cela fait maintenant plus de sept ans qu’elle tatoue et a même mis en place un système d’apprentissage dans son studio de Séoul.
Dans ses dessins verticaux, le paysage est parfaitement contenu dans un étroit cadre rectangulaire, à l’exception d’un personnage ou d’un élément architectural qui se détache pour ajouter une touche cinématographique au tatouage.


En plus des scènes réelles, Nam a crée également des designs reflétant la culture pop de la région, que ce soit des graphismes inspirés des Pokémon, de Mulan ou du Studio Ghibli.
Voici quelques tatouages asiatiques verticaux par Daldam:
(Plus de ses créations sur le compte Instagram de cette tatoueuse ici)
Jimmy Cricket, le 24/04/2024
Les tatouages asiatiques verticaux de Daldam

16.04.2024 à 11:34
Les Oiseaux du temps défont les préjugés, mais pas que
L'Autre Quotidien

Texte intégral (3943 mots)
Un court roman épistolaire d’une rare brillance, mêlant intimement guerre à travers le temps, sentiments improbables et poésie politique. « Les oiseaux du temps » s’inscrit dans la précieuse zone des chefs-d’œuvre (ici, très paradoxalement) intemporels. Un peu comme la rencontre pas si fortuite d’Ernst Jünger et de Donna Haraway, de Gérard Chaliand et de René Char, sur une table de dissection des sentiments abandonnée aux courants de l’Histoire.

Quand Rouge gagne, il ne reste qu’elle.
Le sang nappe ses cheveux. Elle exhale de la vapeur dans la dernière nuit de ce monde mourant.
C’était amusant, songe-t-elle, mais cette pensée la gêne aux entournures. C’était propre, au moins. Remonter les fils du temps vers le passé pour s’assurer que personne ne survivrait à cette bataille et ne contrarierait les futurs prévus par son Agence – des futurs dans lesquels l’Agence règne, dans lesquels Rouge elle-même est possible. Elle est venue nouer ce brin d’histoire et le brûler jusqu’à ce qu’il fonde.
Elle tient un cadavre qui a été un homme, les mains gantées par ses entrailles, les doigts serrés sur l’alliage métallique de son épine dorsale. Elle lâche prise et l’exosquelette cliquette contre la pierre. Une technologie grossière. Antique. Bronze contre uranium appauvri. Il n’avait aucune chance. C’est la finalité de Rouge.
Après une mission plane un silence grandiose, définitif. Ses armes et son armure se replient en elle comme des roses au crépuscule. Une fois que les pans de pseudopeau ont repris leur place et guéri, que la matière programmable de ses vêtements s’est retissée, Rouge ressemble, de nouveau, vaguement à une femme.
Elle arpente le champ de bataille, cherchant, vérifiant.
Elle a gagné, oui, elle a gagné. Elle est certaine d’avoir gagné. N’est-ce pas ?
Les deux armées gisent, mortes. Deux grands empires ont fait naufrage ici, chacun perçant de son écueil la coque adverse. C’est pour ça qu’elle est là. D’autres s’élèveront sur leurs cendres, plus adaptés aux desseins de son Agence. Et pourtant.
Il y avait quelqu’un d’autre sur le terrain – pas un rampant, comme ces cadavres embourbés dans le temps qui jonchent son chemin, mais un véritable adversaire. Quelqu’un de l’autre camp.
Peu d’agents tels que Rouge auraient senti cette présence contraire, mais elle est patiente, solitaire, prudente. Elle a préparé cet affrontement. Elle l’a visualisé, en amont comme en aval. Quand les vaisseaux n’étaient pas à l’endroit prévu, quand les capsules de sauvetage n’ont pas été éjectées au moment prévu, quand certaines fusillades se sont produites avec trente secondes de retard, elle l’a remarqué.
Deux fois, c’est une coïncidence. Trois fois, c’est l’œuvre de l’ennemi.
Mais pourquoi ? Rouge a atteint son objectif ici, se dit-elle. Toutefois, les guerres regorgent de causes et d’effets, de calculs et d’étranges attirances, a fortiori les guerres dans le temps. Une vie épargnée peut compter davantage pour l’autre camp que tout le sang qu’a fait couler Rouge aujourd’hui. Une fugitive devient reine, scientifique ou pire, poète. Ou son enfant le devient, ou un contrebandier avec qui elle échange son blouson dans un spatioport lointain. Et tout ce sang pour rien.
Tuer devient plus facile avec le temps, en matière de technique, de mécanique. Mais pour Rouge, avoir tué, non. Les autres agents ne vivent pas les choses de la même manière – ou s’en cachent mieux.
Deux guerrières de camps opposés, deux combattantes que tout sépare ou devrait séparer : soldates des forces spéciales de leurs puissances respectives, elles participent de près à une vaste manipulation souvent sanglante qui se joue non pas à travers l’espace, mais à travers le temps : s’assurer, quel qu’en soit le coût humain « local », que l’Histoire suivra les bons rails, ceux qui garantissent le mode de vie futur de leurs factions à chacune. Soldates de l’extrême, capables de faire la différence à tout moment du passé, en aiguillant, en tordant, en prévenant ou en intervenant très directement et aussi discrètement que possible, néanmoins, Rouge et Bleu devraient se détester, et très mal réagir lorsqu’elles sont amenées à se croiser sur le terrain. Et c’est comme une sorte de teasing sophistiqué, de jeu avec les nerfs de l’autre, que commence l’impensable : l’entretien d’une correspondance entre elles, hautement rusée et parfois quelque peu machiavélique. À travers ces échanges d’abord dignes d’un jeu cruel, où les provocations rivalisent avec les tours de passe-passe et les tortures psychologiques à distance, quelque chose de radicalement différent et improbable se développe pourtant : quelque chose comme le début d’une sororité, voire d’une amitié, voire davantage, et en tout cas le début d’un questionnement réciproque dans lequel le « Pourquoi nous combattons ? » devient à la fois cible et enjeu.

Ma si insidieuse Bleu,
Comment commence-t-on ce genre de choses ? Cela fait bien longtemps que je n’ai pas engagé une conversation. Nous ne sommes pas aussi isolés que toi, pas autant enfermés dans nos propres têtes. Nous pensons publiquement. Nos notions s’informent, se corrigent, s’étendent, évoluent. Et c’est pour cela que nous gagnons.
Même durant les entraînements, les autres cadets et moi nous connaissons comme l’on connaît un rêve que l’on a fait enfant. J’ai salué des camarades que je pensais n’avoir jamais rencontrés, pour découvrir que nos chemins s’étaient croisés dans un coin étrange du cloud, avant que nous n’ayons fait connaissance.
Du coup, je ne suis pas trop douée pour la correspondance. Cependant, j’ai scanné assez de livres et indexé suffisamment d’exemples pour m’essayer à l’exercice.
La plupart des lettres commencent par une adresse au lecteur. Cela étant déjà fait, je peux passer au sujet qui nous intéresse : je suis désolée que tu n’aies pas pu rencontrer le bon médecin. Elle est importante. Plus précisément, la fille de sa sœur le deviendra si elle leur rend visite cet après-midi et qu’elles discutent des motifs récurrents dans le chant des oiseaux – ce qui aura été fait quand tu liras ces lignes. Les ruses que j’ai utilisées pour qu’elle échappe à ton emprise ? Une panne de moteur, un beau jour de printemps, une suite de logiciels trop efficaces et trop bon marché pour être honnêtes, que son hôpital a achetés il y a deux ans et qui permettent au bon docteur de travailler depuis chez elle. Ainsi, nous tressons le Brin 6 et le Brin 9, et notre glorieux futur de cristal brille si fort que je vais avoir besoin de lunettes de soleil, comme dit le prophète.
En repensant à notre dernière rencontre, j’ai préféré m’assurer que tu ne pourrais subvertir un autre rampant, d’où l’alerte à la bombe. Un procédé grossier mais efficace.
J’apprécie ta subtilité. Toutes les batailles ne sont pas grandioses, toutes les armes ne sont pas féroces. Même nous, qui combattons à travers le temps, oublions la valeur d’un mot prononcé au bon moment, d’un bruit dans le bon moteur, d’un clou dans le bon sabot… Il est si facile de détruire une planète que l’on peut négliger la valeur d’un murmure susurré à la neige.
S’adresser au lecteur : c’est fait. Parler de nos affaires communes : fait aussi, ou presque.
Je t’imagine en train de rire en lisant cette lettre, incrédule. Je t’ai vue rire, je crois, dans les rangs de l’Armée toujours victorieuse, tandis que tes marionnettes incendiaient le Palais d’été et que je récupérais ce que je pouvais des merveilleux mécanismes d’horlogerie de l’Empereur. Tu marchais, hautaine et farouche dans les couloirs, pourchassant un agent sans savoir qu’il s’agissait de moi.
Alors j’imagine le feu qui miroite sur tes dents. Tu penses t’être introduite en moi – avoir semé des graines ou des spores dans mon cerveau, quelle que soit ta métaphore végétale préférée. Mais ceci est ma réponse à ta lettre. Nous avons désormais entamé une correspondance. Et si tes supérieurs la découvrent, elle déclenchera une série de questions que tu jugeras, je pense, inopportunes.
Qui infecte qui ? De mon temps, nous savons qu’il n’y a jamais deux chevaux sans Troie. Répondras-tu, instaurant une complicité, poursuivant nos traces écrites autodestructrices, juste pour avoir le dernier mot ? Prendras-tu tes distances, laissant ma note dérouler ses mathématiques fractales à l’intérieur de toi ?
Je me demande ce qui me plairait le plus.
Enfin : conclure.
C’était amusant.
Mes hommages aux vastes membres de pierre sans tronc,
Rouge

Court roman épistolaire, triplement consacré par les prestigieux prix Hugo, Nebula et Locus à sa publication en 2019, « Les oiseaux du temps » (on pourra préférer l’étrange saveur descriptive du titre original : « This Is How You Lose the Time War ») – traduit en 2021 par Julien Bétan pour les éditions Mü – est la première collaboration de la Canadienne Amal El-Mohtar et de l’Américain Max Gladstone.
Pouvant d’abord apparaître comme une sorte de relecture malicieuse du « Grand jeu du temps », le roman qui valut au grand Fritz Leiber son premier prix Hugo en 1958, roman dans lequel les Araignées et les Serpents se livraient en effet une guerre sans merci à travers les âges en modifiant sans cesse à leur profit ultime les paramètres de l’Histoire (et roman qui fut toujours, de façon quelque peu inexplicable, largement négligé en France malgré quelques tentatives éditoriales en 1964 et en 1978), « Les oiseaux du temps » intègre toutefois immédiatement une forme rare d’esthétique politique que l’on trouve plutôt habituellement du côté de Iain M. Banks (avec ses agentes ou agents des Circonstances Spéciales établis sous couverture profonde au sein de civilisations moins avancées – on songe ainsi à « Inversions » en 1998 ou à « Trames » en 2008), voire de Doris Lessing (et des manipulations au long cours conduites par les grandes puissances stellaires dans son monumental « Canopus dans Argo : Archives » de 1979-1983) – et l’aspect très directement exo-militaire résonne joliment avec la création de Laurent Genefort dans son « Opexx » de 2022.
C’est pourtant l’écriture elle-même qui vient distinguer cette longue nouvelle (ou court roman) en mêlant étroitement et avec un art imparable les registres de l’intrigue maligne, du billard à beaucoup de bandes, de la guerre et de la poésie la plus authentique : avec elle, « Les oiseaux du temps » s’inscrit dans la précieuse zone des chefs-d’œuvre (ici, très paradoxalement) intemporels. Un peu comme la rencontre pas si fortuite d’Ernst Jünger et de Donna Haraway, de Gérard Chaliand et de René Char, sur une table de dissection des sentiments abandonnée aux courants de l’Histoire.
Ma chère Rouge, aux crocs ensanglantés,
Tu avais raison : j’ai ri. Ta lettre était fort bienvenue. J’ai appris beaucoup de choses. Tu imaginais le feu luisant sur mes dents ; connaissant l’attention extrême que tu portes aux détails, je me suis dit qu’il fallait pimenter un peu les choses.
Je devrais peut-être commencer par des excuses. Ceci n’est pas, je le crains, le présage que tu attendais ; pendant que tu écoutes mes paroles, tu devrais réfléchir sur à qui appartenaient ces os évidés et percés constituant ma lettre. Ca pauvre pèlerin qui aurait pu exister ! Pourquoi laisser des traces écrites autodestructrices, quand on peut se livrer à une session de gravure tout en détruisant une ressources ennemie, et laisser le vent venir chatouiller l’ivoire ?
Ne t’inquiète pas : il a eu une belle vie. Peut-être pas celle que tu aurais voulu qu’il mène : malheureux mais utile à la postérité, accueillant les plus faibles, criblant les cartes perforées de l’avenir, une nouvelle vie après l’autre. Au lieu de construire un ermitage, il est tombé amoureux ! Il a composé de magnifiques morceaux de musique avec ses amis, a beaucoup voyagé, a tiré des larmes à une impératrice, a fait fondre son cœur, a fait passer l’Histoire d’un sillon à un autre. Si je ne m’abuse, le Brin 22 croise le Brin 56 et, quelque part en aval, un bouton a fleuri, gonflé de promesses.
Je suis flattée de ton attention soutenue. Sois sûre que je t’ai observée longuement, intensément, pendant que tu assemblais mon petit projet artistique. T’immobiliseras-tu ou te détourneras-tu vivement quand tu te rendras compte que je t’observe ? Me verras-tu ? Dans le cas contraire, imagine que je te fais signe ; je serai alors trop loin pour que tu puisses distinguer ma bouche.
Je plaisante. Quand les vents tourneront, je serai partie depuis longtemps. Tu as quand même regardé, non ?
Je t’imagine aussi en train de rire.
Dans l’attente de ta réponse,
Bleu
Hugues Charybde, le 17/04/2024
Amal El-Mohtar, Max Gladstone - Les Oiseaux du temps - éditions Livre de poche
L’acheter chez Charybde, ici

08.04.2024 à 16:49
Terre d'enfance de Niki de Saint Phalle
L'Autre Quotidien

Texte intégral (3911 mots)
Face à la noirceur, une vie de jeu et un jeu de la vie tout en rayonnement solaire – superbement exploré au fil des cartes déjà distribuées ou créées au fur et à mesure.

« Moi, je m’appelle Niki de Saint Phalle, et je fais des sculptures monumentales. »
Elle est assise au fond d’une demi‐sphère orange, un fauteuil‐œuf qui engloutit son buste sanglé dans une veste blanche de karatéka, d’un coup elle se redresse, croise les bras, pose son menton sur sa main, darde un regard bleu très fardé, elle dit ça. Elle dit « moi je », elle fait claquer les syllabes, elle prononce le p de « sculpture », elle fait rimer « Saint Phalle » avec « monumental ». Elle est insolente, moqueuse et bien campée, elle a l’air de s’amuser follement, elle ne s’en laisse pas conter, avec ses airs de Madone pop elle pourrait bien rugir comme le lion de la Metro‐Goldwyn‐Mayer. Puis elle se renverse en arrière, fait pivoter le fauteuil : elle disparaît.
C’était en 1966, la bande‐annonce d’un ballet de Roland Petit, Éloge de la folie. Avec Jean Tinguely et Martial Raysse elle en a conçu les décors, et même un peu plus : elle a semé la scène de sculptures colossales, de géantes sans visage, gravides et colorées. Les danseurs s’en saisissent, délicats et ternes dans leur justaucorps noir, leurs collants gris, ils épousent leurs formes pleines, leur insufflent mouvement et vie, ils les portent en triomphe.
Quelques décennies plus tard, c’est cette trace monumentale que l’on retient de Niki de Saint Phalle : les Nanas. Les enfants les dessinent à l’école, dans les expositions, les musées où on les traîne ils les regardent complices, courent se lover, comme les danseurs de Roland Petit, contre leur ventre, leurs cuisses, leurs seins démesurés. On ne va pas s’en plaindre, peu d’artistes ont, autant que Saint Phalle, annulé la distance avec l’enfance, tant d’autres ne sont connus que par une œuvre unique. Être à ce point identifiée aux Nanas, dit‐elle dans un entretien accordé en 1991, onze ans avant sa mort, ça l’a parfois un peu agacée, mais ça n’est pas grave. Pourtant, on ne peut s’empêcher de penser qu’elle disparaît dans ce monument‐là, qu’elle y est engloutie, comme la karatéka de 1966 dans sa sphère orange.
On l’identifie aux Nanas et on l’appelle Niki – sans trop savoir que Niki vient du grec nikē, qui signifie « victoire », et dont la ville de Nice tire elle aussi son nom : Nice où, très jeune, bien avant la vidéo karatéka, la rencontre avec Tinguely, l’Éloge de la folie, « Niki » a vécu, tenté de se tuer, été internée, subi des électrochocs, commencé à peindre. « Nanas », « Niki » – babil enfantin, diminutif affectueux, quoique un brin agaçant : appelle‐t‐on Picasso « Pablo », Gaudí « Antoni » ? Mais Saint Phalle est une femme, alors on s’autorise à la désigner par son prénom, comme on le fait pour les mannequins, les actrices, les autrices. À quoi s’ajoute qu’elle est belle, d’une beauté canonique et irréfutable, ça saute aux yeux, autant le dire d’emblée. Avant Nice, avant les électrochocs et les premières gouaches, quand elle n’était encore qu’une jeune patricienne promise à un avenir américain, luxueux, et mortifère, elle a d’ailleurs été mannequin. Elle a appris à jouer de sa beauté, à prendre la pose, elle sait donner du regard.
J’étais fort curieux de découvrir comment Gwenaëlle Aubry, après les magnifiques échappées romanesques de « Partages » (2012), « Perséphone 2014 » (2016) et « La Folie Elisa » (2018), allait inventer à nouveau une forme distinctive pour revenir presque quinze ans après sur le terrain de la biographie, terrain qu’avait parcouru si fort – au prix d’une douleur intime savamment maîtrisée – son « Personne » de 2009. Publié en 2021 chez Stock, « Saint Phalle – Monter en enfance » ne déçoit pas : pour rendre compte d’une vie complexe, aussi sombre que solaire et ne dédaignant jamais la possibilité d’un paradoxe, elle a su aller chercher dans les cartes à jouer, à penser et à rêver du Jardin des Tarots, en Toscane, œuvre d’une vie ou presque pour la grande plasticienne, de quoi inventer une approche spécifique, déjouant les pièges du récit linéaire sans se risquer à concurrencer l’exceptionnelle mosaïque construite un an plus tôt par Caroline Deyns dans son « Trencadis ».

Elle s’appelle Saint Phalle, et à l’âge de onze ans elle a été violée par son père. On pourrait commencer par là, tout reprendre à zéro. Elle est née le 29 octobre 1930, Catherine Marie‐Agnès Fal de Saint Phalle, et un jour de l’été 1942, son père, André Marie Fal de Saint Phalle, a « mis son sexe dans [sa] bouche ». C’est ainsi qu’elle le raconte dans Mon secret, l’un des trois courts récits qui composent son autobiographie, et qui prend la forme d’une lettre adressée à sa fille, Laura : « Chère Laura, l’été des serpents fut celui où mon père, ce banquier, cet aristocrate, avait mis son sexe dans ma bouche. » Elle dit tout et sans détour, cash, mais ces phrases nues tracées de sa main, et que le livre reproduit à l’identique, avec leurs américanismes, leur syntaxe et leur orthographe anarchiques, sont habillées par le dessin. Les mots lourds, les mots écrasants, « Peur », « Mort » ou « Viol », « Père », « Dieu » ou « Daddy », elle les enlumine, tel un moine médiéval, les orne de hachures, de traits sinueux et d’étranges pétales, elle en comble les vides, elle les fait serpenter. Elle signe « Niki », le prénom vif et clair que sa mère a substitué à celui, sage et blanc, d’Agnès, lequel fut choisi par son père en souvenir de l’une de ses maîtresses.
Elle s’appelle Niki de Saint Phalle, ces syllabes qu’elle fait claquer portent la victoire, le saccage et le sacre, sa vie entière elle jouera les cartes distribuées par ce nom, elle traquera la main triomphale.
Le saccage, c’est sous ce signe qu’elle a débuté, le saccage et la profanation. Avant les sculptures monumentales et les Nanas, elle a piégé dans des tableaux un arsenal de tueuse et de ménagère, poêle à frire et lame de rasoir, débris de vaisselle et pistolet, parfois aussi des jouets en plastique ou une dame de pique ; moulée dans une combinaison blanche, elle a, en pleine guerre d’Algérie, tiré à la carabine sur d’autres assemblages recouverts d’une couche de plâtre, fait exploser au .22 long rifle les poches de couleur enfouies sous cette surface immaculée. Elle a entendu le mot d’ordre dada : « Que chaque homme crie : il y a un grand travail destructif, négatif à accomplir. Balayer, nettoyer. » Sur des autels, autour d’un nu antique, elle a cloué des crucifix, une chouette taxidermisée, des nonnes en cornette, des moines en prière, puis, toujours à la carabine, les a ensanglantés de peinture noire ; elle a accouplé Kennedy et Khrouchtchev en un monstre phallique et bicéphale ceinturé de soldats de plomb, elle a sculpté des mariées blêmes et des parturientes au ventre de charognes, grouillantes de baigneurs démembrés ; les Nanas sont venues, leur plénitude aveugle, sphérique et bariolée (et à leur tête la Hon, « la plus grande putain du monde », construite, puis méticuleusement détruite, de concert avec Tinguely), mais aussi le ballet, le théâtre et les films – parmi lesquels Daddy, le très violent et sacrilège, le très dada Daddy – et, en fin de cortège, les Skinnies vagabonds et filiformes, modelés de vide et d’air. On peut être un grand artiste et peindre toujours le même tableau, écrire le même livre, faire varier à l’infini une même forme : elle n’a cessé de rebattre et de réinventer les cartes. Glissant dans les salles des musées, les rétrospectives, on est pris dans cette frénésie de métamorphose: « Liberté, écrit Tzara, hurlement des couleurs crispées, entrelacement des contraires et de toutes les contradictions, des grotesques, des inconséquences : LA VIE. »

Pour appréhender dans sa pleine profondeur de champ une vie aussi oscillante, aussi fureteuse et aussi potentiellement déroutante dans toute sa liberté que celle de Niki de Saint-Phalle, Gwenaëlle Aubry s’est penchée sur le jeu – jeu pratiqué et jeu rêvé, mais aussi jeu créant du jour dans l’épaisseur barricadée de la nuit. Si les cartes de tarot proposaient bien pour cela une forme secrète – et en tout état de cause, à tenter – de fil conducteur, elles étaient aussi, sans aucun doute, une bien tentante invitation à la cryptographie et au décodage, à la divination structurelle capable de donner tout son sens à une vie d’élans et de contrastes. Trouver au bout de ces sentiers ayant maintes fois bifurqué, et malgré la présence potentiellement accablante des traumatismes originels, l’enfant qui joue plutôt que le chameau qui supporte : conduisant avec opiniâtreté – mais sans jamais négliger la beauté qui rayonne souvent comme à l’improviste, son programme d’exploration et de remontée aux sources (forcément multiples, voire travaillées de résurgences secrètes), Gwenaëlle Aubry nous offre un fabuleux voyage esthétique et paradoxalement politique, parfaitement complémentaire de celui, sus-mentionné, entrepris aux côtés de Caroline Deyns, dans les engageants méandres d’une œuvre et d’une personne aussi célèbres que toujours à découvrir.
Comme de la chambre, comme des musées, elle est sortie du monde. «Il faudrait, écrit Heinrich von Kleist, faire le tour du monde pour voir s’il ne s’y trouverait pas, quelque part derrière, une autre ouverture. » Cette ouverture, elle l’a percée. C’est en Toscane, dans la Maremma : enfoui sous les chênes, les oliviers et les cyprès, épousant la pente d’une colline qui dévale doucement vers la mer, un jardin où reposent, placides, barbares et miroitantes, des figures nommées d’après les arcanes majeurs du tarot : La Force et Le Magicien, La Papesse et Le Fou, L’Empereur et Le Pendu, Le Monde et La Mort, La Justice, L’Impératrice, La Lune, d’autres encore – tous sont là. Leurs flancs pleins, sertis de céramiques et d’éclats de miroirs, leurs lignes frêles de Skinnies, abritent, outre ce jeu du hasard et du destin, des mythes anciens et des rituels naïfs, des gestes de conjuration et des peurs archaïques. À croire que le Jardin des Tarots a toujours existé, que Saint Phalle l’a, non pas créé, mais découvert, caché derrière une porte secrète du monde, enfoui dans un pli du réel.
Ce jardin, elle l’appelle son « destin ». Elle en a eu la révélation très jeune, en 1955, alors qu’elle arpentait l’Espagne avec son premier mari, l’écrivain Harry Mathews. Un jour, elle est entrée dans le Park Güell, construit par Gaudí sur les hauteurs de Barcelone, et elle a su d’évi‐ dence qu’elle devait faire ça : édifier à son tour un « jardin de joie », un « jardin des Dieux ». Ce fut, dit Bloum Cardenas, sa petite‐fille, « son jour Eurêka ». Saint Phalle a fait le tour du monde, détruit, construit, et des années après, en 1978, est venu le temps du Jardin. Pendant près de vingt ans, elle a travaillé à faire surgir des ondulations de la colline ce que Baudelaire nomme le beau bizarre. Modeler des maquettes de terre agrandies ensuite à l’échelle par Tinguely et son « œil médiéval », tresser d’arachnéennes armatures de fer, pulvériser du béton, mouler et cuire des céramiques, tailler et agencer des fragments de miroirs – mais aussi détourner les sources, apprivoiser les pierres, les épineux, le maquis de genêts et de genévriers, les troncs courbes des chênes et des oliviers : travail de pharaonne et de sorcière. Une équipe s’est peu à peu constituée : amis et collaborateurs de toujours, prince et princesse de Grèce, céramistes, maçons et jardiniers, postier et cuisinière, Tinguely, bien sûr, qui détestait le mot « artiste », préférait se dire « poète », au sens ancien, « celui qui fait », c’est tout, ou encore « bricoleur superlouche ». Des bricoleurs superlouches, donc, une tribu de princes‐ouvriers et de poètes‐artisans, dont les noms, mêlés à ceux de dieux antiques, sont gravés en caractères grecs sur les allées du Jardin.
Hugues Charybde, le 10/04/2024
Gwenaëlle Aubry - Saint Pahlle, monter en enfance - éditions Livre de Poche
l’acheter chez Charybde ici

13.03.2024 à 14:30
Ce que défend L'Autre Quotidien
L'Autre Quotidien

Texte intégral (714 mots)

Tout journal est politique. Celui que nous faisons ne se cache pas cette évidence. Son existence, qui n'était pas donnée, car personne ne nous a invités, est déjà en elle-même un fait politique. Nous faisons irruption. Nous entrons par effraction dans le champ bien gardé des opinions bonnes à entendre. Sachant qu'exister, c'est résister, nous avons fait le choix d'exister. Or choisir est l'acte politique même. Choisir avec qui on vit et travaille est politique. Choisir l'égalité des salaires est politique. Dénoncer l'injustice est politique. Accepter (et accepter réellement) de donner la parole aux autres est politique. Proposer des haïkus dans nos éphémérides est politique. Mettre le sort d'un journal dans les mains de ses lecteurs est politique. Ce qui implique à nos yeux de répondre avant toute chose à des questions légitimes sur l'origine de ce projet, notre financement, nos objectifs, l'idée que nous faisons de notre travail.
L'Autre Quotidien est parfaitement indépendant. Créé par des journalistes et géré par une association 1901 : Nuit & Jour, il n'a ni capital de départ, ni capital d'arrivée. Qui le finance ? Jusqu'à présent, ses abonnés. Est-il riche ? Non, il est pauvre. Il fait donc avec de pauvres moyens. Cela aussi, il est juste d'en prévenir.
L'Autre Quotidien n'est le cache-sexe ou le compagnon de route d'aucun parti ou réseau d'influence. Il n'en est ni membre, ni évidemment porte-parole.
L'Autre Quotidien ne prétend pas pour autant à la neutralité en politique. Dans le combat contre toutes les formes d'oppression, nous ne sommes pas neutres, nous sommes du côté de ceux qui s'organisent et résistent.
L'Autre Quotidien n'a pas le goût de la propagande. Quant à la communication, sa sœur jumelle dopée aux méthodes du marketing, nous n'oublions pas que c'est la Préfecture de police qui a inventé le communiqué. Les gens d'en bas ne "communiquent" pas, ils s'expriment. De leur bouche une parole naît, libre des pitoyables "éléments de langage". La communication et la propagande ne sont donc pas notre affaire. La recherche de l'expression juste est notre affaire.
06.02.2024 à 10:43
Saint-Vincent 2024 en Chambolle-Musigny et Morey Saint-Denis
L'Autre Quotidien

Texte intégral (4472 mots)
Cette quatre vingtième édition de la Saint Vincent se tenait ce dernier week-end de Janvier à Morey Saint Denis et Chambolle- Musigny. Les deux villages à la belle réputation œnophile sont voisins de quelques kilomètres, c’est pourquoi ils ont pensé partagé les dizaines de milliers de visiteurs venus déguster huit vins spécialement préparés pour cette fête mémorable, dont, à en croire les experts deux cuvées, la Cuvée Morey-Saint-Denis, et la Cuvée Chambolle-Musigny, toutes deux issues de la vendange des raisins de plusieurs vignerons du millésime 2022, spécialement élevées pour la Saint-Vincent 2024.

Promu à la dégustation et assez confidentiellement un Premier cru de Chambolle-Musigny ou de Morey-Saint-Denis, deux appellations village, deux cuvées spéciales Saint-Vincent et deux bourgogne Pinot Noir ont fait l’objet de bien des convoitises et de bien des attentes.





La manifestation s’est tenue sur le week-end des 27 et 28 Janvier dans deux ambiances climatiques bien différentes. Samedi, grâce à une journée magnifique, ensoleillée, les températures avoisinaient les douze degrés, presque autant que celle des rouges promus à la dégustation, Dimanche, beaucoup plus fraiche était un jour de brouillard à l’humidité pénétrante.



Les deux villages ont été vite saturés, victimes de leur succès, les dégustateurs bloquaient les rues pour entrer dans les caveaux qui dispensaient le divin breuvage à ce public impatient, tout en joie et en sourire. Le ciel était bleu, la lumière, enchanteresse, la convivialité, de circonstance, la surveillance, de bon aloi…. Saint Vincent, dans sa présence exerçait toute sa bienveillance à ces pécheurs repentis et tout de même assez en joie, en bonne maîtrise de leurs passions funestes, leur soufflant de préférer le mystère de l’eucharistie, celui de l’ivresse et de la poésie de l’incarnation dans ses joies divines, plutôt que de succomber trop souvent aux sacrifices de cette plénitude, qui donne aux pénitents l’absolution et le chemin du ciel…
Bref, ce fut une journée haute en couleur.
Le reste en musique, ici, en images, le reportage, in extenso ici
La Commune de Chambolle-Musigny : https://chambollemusigny.fr/
La Commune de Morey-Saint-Denis : https://lapagelocale.fr/21220-morey-saint-denis
La Confrérie des Chevaliers du Tastevin : https://www.tastevin-bourgogne.com/
Le Bureau Interprofessionnel des Vins de Bourgogne (BIVB) : https://www.vins-bourgogne.fr/
L’Association des Climats de Bourgogne : https://www.climats-bourgogne.com/
Office de Tourisme du Pays de Nuits-Saint-Georges : : https://www.gevreynuitstourisme.com/
Pascal Therme, le 7/02/2024
Saint-Vincent 2024 en Chambolle-Musigny et Morey Saint-Denis


24.01.2024 à 15:09
Double bang pour Stéphane Duroy avec expo chez VU et sortie en Poche
L'Autre Quotidien

Texte intégral (5538 mots)
A l’occasion de la signature de l’excellent photo poche (Actes-Sud) qui lui est dédié, préfacé par Hervé Le Goff, Stéphane Duroy est exposé à la galerie Vu, du 11 janvier au 24 Février, dans une exposition rétrospective qui embrasse 50 ans de photographies. et une bonne soixantaine de ses tirages, petits et moyens formats.

©Stéphane Duroy, Glasgow 1980
La galerie Vu se prête merveilleusement en la circonstance à cet exercice de la déambulation devant un accrochage parfait, rythmé, qui fait voyage, au sein de la production du photographe, membre de l’Agence depuis 1987. Grâce à ses quatre espaces, trois salles et un couloir assez long, on peut prendre le temps de re-nouer le dialogue avec la photographie de Stéphane Duroy, en recueillir la nervure, de s’y aventurer encore et toujours, tant elle surprend le regard, investit l’Histoire, fait document, œuvre, écriture; car c’est bien là, la particularité du photographe que d’être à la fois précis et juste dans ce qui s’affiche de l’ Histoire au sein de ces scènes de vie quotidienne qui en deviennent emblématiques, sans rien oublier de ce qui échappe toujours à la conscience du drame toujours à l’œuvre en cette Europe, territoires de l’holocauste et des migrations intérieures de l’Amérique du Nord dans la relégation de ses invisibles.
La photographie de Stéphane Duroy est essentielle à une compréhension de l’Histoire, du temps présent, tant elle est faite d’intensités, de mouvements, de présences, de ce regard précieux qui fixe en ses arcanes à la fois l’Histoire et l’histoire dans un a-perçu qui échappe au constat, qui se résout à mon sens en ce drama, toujours actif, dans sa théâtralité: les corps sont perturbés, visages fermés, étrangement calmes, corps à l’épreuve de leur énergie dans ce qui les oblitère, les occupe. Ils marchent, traversent le champ photographique, en courant pour exemple dans un décor de désolation, ici, cette rue aux immeubles de briques noircies, glissent vers un hors champ funèbre; l’énergie de leur passage a fait photographie, comètes en feu, point fuyant dans la nuit sociale, intensités brèves de leur inscription dans l’espace, marche lente, comme ces voitures qui passent dans une même corrélation et une énergie semblables. Chez Duroy rien n’est n’est vraiment montré, tout apparait, tout est question, interrogation, fuite en avant, même dans ces paysages glacés, immobiles, comme morts; le temps physique n’est plus ce temps cyclique qui établit les saisons, mais cet hiver gelé où tout repose, défait.
A l’épreuve du Réel, sa photographie, instinctivement fulgurante, demeure une abrasive et silencieuse question sur la société actuelle et ses inerties sur cinquante ans. Tout cela est partie vivante de cette écriture photographique qui s’empare de situations ou les corps, les villes, Liverpool, Dublin, Berlin, Katowice, Auschwitz-Birkenau, Lodz, Lisbone, Paris, Manhattan, le Montana situent très physiquement ce réel qui se recompose autour des paysages souvent urbains, à travers une banalité des situations issues d’ une photographie sociale, où ces damnés de la terre semblent n’être que les personnages falots d’une Comédie Humaine jouant dans un théâtre d’ombres et de glissements silencieux, de disparitions. Il semblerait qu’une contamination majeure, une irradiation, celle des camps, ait opéré un tel changement de paradigmes, que le monde ne peut plus être le monde d’avant mais son ombre artificielle, agi par un abandon complet, dans sa dereliction.
C’est bien cet héritage que Stéphane Duroy ne cesse de photographier, toutes ces années où il se déplace dans cette Europe contaminée, devenue une terre faussée, mal dite.

©Stéphane Duroy, Dublin 1981.
Il est ici question de ces oiseaux de solitudes, de ces êtres en plein désarroi sous l’emprise de la misère, de cette condamnation de l’Histoire, que Stéphane Duroy regarde, sans jugement, avec distance et douleur. Le photographe scrute ces corps à l’impassible message pour composer un portrait métaphorique d’une humanité vouée à la disparition. Son théâtre est un lieu de froissements, de situations au demeurant banales, mais chargées du drame encore à venir, de territoires iabandonnés, de lieux hantés par la folie destructrice des hommes, vidés de toute vie possiblement rédemptrice. Le gouffre et l’abîme semblent imposer à rebours la mécanique inéluctable de la solution finale, dans sa résonance. Le poison d’hier continue d’infiltrer le corps social, de contaminer la vie, de corrompre ce qui fait humanité, ville, pays, société.
Un drame invisible court sous l’image qui, de disparition en sacrifices, en relève la sidération , en note l’inertie, les mouvements, dans un univers ou tout est signifiant, ou tout détail juste prend place dans l’image, ouverte à tout ce qui la fonde sensiblement pour en faire une balise émettrice à travers la nuit du temps, dans un avertissement qui n’a jamais cessé. C’est là toute la résilience du photographe.
Duroy fait critique de nos sociétés après l’holocauste dans un renversement de l’Histoire, il n’y a plus de civilisation qui tienne, un immense chaos survient pour emporter ce monde vers la destruction et l’anéantissement, mais il le fait en peintre, en romancier, en écrivain, en song writer, en artiste insurgé. Il peint dans sa discontinué les images qui lui arrivent dans un théâtre de l’ absurde, surréel et poétique, quand, cette revanche impossible sur le réel ne semble plus pouvoir faire basculer l’Histoire du bon côté… Nous sommes irrémédiablement perdus, tel est le message sombre, le constat porté par sa photographie.
En quoi pourrait-on le nier, au vu de l’actualité de ces derniers mois, de ces dernières années, … quel sera notre avenir si aucune insurrection n’a lieu prochainement. C’est aussi la question sous-jacente que ne cesse de poser sa photographie, dans l’interrogation de ce regard habitué à faire parler les apparences en dehors de leur fausse banalité.

©Stéphane Duroy Halle, 1986
Si la révolte du photographe est une prise de position dans et par sa photographie sur le monde, il l’exerce également envers lui même par une forme absolue d’exigence dans son travail: sélection drastique de sa production d’images sur cinquante ans dans une volonté tendue. Stéphane Duroy ne fait aucune concession dans ce qu’il voit, dans ce qu’il montre. C’est un travail incorruptible, d’une exigence rare, sans complaisance aucune, au couteau. C’est pourquoi sa photographie induit une réflexion d’ordre politique, qu’avons nous fait du monde, qu’est-il devenu, qu’est-il en train d’advenir, en quoi la résonance de sa photographie est-elle un constat, une mise en garde contre l’obscurité et l’impossibilité du relèvement, d’une renaissance.
Ses photographies, petits « miraculums », narguent nos déterminations plus politiques, plus humanistes, plus heureuses, dans une dénégation qui fait provocations et nous oblige à réfléchir, à voir ce qu’il y a dorénavant de plus funèbre, voire de funéraire dans cette Europe, aujourd’hui emportée par le politiquement correct de l’abjection dans son cauchemar, moment où, curieusement l’histoire repositionne le grotesque et l’absurde du néant et du mal.
C’est pourquoi tout fait sens dans ce travail sur l’Histoire (une image juste), tant dans ces scènes de la vie sociale qui croisent objectivement le spectacle nu et froid de l’hiver, saison élue du photographe, que dans les paysages urbains qui établissent les villes aux points de rupture des régimes politiques de l’Europe de l’Est, là, où sont encore présentes les traces du meurtre du temps, de la Raison.

©Stéphane Duroy, rue Potnocna, Lodz, 1992.
Stéphane Duroy revient aussi bien sur ce que nous n’avons pas vu, ce qui nous a échappé et qu’il a si bien photographié, l’abandon progressif de toute contestation dans une attaque en règle des années Thatcher contre la classe ouvrière anglaise qui fait ici signes, dans ce commun qui éclaire la relation dialectique entre ce présent des vies et ce qui les a contraintes à être déterminées, en ces lieux, dans cette distribution des rôles.
Quatre personnages semblent seuls en eux mêmes, temps suspendu d’un infra-moment, comme si cette milli-seconde ouvrait une béance dans la permanence des choses, qu’une porte ait été ouverte sur l’intime, en chacun, en même temps; elle met en scène ce hors temps, ce hors champ, sans que la présence du photographe, qui saisit cette scène, l’extrait du visible, physiquement placé, à un ou deux mètres de ces personnages, ne soit notable ou interfère avec son sujet… on peut lire ce à quoi chacun pense, par quoi il est occupé, cette solitude lourde des réflexions sur la vie, les problèmes, le travail, les enfants, la famille, la fin du mois, le pub où s’échangent, autour d’une pinte ces solitudes; une solidarité est encore possible.
….Il y a aussi ce pardessus (Butte, MT 2014) qui apparait dans une vitrine, comme un rappel surréaliste, une évocation à la Breton de l’étrange, sorte de fantôme qui évoque l’empreinte et sa persistance, convoque la photographie sociale de la FSA, à un moment de l’Histoire qui semble faire de ce pardessus un cadeau issu de la mémoire des camps, dans l’ambivalent travail d’identification que porte toute photographie sans légende, dans ses renvois à une iconographie plus large, à ce que, pour exemple, Boltanski a mis en scène lors de sa dernière exposition à Beaubourg, il y a 4 ans, et qui semble toujours « raccord » avec certaines des photographies de Stéphane, un hors monde issu de la corruption des temps est versé à l’apocalypse et au funèbre.

©Stéphane Duroy, Berlin, décembre 1988.
Il y a aussi cette vue par dessus le Mur de Berlin de 1980 : lumière froide, sous la neige, l’image est centrée sur une perspective, une avenue qui file devant soi, large séparant deux villes, deux quartiers, par ce mur sombre, une voiture, une trabant dirait-on, sort du cadre sur la gauche, le paysage urbain, presque léger, semble a priori calme, sans aucune dramatisation. Ce pourrait être juste une photographie, un moment extrait du flux du temps, ce jour d’hiver ou personne ne marche dans cette rue, où tout parait tranquille et simple, ou tout est silencieux et vide…. Est ce une métaphore apaisée de la vie, de l’absence, voire de la mort au contraire, de la glaciation, une proposition de silence et de recueillement où une vacuité hante le référent historique de ce Berlin sous la neige…? Comment appréhender avec certitude ce qui fait photographie, sans ce référentiel de l’appartenance à l’Est ou à l’Ouest, dans leur opposition de système et de société, quand joue cette opposition de la partie sombre et de la partie claire, dans le jeu des ambivalences, là, où l’image n’affirme rien de si tangible que la permanence de ces interrogations, que voit-on au juste, qu’enregistre la photographie des réalités qui la composent?
Où sommes nous exactement? Tourne ainsi le mystère qui questionne et qui ouvre sur la fiction, le roman, qui glisse sur un film noir, tant la portée du regard de Stephane Duroy, est une partition où s’assemblent le rêve et son double, ombre invisible mais présente, quand une forme d’angoisse à peine perceptible domine la scène, s’ancre dans l’image, que celle ci se charge ou s’en libère par la seule perception de l’air, de la neige, de l’a-ttention qui en résulte, pour que se formule une sorte de proposition libre qui séduit, déplaçant le Réel vers d’autres champs ou un contre-rêve semble établir dans cette matière photographique subtile, un corps subtil, une image latente, voire rémanente qui circule en fond de tache, dans une autre couche de l’image, invisible mais prégnante, lorsque cette fausse réalité d’une avenue paisible en hiver, est à Berlin Est, où ce fantôme de la Liberté hante encore ce décor, en cette heure où tout repose.
Que comprendre alors du jeu de l’image et de son référent, de leur adéquation, comme de leur non adéquation… au moins la question se pose, même si la réponse n’est pas si évidente, l’important est cet effort de décryptage et de lecture des signes au delà de leurs apparences, s’attachant au corps de l’image (on pense à Antonioni, Blow Up, Profession Reporter) dans ce u’il livre à notre perception de l’invisible, à ce qui se dit du couple d’oppositions vrai/faux pour admettre qu’une image peut en cacher une autre, dont un double négatif. Il est question ici de palimpsestes, de ce qui circule comme forces de corruption dans le réel, du pouvoir d’hallucination, de voyance du photographe par sa photographie, de son système d’enregistrement du réel et de la puissance de la psyché de son auteur, Eyes Wide Open, qui ouvre ce regard lucide au monde environnant, comme un contre- regard éluardien qui transcende les apparences dans l’Amour. Duroy, lui, est aux prises avec cette sidération de l’absurde et de la disparition.

©Stéphane Duroy, Unknown, tentative d’épuisement d’un livre, 2017
Pour le regardant, tout d’un coup se sont constitués, sous ses yeux, un cadre, un décor, une action, des sensations, et surtout, un après et un ailleurs…. l’image est hantée, elle aussi, bien que camera clara, elle se trouve chargée, intensément du « climat froid, nocturne, physique, de son double, de son prolongement dans l’imaginaire, dans une forme de sur-réalité froide… à la portée de ces fantômes qui ne cessent d’y être chez eux, parlant, vaquant à leurs occupations quotidiennes, comme si, au fond en tout espace, en tout temps, le photographe ne pouvait faire l’ablation de cette mémoire dramatique, qui s’épanouit dans la part invisible de sa photographie, cachée sous la peau sensible de l’image, chuchotant les formules de conjuration et de renoncement.
La question toujours ouverte de l’Histoire sur ses territoires de l’Europe de l’Est et les enjeux de l’Histoire, la fin du bloc soviétique, le capitalisme en crise, se construit, pour Duroy, au présent de ce qu’il traverse par lui même, ce qui se produit devant lui, de ce qu’il photographie: le statut du réel et de ses enjeux, l’émergence après les faits et les évènements d’une volonté de savoir, d’estimer la justesse d’une image, sa pertinence historique, d’autant qu’elle n’est pas seulement document ou témoignage, mais écriture, mise à distance, énigme, passage secret de l’évidence de ces « ments le songe » pour s’extraire des apparences, se laisser approcher par ce qui interpelle au plus profond de soi, se déprendre des apparences dans la nécessité de cette double vue, de traverser le visible…..de retrouver et d’entendre au plus profond de soi ces voies chères qui se sont tues. Tout bouge sous la glace, la mémoire et l’amour, le temps de l’amère beauté et de l’enfance, la beauté qui apaise, l’insurrection qui augmente…la révolution d’un temps qui accomplit et qui honore, le succès et la certitude de la mort et de la disparition, un monde hanté par le chant…
Dans sa dé-couverte et son énonciation, faire énoncer par le signifiant, (la photographie dans sa forme), tout le signifié qui échappe en partie au photographe, mais dont il est à la fois le dépositaire et l’agent actif, le révélateur, le sujet, est un processus secret…. Duroy est un Vitriol qui agit sur la matière sensible de l’image et en fait un passage de témoin pour qui sait voir et entendre… c’est le challenge de l’œuvre dans ce qui se découvre alors à nos yeux, comme aux siens dans l’objectivation des preuves de l’Histoire et de son obscurcissement. Que dire de tous ces politiques et de ces gouvernants, qui, après cinquante ans, n’accouchent que de l’illusion suprême, en sacrifiant la vie du plus grand nombre à leurs profits et à leurs mensonges. Ment le songe dans sa réverbération hypnotique, où nous apparaissons comme des témoins à l’impassible sacrifice, mais au combat majeur.
Il est heureux que ce constat n’altère pas définitivement notre capacité à être et à refuser l’enfermement que proposent toutes ces formes de domination, pour autant que le retour du signifié ne peut altérer le champ symbolique qui fonde cette aptitude à être et à créer dans un jeu ouvert et partagé. Par son contenu manifeste, la photographie et son signifié interpolent le contenu latent dans une sorte de rêve éveillé contre-transférentiel….c’est pourquoi le fantôme de la Liberté, très bunuélien, semble également à l’œuvre, chez Stéphane Duroy, comme l’ombre d’un objet éclairé souligne un volume supérieur, en lui donnant sa dynamique. Il s’agit ici, entre espoir individuel et drame collectif, d’un redressement de la conscience devant l’inacceptable, d’une insurrection de soi dans le partage des signes avérés dans leur déploiement de la fin de l’Histoire et de la civilisation, du règne de la violence sans nom, de l’apothéose de la marchandise en tant que système décadent, mortifère, (le fétichisme de la marchandise) proposant l’ aliénation de tout sujet, alors que le projet d’une domination totale en acte est en cours.
La preuve en est cette édition et cette exposition qui parlent si clairement des ombres et de cette vérité qui tangue sous les travestissements de l’Histoire. C’est pourquoi le travail de Stéphane Duroy est si précieux dans ce champ de l’image et de l’imaginaire, pour nous aider à nous déprendre des ombres noires de l’illusion et regarder, en face, ces présents à l’altérité à conquérir.
Il faut sortir des paradigmes actuels si nous voulons nous hisser hors de la programmation de l’abject et du mal, pour retrouver ce qui nous fonde, dans un projet de l’Universel et de la Vie.
Pascal Therme, le 24 Janvier 2024
Stéphane Duroy - exposition -> 23/02/2024
Galerie VU - Hôtel Paul Delaroche, 58, rue Saint-Lazare 75009 Paris
Stéphane Duroy - Photo Poche - éditions Actes Sud
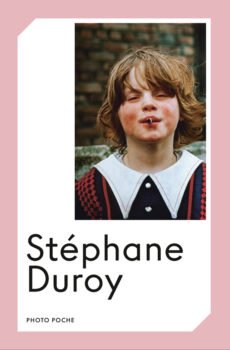
- GÉNÉRALISTES
- Basta
- Blast
- L'Autre Quotidien
- Alternatives Eco.
- La Croix
- Euronews
- Le Figaro
- France 24
- FTVI
- HuffPost
- L'Humanité
- LCP
- Le Media
- Le Monde
- Libération
- Mediapart
- La Tribune
- EUROPE
- Courrier Europe Centle
- Euractiv
- Toute l'Europe
- INTERNATIONAL
- Equaltimes
- CADTM
- Courrier International
- Global Voices
- Info Asie
- Inkyfada
- I.R.I.S
- Jeune Afrique
- Kurdistan au féminin
- N-Y Times
- Orient XXI
- Of AFP
- Rojava I.C
- OSINT / INVESTIGATION
- OFF Investigation
- OpenFacto°
- Bellingcat
- Disclose
- G.I.J.N
- MÉDIAS D'OPINION
- AOC
- Au Poste
- Cause Commune
- CrimethInc.
- Issues
- Les Jours
- Le Monde Moderne
- LVSL
- Marianne
- Médias Libres
- Quartier Général
- Rapports de force
- Reflets
- Rézo
- StreetPress
- OBSERVATOIRES
- Armements
- Acrimed
- Catastrophes naturelles
- Conspis
- Culture
- Extrême-droite
- Human Rights
- Inégalités
- Information
- Internet actu ✝
- Justice fiscale
- Liberté de création
- Multinationales
- Situationnisme
- Sondages
- Street-Médics
- Routes de la Soie
- Vrai ou Fake ?
