Accès libre Hymnes européens
07.10.2025 à 17:36
Guerre en Ukraine : chronologie des événements

Cette chronologie non exhaustive se concentre sur les événements du conflit ukrainien directement liés à l'Union européenne. De la fin de l'URSS à l'intervention russe en Géorgie Avec l’effondrement de l’Union soviétique, l'Ukraine redevient officiellement indépendante le 24 août 1991. Après 1991, plusieurs républiques ex-soviétiques héritent d'une partie de l'arsenal nucléaire de l'ex-URSS. Kiev est […]
L’article Guerre en Ukraine : chronologie des événements est apparu en premier sur Touteleurope.eu.

Cette chronologie non exhaustive se concentre sur les événements du conflit ukrainien directement liés à l'Union européenne.
Les dernières dates européennes importantes de la guerre en Ukraine :
- 10 septembre 2025 : Incursions de drones russes en Pologne lors d'une attaque massive contre l'Ukraine
- 4 septembre 2025 : 26 alliés de Kiev s'engagent à apporter des garanties de sécurité à l'Ukraine en cas de cessez-le-feu
- 31 août 2025 : L'UE prépare un plan d'envoi de troupes après la guerre
- 18 août 2025 : Donald Trump reçoit Volodymyr Zelensky et plusieurs dirigeants européens à Washington
- 18 juillet 2025 : un 18e train de sanctions sans précédent contre la Russie
- 6 mai 2025 : L'Union européenne dévoile son plan pour mettre fin aux importations d'énergie russe d'ici 2027
- 11 mars 2025 : L'Ukraine approuve un accord de cessez-le-feu proposé par les Etats-Unis
- 14-16 février 2025 : la 61e conférence sur la sécurité à Munich, un tournant pour la sécurité européenne
- 18 mars 2024 : les Vingt-Sept adoptent un fonds de cinq milliards d'euros pour soutenir militairement l'Ukraine
- 1er février 2024 : les Vingt-Sept accordent une aide de 50 milliards d'euros à l'Ukraine
- 14 décembre 2023 : le Conseil européen décide d'ouvrir les négociations d'adhésion à l'UE avec l'Ukraine
- 4 avril 2023 : la Finlande devient le 31e membre de l'Otan
- 23 mars 2023 : les Vingt-Sept approuvent un plan de livraison d'un million de munitions à l'Ukraine
- 15 novembre 2022 : début d'une mission militaire européenne pour former les soldats ukrainiens
- 23 juin 2022 : les chefs d'Etat et de gouvernement des Vingt-Sept accordent à l'Ukraine le statut de candidat à l'UE
- 16 mars 2022 : accusée de "crimes de guerre", la Russie est exclue du Conseil de l'Europe
- 24 février 2022 : la Russie attaque l’Ukraine, l’UE réplique par de lourdes sanctions
De la fin de l'URSS à l'intervention russe en Géorgie
Avec l’effondrement de l’Union soviétique, l'Ukraine redevient officiellement indépendante le 24 août 1991.
Après 1991, plusieurs républiques ex-soviétiques héritent d'une partie de l'arsenal nucléaire de l'ex-URSS. Kiev est d'abord réticente à l'idée de démanteler l'ensemble de ses armes nucléaires, à cause notamment des dangers qui pèsent sur l'indépendance de son Etat et de la montée du nationalisme russe. Mais après de longues négociations, les chefs d'Etat américain Bill Clinton, russe Boris Eltsine, et ukrainien Leonid Kravtchouk signent en janvier 1994 un accord trilatéral pour garantir la dénucléarisation du pays.
A cette occasion, le président américain Bill Clinton annonce que cette décision ouvre la porte à une coopération militaire entre l'Otan et l'Ukraine.
L'accord est confirmé par le mémorandum de Budapest du 5 décembre 1994. Celui-ci garantit la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Ukraine en échange du transfert de son arsenal nucléaire à la Russie et de sa ratification du traité de non-prolifération des armes nucléaires.
Fin 1994, l'Otan se déclare ouverte à l'adhésion de pays démocratiques d'Europe orientale. Une position critiquée par la Russie, qui reproche aux Etats-Unis leur volonté d'expansion, mais qui se concrétise avec l'intégration de la Hongrie, de la Pologne et de la République tchèque au sein de l'Alliance atlantique le 8 juillet 1997.
Entre-temps, le 27 mai 1997, est signé l'Acte fondateur Otan-Russie. Cet accord de coopération et de partenariat vise à construire une paix durable en Europe et une sécurité mutuelle entre l'Alliance atlantique et la Fédération de Russie. A travers des consultations régulières entre les parties, ce traité doit contribuer à instaurer une relation de confiance entre Moscou et ses voisins européens, et ainsi entériner la pacification des relations entre l'Occident et la Russie dans le contexte post-Guerre froide. Avec la signature de cet accord, dans le but de rassurer Moscou, l'Otan affirme "n'avoir aucune intention […] de déployer des armes nucléaires sur le territoire des nouveaux membres" ni d'y stationner des forces de combat permanentes.
Nouveau président de la Russie à partir du 31 décembre 1999, Vladimir Poutine tente d'abord un rapprochement avec l'Alliance atlantique, allant jusqu'à évoquer la possibilité d'une intégration de son pays à l'Otan. Mais d'autres ex-membres du bloc soviétique (Estonie, Lituanie, Lettonie, Roumanie, Slovaquie, Bulgarie) rejoignent à leur tour l'organisation le 29 mars 2004. L'adhésion à l'Otan de pays de l'ex-URSS pousse Vladimir Poutine à changer de position.
En novembre 2004, une partie du peuple ukrainien se révolte pour contester la réélection truquée du président pro-russe Viktor Ianoukovytch et demander un rapprochement avec l’Union européenne. C'est la révolution orange, qui porte au pouvoir l’un de ses meneurs, l'opposant Viktor Iouchtchenko, après un troisième tour organisé en décembre. Si l'Ouest du pays vote majoritairement pour M. Iouchtchenko, l'Est majoritairement russophone se prononce largement en faveur de M. Ianoukovytch.

Sous la nouvelle présidence de 2005 à 2010, l’Ukraine se rapproche ainsi de l'Union européenne. Des négociations sur un accord d'association sont lancées à partir de 2007 (le texte ne sera signé qu'en 2014). De son côté, la Russie tâche de conserver son influence à l’est de l'Ukraine, notamment en Crimée où l'armée russe occupe le phare du cap Sarytch à partir d'août 2005.
Dans un discours prononcé le 10 février 2007 à l'occasion de la Conférence de Munich sur la sécurité, Vladimir Poutine fustige l'interventionnisme américain et l'installation de bases de l'Otan aux frontières de la Russie ("on voit apparaître en Bulgarie et en Roumanie des bases américaines […] de 5 000 militaires chacune", déclare notamment le président russe), en violation des "promesses" occidentales de ne pas étendre les limites de l'organisation en direction de l’URSS. Des engagements qui figurent explicitement dans les comptes-rendus de discussions des années 1990-1991 entre Mikhaïl Gorbatchev et les dirigeants de l'Ouest sur l'appartenance de l'Allemagne réunifiée à l'Otan, sans pour autant avoir été formalisés dans un traité. Ils sont depuis utilisés par le Kremlin, de Boris Eltsine à Vladimir Poutine, pour dénoncer la "trahison" des Occidentaux.
En avril 2008, lors du sommet de Bucarest, l'Alliance entérine la perspective d'adhésion de la Géorgie et de l'Ukraine. Le président russe Dmitri Medvedev déclare alors qu'aucun pays ne serait satisfait à l'idée de voir un bloc militaire s'approcher de ses frontières.
En août 2008, l'armée de Géorgie lance un assaut contre les séparatistes d'Ossétie du Sud, soutenus par la Russie, entraînant en retour une intervention militaire de cette dernière pour appuyer les rebelles. Au terme d'un conflit rapidement remporté par Moscou, les parties signent entre le 12 et le 16 août un plan de paix réalisé sous la médiation du président français Nicolas Sarkozy, qui assume alors la présidence du Conseil de l'Union européenne. Le 25 août, la Russie déclare reconnaître l'indépendance de l'Ossétie du Sud et de l'Abkhazie, une décision condamnée par plusieurs capitales occidentales.
21 novembre 2013 : le président ukrainien Viktor Ianoukovytch refuse de signer un accord avec l'UE et se tourne vers la Russie
Principal opposant au président Viktor Iouchtchenko, Viktor Ianoukovytch lui succède à son tour en 2010. Ouvertement pro-russe, il tourne brusquement le dos à l'Union européenne en novembre 2013, avec laquelle l'Ukraine prévoyait de signer un accord d'association (en négociation depuis 2007). Souhaitant relancer les relations avec Moscou, il obtient la levée des barrières douanières avec la Russie, la promesse d'une baisse du prix du gaz russe ainsi qu'un prêt de plusieurs milliards de dollars. Cette volte-face suscite de vives protestations en Ukraine et provoque l'apparition du mouvement "Euromaïdan" de novembre 2013 à février 2014. Celui-ci débouche sur la "révolution de février" (ou "révolution de Maïdan"), la démission du président Viktor Ianoukovytch et sa fuite en Russie. Ces contestations sont marquées par une extrême violence et des centaines de morts, dont plusieurs personnes tuées par les forces policières.

Fin février - début mars 2014 : manifestations "Antimaïdan" dans l'est de l'Ukraine et sécession de Donetsk et de Louhansk
A la suite des manifestations "Euromaïdan", un nouveau gouvernement favorable au rapprochement avec l'Union européenne prend la relève en Ukraine à partir du 23 février. A compter de la fin du mois de février 2014, cette séquence débouche sur des contestations "Antimaïdan" dans de nombreuses villes de l'est de l'Ukraine ainsi qu'en Crimée. Les soulèvements pro-russes s'amplifient en avril 2014 lorsque des séparatistes occupent les bâtiments gouvernementaux des villes de Donetsk, Louhansk et Kharkiv. A la suite de référendums locaux, deux entités indépendantes aux noms de "République populaire de Donetsk" et "République populaire de Louhansk" sont auto-proclamées. Les référendums d'autodétermination ne sont reconnus ni par l'Union européenne, ni par les Etats-Unis, ni par la Russie qui se contente du silence (mais qui les reconnaîtra en février 2022). Kiev considère ces territoires séparatistes comme tenus par des organisations terroristes.

Mars 2014 : la Crimée et Sébastopol sont annexés par la Russie
Pendant ce temps, des séparatistes pro-russes, avec le soutien du président Vladimir Poutine, s'emparent de la ville ukrainienne de Sébastopol, capitale de la péninsule de Crimée. En effet, ceux-ci sont aidés par les "petits hommes verts", qui se sont révélés être des soldats russes. Moscou nie toute présence de ses armées sur le territoire ukrainien et défend l'idée qu'il s’agit simplement de forces d'autodéfense locale. Le 11 mars 2014, le parlement de Crimée déclare l'indépendance du territoire. Le rattachement de la Crimée à la Russie a officiellement lieu cinq jours plus tard, après un référendum. L'Ukraine n’a d’autre choix que de retirer ses troupes et d’abandonner le contrôle de la région. Le 17 mars 2014, l'Union européenne soumet la Russie à ses premières sanctions pour son action dans la crise ukrainienne et pour l'annexion de la Crimée. Ces mesures (principalement économiques) seront reconduites tous les six mois sans interruption.
25 mai 2014 : élection du pro-européen Petro Porochenko à la présidentielle ukrainienne
Le conflit du Donbass gagne en intensité lorsque, début mai 2014, l'armée ukrainienne lance une grande opération militaire afin de reprendre les villes contrôlées par les sécessionnistes. L'élection présidentielle de mai 2014 porte Petro Porochenko, soutien de la révolution de Maïdan, au pouvoir dès le premier tour. Il propose le 20 juin 2014 un plan de paix, mais le cessez-le-feu n'est pas respecté et les actions militaires s'accentuent. Petro Porochenko interdit également toute coopération avec la Russie et s'oppose à un rétablissement des liens diplomatiques (quasiment rompus dès son arrivée au pouvoir) avec Vladimir Poutine sans retour de la Crimée sous l'autorité de l’Ukraine.
6 juin 2014 : premier entretien au "format Normandie"
François Hollande, Angela Merkel, Vladimir Poutine et Petro Porochenko se rencontrent en Normandie à l'occasion du soixante-dixième anniversaire du débarquement allié. Il s'agit de la première réunion entre le président russe et son homologue ukrainien depuis l'éclatement du conflit à l'est de l'Ukraine. Ces rendez-vous quadripartites ("format Normandie") entre la France, l'Allemagne, la Russie et l'Ukraine se succéderont en vue de poser les bases d'un cessez-le-feu.
27 juin 2014 : l'Ukraine signe un accord de libre-échange avec l'Union européenne
Après un premier volet politique signé en mars 2014, l'accord d'association entre l'Ukraine et l'UE est conclu le 27 juin 2014 avec la signature de son volet économique. Ce traité engage l'Union et l'Ukraine à coopérer sur leurs politiques économiques et à établir des règles communes (droits des travailleurs, suppression des visas, accès à la Banque européenne d'investissement…). La Russie prévient, par la voix d'un haut diplomate russe, que l'accord aura de "graves conséquences". Il est ratifié par l'Union européenne le 11 juillet 2017 et entre définitivement en vigueur le 1er septembre suivant.
17 juillet 2014 : crash du vol MH17 abattu dans la région de Donetsk
Début juillet 2014, l’armée ukrainienne reprend plusieurs villes de la région de Donetsk et repousse les pro-russes. Le Boeing 777 de la compagnie Malaysia Airlines, assurant le vol MH17, est abattu au-dessus de la région par un missile, tuant les 298 passagers dont deux tiers de Néerlandais. Si les différentes parties au conflit s’accusent mutuellement de l'origine du tir, l'hypothèse d'un type de missile sol-air que les séparatistes savent utiliser prévaut. La crise s'internationalise, les Etats-Unis menaçant Moscou de sanctions. Le Conseil de sécurité de l’ONU se réunit et demande l'ouverture d'une enquête internationale. Le parquet néerlandais affirmera le 28 septembre 2016 que le missile a bien été tiré depuis le territoire contrôlé par les séparatistes, et que le matériel de tir a été acheminé depuis la Russie. Le 24 mai 2018, les enquêteurs internationaux parviendront à la même conclusion. La Russie continue quant à elle de nier toute implication directe et de rejeter les conclusions internationales.
5 septembre 2014 : signature du protocole de Minsk
Alors que la situation devient critique jusqu'à la fin du mois d'août 2014 - l'ONU dénombre plus de 1 100 morts et plus de 3 400 blessés en Ukraine seulement entre la mi-avril et la fin du mois juillet 2014, un accord de cessez-le-feu immédiat est conclu dans la capitale biélorusse entre les représentants de l'Ukraine, de la Russie, de la République populaire de Donetsk et de la République populaire de Louhansk : c'est le protocole de Minsk. Mais celui-ci est violé au bout de quelques jours, les combats reprenant sans trêve. De 2014 à 2015, le conflit fait plus de 10 000 morts, des dizaines de milliers de blessés et près de deux millions de personnes déplacées.
11 février 2015 : accord de paix "Minsk II"
Les dirigeants de l’Ukraine, de la Russie, de l’Allemagne et de la France se réunissent de nouveau en Biélorussie avec son chef de l'Etat Alexandre Loukachenko afin d’imposer un nouveau cessez-le-feu, qui doit être effectif à partir du 15 février 2015. En plus du cessez-le-feu, l'accord comprend des mesures telles que le retrait des armes lourdes de chaque côté, l'échange de prisonniers, la restauration des frontières de l'Ukraine ou encore le retrait des troupes étrangères. Mais si les combats d'envergure cessent, des affrontements de moindre ampleur se poursuivent néanmoins dans l'est sécessionniste : le 13 avril 2015, les ministres des Affaires étrangères des quatre pays signataire de "Minsk II" font part de leur inquiétude devant la recrudescence des violations du cessez-le-feu et la constatation de combats autour du port de Marioupol, convoité par les sécessionnistes. Les périodes de trêves succèdent aux combats, avec des cessez-le-feu régulièrement signés mais aussitôt enfreints. A titre d'exemple, le 19 octobre 2016, un nouveau sommet se tient entre Moscou, Kiev, Paris et Berlin, mais l'on constate que le conflit est gelé et qu'il donne lieu à des violences et à des affrontements fréquents dans le Donbass entre l'armée ukrainienne et les séparatistes… De nombreuses violations du cessez-le-feu sont observées.

25 novembre 2018 : affrontements en mer Noire entre navires russes et ukrainiens
Les accords de Minsk sont de nouveau fragilisés par un attentat : le séparatiste prorusse Alexandre Zakhartchenko, dirigeant de l'autoproclamée République populaire de Donetsk, est tué par l’explosion d’une bombe le 31 août 2018. Les séparatistes et la Russie attribuent la responsabilité de cet assassinat aux services ukrainiens. Par la suite, le 25 novembre se produit l'incident du détroit de Kertch : la marine russe ouvre le feu sur des navires ukrainiens, qui sont arraisonnés par les Russes, et capture les marins ukrainiens. Moscou affirme que ces navires se trouvaient dans les eaux territoriales de la Crimée. Les Russes souhaitent en réalité prendre le contrôle de la mer Noire, près du port de Marioupol. Le lendemain, M. Porochenko instaure la loi martiale dans les régions frontalières de la Russie pour une durée de 30 jours.
21 avril 2019 : élection de Volodymyr Zelensky à la présidence ukrainienne
L'acteur et humoriste Volodymyr Zelensky fait campagne contre la corruption, tout en affichant une ligne moins virulente que le président sortant Porochenko vis-à-vis de la Russie. Il prône un cessez-le-feu dans le Donbass mais aussi l’organisation d’un référendum sur l'entrée de l’Ukraine dans l’Otan. Elu président le 21 avril 2019, il promet de relancer les discussions diplomatiques avec Moscou au sujet de la guerre du Donbass. Mais trois jours après seulement, Vladimir Poutine autorise la délivrance de passeports russes à des habitants des régions de Donetsk et de Louhansk, une décision qui va à l’encontre des accords de Minsk. Le 1er octobre, les représentants ukrainiens et russes de nouveau réunis en Biélorussie s'accordent sur l’organisation d'élections dans les régions séparatistes d’Ukraine et l’octroi d’un statut spécial aux territoires du Donbass. Le 6 octobre, des manifestations importantes ont lieu à Kiev et dans d’autres grandes villes pour dénoncer ce qui est perçu comme un abandon face à la Russie.

9 décembre 2019 : nouvelle rencontre au "format Normandie"
La première rencontre officielle entre Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky, aux côtés d'Emmanuel Macron et d’Angela Merkel, vise de nouveau à relancer la mise en œuvre des accords de paix “Minsk II”. Les dirigeants russe et ukrainien s'accordent ainsi sur l’échange de tous les prisonniers avant la fin de l’année 2019, sur une démilitarisation de points de la ligne de front et sur l’ouverture de points de passage entre les régions séparatistes et le reste de l'Ukraine. Quelques jours plus tard, le 29 décembre, un échange d’environ deux cents prisonniers a lieu entre Kiev et les sécessionnistes.

31 décembre 2019 : accord sur le gaz entre la Russie et l'Ukraine
Signe d’une détente qui se confirme et d’un certain apaisement de leurs relations, Moscou et Kiev concluent un accord pour le transit du gaz russe à travers l’Ukraine, qui garantit l’approvisionnement de l’Europe en gaz pour cinq années supplémentaires. Cet accord avait été auparavant menacé, en 2009, lors d'une crise majeure à ce sujet lorsque Kiev et la société russe Gazprom ne parvenaient pas à se mettre d’accord sur le prix à payer pour le gaz (Gazprom avait alors réduit, puis même stoppé les livraisons de gaz à l'Ukraine). Par ailleurs, la construction du gazoduc Nord Stream 2 reliant la Russie et l’Allemagne à travers la mer Baltique doit permettre l’exportation du gaz russe vers l’Europe, qui en est particulièrement dépendante, par d’autres voies.
22 juillet 2020 : nouvel accord de cessez-le-feu aussitôt rompu
L’Ukraine et la Russie signent un nouvel accord de cessez-le-feu dans le Donbass. Il est cependant violé quelques minutes après son entrée en vigueur le 27 juillet par des tirs provenant des territoires séparatistes contre les militaires ukrainiens.
Avril 2021 : mobilisation de troupes russes aux frontières ukrainiennes
Le 1er avril, le président Volodymyr Zelensky accuse la Russie de masser des troupes aux frontières de l’Ukraine, alors que les violations du cessez-le-feu se multiplient dans le Donbass. Les Occidentaux dénombrent 100 000 soldats russes, des manœuvres que la Russie considère comme une réponse à l’Otan et aux “provocations” ukrainiennes (cela fait notamment référence au fait que l'Ukraine affiche sa volonté d'adhérer à l'Otan). Pour Moscou, en réponse aux accusations de Kiev sur l'hypothèse de la préparation d'une invasion en Ukraine, il s'agit simplement de manœuvres en réponse à des "exercices" de l'Otan et des Etats-Unis en Europe. Le 6 avril, Volodymyr Zelensky change de ton vis-à-vis de la Russie - alors qu'il a un temps prôné le dialogue avec elle - et déclare que l’adhésion de son pays à l’Otan est le seul moyen de mettre un terme à la guerre du Donbass. Il se déclare également favorable à une entrée de son pays dans l’Union européenne.
Novembre 2021 : les Occidentaux craignent une offensive russe en Ukraine
Les inquiétudes des Américains et des Européens vis-à-vis des mouvements de troupes russes s'accroissent. Ils craignent un risque imminent d’escalade et d’invasion en Ukraine. En effet, des images satellites publiées début novembre montrent des chars russes et autres véhicules blindés à proximité de la frontière ukrainienne. Pour se défendre de ces mouvements de troupes, le président Vladimir Poutine accuse les Occidentaux de livrer des armes à Kiev et de mener des manœuvres militaires en mer Noire.
7 décembre 2021 : échange entre Joe Biden et Vladimir Poutine
Le 7 décembre, lors d'un échange avec le président américain Joe Biden, le président russe dénonce la volonté de Kiev de rejoindre l’Otan, et demande des "garanties juridiques sûres" contre l’élargissement de l’Alliance atlantique en Ukraine. La Russie exige ainsi à la fois le bannissement de tout nouvel élargissement de l'Otan et le retrait de ses forces dans les pays de l'ex-URSS. Joe Biden prévient néanmoins qu’une offensive militaire russe entraînerait de lourdes sanctions ainsi qu’un renforcement du soutien américain à l’Ukraine, aux pays baltes, à la Pologne et à la Roumanie.
16-17 décembre 2021 : les Vingt-Sept font front commun face à la menace russe
Le 17 décembre, Moscou publie deux projets de traités en vue d'être signés avec les Etats-Unis et l'Otan, dont les revendications sont les suivantes : les pays membres de l'Otan avant son élargissement en 1997 doivent s'engager à ne pas déployer d'armes sur d'autres territoires européens à l'est ; l'Otan doit s'engager à n'intégrer ni l'Ukraine, ni la Géorgie. De leur côté, les Européens s’entretiennent aussi diplomatiquement avec la Russie mais se montrent fermes et la menacent de nouvelles sanctions économiques qui auront de "lourdes conséquences" en cas de nouvelle agression militaire de l'Ukraine. Lors du Conseil européen des 16 et 17 décembre, les Vingt-Sept réaffirment la souveraineté du pays et leur soutien. Par ailleurs, lors de la rencontre des ministres européens de la Défense et des Affaires étrangères du 12 au 14 janvier 2022, le chef de la diplomatie de l’UE Josep Borell déclare que les revendications russes pour résoudre le conflit contreviennent aux principes de l’architecture de sécurité européenne.
24-26 janvier 2022 : réponses occidentales aux revendications russes
Entretemps, l'Otan annonce placer des troupes en alerte pour renforcer ses défenses en Europe de l'Est. Le 24 janvier, le président américain Joe Biden assiste à une réunion en visioconférence avec plusieurs dirigeants européens. A l’issue de cette discussion, les Occidentaux appellent la Russie à prendre des mesures de désescalade dans le conflit ukrainien, rappelant que Moscou devra faire face à des "conséquences massives" si elle attaquait à nouveau l'Ukraine. Face aux exigences russes de retrait des forces de l’Otan d’Europe orientale et de l’assurance que l’Ukraine ne rejoindra jamais l’Alliance atlantique, cette dernière ainsi que les Etats-Unis refusent explicitement ces demandes le 26 janvier 2022. Le secrétaire général de l'Otan rappelle que les questions d’adhésion relevaient uniquement de la responsabilité des Alliés et des pays candidats.
Début février 2022 : la France et l'Allemagne tentent d'apaiser les tensions et un espoir de désescalade s'ensuit
Une nouvelle étape dans le dialogue a lieu d'abord le 7 février lorsque le président Emmanuel Macron rencontre Vladimir Poutine pour discuter de solutions afin de résoudre la crise. Les deux dirigeants affichent alors leur volonté commune d’éviter la guerre et de trouver des compromis. Le chef d'Etat français propose des garanties concrètes de sécurité, dont certaines sont jugées bonnes par le président russe. De la même façon, le chancelier allemand Olaf Scholz se rend à Kiev le 14 février et à Moscou le 15 février pour tenter d'obtenir de la part de Moscou des actes immédiats de désescalade. Alors que la situation paraît très tendue, et que les services secrets américains redoutent une offensive russe le 16 février, Moscou annonce la veille contre tout attente le retrait de militaires russes positionnés à la frontière entre la Biélorussie et l'Ukraine. La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen avertit tout de même le 16 février que l'Otan ne voit pas encore de signes de réduction des troupes russes et que si Moscou choisissait la violence, les Européens répondraient de manière unie et forte.
21 février 2022 : la Russie reconnaît l'indépendance de Donetsk et de Louhansk et entre sur les territoires séparatistes
Alors que la présidence de la République française annonce le 20 février 2022 que les présidents russe et américain avaient accepté de se rencontrer, Vladimir Poutine signe finalement l'acte de reconnaissance le lendemain des deux territoires séparatistes du Donbass en Ukraine : la République populaire de Donetsk et la République populaire de Louhansk, en violation des accords de Minsk. Dans la nuit du 21 au 22 février, des véhicules blindés et des troupes russes pénètrent dans l'est de l'Ukraine sous couvert de maintien de la paix. L'Europe, les Etats-Unis, l'ONU et la majorité des membres du Conseil de sécurité condamnent cette décision de la Russie, considérée comme une violation du droit international. Les Etats-Unis et l'Union européenne annoncent de nouvelles sanctions à l'encontre de Moscou et la mise en service du gazoduc Nord Stream 2 est suspendue par l'Allemagne. L'Union européenne décide sans attendre de cibler la capacité de la Russie à accéder aux marchés des capitaux et services financiers européens ainsi que les banques qui ont contribué à financer les opérations militaires russes dans le Donbass.
24 février 2022 : la Russie attaque l'Ukraine, l'UE réplique par de lourdes sanctions
Le 24 février, une étape sans précédent est franchie par la Russie. Vladimir Poutine annonce en effet une opération militaire d’envergure sur le territoire ukrainien dans l’objectif, selon lui, de défendre les séparatistes du Donbass. Le chef d'Etat russe invoque également des motifs de "dénazification" et de "démilitarisation" de l’Ukraine. Cette fois-ci, Moscou ne s’arrête pas à l’est de l’Ukraine puisque de puissantes explosions frappent plusieurs grandes villes, et notamment la capitale Kiev. Suite à cette déclaration de guerre, le président Volodymyr Zelensky instaure la loi martiale dans son pays et la communauté internationale condamne cette agression inédite. Dans la foulée, des dizaines de milliers d'Ukrainiens se pressent aux frontières et tentent de fuir leur pays. Les chefs d’Etat et de gouvernement de l’UE se réunissent le 24 février au soir pour un Conseil européen extraordinaire. Face à Moscou, les Vingt-Sept se mettent d’accord sur les mesures de rétorsion les plus sévères jamais mises en œuvre par l’Union européenne : sanctions financières réduisant l’accès aux marchés de capitaux européens (pour atteindre le marché bancaire russe et les principales entreprises publiques), interdiction d’exportation touchant le pétrole ou encore gel des avoirs de Vladimir Poutine…
27 février 2022 : Vladimir Poutine brandit la menace nucléaire tandis que l'UE finance l'envoi d'armes à l'Ukraine
Alors que nous sommes seulement au quatrième jour de l'offensive russe en Ukraine, le chef du Kremlin Vladimir Poutine annonce à la télévision russe mettre les "forces de dissuasion (nucléaire) de l'armée russe en régime spécial d'alerte au combat" (d'autant que la Russie possède le plus important arsenal nucléaire au monde) afin de répondre aux réactions des Occidentaux et des puissances de l'Otan.
En parallèle, pour la première fois de leur histoire, l'UE approuve le financement d'envoi d'armes à l'Ukraine, à travers la Facilité européenne pour la paix. Ainsi, 450 millions d'euros d'armement seront financés, de même que 50 millions d'euros d'équipements de protection et de carburant.
Cette décision s'accompagne de sanctions renforcées à l'égard de la Russie. De manière coordonnée avec les Etats-Unis, le Canada et le Royaume-Uni, les Etats membres donnent leur feu vert à la déconnexion de plusieurs banques russes du système bancaire Swift. Ce qui devrait compliquer très fortement leurs transactions, et notamment leur capacité à échanger des capitaux à l’international. Toutes les banques ne sont cependant pas concernées, en particulier celles liées au commerce du gaz, dont dépendent beaucoup d'Etats européens. En complément de cette mesure de rétorsion s'ajoute le gel des avoirs de la Banque centrale russe hors de Russie.
L'espace aérien de l'Union est par ailleurs fermé à l'aviation russe. Egalement, afin de lutter contre la désinformation organisée par le Kremlin, les Vingt-Sept donnent leur accord à l’interdiction de diffusion au sein de l’UE des médias Russia Today et Sputnik. Enfin, la Biélorussie, Etat allié de la Russie et d’où l’invasion de l’Ukraine a en partie été lancée, est elle aussi sanctionnée par les Européens, avec les secteurs phares de son économie (hydrocarbures, tabac, ciment, fer et acier) interdits d'exportation vers l'UE. Des sanctions individuelles visant des responsables liés à l'invasion de l'Ukraine sont aussi décidées.
28 février 2022 : l'Ukraine fait une demande d'adhésion à l'UE
Alors que l'objectif d'une intégration à l'UE est inscrit dans la constitution ukrainienne depuis février 2019, et que le président Volodymyr Zelensky exhorte depuis plusieurs mois les Européens à faire adhérer l'Ukraine à l'UE, Kiev signe officiellement une demande d'adhésion. Un jour plus tôt, Ursula von der Leyen s'est prononcée en faveur de cette perspective d'adhésion à terme de l'Ukraine : "ils sont des nôtres et nous les voulons parmi nous". La demande formelle d'entrée de l'Ukraine dans l'UE est signée par Volodymyr Zelensky, le Premier ministre Denys Chmyhal et le président du Parlement Rouslan Stefantchouk. Le chef d'Etat ukrainien souhaite une intégration "sans délai" via "une nouvelle procédure spéciale" pour bénéficier de ce statut qui assurerait une protection à son pays. A ce sujet, le président du Conseil européen Charles Michel explique qu'un avis officiel de la Commission ainsi qu'un accord unanime des Vingt-Sept sont nécessaires.
Le lendemain, le 1er mars, Volodymyr Zelensky s'exprime devant le Parlement européen en visioconférence. Il appelle l'UE à “prouver” qu’elle soutient son pays. “L’Ukraine a fait son choix : le choix de l’adhésion à l’Europe. Et je voudrais qu’aujourd’hui vous confirmiez le choix de l’Europe d’accepter l’Ukraine. […] Sans vous, l’Ukraine sera seule. Nous avons prouvé notre force, nous avons montré que nous sommes vos égaux.”, déclare M. Zelensky. Son allocution est saluée par une ovation des eurodéputés, qui approuvent très majoritairement (637 voix pour, 13 contre et 26 abstentions) une résolution demandant "aux institutions de l’Union de faire en sorte d’accorder à l’Ukraine le statut de candidat à l’Union européenne".
Pendant ce temps, la guerre fait rage. Le 28 février, l'Onu compte 102 civils tués depuis le début de l'invasion russe, dont 7 enfants, ainsi que 304 blessés, tout en avertissant que les chiffres réels sont sans doute considérablement plus élevés. En outre, plus de 500 000 réfugiés ont déjà fui l’Ukraine.

2 mars 2022 : l'ONU adopte une résolution contre la guerre en Ukraine et exige le retrait des forces russes
Alors que la guerre se poursuit depuis bientôt une semaine en Ukraine, l'Assemblée générale des Nations unies adopte à la grande majorité de ses membres (141 pays sur 193 ont voté pour) une résolution qui "exige que la Russie cesse immédiatement de recourir à la force contre l'Ukraine" et qui "condamne la décision de la Russie d'accentuer la mise en alerte de ses forces nucléaires". A noter que seulement quatre Etats ont ouvertement soutenu Moscou en votant contre cette résolution : la Biélorussie, la Corée du Nord, l'Erythrée et la Syrie. 35 pays, tels que la Chine et l'Inde, se sont par ailleurs abstenus.
Le lendemain, à l'issue d'un nouvel entretien téléphonique avec Vladimir Poutine, le président français Emmanuel Macron assure que "le pire est à venir", en raison de la "très grande détermination" du chef d'Etat russe à prendre le contrôle de l'ensemble de l'Ukraine.
4 mars 2022 : un incendie est provoqué sur le site de la plus grande centrale nucléaire d'Europe en Ukraine
Quelques jours seulement après la menace brandie par Vladimir Poutine de recourir à son arsenal nucléaire, Kiev accuse Moscou d'avoir recours à la "terreur nucléaire" en Ukraine. Cette accusation fait notamment suite à un incendie dans la plus grande centrale atomique d'Europe, située à Zaporijia dans le centre du pays, provoqué par des frappes de l'armée russe dans la nuit du 3 au 4 mars 2022. L'incendie a cependant pu être éteint après l'intervention des pompiers ukrainiens et les niveaux de radioactivité n'ont pas augmenté sur le site de la centrale. Mais les craintes d'un accident nucléaire lié au conflit demeurent en Ukraine, qui compte au total 15 réacteurs sur son territoire.
Le lendemain, un bilan humain est publié par le Haut-Commissariat de l'Onu aux droits de l'homme (HCDH) qui indique avoir recensé 351 victimes civiles depuis le début de l'offensive russe. Le bilan compte également 707 blessés. La plupart de ces victimes sont causées par des bombardements d'artillerie lourde et des tirs de missiles terrestres et aériens dans les villes ukrainiennes. Encore une fois, le HCDH prévient que les chiffres réels sont sans doute considérablement plus élevés. En parallèle, en seulement dix jours, plus de 1,3 million de personnes ont fui l'Ukraine selon les chiffres de l'Onu.
8 mars 2022 : la Chine soutient la volonté d'aboutir à un cessez-le-feu ; les sanctions à l'encontre de Moscou sont renforcées
Au cours d'un entretien téléphonique avec le président Emmanuel Macron et le chancelier allemand Olaf Scholz, le chef d'Etat chinois Xi Jinping apporte son soutien à l'action de la France et de l'Allemagne pour aboutir à un cessez-le-feu en Ukraine ainsi qu'à la garantie d'un accès à l'aide humanitaire pour les populations. Il souligne l'importance des principes de souveraineté et d'intégrité territoriale.
Le même jour, le président ukrainien Volodymyr Zelensky tempère son positionnement vis-à-vis d'une entrée de son pays dans l'Otan, perspective constituant une ligne rouge pour la Russie. Dans un entretien, le dirigeant affirme ne plus vouloir insister sur l'obtention d'une adhésion de l'Ukraine à l'Alliance atlantique. Il se dit également prêt à "trouver un compromis" sur le statut des territoires séparatistes pro-russes de l'est du pays, dont l'indépendance a été reconnue par Vladimir Poutine.
Ce 8 mars également, les Etats-Unis et le Royaume-Uni décident de sanctionner à nouveau Moscou en imposant un embargo sur les importations de pétrole et de gaz russes. Une décision qui n'est pas répliquée par l'UE, encore très dépendante des hydrocarbures russes. Le lendemain, l'Union européenne annonce en revanche de nouvelles mesures pour sanctionner la Russie ainsi que la Biélorussie. Les Vingt-Sept ajoutent des dirigeants et oligarques russes à leur "liste noire", élargissent la liste des technologies (notamment destinées au secteur maritime) et des biens qui ne peuvent pas être exportés vers la Russie et débranchent trois banques biélorusses du système financier Swift.
Le 9 mars, alors que les combats font toujours rage en Ukraine et que plusieurs villes du pays sont bombardées, Kiev et Moscou s'entendent pour respecter une série de cessez-le-feu dans plusieurs zones de combat afin d'évacuer des civils, par le biais de couloirs humanitaires.
11 mars 2022 : l'UE écarte une intégration rapide de l'Ukraine
Alors qu'ils sont réunis en sommet à Versailles les 10 et 11 mars, les 27 chefs d'Etat et de gouvernement de l'Union européenne excluent une adhésion rapide de l'Ukraine à l'UE, comme l'avait demandé le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Celui-ci avait appelé à une intégration accélérée via une "nouvelle procédure spéciale". Toutefois, les Vingt-Sept se mettent d'accord pour resserrer les liens de l'UE avec l'Ukraine en renforçant notamment l'assistance politique et financière accordée à Kiev.
Dans le même temps, la catastrophe humanitaire se poursuit en Ukraine, comme en témoigne la barre franchie des 2,5 millions de réfugiés (selon les chiffres de l'Onu), seulement deux semaines après le début du conflit. Selon le Haut Commissaire des Nations unies pour les réfugiés Filippo Grandi, il s'agit du flux le plus rapide en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale. Le nombre de civils tués témoigne aussi de cette situation, la ville de Marioupol, assiégée par l'armée russe, ayant notamment établi un bilan provisoire de 1 207 morts parmi sa population civile au 9 mars.
13 mars 2022 : l'armée russe bombarde une base militaire ukrainienne près de la frontière polonaise
Une base militaire dans l'ouest de l'Ukraine, à Yavoriv, est prise pour cible par l'armée russe, dans une attaque causant la mort d'au moins 35 personnes et plus de 130 blessés. Le terrain d'entraînement pour les forces ukrainiennes où elle a lieu se situe à peine à une vingtaine de kilomètres de la Pologne, membre de l'UE et de l'Otan. La guerre semble alors se rapprocher dangereusement des pays faisant partie de l'Alliance atlantique. A plusieurs reprises, le secrétaire général de l'organisation Jens Stoltenberg et les Etats-Unis ont affirmé qu'ils voulaient éviter un conflit direct contre Moscou.
En parallèle, les villes stratégiques de Kiev et de Marioupol sont toujours assiégées et encerclées par les forces armées russes et le bilan humain ne cesse de s'alourdir. Alors que le port de Marioupol n'est toujours pas accessible, les associations humanitaires craignent un "scénario du pire", comme en alerte la Croix-Rouge. Toutefois, une nouvelle session de négociations se tient le lundi 14 mars entre Moscou et Kiev : tandis qu'un négociateur russe évoque des "progrès significatifs", l'Ukraine indique que la Russie cesse de poser "des ultimatums". Mais l'armée russe n'exclut pas de lancer de nouveaux assauts pour prendre le "contrôle total" des grandes villes ukrainiennes.
16-17 mars 2022 : la Russie est exclue du Conseil de l'Europe et est accusée de "crimes de guerre"
Alors qu'elle avait déjà été suspendue du Conseil de l'Europe au lendemain de l'offensive menée contre l'Ukraine, la Fédération de Russie est exclue le mercredi 16 mars de l'organisation internationale en raison de son "agression injustifiée et non provoquée". Avant cette exclusion, la Cour de Strasbourg comportait 47 pays comptant 830 millions de personnes. A partir de cette date, les citoyens russes n'ont donc plus accès à la Cour européenne des droits de l'homme pour protéger leurs droits fondamentaux.
Dans le même temps, au 22ème jour du conflit en Ukraine, un bombardement russe intervient le 16 mars sur un théâtre de Marioupol abritant des centaines de civils et des tirs d'artillerie russes sont effectués près de Kharkiv, causant au moins 21 morts et 25 blessés. Alors que Moscou multiplie ainsi les attaques contre les civils et les zones résidentielles en Ukraine, les Américains et les Européens dénoncent ces violations du droit international. En effet, l'UE et les Etats-Unis condamnent le 17 mars les "crimes de guerre" que la Russie commet en Ukraine. Josep Borrell déclare que que les attaques contre les populations civiles perpétrées par le Kremlin constituent de "graves violations du droit international humanitaire" et que les auteurs de ces "crimes de guerre" seront tenus responsables. Dans le même temps, Joe Biden qualifie pour la première fois Vladimir Poutine de "criminel de guerre".
En ce qui concerne l'évolution du conflit, même si la Russie a déjà conquis plusieurs dizaines de milliers de kilomètres carrés du territoire ukrainien, les fronts apparaissent figés et l'offensive russe bloquée. Après quatre semaines de guerre, le Kremlin essuie des revers tactiques importants et l'objectif d'une défaite de l'Ukraine en quelques jours est désormais hors d'atteinte. En effet, pour le moment, aucune des grandes villes du pays n'est occupée par la Russie. Le colonel et historien français Michel Goya analyse dans la revue Le Grand Continent au vingtième jour du conflit que "les forces russes n'ont plus lancé d'attaques de grande ampleur depuis le 4 mars", tout en précisant qu'on "a l'impression que l'armée russe s'est obstinée à poursuivre un mauvais plan jusqu'à se retrouver imbriquée, dispersée et bloquée devant les localités".
20 mars 2022 : 10 millions d'Ukrainiens ont dû fuir la guerre
Le 20 mars, le Haut-Commissaire des Nations unies pour les réfugiés déclare qu'au moins 10 millions de personnes ont déjà dû fuir leurs foyers en Ukraine depuis le début de la guerre, moins d'un mois après son déclenchement. Un nombre qui représente près du quart de la population du pays. Sur ces 10 millions d'exilés, plus de 3,4 millions ont traversé les frontières ukrainiennes et ont été accueillis pour la plupart dans des pays européens. Première destination pour les réfugiés ukrainiens, la Pologne en compte plus de deux millions s'étant installés sur son territoire ou y ayant transité.
24-25 mars 2022 : sommets de l'Otan, du G7 et de l'UE pour répondre à la guerre en Ukraine
Une importante séquence diplomatique s'ouvre en Europe avec la juxtaposition de sommets de l'Otan et du G7 le 24 mars à Bruxelles, puis le Conseil européen les 24 et 25 mars, également dans la capitale belge. Des réunions auxquelles participe le président américain Joe Biden.
Le sommet de l'Alliance atlantique est l'occasion de discuter des moyens mis en place pour mieux prévenir la menace russe en Europe ainsi que de l'aide militaire fournie à l'Ukraine. Les dirigeants des 30 pays membres de l’Otan entérinent la création de quatre nouveaux groupements tactiques à l'est de l'Europe. Des forces opérationnelles seront ainsi déployées en Roumanie, en Bulgarie, en Hongrie et en Slovaquie. Les alliés conviennent en outre d'envoyer des équipements à l'Ukraine pour la protéger des risques "NRBC" : nucléaires, radiologiques, biologiques et chimiques.
Plus tard dans la journée du 24 mars, les pays membres du G7 se disent prêts à mettre en œuvre des sanctions supplémentaires contre la Russie, et indiquent qu'ils sanctionneront les transactions qui impliquent les réserves d'or de cette dernière, afin de l'empêcher de contourner les mesures restrictives déjà en vigueur.
En outre, le Conseil européen, qui se tient après les sommets de l'Otan et du G7, voit les chefs d'Etat et de gouvernement des Vingt-Sept adopter la boussole stratégique, “livre blanc” visant à définir les grandes orientations de la sécurité et de la défense européennes jusqu’en 2030. Un document qui témoigne de la volonté des Etats membres de renforcer la protection de l'UE face aux menaces externes, dont celles de la Russie. Pour réduire leur dépendance énergétique vis-à-vis de Moscou et l'isoler davantage, les Européens s'accordent pour signer un nouveau partenariat avec les Etats-Unis afin d'importer davantage de gaz naturel liquéfié américain. La Commission européenne reçoit aussi mandat des Vingt-Sept pour réaliser des achats groupés de gaz, pour limiter son coût en Europe. Dans leurs conclusions, les pays de l'UE affirment par ailleurs leur détermination à assurer l'approvisionnement en gaz et en électricité de l'Ukraine.

29 mars 2022 : pourparlers en Turquie entre Russes et Ukrainiens
Les négociations entre les diplomates russes et ukrainiens semblent progresser le 29 mars, alors que ceux-ci sont invités à Istanbul par le président turc Recep Tayyip Erdoğan. Des avancées entre les deux parties sont relevées lors de ces pourparlers qui donnent lieu pour la première fois à des "discussions substantielles", selon Moscou. En premier lieu, les négociateurs russes annoncent des activités militaires menées par le Kremlin "radicalement" réduites en Ukraine autour de la capitale Kiev et de Tchernihiv. La Russie affirme désormais se concentrer uniquement sur ce qu'elle nomme la "libération" du Donbass (à l'est du pays). Ces annonces sont toutefois accueillies avec circonspection de la part de l'Ukraine et de ses soutiens.
Côté ukrainien, le président Volodymyr Zelensky note des "signaux positifs" à la suite de ces pourparlers. Au cœur des négociations, se pose la complexe question de la neutralité de l'Ukraine, voulue par Moscou. Si l'Ukraine se dit prête à l'accepter, et donc de renoncer à adhérer à l'Otan, elle souhaite voir sa sécurité garantie par un accord international dont seraient signataires plusieurs pays garants, tels que les Etats-Unis, le Royaume-Uni, la Turquie, la France et l'Allemagne. Mais cette solution implique que les pays garants interviennent en cas d'attaque de l'Ukraine, comme le prévoit l'article 5 du traité de l'Atlantique nord qui régit l'Otan. Ce qui pourrait être difficile à accepter pour la Russie. Par ailleurs, l'Ukraine maintient sa demande d'adhésion à l'UE. En plus d'une adhésion ukrainienne à l'Otan, cette perspective constitue également une ligne rouge pour Vladimir Poutine.
Le jour suivant ces pourparlers, Volodymyr Zelensky déclare qu'il ne croit pas aux promesses de Moscou de réduction radicale de son activité militaire autour de Kiev et que l'armée ukrainienne se prépare à de nouveaux combats dans l'est du pays. Le 31 mars, le secrétaire général de l'Otan Jens Stoltenberg considère que les forces russes "ne se retirent pas mais se repositionnent" en Ukraine et affirme que l'organisation s'attend à des "offensives supplémentaires".
4 avril 2022 : après la découverte des massacres de Boutcha, l'UE veut prendre de nouvelles sanctions
Lors du week-end des 2-3 avril, les Russes redéploient leurs troupes du nord vers l'est et le sud de l'Ukraine. Les Ukrainiens reprennent contrôle de la totalité de la région de Kiev, selon la vice-ministre ukrainienne de la Défense.
Le monde découvre alors avec effroi les images de centaines de civils morts et éparpillés dans les rues de la ville de Boutcha, au nord-ouest de Kiev. Le gouvernement ukrainien dénonce un "massacre […] délibéré", Londres et Madrid réclament une enquête pour "crimes de guerre", tandis que le président du Conseil européen dénonce les "atrocités" commises par l'armée russe et assure que "l'UE aide l'Ukraine et les ONG à rassembler les preuves nécessaires aux poursuites devant les tribunaux internationaux". Ce dernier réclame, comme plusieurs dirigeants européens à sa suite (Allemagne, France, Espagne, Pologne…), un renforcement des sanctions à l’encontre de Moscou. Les Etats baltes annoncent par ailleurs cesser d'importer du gaz naturel russe.
Le lundi 4 avril, le haut représentant de l’UE Josep Borrell "condamne" à son tour "les atrocités rapportées commises par les forces armées russes dans plusieurs villes ukrainiennes occupées, qui ont maintenant été libérées". L'Union européenne annonce alors travailler "en urgence" sur de nouvelles sanctions à l'encontre de la Russie.
De son côté, Moscou nie la version des faits et demande une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU, afin de statuer sur les "provocations haineuses" commises selon elle par l'Ukraine dans le territoire de Boutcha.
7 avril 2022 : accord des Vingt-Sept sur la cinquième salve de sanctions européennes contre Moscou
Après plusieurs jours de discussions, faisant suite aux propositions de la Commission européenne, les Vingt-Sept s'accordent le jeudi 7 avril pour un cinquième train de sanctions à l'encontre de la Russie. La découverte des dizaines de civils morts à Boutcha a poussé les Européens à renforcer leur réaction face à la guerre en Ukraine. Ainsi, pour la première fois, une mesure concernant l'énergie est prise : celle d'un embargo sur le charbon russe. En revanche, aucune mesure n'est adoptée sur le gaz et le pétrole, alors que le Parlement européen vote (à la très grande majorité : 513 eurodéputés pour, 22 contre et 19 abstentions) lors de la même journée du 7 avril une résolution réclamant l'imposition d'un embargo "total et immédiat" sur les importations "de pétrole, de charbon de combustible nucléaire et de gaz" russes.
En plus de cette sanction sur le charbon, les ports de l'Union sont désormais fermés aux navires russes, ainsi que les routes européennes pour les transporteurs russes et biélorusses. Des interdictions d'exportations vers la Russie, notamment de biens de haute technologie, mais aussi de nouveaux gels d'avoirs de banques russes sont également décidées. D'autres mesures restrictives visant des oligarques et des membres de l'appareil sécuritaire et militaire du secteur industriel et technologique russe sont arrêtées. Enfin, dans le cadre de la Facilité européenne pour la paix, l'UE propose d'augmenter encore de 500 millions d'euros le financement d'envoi d'armes à l'Ukraine, pour porter l'aide militaire européenne à un total de 1,5 milliard depuis le début de la guerre.
Le lendemain, le 8 avril, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen et le chef de la diplomatie de l'UE Josep Borrell se rendent dans la capitale ukrainienne afin de rencontrer le président Volodymyr Zelensky et de lui exprimer un "soutien indéfectible" et leur solidarité envers le peuple ukrainien. Lors de leur rencontre, un plan de financement européen pour l'Ukraine est notamment discuté.
11 avril 2022 : sixième paquet de sanctions discuté et rencontre du chancelier autrichien avec Vladimir Poutine
Les ministres européens des Affaires étrangères se réunissent à Luxembourg le 11 avril afin de trouver un accord sur un sixième train de sanctions à l'égard de Moscou. Trouver un consensus devient plus difficile, sur les questions énergétiques principalement et en particulier sur le pétrole et le gaz. Pour autant, des alternatives aux hydrocarbures russes sont recherchées, avec des projets de terminaux méthaniers en Allemagne, en Finlande ou en France, en passant par de possibles nouvelles voies à travers l'Espagne ou l'est de la mer Méditerranée. A côté de ces négociations difficiles, les Européens s'accordent toutefois sur une rallonge de 500 millions d'euros supplémentaires en soutien militaire à l'Ukraine, pour porter le budget total à 1,5 milliard depuis le début de l'offensive russe.
Ce même jour, le chancelier autrichien Karl Nehammer se rend 11 avril à Moscou pour rencontrer le président Vladimir Poutine. Il s'agit de la première rencontre entre un dirigeant européen et le chef du Kremlin depuis le début de la guerre le 24 février. Après une discussion "franche, ouverte et difficile", le chancelier autrichien se montre pessimiste et déclare qu'il "ne faut pas se faire d'illusions" et que le président russe "est entré massivement dans une logique de guerre".
Sur le front du conflit, la situation apparaît plus désespérée que jamais à Marioupol. Assiégée depuis une quarantaine de jours et amplement détruite, la ville portuaire est sur le point de tomber aux mains des Russes, la 36ème brigade de la marine nationale ukrainienne annonçant le 11 avril qu'elle se prépare à "une ultime bataille" car ses munitions s'épuisent. Dans cette ville stratégique dévastée, le président ukrainien Volodymyr Zelensky craint qu'il y ait des "dizaines de milliers" de morts depuis le début des combats. Ce même jour, le chef des séparatistes pro-russes de Donetsk affirme que ses forces ont conquis entièrement la zone portuaire de la ville de Marioupol. En parallèle, après le retrait des troupes russes des régions du nord du pays et des alentours de Kiev, l'armée ukrainienne craint une offensive russe "très prochainement" à l'est, dans la région du Donbass qui est devenue la principale cible du Kremlin.
13-15 avril 2022 : la Finlande et la Suède se dirigent vers une adhésion à l'Otan et un grand navire russe coule
Le mercredi 13 avril, les Premières ministres suédoise et finlandaise, Magdalena Andersson et Sanna Marin, se retrouvent pour évoquer la possible adhésion de leur pays à l'Alliance atlantique dans les prochains mois. Historiquement neutres, les deux Etats scandinaves repensent leur doctrine suite au déclenchement de la guerre en Ukraine et face à la menace russe. Concernant le soutien des populations à cette potentielle adhésion à l'Otan, Sanna Marin déclare que "l'état d'esprit des Finlandais comme des Suédois s'est transformé radicalement à cause des actes de la Russie". Le processus d'adhésion étant enclenché en Finlande à partir de ce jour, cela représente un revers important pour Vladimir Poutine.
Face à cet échec géostratégique, le Kremlin réagit, notamment par la voix de son ancien président Dmitri Medvedev. Celui-ci fait clairement savoir que Moscou renforcerait ses moyens militaires en mer Baltique en cas d'adhésion des deux pays scandinaves à l'Otan. M. Medvedev prévient que, si cette hypothèse venait à se confirmer, "les frontières de l'Alliance [atlantique] avec la Russie ferait plus que doubler" et qu'il faudrait les défendre, notamment en déployant des missiles et des armes nucléaires aux portes de la Finlande et de la Suède.
Sur le plan du conflit en Ukraine, les troupes russes essuient un spectaculaire coup dur. Alors que les fronts de la guerre n'évoluaient pratiquement plus depuis plusieurs jours, la flotte du Kremlin subit la perte du Moskva, son principal croiseur, le jeudi 14 avril. Ce navire était l'un des fleurons de la marine russe et était extrêmement puissant. Les Ukrainiens affirment avoir touché le croiseur avec des missiles tandis que les Russes évoquent un incendie à bord… Cet événement fait craindre une nouvelle escalade dans le conflit. En grande difficulté sur le plan militaire, le président Vladimir Poutine pourrait céder à l'utilisation d'armes nucléaires tactiques, c'est en tout cas ce que craignent les renseignement américains.
Le vendredi 15 avril, au lendemain du naufrage du Moskva en mer Noire, Moscou menace d'intensifier ses frappes sur la capitale Kiev. Des représailles qui feraient suite aux accusations par la Russie de bombardements ukrainiens de deux villages sur son territoire. Dans la foulée, le ministère de la Défense du Kremlin annonce avoir bombardé une usine d'armement près de Kiev.
17-18 avril 2022 : une nouvelle offensive russe d'ampleur débute dans l'est de l'Ukraine
Le 18 avril, le président ukrainien Volodymyr Zelensky annonce que l'offensive russe prévue depuis plusieurs jours dans l'est du pays a démarré. "Nous pouvons maintenant affirmer que les troupes russes ont commencé la bataille pour le Donbass, pour laquelle elles se préparent depuis longtemps", affirme-t-il. Mais "peu importe combien de soldats russes sont amenés jusqu'ici, nous combattrons", poursuit-il. Même son de cloche dans la ville de Marioupol, cible d'attaques ininterrompues depuis le début de la guerre, où les derniers résistants rejettent l'ultimatum russe qui exige que les Ukrainiens déposent les armes. Les défenseurs de Marioupol se disent prêts à poursuivre les combats "jusqu'au bout".
Le 17 avril, Moscou avait mené une série de bombardements à Kharkiv, mais aussi à Kiev, les deux plus grandes villes du pays. Le lendemain, c'est la ville de Lviv dans l'ouest qui est également prise pour cible par des missiles russes. Dans le Donbass, où le conflit s'intensifie, le gouverneur ukrainien de la région de Louhansk relate que l'offensive "dont on parle depuis des semaines" a commencé et décrit un "enfer".
Suite à ces frappes russes, l'Union européenne condamne "des bombardements aveugles et illégaux de civils" et le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell avertit qu'il "ne peut pas y avoir d'impunité pour les crimes de guerre".
Le mardi 18 avril, la Russie déclare avoir mené une dizaine de frappes dans l’est de l’Ukraine, entamant la bataille pour le Donbass. Selon le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov, il s’agit d’une "nouvelle phase" de la guerre. Dans le même temps, Washington fait savoir que l’Ukraine a reçu des avions de chasse et des pièces détachées pour renforcer son armée de l’air.
Lors d’une réunion virtuelle tenue le même jour, l'Union européenne et les Etats-Unis parviennent à un nouveau consensus sur la nécessité d’accentuer la pression sur le Kremlin, à travers l’adoption de sanctions supplémentaires, en particulier sur l'énergie. Ils conviennent de réduire fortement le recours aux hydrocarbures russes, manne financière considérable pour Moscou.
20-24 avril 2022 : les combats se poursuivent sans trêve à Marioupol, le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken à Kiev
Alors que l'offensive russe s'intensifie dans le Donbass, la chute de Marioupol se rapproche. Le 20 avril, le ministre ukrainien de la Défense explique que l'armée russe "concentr[e] l'essentiel de ses efforts sur la prise de Marioupol" et dénonce des "tentatives d'assaut" dans les régions de l'est de l'Ukraine. "La situation se complique d'heure en heure", s'inquiète-t-il. Ce même jour, le président du Conseil européen Charles Michel se rend à Kiev et assure que l'Union fera "tout son possible" pour que l'Ukraine "gagne la guerre", tout en affirmant que les Vingt-Sept continueront à "prendre des décisions tous ensemble".
Pour apporter une nouvelle aide militaire à Kiev, des pays d'Europe de l'Est enverront "dans les prochains jours" des armes lourdes, dont des chars de combats et des véhicules blindés, déclare le 21 avril la ministre allemande de la Défense Christine Lambrecht. Le lendemain, la France annonce aussi la livraison d'armes lourdes à l'Ukraine. Parallèlement, le 21 avril, le président russe Vladimir Poutine affirme "la fin du travail de libération de Marioupol" et juge que ses forces ont pris le contrôle de la ville portuaire stratégique. Une affirmation que le président américain Joe Biden conteste puisque, selon lui, "il n'y a encore aucune preuve que Marioupol soit complètement perdue".
D'après une déclaration du 22 avril d'un responsable militaire russe, le général Roustam Minnekaïev, le Kremlin compte "établir un contrôle total sur le Donbass et sur le sud de l'Ukraine", afin de permettre "d'assurer un couloir terrestre vers la Crimée" et de prendre possession des "ports de la mer Noire". Il poursuit en déclarant que ce contrôle du territoire ouvrirait "un couloir vers la Transnistrie" (menaçant ainsi la Moldavie), région où selon lui "on observe également des cas d'oppression de la population russophone".
Lors du week-end des 23 et 24 avril, l'invasion de l'Ukraine par la Russie franchit le cap des deux mois. Selon le ministre russe des Affaires étrangères, les négociations au sujet du conflit "patinent" entre Kiev et Moscou. Mais le samedi 23 avril, Volodymyr Zelensky appelle de nouveau à rencontrer Vladimir Poutine pour "parvenir à un accord de paix entre la Russie et l'Ukraine". Le lendemain, le dimanche 24 avril, le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken et le ministre de la Défense Lloyd Austin se rendent à Kiev, ce qui correspond à la première venue de dirigeants des Etats-Unis depuis le début du conflit. M. Blinken souhaite "un retour rapide à la paix" et affirme que les Américains continueront à soutenir les Ukrainiens.
Le lundi 25 avril, au terme de nouvelles négociations, aucun accord n'est conclu pour créer un couloir humanitaire afin d'évacuer les civils à Marioupol. Selon le président ukrainien, il y aurait environ un millier de civils et des centaines de blessés retranchés dans des conditions désastreuses à l'intérieur d'une usine métallurgique. La situation humanitaire continue de s'aggraver, tandis que l'ONU annonce que le nombre de réfugiés ayant quitté l'Ukraine depuis le 24 février a dépassé les 5,2 millions personnes.
4 mai 2022 : la Commission européenne présente un sixième train de sanctions contre la Russie
Après plus de deux mois d'un conflit qui ne semble pas près de se terminer, l'UE cherche à freiner Moscou en lui infligeant des sanctions supplémentaires. Ainsi, l'exécutif européen propose aux Etats membres un sixième paquet de mesures. Celles-ci consistent d'abord en la suspension de trois autres banques russes du système financier Swift, dont Sberbank, la plus importante de Russie. Ensuite, le secteur énergétique est une nouvelle fois concerné puisque Mme von der Leyen suggère aux pays membres de l'Union de mettre en place un embargo progressif sur le pétrole et les produits pétroliers achetés à la Russie. "Nous renoncerons progressivement aux livraisons russes de pétrole brut dans les six mois et à celles de produits raffinés d'ici à la fin de l'année", a-t-elle déclaré.
Ce sixième train de sanctions pourrait cependant être plus difficilement adopté par les Vingt-Sept que les précédents. Ursula von der Leyen reconnaît que "ce ne sera pas facile" étant donné que "certains Etats sont fortement dépendants du pétrole russe". Dans ce cadre, le projet d'embargo prévoirait une exemption pour la Hongrie et la Slovaquie, deux pays enclavés qui pourraient continuer leurs achats d’hydrocarbures à la Russie en 2023. Budapest a réagi rapidement à l'annonce de proposition d'embargo européen sur le pétrole russe et a pointe du doigt le fait qu'il n'y aurait aucune "garantie" pour sa sécurité énergétique.
Les nouvelles sanctions viseraient par ailleurs de nouvelles personnalités (58 au total) telles que le patriarche Kirill, le chef de l'Eglise orthodoxe russe et soutien affiché de la guerre contre l'Ukraine, mais également des militaires ou encore la famille du porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov. La Commission a aussi ajouté que trois grands radiodiffuseurs détenus par l'Etat russe seraient interdits sur les ondes européennes si le nouveau train de sanctions était adopté.
9 mai 2022 : Vladimir Poutine célèbre la victoire de 1945, Emmanuel Macron fête la Journée de l'Europe
Le 9 mai, la Russie et l'Union européenne célèbrent en même temps une journée particulièrement symbolique pour leur unité respective. De son côté, Moscou commémore la défaite de l'Allemagne nazie, le Jour de la Victoire, et M. Poutine profite de cette occasion et de ce grand défilé militaire pour proclamer que son armée ne fait que défendre "la patrie" en Ukraine face à la "menace inacceptable" que représente le camp occidental aux frontières russes.
L'Union européenne, quant à elle, fête sa Journée de l'Europe : l'occasion pour Mme von der Leyen d'annoncer que la Commission rendra son avis en juin sur la candidature de l'Ukraine à l'adhésion européenne. Tout juste réinvesti, Emmanuel Macron appelle à la création d'une "communauté politique européenne" afin de permettre "aux nations européennes démocratiques adhérant à notre socle de valeurs, de trouver un nouvel espace de coopération, en matière de politique, de sécurité, d'énergie, de transport, d'investissement, d'infrastructures, de libre circulation des personnes", tout en rappelant qu'une procédure d'adhésion à l'Union peut prendre à l'inverse "plusieurs décennies". Pour préciser cette proposition, l'Elysée explique qu'en raison du contexte géopolitique, il y a "urgence à ancrer l'Ukraine, la Moldavie, la Géorgie, mais aussi les Balkans occidentaux, à l'UE, et à renforcer la nature des relations".
De leur côté, les Etats-Unis souhaitent encore augmenter leur aide militaire à Kiev : après que le président Joe Biden a demandé un paquet de 33 milliards de dollars fin avril, les démocrates du Congrès américain veulent débloquer 40 milliards de dollars d'aide militaire et humanitaire à l'Ukraine.
Sur le territoire ukrainien, l'armée russe n’a jusqu’à présent pu revendiquer le contrôle complet que d’une ville d’importance : Kherson (dans le sud). L’offensive militaire de la Russie se poursuit "afin d’établir un contrôle total sur les régions de Donetsk, de Louhansk et de Kherson et de maintenir le couloir terrestre entre ces territoires et la Crimée", prévient l’état-major de l’armée ukrainienne. A Marioupol, les résistants assiégés refusent toujours de se rendre. "Capituler n’est pas une option car notre vie n’intéresse pas la Russie", affirme Ilya Samoïlenko, un officier du renseignement ukrainien.
15 mai 2022 : les gouvernements finlandais et suédois font part de leur volonté de rejoindre l'Otan
Le 13 avril 2022, les Premières ministres suédoise Magadalena Andersson et finlandaise Sanna Marin s'étaient réunies pour évoquer la possibilité d'une adhésion de leur pays respectif à l'Alliance atlantique. Les choses ont ensuite avancé très rapidement : le 12 mai, Helsinki fait savoir dans un communiqué que la perspective d'adhésion à l'Otan est soutenue par le gouvernement, qui souhaite une intégration "sans délai". Cette candidature représente un bouleversement géopolitique et un revirement pour Vladimir Poutine, notamment parce que la Russie partage plus de 1 300 kilomètres avec le territoire finlandais.
Le dimanche 15 mai, Helsinki présente son projet d'adhésion tandis que le parti social-démocrate suédois, dont Magdalena Andersson est issue, donne son accord pour une candidature commune à l'Otan avec la Finlande. Si la procédure aboutissait, ce serait le premier élargissement de l'alliance militaire à des pays qui n'appartenaient pas à l'URSS depuis l'intégration de l'Espagne en 1982.
Lors d'un appel avec son homologue finlandais Sauli Niinistö samedi 14 mai, le président russe Vladimir Poutine réagit aux annonces de la Finlande en déclarant qu’un renoncement à sa politique de non-alignement “serait une erreur, puisqu’il n’y a aucune menace à la sécurité" du pays. Moscou indique vouloir prendre des mesures "militaro-techniques" en réponse.
Le lundi 16 mai, le gouvernement suédois annonce à son tour sa candidature à l'Otan. La Première ministre évoque une nouvelle "ère" pour son pays. Elle estime que la procédure d'adhésion ne prendra "pas plus d'un an".
Ce même jour, les Ukrainiens annoncent qu'ils sont parvenus à repousser partiellement les forces ennemies en reprenant le contrôle d'une partie de la frontière avec la Russie, dans la région de Kharkiv au nord-est.
Plus symboliquement, Kiev remporte une autre victoire le samedi 14 mai, celle de l'Eurovision grâce au groupe ukrainien Kalush Orchestra. L'Ukraine reçoit donc la charge d'organiser la prochaine édition du concours en 2023. "Notre courage impressionne le monde, notre musique conquiert l’Europe", affirme le président Volodymyr Zelensky.
24 mai 2022 : trois mois après le début du conflit, les Ukrainiens résistent toujours mais sont en difficulté dans le Donbass
Après treize longues semaines de guerre, l'armée russe poursuit ses bombardements à l'est du territoire ukrainien afin de notamment prendre le contrôle de la ville de Sievierodonetsk dans le Donbass. Le 20 mai, Moscou annonce avoir achevé la conquête de Marioupol, la cité portuaire martyre qui a été détruite à 90 % d'après les autorités locales. A la suite des échecs qu'ont représenté les assauts russes dans le nord de l'Ukraine et à Kiev durant les premiers jours de l'invasion, cette conquête représente un succès stratégique majeur du point de vue des Russes, après près de trois mois de conflit intense.
Le 22 mai, le président polonais Andrzej Duda effectue une visite surprise auprès de Volodymyr Zelensky à Kiev, lui apportant un soutien "inconditionnel" pour la candidature de son pays à l'UE. Fidèle à la cause ukrainienne, M. Duda en profite pour critiquer les pays qui continuent de commercer avec la Russie, estimant que tout “business as usual” avec Moscou est impossible après la découverte de massacres de civils en Ukraine. Le chef d'Etat de Pologne salue les peuples qui “versent leur sang” pour appartenir à l’Europe. Concernant l'intégration de l'Ukraine à l'UE, il déclare n'avoir “aucun doute" que cette dernière "fera un tel geste” envers le pays. Mais la position est plus nuancée du côté de Paris. Selon le ministre français des Affaires européennes Clément Beaune, l'adhésion prendra "sans doute 15 ou 20 ans".
Le 23 mai, la première condamnation pour crimes de guerre dans le cadre du conflit tombe. Un soldat russe de 21 ans, du nom de Vadim Chichimarine, reçoit une lourde peine pour avoir tué un civil ukrainien de 62 ans : la prison à vie.
Sur le front, la situation devient "extrêmement difficile" dans la région du Donbass, considère le président ukrainien Volodymyr Zelensky. De manière générale dans le pays, "les prochaines semaines seront difficiles", prévient-il le 23 mai dans son allocution télévisée quotidienne.
30 mai 2022 : les Européens s'accordent sur un embargo partiel des importations de pétrole russe
Après plusieurs semaines de discussions entre les institutions européennes et la Hongrie (qui souhaitait des garanties sur son approvisionnement énergétique avant de lever son veto sur un embargo vis-à-vis du pétrole russe), les Vingt-Sept réunis en sommet européen trouvent un accord le 30 mai pour se couper de la majeure partie du pétrole acheté à Moscou. Ce sont uniquement les importations par bateau dans l'UE qui sont visées dans le cadre de cet accord, mais pas celles par oléoduc qui restent significatives. L'interdiction prend effet six mois plus tard et concerne plus des deux tiers des importations de pétrole russe.
L'Allemagne et la Pologne ont aussi annoncé mettre fin à leurs importations par oléoduc d'ici à la fin de l'année, ce qui permettra à “l’UE [de] tarir de 90 % les livraisons de pétrole russe d’ici la fin 2022″, selon le président du Conseil européen Charles Michel. L'objectif est toujours de sanctionner le Kremlin pour la guerre qu'il mène en Ukraine et ainsi de le couper d'une source de financement dont il bénéficie. L'exemption vis-à-vis des importations par oléoduc bénéficie avant tout à la Hongrie, à la Slovaquie et à la République tchèque, puisque ces pays enclavés continueront d'être approvisionnés par le pipeline russe Droujba. La Bulgarie devrait également être autorisée à se procurer l'hydrocarbure russe pendant un an et demi.
Le sixième train de mesures comprend d’autres sanctions telles que le retrait de la Sberbank, la plus grande banque commerciale de Russie, du système de paiement Swift. Les nouvelles sanctions visent également des militaires russes responsables des massacres commis à Boutcha et dans d’autres villes occupées par les troupes russes. Initialement ciblé, le patriarche Kirill, chef de l’Eglise orthodoxe russe et proche allié du président Poutine, est finalement retiré de la liste des personnalités sanctionnées sur demande de la Hongrie lors de l'adoption du sixième train de mesures restrictives au Conseil de l'UE le 2 juin. Les chefs d'Etat et de gouvernement européens ont aussi approuvé l’octroi de 9 milliards d’euros à l'Ukraine pour aider son économie lourdement affectée par la guerre.
7 juin 2022 : la ville de Sievierodonetsk devient le théâtre principal de la guerre entre Russes et Ukrainiens
Depuis plusieurs jours, la bataille pour Sievierodonetsk fait rage dans le Donbass et la ville est en proie à de violents combats entre les forces russes et ukrainiennes. Le 4 juin, le gouverneur de Louhansk Serguiï Gaïdaï reconnaît que la situation dans la région s'avère "extrêmement difficile" et que "les combats se concentrent actuellement à Sievierodonetsk car […] l'armée russe a jeté tout son poids et ses réserves" dans la conquête de cette ville clé.
Alors que Moscou gagnait du terrain dans Sievierodonetsk, Kiev affirme le 5 juin que ses "forces armées ont nettoyé la moitié" des troupes russes qui s'y trouvaient, déclarant que "la moitié de la ville est sous le contrôle [des] défenseurs" ukrainiens. Dans le même temps, plusieurs frappes aériennes russes sont effectuées à Kiev, alors que la capitale n'avait pas été ciblée depuis la fin du mois d'avril. Quatre missiles frappent l'usine de Darnytsia, dans le sud-est de la capitale, annonce le chef de la compagnie publique des chemins de fer ukrainienne Ukrzaliznytsia. Selon lui, l'usine ne s'occupe pas des équipements militaires, mais répare des wagons transportant des céréales exportées.
En parallèle, Vladimir Poutine prévient que Moscou répondrait si les Occidentaux fournissaient des missiles de longue portée à l'Ukraine, jugeant que les livraisons d'armes visaient à "prolonger le conflit". En cas de livraisons de tels équipements, "nous tirerons les conclusions appropriées et utiliserons nos armes […] pour frapper des sites que nous n'avons pas visés jusqu'à présent", menace-t-il.
Les Ukrainiens "tiennent bon" à Sievierodonetsk, mais les Russes y sont "plus nombreux et plus puissants", si bien que la situation est "difficile" sur le front oriental, prévient Volodymyr Zelensky. "Les principaux efforts de l’ennemi se concentrent" sur ce centre industriel pour "bloquer" les troupes ukrainiennes dans la région voisine de Lyssytchansk, fait savoir l’armée ukrainienne. Mais le 7 juin, le ministre russe de la Défense Sergueï Choïgou affirme que son armée a "totalement libéré" les zones résidentielles de Sievierodonetsk. Cette affirmation n'est pas confirmée par l'Ukraine. "Ils ne contrôlent pas la ville", rétorque Serguiï Gaïdaï. Sa prise ouvrirait aux Russes la route de Kramatorsk, grande ville de la région de Donetsk, d'autant que Sievierodonetsk est la dernière agglomération encore sous contrôle ukrainien dans la région de Louhansk.
Alors que Sievierodonetsk est "bombardée 24 heures sur 24", le gouverneur de la région Serguiï Gaïdaï envisage un retrait des troupes ukrainiennes vers des positions mieux fortifiées. "Il faudra peut-être se retirer", avoue-t-il. La ville ne devient totalement occupée par les Russes qu’à la fin juin.
16 juin 2022 : Emmanuel Macron, Olaf Scholz et Mario Draghi se rendent à Kiev
Le 13 juin, le chef d'Etat ukrainien déclare que le "coût humain" de la bataille de Sievierodonetsk s'avère "terrifiant". En parallèle, les autorités ukrainiennes indiquent avoir abandonné le centre-ville suite aux vagues d'attaques par les forces russes, même si les combats se poursuivent.
Le 14 juin, Moscou propose d'instaurer un couloir humanitaire à Sievierodonetsk à partir du 15 juin pour que les civils puissent être évacués "en toute sûreté". Le ministère russe de la Défense appelle également à cesser cette "résistance absurde" qui se concentre dans une grande usine chimique.
Alors que Kiev, par l'intermédiaire de la vice-ministre de la Défense Anna Maliar, regrette n'avoir reçu qu'"environ 10 %" des armes dont les Ukrainiens ont besoin, Washington annonce une nouvelle aide militaire d'un montant d'un milliard de dollars "pour leurs opérations défensives dans le Donbass".
Jeudi 16 juin, les président français, le chancelier allemand et le président du Conseil des ministres italien partent en train depuis le sud de la Pologne en direction de Kiev pour rendre visite à Volodymyr Zelensky. Un déplacement inédit de la part des trois dirigeants depuis le début de l'invasion russe en février, destiné à exprimer le soutien de leur pays, puissances européennes fondatrices de l'UE. Ils sont ensuite rejoints par le chef d'Etat roumain Klaus Iohannis pour rencontrer le président ukrainien.
La France annonce notamment la livraison de six nouveaux canons Caesar à Kiev (en plus des 12 qui ont déjà été envoyés), un système d'artillerie très prisé pour sa précision. Surtout, Paris, Berlin, Rome et Bucarest se prononcent en faveur d'un octroi "immédiat" à l'Ukraine du statut de candidat "immédiat" à l'adhésion à l'Union européenne. "Ce statut sera assorti d'une feuille de route et impliquera aussi que soit prise en compte la situation des Balkans occidentaux et du voisinage, en particulier de la Moldavie", ajoute Emmanuel Macron.
17 juin 2022 : la Commission européenne en faveur de l'octroi à l'Ukraine du statut de candidat à l'adhésion européenne
Le 17 juin 2022, la Commission européenne recommande formellement aux Etats membres d’accorder à l’Ukraine le statut de candidat à l’UE. “La Commission recommande au Conseil, premièrement, de donner à l’Ukraine une perspective européenne et, deuxièmement, de lui accorder le statut de candidat. Ceci, bien entendu, à condition que le pays procède à un certain nombre de réformes importantes”, déclare la présidente de l'institution Ursula von der Leyen.
L'avis de l'exécutif européen est présenté avant le sommet européen des 23 et 24 juin, où l'Ukraine pourra formellement être reconnue en tant que candidate à l'intégration européenne si les Vingt-Sept le choisisse à l'unanimité. A ce sujet, le président Volodymyr Zelensky insiste : "cette semaine sera historique pour notre pays lorsque nous entendrons la réponse de l’Union européenne sur le statut de candidat de l’Ukraine". “Depuis 1991, il y a eu peu de décisions aussi fatidiques pour l’Ukraine que celle que nous attendons aujourd’hui”, affirme-t-il également, en se déclarant “convaincu que seule une réponse positive est dans l’intérêt de toute l’Europe”.
23 juin 2022 : les chefs d'Etat et de gouvernement des Vingt-Sept accordent le statut de candidat à l'UE à l'Ukraine
Réunis en Conseil européen à Bruxelles, les dirigeants des Etats membres octroient à l'Ukraine le statut de candidat à l'adhésion européenne, suivant ainsi la recommandation émise par la Commission européenne six jours plus tôt. Un "moment historique" pour le président du Conseil européen Charles Michel. "L'une des décisions les plus importantes pour l'Ukraine depuis son indépendance", salue son chef d'Etat Volodymyr Zelensky. Le pays avait déposé sa candidature le 28 février, soit quatre jours seulement après le début de l'invasion russe.
Dans le même temps, les Vingt-Sept accordent aussi le statut de candidat à la Moldavie, un Etat frontalier de l'Ukraine craignant d'être la prochaine cible de Vladimir Poutine. En revanche, la Géorgie, qui avait candidaté en même temps que les Moldaves le 3 mars, ne voit pas sa candidature officiellement reconnue. En cause notamment : un gouvernement à l'orientation de plus en plus pro-russe et des atteintes répétées à l'état de droit.
4-5 juillet 2022 : à Lugano, les partenaires de l'Ukraine s'accordent sur les principes de la reconstruction du pays
La ville de Lugano a accueilli les 4 et 5 juillet une conférence pour la reconstruction de l'Ukraine, rassemblant des chefs de gouvernements, des acteurs institutionnels ou des ONG. Pour représenter l'UE, Ursula von der Leyen s'est rendue sur place, accompagnée du Premier ministre tchèque Petr Fiala dont le pays exerce actuellement la présidence tournante du Conseil.
Pour certains, l'idée de cette conférence était de fonder un "plan Marsall" pour aider Kiev à se reconstruire après la guerre. Au terme de ces deux journées, il a été décidé que les futures aides financières - conditionnées à la fin du conflit - ne seront versées que si l'Ukraine entreprend des réformes importantes en matière de lutte contre la corruption notamment. Face à cette demande, le Premier ministre ukrainien Denys Chmyhal a promis de “non seulement combattre la corruption mais la rendre impossible”.
Outre ce dossier, le pays devra réaliser des investissements massifs pour favoriser la confiance des entreprises et réformer sa représentativité démocratique. Plusieurs participants ont également précisé le montant de leur aide : pour l'UE, un nouveau plan impliquant la Banque européenne d’investissement doit mobiliser jusqu’à 100 milliards d’euros.
21 juillet 2022 : l'UE adopte un embargo sur l'or russe
Les Vingt-Sept s'entendent sur un septième train de sanctions. La principale concerne l'interdiction d'importer de l'or en provenance de Russie, y compris les bijoux. Cette sanction a encore une fois pour but d'affaiblir l'économie russe et de limiter la capacité du Kremlin à financer la guerre en Ukraine.
Les actifs de Sberbank, la plus grande banque russe, dans l'UE sont par ailleurs gelés. La liste des personnalités et entités figurant sur la liste noire de l'Union est dans le même temps allongée. Enfin, les ressources de certaines banques originaires de Russie, sanctionnées par les Etats membres mais nécessaires au commerce de produits alimentaires comme le blé, sont débloquées afin que les mesures restrictives de l'UE n'aggravent pas la crise alimentaire liée au conflit en Ukraine.
26 juillet 2022 : accord des Vingt-Sept pour réduire leur consommation de gaz de 15 % afin de prévenir une rupture de l'approvisionnement russe
Et si Moscou décidait de complètement fermer le robinet de gaz ? Alors que l'offre russe a déjà baissé de 30 % par rapport à la période 2016-2021 selon la Commission européenne, les Etats membres de l'UE s'entendent sur une mesure visant à réduire le poids de l'arme énergétique brandie par la Russie, destinée à sanctionner leur soutien à l'Ukraine. Afin d'éviter une pénurie l'hiver à venir, les ministres européens de l’Energie approuvent une réduction de 15 % de leur consommation de gaz entre le 1er août 2022 et le 31 mars 2023 par rapport à leur consommation moyenne au cours de la même période ces cinq dernières années.
L’objectif n’est pas contraignant : chaque gouvernement s'engage à faire “tout son possible” pour l’atteindre et reste libre des mesures à prendre en ce sens. Le Conseil de l’UE, qui regroupe les ministres des 27 Etats membres, peut toutefois déclencher un état d’alerte en cas de rupture grave d’approvisionnement ou de demande très élevée. Auquel cas un certain nombre de pays seront cette fois tenus de respecter cette réduction de 15 %.
La proposition initiale de la Commission avait été sévèrement critiquée par plusieurs pays européens en amont de la réunion du Conseil, dont l’Espagne, le Portugal, la Grèce et la France. En cause : l’uniformité des mesures, qui tenait peu compte de la diversité des situations nationales. Après les négociations, seule la Hongrie a finalement voté contre la proposition.
4 août 2022 : l'UE sanctionne l'ancien président ukrainien Viktor Ianoukovytch
Les Etats membres de l'UE ajoutent à leur liste noire l'ancien chef d'Etat ukrainien Viktor Ianoukovytch, de même que son fils Oleksandr. Ces derniers sont ainsi soumis à une interdiction de visa dans les Vingt-Sept et à un gel de leurs potentiels actifs détenus dans l'Union. Viktor Ianoukovytch est accusé d'avoir pris part à une opération russe visant à remplacer le président Volodymyr Zelensky par lui au début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, initiée le 24 février 2022.
Au pouvoir de 2010 à 2014, M. Ianoukovytch avait été renversé par un soulèvement populaire après avoir refusé de signer un accord d'association avec l'UE et s'être rapproché de Moscou. Ce à quoi la Russie avait répondu en annexant la Crimée et en soutenant les séparatistes pro-russes des régions de Donetsk et de Louhansk.
Olekansdr Ianoukovytch est quant à lui sanctionné pour ses liens, notamment financiers, avec les séparatistes du Donbass.
30 août 2022 : feu vert politique des ministres européens de la Défense pour préparer une mission de formation militaire de l'UE en Ukraine
Alors que les Européens ont débloqué 2,5 milliards d'euros destinés à financer l'envoi d'armes à l'Ukraine depuis février, ils pourraient compléter leur soutien en formant directement des forces ukrainiennes. Le 30 août, les ministres de la Défense des Vingt-Sept approuvent le lancement de travaux préparatoires à ce sujet. Ceux-ci visent à définir la forme que pourra prendre une nouvelle mission d'assistance et d'entraînement militaire de haut niveau auprès de l'armée ukrainienne. Si elle est formellement validée, cette initiative viendra s'ajouter aux sept missions militaires actuellement menées par l'UE, quasiment toutes en Afrique et elles aussi principalement tournées vers la formation. Un domaine dans lequel l'Union développe son expertise depuis le début des années 2000.
31 août 2022 : l'UE suspend un accord qui facilitait l'obtention des visas pour les citoyens russes
Les ministres des Affaires étrangères des Etats membres s'entendent pour suspendre un accord de 2007 facilitant l'obtention des visas de court séjour (tourisme) pour les ressortissants russes. Une mesure bien plus radicale est en revanche écartée par les gouvernements européens : l'interdiction totale de ces visas de court séjour pour les citoyens russes.
Réclamée par le président ukrainien Volodymyr Zelensky et avancée par la présidence tchèque du Conseil, cette dernière mesure était soutenue par plusieurs pays tels que la Pologne, les Etats baltes ou encore la Finlande. Mais d'autres, à l'instar de la France, de l'Allemagne, de l'Autriche ou bien de la Hongrie avaient fait part de leur rejet de la proposition. Josep Borell, haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et notamment chargé de présider les Conseils Affaires étrangères, s'y était également déclaré opposé. L'accord des Vingt-Sept autorise toutefois les pays frontaliers de la Russie à procéder à une telle interdiction des visas.
30 septembre 2022 : en réaction à l'annexion de territoires séparatistes par la Russie, l'Ukraine demande une "adhésion accélérée à l'Otan"
La réponse de Kiev à Moscou ne s'est pas fait attendre. Le jour de la célébration en grande pompe par Vladimir Poutine de l'annexion des oblasts de Donetsk, Louhansk, Kherson et Zaporijia, à la suite de référendums non reconnus par la communauté internationale, l'Ukraine réplique en demandant une intégration rapide au sein de l'Alliance atlantique. Alors que le président ukrainien Volodymyr Zelensky avait estimé en mars que son pays ne pourrait pas rejoindre l'Otan, la fuite en avant de la Russie dans le conflit a ainsi fait évoluer sa position. Une "adhésion accélérée", comme demandée par Kiev, reste toutefois peu probable à ce stade. L'unanimité des 30 Etats membres de l'organisation est requise, et l'intégration de l'Ukraine pourrait les faire entrer en guerre contre la Russie, un scénario que l'Otan veut éviter.
6 octobre 2022 : l'UE adopte un huitième train de sanctions contre la Russie
Après une proposition de la Commission européenne le 28 septembre, les ministres des Affaires étrangères des Vingt-Sept s'accordent sur un nouveau paquet de sanctions visant la Russie, afin d'affaiblir davantage la capacité du pays à financer sa guerre contre l'Ukraine. Celles-ci comprennent notamment un plafonnement du prix du pétrole russe à destination des pays tiers. Un accord à venir entre pays du G7 doit déterminer le seuil à appliquer.
Les transactions en cryptomonnaies avec les ressortissants russes sont par ailleurs interdites. De même que le commerce d'armes, d'armes à feu civiles, de munitions, de véhicules militaires et d'équipements militaires. L'import de produits sidérurgiques russes finis et semi-finis est également frappé d'interdiction, avec un manque à gagner pour Moscou estimé à sept milliards d’euros. Et il n'est plus possible de fournir à la Russie des services d'architecture et d'ingénierie, de conseil informatique et de conseil juridique.
Enfin, 30 personnes impliquées dans l'organisation des pseudo-référendums d'annexion dans l'est et le sud de l'Ukraine sont ajoutées à la liste noire l'UE (interdiction de séjour et avoirs gelés), ainsi que sept entités qui soutiennent l'effort de guerre du Kremlin.
20 octobre 2022 : des sanctions contre l'Iran pour son soutien militaire à la Russie
Les Etats membres de l'UE s'entendent pour ajouter à leur liste noire trois personnes ainsi qu'une entité iraniennes impliquées dans la fabrication de drones. Des armes fournies à la Russie et dont le déploiement en Ukraine est meurtrier.
15 novembre 2022 : début d'une mission militaire européenne pour former les soldats ukrainiens
Prévue pour deux ans, la mission doit permettre la formation de 15 000 militaires ukrainiens. Celle-ci a été décidée un mois plus tôt, le 17 octobre 2022, par les Vingt-Sept. La mission d'assistance militaire intitulée EUMAM Ukraine vient répondre à une demande des autorités ukrainiennes, qui cherchent notamment à renforcer leurs compétences en matière de déminage, de défense antiaérienne ou encore d'artillerie. Financée par la Facilité européenne pour la paix, instrument de la politique de sécurité et de défense commune, cette nouvelle initiative s'ajoute aux plus de 3,1 milliards d'aide militaire déjà accordés à Kiev. La mission est commandée par le vice-amiral Hervé Bléjean, militaire français occupant la fonction de directeur général de l'Etat-major de l'UE.
15 novembre 2022 : après une explosion mortelle en Pologne, l'Otan opte pour la prudence
Une explosion liée à un ou plusieurs missiles ou à des débris de missile provoque la mort de deux personnes à Przewodów, village polonais à six kilomètres de la frontière ukrainienne. L'hypothèse d'un tir russe fait craindre un élargissement du conflit, la Pologne étant membre de l'Otan. Réunis autour du président américain Joe Biden le 16 novembre, les dirigeants des pays de l'Alliance atlantique présents au G20 à Bali appellent à éviter toute conclusion hâtive. Pour les Alliés, cet événement serait vraisemblablement lié à un tir accidentel de la défense antiaérienne ukrainienne.
23 novembre 2022 : le Parlement européen qualifie la Russie d'"Etat promoteur du terrorisme"
Les eurodéputés adoptent à une large majorité (494 voix pour, 58 contre et 44 abstentions) une résolution désignant la Russie "comme un Etat promoteur du terrorisme et comme un Etat qui utilise des moyens terroristes". Un texte qui appelle les Vingt-Sept à créer un "cadre juridique européen" permettant de viser les Etats ainsi désignés par de lourdes sanctions. La résolution invite aussi les Etats membres de l'UE à inscrire le groupe Wagner, organisation paramilitaire proche du Kremlin et active en Ukraine, sur la liste européenne des organisations terroristes.
5 décembre 2022 : l'embargo européen sur le pétrole russe entre en vigueur
En application du sixième train de sanctions adopté en juin, les importations de pétrole russe dans l'UE par voie navale sont désormais interdites. Les livraisons par oléoduc ne sont en revanche pas visées. Une mesure prévue pour protéger l'approvisionnement des pays enclavés, tels que la Hongrie, la Slovaquie et la République tchèque. Autre exemption à l'embargo, la Bulgarie n'est pas tenue de l'appliquer avant un an et demi. L'Allemagne et la Pologne ayant décidé de ne plus recourir au pétrole russe via oléoduc, plus de 90 % des flux de pétrole en provenance de Russie sont cependant coupés.
Parallèlement, un plafonnement du prix du pétrole russe vendu aux pays tiers à 60 dollars le baril a été décidé le 2 décembre dernier successivement par l'UE, puis par le G7 et l'Australie. Le principe du plafond avait été adopté début octobre au niveau européen dans le cadre du huitième train de sanctions.
16 décembre 2022 : neuvième paquet de sanctions européennes contre la Russie
Décidé lors d'un Conseil européen le 15 décembre et formellement adopté par le Conseil le lendemain, le neuvième train de sanctions contre la Russie élargit les mesures restrictives de l'UE aux exportations de biens et technologies à usage civil et militaire permettant jusque-là le renforcement du secteur russe de la défense et de la sécurité. 168 nouvelles entités sont ainsi ciblées par des mesures sectorielles. Dans la ligne de mire de l'Union figurent notamment les produits chimiques clés, les équipements de vision nocturne et de radionavigation, les agents neurotoxiques ainsi que les composants électroniques et informatiques.
D'autres secteurs font aussi l'objet de sanctions. C'est le cas du secteur minier, dans lequel de nouveaux investissements européens sont frappés d'interdiction, avec une exception concernant les matières premières critiques. Les restrictions aux exportations dans le secteurs de l'aviation et de l'espace sont élargies pour y inclure les moteurs de drones, qui ne pourront plus être exportés vers la Russie ou des pays hors Union susceptibles de fournir des drones à Moscou.
Deux banques supplémentaires voient par ailleurs leurs actifs dans l'Union gelés, tandis que la Banque russe de développement régional, détenue par l'Etat, ne peut plus effectuer de transactions avec des sociétés européennes.
Ce neuvième train de mesures restrictives prévoit des dérogations aux sanctions pour préserver la sécurité alimentaire mondiale ou en cas de risque pour l'approvisionnement d'Etats membres en engrais.
Les médias russes sont aussi concernés par le paquet de mesures. Accusées de propager la désinformation et la propagande du Kremlin sur le conflit en Ukraine, les chaînes NTV/NTV Mir, Rossiya 1, REN TV et Pervy Kanal sont dans le viseur des Vingt-Sept, qui ont lancé le processus juridique pour leur interdire d'émettre dans l'UE.
23 janvier 2023 : l'UE accorde 500 millions d'euros supplémentaires d'aide militaire à l'Ukraine
Les Vingt-Sept s'entendent pour financer au niveau européen 500 millions d'euros d'armes et d'équipements militaires à destination des forces armées ukrainiennes. Depuis l'invasion russe en février, l'UE a ainsi débloqué un total de 3,6 milliards d'euros pour soutenir militairement Kiev. Un financement qui s'effectue via la Facilité européenne pour la paix, instrument budgétaire créé en mars 2021 dans le cadre de la Politique étrangère et de sécurité commune (PESC). Et qui s'ajoute aux aides versées par les Etats membres au niveau national, dont les montants ne sont pas toujours communiqués. Le 23 janvier 2023, les ministres des Affaires étrangères européens ont aussi décidé d'une enveloppe de 45 millions d'euros pour la formation de militaires ukrainiens dans l'UE.
25 janvier 2023 : l’Allemagne annonce la livraison de chars Leopard à l’Ukraine
Alors que la pression s'accentuait sur Berlin, le chancelier Olaf Scholz annonce officiellement la livraison de 14 chars de combat Leopard 2 à l'Ukraine. Ces mêmes blindés détenus par d'autres pays européens - à l'instar de la Pologne, de la Norvège ou encore de l'Espagne - pourront aussi être livrés à Kiev, fait savoir le gouvernement allemand. De quoi fournir un apport technologique et matériel conséquent à l'armée ukrainienne, qui pourrait compter jusqu'à deux bataillons de quarante chars Leopard. D'autant que les Etats-Unis ont de leur côté annoncé la livraison de 31 chars Abrams. La France n'a quant à elle pas encore pris de décision à propos du déploiement de ses chars Leclerc en Ukraine.
3 février 2023 : sommet UE-Ukraine à Kiev
A l'occasion de ce 24e sommet entre les deux parties qui porte notamment sur le processus d'adhésion, l'Union européenne réaffirme son soutien à la candidature ukrainienne. La veille, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, accompagnée de 15 commissaires, a rencontré le gouvernement ukrainien à Kiev pour lui transmettre un message de solidarité et poursuivre le soutien financier apporté au pays. Un partenariat stratégique sur le biométhane, l'hydrogène et d'autres gaz de synthèse renouvelables est conclu afin de réduire la dépendance à l'égard des importations de combustibles fossiles. Par ailleurs, l'UE et l'Ukraine vont créer un bureau d'enquête sur les "crimes d'agression" de la Russie.
5 février 2023 : entrée en vigueur d'un deuxième embargo sur le pétrole russe
Un second embargo de l’UE sur le pétrole issu de Russie, concernant cette fois-ci les achats de produits pétroliers russes par voie maritime, couplé à un prix plafond de ces derniers appliqué par les pays du G7, entre en vigueur. Il s'ajoute aux sanctions en place depuis le 5 décembre sur le pétrole brut.
8-9 février 2023 : Volodymyr Zelensky en tournée européenne
Pour sa seconde sortie officielle hors d'Ukraine depuis l'invasion russe - la première ayant eu lieu aux Etats-Unis fin décembre - le président ukrainien rencontre le Premier ministre britannique Rishi Sunak le 8 février à Londres. Il poursuit sa tournée européenne en rendant visite dans la soirée à Emmanuel Macron et au chancelier allemand Olaf Scholz, au palais de l'Elysée.
Le 9 février, Volodymyr Zelensky rejoint Bruxelles, en s'adressant d'abord aux eurodéputés réunis au Parlement européen. "Si l’Ukraine tombe, c’est votre mode de vie qui disparaîtra, celui des Vingt-Sept", prévient-il. Enfin, le chef d'Etat ukrainien participe au sommet des 27 chefs d'Etat et de gouvernement le même jour. Le déplacement dans ces trois capitales européennes lui permet de remercier chaudement ses alliés pour leur soutien face à la Russie. Tout en lui offrant une tribune supplémentaire pour les appeler à accroître leur aide, notamment militaire. Après les livraisons de chars de combat, il demande en particulier à recevoir des avions de chasse.
25 février 2023 : un dixième train de sanctions européennes contre la Russie est adopté
Un après le début de l'invasion de l'Ukraine, les Vingt-Sept adoptent un dixième paquet de mesures restrictives contre la Russie. 121 nouvelles personnes et entités, dont des opérateurs iraniens, sont notamment sanctionnées pour leur contribution à l'effort de guerre russe. Parmi elles, des responsables militaires, des propagandistes ou encore des acteurs économiques et financiers, comme les banques Rosbank, Alfa Bank et Tinkoff.
Des restrictions à l'export supplémentaires sont mises en œuvre et visent encore une fois à empêcher la Russie de moderniser et d'approvisionner son armée. Ces mesures touchent, par exemple, les pièces de rechange pour moteurs à réaction et camions, les véhicules spécialisés ou bien le matériel de construction, à l'instar des grues et des antennes. Dans le même temps, des restrictions à l'import dans l'UE sont appliquées à des biens générateurs de revenus importants pour la Russie, le caoutchouc synthétique et l'asphalte en particulier.
Enfin, les citoyens russes ne peuvent plus occuper de postes de direction dans les infrastructures critiques de l'UE. Il est aussi interdit de leur fournir des capacités de stockage de gaz dans l'Union, à l'exception des installations de GNL.
23 mars 2023 : les Vingt-Sept approuvent un plan de livraison d'un million de munitions à l'Ukraine
Réunis en Conseil européen, les chefs d'Etat et de gouvernement valident un plan visant à faire parvenir un million d'obus à l'Ukraine d'ici à 12 mois. Quatre milliards d'euros seront nécessaires pour assurer ces livraisons, dont deux milliards fournis par l'Union européenne via la Facilité européenne pour la paix, un instrument de financement des dépenses communes en matière de défense. Si les Etats membres puiseront dans leurs stocks, ils prévoient aussi de réaliser des achats de munitions ensemble.
L'idée de réaliser des commandes communes avait été proposée cinq semaines plus tôt, en février, par la Première ministre estonienne Kaja Kallas. Le détail du plan européen avait ensuite été approuvé par les ministres des Affaires étrangères des Vingt-Sept le 20 mars, avant validation finale par les chefs d'Etat et de gouvernement quelques jours plus tard.
4 avril 2023 : la Finlande devient le 31e membre de l'Otan
L'intégration de la Finlande à l'Alliance atlantique est affective. Le pays devient ainsi le 31e membre de l'organisation politico-militaire, et le 22e Etat membre de l'Union européenne à y adhérer.
Depuis plusieurs mois, la Finlande attendait aux portes de l'Otan, après avoir été invitée en juin 2022 à la rejoindre, aux côtés de la Suède. En cause : les réticences de la Hongrie et de la Turquie à ratifier leur intégration. La première semble avoir tenté d'utiliser ce levier comme moyen de pression sur d'autres dossiers. Dans le cadre de ses tensions avec l’UE sur l’état de droit notamment, plusieurs milliards d’euros de fonds européens pour Budapest étant gelés. Quant à la seconde, elle a conditionné son accord à la coopération d'Helsinki et de Stockholm contre le PKK, organisation kurde combattue par l’Etat turc.
Mais sur ce sujet, les rapports de la Turquie sont plus tumultueux avec la Suède qu’avec la Finlande. Ce qui a ouvert la voie à la ratification turque de la seule adhésion d'Helsinki, précédée le 27 mars par celles des parlementaires hongrois. Si la Finlande est maintenant intégrée à l’Otan, la Suède attend encore les feux verts de la Turquie et de la Hongrie.
14-16 mai 2023 : en déplacement en Europe, Volodymyr Zelensky appelle ses alliés à intensifier leur soutien militaire
Le président ukrainien réalise une mini-tournée européenne au départ de l'Italie, où il rencontre le président italien Sergio Mattarella et la Première ministre Giorgia Meloni. Après un rendez-vous avec le pape François au Vatican, Volodymyr Zelensky rejoint l'Allemagne, s'entretenant avec le chancelier Olaf Scholz et recevant à Aix-la-Chapelle le prix Charlemagne, qui récompense les acteurs de l'unité européenne. Il s'envole ensuite pour la France pour rendre visite à Emmanuel Macron à l'Elysée. M. Zelensky termine son déplacement européen par le Royaume-Uni, où il est accueilli par le Premier ministre britannique Rishi Sunak.
Ces visites sont notamment motivées par la volonté de l'Ukraine de s'assurer du soutien militaire de ses alliés européens. Si ces derniers promettent de l'accroître en augmentant les livraisons d'armes, ils n'ont pas encore prévu d'envoyer des avions de combat, malgré les demandes répétées de Kiev.
Plus tôt en mai, Volodymyr Zelensky avait déjà réalisé un déplacement début mai en Finlande, dernier pays entré dans l'Otan, où il avait notamment défendu l'entrée du sien dans l'Alliance atlantique. Le voyage s'était poursuivi aux Pays-Bas, Etat dans lequel il avait plaidé pour la création d'un tribunal international spécial afin de juger les responsables de l'invasion russe de l'Ukraine.
21 juin 2023 : l'UE et ses alliés annoncent 60 milliards d'euros d'aide à l'Ukraine pour sa reconstruction
Une aide de 60 milliards d'euros destinés à financer la reconstruction de l'Ukraine est promise au pays, lors d'une conférence internationale consacrée à ce sujet, se tenant à Londres les 21 et 22 juin 2023. L'essentiel de cette aide, 50 milliards d'euros, est prévu par l'Union européenne. Les Etats-Unis annoncent également une nouvelle contribution d'1,2 milliards d'euros, notamment dans l'énergie et les infrastructures. La conférence organisée à Londres correspond aussi au lancement de l'"Ukraine business compact", une initiative invitant le secteur privé dans le monde entier à participer aux efforts de reconstruction.
23 juin 2023 : onzième train de sanctions européennes contre la Russie
Eviter le contournement des précédents paquets de sanctions : tel est l’objectif principal de ce onzième train de mesures restrictives adopté par les Etats membres de l'Union européenne.
Les semi-conducteurs ainsi que des biens en contenant — réfrigérateurs, imprimantes ou encore calculatrices électroniques — sont notamment visés par des interdictions d’exportation. Car la Russie, qui est dénuée d’industries fabriquant des semi-conducteurs, est soupçonnée de les récupérer dans ces produits et de s’en servir à des fins militaires.
Les navires pouvant avoir enfreint l’embargo sur le pétrole russe n’ont plus le droit d’accéder aux ports et aux écluses des Vingt-Sept.
Plusieurs entreprises, accusées de jouer un rôle dans l'acquisition par Moscou de biens interdits d’exportation, s'ajoutent par ailleurs à la liste des entités sanctionnées dans l’UE. Il s’agit de trois sociétés russes installées à Hong Kong, d’une compagnie iranienne, de deux firmes localisées aux Emirats arabes unis, de deux autres en Ouzbékistan, d’une en Arménie et d’une dernière en Syrie.
En réaction à la désinformation russe sur la guerre en Ukraine, cinq médias supplémentaires issus de Russie voient par ailleurs leurs licences de radiodiffusion dans l’Union supprimées. Avec la nouvelle salve de sanctions, un total de 71 personnes et 33 entités rejoignent ainsi la liste noire de l’UE.
8 novembre 2023 : la Commission européenne recommande aux Vingt-Sept l'ouverture des négociations d'adhésion à l'UE avec l'Ukraine
Dans son très attendu rapport annuel sur l'élargissement, la Commission européenne préconise aux Etats membres de l'UE l'ouverture des négociations d'adhésion avec Kiev, moins d'un an et demi après l'obtention du statut de candidat par l'Ukraine. L'exécutif formule la même recommandation à l'égard de la Moldavie, également candidate à l'UE depuis le 23 juin 2022 et victime collatérale de la guerre initiée par la Russie. Les Vingt-Sept doivent décider s'ils suivent ou non l'avis de la Commission lors d'un Conseil européen les 14 et 15 décembre à Bruxelles.
14 décembre 2023 : le Conseil européen décide d'ouvrir les négociations d'adhésion à l'UE avec l'Ukraine
Après l'avis positif formulé par la Commission européenne le 8 novembre, les chefs d'Etat et de gouvernement des Etats membres décident d'ouvrir les négociations d'adhésion à l'UE avec Kiev. La Hongrie, qui avait fait part de ses réticences avant la réunion à Bruxelles, ne prend pas part au vote et ne bloque ainsi pas la décision. Dans le même temps, le Conseil européen ouvre également les négociations avec la Moldavie, victime collatérale de la guerre en Ukraine et elle aussi candidate depuis juin 2022. La Géorgie, autre pays ayant déposé sa candidature à l'UE en réaction à l'invasion russe de l'Ukraine, obtient officiellement le statut de candidat.
14 décembre 2023 : le Conseil européen adopte le douzième paquet de sanctions contre la Russie
Les chefs d'Etat et de gouvernement des Etats membres reprennent les propositions de la Commission européenne, formulées le 15 novembre. Le douzième train de mesures restrictives consiste notamment en une interdiction, prévue le 1er janvier 2024, du commerce de diamants avec la Russie. Un secteur qui rapporte entre 4 et 5 milliards de dollars par an à Moscou. Les sanctions frappant déjà le pétrole russe sont également étendues au gaz de pétrole liquéfié (GPL), comme le butane et le propane utilisés notamment pour le chauffage.
1er février 2024 : les Vingt-Sept accordent une aide de 50 milliards d'euros à l'Ukraine
A Bruxelles, les chefs d'Etat et de gouvernement décident d'un nouveau soutien financier pour Kiev, à hauteur de 50 milliards d'euros pour la période 2024-2027. Dans le détail, il s'agit de 33 milliards d'euros de prêts et de 17 milliards d'euros de dons. Cette aide massive avait été proposée dès juin 2023 par la Commission européenne. Mais elle avait fait l'objet d'un véto de la part de la Hongrie lors d'un Conseil européen en décembre. Resté proche de Moscou, le Premier ministre hongrois Viktor Orbán avait conditionné son accord au déblocage des fonds européens à destination de son pays, gelés en raison de craintes liées à l'état de droit. Sous pression de l'ensemble des autres Etats membres, Budapest a finalement accepté d'approuver l'aide de 50 milliards d'euros pour l'Ukraine.
23 février 2024 : les Vingt-Sept adoptent un treizième train de sanctions contre la Russie
Adopté à la veille des deux ans de l’invasion russe de l’Ukraine, ce treizième paquet de mesures restrictives contre Moscou cible 106 personnes et 88 entités supplémentaires, dont les avoirs dans l’UE sont gelés et auxquelles les entreprises européennes ne peuvent mettre de fonds à disposition. Les individus concernés ont par ailleurs interdiction d’entrer sur le territoire de l’UE.
Les personnes et entités ajoutées à la liste noire de l’UE sont pour certaines considérées comme des soutiens au complexe militaro-industriel russe. Parmi elles figurent des sociétés implantées hors de Russie - en Chine, en Inde, au Sri Lanka, en Thaïlande, au Kazakhstan, en Turquie et en Serbie - qui permettent à Moscou de contourner les sanctions européennes. Des individus responsables de déportations d’enfants ukrainiens sont aussi visés par ces mesures restrictives.
26 février 2024 : Emmanuel Macron envisage l'envoi de troupes au sol en Ukraine
Lors d'une conférence internationale de soutien à l'Ukraine, organisée à Paris et à laquelle participent une vingtaine de chefs d'Etat et de gouvernement, le président français affirme que l'envoi de troupes au sol dans le pays ne doit pas "être exclu". Une déclaration inédite de la part d'un dirigeant d'un pays appartenant à l'Otan. Ne précisant pas quelle forme pourraient prendre ces envois de troupes, Emmanuel Macron affirme cultiver une "ambiguïté stratégique". Plusieurs Etats de l'Alliance atlantique - Royaume-Uni, Allemagne, Espagne, Pologne, République tchèque, Slovaquie ou encore Hongrie - font toutefois part de leur opposition à cette possibilité au lendemain de la déclaration du chef de l'Etat. Une telle hypothèse ne serait "pas dans l'intérêt" des Occidentaux, commente pour sa part le Kremlin.
Emmanuel Macron profite aussi de la conférence de soutien à Kiev pour annoncer la création d'une "coalition pour les frappes dans la profondeur", alliance capacitaire internationale pour fournir à l'Ukraine des "missiles et bombes de moyenne et longue portée". D'après le Premier ministre tchèque Petr Fiala, une quinzaine de pays dont la France sont par ailleurs favorables à une initiative portée par Prague visant à acheter hors d'Europe des munitions à livrer aux Ukrainiens.
7 mars 2024 : la Suède devient le 32e pays de l'Otan
L'adhésion de la Suède à l'Alliance atlantique, officialisée le 7 mars 2024, marque un tournant majeur dans la politique de sécurité du pays. Largement influencée par l'invasion russe de l'Ukraine en février 2022, cette décision met fin à deux siècles de non-alignement militaire.
Comme la Finlande qui l'a précédée en avril 2023, la Suède a réagi à la menace perçue de la Russie en cherchant à renforcer sa sécurité au sein d'une alliance militaire collective. Ralenti par les tractations avec la Turquie et la Hongrie, le processus d'adhésion a finalement abouti après le vote des parlements turc (en janvier 2024) puis hongrois (en février 2024). La Russie a réagi en promettant des contre-mesures.
18 mars 2024 : les Vingt-Sept adoptent un fonds de cinq milliards d'euros pour soutenir militairement l'Ukraine
A Bruxelles, les ministres des Affaires étrangères de l'UE adoptent formellement la réforme de la Facilité européenne pour la paix, instrument européen destiné à financer les actions de l'UE en matière de défense. Une décision qui acte la création d'un fonds de cinq milliards d'euros consacrés au soutien militaire de l'Ukraine. Parmi ces cinq milliards d'euros, un milliard doit être réservé à des achats communs d'armes européennes. Deux milliards et demi d'euros sont prévus pour des achats hors d'Europe, si les industries de l'armement européenne ne sont pas en mesure de répondre à la demande des Vingt-Sept. Enfin, l'enveloppe d'un milliard et demi d'euros restante servira à financer la formation de soldats ukrainiens dans les Etats membres.
Le 18 mars 2024, les ministres des Affaires étrangères ajoutent par ailleurs 30 personnes et entités russes à la liste des personnes sanctionnées par l’UE (interdiction de séjour et gel des avoirs dans les Etats membres). Un ajout effectué en raison de leur responsabilité dans la mort d’Alexeï Navalny, l’opposant principal de Vladimir Poutine, décédé dans une prison de l’Arctique russe le 16 février 2024.
13 juin 2024 : accord de principe du G7 pour un prêt de 50 milliards d'euros à l'Ukraine financé par les avoirs russes gelés
Réunis en Italie, les dirigeants du G7 (Etats-Unis, Canada, Japon, Royaume-Uni, France, Allemagne, Italie et Union européenne) donnent leur accord à un nouveau prêt de 50 milliards d'euros pour Kiev. Celui-ci doit être financé grâce aux revenus générés par les avoirs russes immobilisés depuis l'invasion de l'Ukraine. Une somme prévue pour soutenir l'effort de guerre ukrainien, de même que l'économie du pays et sa reconstruction.
Les modalités du prêt doivent cependant encore être précisées. Certaines questions ont en effet été laissées en suspens, comme celle du potentiel avancement des sommes promises par les membres du G7, avant d'être remboursés par les dividendes des avoirs russes.
En mai, les ministres des Affaires étrangères de l'UE avaient déjà acté l'utilisation des revenus générés par les avoirs russes gelés dans les Etats membres. Ceux-ci représentent jusqu'à 3 milliards d'euros par an pour l'ensemble des Vingt-Sept.
24 juin 2024 : un quatorzième train de sanctions contre la Russie adopté par les Vingt-Sept
Ce paquet de mesures restrictives concerne notamment le gaz naturel liquéfié (GNL) russe, qui compte pour 16 % des importations de GNL de l’UE. Il est désormais interdit de le transborder dans les Vingt-Sept, à savoir l’importer puis le réexporter directement vers des pays tiers. Une mesure visant à empêcher la Russie de se servir des ports européens pour exporter son GNL et ainsi financer son effort de guerre en Ukraine.
Ce paquet de sanctions a aussi pour objectif d’éviter le contournement par Moscou des précédents trains de mesures restrictives par Moscou. Il ajoute ainsi des obligations aux entreprises européennes afin qu’elles s’assurent que les biens exportés vers des pays tiers ne soient pas réutilisés sur le champ de bataille en Ukraine. Dans le secteur financier, l’utilisation du système SPFS, mis en place par la Russie pour contourner son exclusion du dispositif international de messagerie bancaire Swift, est interdite dans l’UE. 61 nouvelles entités, dont certaines situées dans des pays tiers (Chine, Turquie, Emirats arabes unis, Kazakhstan et Kirghizstan), sont par ailleurs visées par des restrictions à l’exportation de biens susceptibles d’être utilisées à des fins militaires par les autorités russes.
25 juin 2024 : les négociations d'adhésion de l'Ukraine et de la Moldavie à l'UE débutent officiellement
Deux ans à peine après le dépôt de leurs candidatures respectives auprès de l'UE, précipitées par l'invasion russe de l'Ukraine, Kiev et Chișinău franchissent une étape cruciale dans leur intégration européenne. "Un jour historique", selon le président ukrainien Volodymyr Zelensky, qui suit le feu vert des chefs d'Etat et de gouvernement des Vingt-Sept aux pourparlers d'adhésion en décembre 2023.
L'UE va donc désormais vérifier la compatibilité des droits ukrainien et moldave au sien et demander le cas échéant une mise en conformité des deux pays. L'Ukraine et la Moldavie devront également garantir que leurs institutions sont démocratiques et stables et qu'elles sont dotées d'une économie de marché viable. Un processus qui prendra des années avant une éventuelle adhésion à l'UE.
5 juillet 2024 : visite de Viktor Orbán en Russie
Le Premier ministre hongrois rencontre le président Vladimir Poutine à Moscou, suscitant la colère des autres dirigeants européens alors que son pays vient de prendre la présidence tournante du Conseil de l'UE. Habitué des provocations, Viktor Orbán a défendu une "initiative de paix" avec le chef d'Etat russe.
"Seules l’unité et la détermination ouvriront la voie à une paix globale, juste et durable en Ukraine", a taclé la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. De son côté, le président du Conseil européen, Charles Michel, a rappelé que cette visite s'inscrivait dans le cadre des relations bilatérales entre la Hongrie et la Russie, Budapest n'ayant aucun mandat de l'UE pour parler au nom des Vingt-Sept.
22 octobre 2024 : les députés européens approuvent un prêt à Kiev financé par les avoirs russes gelés
Réunis en session plénière à Strasbourg, les députés européens approuvent un prêt à l’Ukraine, qui pourra atteindre jusqu’à 35 milliards d’euros. Il sera financé par les recettes des avoirs russes gelés dans l’Union européenne. Un principe qui avait été acté par les pays du G7 au mois de juin. Les ambassadeurs des Etats membres s'étaient accordés sur cet instrument le 9 octobre.
5 novembre 2024 : Donald Trump élu président des Etats-Unis
Donald Trump remporte l'élection américaine, marquant ainsi son retour à la Maison-Blanche en janvier pour un second mandat, huit ans après sa première victoire. Critique à l'égard du soutien militaire et financier des Etats-Unis à Kiev, le milliardaire pourrait redéfinir la politique américaine sur le conflit et ouvre une période d'incertitudes dans les relations transatlantiques.
Donald Trump a notamment menacé de retirer les Etats-Unis de l'Otan si les alliés ne respectaient pas leurs engagements financiers. Il a exigé que les pays membres augmentent leurs dépenses de défense à au moins 2 % de leur PIB, voire 5 %, et affirmé que les Etats-Unis ne protégeraient que ceux qui "paient leurs factures".
17-21 novembre 2024 : escalade des tensions entre la Russie et l'Occident
A partir de la fin du mois d'octobre, 10 000 soldats nord-coréens viennent en renfort de l'armée russe dans la région de Koursk, en Russie. L'Ukraine avait fait une percée surprise sur le sol russe avec une offensive lancée le 6 août 2024. Entre-temps, Donald Trump est réélu à la Maison-Blanche le 5 novembre 2024 et promet de mettre fin au conflit en Ukraine avec un "plan de paix" s'annonçant très favorable à la Russie. Le 17 novembre, à quelques semaines de la fin de son mandat, le président Joe Biden autorise pour la première fois l'Ukraine à utiliser les missiles américains longue-portée pour mener une offensive dans la région de Koursk.
Deux jours plus tard, l'Ukraine frappe en profondeur le territoire russe avec les missiles longue-portée américains (ATACMS) et britanniques (Storm Shadow). Le 20 novembre, les Etats-Unis annoncent également la livraison de mines antipersonnel à Kiev. Le Kremlin accuse alors les Etats-Unis de vouloir "prolonger la guerre" en renforçant les livraisons d’armes à Kiev. En représailles, la Russie tire le 21 novembre un missile balistique intercontinental (ICBM) sur la ville de Dnipro, à l'est de l'Ukraine. Ces armes développées durant la Guerre froide n'avaient jusqu'alors jamais été utilisés au combat. L'escalade sonne comme un avertissement aux yeux de la communauté internationale. Le 27 novembre, le Conseil de sécurité de l'ONU considère que "l’emploi du missile Oreshnik par la Russie représente une grave escalade, susceptible d’aggraver le risque nucléaire".
16 décembre 2024 : l'UE adopte un quinzième paquet de sanctions
Ce paquet de sanctions cible la "flotte fantôme" russe. Il s'agit de navires battant pavillon étranger transportant du pétrole pour le compte de la Russie afin de contourner les sanctions. 52 bateaux s’ajoutent à la liste des interdictions, portant leur total à 79, avec l'interdiction d'accéder aux ports et de fournir des services. Pour la première fois, des sanctions totales (interdiction de voyager, gel des avoirs) frappent des personnalités chinoises et nord-coréennes, ainsi que 32 entreprises (dont 20 russes) liées à l’industrie militaire de Moscou. L’UE renforce aussi les restrictions sur l’exportation de technologies sensibles.
Ce train de sanctions protège aussi les entreprises européennes en interdisant de reconnaître ou d’exécuter certaines décisions dans les litiges entre entreprises russes et européennes. Enfin, il autorise les dépositaires centraux de titres (DCT) de l’UE à libérer des soldes de trésorerie pour honorer leurs obligations clients, et à ne pas verser d’intérêts à la Banque centrale de Russie, sauf ceux contractuellement dus.
14-16 février 2025 : la 61e conférence sur la sécurité à Munich, un tournant pour la sécurité européenne
La conférence annuelle sur la sécurité à Munich, souvent présentée comme l'équivalent diplomatique du forum de Davos, réunit 50 chefs d'Etat et de gouvernement du 14 au 16 février 2025. Cette 61e conférence est marquée par une attitude particulièrement hostile du côté américain. Quelques jours auparavant, Donald Trump avait pris de court les Européens et les Ukrainiens avec l'annonce de pourparlers de paix entre la Russie et les Etats-Unis.
L'objectif affiché de ce sommet informel sur la politique de sécurité est "d'instaurer la confiance et de contribuer à la résolution pacifique des conflits" au sein de la communauté internationale. Lors de son allocution, le vice-président des Etats-Unis J.D. Vance livre un discours virulent contre l'Union européenne, l'accusant au passage de brider la liberté d'expression. L'émissaire américain pour l'Ukraine, Keith Kellog, élude les détails du "plan de paix" proposé par Washington et remet en question l'implication des Européens dans les négociations.
De son côté, Volodymyr Zelensky appelle à un sursaut européen et à la création de "forces armées européennes". "L'UE ne s'en sortira pas toute seule, mais nous non plus", avertit le président ukrainien, selon qui la Russie n'exclut pas d'attaquer les pays de l'Otan. De nombreux diplomates et observateurs présents lors du sommet considèrent que cette conférence est un point de bascule dans la guerre en Ukraine et dans les relations transatlantiques, puisque les Etats-Unis semblent se détourner de leurs alliés historiques au profit de Moscou.
Le 17 février, au lendemain de la conférence, une dizaine de dirigeants européens ainsi que la présidente de la Commission européenne, le président du Conseil européen et le secrétaire général de l'Otan se réunissent en urgence à Paris. L'Allemagne, le Royaume-Uni, l’Italie, la Pologne, l’Espagne, les Pays-Bas, le Danemark et la France discutent des garanties de sécurité pour l'Ukraine. "La sécurité de l'Europe est à un tournant", rappelle alors Ursula von der Leyen sur le réseau social X à son arrivée dans la capitale française.
A l'issue de cette réunion, les dirigeants réaffirment leur soutien à l'Ukraine, leur volonté de participer activement aux négociations de paix et appellent à augmenter les dépenses de défense pour renforcer la sécurité européenne. Alors que certains pays, comme le Royaume-Uni et la Suède, expriment leur ouverture à l'envoi de troupes européennes en Ukraine, d'autres comme l'Allemagne réaffirment leur opposition à ce scénario, qu'ils jugent prématuré.
24 février 2025 : l'UE adopte un 16e paquet de sanctions contre la Russie
Approuvé le 19 février au niveau des ambassadeurs de l'UE (Coreper), un 16e train de sanctions de l’Union européenne contre la Russie est officiellement adopté le 24 février 2025, trois ans jour pour jour après le début du conflit. Il comprend plusieurs mesures visant à renforcer la pression économique sur Moscou. A commencer par l'interdiction des importations d'aluminium primaire russe, qui complète les restrictions déjà en vigueur sur certains produits dérivés de ce métal (comme les fils et les tubes). L’aluminium brut en provenance de Russie représente environ 6 % des importations européennes, une part en baisse ces dernières années.
De nouvelles mesures sont aussi adoptées contre la "flotte fantôme russe", déjà visée dans le précédent train de sanctions. Les Vingt-Sept s'accordent sur l'ajout de 73 nouveaux navires à leur liste noire, portant le total à 153 unités interdites d’accès aux ports et services européens.
Sur le plan financier et médiatique, l’Union convient également de renforcer ses restrictions en excluant 13 banques russes du système SWIFT et en suspendant les licences de diffusion de huit médias pro-Kremlin.
Ce nouveau train de sanctions intervient alors que les discussions sur une éventuelle négociation autour du conflit ukrainien s’intensifient, notamment sous l’impulsion des Etats-Unis. Le secrétaire d’Etat américain Marco Rubio a évoqué mardi 18 février la possibilité d’une participation européenne à de futures négociations, tout en soulignant que la pression économique sur Moscou devra se poursuivre tant qu’aucun plan de paix crédible ne se dessinera.
11 mars 2025 : un cessez-le-feu approuvé par l'Ukraine, rejeté par la Russie
Lors de négociations à Djedda (Arabie saoudite) le 11 mars 2025, les négociateurs ukrainiens ont déclaré être prêts à accepter la proposition américaine d'instaurer un cessez-le-feu immédiat et provisoire de 30 jours avec la Russie. A l'issue de cette réunion, les Etats-Unis ont par ailleurs annoncé reprendre leur aide militaire à l'Ukraine, que Donald Trump avait suspendue le 4 mars. Cette décision avait été prise quelques jours après un échange houleux opposant le président américain à son homologue ukrainien, Volodymyr Zelensky, dans le Bureau ovale et devant les caméras du monde entier.
Washington et Kiev se sont également accordés pour conclure "dès que possible" un accord sur les minerais, qui permettrait aux États-Unis d'accéder aux ressources ukrainiennes. En échange de quoi Volodymyr Zelensky espère obtenir des garanties de sécurité américaines.
Cependant, le président russe Vladimir Poutine exprime des réserves, affirmant que certains points doivent être résolus pour que la Russie soit en mesure d'accepter un cessez-le-feu. Il exige notamment l'arrêt des livraisons d'armes occidentales à l'Ukraine et la reconnaissance de l'annexion de certains territoires ukrainiens par la Russie.
Les négociations piétinent alors, tandis que Moscou intensifie son offensive. Après des frappes meurtrières le 4 avril à Kryvyï Rih, ville natale de Volodymyr Zelensky, une attaque à Sumy cause le décès de 35 personnes le 13 avril.
24 avril 2025 : Kiev subit l'une de ses pires attaques aériennes
Après une brêve trêve pascale, une attaque combinée de missiles et de drones fait 12 morts et 90 blessés à Kiev dans la nuit du 24 avril. "Cela fait 44 jours que l’Ukraine a accepté un cessez-le-feu total et l’arrêt des frappes… Et cela fait 44 jours que la Russie continue de tuer notre peuple", dénonce sur X le président ukrainien Volodymyr Zelensky, ajoutant que "les frappes doivent cesser immédiatement et sans conditions".
Quelques heures avant les frappes meurtrières sur l'Ukraine, Donald Trump fait monter la pression. "Nous sommes très proches d'un accord, mais l'homme qui n'a 'aucune carte à jouer' devrait maintenant, enfin, le faire", déclare le locataire de la Maison-Blanche sur Truth Social, fustigeant le dirigeant ukrainien.
26 avril 2025 : Donald Trump et Volodymyr Zelensky s'entretiennent en marge des funérailles du pape François au Vatican
Fin avril, les prises de parole s'intensifient du côté ukrainien et du côté russe, tandis que Donald Trump montre des signes d'impatience vis-à-vis de Kiev et Moscou. En marge des funérailles du pape François, le 26 avril à Rome, Volodymyr Zelensky s'entretient avec son homologue américain pour la première fois depuis leur altercation dans le Bureau ovale fin février. Une brève entrevue, d'une quinzaine de minutes, mais "très productive", selon un porte-parole de la Maison-Blanche.
Dans le même temps, le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, pose "comme condition à toute négociation avec Kiev la reconnaissance par la communauté internationale de l'annexion russe de la Crimée et d'autres régions ukrainiennes". Une ligne rouge pour les Ukrainiens comme pour les Européens.
30 avril 2025 : Kiev et Washington signent un accord historique sur l’exploitation des minerais, du gaz et du pétrole ukrainiens
Le 30 avril, un "Accord sur la création d’un fonds d’investissement pour la reconstruction entre les Etats-Unis et l’Ukraine" est signé entre les deux parties à Washington. Présenté à l'origine comme un accord sur les minerais ukrainiens, le texte signé va au-delà des terres rares puisqu'il inclut d'autres ressources comme le pétrole, le gaz naturel, l’or et le cuivre.
Contrairement aux souhaits initiaux de Donald Trump, le document ne prévoit pas de comptabiliser comme dette de l’Ukraine, envers les Etats-Unis, l’aide américaine accordée par son prédécesseur Joe Biden depuis le début de l’invasion en 2022. A l'inverse, les garanties de sécurité demandées par Volodymyr Zelensky en cas de cessez-le-feu ne sont pas inscrites dans l'accord, qui envoie toutefois un signal politique fort.
L'accord est ratifié par le Parlement ukrainien le 8 mai. 338 parlementaires votent en faveur de ce texte, le minimum requis étant de 226. Qualifié d’"historique" par la ministre ukrainienne de l’Economie, il devrait ouvrir la voie à une nouvelle aide militaire américaine pour l’Ukraine.
6 mai 2025 : l'Union européenne dévoile son plan pour mettre fin aux importations d'énergie russe d'ici 2027
Après une forte baisse, les importations de combustibles russes dans l’UE ont rebondi en 2024. Le commissaire européen à l'Energie, Dan Jørgensen, dévoile le 6 mai 2025 une nouvelle série de mesures pour les interdire progressivement. En continuant d'acheter des produits énergétiques russes, l'UE "aura, par ces achats, fourni plus de devises à Moscou que d'aide à Kiev" depuis le début de la guerre en 2022, rappelle le commissaire. L'exécutif européen propose notamment de mettre fin aux nouveaux contrats gaziers avec des fournisseurs russes d'ici à 2027.
10 mai 2025 : les Vingt-sept posent un ultimatum à la Russie
Le 10 mai, Emmanuel Macron, le nouveau chancelier allemand Friedrich Merz, le Premier ministre britannique Keir Starmer et le Premier ministre polonais Donald Tusk, représentants de la 'coalition des volontaires' en soutien à l'Ukraine, se rejoignent à Kiev sur invitation de leur homologue ukrainien, Volodymyr Zelensky.
A l'issue de cette réunion, les dirigeants européens, de concert avec l'Ukraine et les Etats-Unis, adressent un ultimatum à Moscou pour accepter un cessez-le-feu "complet et inconditionnel" de 30 jours à compter du 12 mai, faute de quoi la Russie s'exposerait à de nouvelles sanctions.
15 mai 2025 : de nouveaux pourparlers en Turquie, sans la Russie
Après avoir laissé planer le doute, Vladimir Poutine annonce finalement qu'il ne se rendra pas en Turquie pour y rencontrer son homologue ukrainien, Volodymyr Zelensky, en vue de négcciations sur un cessez-le-feu. Même chose du côté des Etats-Unis : un responsable américain a déclaré plus tard dans la journée que le président Donald Trump, qui avait manifesté son intérêt, ne participerait finalement pas à cette réunion à Istanbul.
20 mai 2025 : dix-septième train de sanctions
Les Vingt-sept approuvent le 20 mai un 17e paquet de sanctions contre la Russie, qui cible à nouveau des pétroliers "fantômes" utilisés pour contourner les sanctions déjà existantes, afin de limiter les exportations de pétrole russes. Près de 200 nouveaux navires fantômes utilisés par la Russie, et une trentaine d’entités accusées d’avoir aidé Moscou sont concernées. Au total, près de 345 navires sont dans le collimateur de l’Union européenne à cette date.
De nouvelles sanctions sont par ailleurs envisagées, dans le cas où Moscou refuserait un cessez-le-feu de 30 jours déjà accepté par Kiev et réclamé par ses alliés occidentaux. "Des sanctions européennes seront élaborées 'dans les prochains jours' si Vladimir Poutine ne répond pas à l'ultimatum lancé ce week-end", déclarait Emmanuel Macron lors d'une interview sur TF1, mardi 13 mai. "D'autres sanctions à l'encontre de la Russie sont en préparation. Plus la Russie mènera la guerre, plus notre réponse sera sévère", confirme une semaine plus tard la cheffe de la diplomatie européenne, Kaja Kallas.
13 juin 2025 : la protection temporaire des réfugiés ukrainiens prolongée jusqu'en 2027
Au début du mois de juin 2025, le Conseil approuve unanimement la proposition visant à proroger jusqu'au 4 mars 2027 la protection temporaire accordée aux plus de quatre millions d'Ukrainiens ayant fui la guerre. Depuis mars 2022, l'UE offre la sécurité et un refuge à plus de 4 millions de réfugiés ukrainiens sur la base d'une directive adoptée en 2001, relative à la protection temporaire.
30 juin 2025 : l'UE et l'Ukraine révisent leur accord de libre-échange
Le 30 juin, Bruxelles a nnoncé avoir trouvé un "accord de principe" avec Kiev pour faire évoluer la relation commerciale entre l'UE et l'Ukraine. Depuis 2022, l’Union européenne avait suspendu les droits de douane sur de nombreux produits agricoles ukrainiens afin de soutenir Kiev face à l’invasion russe. Cette mesure, renouvelée jusqu’au 5 juin 2025, visait à faciliter les exportations ukrainiennes vers l’UE. Depuis cette date et dans l'attente d'un compromis, l'Union européenne avait mis en place des mesures transitoires revenant aux quotas de 2016 et très critiquées par Kiev.
La suspension des droits de douane avait suscité la colère d'agriculteurs européens, notamment en Pologne, en France et en Hongrie. Dénonçant la "concurrence déloyale" d'un acteur majeur de l'agriculture mondiale, ceux-ci réclamaient le retour aux quotas d’importation en vigueur avant la guerre.
Pour les rassurer, la Commission européenne promet des quotas sur les "produits sensibles comme les œufs, le sucre et le blé", tandis que d’autres produits seront entièrement libéralisés comme le jus de raisin ou le lait fermenté. Cet accord vise "un juste équilibre entre le soutien au commerce de l'Ukraine avec l'Union et la prise en compte des sensibilités d'un certain nombre de secteurs agricoles de l'UE et des préoccupations qui y sont liées", a justifié Christophe Hansen, le commissaire européen à l'Agriculture.
L'Ukraine s'est par ailleurs engagée à aligner progressivement ses normes de production agricole sur celles de l'UE d'ici 2028, dans le cadre de son processus d'adhésion à l'UE. Des mécanismes de sauvegarde seront également mis en place pour protéger certaines filières agricoles, dans le cas où les importations risqueraient de provoquer des perturbations importantes sur le marché européen ou au niveau national.
14 juillet 2025 : Donald Trump pose un ultimatum à la Russie, plusieurs pays européens se préparent à acheter des armes américaines
Alors que les négociations en vue d'une issue diplomatique au conflit en Ukraine piétinent, le président américain Donald Trump affiche sa lassitude, mi-juillet. Après avoir longtemps parié sur une relation jugée privilégiée avec le chef du Kremlin, Vladimir Poutine, le président américain change de stratégie.
Lors d'une rencontre avec le secrétaire général de l’Otan, Mark Rutte, dans le bureau Ovale, le Républicain déclare qu'il imposera unilatéralement des droits de douane de "100 %" à la Russie s'il un accord de paix n'est pas trouvé dans les 50 jours. Il indique également que plusieurs pays membres de l'Otan, dont l'Allemagne et la Finlande, s'apprêtent à acheter des armes aux États-Unis afin de les livrer à l'Ukraine. Concrètement, les pays européens les plus engagés livreront à l'Ukraine du matériel déjà en leur possession, avant de reconstituer leurs stocks en achetant des munitions aux Américains.
Une annonce saluée par la cheffe de la diplomatie européenne, Kaja Kallas, qui rappelle toutefois que l'achat d'armes ne peut supplanter l'aide directe de Washington, appelant à un "partage du fardeau". "Si nous payons pour ces armes, c'est notre soutien. Donc, c'est un soutien européen", ajoute-t-elle à l'issue d'une réunion des ministres des Affaires étrangères de l'UE.
18 juillet 2025 : dix-huitième train de sanctions
Le 18 juillet, les ambassadeurs des Vingt-Sept valident un 18e paquet de sanctions à l'encontre de Moscou. La mesure phare de ce nouveau train est l'abaissement du prix du pétrole russe autorisé à l’exportation. La Slovaquie, qui bloquait l'adoption de ce 18e paquet, a finalement accepté de lever son veto après avoir obtenu quelques garanties sur son approvisionnement en gaz, alors que l'UE souhaite interrompre totalement ses importations d'hydrocarbures russes à partir de 2028.
Dans le détail, ces nouvelles sanctions prévoient d'abaisser le seuil du prix du pétrole brut russe, désormais fixé à un peu plus de 45 dollars le baril, soit 15 % de moins que le prix moyen actuel du baril russe sur le marché. Ce seuil était jusqu'alors fixé à 60 dollars le baril, un prix jugé trop élevé compte tenu du niveau actuel des prix du pétrole. L'UE vise aussi à mettre fin aux transactions commerciales avec les gazoducs russes Nord Stream, et avec les banques aidant la Russie à échapper aux sanctions européennes, notamment des banques chinoises.
"L'UE vient d'approuver l'un des trains de sanctions les plus sévères jamais adoptés à l'encontre de la Russie. Nous réduisons encore le budget de guerre du Kremlin, nous nous attaquons à 105 nouveaux navires de la flotte fantôme et à ceux qui les soutiennent, et nous limitons l'accès des banques russes au financement", salue la cheffe de la diplomatie européenne, Kaja Kallas, sur X.
22-31 juillet 2025 : une loi visant à supprimer l'indépendance des instances anticorruption provoque un tollé en Ukraine et dans l'UE
Le 22 juillet, le parlement ukrainien, la "Rada", vote à une large majorité (263 voix pour, 13 contre et 13 abstentions) une loi supprimant l'indépendance des principales instances de lutte contre la corruption du pays, désormais placées sous l'autorité du pouvoir. Concrètement, il prévoit de placer l’agence nationale anticorruption (NABU) et le parquet spécialisé anticorruption (SAP) directement sous la tutelle du procureur général, lui-même nommé par le chef de l’État. Le texte, promulgué par Volodymyr Zelensky, provoque la colère de la population et inquiète les alliés de Kiev.
La Commission européenne, par la voix de la commissaire chargée de l'Élargissement, Marta Kos, se dit alors "profondément préoccupée" par le vote, estimant qu'il s'agissait d'un "sérieux recul". Face à la contestation, Volodymyr Zelensky propose un nouveau projet de loi visant à rétablir l'indépendance des agences, voté par le Parlement le 31 juillet.
15 août 2025 : rencontre entre Donald trump et Vladimir Poutine en Alaska
Le 15 août, Donald Trump rencontre Vladimir Poutine sur une base militaire à Anchorage, en Alaska. Un succès diplomatique pour le président de la Fédération de Russie, dont les voyages officiels se limitent à ses proches alliés depuis le début de la guerre. La dernière rencontre entre les deux chefs d'État remontait au sommet du G20 à Osaka, en 2019.
Le sommet n'aboutit pas à des avancées concrètes, mais relance un processus de réconciliation entre les deux puissances. Au terme de la rencontre, Donald Trump salue une discussion "très productive", tandis que Vladimir Poutine parle d’un dialogue "constructif". Du côté de Kiev, le président ukrainien réaffirme simplement "sa volonté de déployer tous les efforts possibles pour parvenir à la paix" et estime "important que la puissance des États-Unis influence l’évolution de la situation".
Dans un communiqué, sept dirigeants européens (Emmanuel Macron, Friedrich Merz, Giorgia Meloni, Alexander Stubb, Donald Tusk, António Costa et Ursula von der Leyen) saluent les efforts du président Trump, rétitérant que "l'étape suivante est de poursuivre les discussions incluant le président Zelensky". Ils insistent sur la nécessité pour l'Ukraine d'obtenir des garanties de sécurité solides pour mettre fin au conflit.
18 août 2025 : Donald Trump reçoit Volodymyr Zelensky et plusieurs dirigeants européens à Washington
Le 18 août, soit trois jours après son tête-à-tête avec Vladimir Poutine en Alaska, Donald Trump reçoit Volodymyr Zelensky et plusieurs dirigeants européens à la Maison-Blanche. En amont de ce rendez-vous plein d'espoir, il publie un avertissement équivoque sur son réseau Truth social : "le président ukrainien Zelensky peut mettre fin à la guerre avec la Russie presque immédiatement s'il le veut, ou il peut continuer à combattre". Donald Trump précise également qu'il n’est "pas question" pour l'Ukraine de récupérer la Crimée annexée ni de rejoindre l'Otan.
Volodymyr Zelensky annonce quant à lui que les alliés de Kiev s'apprêtent à formaliser "d'ici dix jours" des garanties de sécurité, destinées à prévenir toute nouvelle offensive russe après un éventuel accord de paix. De leur côté, les alliés européens s'engagent à acheter pour environ 100 milliards de dollars d'armes américaines destinées à l'armée ukrainienne.
Selon l'envoyé spécial américain en charge des négociations, Steve Witkoff, Moscou envisagerait de formaliser par une loi son intention de ne plus agresser l'Ukraine après un accord de paix, ni de violer d'autres frontières européennes. La plus grande avancée concerne la possibilité d'une rencontre entre Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky dans un avenir proche, qui n'aura finalement pas lieu.
28 août 2025 : les bureaux de l'UE à Kiev endommagés par une frappe russe
Fin août 2025, le bâtiment de la délégation de l'UE à Kiev est gravement endommagé par des frappes aériennes massives de la Russie. Ces nouvelles attaques montrent que Moscou "ne recule devant rien" pour "terroriser" l'Ukraine, réagit alors la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. "Il s’agit de l’attaque de drones et de missiles la plus meurtrière contre la capitale (ukrainienne) depuis juillet", déplore-t-elle par ailleurs devant la presse. L'ambassadeur de Russie à Bruxelles est convoqué dans la journée.
31 août 2025 : Ursula von der Leyen annonce la préparation d'un plan d'envoi de troupes après la guerre
Le 31 août, la présidente de la Commission européenne déclare que l'UE a établi une "feuille de route claire" pour déployer des troupes une fois le conflit réglé, avec l'appui des États-Unis. Il s'agit d'une demande clé de l'Ukraine, dans le cadre de tout accord de paix visant à mettre fin à la guerre déclenchée par Moscou le 24 février 2022. Le rôle de la Commission est "primordial pour permettre aux États membres de financer un renforcement de la défense", a précisé l'Allemande, arguant que "le caractère de la guerre a complètement changé".
Concrètement, selon un accord conclu entre Donald Trump, Volodymyr Zelensky et plusieurs dirigeants européens, ces forces pourraient rassembler plusieurs dizaines de milliers de soldats, placés sous commandement européen. Les États-Unis apporteraient un soutien crucial, notamment en matière de commandement, de renseignement et de surveillance.
Dans le même temps, Kaja Kallas annonce que l'UE continue d'explorer toutes les "voies possibles" pour utiliser au mieux les avoirs russes gelés en Europe, l'objectif étant de renforcer le soutien financier à l'Ukraine.
4 septembre 2025 : 26 alliés de Kiev s'engagent à apporter des garanties de sécurité à l'Ukraine en cas de cessez-le-feu
Le 4 septembre 2025, l'Élysée accueille une réunion de la "coalition des volontaires", une structure informelle regroupant la plupart des grands États européens (la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni, la Finlande, la Suède, l'Espagne…), l'Union européenne, l'Otan - tous deux en tant qu’organisation - et des pays non-européens tels que le Canada ou la Turquie.
Coprésidée par le président français Emmanuel Macron et le Premier ministre britannique, Keir Starmer, cette rencontre, à laquelle prend part Volodymyr Zelensky, acte que ses membres sont "prêts" à octroyer des garanties de sécurité à l'Ukraine une fois la paix avec Moscou signée. Ces 26 pays s'engagent "à déployer comme force de réassurance des troupes en Ukraine ou à être présents sur le sol, en mer ou dans les airs pour apporter cette réassurance au territoire ukrainien et à l’Ukraine", déclare alors Emmanuel Macron.
10 septembre 2025 : incursions de drones russes en Pologne lors d'une attaque massive contre l'Ukraine
Dans la nuit du 9 au 10 septembre, une vingtaine de drones russes pénètre l'espace aérien de la Pologne, au cours d'une attaque massive dirigée contre l'Ukraine. L'opération débute peu avant minuit, avec plus de 100 drones russes signalés en Ukraine. Plusieurs engins franchissent la frontière polonaise, selon les autorités ukrainiennes, dont quatre sont abattus. Quatre aéroports, dont celui de Varsovie, sont temporairement fermés et la défense aérienne est portée à son plus haut niveau.
Cet événement ouvre un nouveau chapitre dans le conflit : c'est la première fois depuis le début de l'invasion russe en février 2022 qu'autant d'engins s'introduisent dans le territoire d'un pays membre de l'Otan. "La nuit dernière en Pologne, nous avons assisté à la violation la plus grave de l'espace aérien européen par la Russie depuis le début de la guerre, et les indications suggèrent qu'il s'agissait d'un acte intentionnel, non accidentel", dénonce la cheffe de la diplomatie européenne, Kaja Kallas.
À la demande du Premier ministre polonais Donald Tusk, l'article 4 du traité de l'Atlantique Nord est activé. Celui-ci prévoit que des pays membres peuvent solliciter des consultations entre alliés dès lors que "l'intégrité territoriale, l'indépendance politique ou la sécurité de l'une des parties [est] menacée".
13-19 septembre : nouvelles intrusions dans l'espace aérien de la Roumanie et de l'Estonie
Quelques jours après l'incursion en Pologne, la Russie viole l'espace aérien de la Roumanie lors d'une nouvelle attaque dirigée contre l'Ukraine. Pendant près de 50 minutes, un drone russe survole l'est du pays, avant de se diriger vers l'Ukraine pour frapper des infrastructures. Deux avions de combat roumains F-16, rejoints par deux avions Eurofighter Typhoon allemands, poursuivent ce drone. Bucarest dénonce un "acte inacceptable et irresponsable", convoquant par ailleurs l'ambassadeur de la Russie en Roumanie pour lui faire part de "sa vive protestation". Le Kremlin, de son côté, dément toute implication, que ce soit en Pologne ou en Roumanie.
Le 19 septembre, les pays Baltes entrent eux aussi en état d'alerte. Cette fois, trois avions de chasse russes MiG-31 traversent l'espace aérien de l'Estonie durant 12 minutes. Moscou estime alors que "le vol s'est déroulé en stricte conformité avec les règles internationales". Quelques jours plus tard, un autre appareil de reconnaissance russe est intercepté par des avions allemands, au-dessus de la mer baltique.
22-28 septembre 2025 : nouveaux survols de drones au Danemark
Dans la nuit du 22 septembre, le Danemark est à son tour la cible d'incursions de drones au-dessus de l'aéroport de Copenhague, qui ferme alors durant 4 heures. "Il s'agit de l'attaque la plus grave jamais perpétrée contre une infrastructure critique danoise", alerte la Première ministre danoise, Mette Frederiksen, le lendemain. Des survols sont également détectés au-dessus de l'aéroport d'Oslo, en Norvège, durant la nuit.
Toutefois, l'origine des drones n'est pas identifiée. Le Danemark connaît de nouvelles intrusions dans les jours qui suivent, au-dessus des quatre plus grand aéroports du pays et de la plus garnde base militaire danoise. Si la Russie n'est pas directement mise en cause, la Première ministre du pays fait savoir qu'elle n'exclut pas une possible implication de Moscou.
Le Danemark, qui assure alors la présidence du Conseil de l'UE et accueille deux sommets européens début octobre, se voit contraint d'interdire les vols de drones civils sur son territoire. Plusieurs pays européens viennent en renfort pour assurer la sécurité aérienne, durant le Conseil européen et le 7e sommet de la Communauté politique européenne (CPE).
23 septembre 2025 : revirement de Donald Trump sur l'Ukraine lors de la 80e Assemblée générale des Nations unies
Après un entretien avec le président ukrainien en marge de l'Assemblée générale des Nations unies, le 23 septembre, Donald Trump prend tout le monde de court avec une déclaration sur Truth social. Dans son message, il assure que l'Ukraine pourrait "regagner son territoire dans sa forme originelle et peut-être même aller plus loin" face à la Russie. Le président américain opère un revirement notable, alors que la question du statut des annexions russes, dans le cadre d'un futur accord de paix, était en suspens depuis de longs mois.
Le son de cloche est radicalement différent côté russe. "Dans nos relations (russo-américaines), une piste vise à éliminer les facteurs d'irritation […]. Mais cette piste avance lentement. Ses résultats sont proches de zéro", exprime non sans frustration le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov.
30 septembre 2025 : l'UE annonce une nouvelle aide financière pour les drones ukrainiens
Lors d'un point presse à Bruxelles, mardi 30 septembre, la présidente de la Commission européenne annonce un renforcement de l'assistance militaire à l'Ukraine, avec un investissement de 2 milliards d'euros dans les drones, afin de renforcer la capacité de production dans l'UE tout en développant le savoir-faire technologique européen.
"Concrètement, nous avons convenu avec l'Ukraine qu'un montant total de deux milliards d'euros sera consacré à l'achat de drones. Cela permettra à l'Ukraine d'augmenter sa capacité de production de drones et à l'UE de bénéficier de cette technologie", déclare la présidente de la Commission. Elle évoque également lors de cette prise de parole l'idée d'un "prêt de réparation" pour l'Ukraine, basé sur les avoirs souverains russes gelés. Un dossier à l'ordre du jour du Conseil européen informel à Copenhague, le 1er octobre, alors que l'utilisation des avoirs russes suscite encore les réserves de la Belgique et de la France.
Vers un 19e paquet de sanctions
"Au cours de ce dernier mois, la Russie a malheureusement fait montre de tout son mépris à l'égard de la diplomatie et du droit international. Elle a lancé certaines des plus vastes attaques de drones et de missiles contre l'Ukraine depuis le début de la guerre, frappé tant des bâtiments gouvernementaux que des habitations civiles et touché notre bureau de Kiev, la représentation de notre Union. […] Ces deux dernières semaines, des drones Shahed russes ont violé l'espace aérien de notre Union, tant en Pologne qu'en Roumanie". C'est par ces mots qu'Ursula von der Leyen présente, le 19 septembre 2025, un 19e train de sanctions à l'encontre de Moscou.
La Commission européenne envisage que l'UE mette fin plus tôt que prévu à ses importations de gaz naturel liquéfié russe, à la suite de discussions avec Donald Trump. Le président américain a exprimé sa volonté d'imposer de nouvelles sanctions à la Russie, à condition toutefois que les Européens cessent d'acheter des hydrocarbures russes, dont les revenus constituent l'une des principales ressources du Kremlin pour financer la guerre contre l'Ukraine. "Notre objectif est d'accélérer l'élimination progressive du gaz naturel liquéfié russe d'ici le 1er janvier 2027", détaille Kaja Kallas sur X, alors que cette cible était initialement fixée au 1er janvier 2028.
Le nouveau paquet pourrait aussi cibler des entreprises de pays tiers, comme la Chine ou l'Inde, accusées d'aider la Russie à contourner les sanctions occidentales. Ces mesures doivent encore être approuvées par les Vingt-Sept au Conseil de l'UE.
L’article Guerre en Ukraine : chronologie des événements est apparu en premier sur Touteleurope.eu.
07.10.2025 à 16:46
République tchèque : "L'admiration d'Andrej Babiš pour Viktor Orbán est ancienne"

Cette fois, il est de retour. Après un premier mandat entre 2017 et 2021, Andrej Babiš devrait retrouver le poste de Premier ministre grâce à la large victoire de son parti, ANO, lors des élections législatives tchèques des 3 et 4 octobre dernier (34,5 % des voix et 80 sièges obtenus sur les 200 de […]
L’article République tchèque : "L'admiration d'Andrej Babiš pour Viktor Orbán est ancienne" est apparu en premier sur Touteleurope.eu.
Texte intégral (2383 mots)

Cette fois, il est de retour. Après un premier mandat entre 2017 et 2021, Andrej Babiš devrait retrouver le poste de Premier ministre grâce à la large victoire de son parti, ANO, lors des élections législatives tchèques des 3 et 4 octobre dernier (34,5 % des voix et 80 sièges obtenus sur les 200 de la Chambre des députés). Quatre ans après avoir échoué de peu à conserver son siège, deux ans après une large défaite lors de l'élection présidentielle face à Petr Pavel, le milliardaire est revanchard.
Entretemps, le parti d'Andrej Babiš a effectué un virage important. Au Parlement européen, ses membres ont par exemple changé de groupe : ils sont passés des libéraux de Renew Europe, où siègent notamment les députés macronistes, aux Patriotes pour l'Europe, à l'extrême droite. Ils ont ainsi rejoint les eurodéputés du Rassemblement national ou ceux du Fidesz de Viktor Orbán, pour qui le probable futur Premier ministre tchèque voue une forme d'admiration.
C'est d'ailleurs toujours du côté de l'extrême droite qu'Andrej Babiš devrait tenter de trouver des partenaires de coalition pour son gouvernement. Avec des conséquences importantes pour l'Union européenne, ses politiques migratoires et environnementales, mais aussi son soutien à l'Ukraine. Michel Perottino, directeur du département de Science politique de l’Université Charles de Prague, nous aide à y voir plus clair.
Comment expliquer la large victoire d'Andrej Babiš lors des élections législatives ?
Michel Perottino : Sa victoire était prévue de longue date, mais elle est peut-être plus massive qu'attendue. La société tchèque est actuellement très polarisée : depuis quelques années maintenant, le parti ANO 2011 fait figure de principale, sinon de seule grande force d'opposition. C'est un électorat manifestement remonté contre le gouvernement de Petr Fiala (2021-2025) qui est allé voter pour Andrej Babiš.
Une assez large partie de la population tchèque juge négativement l'état de la société ou de l'économie. Beaucoup ont le sentiment que la République tchèque va de plus en plus mal, et en rendent responsables le précédent gouvernement de centre droit. Pourtant, les statistiques économiques et sociales laissent penser que le pays va plutôt bien.
Autre facteur, certes moins important qu’en Pologne ou dans des pays Baltes : la perception d'un danger qui vient de l'Est, depuis le début de l'invasion russe en Ukraine.
Pourtant, le Premier ministre sortant a présenté son rival comme le candidat "de Moscou" ?
Petr Fiala est sans doute allé beaucoup trop loin dans le discours contre Andrej Babiš, en le présentant comme pro-russe. Or quelques jours avant l'élection, Andrej Babiš a pris des positions claires, expliquant par exemple qu'en cas de survol d'un drone ou d'un avion russe au-dessus du territoire, celui-ci devrait être abattu.
Andrej Babiš est également accusé de fraude aux fonds européens depuis longtemps…
Oui mais pour les Tchèques cela fait presque trop longtemps, de plus l'affaire est relativement compliquée. Pour certains, prendre de l'argent à l'Union européenne n'est même pas forcément synonyme de voler… dans les années 1970-1980, un dicton très connu affirmait que "celui qui ne vole pas l’État vole sa famille" !
Les affaires d'Andrej Babiš sont anciennes [il est accusé depuis 2017 d'avoir retiré sa ferme "Nid de cigogne" de son conglomérat Agrofert, pour qu'elle puisse bénéficier illégalement d'une subvention européenne de 2 millions d'euros destinée aux petites entreprises, ndlr]. Depuis, ce dernier a même réussi à imposer un mot d'ordre : "tout le monde sait que ça n'est pas vrai, que c'est uniquement politique". Par ailleurs, d'autres affaires ont touché plus récemment l'ODS, le parti de Petr Fiala.
Andrej Babiš a souvent été qualifié de "Trump tchèque". Ce surnom est-il approprié ?
Le système politique des États-Unis et de la République tchèque est complètement différent. Le Premier ministre tchèque n'a pas autant de pouvoir que le président américain. Par exemple, il ne peut pas déployer l'armée pour régler un problème de politique interne.
En revanche, les deux personnages partagent une manière similaire de communiquer. Andrej Babiš utilise de nombreuses formules péremptoires, notamment sur les réseaux sociaux. Il écrit trois phrases et estime ensuite qu'il n'y a pas besoin d'en discuter.
Autre chose est sa casquette rouge floquée "Silné Česko" (République tchèque forte), portée par Andrej Babiš et ses partisans durant la campagne. Elle rappelle celle utilisée par Donald Trump avec le slogan "Make America Great Again", le parallèle est évident. Et pourtant, Andrej Babiš a pris ses distances en démentant la référence à ce dernier.
Quelles sont les relations entre Andrej Babiš et les autres populistes Viktor Orbán, en Hongrie, et Robert Fico en Slovaquie ?
Le retour d'Andrej Babiš va tout simplement renforcer le pôle critique vis-à-vis de l'intégration européenne. Il voue une admiration à Viktor Orbán depuis longtemps. Dans un documentaire en 2014-2015, alors qu'il est chez lui et oublie qu'il est enregistré, il déclare auprès de l'ambassadeur hongrois : "J'adore Orbán mais je ne peux pas le dire parce que sinon on va me tomber dessus".
Pourquoi Orbán ? Parce qu'il gouverne seul. Le fait qu'un seul décide de tout est une marotte chez Andrej Babiš, héritée de sa carrière d'entrepreneur. Or le système tchèque impose des gouvernements de coalition formés avec plusieurs partis, qu'Andrej Babiš juge inefficace. Pendant la campagne, il n'a cessé de répéter qu'il voulait un gouvernement monocolore.
Mais les résultats des législatives ne lui permettront pas de gouverner seul…
En République tchèque, contrairement à la France où l'on peut s'en passer, tout gouvernement doit impérativement obtenir la confiance des députés pour entrer en fonctions. ANO doit ainsi recueillir la majorité des voix des députés présents, soit 101 voix sur les 200 parlementaires s'ils sont tous présents.
Dans la situation actuelle, ses deux principaux alliés seraient le SPD (Liberté et démocratie directe), d'extrême droite, et "Les Automobilistes entre eux" [un parti populiste axé sur la défense des automobilistes, ndlr]. Ces derniers siègent dans le même groupe qu'ANO, les Patriotes pour l'Europe, au Parlement européen.
Ces deux formations vont vouloir tenter d'entrer au gouvernement. Les trois partenaires atteindraient alors une majorité de 108 voix.
Un tel attelage est-il envisageable ?
Les revendications des Automobilistes sont très proches de celles d'ANO. Ils sont anti-immigration et opposés au Pacte vert européen [notamment l'interdiction des ventes de véhicules thermiques neufs en 2035, ndlr]. Le SPD partage ces positions sur l'immigration et le Pacte vert, avec une petite différence : ils veulent organiser un référendum sur la sortie de la République tchèque de l'Union européenne.
Andrej Babiš pourrait faire une concession en adoptant une loi sur le principe du référendum, tout en s'accordant avec les partis pour ne pas l'organiser pendant les quatre années d'exercice du gouvernement.
Pour Andrej Babiš et sa société Agrofert [une des plus grandes entreprises du pays, spécialisée dans l'agroalimentaire], une sortie de l'Union européenne serait une catastrophe. Agrofert ne commerce pas avec la Russie ou avec la Chine, mais avec l'Union européenne. Je pense même qu'Andrej Babiš ne serait pas contre l'adoption par la République tchèque de l'euro, alors même qu'un tel changement est politiquement impossible dans la situation actuelle.
L'adoption de l'euro a-t-il été un sujet durant la campagne électorale ?
Le sujet est porté par les Maires et indépendants, les Pirates ou TOP 09 [un des trois partis de la coalition sortante de centre droit, ndlr], mais tous les autres n'en veulent pas. Ils ont la certitude que la couronne tchèque est source de bénéfices économiques et la garantie de l'indépendance de leur politique monétaire. A l'inverse, ils pensent que l'euro les mènerait à la catastrophe.
La République tchèque a été en première ligne pour soutenir l'Ukraine. Cette situation pourrait-elle changer ?
La République tchèque soutient l'Ukraine. Rapporté à sa population, le pays a reçu plus de réfugiés ukrainiens que les autres [350 000 réfugiés ukrainiens sont encore présents dans le pays qui compte 11 millions d'habitants, ndlr].
Ce n'est pas du goût de l'extrême droite, notamment le SPD, qui estime que les Ukrainiens prennent le travail et mangent le pain des Tchèques, et qui s'oppose à la scolarisation des enfants ukrainiens. Le discours reste tout de même assez flou. Quand l'extrême droite parle d'immigration, elle vise avant tout les musulmans, pourtant très peu présents en République tchèque.
L'autre problème pour ANO et ses futurs partenaires concerne le réarmement : ils sont opposés à la dynamique européenne de soutien militaire à l'Ukraine. Ils estiment que des milliards ont déjà été dépensés et que l'argent est parti dans la poche des fabricants d'armes, même si ceux-ci sont tchèques pour certains d'entre eux.
L’article République tchèque : "L'admiration d'Andrej Babiš pour Viktor Orbán est ancienne" est apparu en premier sur Touteleurope.eu.
07.10.2025 à 15:19
Qui sont les chefs d'État et de gouvernement des pays de l'Union européenne ?

Les États membres de l'Union européenne ont chacun une organisation politique et institutionnelle qui leur est propre. Mais tous ont deux personnages à leur tête : un chef d'État (président ou monarque) et un chef de gouvernement (Premier ministre ou encore chancelier). À l'exception notable de Chypre, où le président assure les deux fonctions. Découvrez l'identité, […]
L’article Qui sont les chefs d'État et de gouvernement des pays de l'Union européenne ? est apparu en premier sur Touteleurope.eu.
Texte intégral (19640 mots)
Les États membres de l'Union européenne ont chacun une organisation politique et institutionnelle qui leur est propre. Mais tous ont deux personnages à leur tête : un chef d'État (président ou monarque) et un chef de gouvernement (Premier ministre ou encore chancelier). À l'exception notable de Chypre, où le président assure les deux fonctions.
Découvrez l'identité, l'orientation politique et les pouvoirs des dirigeants de chaque État membre de l'UE. En fin d'article, vous apprendrez également qui du chef de l'État ou de gouvernement représente son pays lors des réunions du Conseil européen.
Cliquez ici pour accéder rapidement à un pays
Sur ordinateur : les informations concernant le chef de l'État s'affichent sur la gauche. Celles concernant le chef du gouvernement sur la droite.
Sur mobile : les informations concernant le chef de l'État s'affichent en premier. Celles concernant le chef du gouvernement en second.
Allemagne 
Président fédéral

Frank-Walter Steinmeier
Parti social-démocrate (SPD, centre gauche)
Depuis mars 2017
Chancelier

Friedrich Merz
Union chrétienne-démocrate (CDU, centre droit)
Depuis mai 2025
Gouvernement actuel : coalition entre chrétiens-démocrates (CDU/CSU) et sociaux-démocrates (SPD).
Régime politique : parlementaire
Organisation : fédérale
Parlement : bicaméral
Scrutin : proportionnel
En bref : L'Allemagne est une république fédérale, ce qui signifie que les régions allemandes (Länder) ont un pouvoir de décision important. Le pays possède une forte culture de la coalition et les deux partis principaux, l'Union chrétienne-démocrate (CDU) et le Parti social-démocrate (SPD), se partagent le pouvoir depuis 1949. De 2005 à 2021, la chancelière Angela Merkel a dirigé quatre gouvernements successifs, dont trois en coalition avec le SPD. Le social-démocrate Olaf Scholz lui a succédé en décembre 2021, dans une coalition gouvernementale inédite avec Les Verts (Die Grünen) et le Parti libéral-démocrate (FDP). La CDU a retrouvé le pouvoir à la suite des élections fédérales de février 2025. Depuis le 6 mai 2025, le nouveau gouvernement de coalition, formé par la CDU/CSU et le SPD, est dirigé par Friedrich Merz.
Autriche 
Président fédéral
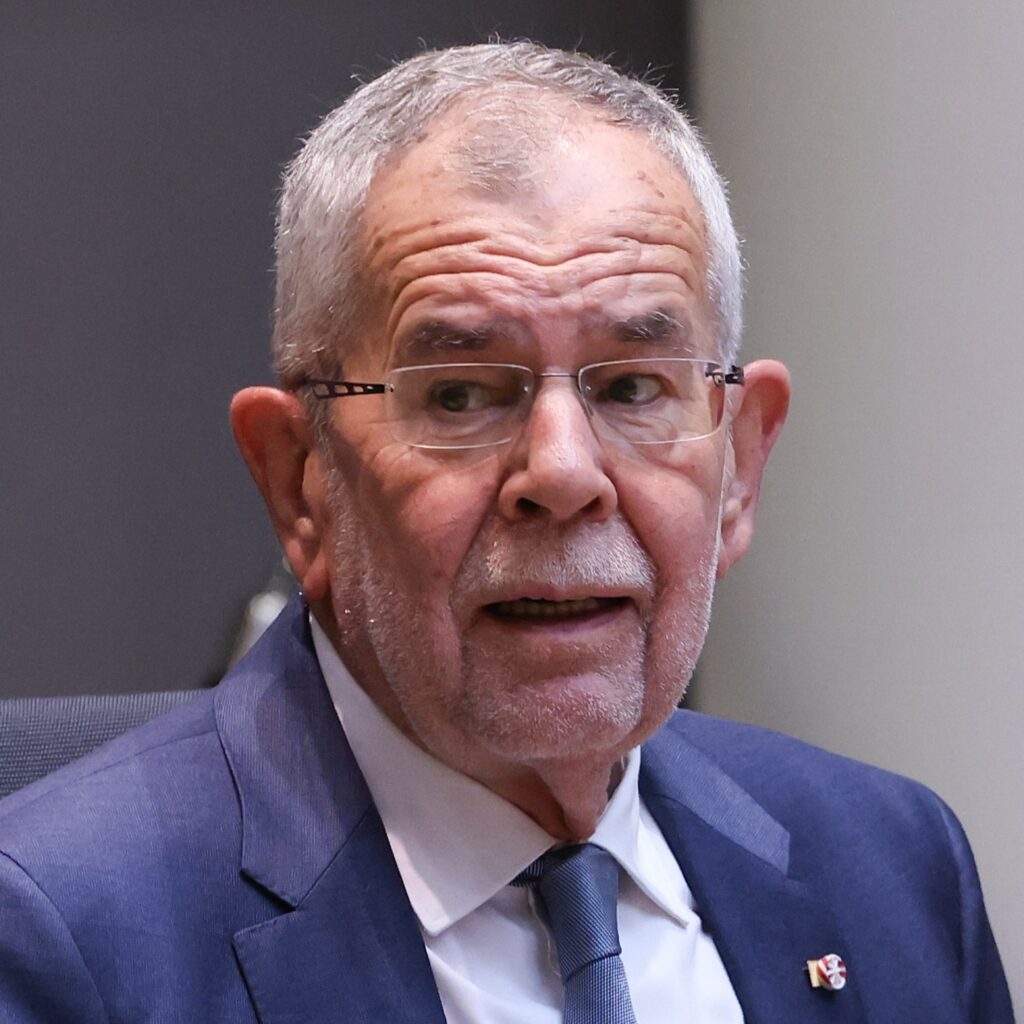
Alexander Van der Bellen
Indépendant (ex-écologiste, Die Grünen)
Depuis janvier 2017
Chancelier

Christian Stocker
Parti populaire autrichien (ÖVP, centre droit)
Depuis mars 2025
Gouvernement actuel : coalition entre chrétiens-démocrates (ÖVP), sociaux-démocrates (SPÖ) et libéraux (NEOS).
Régime politique : parlementaire
Organisation : fédérale
Parlement : bicaméral
Scrutin : proportionnel
En bref : L'Autriche est une république fédérale avec une forte stabilité politique. Depuis 1945, le paysage politique est dominé par les chrétiens-démocrates du Parti populaire autrichien (ÖVP) et les sociaux-démocrates du Parti social-démocrate d'Autriche (SPÖ). Le parti d'extrême droite FPÖ (Parti autrichien de la liberté) a cependant réalisé d'importants scores électoraux à partir des années 1990, intégrant différents gouvernements. Les Verts (Die Grünen) ont également émergé dans la vie politique autrichienne, entrant pour la première fois au gouvernement en 2020. Plusieurs mois après les élections législatives de septembre 2024, l'ÖVP, le SPÖ et les libéraux de NEOS (La nouvelle Autriche et le Forum libéral) sont parvenus à trouver un accord pour former une coalition gouvernementale. Ce nouveau gouvernement est entré en fonction le 3 mars, avec à sa tête Christian Stocker, leader de l'ÖVP.
Belgique 
Roi des Belges

Philippe de Belgique
Monarque
Depuis juillet 2013
Premier ministre

Bart De Wever
Nouvelle Alliance flamande (N-VA, droite)
Depuis février 2025
Gouvernement actuel : coalition entre conservateurs flamands (N-VA), sociaux-démocrates flamands (Vooruit), chrétiens-démocrates flamands (CD&V) et libéraux wallons (Les Engagés et MR).
Régime politique : monarchie parlementaire
Organisation : fédérale
Parlement : bicaméral
Scrutin : proportionnel
En bref : Le fédéralisme belge fonctionne sur un système devant composer entre les communautés francophone, néerlandophone et germanophone. Les gouvernements reposent souvent sur des coalitions fragiles. Lorsque celles-ci tombent, les négociations pour former un nouveau gouvernement peuvent s'étendre sur plusieurs mois. Les élections fédérales du 9 juin 2024 ont conduit à une fragmentation du paysage politique, complexifiant la constitution d'une coalition majoritaire. Après 7 mois et demi d'attente, un accord de coalition a été trouvé entre cinq partis. Le nouveau gouvernement est entré en fonction le 3 février 2025, dirigé par le leader du N-VA (conservateurs flamands), Bart De Wever.
Bulgarie 
Président de la République

Roumen Radev
Indépendant (soutenu par le Parti socialiste bulgare, BSP, centre gauche)
Depuis janvier 2017
Premier ministre

Rossen Jeliazkov
Citoyens pour le développement européen de la Bulgarie (GERB, centre droit)
Depuis janvier 2025
Gouvernement actuel : coalition entre chrétiens-démocrates (GERB), sociaux-démocrates (BSP) et populistes conservateurs (ITN).
Régime politique : parlementaire
Organisation : unitaire
Parlement : monocaméral
Scrutin : proportionnel
En bref : La politique bulgare est marquée par une relative instabilité depuis la chute du régime communiste, en 1989. L'ancien Premier ministre de centre droit, Boïko Borisov, resté près de dix ans au pouvoir au cours de trois mandats non consécutifs entre 2009 et 2021, y a fait exception par sa longévité à la tête du pays. À l'été 2020, d'importantes manifestations ont éclaté, dénonçant un exécutif corrompu et réclamant sa démission. Depuis, plusieurs élections législatives se sont succédé, mais aucun gouvernement n'est parvenu à s'inscrire dans la durée. Un septième scrutin en trois ans s'est tenu le 27 octobre 2024. Finalement, le 16 janvier 2025, après deux mois et demi de négociations, le Parlement bulgare a approuvé la nomination de Rossen Jeliazkov (GERB) comme nouveau Premier ministre. La coalition gouvernementale est formée par le GERB (centre droit), BSP - Gauche unie (centre gauche) et Il y a un tel peuple (populistes conservateurs).
Chypre 
Président de la République

Níkos Christodoulídis
Indépendant (ex-Rassemblement démocrate, DISY, centre droit)
Depuis février 2023
À Chypre, le président de la République exerce à la fois la fonction de chef de l'État et de chef du gouvernement.
Gouvernement actuel : coalition entre conservateurs (DIKO et AL), libéraux (DIPA) et sociaux-démocrates (EDEK).
Régime politique : présidentiel
Organisation : scindée
Parlement : monocaméral
Scrutin : proportionnel (+3 observateurs des minorités)
En bref : Chypre est une république présidentielle. Le président de la République est à la fois chef de l'État et chef du gouvernement : il exerce l'essentiel du pouvoir exécutif, nomme les ministres (sans approbation du Parlement) et dirige la politique intérieure et extérieure du pays. Il est élu au suffrage universel direct pour un mandat de cinq ans. Le président n'a pas besoin de majorité parlementaire pour gouverner. Ce système fonctionne uniquement dans la partie sud de l'île, contrôlée par la République de Chypre, membre de l'UE. La partie nord est la République turque de Chypre du Nord, autoproclamée et reconnue uniquement par la Turquie.
Croatie 
Président de la République

Zoran Milanović
Parti social-démocrate de Croatie (SDP, centre gauche)
Depuis février 2020
Premier ministre

Andrej Plenković
Union démocratique croate (HDZ, centre droit)
Depuis octobre 2016
Gouvernement actuel : coalition minoritaire entre chrétiens-démocrates (HDZ) et nationalistes (DP).
Régime politique : parlementaire
Organisation : unitaire
Parlement : monocaméral
Scrutin : proportionnel
En bref : Avant 2001, la Croatie était un régime semi-présidentiel et le président de la République détenait des pouvoirs étendus. Depuis, un amendement de la Constitution a rétabli un parlement monocaméral et a réduit les pouvoirs du président. C'est donc le Premier ministre qui assure désormais la plupart des tâches exécutives du pays. En poste depuis 2016, Andrej Plenković a dirigé différentes coalitions gouvernementales, tantôt avec des sociaux-démocrates, tantôt avec des libéraux. Depuis 2024, son parti, l'Union démocratique croate (HDZ), forme un gouvernement minoritaire avec les nationalistes du Mouvement patriotique (DP).
Danemark 
Roi de Danemark

Frederik X
Monarque
Depuis janvier 2024
Première ministre

Mette Frederiksen
Social-démocratie (A, centre gauche)
Depuis juin 2019
Gouvernement actuel : coalition entre sociaux-démocrates (A) et libéraux (V et M).
Régime politique : monarchie parlementaire
Organisation : unitaire
Parlement : monocaméral
Scrutin : proportionnel
En bref : Le Danemark est un pays où existe un grand nombre de partis politiques. Une situation qui implique un morcellement du Parlement ayant parfois pu nuire à la longévité des gouvernements. Les coalitions gouvernementales sont donc très courantes dans le système politique danois. Une situation qui a changé en 2019 avec l'arrivée au pouvoir de la Social-démocratie (centre gauche). Leur leader, Mette Frederiksen, est toujours Première ministre, mais à la tête d'une coalition depuis 2022, formée avec deux partis libéraux : La Gauche, Parti libéral du Danemark et les Modérés.
Espagne 
Roi d'Espagne

Felipe VI (de Bourbon)
Monarque
Depuis juin 2014
Premier ministre

Pedro Sánchez
Parti socialiste ouvrier espagnol (PSOE, centre gauche)
Depuis juin 2018
Gouvernement actuel : coalition minoritaire entre sociaux-démocrates (PSOE et PSC) et socialistes (Sumar).
Régime politique : monarchie parlementaire
Organisation : unitaire (voire régionale)
Parlement : bicaméral
Scrutin : proportionnel
En bref : De 1970 à 2015, l'Espagne a connu une succession de gouvernements stables, marquée par un fort bipartisme entre le Parti socialiste ouvrier espagnol (PSOE) et le Parti populaire de centre droit (PP). En 2015, deux nouveaux partis ont émergé, Podemos (gauche radicale) et Ciudadanos (libéraux), mettant fin au bipartisme et rendant plus difficile la formation de gouvernements. Le parti d'extrême droite, Vox, est également apparu dans le paysage politique. En outre, la question de l'indépendance de la Catalogne est devenue de plus en plus centrale dans le débat politique espagnol ces dernières années.
Estonie 
Président de la République

Alar Karis
Indépendant (soutenu par le Parti de la réforme, le Parti du centre, le Parti social-démocrate et Isamaa)
Depuis octobre 2021
Premier ministre

Kristen Michal
Parti de la réforme d'Estonie (ERE, centre)
Depuis juillet 2024
Gouvernement actuel : coalition entre libéraux (ERE et E200).
Régime politique : parlementaire
Organisation : unitaire
Parlement : monocaméral
Scrutin : proportionnel
En bref : Après une succession de gouvernements de courte durée dans les années 1990 et 2000, l'Estonie a été dirigée de manière stable par le Parti de la réforme d'Estonie (ERE, centre droit) de 2005 à 2016. Ce dernier a repris les rênes du pouvoir en 2021 avec l'arrivée de Kaja Kallas à la tête de l'exécutif. Désignée haute représentante de l'UE pour les Affaires étrangères et la Politique de sécurité, elle a laissé sa place à Kristen Michal en juillet 2024. Depuis 2023, aux côtés de l'ERE, Estonie 200 (libéraux) et le Parti social-démocrate (SDE, centre gauche) participaient à la coalition gouvernementale. Mais les sociaux-démocrates en ont été exclus en mars 2025 afin de recentrer la politique menée par le gouvernement.
Finlande 
Président de la République

Alexander Stubb
Parti de la coalition nationale (Kok, droite)
Depuis mars 2024
Premier ministre

Petteri Orpo
Parti de la coalition nationale (Kok, droite)
Depuis juin 2023
Gouvernement actuel : coalition entre libéraux-conservateurs (Kok), conservateurs radicaux (PS), libéraux (SFP) et chrétiens-démocrates (KD).
Régime politique : parlementaire
Organisation : unitaire
Parlement : monocaméral
Scrutin : proportionnel
En bref : La Finlande est généralement dirigée par des gouvernements dits "arc-en-ciel", regroupant trois partis ou plus. Depuis la Constitution de 2000, le Président possède moins de pouvoir, mais reste un personnage central. Le Premier ministre a un poids politique moins important que dans beaucoup d'autres systèmes parlementaires européens. Depuis juin 2023, Petteri Orpo dirige le gouvernement finlandais, à la tête d'une large coalition de droite qui compte le Parti de la coalition nationale (Kok, libéral-conservateur) dont il est membre, le Parti des Finlandais (PS, conservateur), le Parti populaire suédois de Finlande (SFP, libéral) et les Chrétiens-démocrates (KD).
France 
Président de la République

Emmanuel Macron
Renaissance (centre)
Depuis mai 2017
Premier ministre

Sébastien Lecornu (démissionnaire)
Renaissance (centre)
Depuis septembre 2025
Gouvernement actuel (démissionnaire) : coalition de libéraux et de conservateurs
Régime politique : semi-présidentiel
Organisation : unitaire
Parlement : bicaméral
Scrutin : majoritaire
En bref : La France, avec son régime semi-présidentiel, est l'une des organisations politiques les plus singulières d'Europe. Le pouvoir exécutif est occupé par deux personnalités aux prérogatives importantes : le président de la République et le Premier ministre. Dans les faits, on assiste toutefois à une suprématie du chef de l'État, fort de son élection au suffrage universel direct, de son pouvoir de nomination et de révocation sur le chef du gouvernement. Depuis les élections législatives anticipées de juillet 2024, le gouvernement et le Parlement ont davantage de pouvoir. Sébastien Lecornu a été nommé Premier ministre le 9 septembre par Emmanuel Macron, au lendemain de la chute du gouvernement de François Bayrou. Ce dernier a perdu un vote de confiance devant l'Assemblée nationale la veille, le 8 septembre.
Grèce 
Président de la République

Konstantínos Tasoúlas
Nouvelle démocratie (ND, droite)
Depuis mars 2025
Premier ministre

Kyriákos Mitsotákis
Nouvelle démocratie (ND, droite)
Depuis juillet 2019
Gouvernement actuel : majorité de conservateurs (ND).
Régime politique : parlementaire
Organisation : unitaire
Parlement : monocaméral
Scrutin : proportionnel
En bref : Depuis la fin de la dictature des colonels en 1974, la Grèce alterne entre stabilité politique et gouvernements fragiles. Après l'instabilité politique causée par la crise de 2008, le leader du parti de gauche radicale SYRIZA, Aléxis Tsípras, a accédé à la tête du gouvernement en 2015. Défait aux élections de 2019, il a été remplacé en juillet 2019 par un gouvernement de droite, dirigé par Kyriákos Mitsotákis et son parti, Nouvelle démocratie (ND, droite). Ceux-ci sont, aujourd'hui encore, au pouvoir.
Hongrie 
Président de la République

Tamás Sulyok
Indépendant (soutenu par le Fidesz et le KDNP)
Depuis mars 2024
Premier ministre

Viktor Orbán
Fidesz (extrême droite)
Depuis mai 2010
Gouvernement actuel : coalition de partis d'extrême droite (Fidesz et KDNP).
Régime politique : parlementaire
Organisation : unitaire
Parlement : monocaméral
Scrutin : majoritaire mixte
En bref : La Hongrie est dirigée depuis 2010 par le Premier ministre Viktor Orbán et son parti national-conservateur et eurosceptique, le Fidesz. Depuis près de quinze ans, le dirigeant et son gouvernement ont été pointé du doigt à de multiples reprises concernant des atteintes à la liberté d'expression, à l'État de droit ou à la protection des minorités. Depuis 2010, Viktor Orbán a dirigé quatre gouvernements successifs (il avait déjà été Premier ministre de 1998 à 2002).
Irlande 
Président (Uachtarán)

Michael D. Higgins
Indépendant (ex-Parti travailliste, centre gauche)
Depuis novembre 2011
Taoiseach

Micheál Martin
Fianna Fáil (FF, centre droit)
Depuis janvier 2025
Gouvernement actuel : coalition entre chrétiens-démocrates (FF et FG).
Régime politique : parlementaire
Organisation : unitaire
Parlement : bicaméral
Scrutin : proportionnel à vote unique transférable
En bref : La vie politique irlandaise est largement dominée par deux partis de centre droit : le Fine Gael (FG, tendance chrétienne-démocrate) et le Fianna Fáil (FF, tendance libérale). Depuis les années 1920, tous les Premiers ministres irlandais ont été exclusivement issus de ces deux formations. Déjà à la tête du gouvernement de 2020 à 2022, Micheál Martin est redevenu Taoiseach (Premier ministre d'Irlande) en janvier 2025 après la victoire de son parti, le Fianna Fáil, aux élections générales anticipées de novembre 2024. Son parti forme une coalition gouvernementale avec le Fine Gael.
Italie 
Président de la République

Sergio Mattarella
Indépendant (soutenu par le Parti démocrate, centre gauche)
Depuis février 2015
Première ministre

Giorgia Meloni
Frères d'Italie (FdI, droite radicale)
Depuis octobre 2022
Gouvernement actuel : coalition entre droite radicale (FdI), extrême droite (Lega), libéraux-conservateurs (FI) et chrétiens-démocrates (NM).
Régime politique : parlementaire
Organisation : unitaire (voire régionale)
Parlement : bicaméral
Scrutin : proportionnel
En bref : Si le chef de l'État assure une certaine stabilité, les gouvernements italiens dépassent rarement les deux ans de longévité, et ce depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. En septembre 2022, Giorgia Meloni et son parti d'extrême droite, Frères d'Italie (FdI), sont arrivés en tête des élections générales. Elle est devenue la première femme à accéder à la présidence du Conseil des ministres, à la tête d'une large coalition intégrant la Ligue du Nord (Lega, extrême droite), Forza Italia (FI, centre droit) et la coalition Nous, modérés (NM, centre).
Lettonie 
Président de la République

Edgars Rinkēvičs
Unité (centre droit)
Depuis juillet 2023
Première ministre

Evika Siliņa
Unité (centre droit)
Depuis septembre 2023
Gouvernement actuel : coalition entre chrétiens-démocrates (Unité), écologistes (ZZS) et de sociaux-démocrates (PRO).
Régime politique : parlementaire
Organisation : unitaire
Parlement : monocaméral
Scrutin : proportionnel
En bref : La crise économique de 2008 et une perte de confiance de la population vis-à-vis de son gouvernement ont déclenché une crise politique inédite en Lettonie. De violentes manifestations ont éclaté en 2009, les Lettons demandant la démission du Parlement. Le pays a depuis renoué avec la stabilité politique. Des tensions demeurent toujours autour de la langue russe, utilisée par plus d'un tiers des habitants, mais qui n'a pas de statut de langue officielle. Aujourd'hui, le chef d'État et la Première ministres sont tous deux issus du même parti, Unité (centre droit). Le gouvernement dirigé depuis septembre 2023 par Evika Siliņa repose sur une coalition formée avec l'Union des verts et des paysans (ZZS, écologistes) et Les Progressistes (PRO, centre gauche).
Lituanie 
Président de la République

Gitanas Nausėda
Indépendant
Depuis juillet 2019
Première ministre

Inga Ruginienė
Parti social-démocrate lituanien (LSDP, centre gauche)
Depuis août 2025
Gouvernement actuel : coalition entre sociaux-démocrates (LSDP), le parti populiste et le centre (LGPU)
Régime politique : semi-présidentiel
Organisation : unitaire
Parlement : monocaméral
Scrutin : proportionnel
En bref : Premier pays de l'Est à déclarer son indépendance de l'URSS en 1990, la Lituanie a établi un régime démocratique stable. L'alternance entre gouvernements de coalition y est régulière. Depuis le 26 août 2025, Inga Ruginienė est à la tête d'un gouvernement de coalition formé par son parti, le Parti social-démocrate lituanien (LSDP, centre gauche), le parti populiste l'Aube sur le Niémen, l'Union des paysans et des Verts lituaniens (LGPU, centre), l’Action électorale des Polonais de Lituanie ainsi que des députés indépendants. Le Parlement lituanien a nommé cette ancienne dirigeante syndicale après la démission en juillet, de son prédécesseur, Gintautas Paluckas, à la tête du gouvernement depuis décembre 2024, qui était visé par des enquêtes de corruption et de conflits d'intérêt.
Luxembourg 
Grand-duc de Luxembourg

Henri de Luxembourg
Monarque
Depuis octobre 2000
Premier ministre

Luc Frieden
Parti populaire chrétien-social (PCS, centre droit)
Depuis novembre 2023
Gouvernement actuel : coalition entre chrétiens-démocrates (PCS) et libéraux (DP).
Régime politique : monarchie parlementaire
Organisation : unitaire
Parlement : monocaméral
Scrutin : proportionnel
En bref : La politique luxembourgeoise est stable et habituée des coalitions. En 2008, le grand-duc a refusé de signer la loi légalisant l'euthanasie, entraînant une crise constitutionnelle. Un amendement de la Constitution a dû être adopté pour se passer de l'approbation du monarque, lui retirant donc un de ses derniers rôles d'importance. En décembre 2024, le Grand-Duc Henri de Luxembourg annonce sa future abdication en octobre 2025, laissant le trône à son fils, le prince Guillaume de Nassau. Depuis novembre 2023, Luc Frieden est à la tête du gouvernement, une coalition formée par le Parti populaire chrétien-social (PCS, centre droit) auquel il appartient et le Parti démocratique (DP, centre).
Malte 
Présidente de la République

Myriam Spiteri Debono
Parti travailliste (PL, centre gauche)
Depuis avril 2024
Premier ministre

Robert Abela
Parti travailliste (PL, centre gauche)
Depuis janvier 2020
Gouvernement actuel : majorité de sociaux-démocrates (PL).
Régime politique : parlementaire
Organisation : unitaire
Parlement : monocaméral
Scrutin : proportionnel à vote unique transférable
En bref : Après avoir acquis son indépendance vis-à-vis de la Couronne britannique en 1964, Malte est devenu une république, mais fait toujours partie du Commonwealth. Son système politique est par ailleurs très proche de celui du Royaume-Uni. Le pays se caractérise par sa stabilité politique, qui s'illustre notamment par un bipartisme prononcé depuis plus d'un demi-siècle. Depuis 1950, deux partis se succèdent à la tête du gouvernement : le Parti travailliste (PL, centre gauche) et le Parti nationaliste (PN, centre droit). Robert Abela est à la tête d'un gouvernement social-démocrate depuis 2020.
Pays-Bas 
Roi des Pays-Bas

Willem-Alexander
Monarque
Depuis avril 2013
Premier ministre

Dick Schoof (démissionnaire)
Indépendant
Depuis juillet 2024
Gouvernement actuel (démissionnaire) : coalition entre des libéraux (VVD), des chrétiens-démocrates (NSC) et des conservateurs (BBB).
Régime politique : monarchie parlementaire
Organisation : unitaire
Parlement : bicaméral
Scrutin : proportionnel
En bref : Le grand nombre de partis présents dans le paysage politique néerlandais a toujours contribué à la formation de gouvernements de coalition. Il faut remonter à 1913 pour trouver un gouvernement composé d'un seul parti. Le pays est donc gouverné dans un effort de consensus entre les membres de la coalition au pouvoir, même si les Premiers ministres restent généralement en place pendant plusieurs années. À l'issue des élections législatives anticipées de novembre 2023, le Parti pour la liberté (PVV, extrême droite), formation nationaliste dirigée par Geert Wilders, est devenue la première force politique du pays. Les autres partis néerlandais ont toutefois refusé que ce dernier prenne la tête du gouvernement. Ils se sont entendus sur la désignation d'un Premier ministre indépendant en la personne de Dick Schoof. Le 3 juin 2025, Geert Wilders et le PVV ont annoncé leur départ de cette coalition, entraînant la chute du gouvernement, désormais démissionnaire en attendant de nouvelles élections.
Pologne 
Président de la République

Andrzej Duda
Indépendant (ex-Droit et justice, droite radicale)
Depuis août 2015
Premier ministre

Donald Tusk
Plate-forme civique (PO, centre droit)
Depuis décembre 2023
Gouvernement actuel : coalition entre chrétiens-démocrates (KO), libéraux (TD) et sociaux-démocrates (Lewica).
Régime politique : parlementaire
Organisation : unitaire
Parlement : bicaméral
Scrutin : proportionnel
En bref : Même si le président de la République dispose d'un rôle relativement symbolique, il est arrivé à plusieurs reprises depuis la fin du communisme qu'une mauvaise relation entre le chef d'État et son Premier ministre provoque la chute du gouvernement polonais. Après une politique pro-européenne qui a conduit à l'adhésion du pays à l'UE en 2004, le paysage politique est devenu très eurosceptique à partir de 2015 avec le retour de Droit et justice (PiS, droite radicale) au pouvoir, un parti régulièrement accusé de fragiliser l'État de droit. À la suite des élections parlementaires de 2023, l'opposition pro-européenne est revenue au pouvoir. Donald Tusk, qui fut déjà Premier ministre entre 2007 et 2014, est à la tête d'un gouvernement formé par la Coalition civique (KO, centre droit), Troisième voie (centre) et La Gauche (Lewica, centre gauche).
Portugal 
Président de la République

Marcelo Rebelo de Sousa
Indépendant (ex-Parti social-démocrate, centre droit)
Depuis mars 2016
Premier ministre

Luís Montenegro
Parti social-démocrate (PSD, centre droit)
Depuis avril 2024
Gouvernement actuel : minorité de conservateurs et de chrétiens-démocrates (PSD et CDS-PP).
Régime politique : semi-présidentiel
Organisation : unitaire
Parlement : monocaméral
Scrutin : proportionnel
En bref : Depuis les années 1980, le Portugal est dirigé alternativement par le Parti socialiste (PS, centre gauche) et le Parti social-démocrate (PSD, centre droit). De 2015 a 2024, le pays a été gouverné par le socialiste António Costa. Sa démission surprise en novembre 2023 a conduit à l'organisation d'élections anticipées en mars 2024, remportées de justesse par le PSD. Luís Montenegro est Premier ministre depuis, son gouvernement comptant essentiellement des membres du PSD, et quelques uns du CDS – Parti populaire (droite). Il a de nouveau remporté les élections législatives anticipées de mai 2025, mais échouant encore à décrocher une majorité absolue de sièges au Parlement.
République tchèque 
Président de la République

Petr Pavel
Indépendant (soutenu par la coalition Ensemble, centre droit)
Depuis mars 2023
Premier ministre

Petr Fiala
Parti démocratique civique (ODS, droite)
Depuis novembre 2021
Gouvernement actuel : coalition de chrétiens-démocrates et de conservateurs (SPOLU et STAN).
Régime politique : parlementaire
Organisation : unitaire
Parlement : bicaméral
Scrutin : proportionnel
En bref : Petr Pavel, général à la retraite et ancien président du comité militaire de l'Otan, est à la tête de l'État tchèque depuis 2023. le gouvernement est dirigé depuis 2021 par Petr Fiala, membre du Parti démocratique civique (ODS, droite). Ce parti forme une large coalition électorale de centre droit appelée Ensemble, avec l'Union chrétienne démocrate – Parti populaire tchécoslovaque (KDU-ČSL, centre droit), et TOP 09 (centre droit). Le parti Maires et Indépendants (STAN, centre droit) appartient également à la coalition gouvernementale.
Roumanie 
Président de la République

Nicușor Dan
Indépendant (soutenu par des partis pro-européens)
Depuis mai 2025
Premier ministre

Ilie Bolojan
Parti national libéral (PNL, centre droit)
Depuis juin 2025
Gouvernement actuel : coalition entre sociaux-démocrates (PSD) et libéraux-conservateurs (PNL et UDMR).
Régime politique : semi-présidentiel
Organisation : unitaire
Parlement : bicaméral
Scrutin : proportionnel
En bref : La vie politique roumaine est relativement instable depuis la fin du communisme en 1989, aucun Premier ministre n'étant resté au pouvoir plus de quatre ans. En novembre 2024, l'annulation par la Cour constitutionnelle de l'élection présidentielle lors de l'entre-deux tours a mis en lumière des problèmes de transparence électorale et d'ingérence massive venue de Russie, accentuant les divisions politiques et sociales. Sous la pression de l'opposition d'extrême droite, le président Klaus Iohannis, en poste depuis 2014, a démissionné le 12 février 2025. Le maire europhile de Bucarest, Nicușor Dan, a finalement remporté l'élection présidentielle, rejouée en mai 2025. L'instabilité règne tout autant au sein du gouvernement. Premier ministre depuis décembre 2024, Marcel Ciolacu a présenté sa démission au lendemain du premier tour de la présidentielle, après l'échec du candidat soutenu par sa coalition gouvernementale. Ilie Bolojan, issu des rangs du Parti national libéral (PNL, centre droit) occupe désormais la fonction.
Slovaquie 
Président de la République

Peter Pellegrini
Indépendant (soutenu par la majorité gouvernementale)
Depuis juin 2024
Président du gouvernement

Robert Fico
SMER – social-démocratie (nationalistes de gauche)
Depuis octobre 2023
Gouvernement actuel : coalition entre populistes-nationalistes de gauche (SMER), sociaux-démocrates (HLAS) et nationalistes (SNS et NK/NEKA).
Régime politique : parlementaire
Organisation : unitaire
Parlement : monocaméral
Scrutin : proportionnel
En bref : De 2006 à 2010 puis de 2012 à 2020, le SMER (sociaux-démocrates à l'époque) a dirigé plusieurs gouvernements, composant avec des partis d'horizons très différents, dont le Parti national slovaque (SNS, extrême droite). Après la défaite du SMER aux élections législatives de 2020, une coalition allant du centre à la droite radicale a pris la tête de l'exécutif. En 2023, après une campagne émaillée de désinformation, le SMER et son chef, Robert Fico, devenus des populistes et nationalistes de gauche, ont repris le pouvoir en s'alliant au HLAS (centre gauche) ainsi qu'au SNS et qu'à la Coalition nationale (NK/NEKA, extrême droite). Cette coalition a valu au SMER comme au HLAS d'être suspendus du Parti socialiste européen.
Slovénie 
Présidente de la République

Nataša Pirc Musar
Indépendante
Depuis décembre 2022
Président du gouvernement

Robert Golob
Mouvement pour la liberté (GS, centre)
Depuis juin 2022
Gouvernement actuel : coalition entre libéraux (GS), sociaux-démocrates (SD) et gauche radicale (Levica).
Régime politique : parlementaire
Organisation : unitaire
Parlement : bicaméral
Scrutin : proportionnel
En bref : La Slovénie est habituée à une certaine stabilité politique, même si les gouvernements de coalition sont la norme. En 2013, le conservateur Janez Janša a été destitué puis emprisonné pour corruption. Après trois gouvernements de coalition entre partis libéraux et de centre gauche, Janez Janša, dont la condamnation a été annulée, a retrouvé le pouvoir en 2020 à la tête d'une alliance de centre droit menée par le Parti démocratique slovène (SDS, droite) auquel il appartient. En avril 2022, le Premier ministre sortant a été battu par le Mouvement pour la liberté (GS, centre), formation libérale et écologiste, menée par Robert Golob. Il est depuis Premier ministre, à la tête d'une coalition formée avec les Sociaux-démocrates (SD, centre gauche) et La Gauche (Levica, gauche radicale).
Suède 
Roi de Suède

Carl XVI Gustave
Monarque
Depuis septembre 1973
Premier ministre

Ulf Kristersson
Les Modérés (M, centre droit)
Depuis octobre 2022
Gouvernement actuel : coalition minoritaire entre libéraux-conservateurs (M), chrétiens-démocrates (KD) et libéraux (L).
Régime politique : monarchie parlementaire
Organisation : unitaire
Parlement : monocaméral
Scrutin : proportionnel
En bref : La Suède possède une stabilité politique bien ancrée, avec une importance constante du Parti social-démocrate, régulièrement au pouvoir. Des coalitions sont souvent formées mais il n'est pas rare qu'un parti puisse diriger seul. Fait politique inédit, la coalition de droite au gouvernement depuis octobre 2022 est soutenue sans participation par les Démocrates de Suède (SD, droite radicale), parti ultraconservateur. La monarchie de Suède est l'une des plus effacées au monde et la vie politique suédoise est très peu influencée par le roi. Ulf Kristersson, membre des Modérés (M, centre droit), est à la tête du gouvernement formé par son parti, les Chrétiens-démocrates (KD, droite) et Les Libéraux (L, centre).
Qui sont les membres du Conseil européen ?
Chaque État membre décide, selon sa propre organisation institutionnelle, quel personnage de l'État le représente lors des sommets du Conseil européen. C'est dans cette institution, qui regroupe les dirigeants des 27 pays membres de l'UE, que les grandes orientations politiques communes sont décidées.
Pour quatre États membres (France, Chypre, Lituanie et Roumanie), c'est le président de la République qui siège lors de ces réunions. Pour les 23 autres, c'est le chef du gouvernement qui prend place autour de la table. On y retrouve ainsi des Premiers ministres (venant par exemple d'Espagne, des Pays-Bas ou bien de République tchèque), des chanceliers (seulement en Allemagne et en Autriche) et un Taoiseach irlandais.
Les deux derniers membres du Conseil européen ne sont pas chefs d'État ou de gouvernement, mais dirigeants d'institutions européennes. Il s'agit du Portugais António Costa et de l'Allemande Ursula von der Leyen, respectivement présidents du Conseil européen et de la Commission européenne.
| État membre | Représentant |
|---|---|
| Allemagne | Friedrich Merz (Chancelier fédéral) |
| Autriche | Christian Stocker (Chancelier fédéral) |
| Belgique | Bart De Wever (Premier ministre) |
| Bulgarie | Rossen Jeliazkov (Premier ministre) |
| Chypre | Níkos Christodoulídis (Président de la République) |
| Croatie | Andrej Plenković (Premier ministre) |
| Danemark | Mette Frederiksen (Première ministre) |
| Espagne | Pedro Sánchez (Premier ministre) |
| Estonie | Kristen Michal (Premier ministre) |
| Finlande | Petteri Orpo (Premier ministre) |
| France | Emmanuel Macron (Président de la République) |
| Grèce | Kyriákos Mitsotákis (Premier ministre) |
| Hongrie | Viktor Orbán (Premier ministre) |
| Irlande | Micheál Martin (Taoiseach) |
| Italie | Giorgia Meloni (Première ministre) |
| Lettonie | Evika Siliņa (Première ministre) |
| Lituanie | Gitanas Nausėda (Président de la République) |
| Luxembourg | Luc Frieden (Premier ministre) |
| Malte | Robert Abela (Premier ministre) |
| Pays-Bas | Dick Schoof (Premier ministre) |
| Pologne | Donald Tusk (Premier ministre) |
| Portugal | Luís Montenegro (Premier ministre) |
| République tchèque | Petr Fiala (Premier ministre) |
| Roumanie | Nicușor Dan (Président de la République) |
| Slovaquie | Robert Fico (Premier ministre) |
| Slovénie | Robert Golob (Premier ministre) |
| Suède | Ulf Kristersson (Premier ministre) |
| Union européenne | António Costa (Président du Conseil européen) |
| Union européenne | Ursula von der Leyen (Présidente de la Commission européenne) |
Crédits photo : Conseil de l'Union européenne | Parlement européen | Gouvernement hongrois CC BY-SA 4.0 | Flick Saeima CC BY-SA 2.0 Deed | Quirinale.it | Elekes Andor / wikimedia commons CC BY 4.0 Deed | Österreichisches Außenministerium | Sebastian Indra / Ministry of Foreign Affairs of Poland | Dean Calma / IAEA | AIVD NL | Augustas Didžgalvis / wikimedia commons CC BY 4.0 Deed
L’article Qui sont les chefs d'État et de gouvernement des pays de l'Union européenne ? est apparu en premier sur Touteleurope.eu.
- GÉNÉRALISTES
- Basta
- Blast
- L'Autre Quotidien
- Alternatives Eco.
- Le Canard Enchaîné
- La Croix
- Le Figaro
- France 24
- France-Culture
- FTVI
- HuffPost
- L'Humanité
- LCP / Public Senat
- Le Media
- Le Monde
- Libération
- Mediapart
- La Tribune
- EUROPE ‧ RUSSIE
- Courrier Europe Centrale
- Desk-Russie
- Euractiv
- Euronews
- Toute l'Europe
- Afrique du Nord ‧ Proche-Orient
- Haaretz
- Info Asie
- Inkyfada
- Jeune Afrique
- Kurdistan au féminin
- L'Orient - Le Jour
- Orient XXI
- Rojava I.C
- INTERNATIONAL
- CADTM
- Courrier International
- Equaltimes
- Global Voices
- I.R.I.S
- The New-York Times
- OSINT ‧ INVESTIGATION
- OFF Investigation
- OpenFacto°
- Bellingcat
- Disclose
- Global.Inv.Journalism
- MÉDIAS D'OPINION
- AOC
- Au Poste
- Cause Commune
- CrimethInc.
- Hors-Serie
- L'Insoumission
- Là-bas si j'y suis
- Les Jours
- LVSL
- Médias Libres
- Politis
- Quartier Général
- Rapports de force
- Reflets
- Reseau Bastille
- Rézo
- StreetPress
- OBSERVATOIRES
- Armements
- Acrimed
- Catastrophes naturelles
- Conspis
- Culture
- Curation IA
- Extrême-droite
- Human Rights
- Inégalités
- Information
- Internet actu ✝
- Justice fiscale
- Liberté de création
- Multinationales
- Situationnisme
- Sondages
- Street-Médics
- Routes de la Soie

