20.02.2026 à 13:08
Face aux aléas climatiques, quelles variétés de céréales privilégier ?
Texte intégral (2108 mots)

On favorise souvent les variétés de céréales qui ont, en moyenne, les meilleurs rendements. Mais les hétérogénéités climatiques et aléas croissants viennent chahuter ce paradigme.
Blé, orge, maïs, riz… Ces cultures assurent près de la moitié des apports caloriques mondiaux, ce qui rend leur adaptation au changement climatique cruciale.
Mais alors que sécheresses, gels tardifs et coups de chaleur se multiplient, une question s’impose : quelles variétés choisir pour faire face à des conditions de plus en plus imprévisibles ?
Car toutes les variétés ne réagissent pas de la même façon : certaines voient leur rendement chuter rapidement sous stress, quand d’autres compensent mieux et conservent des performances plus stables. Choisir les variétés à sélectionner et à cultiver est donc à la fois difficile et capital pour assurer la sécurité alimentaire.
Faut-il miser sur une variété championne dans des conditions climatiques particulières ou sur des profils plus robustes face à l’imprévisibilité ? Comment connaître précisément les déterminants climatiques qui vont gouverner cette performance et cette stabilité ? Ces questions sont au cœur de notre travail afin d’amener de nouvelles connaissances pour la sélection variétale et accroître la pertinence du choix variétal.
Les performances moyennes et leurs limites
Depuis des décennies, la sélection variétale repose sur des essais conduits dans de multiples lieux et sur plusieurs années. On y analyse les performances pour choisir des variétés nouvelles ou renforcer les recommandations de variétés existantes, comme les variétés Chevignon, Intensity et Prestance pour le blé tendre et Planet, Timber et Lexy pour l’orge de printemps brassicole. Historiquement, et encore très souvent, ces décisions sont prises en observant les moyennes de performance réalisées sur l’intégralité ou sur une grande partie du réseau d’essais, et en recommandant les variétés les plus performantes en moyenne.
Le problème est que, sous un climat qui évolue rapidement et qui apparaît de plus en plus imprévisible, cette valeur moyenne de performance est trompeuse, car elle ne nuance pas suffisamment les différences de performance relative des diverses variétés face aux variations climatiques et aux variations des facteurs du sol. Plus surprenant encore : les facteurs climatiques qui déterminent les niveaux de rendement ne sont pas toujours ceux qui provoquent les changements de classement entre variétés. Autrement dit, les conditions climatiques qui font varier le rendement de la culture ne sont pas nécessairement celles qui avantagent ou désavantagent certaines variétés par rapport à d’autres, révélant ainsi toute la complexité de l’adaptation des plantes cultivées à l’instabilité climatique et les défis qu’elle pose à la sélection variétale.
Une variété très performante une année – atteignant par exemple 9 tonnes par hectare (t/ha) en blé – peut subir une chute significative de rendement la campagne suivante, à 6–7 t/ha, tout en étant reléguée dans le classement par des variétés mieux adaptées aux conditions climatiques.
Face à ce constat, nous avons donc tâché de procéder autrement. Plutôt que de considérer chaque année ou chaque site comme un cas isolé, nous avons voulu identifier les grands types de situations climatiques et agronomiques auxquels les cultures sont confrontées ainsi que leur fréquence d’apparition, même si leur succession demeure difficilement prévisible.
Utiliser l’envirotypage pour mieux comprendre les singularités de chaque lieu et variété
Ces situations sont décrites à partir de variables clés – températures, disponibilité en eau, rayonnement… – analysées aux moments les plus sensibles du cycle des cultures, par exemple sur la période allant des semis à l’émergence, sur celle allant de la floraison jusqu’au début du remplissage des grains ou encore du remplissage à la maturité. Un découpage crucial qui permet dans un premier temps de mieux comprendre les réponses contrastées des variétés selon les conditions et, dans un second temps, de regrouper les années et les lieux en familles d’environnements historiquement comparables : c’est le principe de l’envirotypage.
Appliquée à l’orge de printemps, cette approche met en évidence trois grands types d’environnements en Europe, définis à partir des facteurs climatiques qui expliquent les réponses contrastées des variétés au sein du réseau d’essai : maritime, tempéré et continental.
Leur fréquence varie fortement selon les régions. En Irlande ou en Écosse, le scénario climatique est très majoritairement maritime d’une année sur l’autre. À l’inverse, dans le nord de la France, ces types alternent fréquemment (Figure 1), ce qui oriente la sélection et le choix variétal vers des génotypes à adaptation plus générale, c’est-à-dire capables de bien se comporter en moyenne dans des contextes contrastés. En Irlande et en Écosse, il sera donc judicieux de miser sur une variété championne pour des conditions particulières tandis que dans le nord de la France, il faudra plutôt plébisciter une variété robuste face à l’imprévisibilité.
Les analyses montrent également que des températures fraîches en début de cycle, entre l’émergence et le stade « épi 1 cm » – ce dernier correspondant au début de la progression du futur épi dans la tige –, peuvent maximiser le potentiel de rendement des variétés d’orge de printemps testées. Par ailleurs, l’intensité du rayonnement solaire durant la phase de remplissage des grains d’orge induit des réponses contrastées selon les variétés. Ces résultats constituent des leviers précieux pour orienter la stratégie de sélection.
Les rendements du blé tendre d’hiver stagnent
Le cas du blé tendre d’hiver est également central. Première céréale cultivée au monde, il a bénéficié de progrès génétiques constants depuis la fin des années 1980, mais sa stabilité de rendement reste fragile, avec des niveaux moyens autour de 7,5 t/ha depuis la fin des années 1990. Les interactions entre variétés et environnements jouent un rôle majeur dans l’expression des niveaux de rendement, qui s’expriment également au plan régional.
L’envirotypage permet d’identifier les grands scénarios climatiques responsables des variations de rendement et de qualité, et de définir des zones d’adaptation générale ou spécifique. Un enseignement important est que les variétés les plus performantes ne sont pas nécessairement les plus stables pour le rendement : le progrès génétique n’a pas automatiquement renforcé la résilience climatique.
Ces travaux convergent vers un même message : comprendre le climat ne suffit plus, il faut organiser son imprévisibilité. En structurant les environnements réellement rencontrés par les cultures, l’envirotypage offre une approche à la fois scientifique, pour améliorer la connaissance en mettant en évidence les caractères des plantes impliqués dans l’adaptation au changement climatique, et pragmatique pour adapter dès aujourd’hui la sélection variétale au climat de demain.
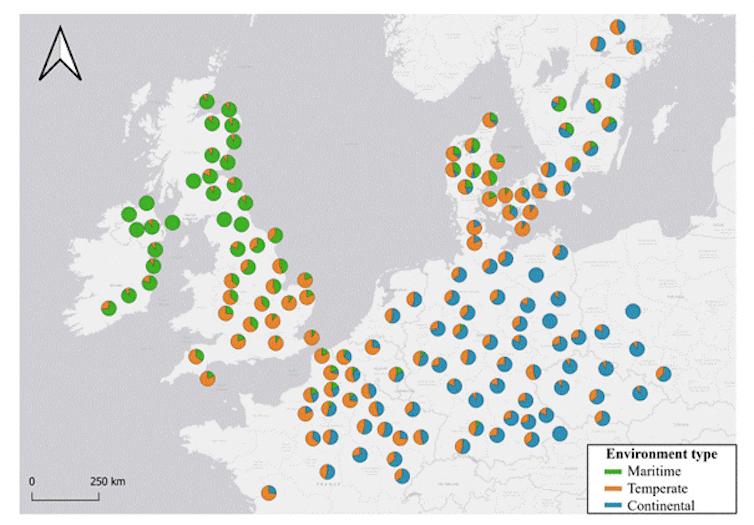
Des résultats qu’il faut intégrer aux choix des pratiques
Face à un climat de plus en plus instable, il ne suffit plus de raisonner le choix des variétés à partir de performances moyennes. En structurant la diversité des situations climatiques réellement rencontrées par les cultures, l’envirotypage permet de mieux comprendre pourquoi les variétés changent de comportement d’une année ou d’un contexte à l’autre, et d’orienter la sélection vers des profils plus robustes face à l’imprévisibilité.
Cette approche reste toutefois fondée sur des essais conduits dans des conditions souvent favorables (texture, structure, et profondeur de sol optimales) et avec des pratiques agricoles très conventionnelles. L’enjeu sera donc aussi d’intégrer l’effet des pratiques – dates de semis, les pratiques de travail du sol, de fertilisation et de protection des cultures – à partir des données issues du terrain et de la traçabilité agricole.
En les structurant avec et pour les agriculteurs, ces informations ouvriront la voie à des recommandations variétales plus réalistes, associées à des pratiques culturales mieux adaptées à la diversité des systèmes agricoles et aux contraintes du climat de demain.
Cet article a bénéficié de l’appui de Chloé Elmerich et Maëva Bicard dans le cadre de leurs thèses de doctorat réalisées au sein de l’unité de recherche AGHYLE (Agroécologie, hydrogéochimie, milieux et ressources, UP2018.C10) de l’Institut polytechnique UniLaSalle.
Bastien Lange a reçu des financements de Florimond Desprez, SECOBRA Recherches et LIDEA, la Région des Hauts de France et l’ANRT.
Michel-Pierre Faucon est membre du pôle Bioeconomy For change. Il a reçu des financements de Florimond Desprez, SECOBRA Recherches et VIVESCIA, la Région des Hauts de France, l'ANR, l'ANRT et l'UE.
Nicolas Honvault est membre de la chaire “Fermes resilientes bénefiques pour climat et la biodiversité”. Il a reçu dans ce cadre des financements de VIVESCIA.
19.02.2026 à 17:03
Pourquoi la beauté des vaches n’est pas qu’une affaire de génétique
Texte intégral (3025 mots)
Une belle vache, c’est quoi ? Les critères pour évaluer cette qualité ne manquent pas : l’expérience et le vécu de chaque éleveur, les avancées de la génétique qui s’immiscent de plus en plus dans le quotidien des fermes et, bien sûr, les « beautés des vaches », ces qualités morphologiques qui structurent le canon de chaque race. Au croisement de tous ces enjeux, la question de la beauté des bovins continue en tout cas d’être la source de discussions sans fin.
Qu’est-ce qui fait la beauté d’une vache ? Pour le promeneur qui s’attarde au bord d’un pré, ce peut être la qualité de celle qui sera la plus fringante, qui viendra à sa rencontre et lui rappellera les images qu’il a vues dans des livres d’enfant. Pour l’artiste, une vache se doit d’avoir de belles formes, une robe et des taches aux couleurs bien marquées. Mais pour les techniciens, les vétérinaires et surtout pour les éleveurs, c’est bien plus que cela. Ils vont d’ailleurs parler au pluriel des « beautés des vaches. »
Le pointage
Les « beautés » forment une liste de critères d’évaluation des animaux utilisés lors du pointage. Cette appréciation visuelle de la morphologie de l’animal se base sur plusieurs dizaines de mesures ou observations qui renseignent le potentiel de l’animal non seulement en termes de production de lait mais aussi de santé. Ainsi, par exemple, l’angle que forme le jarret avec le sol est un critère important car un mauvais angle fait courir le risque que la vache boite ce qui diminuera sa mobilité, importante pour des animaux qui pâturent très régulièrement.
Le pointage est l’affaire de techniciens du conseil agricole qui vont de fermes en fermes et aident les éleveurs à sélectionner leurs animaux. C’est donc une pratique technique et économique spécialisée de sélection des meilleures vaches. Mais c’est aussi une pratique des éleveurs eux-mêmes qui tiennent à maîtriser la composition de leurs troupeaux. Le pointage se pratique également avec ferveur dans les lycées agricoles où on l’apprend de manière méthodique. Les élèves, futurs éleveurs, s’y adonnent avec plaisir et enthousiasme, notamment tant cela fait partie de l’excellence professionnelle.
Il y aussi des concours de jeunes pointeurs qui désigneront les plus compétents. Enfin, cette pratique de pointage est aussi mise en scène de manière spectaculaire lors des comices, fêtes agricoles locales qui rassemblent toute la profession : des juges – éleveurs réputés – y décerneront des prix. Les vaches présentées sont préparées soigneusement pour y apparaître les plus belles. Les animaux primés peuvent ensuite poursuivre leur carrière à travers d’autres événements dont le plus prestigieux est évidemment le salon international de l’Agriculture à Paris.
Ces trois collectifs – jeunes pointeurs, techniciens, juges de concours – et leurs pratiques témoignent de la nature diverse du pointage : une activité à la fois technique, sociale et symbolique. Sa mise en œuvre les réunit dans la singularité des fermes ou lors de manifestations publiques, autant d’occasions d’échanger de « parler métier » entre collègues et de manière festive : « Faut qu’on soit devant la race, c’est notre métier, notre identité » affirme à cet égard un éleveur franc-comtois.
À lire aussi : L’enseignement agricole, un objet politique mal identifié
Dans cette région, une race de vache est particulièrement scrutée : la montbéliarde. Son lait entre dans la production de plusieurs fromages d’origine contrôlée comme le comté. Son histoire est ancrée dans le massif jurassien, où sa silhouette est iconique : une robe « pie rouge » blanche tachetée de rouge brun. Tête blanche, oreilles rouges, ses formes sont rassurantes et harmonieuses, c’est une « séductrice », assurent certains éleveurs. Le pointage reste alors le témoin d’une dynamique collective dans laquelle la confusion entre les compétences professionnelles, le métier et le plaisir ne peut être levée. C’est une culture, qui s’enrichit, se transforme en fonction de l’expérience, des connaissances accumulées pour améliorer le progrès génétique d’une race, l’arrimer à la modernité, tout en restant fidèle à son histoire.

La sélection
Dans l’élevage laitier, étant donné que le niveau de lactation est lié à la reproduction, les vaches sont régulièrement inséminées, idéalement tous les ans et majoritairement de manière artificielle. De ce fait, le troupeau compte un grand nombre de jeunes animaux et tous ne pourront pas rester sur la ferme. Si les mâles sont rapidement vendus, la sélection des femelles est plus délicate. Les éleveurs trient donc leurs bêtes en continu suivant des choix composites ancrés tout à la fois dans l’histoire des familles humaines et dans celles des lignées animales.
Dans l’après-guerre, avec le développement de la génétique quantitative, la sélection s’est basée sur l’accumulation de données issues du pointage et de données de suivi des animaux quant à leur production et leur santé. Cela a permis d’identifier de bons reproducteurs, des taureaux pouvant donner lieu à des lignées performantes. Cela a également impliqué d’évaluer des descendances et donc d’accumuler des données, ce dont étaient chargées des coopératives départementales de sélection qui disposaient d’un monopole local de gestion de la race.
Ce paysage a complètement changé au début de notre siècle. C’est une chose que l’on sait peu mais depuis le début des années 2010, la sélection des animaux domestiques a radicalement été modifiée. Grâce au décryptage de l’ADN, la génomique a succédé aux acquis de la statistique quantitative. Elle rend désormais envisageable le choix des jeunes femelles dès leur naissance en cherchant à répondre aux défis de plus en plus nombreux rencontrés par les élevages modernes. Alors que jusqu’ici, les index ciblaient la production de lait, les caractères fonctionnels et les caractères morphologiques, il est désormais possible – ou ce sera bientôt le cas – de caractériser l’absence de cornes, la fromageabilité du lait, les pathologies liées aux aplombs, une moindre émission de gaz à effet de serre, la résistance à la chaleur…
Tous les domaines de l’élevage semblent concernés par ces avancées : la santé des animaux et leur bien-être, leur adaptation à des environnements moins contrôlés et plus diversifiés, la réduction des impacts environnementaux, l’amélioration de la qualité sanitaire des produits alimentaires… Il serait désormais possible d’identifier, dès la naissance, le potentiel de l’animal et donc d’indiquer à l’éleveur quels animaux faire entrer dans le troupeau.
Concomitant à ce changement technique, l’interprétation française d’une législation européenne sur la libre concurrence a conduit à dissoudre les coopératives de sélection au profit d’entreprises privées qui vendent désormais les doses de sperme mais aussi les données issues du génotypage. Car pour caractériser les animaux il leur faut disposer d’une masse la plus importante possible de données issues des élevages. Les éleveurs deviennent ainsi à la fois consommateurs d’évaluations et de doses de sperme mais aussi fournisseurs de données. L’évaluation visuelle de l’animal – le pointage – reste pertinent non plus comme jugement de l’animal à sélectionner mais comme production de données dans un processus obscur de classement par des entreprises privées.
Pour suivre cette innovation, une enquête universitaire au long cours a débuté en 2014 sur la conduite de la race montbéliarde dans le massif jurassien. Mais alors que l’investigation devait porter sur les premières réalisations technico-scientifiques de la sélection assistée par marqueurs (la SAM), il a été observé qu’éleveurs et techniciens mélangent constamment, dans un désordre apparent, des calculs, des réflexions, des souvenirs, des affects…
Choisir une vache
Toutes ces dimensions sont visibles alors que les éleveurs entrent dans l’étable, sortent au pré pour apprécier les animaux en leur présence, ou se connectent au big data agricole et aux informations multiples auxquelles il donne accès via un écran. Les éleveurs s’alignent-ils sur les préconisations de ces outils numériques ? Une interpellation d’un conseiller technique suggère que la réponse à cette question n’est pas encore écrite :
« Ce qui fait ton plaisir, tes actes de décision… Ça doit pas être l’algorithme qui fasse tes décisions, qui te fasse garder ou pas une vache… Mais on n’en est pas loin, hein ? Et moi, je m’inscris en faux là-dessus… Il peut t’aider l’algorithme… Mais si c’est cette vache-là que t’aime bien… Parce que c’est elle qui emmène le troupeau au pâturage… Elle te fait un veau par an sans problème et elle ne tape pas quand tu la trais et que tu l’aimes vraiment… Ah, ben tu la gardes… »
Car la sélection reste avant tout une affaire individuelle menée par chaque éleveur pour garder la vache « qui va ». À la recherche de la « toute bonne » ou de la « toute belle », ils poursuivent avec obstination des images de vaches qu’ils ont dans la tête.
Car l’élevage est un métier au cœur duquel il y a plusieurs manières de faire et d’exceller et dans chaque troupeau, il y a divers profils d’animaux qu’on peut valoriser ou non. Il y a bien sûr la meneuse, les indépendantes ou les amicales. Il y a celles dont les lignées sont connues et « qui font partie de la famille » humaine et animale. Celles qui ne font pas parler d’elles, qui marchent bien pour aller au pré et sont capables de s’adapter aux ressources disponibles, aux aléas de la pousse de l’herbe. Pour les prairies rocailleuses du Haut-Jura, il faut des pattes solides et un large museau pour brouter. Bien sûr, il y a aussi celles dont la robe et les formes sont conformes à l’idéal de la race.
À travers la sélection que mènent les éleveurs, le fonctionnel (la bonne vache) et l’esthétique (la belle vache) ne peuvent être dissociés, ils sont au cœur de l’émotion que procure un animal avec lequel travailler : « Bon, il y en a qui se rapprochent toujours du standard “montbéliarde”, bonne mamelle, bon corps, etc. Mais après, les vaches, c’est comme les gens… C’est pas parce qu’elles ont un défaut qu’elles ne sont pas bonnes… », juge ainsi un éleveur.
Elles sont alors d’autant plus belles qu’elles ont des qualités multiples qui débordent largement les critères du pointage, qu’elles se savent choisies et peuvent ainsi exprimer leur agency. Ce terme, qui désigne la capacité à agir, ne s’applique pas exclusivement aux humains. L’agency n’est en outre pas une qualité individuelle, distribuée a priori, elle est encastrée dans les situations et les relations. Dans le massif jurassien, il y a des éleveurs qui se « sentent éleveur s » et des vaches qui « savent qu’elles sont des vaches ». Ils travaillent ensemble dans l’impromptu autant que dans la durée. « Rester en contact avec l’animal, ce lien avec chacune de nos vaches, car elles sont toutes différentes, ce qui fait que chaque jour est différent et raconte notre histoire », souligne une éleveuse sur Facebook dans le groupe « Passionné de la race montbéliarde ».
À lire aussi : L’éternelle quête de la vache parfaite, de l’auroch nazi aux bovins sans cornes
Quelle vache pour demain ?
La génomique permet de sélectionner dès la mise bas : plus qu’une meilleure qualité, c’est une accélération supplémentaire. Cela repose sur un outil numérique qui s’appuie lui-même sur une indispensable collecte de données auprès des éleveurs. Tout ceci confirme que la race est un bien commun : elle n’existe et ne s’améliore que par la participation de tous. Mais sa gestion est désormais privatisée. Les éleveurs sont aujourd’hui utilisateurs et non plus acteurs d’une gestion collective.
Quant à la sélection elle-même, aux choix concrets des éleveurs pour constituer et renouveler leurs troupeaux, ne tend elle pas à se substituer à leurs propres appréciations dont on voit qu’elles ne relèvent pas seulement d’un raisonnement d’efficacité mais aussi de logiques symboliques, affectives, relationnelles qui se traduisent dans une esthétique de la vache, la bonne et la belle ?

Pour aller plus loin, Élever des montbéliardes… Entre passion et productions animales, de Catherine Mougenot, préface de Bernard Hubert et dessins de Gilles Gaillard, Cardère Éditeur, septembre 2025.
Marc Mormont ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
19.02.2026 à 11:48
Prairies sous Plexiglas, images satellite, équations… comment les scientifiques prédisent les effets du changement climatique sur les écosystèmes
Texte intégral (3630 mots)

Expérimentation à ciel ouvert avec des prairies recouvertes de Plexiglas ou bien avec des anneaux en carbone de 25 mètres, reproduction d’écosystèmes miniatures en laboratoire, utilisations de données historiques, suivis depuis l’espace, équations… Pour comprendre comment le changement climatique va impacter les écosystèmes, les méthodes sont nombreuses et souvent complémentaires.
« Gérer l’inévitable pour éviter l’ingérable. » À l’heure où les effets du changement climatique ne vont partout qu’en s’accroissant, telle est la formulation courante des climatologues pour exprimer très concrètement l’objectif stratégique des politiques climatiques.
Face aux prédictions préoccupantes, les écologues observent, cherchent à comprendre ce phénomène pour mieux prédire ses conséquences sur nos écosystèmes.
Il existe différentes approches pour tester comment le changement climatique influe sur les organismes, leurs interactions entre individus, entre espèces et avec leur environnement. Cela combine des observations, des expérimentations et de la modélisation. Voici un tour d’horizon de ces différentes approches mises en place en France et dans le monde.
Des plateformes expérimentales grandeur nature
Une première approche consiste à modifier un écosystème via des équipements et à étudier les changements qui en découlent. Que ce soit pour évaluer la sécheresse, les hausses de température ou l’augmentation du CO2 dans l’atmosphère, le principe reste le même. Cela permet de contrôler une ou plusieurs variables environnementales (la pluviométrie, la température et autres) comme si nous étions sous les conditions futures, pour simuler les scénarios climatiques à venir.
C’est le cas de la plateforme de Puéchabon, dans le sud de la France, ou de la plateforme DRI-GRASS, près de Sydney (Australie). Toutes deux cherchent à comprendre comment un changement dans les régimes de pluie impacte l’écosystème et son fonctionnement, mais dans deux écosystèmes bien distincts.
À Puéchabon (Hérault), un système de gouttières dans une forêt de chênes verts exclut partiellement l’eau de pluie pour simuler la sécheresse. Cette expérimentation a débuté en 2003, avec quatre parcelles de 140 mètres carrés dans la forêt de chênes verts. Ainsi, on évalue l’effet de la sécheresse sur des parcelles entières de forêt. Quels effets sur la forêt, sur les arbres, sur le sol ? Quels effets sur le stockage de carbone ?
À Sydney, la plateforme DRI-Grass utilise un système similaire dans un autre type d’écosystème : une prairie. À la place de gouttières, ce sont des toits en Plexiglas qui couvrent différentes parties de la prairie. Cette expérience, plus récente, a débuté en 2013 et couvre un peu plus de 120 m2.

Élément en plus, un système d’irrigation simule plusieurs scénarios possibles : une augmentation, diminution ou changement dans la distribution des eaux de pluie. Cette dernière permet d’étudier les scénarios d’événements extrêmes : des pluies plus rares mais plus fortes. Les chercheurs peuvent donc modifier les régimes hydriques pour se caler sur les scénarios de prédiction des climats futurs. L’un d’entre nous a ainsi travaillé sur cette plateforme pendant trois ans pour mieux comprendre la réponse des champignons et leur interaction avec les plantes face au changement climatique.
Toujours en Australie, mais beaucoup plus impressionnante par sa taille et le dispositif mis en place, la plateforme EucFACE teste l’effet de l’augmentation du CO2 dans l’atmosphère. Ici, ce sont des anneaux en fibre de carbone qui entourent des parcelles circulaires de forêt d’eucalyptus de 25 mètres de diamètre et hauts de 28 mètres !

Durant la journée, ces anneaux injectent du CO2 sur la forêt pour simuler une augmentation de CO2 à 550 ppm, la concentration attendue dans l’atmosphère pour l’année 2050. De nombreux chercheurs travaillent sur cette plateforme pour comprendre comment l’augmentation du CO2 risque de perturber le fonctionnement des forêts natives d’Australie.
Pour une simulation plus réaliste des changements à venir, certaines plates-formes allient plusieurs facteurs. La plateforme autrichienne ClimGrass par exemple, teste non seulement l’augmentation du CO2 mais aussi la température et la sécheresse. Cette plateforme de maintenant dix ans s’intéresse aux impacts du changement sur une prairie.
Quels que soient la plateforme et le scénario testé, des chercheurs de plusieurs disciplines travaillent et prennent des mesures pour étudier les effets du changement climatique sur les organismes (plantes, organismes du sol, herbivores et autres), la diversité des espèces et sur le fonctionnement de l’écosystème (sa capacité à fixer le carbone, par exemple).
Une des difficultés liées avec cette approche expérimentale est la multitude de facteurs qui ne sont pas contrôlés dans une expérimentation à ciel ouvert. Les résultats peuvent varier d’une année sur l’autre en fonction des aléas bien réels du terrain (une année exceptionnellement pluvieuse, par exemple). De plus, ces études sont en général plus coûteuses et demandent plus d’entretien.
Créer et contrôler un mini-écosystème : les microcosmes
Pour des conditions plus contrôlées, d’autres projets consistent à mettre en place des écosystèmes à échelle réduite en laboratoire. Par exemple, un microcosme terrestre peut contenir soit des assemblages artificiels d’organismes (une sélection de plantes en pots) soit des portions d’écosystème venant de l’environnement (des sols et plants extraits d’une prairie ou autre).

Ces mini-écosystèmes sont ensuite placés dans des chambres climatiques. Ces chambres varient en taille, mais peuvent être aussi réduites à deux mètres cubes. Elles confinent des communautés d’organismes et les exposent à des variables environnementales (température, humidité, CO2…) simulant des scénarios du changement climatique en conditions entièrement contrôlées.
Ce genre d’expérimentation a l’avantage d’avoir un environnement qui facilite l’interprétation et le suivi. Par exemple, simuler une hausse de température tandis que les autres paramètres (humidité, CO2…) sont constants et eux aussi contrôlés avec précision. Cela permet d’isoler et d’interpréter l’effet de la température, et uniquement de la température, sur le microcosme. Ainsi, les microcosmes ne sont qu’une portion de l’écosystème, et s’éloignent de conditions plus fluctuantes et réalistes.
Exploiter les gradients naturels
Plutôt que modifier l’écosystème ou d’en isoler une partie, certains chercheurs utilisent des gradients naturels, soit les variations naturelles que l’on constate dans la nature. Sur les écosystèmes terrestres, on retrouve des gradients de température avec l’altitude en montagne, par exemple. Plus on monte en altitude, plus les températures chutent. Un gradient de température existe aussi en fonction de la latitude. En général, plus on se rapproche des pôles, plus les températures sont froides. Et, plus récemment utilisés, il existe aussi les gradients de température entre les zones rurales et urbaines avec leurs îlots de chaleur.
Ainsi, l’impact de la température peut être évalué en suivant un transect (ligne virtuelle) le long du gradient, mais pas seulement.
Il existe des expériences de « translocation », où les chercheurs déplacent soit des espèces soit des communautés entières de zones élevées en montagne vers des zones plus basses pour simuler un réchauffement. Par exemple, des chercheurs ont déplacé des placettes de prairie de 0,7 mètre sur 0,7 mètre à trois différentes élévations dans les Alpes : 950, 1 450 et 1 950 mètres au-dessus du niveau de la mer. À la suite de ces transplantations, un suivi régulier peut être effectué pour étudier les plantes, leurs abondances et les espèces associées.
Un autre type d’expérimentation consiste à déplacer un organisme vers des zones plus élevées, et donc actuellement plus froides. Ces zones, pour le moment inaccessibles aux organismes de basses altitudes (avec des températures plus clémentes), deviendront propices à leur développement avec le réchauffement global. L’intérêt de ces études est de mesurer l’impact de ces futures migrations sur les écosystèmes où ces espèces sont pour le moment absentes.
Bien qu’informatives, ces expériences ont, elles aussi, leurs biais. Le gradient de température est un facteur déterminant, cependant il existe toute une myriade d’autres facteurs environnementaux qui varient le long de ces gradients. Ces facteurs ne peuvent pas être contrôlés, mais on peut tout de même les prendre en compte pour interpréter les observations des chercheurs.
Des suivis et des mesures de longue haleine
Certains écosystèmes sont étudiés depuis très longtemps. C’est le cas de la forêt expérimentale Hubbard Brook, au New Hampshire, dans le nord-est des États-Unis. Des mesures environnementales et les suivis d’espèces associées sont collectés depuis 1955 (soit soixante-et-onze ans cette année !). En France, le Centre d’études biologiques de Chizé effectue des recherches sur l’évolution des populations animales sauvages depuis 1968.
On peut ainsi corréler les données météorologiques avec l’activité, l’abondance et la diversité d’espèces. Les données permettent non seulement d’observer directement le changement du climat lors des décennies passées mais aussi comment la variabilité des événements climatiques influence le fonctionnement de l’écosystème.
Une autre manière d’obtenir des mesures sur le long terme et de réaliser des suivis à grande échelle se fait grâce aux sciences citoyennes. Que ce soit dans un jardin, en ville ou en randonnée, les données d’observation d’espèces permettent non seulement d’enregistrer la présence de l’espèce mais aussi leur phénologie, c’est-à-dire comment le climat influence la saisonnalité des espèces.
Ces fluctuations sont aussi mises en évidence grâce à des registres historiques. C’est le cas de la date de floraison des cerisiers de Kyoto, dont les registres remontent à 853. Ou encore plus proche de nous, les registres des dates des vendanges qui prouvent qu’elles ont avancées en moyenne de deux à trois semaines.

Ce genre de projet permet de répondre à plusieurs questions, par exemple : Est-ce que le printemps démarre de plus en plus tôt ? Est-ce que la distribution géographique de l’espèce change ? Lesquelles sont les plus impactées ?
Des suivis depuis l’espace
Des mesures en continu, tous les jours, et qui recouvre toute la surface terrestre depuis l’espace pour mieux comprendre le fonctionnement terrestre et améliorer les modèles de prédiction. Parmi les nombreuses applications de cet outil, ça permet notamment de cartographier la végétation, son état de santé et sa capacité à fixer le CO2.
La modélisation
La modélisation est une activité incontournable en sciences, permettant de représenter de manière simplifiée un système, en l’occurrence ici, un écosystème. Ces modèles peuvent prendre des formes très différentes, de la simple équation mathématique jusqu’au modèle complexe reposant sur un grand nombre de paramètres (climatiques, pédologiques, biologiques et autres).
Un exemple très parlant de l’utilisation de la modélisation est la projection des feux de forêts. Cela permet de prédire comment le changement climatique influe sur l’intensité, la durée des saisons des feux, leurs étendues. Ces modélisations sont d’autant plus importantes car elles permettent aussi d’identifier des forêts jusque-là épargnées, mais qui avec le changement climatique, seront touchées.
Une fois que les risques d’incendie sont estimés, il est possible d’allier ces prédictions avec les observations de terrain : quelles espèces sont présentes ? Sont-elles adaptées aux feux ? Des simulations permettent aussi d’examiner l’implantation et l’extinction de différentes espèces en relation avec les feux et l’environnement.
De manière générale, les modèles sont adaptables à différents écosystèmes (forêts, prairies, lac, océans…), espèces modèles, climats (tempérés, tropicaux…). Avec l’avancée de nos technologies, ces modèles deviennent toujours plus performants. Bien que complexes, ces méthodes sont des outils puissants pour explorer les conséquences du changement climatique et laissent la porte ouverte à tout un champ des possibles.
Quelle que soit l’approche utilisée par les chercheurs, tous ces outils et méthodes sont complémentaires. Chacun apporte une pierre à l’édifice dans la construction d’une connaissance scientifique opérationnelle pour l’atténuation des causes du changement climatique et l’adaptation face à ses effets déjà observables.
Les auteurs ne travaillent pas, ne conseillent pas, ne possèdent pas de parts, ne reçoivent pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'ont déclaré aucune autre affiliation que leur organisme de recherche.
