02.11.2025 à 08:55
Pourquoi la France, malgré la dégradation de sa note par les agences financières, reste emprunteuse « sans risque » pour les régulateurs ?
Texte intégral (1828 mots)

Malgré la dégradation de la note de la France de AA- à A+ en septembre 2025 par l’agence Fitch, puis en octobre 2025 par Standard & Poor’s, l’Hexagone est toujours considéré comme un emprunteur « sans risque » dans les bilans des banques et des assureurs. Pourquoi ce décalage ?
Vendredi 12 septembre 2025, Fitch a dégradé la note de la France de AA- à A+, après la clôture des marchés. Symboliquement, c’est un coup dur. Pour la première fois depuis plus de dix ans, la France a perdu son badge « double A ». Et pourtant, le lundi suivant, rien n’avait changé : le CAC 40 était en hausse et les spreads de crédit de la France étaient stables.
Rebelote un mois plus tard : le 18 octobre, Standard & Poor’s (S&P) abaisse à son tour la note de la France à A+. Là encore, aucune réaction notable des marchés – ni sur les spreads obligataires ni sur l’indice CAC 40. Le 24 octobre, Moody’s a pour sa part placé la note AA- de la France sous perspective négative.
L’explication courante ? Les marchés avaient déjà anticipé ces décisions. Mais est-ce vraiment toute l’histoire ?
Dans cet article, nous expliquons pourquoi, tant dans le cadre de la réglementation bancaire (Capital Requirements Regulation, CRR) relative aux exigences de fonds propres, que de la réglementation des assurances (Solvency II), la France est toujours considérée comme un emprunteur entrant dans la définition d’un pays « sans risque ».
Cela peut aider à comprendre l’impact limité jusqu’à présent des dégradations successives de Fitch et de Standard & Poor’s, tout en soulignant que les mécanismes bancaires et assurantiels à l’œuvre peuvent soudainement se transformer en couperet.
Notations vs échelons
Dans le cadre des approches standardisées, les réglementations prudentielles européennes (2024/1820 et 2024/1872 essentiellement) ne fonctionnent pas directement avec des notations alphabétiques, mais s’appuient sur des credit quality step (CQS), soit des échelons de qualité de crédit. Ces échelons sont des catégories générales qui regroupent plusieurs notations :
– CQS 0 : AAA (Solvency II uniquement ; le CRR ne comporte pas de niveau 0), comme l’Allemagne, la Suisse, le Danemark, les Pays-Bas ou la Suède.
– CQS 1 : AAA à AA- (CRR)/CQS 1 et AA+ à AA- (Solvency II), comme l’Autriche, la Finlande, l’Estonie, la Belgique ou la République tchèque.
– CQS 2 : A+ à A-, comme la Slovénie, la Slovaquie, la Pologne, la Lituanie ou la Lettonie.
– CQS 3 : BBB+ à BBB-, comme l’Italie, la Roumanie, la Bulgarie, la Croatie, ou la Hongrie.
– CQS 4-6 : notations spéculatives (BB+ et inférieures), comme la Serbie, le Monténégro, la Macédoine du Nord ou le Kosovo.
Techniquement, selon les réglementations bancaires et assurantielles, la dégradation de la note de la France par Fitch en septembre 2025 aurait pu la faire passer de CQS 1 à CQS 2. Mais ce n’est pas le cas.
Jusqu’en octobre 2025, date de la dégradation de la note française par Standard & Poor’s, ces deux cadres réglementaires continuaient de traiter la France comme un émetteur de très haute qualité, c’est-à-dire « AA » et non « A ». Cela tient à la manière dont les réglementations traitent les notes multiples : ni les banques ni les assureurs ne retiennent mécaniquement la note la plus basse.
Règle de la deuxième meilleure notation
En vertu de la réglementation bancaire et assurantielle européenne, la règle de la deuxième meilleure notation s’applique.
Par exemple, si un débiteur est noté par trois agences (S&P, Moody’s, Fitch), les notations la plus élevée et la plus basse sont écartées, et celle du milieu est retenue. Tant que deux des trois agences maintenaient la France dans la catégorie AA, la notation de référence aux fins du capital réglementaire restait CQS 1.
À lire aussi : Moody’s, Standard & Poor’s, Fitch… plongée au cœur du pouvoir des agences de notation
En d’autres termes, même après la dégradation par Fitch à A+, les régulateurs continuaient de classer la France comme « AA ». Ce n’est qu’après la dégradation par S&P, le 17 octobre 2025, que la France est effectivement passée en CQS 2. Moody’s, de son côté, a maintenu sa note AA-, mais l’a placée sous perspective négative le 24 octobre – un signal d’alerte, certes, mais sans conséquence réglementaire à ce stade.
Toutes les dégradations ne se valent pas. Certaines modifient immédiatement la manière dont les institutions financières européennes doivent traiter le risque. D’autres, en revanche, restent sans effet opérationnel. Et pourtant, aucune n’a véritablement fait réagir les marchés.
Illusion réglementaire de la sécurité
Pour la plupart des débiteurs, tels que les entreprises ou les institutions financières, le passage d’un échelon de qualité de crédit, ou credit quality step (CQS), à un autre a une incidence directe sur les exigences de fonds propres. Dans le cas particulier des États souverains européens, même un passage officiel au CQS 2 n’a guère d’importance.
En vertu des règles actuelles, les obligations souveraines de l’Union européenne libellées dans leur propre devise ont en effet une pondération de risque de 0 %. Pourquoi ?
Dans la pratique, les banques ne sont pas tenues de mettre de côté des fonds propres pour couvrir le risque de défaut des emprunts de la France libellés en euros, et ce, quelle que soit la note attribuée à cette dette par les agences de notation.
De même, les assureurs qui détiennent des obligations émises par les États de l’Union européenne (libellées dans leur propre monnaie) ne sont soumis à aucune exigence de capital pour se prémunir contre un éventuel défaut de paiement sur ces titres.
Les seules exigences de fonds propres pour ces obligations proviennent des risques dits « de marché » : le risque de taux d’intérêt, c’est-à-dire la perte potentielle liée à une hausse des taux, et le risque de change, en cas de variation défavorable des devises étrangères. Aucun capital n’est exigé au titre du spread de crédit, c’est-à-dire du risque que le marché exige une prime plus élevée pour prêter à l’État.
Les prêts à la France – ou à tout autre État souverain européen dans sa monnaie nationale – sont considérés comme sans risque de crédit. Ce cadre a été conçu pour éviter la fragmentation et traiter la dette publique de tout État membre européen comme la base du système financier, quelle que soit la situation individuelle de chaque pays.
Paradoxe systémique
Les marchés font bien sûr déjà la distinction entre les États souverains. Les écarts se creusent, les prix des credit defaut swaps (CDS) – qui permettent aux investisseurs de s’assurer contre le défaut d’un émetteur de dette – augmentent et les investisseurs exigent une prime pour les crédits les plus faibles, bien avant que la dégradation ne soit officielle.
Du point de vue des fonds propres réglementaires, le cadre existant ne laisse aucune place à une distinction progressive au sein de l’Union européenne. La conséquence est claire : les États souverains européens sont considérés comme « sûrs » par définition, jusqu’à ce qu’ils ne le soient plus…
Cela crée une sorte d’« effet de falaise » organique. Tant que la confiance institutionnelle reste suffisante, la réglementation atténue partiellement la reconnaissance du risque. Dès qu’un seuil est franchi – souvent un seuil de confiance, plutôt que purement comptable –, la correction devient brutale. Ce qui devrait être une réévaluation progressive se transforme en rupture systémique.
Il y a quinze ans, la crise de la dette publique en Grèce avait suffi à déclencher une crise à l’échelle européenne. Aujourd’hui, la France nous rappelle que l’architecture même de la réglementation européenne rend sa stabilité financière moins graduelle que binaire. Tant que les marchés y croient, tout tient. Mais si la confiance venait à se dérober, ce n’est pas seulement la France qui vacillerait – ce serait toute l’Europe.
Rémy Estran est président de l'EACRA (European Association of Credit Rating Agencies).
01.11.2025 à 19:48
Délibération budgétaire : le lent apprentissage de la démocratie parlementaire
Texte intégral (1688 mots)
Avec le renoncement au 49.3, des discussions budgétaires inédites ont lieu entre groupes politiques à l’Assemblée nationale : le Parlement redevient un lieu de débats décisifs. Est-ce là une nouvelle étape dans le « réapprentissage » de la délibération parlementaire selon des standards européens ?
Après l’éclatement rapide de son gouvernement initial, le premier ministre Sébastien Lecornu est parvenu à survivre aux premières motions de censure déposées contre lui le 16 octobre en échange de deux engagements principaux envers la gauche – le Parti socialiste en particulier : la suspension de la réforme des retraites et le renoncement à l’article 49.3 de la Constitution.
Cette situation ouvre la voie à une vraie expérience de délibération parlementaire. De fait, les débats budgétaires à l’Assemblée nationale depuis le début de la session offrent un spectacle inhabituel : des députés mobilisés et nombreux, des chefs de partis très présents, des négociations pratiquées en pleine séance ou pendant les suspensions entre des blocs opposés… Le Parlement redevient un lieu de débats décisifs. Néanmoins, les chances de succès des discussions budgétaires sont minces et l’apprentissage du parlementarisme « à l’européenne » prend du temps.
Un budget dépendant des aléas de la délibération parlementaire
La décision de Sébastien Lecornu de renoncer à l’article 49.3 semblait s’imposer au premier ministre : en l’absence de majorité, cet article n’est plus une arme à toute épreuve pour le gouvernement, comme l’a démontré la censure de Michel Barnier en décembre 2024. Reste que la construction d’un compromis budgétaire par l’Assemblée nationale est très incertaine.
Le 49.3 offre en principe deux avantages principaux au premier ministre. D’une part, il dispense d’un vote sur le texte de loi lui-même – remplacé par un éventuel vote de censure. D’autre part, il lui permet de conserver le texte dans la version de son choix, avec les amendements déposés ou acceptés par lui. Il peut alors présenter à l’Assemblée nationale un choix de « tout ou rien », c’est-à-dire un budget à laisser passer tel quel ou à rejeter en bloc par la censure.
En l’absence de cette arme et pour la première fois depuis 2021, le projet de loi de finances (PLF) et le projet de loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS) dépendent donc des débats à l’Assemblée nationale. À partir du texte initial déposé par le gouvernement (rectifié pour inclure la suspension de la réforme des retraites), le texte final résultera des votes des députés sur chaque article et chaque amendement déposé. Cela implique de trouver une majorité de suffrages exprimés favorables à chaque disposition pour que celle-ci figure dans le texte de l’Assemblée nationale.
Le droit d’amendement des députés et les discussions parlementaires restent certes enserrés de contraintes, entre la recevabilité financière des amendements déposés par les élus (exigée par l’article 40 de la Constitution), la possibilité pour le gouvernement d’imposer un vote unique sur un ensemble de dispositions (procédure du « vote bloqué » de l’article 44.3) et la poursuite de la navette parlementaire à laquelle participera le Sénat. Il n’en reste pas moins que les députés auront le dernier mot et qu’une majorité de votes « pour » à l’Assemblée nationale sera nécessaire à l’adoption du texte. Autrement dit, l’adoption du PLF et du PLFSS par le Parlement nécessitera le vote « pour » d’au moins une partie des groupes d’opposition, et non pas seulement leur abstention.
Toute la difficulté est donc de trouver le point d’équilibre – s’il existe – qui fasse le moins mal possible à des groupes d’opposition pour leur permettre d’assumer de voter le texte – de revendiquer des victoires malgré les concessions.
Le risque est donc grand que les débats dans l’hémicycle aboutissent plutôt, que ce soit sur chaque article ou sur le texte final, à des majorités « négatives » qui coalisent les votes « contre » de plusieurs groupes, parfois pour des raisons opposées. Les différents blocs parlementaires pourraient donc rejeter mutuellement leurs propositions sans parvenir à un accord majoritaire – une issue fort vraisemblable.
L’absence persistante d’un vrai accord préalable
Devant la crise politique qui s’éternise depuis l’été 2024, les pratiques évoluent doucement. L’importance prise par les négociations entre Sébastien Lecornu et le Parti socialiste et les vraies concessions annoncées par le premier ministre vont bien plus loin que ce que François Bayrou avait pu tenter. Mais les pratiques françaises ne rejoignent pas encore les standards des pratiques européennes.
L’adoption des lois budgétaires nécessiterait un compromis global préalable, même a minima, entre le gouvernement, les groupes minoritaires – principalement LR – et une partie des groupes d’opposition – le PS étant a priori le plus ouvert à cet égard. Un tel compromis global devrait fixer les grands équilibres et les principales concessions que les parties prenantes s’engagent à se faire mutuellement, quitte à se faire violence.
Dans les régimes parlementaires européens plus habitués à la négociation parlementaire et à la construction de coalitions post-électorales – dont l’Allemagne est l’exemple le plus évident – la pratique la plus courante consiste à mettre au clair, avant les débats au Parlement proprement dits, un accord entre forces politiques. Les gouvernements de coalition les plus durables sont, sans surprise, ceux qui s’appuient sur un « contrat de coalition » le plus complet et détaillé possible. Dans ce cas, les parlementaires peuvent devoir voter des textes qui leur déplaisent, mais le font pour remplir leur part du « contrat de coalition », en échange de la même discipline de la part de leurs partenaires pour les dispositions qui leur tiennent à cœur.
Lorsque les partis partenaires ne parviennent pas à se mettre d’accord au préalable sur certains sujets plus clivants, ils se mettent d’accord sur un renvoi ultérieur du débat et sur des procédures pour trancher les désaccords – par exemple en prévoyant un « comité de coalition » réunissant les membres des directions partisanes et chargé d’arbitrer le moment venu lorsqu’une décision doit être prise. Des procédures visant à éviter les mauvaises surprises et ne pas s’en remettre à l’incertitude des rapports de force en assemblée ou à la cacophonie gouvernementale.
La France est encore loin d’avoir institutionnalisé un mode de fonctionnement parlementaire fondé sur la négociation et le compromis. Aucun accord formel et encore moins de contrat de législature n’existe entre le gouvernement et les groupes minoritaires et d’opposition – pas plus qu’il n’en a existé entre les partenaires de la défunte coalition du « socle commun ».
Une adoption du budget très improbable
À cet égard, il est très révélateur que l’annonce de la suspension de la réforme des retraites par le premier ministre, la plus importante concession faite au PS en échange de sa non-censure, n’engage pas automatiquement sa propre base parlementaire, puisque les députés Renaissance sont divisés sur le vote de ce compromis, mollement défendu par le président Macron, et que la position collective du groupe s’est orientée vers un refus de la voter, quitte à mettre en péril l’adoption du PLFSS.
Elle engage encore moins les parlementaires LR : le président du Sénat Gérard Larcher a déjà annoncé que la droite sénatoriale supprimerait la suspension de la réforme des retraites. À tout cela s’ajoute les désaccords apparemment irréductibles entre PS et LR sur la fiscalité et notamment la taxation des plus riches, alors qu’une version même « allégée » de la taxe Zucman est exigée par les socialistes.
L’absence d’accord de compromis préalable sur au moins quelques grandes mesures, acceptées par une majorité de groupes parlementaires, donne certes tout son intérêt à la délibération dans l’hémicycle, mais laisse très incertaine, pour ne pas dire très improbable, l’adoption d’un budget pour l’État et la Sécurité sociale. Le processus d’adaptation de la politique française à l’absence de majorité à l’Assemblée nationale est donc loin d’être terminé.
Damien Lecomte ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
01.11.2025 à 10:04
Ce que la taille de votre signature révèle vraiment de vous
Texte intégral (1674 mots)
Et si la taille de votre signature trahissait votre personnalité ? Loin d’être anodines, ces quelques lettres griffonnées à la hâte sur un chèque ou sous un contrat permettent de mieux comprendre le pouvoir, l’estime de soi et les dérives narcissiques.
Depuis des années, la signature de Donald Trump – large, anguleuse et spectaculaire – attire l’attention du public. On a récemment découvert qu’elle figurait dans un livre offert à Jeffrey Epstein pour son cinquantième anniversaire, mais elle s’inscrit surtout dans la longue tradition d’autocélébration tapageuse de l’ancien président. « J’adore ma signature, vraiment », a-t-il déclaré, le 30 septembre 2025, devant des responsables militaires. « Tout le monde adore ma signature. »
Cette signature présente pour moi un intérêt particulier, en raison de ma fascination de longue date – et de mes recherches occasionnelles – sur le lien entre la taille des signatures et les traits de personnalité. Chercheur en psychologie sociale m’étant fait une spécialité des élites américaines, j’ai réalisé une découverte empirique involontaire il y a plus de cinquante ans, alors que j’étais encore étudiant. Le lien que j’avais observé à l’époque – et que de nombreuses recherches sont venues confirmer depuis – est que la taille d’une signature est liée au statut social et à la perception de soi.
Taille de la signature et estime de soi
En 1967, lors de ma dernière année d’université, je travaillais à la bibliothèque de psychologie de l’Université Wesleyan (Connecticut) dans le cadre d’un emploi étudiant. Quatre soirs par semaine, ma mission consistait à enregistrer les prêts et à ranger les livres rendus.
Quand les étudiants ou les professeurs empruntaient un livre, ils devaient inscrire leur nom sur une fiche orange, sans lignes, glissée à l’intérieur de l’ouvrage. À un moment, j’ai remarqué un schéma récurrent : les professeurs prenaient beaucoup de place pour signer, leurs lettres occupant presque toute la carte. Les étudiants, eux, écrivaient en petit, laissant largement de la place pour les lecteurs suivants. J’ai alors décidé d’étudier cette observation de façon plus systématique.
J’ai rassemblé au moins dix signatures pour chaque membre du corps enseignant, ainsi qu’un échantillon comparable de signatures d’étudiants dont les noms comptaient le même nombre de lettres. Après avoir mesuré la surface occupée – en multipliant la hauteur par la largeur de la zone utilisée –, j’ai constaté que huit professeurs sur neuf utilisaient nettement plus d’espace pour signer leur nom.
Afin de tester l’effet de l’âge autant que celui du statut, j’ai mené une autre étude : j’ai comparé les signatures de personnes occupant un emploi manuel – agents d’entretien, jardiniers, personnel technique de l’université – avec celles d’un groupe de professeurs et d’un groupe d’étudiants, toujours en égalisant le nombre de lettres et en utilisant cette fois des cartes vierges de 3 pouces sur 5 (7,6 cm sur 12,7 cm.). Le premier groupe prenait plus de place que les étudiants, mais moins que les enseignants. J’en ai conclu que l’âge jouait un rôle, mais aussi le statut social.
Quand j’ai raconté mes résultats au psychologue Karl Scheibe, mon professeur préféré, il m’a proposé de mesurer les signatures figurant dans ses propres livres – celles qu’il apposait depuis plus de dix ans, depuis sa première année d’université.
Comme on peut le voir sur le graphique, la taille de ses signatures a globalement augmenté au fil du temps. Elles ont connu un net bond entre sa troisième et sa dernière année d’études, ont légèrement diminué lorsqu’il est entré en doctorat, puis ont de nouveau grandi lorsqu’il a achevé sa thèse et rejoint le corps enseignant de Wesleyan.
J’ai ensuite mené plusieurs autres études et publié quelques articles, concluant que la taille de la signature était liée à l’estime de soi ainsi qu’à une mesure de ce que j’ai appelé la « conscience du statut ». J’ai constaté que ce schéma se vérifiait dans divers contextes, y compris en Iran, où l’écriture se lit pourtant de droite à gauche.
Le lien avec le narcissisme
Même si mes recherches ultérieures ont donné lieu à un livre sur les PDG des entreprises du classement Fortune 500, il ne m’était jamais venu à l’esprit d’étudier leurs signatures. Quarante ans plus tard, d’autres chercheurs y ont pensé. En mai 2013, j’ai reçu un appel de la rédaction du Harvard Business Review à propos de mes travaux sur la taille des signatures. Le magazine prévoyait de publier une interview de Nick Seybert, professeur associé de comptabilité à l’université du Maryland, sur le lien possible entre la taille des signatures et le narcissisme chez les PDG.
Seybert m’avait expliqué que ses recherches n’avaient pas permis d’établir de lien direct entre les deux, mais l’idée d’une possible corrélation qu’il avançait a tout de même éveillé ma curiosité. J’ai donc décidé de la tester auprès d’un échantillon de mes étudiants. Je leur ai demandé de signer une carte vierge comme s’ils rédigeaient un chèque, puis je leur ai fait passer un questionnaire de 16 questions couramment utilisé pour mesurer le narcissisme.
Et, surprise : Seybert avait raison de supposer un lien. Il existait bien une corrélation positive significative entre la taille de la signature et le narcissisme. Mon échantillon était certes modeste, mais ce résultat a incité Seybert à reproduire l’expérience auprès de deux autres groupes d’étudiants – et il a obtenu la même corrélation positive significative.
D’autres chercheurs ont rapidement commencé à utiliser la taille de la signature pour évaluer le narcissisme chez les PDG. En 2020, l’intérêt croissant pour le sujet a conduit le Journal of Management à publier un article qui recensait la taille de la signature parmi cinq indicateurs possibles du narcissisme chez les dirigeants d’entreprise.
Un champ de recherche en expansion
Aujourd’hui, près de six ans plus tard, les chercheurs utilisent la taille de la signature pour étudier le narcissisme chez les PDG et d’autres cadres dirigeants, comme les directeurs financiers. Ce lien a été observé non seulement aux États-Unis, mais aussi au Royaume-Uni, en Allemagne, en Uruguay, en Iran, en Afrique du Sud et en Chine.
Par ailleurs, certains chercheurs se sont penchés sur l’effet que produisent, sur les observateurs, des signatures plus grandes ou plus petites. Par exemple, dans un article récent du Journal of Philanthropy, des chercheurs canadiens ont rendu compte de trois expériences faisant varier systématiquement la taille de la signature d’une personne sollicitant des dons, afin d’évaluer si cela influençait le montant des contributions. Et c’était bien le cas : dans l’une de leurs études, ils ont montré qu’agrandir la signature de l’expéditeur générait plus du double de recettes.
Le retour inattendu des recherches utilisant la taille de la signature pour évaluer le narcissisme m’amène à plusieurs conclusions. D’abord, cette mesure de certains aspects de la personnalité s’avère bien plus solide que je ne l’aurais imaginé, lorsque je n’étais qu’un étudiant curieux travaillant dans une bibliothèque universitaire en 1967.
En réalité, la taille de la signature n’est pas seulement un indicateur de statut ou d’estime de soi, comme je l’avais conclu à l’époque. Elle constitue aussi, comme le suggèrent les études récentes, un signe de tendances narcissiques – du type de celles que nombre d’observateurs prêtent à la signature ample et spectaculaire de Donald Trump. Nul ne peut dire quelle direction prendra cette recherche à l’avenir – pas même celui qui, il y a tant d’années, avait simplement remarqué quelque chose d’intrigant dans la taille des signatures.
Richie Zweigenhaft ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
30.10.2025 à 15:50
Gouvernement Lecornu : les enjeux d’une nouvelle décentralisation
Texte intégral (2012 mots)
Sébastien Lecornu a donné jusqu’à ce 31 octobre aux élus locaux pour lui remettre des propositions relatives à la décentralisation. Alors qu’Emmanuel Macron a plutôt « recentralisé » depuis 2017, son nouveau premier ministre promet un « grand acte de décentralisation » visant à redéfinir le partage – souvent confus – des compétences entre les acteurs (État, régions, départements, métropoles, communes, intercommunalités…). Une telle ambition est-elle crédible alors que le gouvernement envisage un budget d’austérité impactant lourdement les collectivités territoriales ?
La décentralisation est l’un des principaux chantiers annoncés par le premier ministre Sébastien Lecornu avant sa démission du 6 octobre et qui a été réaffirmé dès la constitution de son second gouvernement. Depuis l’élection d’Emmanuel Macron à la présidence de la République en 2017, aucune loi n’a poursuivi les trois premiers actes de décentralisation (1982, 2004, 2015). Des formes d’organisation locales et hétérogènes se sont multipliées.
Dans sa déclaration de politique générale, le chef du gouvernement entend mettre fin à cette hétérogénéité en clarifiant le partage des compétences entre l’État et les collectivités. Mais une « rupture » avec la décentralisation telle qu’observée aujourd’hui est-elle possible ?
Décentraliser le pouvoir en France, une histoire longue
On sait que la France est un pays historiquement centralisé, des Capétiens à la monarchie absolue, de la révolution jacobine à la Ve République. L’État hérité de la féodalité est d’abord demeuré centré sur des fonctions dites « régaliennes » : l’armée, la fiscalité, la diplomatie, la police ou la justice, avec, en son cœur, un appareil administratif professionnalisé. À l’ère moderne, l’État s’adosse à la nation, et poursuit sa croissance indépendamment du régime politique (monarchie, république, empire). Il faut pourtant signaler que ce qu’on appelle « l’État-providence » s’est en grande partie développé localement, les initiatives territoriales étant parfois reprises et généralisées par le centre, dès le Second Empire et la IIIᵉ République, dans le domaine de l’assistance et de l’action sociale.
Pourtant, depuis plus de quarante ans, une politique de décentralisation est à l’œuvre. Les trois premières étapes ou premiers moments, que l’on appelle « actes » pour leur donner la puissance de l’action, ont profondément modifié le système de pouvoir et d’action publique. D’abord, au début des années 1980, des régions autonomes ont été créées et les échelons communaux et départementaux renforcés, ces trois collectivités disposant de conseils élus. La fonction publique territoriale est également créée.
En 2003-2004, le second acte a renforcé l’autonomie des collectivités tout en transférant certaines compétences, telle la politique sociale, transférée au département, pleinement responsable. D’aucuns y ont vu l’apparition d’un « département-providence ».
Quant au dernier acte en date, il remonte au quinquennat du socialiste François Hollande : regroupement des régions pour atteindre une taille critique, affirmation des métropoles, clarification du partage de compétences.
Parallèlement à ce processus, l’État n’a cessé de revoir son ancrage territorial, depuis les années 1990. La réforme de l’administration territoriale de l’État (dite RéATE), en 2007, a régionalisé l’action de l’État. À la suite de la crise des gilets jaunes (2018-2019), le gouvernement a déployé une réorganisation territoriale discrète, renforçant l’articulation interministérielle et le rôle du préfet.
En revanche, depuis 2017, la décentralisation n’a plus bougé. Emmanuel Macron n’en a pas fait un axe structurant de ses mandats – lesquels sont même perçus comme recentralisateurs.
Des formes locales très différentes ont finalement proliféré, questionnant le principe initial d’une République « une et indivisible ». Que l’on pense au sinueux bâtissage de la métropole du Grand Paris, aux spécificités des métropoles d’Aix-Marseille ou de Lyon, à la communauté européenne d’Alsace qui a uni, en 2021, deux départements historiques, aux intercommunalités rurales souvent indispensables, au regroupement de communes, au statut spécifique de la Corse intégrée depuis 1768 ou encore à Mayotte refondée en 2025 et à la Nouvelle-Calédonie, dont le statut est actuellement négocié.
Sébastien Lecornu a choisi de remettre en ordre cette nature proliférante, résultant à la fois de la réorganisation de l’État localement et de la décentralisation.
Une « rupture » dans le modèle de partage des compétences ?
Dans sa déclaration de politique générale, le premier ministre a assumé sa volonté de « rupture », clé de la légitimité de son gouvernement et des réformes nécessaires au redressement de la France. S’agit-il également d’une rupture avec l’arrêt de la décentralisation sous Emmanuel Macron ? Pour Sébastien Lecornu, la décentralisation ne doit plus suivre l’ancienne logique de rationalisation et de délégation. Il déclare ainsi :
« Je proposerai un principe simple, celui de l’identification d’un seul responsable par politique publique. Il s’agira soit d’un ministre, soit d’un préfet, soit d’un élu. Il ne faut pas décentraliser des compétences. Il faut décentraliser des responsabilités, avec des moyens budgétaires et fiscaux et des libertés, y compris normatives. »
Si le gouvernement semble tout adéquat pour les politiques régaliennes et les préfets pour leur déploiement, quels élus locaux seront responsables ? Le principe d’un décideur par politique publique imposerait de repenser l’ensemble de l’action publique – c’est un chantier pharaonique.
Car malgré les trois actes de décentralisation, les compétences ne sont pas à ce jour clairement réparties : quel citoyen pourrait clairement savoir à quel niveau de gouvernement s’adresser selon sa demande ? Le rapport Ravignon (2024) évoque une « grande confusion » des citoyens devant cette complexité. Il montre aussi que de nombreuses politiques publiques sont éclatées et dépendent parfois de trois acteurs ou plus, comme le tourisme, la culture ou le développement économique. Cela est également visible dans l’aménagement du territoire, où les évolutions dépendent de l’État, de la stratégie régionale et des départements, voire des intercommunalités et des communes.
Pour certaines politiques, on assiste même à une concurrence entre autorités publiques. Les communes (ainsi que certaines métropoles) disposent de la clause générale de compétences, qui leur permet de toucher à tout sujet dont elles souhaitent s’emparer. On les retrouve ainsi intervenant là où le font déjà l’État (logement, transition écologique…), les régions (développement économique, tourisme…) ou les départements (culture, insertion…).
Notons, par ailleurs, la montée en puissance des métropoles qui s’est faite de manière discrète, notamment par le biais des politiques d’aménagement. Créées en 2010 et généralisées en 2014, désormais au nombre de 21, elles tendent à devenir la nouvelle frontière de l’État-providence, c’est-à-dire l’espace où la modernisation du système social se réalise en regroupant un large éventail de compétences. C’est encore plus vrai lorsque les compétences sociales du département sont intégrées à cet éventail, comme dans le cas de Lyon ou de Paris.
On comprend mieux pourquoi le rapport Woerth de 2024 proposait de recentrer l’action des métropoles. Les compétences sociales, qui représentent une lourde charge, restent principalement à la charge des départements, expliquant souvent leurs problèmes financiers, comme dans le cas emblématique de la Seine-Saint-Denis, soutenue directement par l’État. Une clarification sur ce sujet deviendrait nécessaire, d’autant plus que les départements continuent d’investir le développement économique (pourtant responsabilité de la région depuis l’acte III de la décentralisation, en 2015).
Le regroupement de communes et d’intercommunalités mériterait également de se poursuivre, notamment en zone rurale. Si Matignon souhaite un recentrage de l’État sur les fonctions régaliennes, la question du retrait de l’État de politiques qu’il tend à réinvestir, comme l’urbanisme ou la lutte contre la pauvreté, se pose également. Cela supposera également de penser une nouvelle étape de déconcentration.
Enfin, certaines compétences méritent d’être mieux organisées pour faire face à des défis qui ne feront qu’augmenter dans les années et décennies à venir, à l’instar du grand âge. Mais une telle clarification ne saurait se faire sans base financière durable.
La décentralisation en contexte de crise budgétaire
Pour la première fois, le chantier de la décentralisation revient avec grande ambition, à l’heure de la crise budgétaire. Devant le Sénat, Sébastien Lecornu a affirmé que « le grand acte de décentralisation » s’inscrivait pleinement dans cette problématique financière, qui vient en justifier l’urgence également.
S’il y a « rupture », ce serait dans l’idée que seul un transfert massif « des responsabilités » aux collectivités pourra garantir la hausse des moyens des fonctions régaliennes de l’État, alors que l’effort financier demandé aux collectivités représente au moins 4,6 milliards d’euros selon le gouvernement, mais jusque 8 milliards d’euros selon les élus locaux. Face à cet impératif budgétaire, une décentralisation poussée, de « rupture » est-elle envisageable ? Le projet de loi à venir, vraisemblablement début 2026, saura éclairer ces aspects.
Tommaso Germain ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
29.10.2025 à 15:49
Avec les restrictions d’âge sur les réseaux sociaux, Internet entre-t-il dans une nouvelle ère de contrôle moral ?
Texte intégral (1595 mots)
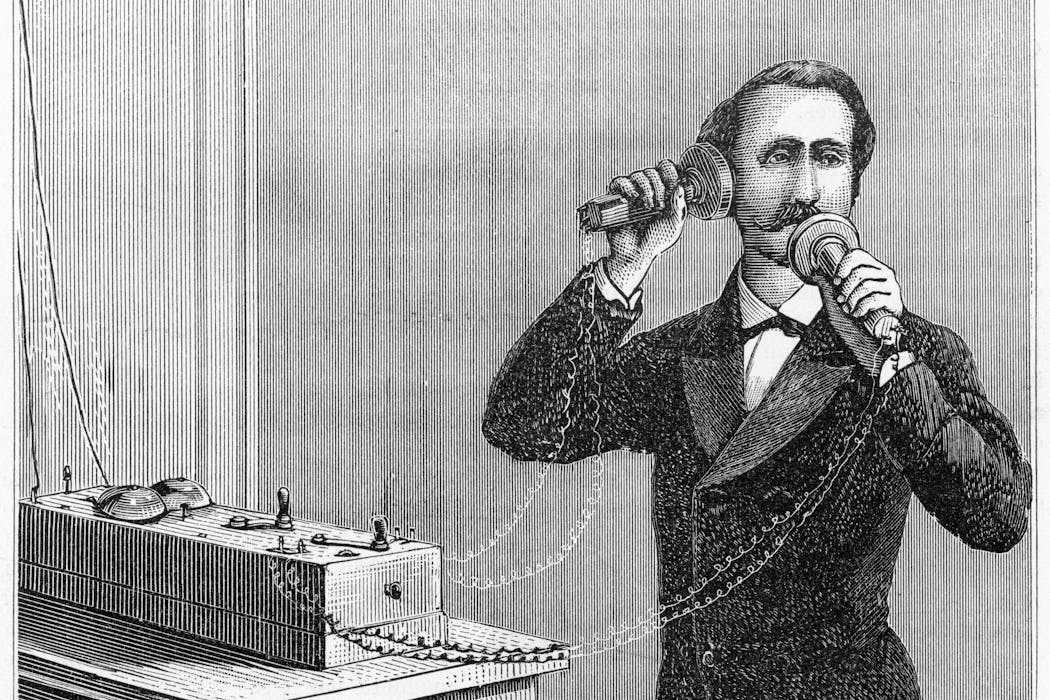
De l’Australie au Danemark, les projets d’interdire TikTok ou Instagram aux adolescents se multiplient. Derrière les arguments de protection des mineurs, ces restrictions d’âge sur les réseaux sociaux traduisent un tournant culturel et moral.
Une vague de projets d’interdictions des réseaux sociaux aux plus jeunes déferle à travers le monde, nourrie par l’inquiétude croissante face aux effets supposés de TikTok, Instagram ou Snapchat sur des esprits jugés vulnérables.
L’Australie a été la première à annoncer des restrictions visant les moins de 16 ans. La Nouvelle-Zélande pourrait bientôt emboîter le pas et au Danemark, la première ministre a déclaré vouloir interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans, accusant téléphones et plateformes de « voler l’enfance de nos enfants ».
Le Royaume-Uni, la France (le rapport parlementaire, publié en septembre 2025, préconise d’interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans ainsi qu’un couvre-feu numérique pour les 15-18 ans, de 22 heures à 8 heures, ndlt), la Norvège, mais aussi le Pakistan et les États-Unis envisagent ou mettent en place des mesures similaires, souvent conditionnées à un consentement parental ou à une vérification d’identité numérique.
À première vue, ces politiques visent à protéger la jeunesse des risques, pour la santé mentale, d’exposition à des contenus explicites ou de ceux de mécanismes addictifs. Mais derrière le vocabulaire de la sécurité se dessine autre chose : un basculement des valeurs culturelles.
Ces interdictions traduisent une inflexion morale, au risque de ressusciter des conceptions conservatrices qui précèdent Internet. Sommes-nous en train d’entrer dans une nouvelle ère victorienne du numérique, où la vie en ligne des jeunes serait remodelée non seulement par la régulation, mais aussi par un regain de contrôle moral ?
Un discours sur le déclin moral
L’époque victorienne se caractérisait par des codes sociaux rigides, une morale stricte et un contrôle serré des comportements, l’école jouant un rôle central dans la transmission des hiérarchies sociales et genrées. On en retrouve aujourd’hui des échos dans le discours sur le « bien-être numérique ». Applications de suivi du temps d’écran, cures de « détox digitale » ou téléphones simplifiés sont présentés comme des moyens de cultiver une vie connectée « saine » – souvent sur fond de morale implicite. L’utilisateur idéal est calme, concentré, mesuré ; l’utilisateur impulsif ou expressif est pathologisé.
Cette vision est notamment popularisée par le psychologue Jonathan Haidt, auteur de The Anxious Generation (2024), devenu une référence du mouvement en faveur des restrictions d’âge. Selon lui, les réseaux sociaux accentuent les comportements performatifs et la dysrégulation émotionnelle chez les jeunes. La vie numérique des adolescents est ainsi décrite comme un terrain de fragilisation psychologique, de polarisation accrue et d’effritement des valeurs civiques communes.
Vu sous cet angle, la vie numérique des jeunes se traduit par une résilience psychologique en déclin, par une polarisation croissante et par l’érosion des valeurs civiques communes, plutôt que par un symptôme de mutations complexes. Cela a contribué à populariser l’idée que les réseaux sociaux ne sont pas seulement nocifs mais corrupteurs.
Mais ces thèses font débat. De nombreux chercheurs soulignent qu’elles reposent sur des corrélations fragiles et sur des interprétations sélectives. Certaines études établissent un lien entre usage intensif des réseaux sociaux et troubles anxieux ou dépressifs, mais d’autres montrent des effets modestes, variables selon les contextes, les plateformes et les individus. Surtout, ces analyses négligent la marge de manœuvre des jeunes eux-mêmes, leur capacité à naviguer dans les espaces numériques de façon créative, critique et sociale.
En réalité, la vie numérique des jeunes ne se résume pas à une consommation passive. C’est un espace de littératie, d’expression et de connexion. Des plateformes, comme TikTok et YouTube, ont favorisé une véritable renaissance de la communication orale et visuelle.
Les jeunes assemblent des mèmes, remixent des vidéos et pratiquent un montage effréné pour inventer de nouvelles formes de récit. Il ne s’agit pas de signes de déclin, mais de narrations en évolution. Réglementer leur accès sans reconnaître ces compétences, c’est risquer d’étouffer la nouveauté au profit du déjà-connu.
Réguler les plateformes, pas les jeunes
C’est ici que la comparaison avec l’ère victorienne a toute son utilité. De la même façon que les normes victoriennes visaient à maintenir un ordre social particulier, les restrictions d’âge actuelles risquent d’imposer une vision étroite de ce que devrait être la vie numérique.
En apparence, des termes comme celui de « brain rot » (pourrissement du cerveau) semblent désigner les effets nocifs d’un usage excessif d’Internet. Mais en pratique, les adolescents les emploient souvent pour en rire et pour résister aux pressions de la culture de la performance permanente.
Les inquiétudes autour des habitudes numériques des jeunes semblent surtout enracinées dans la peur d’une différence cognitive – l’idée que certains usagers seraient trop impulsifs, trop irrationnels, trop déviants. Les jeunes sont fréquemment décrits comme incapables de communiquer correctement, se cachant derrière leurs écrans et évitant les appels téléphoniques. Pourtant, ces changements reflètent des mutations plus larges dans notre rapport à la technologie. L’attente d’une disponibilité et d’une réactivité constantes nous attache à nos appareils d’une manière qui rend la déconnexion véritablement difficile.
Les restrictions d’âge peuvent atténuer certains symptômes, mais elles ne s’attaquent pas au problème de fond : la conception même des plateformes, construites pour nous faire défiler, partager et générer toujours plus de données.
Si la société et les gouvernements veulent vraiment protéger les jeunes, la meilleure stratégie serait sans doute de réguler les plateformes numériques elles-mêmes. Le juriste Eric Goldman qualifie l’approche fondée sur les restrictions d’âge de « stratégie de ségrégation et de répression » – une politique qui punit la jeunesse plutôt que de responsabiliser les plateformes.
On n’interdit pas aux enfants d’aller dans les aires de jeux, mais on attend de ces espaces qu’ils soient sûrs. Où sont les barrières de sécurité pour les espaces numériques ? Où est le devoir de vigilance des plateformes ?
La popularité croissante des interdictions de réseaux sociaux traduit un retour en force de valeurs conservatrices dans nos vies numériques. Mais la protection ne doit pas se faire au prix de l’autonomie, de la créativité ou de l’expression.
Pour beaucoup, Internet est devenu un champ de bataille moral, où s’affrontent des conceptions opposées de l’attention, de la communication et de l’identité. Mais c’est aussi une infrastructure sociale que les jeunes façonnent déjà par de nouvelles formes de narration et d’expression. Les en protéger reviendrait à étouffer les compétences et les voix mêmes qui pourraient nous aider à construire un futur numérique plus riche et plus sûr.
Alex Beattie reçoit des financements de la Royal Society Te Apārangi. Il est lauréat d’une bourse Marsden Fast Start.
