28.01.2026 à 14:43
Des fossiles datés de 773 000 ans éclairent l’histoire de nos origines
Texte intégral (1024 mots)
Le site de la grotte aux Hominidés à Casablanca, sur la côte atlantique du Maroc, offre l’un des registres de restes humains les plus importants d’Afrique du Nord. Il est connu depuis 1969 et étudié par des missions scientifiques impliquant le Maroc et la France. Ce site éclaire une période cruciale de l’évolution humaine : celle de la divergence entre les lignées africaines qui donneront nos ancêtres directs, les Néandertaliens en Europe et les Dénisoviens en Asie.
Une étude très récente publiée dans Nature décrit des fossiles d’hominines datés de 773 000 ans. Le groupe des hominines rassemble à toutes les espèces qui ont précédé la nôtre depuis la divergence de la lignée des chimpanzés. Ces fossiles (des vertèbres, des dents et des fragments de mâchoires) ont été découverts dans une carrière qui a fait l’objet de fouilles pendant de nombreuses années. Les découvertes les plus importantes et les plus spectaculaires ont eu lieu en 2008-2009. La raison pour laquelle ce matériel n’avait pas été révélé plus tôt à la communauté scientifique et au public est que nous n’avions pas de datation précise.
Comment cette découverte a-t-elle pu être réalisée ?
Grâce à l’étude du paléomagnétisme, nous avons finalement pu établir une datation très précise. Cette technique a été mise en œuvre par Serena Perini et Giovanni Muttoni de l’Université de Milan (Italie). Ces chercheurs s’intéressent à l’évolution du champ magnétique terrestre. Le pôle Nord magnétique se déplace au cours du temps, mais il y a aussi de très grandes variations : des inversions. À certaines époques, le champ devient instable et finit par se fixer dans une position inverse de la précédente. Ce phénomène laisse des traces dans les dépôts géologiques sur toute la planète.
Certaines roches contiennent des particules sensibles au champ magnétique, comme des oxydes de fer, qui se comportent comme les aiguilles d’une boussole. Au moment où ces particules se déposent ou se fixent (dans des laves ou des sédiments), elles « fossilisent » l’orientation du champ magnétique de l’époque. Nous connaissons précisément la chronologie de ces inversions passées du champ magnétique terrestre et, dans cette carrière marocaine, nous avons identifié une grande inversion datée de 773 000 ans (l’inversion Brunhes-Matuyama). Les fossiles se trouvent précisément (et par chance) dans cette couche.
En quoi cette recherche est-elle importante ?
En Afrique, nous avons pas mal de fossiles humains, mais il y avait une sorte de trou dans la documentation entre un million d’années et 600 000 ans avant le présent. C’était d’autant plus embêtant que c’est la période pendant laquelle les chercheurs en paléogénétique placent la divergence entre les lignées africaines (qui vont donner nos ancêtres directs), les ancêtres des Néandertaliens en Europe et les formes asiatiques apparentées (les Dénisoviens).
Ce nouveau matériel remplit donc un vide et documente une période de l’évolution humaine assez mal connue. Ils nous permettent d’enraciner très loin dans le temps les ancêtres de notre espèce – les prédécesseurs d’Homo sapiens – qui ont vécu dans la région de Casablanca.
Le manque d’informations pour la période précédant Homo sapiens (entre 300 000 ans et un million d’années) a poussé quelques chercheurs à spéculer sur une origine eurasienne de notre espèce, avant un retour en Afrique. Je pense qu’il n’y a pas vraiment d’argument scientifique pour cela. Dans les débuts de la paléoanthropologie, les Européens avaient du mal à imaginer que l’origine de l’humanité actuelle ne se place pas en Europe.
Plus tard, au cours du XXᵉ siècle, le modèle prépondérant a été celui d’une origine locale des différentes populations actuelles (les Asiatiques en Chine, les Aborigènes australiens en Indonésie et les Européens avec Néandertal). Ce modèle a été depuis largement abandonné face notamment aux preuves génétiques pointant vers une origine africaine de tous les hommes actuels.
Quelles sont les suites de ces recherches ?
Notre découverte ne clôt peut-être pas définitivement le débat, mais elle montre que, dans ce qui était un vide documentaire, nous avons des fossiles en Afrique qui représentent un ancêtre très plausible pour les Sapiens. On n’a donc pas besoin de les faire venir d’ailleurs.
Nous avons en projet de réaliser le séquençage des protéines fossiles peut-être préservées dans ces ossements. Si ces analyses sont couronnées de succès, elles apporteront des éléments supplémentaires à la compréhension de leur position dans l’arbre des origines humaines.
Tout savoir en trois minutes sur des résultats récents de recherches, commentés et contextualisés par les chercheuses et les chercheurs qui les ont menées, c’est le principe de nos « Research Briefs ». Un format à retrouver ici.
Jean-Jacques Hublin ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
28.01.2026 à 11:56
Du chatbot du pape au canard de Vaucanson, les croyances derrière l’intelligence artificielle ne datent pas d’hier
Texte intégral (3699 mots)

Des mythes antiques à la tête parlante du pape, de Prométhée aux algorithmes modernes, l’intelligence artificielle (IA) puise dans notre fascination intemporelle pour la création et le pouvoir de la connaissance.
Il semble que l’engouement pour l’intelligence artificielle (IA) ait donné naissance à une véritable bulle spéculative. Des bulles, il y en a déjà eu beaucoup, de la tulipomanie du XVIIe siècle à celle des subprimes du XXIe siècle. Pour de nombreux commentateurs, le précédent le plus pertinent aujourd’hui reste la bulle Internet des années 1990. À l’époque, une nouvelle technologie – le World Wide Web – avait déclenché une vague d’« exubérance irrationnelle ». Les investisseurs déversaient des milliards dans n’importe quelle entreprise dont le nom contenait « .com ».
Trois décennies plus tard, une autre technologie émergente déclenche une nouvelle vague d’enthousiasme. Les investisseurs injectent à présent des milliards dans toute entreprise affichant « IA » dans son nom. Mais il existe une différence cruciale entre ces deux bulles, qui n’est pas toujours reconnue. Le Web existait. Il était bien réel. L’intelligence artificielle générale, elle, n’existe pas, et personne ne sait si elle existera un jour.
En février, le PDG d’OpenAI, Sam Altman, écrivait sur son blog que les systèmes les plus récents commencent tout juste à « pointer vers » l’IA dans son acception « générale ». OpenAI peut commercialiser ses produits comme des « IA », mais ils se réduisent à des machines statistiques qui brassent des données, et non des « intelligences » au sens où on l’entend pour un être humain.
Pourquoi, dès lors, les investisseurs sont-ils si prompts à financer ceux qui vendent des modèles d’IA ? L’une des raisons tient peut-être au fait que l’IA est un mythe technologique. Je ne veux pas dire par là qu’il s’agit d’un mensonge, mais que l’IA convoque un récit puissant et fondateur de la culture occidentale, celui des capacités humaines de création. Peut-être les investisseurs sont-ils prêts à croire que l’IA est pour demain, parce qu’elle puise dans des mythes profondément ancrés dans leur imaginaire ?
Le mythe de Prométhée
Le mythe le plus pertinent pour penser l’IA est celui de Prométhée, issu de la Grèce antique. Il en existe de nombreuses versions, mais les plus célèbres se trouvent dans les poèmes d’Hésiode, la Théogonie et les Travaux et les Jours, ainsi que dans la pièce Prométhée enchaîné, traditionnellement attribuée à Eschyle.
Prométhée était un Titan, un dieu du panthéon grec antique. C’était aussi un criminel, coupable d’avoir dérobé le feu à Héphaïstos, le dieu forgeron. Dissimulé dans une tige de fenouil, le feu fut apporté sur Terre par Prométhée, qui l’offrit aux humains. Pour le punir, il fut enchaîné à une montagne, où un aigle venait chaque jour lui dévorer le foie.
Le don de Prométhée n’était pas seulement celui du feu ; c’était celui de l’intelligence. Dans Prométhée enchaîné, il affirme qu’avant son don, les humains voyaient sans voir et entendaient sans entendre. Après celui-ci, ils purent écrire, bâtir des maisons, lire les étoiles, pratiquer les mathématiques, domestiquer les animaux, construire des navires, inventer des remèdes, interpréter les rêves et offrir aux dieux des sacrifices appropriés.
Le mythe de Prométhée est un récit de création d’un genre particulier. Dans la Bible hébraïque, Dieu ne confère pas à Adam le pouvoir de créer la vie. Prométhée, en revanche, transmet aux humains une part du pouvoir créateur des dieux.
Hésiode souligne cet aspect du mythe dans la Théogonie. Dans ce poème, Zeus ne punit pas seulement Prométhée pour le vol du feu ; il châtie aussi l’humanité. Il ordonne à Héphaïstos d’allumer sa forge et de façonner la première femme, Pandore, qui déchaîne le mal sur le monde. Or le feu qu’Héphaïstos utilise pour créer Pandore est le même que celui que Prométhée a offert aux humains.

Les Grecs ont avancé l’idée que les humains sont eux-mêmes une forme d’intelligence artificielle. Prométhée et Héphaïstos recourent à la technique pour fabriquer les hommes et les femmes. Comme le montre l’historienne Adrienne Mayor dans son ouvrage Gods and Robots, les Anciens représentaient souvent Prométhée comme un artisan, utilisant des outils ordinaires pour créer des êtres humains dans un atelier tout aussi banal.
Si Prométhée nous a donné le feu des dieux, il semble logique que nous puissions utiliser ce feu pour fabriquer nos propres êtres intelligents. De tels récits abondent dans la littérature grecque antique, de l’inventeur Dédale, qui créa des statues capables de prendre vie, à la magicienne Médée, qui savait rendre la jeunesse et la vigueur grâce à ses drogues ingénieuses. Les inventeurs grecs ont également conçu des calculateurs mécaniques pour l’astronomie ainsi que des automates remarquables, mues par la gravité, l’eau et l’air.
Le pape et le chatbot
Deux mille sept cents ans se sont écoulés depuis qu’Hésiode a consigné pour la première fois le mythe de Prométhée. Au fil des siècles, ce récit a été repris sans relâche, en particulier depuis la publication, en 1818, de Frankenstein ; ou le Prométhée moderne de Mary Shelley.
Mais le mythe n’est pas toujours raconté comme une fiction. Voici deux exemples historiques où le mythe de Prométhée semble s’être incarné dans la réalité.
Gerbert d’Aurillac fut le Prométhée du Xe siècle. Né au début des années 940 de notre ère, il étudia à l’abbaye d’Aurillac avant de devenir moine à son tour. Il entreprit alors de maîtriser toutes les branches du savoir connues de son temps. En 999, il fut élu pape. Il mourut en 1003 sous son nom pontifical de Sylvestre II.
Des rumeurs sur Gerbert se répandirent rapidement à travers l’Europe. Moins d’un siècle après sa mort, sa vie était déjà devenue légendaire. L’une des légendes les plus célèbres, et la plus pertinente à l’ère actuelle de l’engouement pour l’IA, est celle de la « tête parlante » de Gerbert. Cette légende fut racontée dans les années 1120 par l’historien anglais Guillaume de Malmesbury dans son ouvrage reconnu et soigneusement documenté, la Gesta Regum Anglorum (Les actions des rois d’Angleterre).
Gerbert possédait des connaissances approfondies en astronomie, une science de la prévision. Les astronomes pouvaient utiliser l’astrolabe pour déterminer la position des étoiles et prévoir des événements cosmiques, comme les éclipses. Selon Guillaume, Gerbert aurait mis son savoir en astronomie au service de la création d’une tête parlante. Après avoir observé les mouvements des étoiles et des planètes, il aurait façonné une tête en bronze capable de répondre à des questions par « oui » ou par « non ».
Gerbert posa d’abord la question : « Deviendrai-je pape ? »
« Oui », répondit la tête.
Puis il demanda : « Mourrai-je avant d’avoir célébré la messe à Jérusalem ? »
« Non », répondit la tête.
Dans les deux cas, la tête avait raison, mais pas comme Gerbert l’avait prévu. Il devint bien pape et évita judicieusement de partir en pèlerinage à Jérusalem. Un jour cependant, il célébra la messe à la basilique Sainte-Croix-de-Jérusalem à Rome. Malheureusement pour lui, la basilique était alors simplement appelée « Jérusalem ».
Gerbert tomba malade et mourut. Sur son lit de mort, il demanda à ses serviteurs de découper son corps et de disperser les morceaux, afin de rejoindre son véritable maître, Satan. De cette manière, il fut, à l’instar de Prométhée, puni pour avoir volé le feu.

C’est une histoire fascinante. On ne sait pas si Guillaume de Malmesbury y croyait vraiment. Mais il s’est bel et bien efforcé de persuader ses lecteurs que cela était plausible. Pourquoi ce grand historien, attaché à la vérité, aurait-il inséré une légende fantaisiste sur un pape français dans son histoire de l’Angleterre ? Bonne question !
Est-ce si extravagant de croire qu’un astronome accompli puisse construire une machine de prédiction à usage général ? À l’époque, l’astronomie était la science de la prédiction la plus puissante. Guillaume, sobre et érudit, était au moins disposé à envisager que des avancées brillantes en astronomie pourraient permettre à un pape de créer un chatbot intelligent.
Aujourd’hui, cette même possibilité est attribuée aux algorithmes d’apprentissage automatique, capables de prédire sur quelle publicité vous cliquerez, quel film vous regarderez ou quel mot vous taperez ensuite. Il est compréhensible que nous tombions sous le même sortilège.
L’anatomiste et l’automate
Le Prométhée du XVIIIe siècle fut Jacques de Vaucanson, du moins si l’on en croit Voltaire :
Le hardi Vaucanson, rival de Prométhée,
Semblait, de la nature imitant les ressorts
Prendre le feu des cieux pour animer les corps.

Vaucanson était un grand mécanicien, célèbre pour ses automates, des dispositifs à horlogerie reproduisant de manière réaliste l’anatomie humaine ou animale. Les philosophes de l’époque considéraient le corps comme une machine – alors pourquoi un mécanicien n’aurait-il pu en construire une ?
Parfois, les automates de Vaucanson avaient aussi une valeur scientifique. Il construisit par exemple un « Flûteur automate » doté de lèvres, de poumons et de doigts, capable de jouer de la flûte traversière de façon très proche de celle d’un humain. L’historienne Jessica Riskin explique dans son ouvrage The Restless Clock que Vaucanson dut faire d’importantes découvertes en acoustique pour que son flûtiste joue juste.
Parfois, ses automates étaient moins scientifiques. Son « Canard digérateur » connut un immense succès, mais se révéla frauduleux. Il semblait manger et digérer de la nourriture, mais ses excréments étaient en réalité des granulés préfabriqués dissimulés dans le mécanisme.
Vaucanson consacra des décennies à ce qu’il appelait une « anatomie en mouvement ». En 1741, il présenta à l’Académie de Lyon un projet visant à construire une « imitation de toutes les opérations animales ». Vingt ans plus tard, il s’y remit. Il obtint le soutien du roi Louis XV pour réaliser une simulation du système circulatoire et affirma pouvoir construire un corps artificiel complet et vivant.

Il n’existe aucune preuve que Vaucanson ait jamais achevé un corps entier. Finalement, il ne put tenir la promesse que soulevait sa réputation. Mais beaucoup de ses contemporains croyaient qu’il en était capable. Ils voulaient croire en ses mécanismes magiques. Ils souhaitaient qu’il s’empare du feu de la vie.
Si Vaucanson pouvait fabriquer un nouveau corps humain, ne pourrait-il pas aussi en réparer un existant ? C’est la promesse de certaines entreprises d’IA aujourd’hui. Selon Dario Amodei, PDG d’Anthropic, l’IA permettra bientôt aux gens « de vivre aussi longtemps qu’ils le souhaitent ». L’immortalité semble un investissement séduisant.
Sylvestre II et Vaucanson furent de grands maîtres de la technologie, mais aucun des deux ne fut un Prométhée. Ils ne volèrent nul feu aux dieux. Les aspirants Prométhée de la Silicon Valley réussiront-ils là où leurs prédécesseurs ont échoué ? Si seulement nous avions la tête parlante de Sylvestre II, nous pourrions le lui demander.
Michael Falk a reçu des financements de l'Australian Research Council.
27.01.2026 à 16:26
Qu’est-ce que l’intégrité scientifique aujourd’hui ?
Texte intégral (2405 mots)
Dans un contexte où la production scientifique est soumise à des pressions multiples, où les théories pseudoscientifiques circulent sur les réseaux sociaux, l’intégrité scientifique apparaît plus que jamais comme l’un des piliers de la confiance dans la science. Nous vous proposons de découvrir les conclusions de l’ouvrage L’intégrité scientifique. Sociologie des bonnes pratiques, de Catherine Guaspare et Michel Dubois aux éditions PUF, en 2025.
L’intégrité scientifique est une priorité institutionnelle qui fait consensus. Par-delà la détection et le traitement des méconduites scientifiques, la plupart des organismes d’enseignement supérieur et de recherche partagent aujourd’hui un même objectif de promouvoir une culture des bonnes pratiques de recherche.
Il est tentant d’inscrire cette culture dans une perspective historique : la priorité accordée aujourd’hui à l’intégrité n’étant qu’un moment dans une histoire plus longue, celle des régulations qui s’exercent sur les conduites scientifiques. Montgomery et Oliver ont par exemple proposé de distinguer trois grandes périodes dans l’histoire de ces régulations : la période antérieure aux années 1970 caractérisée par l’autorégulation de la communauté scientifique, la période des années 1970-1990 caractérisée par l’importance accordée à la détection et la prévention des fraudes scientifiques et, depuis les années 1990 et la création de l’Office of Research Integrity, première agence fédérale américaine chargée de l’enquête et de la prévention des manquements à l’intégrité dans la recherche biomédicale financée sur fonds publics, la période de l’intégrité scientifique et de la promotion des bonnes pratiques.
Cette mise en récit historique de l’intégrité peut sans doute avoir une valeur heuristique, mais comme tous les grands récits, celui-ci se heurte aux faits. Elle laisse croire que la communauté scientifique, jusque dans les années 1970, aurait été capable de définir et de faire appliquer par elle-même les normes et les valeurs de la recherche. Pourtant, la régulation qui s’exerce par exemple sur la recherche biomédicale est très largement antérieure aux années 1970, puisqu’elle prend forme dès l’après-Seconde Guerre mondiale avec le Code de Nuremberg (1947), se renforce avec la Déclaration d’Helsinki (1964) et s’institutionnalise progressivement à travers les comités d’éthique et les dispositifs juridiques de protection des personnes.
Elle laisse ensuite penser que la détection des fraudes scientifiques comme la promotion des bonnes pratiques seraient autant de reculs pour l’autonomie de la communauté scientifique. Mais, à y regarder de plus près, les transformations institutionnelles – l’adoption de la charte nationale de déontologie des métiers de la recherche en 2015, la création de l’Office français de l’intégrité scientifique en 2017, l’entrée de l’intégrité dans la loi en 2020 –, sont le plus souvent portées par des représentants de la communauté scientifique. Et ce qui peut paraître, de loin, une injonction du politique faite au scientifique relève fréquemment de l’auto-saisine, directe ou indirecte, de la communauté scientifique. L’entrée en politique de l’intégrité scientifique démontre la capacité d’une partie limitée de la communauté scientifique à saisir des fenêtres d’opportunité politique. À l’évidence, pour la France, la période 2015-2017 a été l’une de ces fenêtres, où, à la faveur d’une affaire retentissante de méconduite scientifique au CNRS en 2015, du rapport porté par Pierre Corvol en 2016, de la lettre circulaire de Thierry Mandon en 2017, ces questions passent d’un débat professionnel à un objet de politique publique structuré.
Enfin, ce récit historique de l’intégrité semble suggérer qu’à la culture institutionnelle de détection des fraudes scientifiques, caractéristique des années 1970-1990, viendrait désormais se substituer une culture, plus positive, des bonnes pratiques et de la recherche responsable. Certes, l’innovation et la recherche responsables sont autant de mots-clés désormais incontournables pour les grandes institutions scientifiques, mais la question de la détection des méconduites demeure plus que jamais d’actualité, et ce d’autant qu’il s’est opéré ces dernières années un déplacement de la détection des fraudes scientifiques vers celle des pratiques discutables. La question de la qualification des méconduites scientifiques comme celle de leur mesure n’ont jamais été autant d’actualité.
Si le sociologue ne peut que gagner à ne pas s’improviser historien des sciences, il ne peut toutefois rester aveugle face aux grandes transformations des sciences et des techniques. En particulier, la communauté scientifique du XXIᵉ siècle est clairement différente de celle du siècle dernier. Dans son rapport 2021, l’Unesco rappelait qu’entre 2014 et 2018 le nombre de chercheurs a augmenté trois fois plus vite que la population mondiale, avec un total de plus de huit millions de chercheurs en équivalent temps plein à travers le monde.
Cette densification de la communauté scientifique n’est pas sans enjeu pour l’intégrité scientifique. Avec une communauté de plus en plus vaste, il faut non seulement être en mesure de parler d’une même voix, normaliser les guides et les chartes, mais s’assurer que cette voix soit entendue par tous. Même si l’institutionnalisation de l’intégrité est allée de pair avec une forme d’internationalisation, tous les pays ne sont pas en mesure de créer les structures et les rôles que nous avons eu l’occasion de décrire.
Par ailleurs, la croissance de la communauté scientifique s’accompagne mécaniquement d’une augmentation du volume des publications scientifiques qui met à mal les mécanismes traditionnels de contrôle. D’où d’ailleurs le développement d’alternatives au mécanisme de contrôle par les pairs. On a beaucoup parlé de la vague de publications liées à la crise de la Covid-19, mais la vague souterraine, peut-être moins perceptible pour le grand public, est plus structurelle : toujours selon les données de l’Unesco, entre 2015 et 2019, la production mondiale de publications scientifiques a augmenté de 21 %. Qui aujourd’hui est capable de garantir la fiabilité d’un tel volume de publications ?
Qui dit enfin accroissement du volume de la communauté scientifique, dit potentiellement densification des réseaux de collaborations internationales, à l’intérieur desquels les chercheurs comme les équipes de recherche sont autant d’associés rivaux. La multiplication des collaborations internationales suppose de pouvoir mutualiser les efforts et de s’assurer de la qualité de la contribution de chacun comme de sa reconnaissance. Nous avons eu l’occasion de souligner l’importance de considérer les sentiments de justice et d’injustice éprouvés par les scientifiques dans la survenue des méconduites scientifiques : une contribution ignorée, un compétiteur qui se voit récompensé tout en s’écartant des bonnes pratiques, des institutions scientifiques qui interdisent d’un côté ce qu’elles récompensent de l’autre, etc., autant de situations qui nourrissent ces sentiments.
Par ailleurs, la multiplication des collaborations, dans un contexte où les ressources (financements, postes, distinctions, etc.) sont par principe contraintes, implique également des logiques de mise en concurrence qui peuvent être vécues comme autant d’incitations à prendre des raccourcis.
Outre la transformation démographique de la communauté scientifique, le sociologue des sciences ne peut ignorer l’évolution des modalités d’exercice du travail scientifique à l’ère numérique. La « datafication » de la science, à l’œuvre depuis la fin du XXᵉ siècle, correspond tout autant à l’augmentation du volume des données numériques de la recherche qu’à l’importance prise par les infrastructures technologiques indispensables pour leur traitement, leur stockage et leur diffusion. L’accessibilité et la diffusion rapide des données de la recherche, au nom de la science ouverte, ouvrent des perspectives inédites pour les collaborations scientifiques. Elles créent une redistribution des rôles et des expertises dans ces collaborations, avec un poids croissant accordé à l’ingénierie des données.
Mais, là encore, cette évolution technologique engendre des défis majeurs en termes d’intégrité scientifique. L’édition scientifique en ligne a vu naître un marché en ligne des revues prédatrices qui acceptent, moyennant paiement, des articles sans les évaluer réellement. Si les outils de l’intelligence artificielle s’ajoutent aux instruments traditionnels des équipes de recherche, des structures commerciales clandestines, les « paper mill » ou usines à papier, détournent ces outils numériques pour fabriquer et vendre des articles scientifiques frauduleux à des auteurs en quête de publications. Si l’immatérialité des données numériques permet une circulation accélérée des résultats de recherche, comme on a pu le voir durant la crise de la Covid-19, elle rend également possibles des manipulations de plus en plus sophistiquées. Ces transformations structurelles créent une demande inédite de vigilance à laquelle viennent répondre, chacun à leur manière, l’évaluation postpublication comme ceux que l’on appelle parfois les nouveaux détectives de la science et qui traquent en ligne les anomalies dans les articles publiés (images dupliquées, données incohérentes, plagiat) et ce faisant contribuent à la mise en lumière de fraudes ou de pratiques douteuses.
À lire aussi : Ces détectives qui traquent les fraudes scientifiques : conversation avec Guillaume Cabanac
Plus fondamentalement, cette montée en puissance des données numériques de la recherche engendre des tensions inédites entre l’intégrité scientifique et l’éthique de la recherche. À l’occasion d’un entretien, un physicien, travaillant quotidiennement à partir des téraoctets de données générés par un accélérateur de particules, nous faisait remarquer, avec une pointe d’ironie, qu’il comprenait sans difficulté l’impératif institutionnel d’archiver, au nom de l’intégrité scientifique, l’intégralité de ses données sur des serveurs, mais que ce stockage systématique d’un volume toujours croissant de données entrait directement en contradiction avec l’éthique environnementale de la recherche prônée par ailleurs par son établissement. Intégrité scientifique ou éthique de la recherche ? Faut-il choisir ?
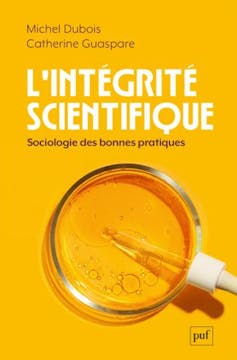
On touche du doigt ici la diversité des dilemmes auxquels sont quotidiennement confrontés les scientifiques dans l’exercice de leurs activités. La science à l’ère numérique évolue dans un équilibre délicat entre l’intégrité scientifique et l’éthique de la recherche. Et l’un des enjeux actuels est sans doute de parvenir à maximiser les bénéfices des technologies numériques tout en minimisant leurs impacts négatifs. D’où la nécessité pour les institutions de recherche de promouvoir une culture de l’intégrité qui puisse dépasser la simple exigence de conformité aux bonnes pratiques, en intégrant les valeurs de responsabilité sociale auxquelles aspire, comme le montrent nos enquêtes, une part croissante de la communauté scientifique.
Le texte a été très légèrement remanié pour pouvoir être lu indépendamment du reste de l’ouvrage en accord avec les auteurs.
Catherine Guaspare et Michel Dubois sont les auteurs du livre L'intégrité scientifique dont cet article est tiré.
Michel Dubois a reçu des financements de l'Agence nationale de la recherche (ANR). Il est directeur de l'Office français de l'intégrité scientifique depuis septembre 2025.
26.01.2026 à 15:01
Chez le poulain, le lien maternel est un moteur du développement social et cérébral – nouvelle étude
Texte intégral (1629 mots)

Une nouvelle étude montre comment la présence prolongée de la mère façonne le développement comportemental, physiologique et cérébral des poulains.
Chez les mammifères sociaux, les relations sociales jouent un rôle déterminant dans le développement. On sait depuis longtemps que la période autour de la naissance est cruciale, lorsque le nouveau-né dépend entièrement de son ou de ses parent(s) pour se nourrir et se protéger. En revanche, ce qui se joue après, lorsque le jeune n’est plus physiquement dépendant de sa mère mais continue de vivre à ses côtés, reste encore mal compris.
Dans une étude récente publiée dans Nature Communications, nous avons exploré chez le cheval cette période souvent négligée du développement. Nos résultats montrent que la présence prolongée de la mère façonne à la fois le cerveau, le comportement
– social en particulier – et la physiologie des poulains.
Pourquoi s’intéresser à l’« enfance » chez le cheval ?
Le cheval est un modèle particulièrement pertinent pour étudier le rôle du lien parental sur le développement des jeunes. Comme chez l’humain, les mères donnent généralement naissance à un seul petit à la fois, procurent des soins parentaux prolongés et établissent un lien mère-jeune fort sur le plan affectif, individualisé et durable.
Dans des conditions naturelles, les poulains restent avec leur groupe familial, et donc avec leur mère, jusqu’à l’âge de 2 ou 3 ans. En revanche, en élevage ou chez les particuliers, la séparation est le plus souvent décidée par l’humain et intervient bien plus tôt, autour de 6 mois. Ce contraste offre une occasion unique d’étudier l’impact de la présence maternelle sur le développement au-delà de la période néonatale.
Comment étudier de rôle d’une présence maternelle prolongée chez le cheval ?
Pour isoler l’effet de la présence maternelle, nous avons suivi 24 poulains de l’âge de 6 à 13 mois. Cette période peut être assimilée à celle de l’enfance chez l’être humain. En effet, durant cette période, les poulains ressemblent déjà physiquement à de petits adultes, apparaissent autonomes dans leurs déplacements et consomment très majoritairement des aliments solides, tout en étant encore sexuellement immatures. En d’autres termes, leur survie immédiate ne dépend plus directement de la mère.
Dans notre étude, tous les poulains vivaient ensemble dans un contexte social riche, avec d’autres jeunes et des adultes. La seule différence concernait la présence ou non de leurs mères respectives à partir de l’âge de 6 mois : ainsi, 12 poulains sont restés avec leur mère tandis que 12 autres en ont été séparés, comme c’est fréquemment le cas en élevage.
Durant les sept mois qui ont suivi, nous avons étudié le développement de ces poulains. En éthologie, les comportements sont étudiés de façon quantitative. Nous avons suivi le développement comportemental des poulains à l’aide d’observations et de tests comportementaux standardisés, puis analysé statistiquement ces données pour comparer leurs trajectoires développementales. Ces données ont été complétées par des mesures physiologiques régulières (par exemple, la prise de poids, les concentrations hormonales) et par une approche d’imagerie par résonance magnétique (IRM) pour visualiser les différences fonctionnelles et morphologiques entre nos deux groupes de poulains de manière non invasive.
À lire aussi : Les chevaux nous reconnaissent-ils ?
La présence de la mère favorise l’émergence des compétences sociales
Les résultats issus de nos observations répétées dans le temps montrent que les poulains bénéficiant de la présence de leur mère interagissaient davantage avec leurs congénères, notamment à travers des comportements positifs, comme le jeu ou le toilettage mutuel, que les poulains séparés de leurs mères. Ils se montraient aussi plus explorateurs et plus à l’aise face à des situations sociales nouvelles, suggérant une plus grande sociabilité.
Autre résultat intéressant, les poulains bénéficiant de la présence de leur mère passaient moins de temps à manger mais prenaient plus de poids, suggérant une croissance plus efficace.
Le lien maternel, moteur du développement du cerveau
Pour aller plus loin, nous avons combiné ces observations comportementales avec une approche encore rare chez les animaux d’élevage : l’imagerie médicale. Ici nous avons utilisé des techniques d’IRM, permettant d’observer le fonctionnement et l’organisation du cerveau vivant, sans douleur. Ainsi, nous avons pu caractériser le développement cérébral de nos poulains.
Cette approche nous a permis d’identifier, pour la première fois chez le cheval, un réseau cérébral appelé le réseau du mode par défaut. Bien connu chez l’humain et identifié chez une poignée d’autres espèces animales, ce réseau serait impliqué dans l’intégration des pensées introspectives, la perception de soi et des autres. Chez les poulains ayant bénéficié d’une présence maternelle prolongée, ce réseau était plus développé, faisant écho aux meilleures compétences sociales que nous avons observées.
En outre, nous avons observé des différences morphologiques dans une région fortement impliquée dans la régulation physiologique, l’hypothalamus, en lien avec les différences physiologiques et de comportement alimentaire mises en évidence.
Une phase clé du développement aux effets multidimensionnels
Pris dans leur ensemble, nos résultats soulignent l’importance de cette phase du développement, encore peu étudiée chez l’animal, située entre la petite enfance et l’adolescence.
Ils suggèrent que la présence maternelle prolongée induit un développement comportemental, cérébral et physiologique plus harmonieux, qui pourrait contribuer à équiper les jeunes pour leur vie adulte future, notamment dans le domaine de compétences sociales.
Quelles implications pour l’élevage… et au-delà ?
Notre travail ne permet pas de définir une règle universelle sur l’âge idéal de séparation chez le cheval. Il montre en revanche que la séparation précoce a des conséquences mesurables, bien au-delà de la seule question alimentaire.
Lorsque les conditions le permettent, garder plus longtemps le poulain avec sa mère pourrait donc constituer un levier simple et favorable au développement du jeune. Cependant, d’autres études sont nécessaires pour évaluer l’impact de ces pratiques sur les mères et les capacités de récupération des poulains après la séparation, par exemple.
Avec grande prudence, ces résultats font aussi écho à ce que l’on observe chez d’autres mammifères sociaux, y compris l’humain : le rôle du parent ou de la/du soignant·e (« caregiver ») comme médiateur entre le jeune et son environnement social et physique pourrait être un mécanisme largement partagé. Le cheval offre ainsi un modèle précieux pour mieux comprendre comment les premières relations sociales façonnent durablement le cerveau et le comportement.
Cette étude a été financée grâce à une bourse européenne HORIZON 2020 Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) (ref: 101033271, MSCA European Individual Fellowship, https://doi.org/10.3030/101033271) et au Conseil Scientifique de l'Institut Français du Cheval et de l’Equitation (IFCE) (ref: DEVELOPPEMENTPOULAIN).
David Barrière ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
24.01.2026 à 18:12
Pourquoi mon filtre antispam fonctionne-t-il si mal ?
Texte intégral (1221 mots)
Comment les spams passent-ils au travers des multiples couches de protection annoncées comme presque infranchissables par les entreprises et par les chercheurs en cybersécurité ?
Les escroqueries existent depuis fort longtemps, du remède miracle vendu par un charlatan aux courriers dans la boîte aux lettres nous promettant monts et merveilles plus ou moins fantasques. Mais le Web a rendu ces canaux moins intéressants pour les arnaqueurs.
Les e-mails de spam et le « phishing » (hameçonnage) se comptent aujourd’hui en millions d’e-mails par an et ont été la porte d’entrée pour des incidents majeurs, comme les fuites d’e-mails internes d’Emmanuel Macron lors de sa campagne présidentielle en 2017, mais aussi le vol de 81 millions de dollars (plus de 69 millions d’euros) à la banque du Bangladesh en 2016.
Il est difficile de quantifier les effets de ces arnaques à l’échelle globale, mais le FBI a recensé des plaintes s’élevant à 2,9 milliards de dollars (soit 2,47 milliards d’euros) en 2023 pour une seule catégorie de ce type d’attaques – les pertes dues aux attaques par e-mail en général sont sûrement beaucoup plus élevées.
Bien sûr, la situation n’est pas récente, et les entreprises proposant des boîtes de messagerie investissent depuis longtemps dans des filtres antispam à la pointe de la technologie et parfois très coûteux. De même pour la recherche académique, dont les détecteurs atteignent des précisions supérieures à 99 % depuis plusieurs années ! Dans les faits pourtant, les signalements de phishing ont bondi de 23 % en 2024.
Pourquoi, malgré ces filtres, recevons-nous chaque jour des e-mails nous demandant si notre compte CPF contient 200 euros, ou bien nous informant que nous aurions gagné 100 000 euros ?
Plusieurs techniques superposables
Il faut d’abord comprendre que les e-mails ne sont pas si différents des courriers classiques dans leur fonctionnement. Quand vous envoyez un e-mail, il arrive à un premier serveur, puis il est relayé de serveur en serveur jusqu’à arriver au destinataire. À chaque étape, le message est susceptible d’être bloqué, car, dans cette chaîne de transmission, la plupart des serveurs sont équipés de bloqueurs.
Dans le cadre de ma thèse, j’ai réalisé une étude empirique qui nous a permis d’analyser plus de 380 e-mails de spams et de phishing ayant franchi les filtres mis en place. Nous avons ainsi analysé une dizaine de techniques exploitées dans des proportions très différentes.
La plus répandue de ces techniques est incroyablement ingénieuse et consiste à dessiner le texte sur une image incluse dans l’e-mail plutôt que de l’écrire directement dans le corps du message. L’intérêt est de créer une différence de contenu entre ce que voit l’utilisateur et ce que voient les bloqueurs de spams et de phishing. En effet, l’utilisateur ne fait pas la différence entre « cliquez ici » écrit dans l’e-mail ou « cliquez ici » dessiné avec la même police d’écriture que l’ordinateur. Pourtant, du point de vue des bloqueurs automatisés, cela fait une grosse différence, car, quand le message est dessiné, identifier le texte présent dans l’image demande une analyse très coûteuse… que les bloqueurs ne peuvent souvent pas se permettre de réaliser.
Une autre technique, plus ancienne, observée dans d’autres contextes et recyclée pour franchir les bloqueurs, est l’utilisation de lettres qui sont jumelles dans leur apparence pour l’œil humain mais radicalement différentes. Prenons par exemple un mail essayant de vous faire cliquer sur un lien téléchargeant un virus sur votre téléphone. Un hackeur débutant pourrait envoyer un mail malicieux demandant de cliquer ici. Ce qui serait vu du point de vue de votre ordinateur par 99 108 105 113 117 101 114. Cette suite de nombres est bien évidemment surveillée de près et suspectée par tous les bloqueurs de la chaîne de transmission. Maintenant, un hackeur chevronné, pour contourner le problème, remplacera le l minuscule par un i majuscule (I). De votre point de vue, cela ressemblera à cIiquer ici – avec plus ou moins de réussite en fonction de la police d’écriture. Mais du point de vue de l’ordinateur, cela change tout, car ça devient : 99 76 105 113 117 101 114. Les bloqueurs n’ont jamais vu cette version-là et donc laissent passer le message.
Tromper les filtres à spams basés sur l’IA
Parmi toutes les techniques que nous avons observées, certaines sont plus avancées que d’autres. Contre les bloqueurs de nouvelle génération, les hackers ont mis au point des techniques spécialisées dans la neutralisation des intelligences artificielles (IA) défensives.
Un exemple observé dans notre étude est l’ajout dans l’e-mail de pages Wikipédia écrites en blanc sur blanc. Ces pages sont complètement hors contexte et portent sur des sujets, tels que l’hémoglobine ou les agrumes, alors que l’e-mail demande d’envoyer des bitcoins. Ce texte, invisible pour l’utilisateur, sert à perturber les détecteurs basés sur des systèmes d’intelligence artificielle en faisant une « attaque adversariale » (montrer une grande quantité de texte anodin, en plus du message frauduleux, de telle sorte que le modèle de détection n’est plus capable de déterminer s’il s’agit d’un e-mail dangereux ou pas).
Et le pire est que la plupart des e-mails contiennent plusieurs de ces techniques pour augmenter leurs chances d’être acceptés par les bloqueurs ! Nous avons dénombré en moyenne 1,7 technique d’obfuscation par e-mails, avec la plupart des e-mails comportant au moins une technique d’obfuscation.
Cet article est le fruit d’un travail collectif entre le Laboratoire de recherche spécialisé dans l’analyse et l’architecture des systèmes (LAAS-CNRS) et le Laboratoire d’études et de recherches appliquées en sciences sociales (LERASS). Je tiens à remercier Guillaume Auriol, Pascal Marchand et Vincent Nicomette pour leur soutien et leurs corrections.
Antony Dalmiere a reçu des financements de l'Université de Toulouse et de l'Institut en Cybersécurité d'Occitanie.
21.01.2026 à 11:36
Des éclairs détectés sur Mars pour la toute première fois
Texte intégral (1727 mots)
Pour la première fois, un microphone placé sur le rover Perseverance de la Nasa a permis de découvrir l’existence de petites décharges électriques dans les tourbillons et les tempêtes martiennes de poussière. Longtemps théorisés, ces petits éclairs sur Mars deviennent une réalité grâce à des enregistrements acoustiques et électromagnétiques inédits que nous venons de publier dans la revue Nature. Cette découverte, aux conséquences multiples sur nos connaissances de la chimie et de la physique ainsi que sur le climat de la planète rouge, révèle de nouveaux défis pour les futures missions robotiques et habitées.
Un souffle de vent martien, et soudain, un claquement sec : les dust devils, ces tourbillons de poussière qui parcourent la planète rouge, viennent de nous livrer un secret bien gardé : ils sont traversés de petits arcs électriques ! Ils ont été vus, ou plutôt entendus, de manière totalement fortuite, grâce au microphone de l’instrument SuperCam sur le rover Perseverance qui sillonne Mars depuis 2020.
Ce microphone est notre oreille à la surface de Mars. Il alimente depuis 2021 une « playlist » de plus de trente heures composée de brefs extraits quotidiens du paysage sonore martien : le microphone est allumé environ trois minutes tous les deux jours, pour des raisons de partage du temps du rover avec les autres instruments.
Un jackpot scientifique
Parmi ses morceaux les plus écoutés ? Le ronflement basse fréquence du souffle du vent, le crépitement aigu des grains de sable et les grincements mécaniques des articulations du robot. Mais le dernier titre de cette compilation d’un autre monde est une pépite : un dust devil capté en direct alors qu’il passait au-dessus de notre microphone. Qu’un dust devil passe au-dessus de Perseverance, ce n’est pas forcément exceptionnel – ils sont très actifs dans le cratère de Jezero où est posé Perseverance. Mais, qu’il survole le rover à l’instant même où le microphone est allumé, cela relève du jackpot scientifique.
Au cœur de cet enregistrement se cachait un signal fort que nous avons peiné à interpréter. Notre première hypothèse fut celle d’un gros grain de sable ayant impacté la zone proche de la membrane du microphone. Quelques années plus tard, alors que nous assistions à une conférence sur l’électricité atmosphérique, nous avons eu une illumination : s’il y avait des décharges sur Mars, la façon la plus directe de les détecter serait de les écouter parce qu’aucun autre instrument à bord de Perseverance ne permet d’étudier les champs électriques.
Évidemment, l’enregistrement le plus favorable pour vérifier cette hypothèse était précisément celui-ci. Réexaminé à la lumière de cette interprétation, il correspondait bien au signal acoustique d’une décharge électrique. Ce n’était pas tout !
Cette onde de choc était précédée d’un signal étrange qui ne ressemblait pas à quelque chose de naturel mais qui provenait en réalité de l’interférence électromagnétique de la décharge avec l’électronique du microphone. Nous savions que celle-ci était sensible aux ondes parasites, mais nous avons tourné ce petit défaut à notre avantage. Grâce à la combinaison de ces deux signaux, tout était devenu clair : nous avions détecté pour la première fois des arcs électriques sur Mars. Pour en être absolument convaincus, nous avons reproduit ce phénomène en laboratoire à l’aide de la réplique de l’instrument SuperCam et d’une machine de Wimshurst, une expérience historiquement utilisée pour générer des arcs électriques. Les deux signaux – acoustique et électromagnétique – obtenus étaient rigoureusement identiques à ceux enregistrés sur Mars.
En soi, l’existence de ces décharges martiennes n’est pas si surprenante que cela : sur Terre, l’électrification des particules de poussière est bien connue, notamment dans les régions désertiques, mais elle aboutit rarement à des décharges électriques. Sur Mars, en revanche, l’atmosphère ténue de CO₂ rend ce phénomène beaucoup plus probable, la quantité de charges nécessaire à la formation d’étincelles étant beaucoup plus faible que sur Terre. Cela s’explique par le frottement de minuscules grains de poussière entre eux, qui se chargent en électrons puis libèrent leurs charges sous forme d’arcs électriques longs de quelques centimètres, accompagnés d’ondes de choc audibles. Le vrai changement de paradigme de cette découverte, c’est la fréquence et l’énergie de ces décharges : à peine perceptibles, comparables à une décharge d’électricité lorsqu’on touche une raquette à moustiques, ces étincelles martiennes sont fréquentes, en raison de l’omniprésence de la poussière sur Mars.
Des implications au niveau du climat martien
Ce qui est fascinant, c’est que cette découverte intervient après des décennies de spéculations sur l’activité électrique martienne, touchant une arborescence de phénomènes encore peu ou mal expliqués. Par exemple, l’activité électrique de la poussière a longtemps été suspectée de fournir un moyen très efficace pour soulever la poussière du sol martien. Les champs électriques derrière les arcs électriques entendus sur Mars sont a priori suffisamment forts pour faire léviter la poussière.
En absorbant et en réfléchissant la lumière solaire, la poussière martienne contrôle la température de l’air et intensifie la circulation atmosphérique (les vents). Et parce que les vents contrôlent en retour le soulèvement de la poussière, la boucle de rétroactions poussière-vent-poussière est à l’origine des tempêtes globales qui recouvrent intégralement la planète de poussière tous les 5 ou 6 ans. Vu l’importance de la poussière dans le climat martien, et alors que les meilleurs modèles ne savent pas encore prédire correctement son soulèvement, les forces électrostatiques ne pourront plus être ignorées dans le cycle global de la poussière sur Mars.
Expliquer la disparition du méthane
L’autre sujet qui attire les regards des scientifiques concerne le très controversé méthane martien. La communauté débat depuis plus de vingt ans à son sujet en raison de ses implications potentielles, à savoir une activité géophysique ou biologique éventuelle sur Mars, deux hypothèses fascinantes.
Au-delà du caractère énigmatique de ses détections sporadiques, sa disparition – des centaines de fois plus rapide que ce que prédisent les modèles de chimie atmosphérique les plus sophistiqués – a longtemps laissé les experts circonspects. L’un des mécanismes de destruction du méthane les plus prometteurs, proposé il y a une vingtaine d’années, fait précisément intervenir l’action de champs électriques intenses sur la chimie atmosphérique. En accélérant ions et électrons, ces champs permettent de casser les molécules de méthane, mais surtout celles de la vapeur d’eau, produisant ainsi de puissantes espèces réactives capables de détruire le méthane bien plus efficacement encore.
Qui plus est, la présence d’arcs électriques à l’échelle planétaire pourrait s’avérer déterminante dans la préservation de la matière organique. Des expériences de laboratoire ont montré la destruction brutale de biomarqueurs causée par le recyclage d’espèces chlorées induite par l’activité électrostatique de la poussière.
On le voit, la portée de ces nouveaux sons martiens dépasse largement le seul cadre de la communication grand public. Ils redessinent plusieurs pans de notre compréhension de Mars et ouvrent un nouveau champ d’investigations, qui nécessitera un nombre accru d’observations.
Peut-être lors de futures missions ? L’Agence spatiale européenne (ESA) avait déjà tenté l’expérience – sans succès – avec l’atterrisseur Schiaparelli, qui devait réaliser les premières mesures des champs électriques martiens avant de s’écraser à la surface de la planète. L’exploration future, humaine ou non, se devra de mieux caractériser ces champs pour mieux cerner leurs implications. D’ici là, Perseverance restera l’unique témoin in situ de ce phénomène qui est sans doute loin de nous avoir tout révélé.
Franck Montmessin a reçu des financements de l'ANR et du CNES.
Baptiste Chide ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
21.01.2026 à 11:36
Les crocodiles, des reptiles loquaces et à l’écoute du monde
Texte intégral (3255 mots)

On l’imagine chasseur solitaire et discret, constamment à l’affût d’une proie. Pourtant, l’armure d’écailles du crocodile dissimule une vie sociale complexe. Tendez l’oreille : le seigneur des fleuves a beaucoup à dire.
Lorsque l’on se représente un crocodile, on pense à un prédateur silencieux, un tronc d’arbre flottant au milieu du fleuve, attendant patiemment qu’une proie s’approche pour faire brusquement claquer ses mâchoires. Cette image, bien que partiellement vraie – il est sagement déconseillé de nager au milieu de crocodiles –, occulte une réalité biologique fascinante : les crocodiliens (crocodiles, alligators, caïmans et gavials) sont les reptiles les plus vocaux et les plus sociaux de la planète.
Ces animaux possèdent un système de communication acoustique sophistiqué et une ouïe d’une finesse redoutable, peut-être hérités de leurs ancêtres communs avec les oiseaux et les dinosaures. Depuis près de trois décennies, notre équipe de recherche en bioacoustique s’attelle à décoder ce qu’ils disent et à comprendre comment ils perçoivent leur environnement sonore. Voici ce que nos études révèlent du monde sonore des crocodiliens.
La première conversation : parler depuis l’œuf
L’histoire acoustique d’un crocodile commence avant sa naissance. Contrairement à la majorité des reptiles qui pondent leurs œufs et les abandonnent, les mères ou les pères crocodiliens montent la garde près du nid. Mais comment savoir quand les petits sont prêts à sortir, enfouis sous des dizaines de centimètres de sable ou de végétation ? Nos recherches ont démontré que les embryons de crocodiles ne sont pas passifs. Lorsqu’ils sont prêts à sortir de l’œuf, après trois mois d’incubation, ils commencent à émettre des vocalisations particulières, appelées cris d’éclosion.
Ces sons, audibles à travers la coquille et à l’extérieur du nid, remplissent une double fonction. D’une part, ils s’adressent à la fratrie. Lors d’expériences consistant à émettre des sons depuis un haut-parleur près d’œufs de crocodiles du Nil prêts à éclore, nous avons observé que l’audition de ces cris incite les autres embryons à vocaliser à leur tour et à briser leur coquille. Ce mécanisme permet de synchroniser l’éclosion : toute la nichée va sortir ensemble. Pour des proies aussi vulnérables que des nouveau-nés de quelques dizaines de grammes, c’est une belle stratégie de survie face aux prédateurs.
D’autre part, ces cris sont un signal impérieux pour la mère ou le père. Une femelle crocodile qui monte la garde depuis trois mois réagit immédiatement à l’audition de ces cris d’éclosion : elle se met à creuser le nid avec ses pattes. Sans ce comportement parental en réponse à leur signal sonore, les petits resteraient prisonniers sous terre.
Cependant, la mère ne réagit pas au premier petit bruit venu. Nos expériences sur le crocodile du Nil ont montré que la femelle réagit à des cris isolés par des mouvements de tête, enfouissant son museau dans le sol comme pour en sentir les vibrations, mais elle ne commence à creuser activement que si les cris forment une séquence continue et rythmée. Ceci évite à la femelle d’ouvrir le nid trop tôt pour un seul petit précocement bavard, ce qui mettrait en danger le reste de la couvée.
Le langage des jeunes crocos
Une fois sortis de l’œuf et délicatement transportés à l’eau dans la gueule de leurs parents, les jeunes crocodiliens restent groupés en crèches sous la protection de l’adulte pendant des semaines, voire des mois. Durant cette période, la communication acoustique entre parent et jeunes est vitale.
Le répertoire vocal des juvéniles est structuré autour de deux types de signaux principaux : les cris de contact et les cris de détresse. Le cri de contact est utilisé pour maintenir la cohésion du groupe de jeunes. C’est un son d’intensité assez faible et dont la fréquence varie peu. Le cri de détresse, lui, est émis lorsqu’un jeune est saisi par un prédateur. Il est plus fort et sa fréquence est plus modulée. Il présente souvent une structure acoustique plus chaotique, ce qui le rend un peu rugueux à l’oreille.

La mère sait faire la différence : un cri de contact suscite une simple attention, tandis qu’un cri de détresse déclenche une réaction agressive de défense immédiate. Mais un parent reconnaît-il la voix de ses petits ? Visiblement pas : nos analyses acoustiques des crocodiles du Nil indiquent qu’il n’y a pas de signature vocale chez les nouveau-nés qui permettrait aux parents de les identifier individuellement. En revanche, nous avons découvert que plus le crocodile est petit, plus le cri est aigu. Lors d’expériences réalisées dans la nature, les mères crocodiles du Nil ont réagi plus intensément aux cris les plus aigus. C’est logique : les plus petits sont les plus vulnérables aux prédateurs et nécessitent une protection accrue.

Une ouïe entre l’eau et l’air
Le crocodile est un animal amphibie, vivant à l’interface entre l’air et l’eau, mondes aux propriétés acoustiques radicalement différentes. Mais son audition est d’abord aérienne. Lorsque le crocodile flotte, immobile, ce qui est sa position favorite pour attendre une proie, ses oreilles se trouvent juste au-dessus de la ligne de flottaison. Si l’animal plonge, une paupière vient protéger l’oreille, et l’on ne sait pas encore si les crocodiles entendent bien sous l’eau.

Comment un animal dont la tête est à moitié immergée fait-il pour localiser une proie, un petit ou un rival ? Chez l’humain ou d’autres mammifères et oiseaux, la localisation repose sur deux indices principaux : le son arrive plus vite à l’oreille tournée vers la source et est également plus fort, puisque la tête fait écran. Dans des expériences, nous avons entraîné des crocodiles à se diriger vers des haut-parleurs pour obtenir une récompense, et les résultats montrent qu’ils utilisent également ces deux sources d’information. Pour les sons graves, ils se fient surtout au temps ; pour les aigus, ils utilisent plutôt la différence d’intensité.
Distinguer dans le bruit
Les crocodiliens vivent souvent dans des environnements bruyants. Pour survivre, ils doivent être capables d’isoler un signal pertinent du bruit de fond, mais aussi d’identifier ce qu’ils entendent. Un bruit dans les roseaux est-il une proie ou un congénère ? Au laboratoire, nous avons découvert quel paramètre acoustique ils utilisent pour faire cette distinction. Ce n’est pas la hauteur du son ni son rythme mais l’enveloppe spectrale, c’est-à-dire le timbre du son. C’est exactement le même paramètre que nous, humains, utilisons pour distinguer les voyelles (« a » ou « o ») ou pour reconnaître la voix de quelqu’un au téléphone. Et la catégorisation des sons opérée par les crocodiles n’est pas totalement figée, elle peut être affinée par l’apprentissage, preuve d’une vraie plasticité cognitive.
En particulier, les crocodiles savent reconnaître et sont particulièrement appâtés par les signaux de détresse d’autres animaux. Quand on diffuse des enregistrements de pleurs de bébés humains, bonobos ou chimpanzés à des crocodiles du Nil, les résultats sont frappants : les crocodiles sont très fortement attirés par ces pleurs. Mais pas n’importe comment.
Les humains jugent la détresse d’un bébé principalement à la hauteur de son cri (plus c’est aigu, plus on pense que le bébé exprime de la douleur). Les crocodiles, eux, se basent sur un critère acoustique plus fiable : le chaos, qui se traduit par la rugosité de la voix qui survient lorsque les cordes vocales sont poussées à leurs limites physiques sous l’effet du stress ou de la douleur.
Les crocodiles se sont donc révélés meilleurs que les humains pour évaluer le niveau de détresse des bébés, en particulier des bonobos. Là où nous surestimons la détresse des bonobos à cause de leurs cris suraigus, les crocodiles ne réagissent intensément qu’aux pleurs contenant beaucoup de chaos acoustique, signe d’une véritable urgence, et donc d’une proie vulnérable.
Entre congénère et proie, que privilégier ?
Si les jeunes crocodiliens sont particulièrement bavards, les adultes ne sont pas en reste. Les mères, et les pères pour les espèces où ils s’occupent de leur progéniture, émettent des grognements qui attirent les jeunes. Femelles et mâles adultes rugissent lors des parades nuptiales et pour défendre leur territoire. Lorsqu’ils se sentent menacés, les adultes peuvent souffler de manière bruyante, ce qui passe l’envie de les approcher. On observe cependant de grandes différences dans l’usage des signaux sonores entre les groupes de crocodiliens : si les alligators et les caïmans sont particulièrement vocaux, les autres crocodiles deviennent plus silencieux à l’âge adulte.
Imaginez un jeune crocodile affamé qui entend un congénère l’appeler, mais qui sent en même temps une odeur de viande. Que fait-il ? Nous avons testé ce conflit sensoriel. Les résultats montrent que l’état de satiété modifie la réponse comportementale. Un crocodile rassasié est très attentif aux sons sociaux : il se dirige vers les cris de contact de ses congénères. Un crocodile affamé privilégie la recherche d’une source de nourriture. Cela suggère une modulation de l’attention : la priorité de l’animal peut basculer selon les besoins physiologiques.
Loin de l’image du monstre primitif, le crocodile est un animal doté d’une vie sensorielle et cognitive riche. Il naît dans un monde sonore, synchronisant son éclosion avec ses frères et sœurs. Il communique avec l’adulte qui s’occupe de lui pour obtenir protection. Il analyse son environnement sonore avec des outils sophistiqués (localisation binaurale, démasquage spatial) dignes des oiseaux ou des mammifères. Il catégorise les sons sur la base de leur timbre pour distinguer les congénères des en-cas. Et il est même capable d’évaluer le niveau de détresse dans la voix d’autres espèces.
Ces études sur les crocodiles ont impliqué de nombreux collaborateurs et collaboratrices, dont Thierry Aubin (CNRS), Nicolas Grimault (CNRS), Nicolas Boyer (Université de Saint-Étienne), Amélie Vergne, Léo Papet, Julie Thévenet et Naïs Caron-Delsbosc. Je remercie les parcs zoologiques La Ferme aux crocodiles (Pierrelatte, France) et Crocoparc (Agadir, Maroc) pour leur soutien.
Nicolas Mathevon ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
21.01.2026 à 11:36
Géo-ingénierie marine : qui développe ces grands projets, et qu’y a-t-il à y gagner ?
Texte intégral (2660 mots)
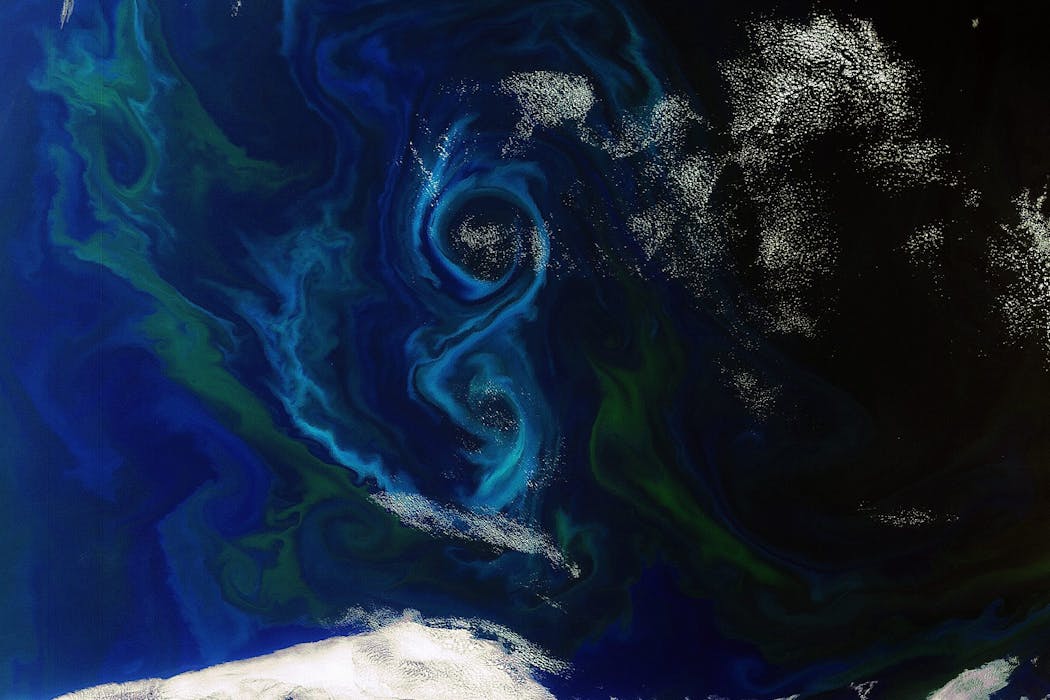
Le mot « géo-ingénierie » recouvre un grand nombre de techniques, du « parasol spatial », qui limite l’arrivée de lumière du soleil dans l’atmosphère, à l’ensemencement de l’océan pour lui faire absorber encore plus de carbone qu’il ne le fait naturellement.
Manuel Bellanger étudie à l’Ifremer le développement des techniques de géo-ingénierie marine avec son regard d’économiste. Cet interview, réalisée par Elsa Couderc, cheffe de rubrique Sciences et Technologies, constitue le second volet de « regards croisés » sur la géo-ingénierie climatique. Dans le premier, nous explorons avec Laurent Bopp, climatologue et académicien, les nouveaux risques climatiques que ces techniques pourraient faire émerger.
The Conversation : La géo-ingénierie marine est mal connue en France, pourtant elle se développe à l’étranger. Qui développe ces projets ?
Manuel Bellanger : En ce qui concerne l’océan, le spectre des acteurs et des techniques de géo-ingénierie est très varié.
Les initiatives les plus prudentes sont en général pilotées par des instituts de recherche, par exemple aux États-Unis ou en Allemagne. Leur finalité est plutôt de comprendre si ces interventions sont techniquement possibles : peut-on développer des méthodes pour capturer du CO₂ atmosphérique par l’océan, mesurer la quantité de carbone stockée durablement, vérifier les affirmations des différents acteurs, étudier les impacts écologiques, tenter de définir des bonnes pratiques et des protocoles ? Ces projets de recherche sont typiquement financés par des fonds publics, souvent sans objectif de rentabilité immédiate.
Il existe aussi des collaborations entre institutions académiques et partenaires privés et, enfin, à l’autre bout du spectre, un certain nombre de start-up qui font la promotion du déploiement rapide et massif de ces techniques.
Peut-on espérer gagner de l’argent grâce à la géo-ingénierie marine ?
M. B. : Le modèle économique de ces start-up repose sur la vente de crédits carbone qu’elles espèrent pouvoir mettre sur les marchés volontaires du carbone – c’est-à-dire qu’elles cherchent à vendre des certificats à des acteurs privés qui veulent compenser leurs émissions.
Pour cela, la séquestration doit être certifiée par des standards ou des autorités. Sachant qu’il y a aussi des initiatives privées qui développent des certifications… aujourd’hui, c’est un peu la jungle, les marchés volontaires du carbone. Et l’achat de ces crédits certifiés reste sur la base du volontariat, puisqu’il n’y a généralement pas d’obligation réglementaire pour les entreprises de compenser leurs émissions.
Pouvez-vous nous donner des exemples de telles start-up et l’état de leurs travaux ?
M. B. : Running Tide, aux États-Unis, a tenté de développer des crédits carbone issus de la culture d’algues sur des bouées biodégradables qui devaient couler sous leur propre poids dans les profondeurs abyssales. Mais ils ne sont pas parvenus à produire des quantités significatives d’algues. L’entreprise a finalement eu recours au déversement de milliers de tonnes de copeaux de bois dans les eaux islandaises pour essayer d’honorer les crédits carbone qu’ils avaient vendus. Mais les experts et observateurs ont critiqué le manque de preuves scientifiques montrant que cette approche permettait réellement de séquestrer du CO₂ et l’absence d’évaluation des impacts sur les écosystèmes marins. L’entreprise finalement a cessé ses activités en 2024 pour des raisons économiques.
Une start-up canadienne, Planetary Technology, développe une approche d’augmentation de l’alcalinité océanique visant à accroître l’absorption du CO₂ atmosphérique et son stockage à long terme sous forme dissoute dans l’océan. Pour cela, ils ajoutent à l’eau de mer du minerai alcalin, de l’hydroxyde de magnésium. Ils ont annoncé avoir vendu des crédits carbone, notamment à Shopify et British Airways.
Une autre société, californienne cette fois, Ebb Carbon, cherche également à augmenter l’alcalinité océanique, mais par électrochimie : ils traitent de l’eau de mer pour la séparer en flux alcalins et acides, puis renvoient la solution alcaline dans l’océan. Cette société a annoncé avoir signé un contrat avec Microsoft pour retirer des centaines de milliers de tonnes de CO₂ sur plusieurs années.
L’écosystème commercial fleurit déjà en Amérique du Nord, même si on n’en entend pas forcément parler ici.
Il y a aussi une sorte de fonds, appelé Frontier Climate, qui engage des contrats anticipés pour des tonnes de CO₂ qui seront retirées de l’atmosphère dans le futur : ils achètent par avance des crédits carbone à des sociétés qui sont en phase de développement et qui ne sont pas encore réellement en train de capturer et de séquestrer du carbone. Derrière ce fonds-là, il y a des géants de la tech, comme Google ou Facebook, parmi les membres fondateurs. On peut supposer que c’est une manière pour ces entreprises, qui ont une consommation énergétique assez importante, de s’acheter une vertu climatique. Donc, eux, ils ont déjà annoncé avoir acheté pour 1,75 million de dollars (plus de 1,5 million d’euros) de crédits carbone à des entreprises d’alcalinisation de l’océan.
Et pourtant, vous disiez tout à l’heure qu’on n’est pas encore sûrs de savoir mesurer scientifiquement si l’océan a bien absorbé ces tonnes de carbone.
M. B. : Effectivement, les bases scientifiques de ces techniques-là ne sont vraiment pas solides aujourd’hui. On ne sait pas encore quelles quantités de CO₂ elles vont permettre de capturer et de séquestrer et on ne sait pas non plus quels vont être les impacts sur l’environnement.
À lire aussi : Géo-ingénierie climatique : de quoi parle-t-on ? Pour quelle efficacité et quels nouveaux risques ?
Et côté scientifique, il n’y a donc pour l’instant pas de consensus sur la capacité des techniques de géo-ingénierie marine à retirer suffisamment de carbone de l’atmosphère pour réellement freiner le changement climatique ?
M. B. : Il y a même pratiquement un consensus scientifique pour dire que, aujourd’hui, on ne peut pas présenter les techniques de géo-ingénierie marine comme des solutions. En fait, tant qu’on n’a pas drastiquement réduit les émissions de gaz à effet de serre, beaucoup considèrent qu’il est complètement futile de vouloir commencer à déployer ces techniques-là.
En effet, aujourd’hui, les ordres de grandeur évoqués (le nombre de tonnes que les entreprises annoncent séquestrer) n’ont rien à voir avec les ordres de grandeur qui permettraient de changer quoi que ce soit au climat. Par exemple, pour la culture de macroalgues, certaines modélisations estiment qu’il faudrait recouvrir 20 % de la surface totale des océans avec des fermes de macroalgues – ce qui est déjà presque absurde en soi – pour capturer (si ça marche) 0,6 gigatonne de CO₂ par an… à comparer aux 40 gigatonnes que l’humanité émet aujourd’hui chaque année. Si ces techniques pouvaient jouer un rôle dans le futur pour compenser les émissions que le Giec désigne comme « résiduelles » et « difficiles à éviter » (de l’ordre de 7 à 9 gigatonnes de CO₂ par an à l’horizon 2050) et atteindre des objectifs de neutralité carbone, les déployer aujourd’hui ne pourrait en aucun cas remplacer des réductions d’émissions rapides et massives.
Alors, qui pousse ces développements technologiques ?
M. B. : Un certain nombre d’initiatives semblent être poussées par ceux qui ont un intérêt au statu quo, peut-être même par certains qui n’auraient pas de réelle volonté de déployer la géo-ingénierie, mais qui ont un intérêt à faire diversion pour retarder l’action qui viserait à diminuer les émissions aujourd’hui.
On pense plutôt aux acteurs des énergies fossiles qu’aux géants de la tech, dans ce cas ?
M. B. : Les acteurs des énergies fossiles ont effectivement cet intérêt à retarder l’action climatique, mais ils sont de fait moins visibles aujourd’hui dans le financement direct des techniques de géo-ingénierie – il semble qu’ils soient plus dans le lobbying et dans les discours qui vont légitimer ce genre de techniques.
De fait, investir dans la géo-ingénierie ne fait-il pas courir le risque de détourner l’attention des citoyens et des gouvernements de l’urgence de réduire nos émissions de gaz à effet de serre ?
M. B. : C’est un risque clairement identifié dans la littérature scientifique, parfois sous le nom d’« aléa moral climatique », parfois d’« effet de dissuasion ». Derrière, il y a l’idée que la promesse de solutions technologiques futures, comme la géo-ingénierie marine, pourrait affaiblir la volonté politique ou sociétale de réduire les émissions dès maintenant. Donc le risque d’être moins exigeants envers nos décideurs politiques pour qu’ils tiennent les engagements climatiques et, in fine, que le décalage entre les objectifs et l’action climatique réelle soit toujours plus grand.
Par ailleurs, on a des ressources financières, ressources en main-d’œuvre, en expertise, qui sont somme toute limitées. Tout ce qui est investi dans la recherche et le développement ou pour l’expérimentation de ces technologies de géo-ingénierie peut se faire au détriment des ressources allouées pour les mesures d’atténuation connues et démontrées : l’efficacité énergétique, les énergies renouvelables, la sobriété. On sait que ces solutions fonctionnent : ce sont elles qu’il faudrait mettre en œuvre le plus rapidement.
La priorité absolue – on n’arrête pas de le répéter –, c’est la diminution rapide des émissions de gaz à effet de serre. Donc la position de la plupart des scientifiques, c’est que ces techniques de géo-ingénierie marine devraient être explorées d’un point de vue de la recherche, par exemple pour évaluer leur efficacité et leurs effets environnementaux, économiques et sociaux, de manière à éclairer les choix politiques et sociétaux à venir. Mais, encore une fois, aujourd’hui la géo-ingénierie marine ne peut pas être présentée comme une solution à court terme.
C’est pour cela que la communauté scientifique appelle à une gouvernance internationale de la géo-ingénierie, avant un déploiement massif de ces techniques. Quelles instances internationales seraient à même de mener une gouvernance sur le sujet ?
M. B. : Il faut en effet que les États s’impliquent fortement dans la gouvernance de la géo-ingénierie, et il faut des traités internationaux. Pour l’instant, c’est assez fragmenté entre différents instruments juridiques, mais il y a ce qu’on appelle le protocole de Londres, adopté en 1996, pour éviter la pollution en mer par dumping (le fait de pouvoir décharger des choses en mer). Ce protocole permet déjà en partie de réguler les usages de géo-ingénierie marine.
Par exemple, la fertilisation des océans par ajout de fer visant à stimuler le phytoplancton qui capture le CO₂ par photosynthèse. Cette technique rentre dans le cadre existant du protocole de Londres, qui interdit la fertilisation de l’océan à des fins commerciales et impose un cadre strict pour la recherche scientifique depuis plus d’une quinzaine d’années. Le protocole pourrait être adapté ou amendé pour réguler d’autres techniques de géo-ingénierie marine, ce qui est plus facile que de créer un nouveau traité international.
Les COP sur le climat sont aussi importantes pour deux raisons : elles rassemblent plus de nations que le protocole de Londres, et elles sont le cadre privilégié pour discuter des marchés carbone et donc pour éviter la prolifération d’initiatives commerciales non contrôlées, pour limiter les risques environnementaux et les dérives du type crédits carbone douteux.
Il y a des précédents avec ce qu’il s’est passé sur les crédits carbone forestiers : une enquête publiée par le Guardian en 2022 a montré que plus de 90 % des projets certifiés par Verra – le principal standard mondial – n’ont pas empêché la déforestation ou ont largement surévalué leurs bénéfices climatiques. Sans encadrement, la géo-ingénierie marine pourrait tout à fait suivre le même chemin.
Enfin, il y a bien sûr des enjeux d’équité, si ceux qui mettent en œuvre une action ne sont pas ceux qui risquent de subir les impacts ! Là aussi, il y a des précédents observés sur des projets forestiers certifiés pour générer des crédits carbone, où les bénéfices économiques sont captés par les investisseurs tandis que les communautés locales subissent des restrictions d’accès aux ressources forestières ou sont exposées à des changements dans leur mode de vie.
Concrètement, quels sont les risques pour les populations qui vivent à proximité de l’océan ou s’en servent de ressource nourricière, par exemple ?
M. B. : Ça dépend vraiment de la technique de géo-ingénierie utilisée et de l’endroit où ça va être déployé. Par exemple, si on imagine un déploiement massif de cultures d’algues, ça pourrait modifier les écosystèmes côtiers, et par ailleurs générer une concurrence pour l’espace avec la pêche ou l’aquaculture traditionnelle.
Sur les littoraux, où les activités maritimes sont souvent très denses, il y a déjà des conflits d’usage, que l’on observe par exemple dans les tensions autour des installations de parcs éoliens en mer.
Propos recueillis par Elsa Couderc.
Manuel Bellanger a reçu des financements dans le cadre du programme ANR n° 21-POCE-0001 PPR Océan & Climat.
21.01.2026 à 11:36
Géo-ingénierie climatique : de quoi parle-t-on ? Pour quelle efficacité et quels nouveaux risques ?
Texte intégral (3491 mots)
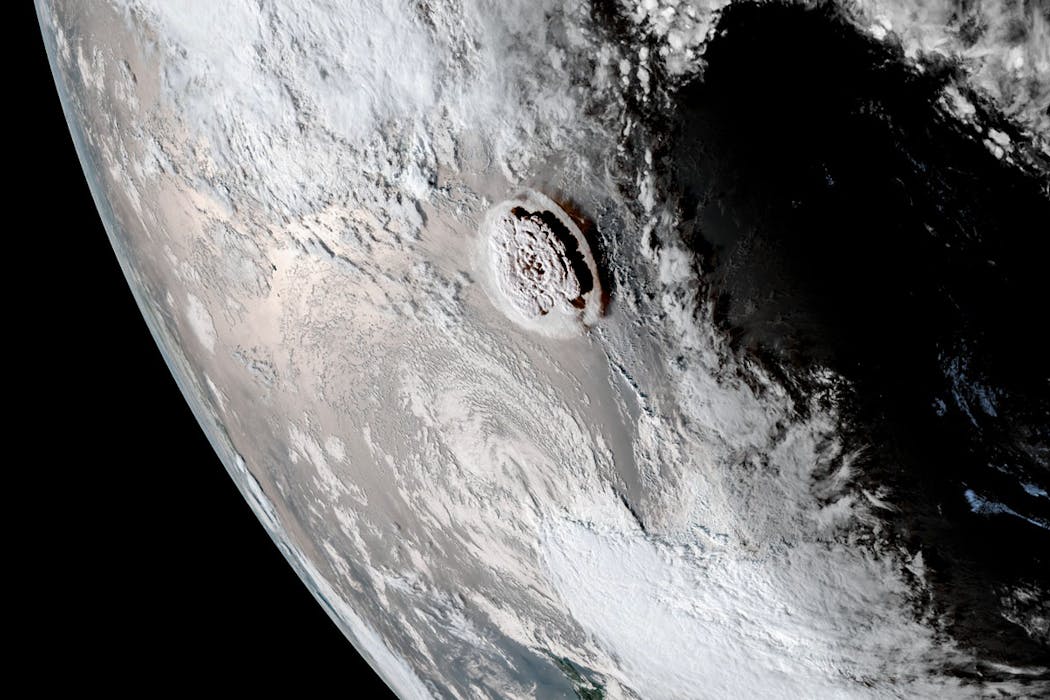
La « géo-ingénierie climatique » recouvre un ensemble de techniques qui visent à manipuler le climat à grande échelle afin d’éviter les risques du changement climatique. Ces techniques sont très variées, depuis les parasols spatiaux pour limiter l’arrivée des rayons du soleil dans l’atmosphère jusqu’à la fertilisation des océans pour que le phytoplancton consomme davantage de CO₂, en passant par la restauration et la conservation de zones humides où le carbone est stocké de façon préférentielle.
En octobre 2025, l’Académie des sciences a publié un rapport qui détaille ce que l’on sait et ce que l’on ignore encore sur les éventuels bénéfices de ces techniques et sur les nouveaux risques qu’elles font surgir.
Elsa Couderc, cheffe de rubrique Sciences et Technologies, explore ici avec Laurent Bopp, climatologue et académicien, les nouveaux risques climatiques que ces techniques pourraient faire émerger. Le second volet de ces « regards croisés » est un entretien avec Manuel Bellanger, qui étudie à l’Ifremer le développement des techniques de géo-ingénierie marine avec un regard d’économiste.
The Conversation : Pourquoi l’Académie des sciences s’empare-t-elle aujourd’hui du sujet de la géo-ingénierie climatique, alors qu’on en parle relativement peu en France ?
Laurent Bopp : Le sujet est de plus en plus présent dans la littérature scientifique, dans le débat scientifique et dans le débat politique qui entoure les discussions sur le changement climatique. On ne s’en rend pas bien compte en France, mais aux États-Unis, en Angleterre, en Allemagne, au Canada, le débat est beaucoup plus présent.
Certains climatologues, y compris de renom, se prononcent pour faire beaucoup plus de recherches sur ces technologies, mais aussi parfois pour envisager leur déploiement à grande échelle afin d’éviter un réchauffement trop important. L’argument est simple : un niveau de réchauffement trop élevé génère des risques importants et pourrait conduire au dépassement de certains points de bascule potentiels dans le système climatique, par exemple une fonte irréversible des calottes glaciaires du Groenland et de l’Antarctique, ce qui pourrait entraîner une élévation du niveau de la mer de plusieurs mètres additionnels.
En France, nous avons besoin collectivement de plus d’informations et de plus de débats autour de ces techniques. Nous avons eu le sentiment que certains de nos représentants se sont retrouvés en partie dépourvus dans des arènes de négociations internationales, face à des représentants d’autres gouvernements qui ont un agenda très agressif sur ces technologies. C’est sans doute une des raisons pour lesquelles l’Académie des sciences s’est emparée du sujet.
L’idée des interventions de géo-ingénierie climatique, c’est de réduire les risques liés au changement climatique. Mais ces interventions pourraient-elles induire de nouveaux risques et lesquels ?
L. B. : Un des intérêts de ce rapport, c’est de mettre la lumière sur ces nouveaux risques.
Mais, avant de rentrer dans le détail, il faut, quand nous parlons de géo-ingénierie climatique, distinguer deux grandes catégories de techniques – ces deux catégories sont fondées sur des approches très différentes et présentent des risques, là aussi, très différents.
Pour la première de ces catégories, il s’agit de modifier de façon assez directe le rayonnement solaire. On parle en anglais de Solar Radiation Management ou SRM. Dans ce cas-là, l’action s’apparente plutôt à une sorte de pansement sur la plaie d’une blessure, sans s’attaquer du tout à la cause du changement climatique : l’idée est de refroidir la Terre de façon artificielle, en utilisant par exemple des particules atmosphériques ou des miroirs spatiaux qui limiteraient la pénétration du rayonnement solaire jusqu’à la surface de la Terre. Ce refroidissement pourrait compenser, en partie au moins, le réchauffement lié aux gaz à effet de serre qui continueraient à augmenter dans l’atmosphère.
L’injection d’aérosols dans la haute atmosphère vise à imiter des éruptions volcaniques de très grande taille qui, par le passé, ont pu refroidir la Terre. Une des limites premières de cette approche, c’est que cette façon de refroidir la Terre est très différente de la façon dont elle se réchauffe aujourd’hui à cause des gaz à effet de serre : les échelles de temps et les échelles spatiales associées sont très différentes, et cela engendre un certain nombre de conséquences. Les risques sont à lire en fonction de ces deux échelles.
Les aérosols que l’on pourrait injecter dans la haute atmosphère ont une durée de vie courte. Ils vont disparaître de l’atmosphère assez rapidement, tandis que les gaz à effet de serre qui réchauffent le système Terre, le CO₂ en particulier, sont dans l’atmosphère pour très longtemps.
Cette différence majeure entraîne l’un des risques les plus préoccupants : le risque de « choc terminal ». Concrètement, si l’on décidait d’arrêter brutalement l’injection d’aérosols après s’être engagé dans ce type de stratégie
– et les raisons pourraient être multiples, qu’il s’agisse de problèmes de gouvernance, de financement ou de conflits internationaux – le réchauffement climatique jusque-là partiellement masqué réapparaîtrait d’un seul coup. On subirait alors, en très peu de temps, plusieurs années de réchauffement accumulé. On aurait des taux de réchauffement temporels très très rapides, et donc des conséquences sur la biodiversité ou sur les sociétés humaines difficiles à anticiper.
En d’autres termes, si le réchauffement arrive relativement lentement, la mise en place de mesures d’adaptation est possible ; s’il est très rapide, les conséquences sont potentiellement bien plus dévastatrices.
L’autre risque majeur est lié aux échelles spatiales : refroidir avec des aérosols par exemple, ce n’est pas du tout la même chose que ne pas refroidir en émettant moins de CO₂. Les effets régionaux du refroidissement vont être très différents de ce qu’ils auraient été si on avait réchauffé un peu moins. La localisation des précipitations, l’intensité de la mousson notamment ont des conséquences sur l’agriculture, sur la santé. Sur ces effets régionaux, il y a encore beaucoup d’incertitudes aujourd’hui, c’est quelque chose que les modèles décrivent moins bien que les effets temporels dont je parlais tout à l’heure.
À lire aussi : Parasols géants et blanchiment du ciel : de fausses bonnes idées pour le climat
Face à ce risque majeur, l’Académie recommande d’arrêter le déploiement des techniques de modification du rayonnement solaire, et même les recherches sur cette technique de géo-ingénierie…
L. B. : Effectivement, notre rapport recommande de ne pas utiliser ces techniques, et nous allons même jusqu’à suggérer un traité international qui interdirait leur déploiement.
Nous pensons aussi qu’il ne faut pas financer, de façon importante, de la recherche qui soit spécifiquement fléchée sur ces techniques de modification du rayonnement solaire, pour éviter de légitimer ces approches trop dangereuses.
Bien sûr, nous avons besoin de bien plus de recherche sur le climat et sur les processus climatiques importants, donc sur les processus qui lient, par exemple, les aérosols dans la haute atmosphère avec la modification du rayonnement, mais nous pensons vraiment qu’il faut éviter les projets fondamentalement pensés pour pousser l’avènement de ces technologies. Les risques associés sont trop importants.
La géo-ingénierie climatique inclut une deuxième approche, celle qui consiste à augmenter l’efficacité des puits de carbone naturels, par exemple les forêts, les tourbières ou les océans qui absorbent naturellement du carbone. En quoi est-ce fondamentalement différent de la modification du rayonnement solaire ?
L. B. : Il ne s’agit plus de refroidir la Terre pour compenser un réchauffement qui serait lié à l’augmentation des gaz à effet de serre, mais d’éliminer du CO₂ qui est déjà présent dans l’atmosphère. Le terme consacré est celui d’« élimination du dioxyde de carbone », ou Carbon Dioxide Removal (CDR) en anglais.
D’abord, soyons clairs : la priorité des priorités reste de réduire les émissions actuelles de façon drastique. Ces « puits de carbone » additionnels ne doivent intervenir que comme un complément, après la réduction des émissions de façon massive et immédiate.
Pour stabiliser le climat et répondre aux objectifs de l’accord de Paris à 1,5 ou 2 °C de réchauffement par rapport à l’époque préindustrielle, nous avons besoin d’aller collectivement vers des émissions nettes nulles !
Comme il y aura sans doute des secteurs difficiles à décarboner, comme la sidérurgie ou le transport aérien, nous savons qu’il y aura sans doute besoin d’un peu de ces puits de carbone pour compenser ces émissions résiduelles.
On est donc sur une ligne de crête compliquée à tenir : ne pas mettre ces techniques d’élimination du CO₂ en avant, pour ne pas décourager la réduction des émissions – en raison du potentiel de décarbonation limité de ces techniques, nous allons y revenir – et en même temps continuer à soutenir la recherche sur ces technologies parce qu’elles pourraient se révéler utiles, au moins dans une certaine mesure.
En augmentant l’efficacité des puits de carbone naturels, si on reprend l’analogie avec le pansement et la blessure, on ne s’attaque toujours pas à la cause (l’émission de gaz à effet de serre), mais on remonte dans la chaîne de causalité en s’attaquant à quelque chose de plus amont que dans le cas de la modification du rayonnement solaire.
Il existe de nombreux types de méthodes d’élimination du CO₂, à la fois naturelles et technologiques. Présentent-elles toutes le même potentiel et les mêmes risques ?
L. B. : Pour éliminer du CO₂ déjà dans l’atmosphère, il y a une très grande diversité de techniques, en partie parce qu’il existe plusieurs « réservoirs » dans lesquels il serait possible de stocker le CO₂ retiré de l’atmosphère : dans le sous-sol, dans l’océan, dans la biomasse continentale.
Pour simplifier, je dirais qu’il y a une série de techniques qui sont aujourd’hui considérées comme « gagnant-gagnant » : elles permettent de retirer du CO₂ de l’atmosphère et elles ont d’autres bénéfices.
Prenons par exemple la restauration et la conservation des écosystèmes côtiers, comme les mangroves ou les herbiers marins : ces actions permettent un stockage de carbone et, par exemple, de mieux protéger les côtes contre la montée du niveau marin et les épisodes de submersion côtière. D’autres techniques, en foresterie, en agroforesterie ou en stockant le carbone dans les sols, permettent aussi de développer des pratiques agricoles qui sont plus vertueuses.
Malheureusement, comme évoqué dans le rapport, ces approches sont difficiles à mettre à l’échelle, en raison des surfaces souvent limitées et des quantités phénoménales de carbone qu’il faudrait pouvoir stocker dans ces réservoirs naturels pour avoir un effet significatif.
Et puis il y a, à l’autre bout du spectre, des techniques qui sont jugées peu efficaces et dont on sait qu’elles ont sans doute des effets dommageables sur les écosystèmes. Compte tenu des connaissances actuelles, l’Académie des sciences recommande de ne pas poursuivre dans ces directions-là.
L’exemple le mieux documenté est celui de la fertilisation par le fer du plancton marin, car elle a été envisagée il y a déjà longtemps, à la fin des années 1980. L’idée est d’aller en pleine mer, dans des régions où le développement du phytoplancton est limité par la faible abondance d’un nutriment bien particulier : le fer. Dans ces régions, il n’y a pas besoin d’ajouter beaucoup de fer pour fertiliser le plancton, qui va se développer davantage, et pour cela absorber plus de CO₂. Une partie de la matière organique produite coule ensuite vers les profondeurs de l’océan, emportant avec elle le carbone qu’elle contient. Ce carbone est ainsi isolé de l’atmosphère dans l’océan profond, potentiellement pour des centaines d’années.
Plusieurs expériences scientifiques ont été menées en pleine mer dans les années 1990 et 2000. À court terme, elles ont effectivement mis en évidence une augmentation du flux de carbone de l’atmosphère vers l’océan.
Toutefois, des travaux plus récents, notamment fondés sur la modélisation, montrent que cette technique est probablement beaucoup moins efficace qu’on ne l’imaginait initialement. Surtout, en modifiant fortement les écosystèmes marins pour capter du carbone, elle entraîne toute une série d’effets indésirables : l’émission d’autres gaz à effet de serre, une diminution de l’oxygène dans les eaux profondes, ou encore l’épuisement de certains nutriments essentiels, qui ne sont alors plus disponibles pour d’autres écosystèmes.
Ces constats ont conduit la communauté internationale à réagir. En 2008, les États ont amendé le protocole de Londres afin d’y introduire une interdiction de ce type de pratiques en haute mer.
Dans le cas de la fertilisation des océans, les risques sont donc bien documentés – ils ne concernent pas directement le climat mais des dommages collatéraux ?
L. B. : Oui. Malheureusement, on voit en ce moment une résurgence de certains projets poussés par certains chercheurs qui continuent à défendre ce type de techniques, par exemple aux États-Unis. Mais pour nous, il semble clair qu’il ne faut pas recommander ces techniques aux effets collatéraux bien documentés.
À lire aussi : Géo-ingénierie marine : qui développe ces grands projets, et qu’y a-t-il à y gagner ?
Entre les techniques trop risquées, comme la fertilisation des océans, et les techniques de conservation et de restauration, que j’appelais « gagnant-gagnant » tout à l’heure, il y a d’autres techniques, pour lesquelles on a besoin de davantage de recherche – c’est le cas, par exemple, des techniques d’alcalinisation de l’océan.
Il s’agit d’une technique chimique cette fois : on augmente le pouvoir tampon de l’océan en ajoutant du matériel alcalin. Un des points positifs, c’est que cette technique consiste en l’accélération d’un phénomène naturel qui est l’altération des roches sur les continents. Quand les roches s’altèrent, elles apportent de l’alcalinité à l’océan, donc elles augmentent le pouvoir tampon de l’océan qui absorbe plus de CO₂ – c’est un processus très lent, qui a un rôle très important sur les échelles de temps très, très longues et qui régule en partie le cycle du carbone sur les échelles de temps géologiques.
Deuxième avantage : le CO2 ainsi stocké dans l’océan l’est de manière très durable, bien plus que dans des approches reposant sur du carbone organique (comme la fertilisation des océans) où le stockage est beaucoup plus incertain. Troisième point positif, cette augmentation de l’alcalinité permet aussi de réduire partiellement l’acidification des océans.
Mais ces bénéfices s’accompagnent de nombreuses incertitudes et de risques. Ajouter des matériaux alcalins modifie parfois fortement la chimie de l’eau de mer. Quels effets cela pourrait-il avoir sur les écosystèmes marins, le plancton ou les espèces côtières dont dépendent de nombreuses populations humaines ? À ce stade, nous manquons encore de données pour répondre clairement à ces questions.
L’efficacité même de la technique reste également incertaine. Pour qu’elle fonctionne, l’alcalinité ajoutée doit rester dans les couches de surface de l’océan, là où les échanges avec l’atmosphère ont lieu. Si elle est rapidement entraînée vers les profondeurs, son impact sur l’absorption du CO₂ devient très limité.
Enfin, il y a beaucoup de questions sur le coût de ces techniques. En particulier, un certain nombre de start-up et d’entreprises s’orientent vers des méthodes électrochimiques, mais c’est très coûteux d’un point de vue énergétique. Il faut faire le bilan sur l’ensemble du cycle de vie de ces techniques.
En somme, on a une gamme de techniques, parfois appelées abusivement « solutions » : certaines que l’on ne recommande pas aujourd’hui parce que les risques sont énormes ; d’autres qu’il faut prioriser et recommander, mais qui ont une efficacité somme toute limitée. Et puis entre les deux, des méthodes sur lesquelles il faut continuer à travailler.
À l’échelle internationale, où et quand se discutent les nouveaux risques des techniques de géo-ingénierie climatique ?
L. B. : La question des puits de carbone est déjà largement débattue dans le cadre des COP Climat, notamment parce que les gouvernements peuvent les intégrer dans leurs objectifs de réduction des émissions. C’est le cas, par exemple, des stratégies d’afforestation (boisement) et de reforestation. En revanche, il reste encore beaucoup de travail à faire sur les modalités concrètes de mise en œuvre de certaines techniques d’élimination du CO₂ que nous avons évoquées. En particulier, les questions de mesure et de vérification du CO₂ réellement retiré de l’atmosphère sont complexes et loin d’être résolues. Le Giec a d’ailleurs été mandaté par les gouvernements pour produire un rapport méthodologique spécifiquement consacré à ces enjeux.
En ce qui concerne la modification du rayonnement solaire, mon inquiétude est nettement plus forte. Certains pays affichent désormais ouvertement leur intérêt pour un déploiement potentiel de ces techniques.
Dans le prochain rapport du Giec, la géo-ingénierie occupera une place plus importante que dans les précédents. J’espère que cela permettra de documenter de façon précise et convaincante les risques potentiels associés à ces approches.
Propos recueillis par Elsa Couderc.
Bopp Laurent a reçu des financements du CNRS, de l'Agence Nationale de la Recherche, de la Fondation pour la Recherche sur la Biodiversité, du Programme Horizon Europe de la Commission Européenne, et de la Fondation Schmidt Sciences.
20.01.2026 à 16:58
Des planètes errantes, sans étoile, découvertes par le satellite Euclid
Texte intégral (1657 mots)

Sa mission est de cartographier le cosmos pour en dévoiler les mystères. Mais au passage, le satellite Euclid a découvert une quinzaine d’exoplanètes sans étoiles : des planètes errantes. On en connaît peu, mais Euclid et de futurs satellites devraient nous aider à comprendre leur formation.
Lorsque le télescope spatial Euclid de l’Agence spatiale européenne (ESA) a été lancé en 2023, son objectif était d’explorer l’un des plus grands mystères de l’Univers : le côté obscur du cosmos. En cartographiant des milliards de galaxies, Euclid doit aider à révéler la nature de la mystérieuse énergie noire qui serait le moteur de l’évolution du cosmos. Il n’avait pas été conçu pour étudier les régions de formation d’étoiles ni pour traquer des planètes.
Mais quelques mois après son lancement, l’ESA a mis en place le programme d’observations préliminaires d’Euclid (Euclid early release observations, ou ERO). Ce programme vise à démontrer les performances exceptionnelles du télescope à travers une large gamme d’objets astrophysiques, qu’il s’agisse de galaxies et d’amas lointains ou de régions de formation d’étoiles beaucoup plus proches. Cela permet de mettre en lumière la polyvalence et la précision des instruments d’Euclid, et prouver leur valeur bien au-delà de sa mission principale de cosmologie.
Des planètes sans soleil
Par définition, les planètes sont censées orbiter autour d’étoiles. Mais certaines sont solitaires, errant dans l’espace interstellaire sans étoile pour les réchauffer. Ces planètes errantes, comme on les surnomme, sont de véritables orphelines du cosmos. On pense qu’elles peuvent s’être formées comme des mini-étoiles, à partir de l’effondrement de petits nuages de gaz et de poussières.
Une autre hypothèse y voit de vraies planètes, nées autour d’une étoile et ayant été violemment éjectées de leur système d’origine. Les détecter et les étudier permet ainsi aux astronomes de mieux comprendre à la fois la formation des étoiles et la formation et l’évolution précoce (et parfois chaotique) des systèmes planétaires.
Jusqu’à présent, repérer ces corps discrets relevait presque de l’impossible tant la lumière qu’ils émettent est faible. Ils sont aussi très difficiles à distinguer d’autres objets astrophysiques, en particulier de galaxies lointaines. Mais Euclid, grâce à la combinaison unique d’un grand champ de vision, d’une résolution fine et d’une sensibilité allant de la lumière visible à l’infrarouge, a changé la donne.
Euclid prend le Taureau par les cornes
Lorsque l’ESA a proposé à la communauté scientifique de participer au programme ERO, notre équipe a suggéré de pointer Euclid vers une région de formation d’étoiles bien connue : le nuage LDN 1495, au sein de la constellation du Taureau, situé à environ 450 années-lumière. Cette région sombre, où le gaz et la poussière se condensent pour former de jeunes étoiles, est étudiée depuis des décennies, mais ne l’avait jamais été avec la précision et la sensibilité fournie par Euclid.
Les observations d’Euclid ont été combinées à plus de vingt ans d’imagerie au sol accumulée par notre équipe et obtenue avec des télescopes, comme le Canada-France-Hawaii Telescope (CFHT), Subaru ou UKIRT, tous les trois situés sur le sommet du volcan Mauna Kea dans l’archipel hawaiien (États-Unis). Cette longue période d’observation nous a permis de mesurer les mouvements, les luminosités et les couleurs de centaines de milliers de sources faibles dans ces images.
Parmi elles, 15 objets se distinguent. Leur luminosité, leur couleur et leur mouvement correspondent à ceux attendus pour des objets qui se sont formés dans les nuages moléculaires du Taureau. Ces objets partagent certaines propriétés : étant nés à peu près ensemble, ils sont tous jeunes (quelques millions d’années), situés à une distance similaire (celle des nuages, d’environ 425 à 490 années-lumière) et se déplacent ensemble à la même vitesse et dans la même direction dans le ciel, ayant hérité du mouvement du nuage moléculaire où ils sont nés. Neuf de ces quinze objets sont totalement nouveaux, et parmi les plus faibles et les moins massifs jamais détectés dans cette région.
Certains de ces candidats sont incroyablement petits : d’après leur luminosité extrêmement faible, ils pourraient avoir des masses proches ou légèrement supérieures à celle de Jupiter. C’est bien en dessous du seuil de masse d’une étoile ou même d’une naine brune, un astre plus gros qu’une planète, mais trop petit pour être une étoile. Cela les place donc clairement dans la catégorie des objets de masse planétaire. S’ils sont confirmés, ils compteraient parmi les objets les plus légers jamais détectés de manière directe en dehors d’un système solaire.
Une fenêtre sur les origines cosmiques
Cette découverte est bien plus qu’une curiosité : elle ouvre une fenêtre directe sur la façon dont l’Univers fabrique ses étoiles et ses planètes. Ces mondes solitaires se forment-ils de la même manière que les étoiles, à partir de petits fragments de nuages qui s’effondrent sous l’effet de la gravité ? Ou bien sont-ils les orphelins de systèmes planétaires, expulsés par le chaos gravitationnel de leur famille ?
Chacun de ces deux scénarios a des implications différentes pour notre compréhension des premiers stades de la formation stellaire, mais aussi de la formation des planètes. Dans des régions comme la constellation du Taureau, où la densité d’étoiles est faible et les étoiles massives sont rares, ces objets de masse planétaire pourraient se former directement par effondrement gravitationnel, brouillant encore davantage la frontière entre planète et étoile.
Les résultats de notre équipe suggèrent également que ces planètes errantes pourraient ne pas être si rares. En extrapolant nos résultats à l’ensemble du complexe du Taureau, on peut estimer que des dizaines d’entre elles, encore à découvrir, pourraient exister dans cette région.
Un Univers plein de surprises
Ce travail ne constitue qu’une première étape. Euclid a déjà observé d’autres régions de formation d’étoiles dans le cadre du programme ERO, actuellement en cours d’analyse, et pourrait en observer à nouveau à l’avenir, offrant ainsi des mesures de mouvements encore plus précises et des recensements plus complets.
À moyen terme, le futur télescope spatial Nancy-Grace-Roman, dont le lancement est prévu à l’automne 2026, disposera de capacités similaires et complémentaires en grand champ et en infrarouge. Ensemble, ces télescopes ouvriront une ère nouvelle pour l’étude systématique des objets de très faible masse dans les jeunes régions du cosmos.
Enfin, le James-Webb Space Telescope jouera un rôle clé dans le suivi de ces découvertes, en fournissant les observations spectroscopiques indispensables pour confirmer la nature, la masse et la composition des atmosphères de ces mondes errants. Ces missions dessinent un avenir particulièrement prometteur pour l’exploration des origines des étoiles et des planètes errantes.
À lire aussi : Euclid vs James-Webb : le match des télescopes spatiaux ?
Chaque nouveau grand télescope finit par accomplir des découvertes qu’il n’était pas censé faire. Le télescope spatial Hubble a révolutionné la cosmologie, mais il nous a aussi offert des vues spectaculaires des pouponnières d’étoiles. Aujourd’hui, Euclid, construit pour cartographier le squelette invisible du cosmos, révèle de nouveaux mondes en formation flottant dans l’Univers sans attache et sans étoile. Petits, froids et solitaires, ces mondes vagabonds nous rappellent que la frontière entre planète et étoile est mince et que, même dans l’obscurité entre les étoiles, il reste des histoires à découvrir.
Hervé Bouy est membre senior de l'Institut Universitaire de France. Il a reçu des financements du Conseil européen pour la recherche (ERC) et a été employé à l'Agence spatiale européenne (ESA).
19.01.2026 à 16:25
La microscopie de fluorescence à super-résolution : véritable tournant technologique dans l’analyse de la dynamique des mitochondries
Texte intégral (1910 mots)
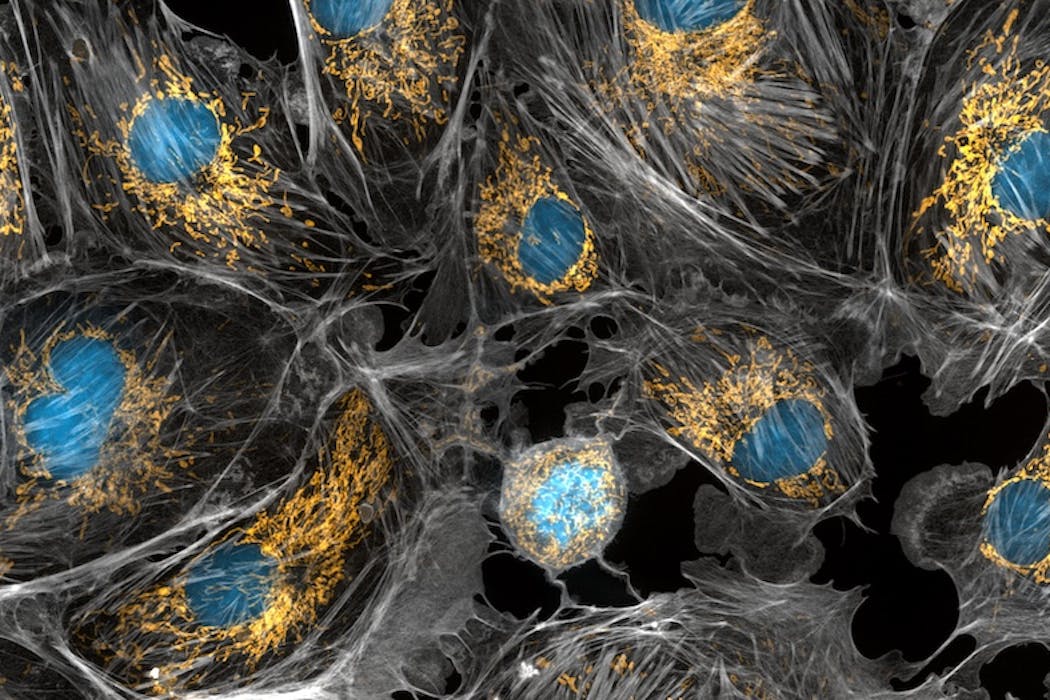
Explorer l’intérieur de nos cellules et leurs compartiments, tout en identifiant chaque protéine pour les cartographier, préciser leurs interactions et déchiffrer de nouveaux mécanismes biologiques… c’est désormais à notre portée grâce au développement de microscopes de super-résolution. Grâce à ces nouvelles techniques, les mitochondries, composants clés des cellules impliqués dans de nombreuses pathologies, révèlent une partie de leurs mystères.
Les mitochondries sont principalement connues pour être les centrales énergétiques de nos cellules, car elles y sont responsables de la production d’énergie et de chaleur. Elles participent également à la synthèse de nombreuses molécules et assurent un contrôle crucial sur la vie et la mort des cellules. Récemment, des microscopes ultrasophistiqués ont permis de mettre à jour l’incroyable vie active des mitochondries, qui se déplacent, fusionnent entre elles et se séparent.
Ces progrès sont cruciaux car les mitochondries sont impliquées dans de nombreuses atteintes neurodégénératives, maladies cardio-vasculaires et cancers. Comprendre comment les mitochondries endommagées contribuent au processus d’une maladie est essentiel pour le développement de traitements.
Les mitochondries, un réseau en reconfiguration perpétuelle
Dans la plupart des cellules et des tissus, les mitochondries ont la forme de tubes, plus ou moins longs. Les mitochondries s’adaptent à la taille et aux besoins énergétiques des cellules, ainsi dans les larges cellules énergivores, il peut y avoir plus de 200 000 mitochondries par cellules tandis que dans d’autres cellules, il y aurait moins de 100 mitochondries. En fonction de l’organe d’origine de la cellule, les mitochondries se répartissent dans la cellule et forment de grands réseaux. Elles changent également sans cesse de formes et leurs attachements avec les autres structures de la cellule.
Dès les années 1950, les données de microscopies électroniques ont révélé la structure de ces petits tubes et précisé leur organisation membranaire. Leur membrane externe est doublée d’une membrane interne, qui s’invagine et forme des poches à l’intérieur des mitochondries. Ces poches sont appelées crêtes et sont le lieu de la synthèse d’énergie.
Pour bien comprendre la fonction des mitochondries, il faut donc s’intéresser à leur structure, leur dynamique et leur distribution. Un axe important de travaux scientifiques porte sur cette relation structure-fonction afin de découvrir de nouveaux moyens de protéger la morphologie mitochondriale et de développer des stratégies thérapeutiques pour lutter contre les maladies mitochondriales ou les atteintes neurodégénératives.
La microscopie de fluorescence, la clé pour le suivi des mitochondries en temps réel
Si la microscopie électronique permet d’obtenir des vues extrêmement détaillées des mitochondries, son utilisation ne permet pas de rendre compte de la complexité de leur organisation au sein des cellules, ni de leur nature dynamique. En effet, ce type de microscopie se limite à des images cellulaires figées dans le temps. C’est ici qu’intervient la microscopie de fluorescence, un domaine en pleine effervescence qui permet de capturer des images ou des vidéos.
La microscopie de fluorescence repose sur le principe d’excitation et d’émission contrôlées de photons, particules composant la lumière, par des molécules présentes dans les cellules. Contrairement aux microscopes à fond clair, qui sont les microscopes les plus simples, comme ceux utilisés en cours de sciences, et où l’image est générée à partir des signaux collectés après le passage de la lumière à travers l’échantillon, les microscopes à fluorescence collectent les signaux lumineux qui proviennent de l’objet biologique lui-même, comme des petites ampoules que l’on allumerait au cœur de la cellule.
Le développement de l’informatique et des capteurs de caméra sensibles et rapides ont également rendu possible le suivi des signaux dans le temps, et la quantification des mouvements de chaque compartiment des mitochondries.
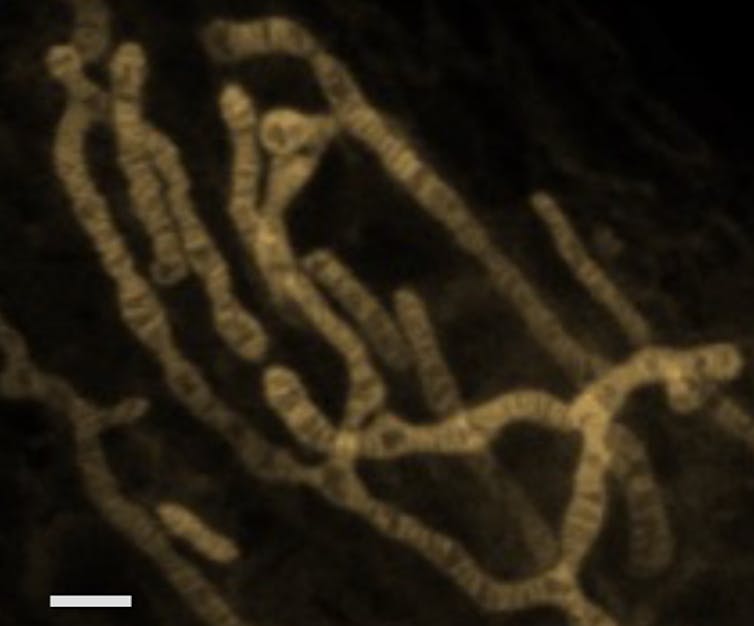
La super-résolution, quand la science éclaire l’invisible
Pour aller plus loin que ces observations déjà fascinantes de réseaux de mitochondries, la microscopie de fluorescence ne suffit pas. En effet, en microscopie optique, les objets plus petits qu’une certaine taille, environ 200-300 nanomètres radialement et 500-700 nanomètres axialement, ne peuvent pas être distingués. En effet, selon un principe physique, la diffraction de la lumière, soit la déviation des rayons lumineux, fait qu’un émetteur unique apparaît comme une tache sur la caméra – on parle de figure de diffraction, et plus précisément ici de « fonction d’étalement du point ».
Cette limitation entrave l’observation précise de structures complexes telles que les mitochondries du fait de leur taille qui est similaire à la limite de diffraction.
La microscopie de fluorescence à super-résolution (microSR) a changé la donne dans le domaine de la recherche biologique depuis les années 2000. Grâce à cette technologie, les scientifiques peuvent pénétrer dans le monde nanoscopique et observer en temps réel les structures complexes et les interactions des composants cellulaires. La microscopie de fluorescence à super-résolution englobe quatre techniques principales, dont l’une a été récompensée par le prix Nobel de chimie en 2014.
Chacune de ces techniques s’attaque à la limite de diffraction d’une manière unique, permettant de séparer des points situés à moins de 200 nanomètres. Cette avancée permet aux chercheurs d’atteindre des résolutions spatiales de quelques nanomètres, dévoilant ainsi les détails les plus fins des structures cellulaires comme jamais auparavant. Restreints il y a encore peu de temps à quelques laboratoires prestigieux dans le monde, ces équipements se démocratisent et se déploient dans les plates-formes de microscopie.
La mitochondrie sous un nouveau jour, dévoilée à l’échelle nanométrique
Nous avons utilisé un type de microscopie de fluorescence à super-résolution, la microscopie de localisation de molécules uniques, qui nous a permis d’identifier les protéines sur les membranes des mitochondries et de les cartographier.
Avec un autre type de microscopie de fluorescence à super-résolution, nous avons visualisé le contour des crêtes, retrouvant ainsi le visuel connu d’une image de microscopie électronique… à ceci près qu’aucun traitement chimique liée à la fixation de l’échantillon n’est venu perturber l’organisation de ces fines membranes et fragiles petites poches. Ceci permet de découvrir la complexité interne des mitochondries et l’hétérogénéité de ses structures, afin de corréler la morphologie des mitochondries à leur activité ou à la présence de défaut génétique.
Ces images donnent accès à deux échelles de temps, c’est-à-dire deux niveaux de cinétique. D’une part, sur quelques minutes durant lesquelles nous pouvons observer, nous voyons que les mitochondries se déplacent, changent de forme, fusionnent entre elles ou se séparent.
D’autre part, toujours avec la microscopie de super résolution, nous pouvons observer sur quelques secondes, toute l’ondulation et le remodelage des structures internes des mitochondries nécessaires à la production d’énergie.
Ainsi, on découvre que les mitochondries ne sont pas de simples centrales énergétiques cellulaires mais des organites dynamiques possédant de nombreuses particularités nanoscopiques. La microscopie de super résolution permet d’envisager une meilleure compréhension de comment les mitochondries endommagées contribuent au processus de nombreuses maladies, ce qui est essentiel pour le développement de traitements.
Arnaud Chevrollier a reçu des financements de l'Université d'Angers, AFM-téléthon
Pauline Teixeira et Solenn Plouzennec ne travaillent pas, ne conseillent pas, ne possèdent pas de parts, ne reçoivent pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'ont déclaré aucune autre affiliation que leur poste universitaire.
19.01.2026 à 16:06
L’origine du « moustique du métro de Londres » enfin résolue
Texte intégral (1810 mots)
Longtemps présenté comme un exemple spectaculaire d’adaptation rapide à l’urbanisation, le « moustique du métro de Londres » n’est en réalité pas né dans les tunnels londoniens, comme on le pensait jusqu’ici. Une nouvelle étude retrace ses origines et montre qu’elles sont bien plus anciennes que ce que l’on imaginait. Elles remonteraient à plus de mille ans, en lien avec le développement des sociétés agricoles.
Et si le « moustique du métro de Londres », surtout connu pour ses piqûres sur les populations réfugiées à Londres dans les sous-sols de la ville pendant la Seconde Guerre mondiale, n’était en réalité pas né dans les tunnels londoniens ? C’est ce que révèle une étude que nous avons récemment publiée avec des collègues.

Nos résultats montrent que les caractéristiques « urbaines » de ce moustique, que l’on pensait s’être adapté à la vie souterraine il y a un peu plus d’un siècle, remontent en fait à plus de mille ans.
Le moustique Culex pipiens molestus, qui diffère de son cousin Culex pipiens pipiens dans la mesure où le premier pique surtout des humains, et le second surtout des oiseaux, est probablement né dans la vallée du Nil ou au Moyen-Orient, en lien avec le développement des premières sociétés agricoles humaines.
À lire aussi : Combien de temps un moustique peut-il survivre sans piquer un humain ?
Le « moustique du métro de Londres » n’est pas né dans le métro
Cette découverte jette une lumière nouvelle sur l’évolution des moustiques. Depuis plusieurs décennies, une hypothèse présentait en effet le moustique commun (Culex pipiens) comme un exemple spectaculaire d’adaptation rapide à l’urbanisation.
Selon cette théorie, une forme particulière de ce moustique, appelée Culex pipiens molestus, se serait adaptée à la vie urbaine en un peu plus de cent ans seulement, à partir de sa forme jumelle Culex pipiens pipiens. Là où celle-ci préfère piquer les oiseaux, s’accoupler dans des espaces ouverts et « hiberner » pendant l’hiver, la forme molestus aurait évolué en une forme quasi distincte, capable de vivre dans les souterrains et de piquer l’humain et d’autres mammifères, de s’accoupler dans des souterrains et de rester actif toute l’année.
Cette adaptation spectaculaire du « moustique du métro de Londres » était devenue un cas d’école, figurant dans de nombreux manuels d’écologie et d’évolution. L’idée sous-jacente était que l’urbanisation des villes pouvait sélectionner à grande vitesse de nouvelles espèces et en quelque sorte « accélérer » l’évolution.
Mais notre étude vient montrer que cette belle histoire, aussi séduisante soit-elle, est fausse.
Un moustique urbain… né bien avant les villes modernes
Notre consortium international de chercheurs PipPop a ainsi publié dans la revue Science une étude qui démystifie cette hypothèse. En séquençant le génome de plus de 350 moustiques, contemporains et historiques, issus de 77 populations d’Europe, d’Afrique du Nord et d’Asie occidentale, nous avons reconstitué leur histoire évolutive.
En définitive, les caractéristiques qui font de Culex pipiens molestus un moustique si adapté à la vie urbaine ne sont pas apparues dans le métro londonien, mais bien plus tôt, il y a plus de mille ans, vraisemblablement dans la vallée du Nil ou au Moyen-Orient. Ce résultat remet en question ce qui était considéré comme un exemple clé de l’évolution urbaine rapide. Au final, il s’agirait d’une adaptation plus lente, associée au développement de sociétés humaines anciennes.
Autrement dit, ce moustique était déjà « urbain » (au sens : étroitement associé aux humains) bien avant l’ère industrielle. Les premières sociétés agricoles, avec leurs villages denses, leurs systèmes d’irrigation et leurs réserves d’eau, lui ont offert un terrain de jeu idéal pour son adaptation.
À lire aussi : Comment les moustiques nous piquent (et les conséquences)
Un acteur clé des épidémies modernes
Le moustique Culex pipiens n’est pas juste une curiosité scientifique : il joue un rôle majeur dans la transmission de virus comme ceux du Nil occidental ou d’Usutu. Ces derniers circulent surtout chez les oiseaux mais peuvent aussi être transmis aux humains et aux mammifères.
La forme Culex pipiens pipiens, qui pique les oiseaux, est principalement responsable de la transmission du virus dans l’avifaune, tandis que Culex pipiens molestus est vu comme responsable de la transmission aux humains et aux mammifères.
Lorsque les deux se croisent et s’hybrident, ils pourraient donner naissance à des moustiques au régime mixte, capables de « faire le pont » entre oiseaux et humains et de nous transmettre des virus dits zoonotiques.
De fait, nos analyses confirment que les deux formes s’hybrident davantage dans les villes densément peuplées, augmentant le risque de transmission de ces virus. Autrement dit la densité humaine augmente les occasions de rencontre entre les deux formes de moustiques – et potentiellement la probabilité de produire des moustiques capables de piquer à la fois les oiseaux et les humains.
Comprendre quand et où ces deux formes se croisent et comment leurs gènes se mélangent est donc crucial pour anticiper les risques d’épidémie.
Repenser l’adaptation urbaine
L’histoire du « moustique du métro de Londres » a eu un immense succès parce qu’elle incarne en une image frappante tout ce que l’on redoute et admire dans l’adaptation rapide des espèces à nos environnements. Par exemple, une adaptation très rapide face à l’augmentation de la pollution et de l’artificialisation des habitats, souvent mobilisée dans les imaginaires, de science-fiction en particulier.
Mais la réalité est tout autre : les moustiques de nos villes modernes ne sont pas une nouveauté née dans le métro londonien. En revanche, le développement urbain a offert une nouvelle scène à un acteur déjà préparé par des millénaires de cohabitation avec les humains dans les premières sociétés agricoles du Moyen-Orient et de la Méditerranée. Le fruit de cette évolution a ensuite pu être « recyclé » dans les villes contemporaines.
On parle alors d’ « exaptation », c’est-à-dire qu’un trait préexistant dans un contexte donné (ici les premières villes du Moyen-Orient) devient avantageux dans un autre contexte (les villes du nord de l’Europe). Les circuits sensoriels et métaboliques qui pilotent la recherche d’hôtes à piquer, la prise de repas sanguin et la reproduction avaient déjà été remodelés par l’histoire ancienne des sociétés agricoles de la Méditerranée et du Moyen-Orient, avant d’être « réutilisés » dans le contexte urbain moderne au nord de l’Europe.
Nos systèmes d’irrigation antiques, nos premières villes et nos habitudes de stockage de l’eau ont donc posé les bases génétiques qui permettent aujourd’hui à certains moustiques de prospérer dans les galeries de métro ou les sous-sols d’immeubles de nos grandes villes.
Cette découverte change la donne. En retraçant l’histoire de la forme urbaine du moustique commun Culex pipiens, l’étude invite à changer de regard sur l’évolution urbaine : ce n’est pas seulement une adaptation rapide déclenchée par l’urbanisation intensive des villes, mais un long processus qui relie notre développement technique et social et celle des autres espèces.
Comprendre ces dynamiques est crucial : non seulement pour la science, mais aussi pour anticiper les risques sanitaires et mieux cohabiter avec les autres espèces. Et vous, saviez-vous que le moustique qui vous pique la nuit avait une histoire évolutive aussi ancienne ?
Haoues Alout a reçu des financements de l'ANR et de l'ANSES ainsi que de l'Union Européenne.
18.01.2026 à 20:51
Les plantes aussi ont un microbiote – pourrait-on s’en servir pour se passer de phytosanitaires ?
Texte intégral (1361 mots)

Les plantes et leur microbiote – tout comme les humains et leur microbiote –échangent du matériel génétique. En étudiant cette forme de communication entre les partenaires d’une symbiose, des scientifiques montrent comment les racines peuvent favoriser l’accès aux nitrates présents dans le sol – une ressource indispensable à la croissance des plantes. Ils et elles explorent aussi l’hypothèse que ce langage permette de lutter contre les pathogènes.
Depuis une dizaine d’années, une nouvelle vision des organismes s’impose. Les êtres humains, les animaux et les plantes ne peuvent exister sans leur association avec une myriade d’espèces de microorganismes qui constituent leur microbiote et qui leur apportent des fonctions biologiques complémentaires à leur hôte.
Par exemple, les champignons « mycorhiziens » prolongent les fonctions racinaires des plantes. Ils leur permettent notamment d’explorer le sol et ses ressources ; et apportent une fonction protectrice contre les pathogènes grâce à leur capacité à synthétiser des fongicides et des antibiotiques.
Cet ensemble « hôte et microbiote » forme ce que l’on appelle l’« holobionte », et il est maintenant admis qu’il s’agit d’une unité évolutive et fonctionnelle à prendre en compte dans son ensemble.
Cette nouvelle vision des organismes, non plus comme des individus uniques mais comme des métaorganismes, implique l’existence d’un dialogue entre les différents partenaires de cet ensemble complexe – que nous nous efforçons aujourd’hui de décoder.
Un nouveau langage, fondé sur le transfert de « code génétique » au sein des êtres vivants
Au sein des êtres vivants, différents mécanismes de communication sont connus, permettant le transfert d’informations à différentes échelles de l’organisme. Il peut s’agir d’échanges d’ions, comme le calcium ou le potassium entre les cellules, de signaux électriques à travers nos neurones ou encore le transport d’hormones dans le sang, comme l’insuline qui régule la glycémie en fonction de notre régime alimentaire.
Il existe même des petites protéines ou des peptides capables de voyager entre les organes, qui peuvent par exemple être impliqués dans l’immunité. Un cas très étudié est celui de la systémine, produite par les feuilles de plantes blessées. Ce peptide est transféré à d’autres organes pour induire des mécanismes de défense dans la plante entière.
En plus de cet arsenal de dialogues moléculaires, une autre voie de communication a été découverte en 1993 et a révolutionné le domaine de la communication chez les organismes vivants. Elle est basée sur l’échange de matériel génétique, composé de mini-séquences appelées « microARN », entre différentes cellules et/ou organes d’un même individu.
Initialement observée chez un nématode (un ver microscopique), cette découverte a ensuite été généralisée à d’autres animaux, aux êtres humains et aux plantes. Elle a donné lieu à l’attribution du prix Nobel de médecine 2024 à Victor Ambros et Gary Ruvkun.
Les premières recherches ont montré que ces microARN sont des intermédiaires de communication impliqués dans la majorité des processus biologiques, depuis l’embryogenèse jusqu’au vieillissement, et affecte notamment l’immunité et la résistance des organismes aux contraintes environnementales.
Un langage aussi utilisé entre différents êtres vivants
Depuis une dizaine d’années, nous savons également que ces microARN sont impliqués dans le transfert d’information entre différents individus – ce que l’on peut qualifier de communication.
En particulier, les microorganismes du microbiote et leur hôte échangent du matériel génétique. Ceci est particulièrement surprenant car, en général, le matériel génétique (ADN) ou l’intermédiaire de ce matériel (ARN) ne sont pas très mobiles entre cellules et a fortiori entre cellules d’individus et d’espèces différents !
Néanmoins, l’étude du microbiote intestinal des mammifères a bien mis en évidence en 2016 l’implication de microARN produits par les cellules épithéliales du tube digestif de l’hôte, dont le but est d’exercer une pression de sélection du microbiote intestinal bénéfique et de reprogrammer le fonctionnement de ce dernier.
De la même façon, nous avons montré que les racines des plantes influencent le fonctionnement de leur microbiote. Celui-ci, par son rôle dans l’assimilation des nutriments, présente des similitudes avec le système digestif des animaux.
Pourquoi ce « langage » est important pour une agriculture en transition
En 2024, nous avons également montré (Brevet FR3147485 du 11/10/2024) que des microARN de plantes pouvaient réduire la compétition de ses dernières avec certains microorganismes présents dans le sol à proximité de leurs racines pour l’accès aux nitrates, une ressource vitale pour les végétaux souvent apportée par les engrais minéraux ou les épandages de lisier et fumier.
De plus, dans le cas de certains stress environnementaux ou bien d’infections par les pathogènes, l’expression des microARN est perturbée et on assiste à un développement anarchique, ou déséquilibre, du microbiote – on parle de « dysbiose ».
Il est concevable d’agir sur le « langage » entre microbiote et racines pour moduler la réponse des plantes aux changements environnementaux, notamment en contexte agricole. Par exemple, l’utilisation de microARN naturellement produits par les plantes pourrait aider ces dernières à recruter un microbiote bénéfique, et leur permettre de se défendre des pathogènes, de résister aux stress environnementaux liés au changement climatique ou encore de faciliter leur nutrition ; ce qui pourrait permettre de limiter notre dépendance aux engrais minéraux et aux produits phytosanitaires délétères pour l’environnement.
Nous espérons que ces pratiques fondées sur l’application de microARN mimant ceux naturellement produits par les plantes puissent constituer une nouvelle porte d’entrée vers une agriculture durable et respectueuse de l’environnement sans avoir recours à l’introduction de gènes exogènes dans le génome des plantes, ce qui crée des organismes génétiquement modifiés, qui sont l’objet de controverses dans notre société.
Cécile Monard a reçu des financements de CNRS, CMI Roullier, OSERen
Abdelhak El amrani a reçu des financements de la région de bretagne, CNRS, Europe, ANR.
15.01.2026 à 16:01
En 2026, à quoi vont ressembler les nouveaux deepfakes qui vont déferler sur nos écrans
Texte intégral (1455 mots)
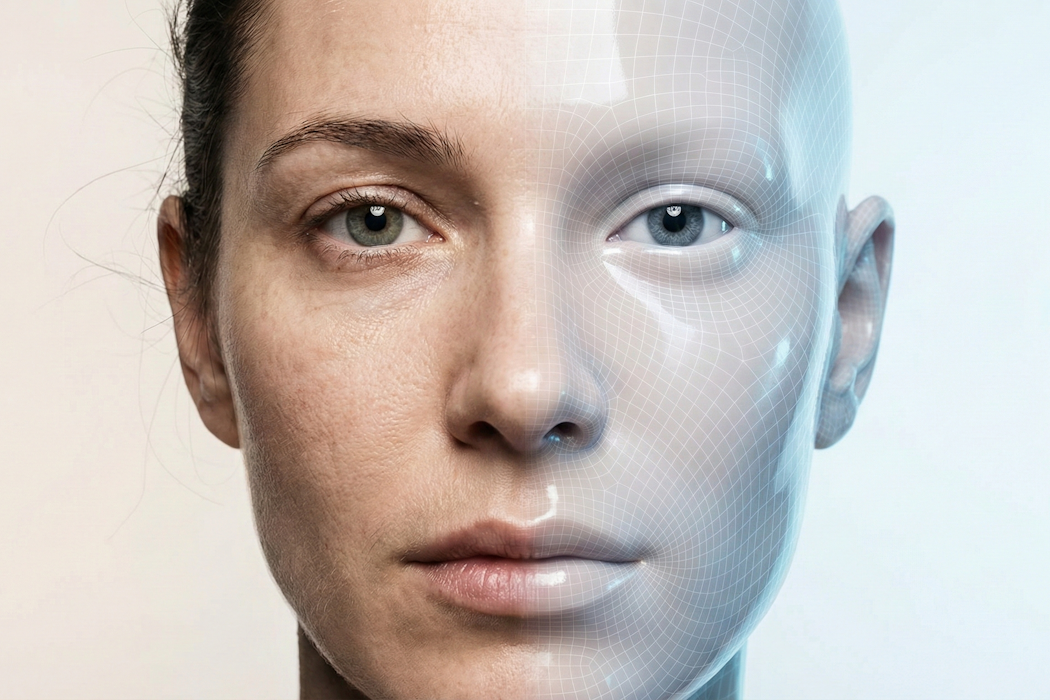
En 2025, la génération de deepfakes a explosé : visages, voix et mouvements du corps créés par des systèmes d’intelligence artificielle deviennent presque indiscernables des humains, bouleversant la perception et la sécurité des contenus en ligne.
Au cours de l’année 2025, les techniques de génération de deepfakes ont connu une évolution spectaculaire. Les visuels de visages, de voix et de corps entiers générés des systèmes d’IA ont gagné en qualité – bien au-delà de ce que beaucoup d’experts imaginaient encore il y a quelques années. Ces vidéos sont aussi davantage utilisées pour tromper ceux qui les regardent.
Dans de nombreuses situations du quotidien – en particulier les appels vidéo de faible résolution et les contenus diffusés sur les réseaux sociaux –, leur réalisme est désormais suffisant pour berner à coup sûr des publics non spécialistes. Concrètement, les médias synthétiques sont devenus indiscernables d’enregistrements authentiques pour le grand public et, dans certains cas, même pour des institutions.
Et cette flambée ne se limite pas à la qualité. Le volume de deepfakes générés a lui aussi explosé : l’entreprise de cybersécurité DeepStrike estime qu’on est passé d’environ 500 000 vidéos de ce type présentes en ligne en 2023 à près de 8 millions en 2025, avec une croissance annuelle proche de 900 %.
Je suis informaticien et je mène des recherches sur les deepfakes et d’autres médias synthétiques. De mon point de vue, la situation risque encore de s’aggraver en 2026, à mesure que les deepfakes évolueront vers des entités synthétiques capables d’interagir en temps réel avec des humains.
Des améliorations spectaculaires
Plusieurs évolutions techniques expliquent cette escalade. Tout d’abord, le réalisme a franchi un cap grâce à des modèles de génération de vidéos conçus spécifiquement pour maintenir la cohérence temporelle. Ces modèles produisent des vidéos aux mouvements cohérents, avec des identités stables pour les personnes représentées et un contenu logique d’une image à l’autre. Ils dissocient les informations liées à la représentation de l’identité d’une personne de celles relatives au mouvement, ce qui permet d’appliquer un même mouvement à différentes identités ou, inversement, d’associer une même identité à plusieurs types de mouvements.
Ces modèles génèrent des visages stables et cohérents, sans les scintillements, déformations ou anomalies structurelles autour des yeux et de la mâchoire qui constituaient des signes techniques fiables de deepfakes auparavant.
Deuxièmement, le clonage vocal a franchi ce que j’appellerais le « seuil d’indiscernabilité ». Quelques secondes d’audio suffisent désormais pour générer un clone convaincant – avec une intonation, un rythme, des accents, des émotions, des pauses et même des bruits de respiration naturels. Cette capacité alimente déjà des fraudes à grande échelle. De grands distributeurs indiquent recevoir plus de 1 000 appels frauduleux générés par l’IA chaque jour. Les indices perceptifs qui permettaient autrefois d’identifier des voix synthétiques ont en grande partie disparu.
Troisièmement, les outils grand public ont fait chuter la barrière technique à un niveau proche de zéro. Les évolutions d’OpenAI avec Sora 2, de Google avec Veo 3 et l’émergence d’une vague de start-up font qu’il suffit aujourd’hui de décrire une idée et de laisser un grand modèle de langage comme ChatGPT d’OpenAI ou Gemini de Google rédiger un script, pour générer en quelques minutes des contenus audiovisuels aboutis. Des agents d’IA peuvent automatiser l’ensemble du processus. La capacité à produire à grande échelle des deepfakes cohérents et construits autour d’un récit s’est ainsi largement démocratisée.
Cette combinaison d’une explosion des volumes et de figures synthétiques devenues presque indiscernables d’êtres humains réels pose de sérieux défis pour la détection des deepfakes, en particulier dans un environnement médiatique où l’attention est fragmentée et où les contenus circulent plus vite qu’ils ne peuvent être vérifiés. Des dommages bien réels ont déjà été constatés – de la désinformation au harcèlement ciblé et aux arnaques financières – facilités par des deepfakes qui se propagent avant que le public n’ait le temps de comprendre ce qui se passe.
Le temps réel, nouvelle frontière
Pour l’année à venir, la trajectoire est claire : les deepfakes se dirigent vers une synthèse en temps réel capable de produire des vidéos reproduisant fidèlement les subtilités de l’apparence humaine, ce qui facilitera le contournement des systèmes de détection. La frontière évolue du réalisme visuel statique vers la cohérence temporelle et comportementale : des modèles qui génèrent du contenu en direct ou quasi direct plutôt que des séquences préenregistrées.
La modélisation de l’identité converge vers des systèmes unifiés qui capturent non seulement l’apparence d’une personne, mais aussi sa façon de bouger et de parler selon les contextes. Le résultat dépasse le simple « cela ressemble à la personne X » pour devenir « cela se comporte comme la personne X sur la durée ». Je m'attends à ce que des participants à des appels vidéo soient synthétisés en temps réel ; à voir des acteurs de synthèse pilotés par l’IA dont le visage, la voix et les gestes s’adaptent instantanément à une consigne ; et à ce que des arnaqueurs déploient des avatars réactifs plutôt que des vidéos fixes.
À mesure que ces capacités se développent, l’écart perceptuel entre humains authentiques et synthétiques continuera de se réduire. La véritable ligne de défense ne reposera plus sur le jugement humain, mais sur des protections au niveau des infrastructures. Cela inclut des mécanismes de traçabilité sécurisée, comme la signature cryptographique des médias et l’adoption par les outils de génération IA des spécifications de la Coalition for Content Provenance and Authenticity. Cela dépendra également d’outils d’analyse multimodaux, comme le Deepfake-o-Meter que je développe avec mes équipes dans mon laboratoire.
Se contenter d’examiner les pixels attentivement ne suffira plus.
Siwei Lyu ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
14.01.2026 à 16:23
Comment fonctionne l’hérédité ? Une nouvelle étude explore le rôle de l’épigénétique
Texte intégral (2481 mots)
On transmet à sa descendance ses gènes, son ADN. Mais certaines espèces peuvent également transmettre un autre type d’information, dite épigénétique, qui indique quels gènes peuvent ou non s’exprimer. Une nouvelle étude parue dans Science explore les mécanismes qui permettent cette transmission chez les plantes.
Comment fonctionne l’hérédité ? Ou, en d’autres termes, par quels mécanismes moléculaires un organisme peut-il transmettre certaines caractéristiques à sa descendance via la reproduction sexuée ?
Depuis les années 1940, on sait que l’ADN porte l’information génétique transmise de génération en génération. Mais différentes observations chez les plantes indiquent que toutes les différences héritables observées entre individus, comme un retard de floraison ou un changement de la pigmentation du maïs, ne sont pas dues à des mutations de la séquence de l’ADN.
Dans notre étude publiée en novembre 2025 dans Science, nous montrons que l’épigénétique contribue, chez les plantes, aux différences héritables entre individus, notamment en réponse à des stress environnementaux comme la sécheresse.
Les modifications dites « épigénétiques » n’affectent pas la séquence de l’ADN proprement dite, mais plutôt sa capacité à favoriser ou non l’expression des gènes. Dans notre étude, nous élucidons certains des mécanismes par lesquels des modifications épigénétiques, en l’occurrence la méthylation de l’ADN (voir encadré), peuvent être transmises, chez les plantes, sur des dizaines de générations… ou au contraire être rapidement rétablies dans leur état initial.
À lire aussi : Épigénétique, inactivation du chromosome X et santé des femmes : conversation avec Edith Heard
Le mystère de la plante qui fleurissait tard
Arabidopsis thaliana est une plante que les scientifiques utilisent beaucoup, à tel point que l’on parle de « plante modèle ». Lorsqu’en 2000 un important retard de floraison a été observé dans une souche de laboratoire d’A. thaliana les recherches se sont naturellement d’abord concentrées sur l’identification de la mutation de la séquence d’ADN potentiellement responsable de ce retard. Or, aucune mutation n’a été identifiée en lien avec ce retard de floraison !… En cause : une perte de méthylation de l’ADN au niveau d’un gène, désigné FWA.
Qu’est-ce que la méthylation de l’ADN ?
- On dit que l’ADN est méthylé lorsqu’il porte une modification chimique particulière : il s’agit d’un groupement chimique « méthyl- » ajouté dans le cycle de certaines bases (la cytosine, abbréviée C) de l’ADN.
- Chez les plantes, la méthylation de l’ADN est le plus généralement inhibitrice, c’est-à-dire qu’elle limite l’expression des gènes avoisinants, lorsqu’elle est densément présente sur toutes les cytosines d’une région donnée.
- Chez les mammifères, on ne trouve la méthylation de l’ADN que dans le contexte CG (une cytosine suivie d’une guanine) et elle est inhibitrice lorsqu’elle est présente sur des régions denses en CG, appelées îlots de CG.
Normalement, le gène FWA d’A. thaliana qui code un répresseur de la floraison est méthylé, ce qui le rend « silencieux », c’est-à-dire qu’il ne s’exprime pas. Dans la souche de laboratoire présentant un retard de floraison, la méthylation de ce gène a disparu – par accident ; le gène FWA est alors réactivé, ce qui conduit à retarder la floraison.
Or, cette perte de la méthylation de FWA est transmise de façon fidèle à la descendance sur au moins plusieurs dizaines de générations. Ceci explique l’hérédité du retard à la floraison… alors même que la séquence du gène FWA (et du reste du génome !) reste inchangée.
Pourquoi de telles observations chez les plantes et non chez les mammifères ?
Les mammifères, comme les plantes, utilisent la méthylation de l’ADN pour réguler l’expression des gènes (voir encadré plus haut). En revanche, il n’existe pas de caractères épigénétiques héritables chez les animaux dans la nature (bien qu’il y ait des exemples au laboratoire sur des séquences transgéniques de mammifères).
À lire aussi : Nous héritons de la génétique de nos parents, mais quid de l’épigénétique ?
La raison n’est pas encore clairement établie, mais la communauté scientifique soupçonne qu’il existe des différences dans la manière dont ces deux groupes d’organismes reprogramment la méthylation de l’ADN à chaque génération.
En effet, nous savons aujourd’hui que les mammifères, mais non les plantes, effacent et rétablissent de manière quasi totale la méthylation de l’ADN le long de leur génome à chaque génération. Ainsi donc, des altérations accidentelles de l’état de méthylation des séquences du génome seraient plus facilement héritables chez les plantes.
Bien que frappants, les exemples décrits jusqu’à présent d’une telle hérédité « épigénétique » (comme dans le cas de FWA) n’avaient pas permis d’établir les mécanismes régissant ce mode additionnel de transmission des caractères.
C’est à cette question que nous nous sommes attelés : en comparant systématiquement des lignées expérimentales et naturelles d’A. thaliana, nous avons obtenu une première démonstration formelle de l’ampleur de l’héritabilité épigénétique dans la nature (chez les plantes) et des mécanismes qui la régissent.
L’hérédité épigénétique dans nos lignées de laboratoire
Pour cela, nous avons d’abord exploité des lignées expérimentales d’A. thaliana générées et caractérisées depuis vingt ans par notre équipe et qui ne diffèrent que dans leurs états de méthylation de l’ADN le long du génome.
Plus précisément, nous avons intentionnellement localisé les différences de méthylation d’ADN au niveau d’« éléments transposables » ou « transposons » (voir encadré ci-dessous). En effet, les éléments transposables sont chez les plantes les cibles principales de la méthylation de l’ADN, qui limite ainsi leur activité mais peut également affecter l’activité des gènes avoisinants.
Qu’est-ce qu’un élément transposable ?
- Les éléments transposables ou transposons sont des éléments génétiques qui ont la capacité de se déplacer le long du génome, soit _via_ un intermédiaire ARN (on parle dans ce cas de rétrotransposons), soit directement par excision et réinsertion (transposons à ADN).
- De par leur capacité à se propager dans le génome, les éléments transposables représentent des fractions significatives de l’ADN des génomes eucaryotes (45 % chez l’humain, 85 % chez le maïs !). Cependant, la grande majorité des éléments transposables du génome sont des copies dérivées d’événements de transposition anciens et ont perdu toute capacité de mobilisation depuis, ce sont donc essentiellement des fossiles.
- Lorsque les éléments transposables sont mobiles, les mutations qu’ils génèrent en s’insérant au sein ou à proximité des gènes ont souvent des effets majeurs. Par exemple, la mobilisation d’un transposon a été impliquée dans l’apparition spontanée de l’hémophilie de type A chez l’humain. Chez les plantes, les mutations causées par des éléments transposables ont été notamment exploitées en agriculture.
- Les éléments transposables, mobiles ou non, sont le plus souvent maintenus dans un état épigénétique dit « répressif », notamment par la méthylation de l’ADN chez les plantes et les mammifères.
Nous avons ainsi montré pour 7 000 éléments transposables présents le long du génome d’A. thaliana qu’une perte de méthylation de l’ADN peut être héritée sur au moins une dizaine de générations, parfois jusqu’à 20… et sans doute beaucoup plus, mais pas infiniment néanmoins.
En étudiant en détail cette transmission épigénétique dans plus d’une centaine de lignées expérimentales, nous avons établi que plus un élément transposable est présent en grand nombre de copies dans le génome, plus il est la cible d’un contrôle épigénétique intense et, dès lors, plus rapidement la méthylation de l’ADN est restaurée sur cet élément lors de la reproduction sexuée.
Dans la nature
Fort de ces résultats, nous avons entrepris ensuite de chercher dans 700 lignées d’A. thaliana isolées dans la nature des pertes héritables de la méthylation de l’ADN de la même amplitude et sur les mêmes 7 000 éléments transposables.
Résultat : environ un millier d’éléments transposables (soit plus de 15 % des 7 000 étudiés) présentent, dans au moins une lignée naturelle, une perte héritable de méthylation de l’ADN très similaire à celle induite expérimentalement dans les lignées de laboratoire.
Qui plus est, nous avons montré que cette perte de méthylation de l’ADN est le plus souvent héritée indépendamment des variations de la séquence d’ADN entre lignées naturelles, et qu’elle est donc bien d’ordre épigénétique.
Ainsi donc, le potentiel de transmission épigénétique révélé expérimentalement au laboratoire est bel et bien le reflet, au moins en partie, de ce qui se passe dans la nature.
Le lien avec les stress environnementaux
Une différence majeure distingue néanmoins les variations épigénétiques expérimentales de celles retrouvées dans la nature : si les premières affectent sans discrimination tout type d’éléments transposables, les secondes sont préférentiellement restreintes à ceux d’entre eux situés à proximité de gènes, notamment des gènes impliqués dans la réponse aux stress biotiques (réponse aux pathogènes) ou abiotiques (variation de température ou d’humidité par exemple).
Cet enrichissement est d’autant plus lourd d’implications, que nous avons pu clairement établir que, comme leur contrepartie expérimentale, les variations épigénétiques naturelles modulent l’expression des gènes voisins.
Par exemple, la perte de méthylation de l’ADN d’un élément transposable situé à proximité d’un gène de réponse au froid et à la sécheresse magnifie l’induction de ce dernier d’un facteur 5 ! De plus, les lignées expérimentales présentant cet élément transposable sous sa forme déméthylée répondent plus vite à la sécheresse que celles portant la version méthylée. Or, les lignées naturelles porteuses de la version déméthylée proviennent de régions du globe où les événements de gel et de sécheresse sont plus fréquents en été, ce qui suggère que la perte de méthylation de l’ADN donne prise à la sélection naturelle.
L’origine de ces pertes de méthylation de l’ADN dans la nature reste néanmoins à établir. Une hypothèse est que l’environnement joue un rôle d’inducteur, mais nos observations et un bilan complet de la littérature apportent peu de soutien à cette théorie. Nous pensons plutôt que ces variants héritables de méthylation de l’ADN apparaissent de manière aléatoire et récurrente, et sont ensuite sélectionnés par l’environnement en fonction de leurs impacts sur l’expression des gènes.
Ces travaux, s’ils ne remettent certainement pas en cause l’importance prépondérante des variations de séquence de l’ADN dans l’origine des différences héritables entre individus, démontrent néanmoins que les variations épigénétiques peuvent elles aussi y contribuer significativement, du moins chez les plantes.
Le projet Prise en compte des éléments transposables et de leur variation épigénétique dans les études de la relation génotype-phénotype — STEVE est soutenu par l’Agence nationale de la recherche (ANR) qui finance en France la recherche sur projets. L’ANR a pour mission de soutenir et de promouvoir le développement de recherches fondamentales et finalisées dans toutes les disciplines, et de renforcer le dialogue entre science et société. Pour en savoir plus, consultez le site de l’ANR.
Vincent Colot a reçu des financements de l'ANR et de l'Union européenne
Pierre Baduel a reçu des financements de l'ANR et de la FRM.
12.01.2026 à 15:58
Les plantes sont bien plus bavardes que vous ne le pensez
Texte intégral (1775 mots)
Les plantes sont loin d’être aussi muettes que ce que l’on imagine ! Beaucoup de végétaux sont en réalité capables d’interagir entre eux et avec le reste de leur environnement. Et ces échanges façonnent et transforment activement les paysages.
On pense souvent les plantes comme des êtres silencieux, immobiles, sans intention ni action. Pourtant, de nombreuses études révèlent aujourd’hui qu’elles communiquent activement entre elles, mais aussi avec les autres êtres vivants, animaux, champignons, microorganismes. En communiquant, elles ne font pas que transmettre des informations : elles modifient les dynamiques écologiques et sont ainsi actrices des transformations de leur environnement.
Cette communication n’a rien de magique : elle repose sur des signaux principalement chimiques. Dans les faits, on peut considérer que la communication se produit lorsqu’un émetteur envoie un signal perçu par un récepteur qui, en retour, modifie son comportement. Pour communiquer, les plantes doivent donc être sensibles à leur environnement. De fait elles sont capables de percevoir de très nombreux signaux environnementaux qu’elles utilisent en tant qu’information : la lumière, l’eau, la présence de nutriments, le toucher, les attaques d’insectes ou encore la proximité d’autres plantes.
Elles savent alors ajuster leur développement : orientation des feuilles vers le soleil, développement de leurs racines vers les zones riches en nutriments ou évitement des endroits pauvres ou toxiques. Lorsqu’elles subissent l’attaque d’un pathogène, elles déclenchent des réactions chimiques qui renforcent leurs défenses ou avertissent leurs voisines du danger. Cela implique donc que les plantes sont aussi capables d’émettre des signaux compréhensibles que d’autres organismes récepteurs vont pouvoir interpréter. Ces comportements montrent une véritable capacité d’action : les plantes ne subissent pas simplement leur environnement, elles interagissent avec lui, elles vont lancer des réponses adaptées, orientées vers un but important pour elles, croître.
Parler avec des molécules
La plupart des échanges entre plantes se font notamment grâce à des composés organiques volatils. Ces molécules sont produites par les plantes et se déplacent sous forme gazeuse dans l’air ou dans le sol et peuvent ainsi véhiculer un message. Attaquée par un pathogène, une plante peut libérer des composés volatils qui alertent ses voisines. L’exemple emblématique, bien que controversé, est l’étude menée par l’équipe de Wouter Van Hoven (Université de Pretoria, Afrique du Sud, ndlr) ayant montré que les acacias soumis au broutage des koudous, une espèce d’antilope, synthétisaient des tanins toxiques et que les acacias situés quelques mètres plus loin faisaient de même.
Les chercheurs ont suggéré que les acacias broutés libéraient de l’éthylène, un composé qui induisait la synthèse de tanins chez les acacias voisins, les protégeant ainsi des koudous. Ce type d’interaction a aussi été observé chez d’autres plantes. Chez l’orge, par exemple l’émission de composés volatils permet de réduire la sensibilité au puceron Rhopalosiphum padi. Les pieds d’orge percevant ces composés peuvent activer leurs défenses avant même d’être attaqués par les pucerons.
Certains de ces composés peuvent être synthétisés spécifiquement pour attirer les prédateurs de l’agresseur. Ainsi, lorsqu’elles sont attaquées par des chenilles, certaines plantes, comme le maïs, émettent des molécules pour appeler à l’aide les guêpes prédatrices des chenilles. D’autres signaux chimiques émis dans les exsudats racinaires permettent aux plantes d’identifier leurs voisines, de reconnaître leurs parentes et d’adapter leur comportement selon le degré de parenté. Ces types d’échanges montrent que la communication végétale n’est pas un simple réflexe : elle implique une évaluation du contexte et une action ajustée.
En fonction du contexte, les plantes s’expriment différemment
Mais toutes les plantes ne communiquent pas de la même façon. Certaines utilisent des signaux dits publics, que de nombreuses espèces peuvent percevoir, ce qu’on appelle parfois l’écoute clandestine. D’autres émettent des messages dits privés, très spécifiques, compris uniquement par leurs proches ou leurs partenaires symbiotiques, c’est-à-dire des espèces avec lesquelles elles échangent des informations ou des ressources. C’est le cas lors de la mise en place des symbioses mycorhiziennes entre une plante et des champignons, qui nécessitent un dialogue moléculaire entre la plante et son partenaire fongique.
Ce choix de communication dépend donc du contexte écologique. Dans des milieux où les plantes apparentées poussent ensemble, le partage d’informations profite à tout le groupe : c’est une stratégie collective. Mais dans des milieux compétitifs, il est plus avantageux de garder les messages secrets pour éviter que des concurrentes en tirent profit. Cette flexibilité montre que les végétaux adaptent la manière dont ils transmettent l’information selon leurs intérêts.
Peut-on dire que les végétaux se parlent ?
De fait, les signaux émis par les plantes ne profitent pas qu’à elles-mêmes. Ils peuvent influencer le développement de tout l’écosystème. En attirant des prédateurs d’herbivores, en favorisant la symbiose avec des champignons ou en modulant la croissance des voisines, les plantes participent à un vaste réseau d’interactions.
La question est alors de savoir si les plantes ont un langage. Si l’on entend par là une syntaxe et des symboles abstraits, la réponse est non. Mais si on considère le langage comme un ensemble de signaux produisant des effets concrets sur un récepteur, alors oui, les plantes communiquent. Des philosophes ont recherché si des analogies avec certains aspects du langage humain pouvaient être mises en évidence.
Certains d’entre eux considèrent que la communication chez les plantes peut être considérée comme performative dans la mesure où elle ne décrit pas le monde, mais le transforme. Quand une plante émet un signal pour repousser un herbivore ou avertir ses voisines, elle n’émet pas seulement de l’information, elle agit. Ce type de communication produit un effet mesurable, ce que les philosophes du langage, dans la lignée de l’Américain John Austin, appellent un effet perlocutoire.
Les plantes façonnent activement les écosystèmes
Cette vision élargie de la communication végétale devrait transformer notre conception des écosystèmes. Les plantes ne sont pas des éléments passifs du paysage, mais des actrices à part entière, capables de transformer leur environnement à travers leurs actions chimiques, physiques et biologiques.
Ces découvertes ouvrent des perspectives pour une agriculture durable : en comprenant et en utilisant la communication des plantes, il devient possible de renforcer leurs défenses sans pesticides, grâce à des associations de cultures ou à des espèces sentinelles qui préviennent les autres du danger. La question des paysages olfactifs est aussi un sujet émergent pour la gestion des territoires.
Pour cela il faut que s’installe un nouveau regard sur le comportement végétal. En effet, pendant des siècles, on a cru que les plantes étaient dénuées de comportement, de mouvement ou de décision. Darwin avait déjà observé, au XIXe siècle, qu’elles orientaient leurs organes selon la lumière, la gravité ou le contact. Aujourd’hui, on sait qu’elles peuvent aussi mémoriser certaines expériences et réagir différemment à un même signal selon leur vécu. Certains chercheurs utilisent des modèles issus de la psychologie et de la théorie de l’information pour étudier la prise de décision chez les plantes : perception d’un signal, interprétation, choix de réponse, action.
Repenser la hiérarchie du vivant
Au-delà de la communication, certains chercheurs parlent désormais d’agentivité végétale, c’est-à-dire la capacité des plantes à agir de façon autonome et efficace dans un monde en perpétuel changement. Reconnaître cette agentivité change profondément notre rapport au vivant. Les plantes ne sont pas de simples organismes passifs : elles perçoivent, décident et agissent, individuellement et collectivement. Elles modifient les équilibres écologiques, influencent les autres êtres vivants et participent activement à la dynamique du monde.
L’idée d’agentivité végétale nous invite à abandonner la vision hiérarchique du vivant héritée d’Aristote, qui place l’être humain tout en haut d’une pyramide d’intelligence. Elle nous pousse à reconnaître la pluralité des formes d’action et de sensibilité dans la nature. Comprendre cela, c’est aussi repenser notre propre manière d’habiter la terre : non plus comme des maîtres du vivant, mais comme des partenaires d’un vaste réseau d’êtres vivants où tous sont capables de sentir, d’agir et de transformer leur environnement.
François Bouteau ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
11.01.2026 à 15:44
L’avenir de l’impression 3D passera par les matériaux
Texte intégral (2079 mots)
Qu’il s’agisse de pièces de fusée, d’automobile, de pont ou même d’aliments, la fabrication additive (FA) redéfinit complètement le champ des possibles dans de très nombreux domaines d’activités. Elle offre des perspectives prometteuses en matière de matériaux, mais elle pose également des défis techniques, économiques et environnementaux qui nécessitent une maturation et une adaptation des procédés en lien avec les matériaux utilisés.
Plus connu sous la dénomination « impression 3D », ce procédé met en œuvre des polymères (plastiques) ou des alliages métalliques pour fabriquer des objets du quotidien. Les imprimantes 3D polymères sont accessibles au grand public pour quelques centaines d’euros. Elles permettent notamment de fabriquer des pièces prototypes (d’où le nom prototypage rapide), des coques de téléphone, des pièces de rechange, des prothèses, des bijoux, des jouets, des objets de décorations ou des maquettes. En ce qui concerne les métaux, les machines d’impression sont beaucoup plus chères (quelques centaines de milliers d’euros). On trouve des applications telles que des implants médicaux, des pièces aérospatiales/automobiles, de l’outillage industriel, des bijoux de luxe. On peut également trouver ce principe de fabrication dans le domaine du BTP avec des « imprimantes » qui mettent en œuvre du béton pour fabriquer des maisons, des bâtiments ou tout type de structure en génie civil.
Mais, comme toute nouveauté, le procédé suscite autant d’espoir qu’il ne réserve de surprises (bonnes ou mauvaises) à celles et ceux qui souhaitent utiliser ce nouveau moyen de fabrication.
D’un point de vue technique, l’impression 3D consiste, couche après couche, à durcir (polymériser) une résine liquide ou à venir déposer de la matière (plastique ou métallique) de manière précise et contrôlée (en ajustant les paramètres tels que la température, la vitesse d’impression, le taux de remplissage, l’orientation de l’objet) pour répondre à certaines contraintes de géométrie, poids, optimisation des propriétés mécaniques ou physiques.
La microstructure d’une pièce imprimée en 3D (polymère ou métal) désigne l’organisation interne de sa matière à une échelle microscopique, influencée par le procédé d’impression. La complexité de la géométrie, les dimensions, le prix vont conditionner le choix de la technologie d’impression et des matériaux associés.
Une révolution dans de nombreux domaines industriels
Qu’elle soit alternative ou complémentaire des techniques conventionnelles par enlèvement de matière ou par déformation, la FA révolutionne de nombreux domaines industriels. De la réalisation de pièces monolithiques (en une seule étape de fabrication, sans assemblage) à forte valeur ajoutée à la fonctionnalisation (conférer à la pièce certaines propriétés locales en changeant les paramètres d’impression au besoin), en passant par le prototypage rapide (valider la conception d’une pièce prototype de manière itérative), les possibilités sont multiples. On peut citer notamment des prothèses de hanche en titane adaptées à l’anatomie de chaque patient, des injecteurs de fusée à géométrie complexe et fabriquées en une seule pièce, des moules optimisés avec canaux de refroidissement sur mesure, des bijoux en métaux précieux avec des designs impossibles à obtenir avec des moyens d’usinage conventionnels.
La chaîne de valeurs de la FA – qui définit l’ensemble des étapes de réalisation d’une pièce de l’approvisionnement en matière première, à la conception, aux conditions de mise en œuvre, à la fabrication, au coût énergétique, à la reprise d’usinage, aux opérations de parachèvement, à la qualification de la santé matière, à la caractérisation des propriétés physiques, au recyclage – est cependant plus complexe et potentiellement plus onéreuse. La technicité, oui, mais pas à n’importe quel prix ! Outre les moyens de fabrication spécifiques sur lesquels elle repose, elle nécessite des règles de conception fondamentalement différentes car elle impose de nouvelles contraintes techniques. De la Conception Assistée par Ordinateur, au choix matériau, au programme machine et à l’industrialisation, il faut ainsi redéfinir complètement la manière de penser du cahier des charges à la maintenance des produits issus de la FA.
Des enjeux majeurs pour les matériaux
Un des points fondamentaux du développement de ces nouveaux procédés réside dans la compréhension du lien entre les paramètres de fabrication des pièces (temps d’impression, puissance du laser, vitesse de déplacement de la tête d’impression, dimensions, environnement de travail – sous atmosphère contrôlée ou non), leur santé matière (présence de porosités ou de défauts parfois liés à un manque de fusion/gazéification locaux de la matière) et leurs propriétés physiques (conductivité thermique ou électrique, propriétés mécaniques, densité). Autrement dit, il est nécessaire de fiabiliser les procédés et optimiser les propriétés finales de la pièce en étant capable de contrôler des paramètres de fabrication, lesquels vont beaucoup dépendre des matériaux mis en œuvre. Ainsi, la FA présente des enjeux majeurs pour les matériaux, qu’ils soient techniques, économiques ou environnementaux.
Tout d’abord, les procédés de FA nécessitent de développer, en amont, des matériaux adaptés (filaments, poudres) aux spécificités des procédés (fusion laser, dépôt de matière fondue, alimentation en matière des têtes d’impression), lesquels vont imposer des contraintes en termes de prix, toxicité et recyclabilité. En effet, les poudres métalliques ou polymères spécifiques (de type thermoplastique) dédiées à la fabrication additive restent souvent plus coûteuses que les matériaux conventionnels, d’un facteur 10 environ.
Néanmoins, malgré le coût plus élevé des matériaux et des procédés, l’impression 3D réduit les déchets (pas de copeaux comme en usinage), permet de fabriquer des pièces dont la géométrie est optimisée (allègement des structures) et élimine le besoin de moules coûteux pour les petites séries, ce qui peut compenser l’écart de coût pour des pièces à forte valeur ajoutée. Ainsi, la réduction des coûts est un enjeu clé pour une adoption plus large. De plus, l’approvisionnement en matière première peut être limité, ce qui ralentit le développement des applications industrielles.
La FA permet également de faire de l’hybridation en associant différents types de matériaux lors de l’impression (en utilisant plusieurs têtes d’impression) afin d’obtenir des pièces composites dont les propriétés mécaniques, électriques ou thermiques sont spécifiques. Par exemple, dans l’industrie aérospatiale ou l’automobile, l’impression 3D de pièces comme des moules d’injection ou des échangeurs thermiques avec des canaux de refroidissement complexes intégrés – lesquels sont impossibles à réaliser par usinage classique – permettent d’optimiser la dissipation thermique, améliorant l’efficacité et la longévité de la pièce.
Les procédés de FA permettent également d’imprimer des structures arborescentes (bio-mimétisme) obtenues via des outils d’optimisation topologique qui est une méthode de conception avancée qui utilise des algorithmes pour déterminer la forme optimale d’une structure en fonction de contraintes spécifiques, telles que la résistance, le poids, ou la distribution des efforts. La spécificité de l’impression 3D réside aussi dans la possibilité de produire des structures complexes de type treillis ou architecturées pour fonctionnaliser le matériau (propriétés mécaniques sur mesure, réduction de la masse, diminution des coûts de fabrication, isolation thermique, acoustique, absorption des chocs ou des vibrations).
Fusion de matière
Quand les pièces sont imprimées, il existe – selon le procédé de fabrication – des opérations dites de parachèvement qui consistent à finaliser les pièces. Cela inclut l’usinage des supports de conformage (qui sont comme des échafaudages qui supportent la pièce lors de la fabrication couche par couche), la reprise d’usinage des surfaces (ou polissage) pour améliorer l’état de surface (quand cela est possible) en raison de la rugosité importante des pièces brutes. On peut également réaliser des traitements thermiques pour homogénéiser la microstructure (pièces métalliques) ou de compression à chaud pour limiter le taux de porosités (un des inconvénients majeurs de l’impression 3D). Ces opérations sont fondamentales, car la rugosité de surface et le taux de porosités sont les caractéristiques les plus critiques du point de vue du comportement mécanique. Par ailleurs, quand il s’agit de procédés à base de poudres, il est nécessaire de dépoudrer les pièces pour évacuer le surplus de matière, lequel peut nuire au fonctionnement en service de la pièce ainsi fabriquée.
Par nature, la majorité des procédés de FA impliquent la fusion de matière (plastique ou métallique), ce qui va se traduire par des échauffements localisés et des différences de température très importants au sein de la pièce. Ces gradients thermiques vont conditionner la microstructure, la présence de contraintes internes (en lien avec la microstructure), la santé (présence de défauts), l’anisotropie (les propriétés ne sont pas les mêmes dans toutes les directions) et l’hétérogénéité (les propriétés ne sont pas les mêmes en tout point) des pièces. La fiabilité des pièces imprimées va donc beaucoup dépendre de ces caractéristiques.
En amont, il est alors important d’étudier les interactions entre procédés-microstructure et propriétés mécaniques pour différents types de matériaux. C’est l’objet de nos travaux de recherche menés à l’INSA Rouen Normandie. Pour les polymères, l’impression 3D par dépôt de filament fondu (FFF) présente une porosité intrinsèque qui réduit la résistance à la rupture. En utilisant des procédés tels que le laser shock peening (LSP), un traitement mécanique in situ appliqué à certaines couches pendant l’impression, on peut alors faire de la fonctionnalisation en réduisant localement la porosité et en créant des barrières ralentissant la propagation des fissures, améliorant ainsi la ténacité des matériaux (la résistance à la fissuration du matériau). De manière similaire, pour les alliages métalliques obtenus par Fusion sur Lit de Poudre, en jouant sur les paramètres de fabrication (puissance et vitesse de déplacement du laser notamment), il est possible d’ajuster localement les propriétés du matériau pour moduler sa ténacité ou sa capacité à se déformer plastiquement.*
Aussi, il est nécessaire de caractériser précisément – en aval de la fabrication – les propriétés (thermiques, électriques, mécaniques) des pièces en accord avec les normes de certification propres aux différents domaines d’activité (médical, aéronautique, aérospatiale, automobile, agro-alimentaire).
Les auteurs ne travaillent pas, ne conseillent pas, ne possèdent pas de parts, ne reçoivent pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'ont déclaré aucune autre affiliation que leur organisme de recherche.
11.01.2026 à 15:42
Groenland : rester avec les Inuit polaires
Texte intégral (2848 mots)
En juin 1951, l’explorateur Jean Malaurie voit surgir de la toundra une immense base militaire américaine, bâtie dans le secret le plus total. Ce choc marque pour lui le début d’un basculement irréversible pour les sociétés inuit. Aujourd’hui, alors que le Groenland redevient un enjeu stratégique mondial, l’histoire semble se répéter. Rester avec les Inuit polaires, c’est refuser de parler de territoires en oubliant ceux qui les habitent.
Le 16 juin 1951, l’explorateur français Jean Malaurie progresse en traîneaux à chiens sur la côte nord-ouest du Groenland. Il est parti seul, sur un coup de tête, avec un maigre pécule du CNRS, officiellement pour travailler sur les paysages périglaciaires. En réalité, cette rencontre avec des peuples dont la relation au monde était d’une autre nature allait forger un destin singulier.
Ce jour-là, après de longs mois d’isolement parmi les Inuit, au moment critique du dégel, Malaurie avance avec quelques chasseurs. Il est épuisé, sale, amaigri. L’un des Inuit lui touche l’épaule : « Takou, regarde » Un épais nuage jaune monte au ciel. À la longue-vue, Malaurie croit d’abord à un mirage : « une cité de hangars et de tentes, de tôles et d’aluminium, éblouissante au soleil dans la fumée et la poussière […] Il y a trois mois, la vallée était calme et vide d’hommes. J’avais planté ma tente, un jour clair de l’été dernier, dans une toundra fleurie et virginale. »
Le souffle de cette ville nouvelle, écrira-t-il, « ne nous lâchera plus ». Les excavatrices tentaculaires raclent la terre, les camions vomissent les gravats à la mer, les avions virevoltent. Malaurie est projeté de l’âge de pierre à l’âge de l’atome. Il vient de découvrir la base secrète américaine de Thulé, nom de code Operation Blue Jay. L’un des projets de construction militaire les plus massifs et les plus rapides de l’histoire des États-Unis.

Sous ce nom anodin se cache une logistique pharaonique. Les États-Unis redoutent une attaque nucléaire soviétique par la route polaire. En un seul été, quelque 120 navires et 12 000 hommes sont mobilisés dans une baie qui n’avait connu jusque-là que le glissement silencieux des kayaks. Le Groenland ne comptait alors qu’environ 23 000 habitants. En 104 jours, sur un sol gelé en permanence, surgit une cité technologique capable d’accueillir les bombardiers géants B-36, porteurs d’ogives nucléaires. À plus de 1 200 kilomètres au nord du cercle polaire, dans un secret presque total, les États-Unis font surgir l’une des plus grandes bases militaires jamais construites hors de leur territoire continental. Un accord de défense est signé avec le Danemark au printemps 1951, mais l’Operation Blue Jay est déjà engagée : la décision américaine a été prise dès 1950.
L’annexion de l’univers Inuit
Malaurie comprend aussitôt que la démesure de l’opération signe, de fait, une annexion de l’univers Inuit. Un monde fondé sur la vitesse, la machine, l’accumulation vient de pénétrer brutalement, aveuglément, un espace réglé par la tradition, le cycle, la chasse et l’attente.
Le geai bleu est un oiseau bruyant, agressif, extrêmement territorial. La base de Thulé se situe à mi-chemin entre Washington et Moscou par la route polaire. À l’heure des missiles hypersoniques intercontinentaux, hier soviétiques, aujourd’hui russes, c’est cette même géographie qui fonde encore l’argument du « besoin impérieux » invoqué par Donald Trump dans son désir d’annexion du Groenland.

Le résultat immédiat le plus tragique de l’Opération Blue Jay ne fut pas militaire, mais humain. En 1953, pour sécuriser le périmètre de la base et de ses radars, les autorités décidèrent de déplacer l’ensemble de la population inughuit locale vers Qaanaaq, à une centaine de kilomètres plus au nord. Le déplacement fut rapide, contraint, sans consultation, brisant le lien organique entre ce peuple et ses territoires de chasse ancestraux. Un “peuple racine” déraciné pour faire place à une piste d’aviation.
C’est sur ce moment de bascule foudroyante que Malaurie situe l’effondrement des sociétés traditionnelles inuit, où la chasse n’est pas une technique de survie mais un principe organisateur du monde social. L’univers inuit est une économie du sens, faite de relations, de gestes et de transmissions, qui donnent à chacun reconnaissance, rôle et place. Cette cohérence intime, qui fait la force de ces sociétés, les rend aussi extrêmement vulnérables lorsqu’un système extérieur en détruit soudainement les fondements territoriaux et symboliques.
Conséquences de l’effondrement des structures traditionnelles
Aujourd’hui, la société groenlandaise est largement sédentarisée et urbanisée. Plus du tiers des 56 500 habitants vit à Nuuk, la capitale, et la quasi-totalité de la population réside désormais dans des villes et localités côtières sédentarisées. L’habitat reflète cette transition brutale. Dans les grandes villes, une part importante de la population occupe des immeubles collectifs en béton, construits pour beaucoup dans les années 1960 et 1970, souvent vétustes et suroccupées. L’économie repose largement sur une pêche industrielle tournée vers l’exportation. La chasse et la pêche de subsistance persistent. Fusils modernes, GPS, motoneiges, connexions satellitaires accompagnent désormais les gestes anciens. La chasse demeure un repère identitaire, mais elle ne structure plus ni l’économie ni la transmission.
Les conséquences humaines de cette rupture sont massives. Le Groenland présente aujourd’hui l’un des taux de suicide les plus élevés au monde, en particulier chez les jeunes hommes inuit. Les indicateurs sociaux contemporains du Groenland - taux de suicide, alcoolisme, violences intrafamiliales – sont largement documentés. De nombreux travaux les relient à la rapidité des transformations sociales, à la sédentarisation et à la rupture des transmissions traditionnelles.

Revenons à Thulé. L’immense projet secret engagé au début des années 1950 n’avait rien de provisoire. Radars, pistes, tours radio, hôpital : Thulé devient une ville stratégique totale. Pour Malaurie, l’homme du harpon est condamné. Non par une faute morale, mais par une collision de systèmes. Il met en garde contre une européanisation qui ne serait qu’une civilisation de tôle émaillée, matériellement confortable, humainement appauvrie. Le danger n’est pas dans l’irruption de la modernité, mais dans l’avènement, sans transition, d’une modernité sans intériorité, opérant sur des terres habitées comme si elles étaient vierges, répétant, à cinq siècles d’écart, l’histoire coloniale des Amériques.
Espaces et contaminations radioactives
Le 21 janvier 1968, cette logique atteint un point de non-retour. Un bombardier B-52G de l’US Air Force, engagé dans une mission permanente d’alerte nucléaire du dispositif Chrome Dome, s’écrase sur la banquise à une dizaine de kilomètres de Thulé. Il transporte quatre bombes thermonucléaires. Les explosifs conventionnels des bombes nucléaires, destinés à amorcer la réaction, détonnent à l’impact. Il n’y a pas d’explosion nucléaire, mais la déflagration disperse sur une vaste zone du plutonium, de l’uranium, de l’americium et du tritium.
Dans les jours qui suivent, Washington et Copenhague lancent Project Crested Ice, une vaste opération de récupération et de décontamination avant la fonte printanière. Environ 1 500 travailleurs danois sont mobilisés pour racler la glace et collecter la neige contaminée. Plusieurs décennies plus tard, nombre d’entre eux engageront des procédures judiciaires, affirmant avoir travaillé sans information ni protection adéquates. Ces contentieux se prolongeront jusqu’en 2018-2019, débouchant sur des indemnisations politiques limitées, sans reconnaissance juridique de responsabilité. Aucune enquête épidémiologique exhaustive ne sera jamais menée auprès des populations inuit locales.
Aujourd’hui rebaptisée Pituffik Space Base, l’ancienne base de Thulé est l’un des nœuds stratégiques majeurs du dispositif militaire américain. Intégrée à la US Space Force, elle joue un rôle central dans l’alerte antimissile et la surveillance spatiale en Arctique, sous un régime de sécurité maximale. Elle n’est pas un vestige de la guerre froide, mais un pivot actif de la géopolitique contemporaine.
Dans Les Derniers Rois de Thulé, Malaurie montre que les peuples racine n’ont jamais de place possible au cœur des considérations stratégiques occidentales. Face aux grandes manœuvres du monde, l’existence des Inuit y devient aussi périphérique que celle des phoques ou des papillons.
Les déclarations de Donald Trump ne font pas surgir un monde nouveau. Elles visent à généraliser au Groenland un système en place depuis soixante-quinze ans. Mais la position d’un homme ne saurait nous exonérer de nos responsabilités collectives. Entendre aujourd’hui que le Groenland « appartient » au Danemark et dépend de l’OTAN, sans même évoquer les Inuit, revient à répéter un vieux geste colonial : concevoir les territoires en y effaçant ceux qui l’habitent.
Les Inuit demeurent invisibles et inaudibles. Nos sociétés continuent de se représenter comme des adultes face à des populations indigènes infantilisées. Leur savoir, leurs valeurs, leurs manières sont relégués au rang de variables secondaires. La différence n’entre pas dans les catégories à partir desquelles nos sociétés savent agir.
À la suite de Jean Malaurie, mes recherches abordent l’humain par ses marges. Qu’il s’agisse des sociétés de chasseurs-cueilleurs ou de ce qu’il reste de Néandertal, lorsqu’on le déshabille de nos projections, l’Autre demeure toujours l’angle mort de notre regard. Nous ne savons pas voir comment s’effondrent des mondes entiers lorsque la différence cesse d’être pensable.
Malaurie concluait son premier chapitre sur Thulé par ces mots :
« Rien n’aura été prévu pour imaginer l’avenir avec hauteur. »
Il faut redouter par-dessus tout non la disparition brutale d’un peuple, mais sa relégation silencieuse, et radicale, dans un monde qui parle de lui sans jamais le regarder ni l’entendre.
Ludovic Slimak ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
07.01.2026 à 11:49
Éditer le génome pour soigner : où en sont les thérapies issues de CRISPR et ses dérivés ?
Texte intégral (1679 mots)
Ce qui ressemblait hier encore à de la science-fiction est désormais une réalité clinique : l’édition du génome humain avec CRISPR-Cas9 commence à guérir des maladies jusque-là incurables. Mais où en est réellement cette révolution annoncée ? Entre premiers succès cliniques, limites techniques et questions éthiques persistantes, les thérapies issues de CRISPR dessinent un paysage où promesses et prudence sont désormais indissociables.
Nous assistons à une nette montée des espoirs pour des maladies rares, souvent « orphelines ». Par exemple, un nourrisson atteint d’un déficit métabolique rare (une maladie génétique dans laquelle une enzyme ou une voie métabolique essentielle ne fonctionne pas correctement) dû à une mutation sur le gène CPS1, a reçu en 2025 un traitement « sur mesure » utilisant la technique d’édition de base (base editing), avec des résultats biologiques encourageants.
Aujourd’hui, l’édition génique n’est plus une hypothèse lointaine, mais donne des résultats concrets et change déjà la vie de certains patients. Pour comprendre ce qui est en train de se jouer, il faut revenir sur les progrès fulgurants de ces dernières années, des premiers essais pionniers aux versions de plus en plus sophistiquées de l’édition génomique.
Développée en 2012 grâce à l’association d’une endonucléase, Cas9, et de petits ARN guides (sgRNA), cette méthode d’édition ciblée du génome a bouleversé la biologie moderne, au point de valoir à ses inventrices le prix Nobel de chimie en 2020. Depuis son invention, le CRISPR-Cas9 classique est largement utilisé dans les laboratoires, dont le nôtre, pour créer des modèles cellulaires de maladies, fabriquer des cellules qui s’illuminent sous certaines conditions ou réagissent à des signaux précis, et explorer le rôle de gènes jusqu’ici mystérieux.
Un premier système extraordinaire mais imparfait
Côté clinique, l’utilisation de CRISPR-Cas9 a ouvert des possibilités thérapeutiques inédites : modifier précisément un gène, l’inactiver ou en corriger une version défectueuse, le tout avec une simplicité et une rapidité jusqu’alors inimaginables. Mais cette puissance s’accompagnait alors de limites importantes : une précision parfois imparfaite, avec des coupures hors-cible difficiles à anticiper (des modifications accidentelles de l’ADN réalisées à des endroits non prévus du génome), une efficacité variable selon les cellules, et l’impossibilité d’effectuer des modifications plus fines sans induire de cassure double brin (une rupture affectant les deux brins d’ADN à un site génomique spécifique) potentiellement délétère.
Ces limites tiennent en grande partie au recours obligatoire aux cassures double brin et à la réparation par homologie (mode de réparation de l’ADN dans lequel la cellule s’aide d’une séquence d’ADN modèle très similaire – ou fournie par le chercheur – pour réparer une cassure double brin), un mécanisme peu fiable et inégal selon les types cellulaires. Mais la véritable rupture est apparue à partir de 2016 avec l’invention des éditeurs de base (base editors), des versions ingénieusement modifiées de CRISPR capables de changer une seule lettre de l’ADN sans provoquer de cassure double brin. Pour la première fois, il devenait possible de réécrire le génome avec une précision quasi chirurgicale, ouvrant la voie à des corrections plus sûres et plus fines que celles permises par Cas9 classique. Cependant, les base editors restaient limités : ils permettaient d’effectuer certaines substitutions de bases, mais étaient incapables de réaliser des insertions ou des modifications plus complexes du génome.
Ces limitations des base editors ont été en partie levées avec l’arrivée de leurs successeurs, les prime editors, en 2019 : ces nouvelles machines moléculaires permettent non seulement de substituer des bases, mais aussi d’insérer ou de supprimer de courtes séquences (jusqu’à plusieurs kilobases), le tout sans provoquer de cassure double brin, offrant ainsi un contrôle beaucoup plus fin sur le génome. Cette technique a été utilisée avec succès pour créer en laboratoire des modèles cellulaires et animaux de maladies génétiques, et des plantes transgéniques. Cependant, en pratique, son efficacité restait trop faible pour des traitements humains, et le résultat dépendait du système de réparation de la cellule, souvent inactif ou aléatoire. Mais en six ans, la technique a gagné en précision et polyvalence, et les études chez l’animal ont confirmé à la fois son efficacité et la réduction des effets hors-cible. Résultat : en 2025, six ans après son invention, le prime editing fait enfin son entrée en clinique, un moment que beaucoup de médecins décrivent comme un véritable tournant pour la médecine.
Des traitements sur le marché
Dès 2019, de premiers essais cliniques avec le système CRISPR-Cas9 classique (le médicament Casgevy) avaient été réalisés sur des patients atteints de β-thalassémie et drépanocytose, deux maladies génétiques de l’hémoglobine, via la correction ex vivo et la réinjection des cellules modifiées au patient. Les premiers résultats étaient prometteurs : certains patients avaient vu leur production de globules rouges anormaux corrigée de manière durable, avec une amélioration significative de leurs symptômes, après une unique injection. Le traitement Casgevy a d’ailleurs été approuvé en Europe en 2024, pour un coût d’environ 2 millions d’euros par patient.
Plus récemment, en 2025 un bébé atteint d’une mutation du gène CPS1 a été guéri grâce à l’édition de base, la version moins invasive et plus sûre de CRISPR-Cas9, mais qui reste limitée aux substitutions ponctuelles et ne permet pas toutes les modifications (pas d’insertion de séquences longues). Mais aujourd’hui, le prime editing lève les deux grands verrous du CRISPR-Cas9 classique – la nécessité de casser l’ADN et la dépendance à des mécanismes de réparation inefficaces – ouvrant la voie à une édition plus sûre, plus précise et applicable à un spectre beaucoup plus large de maladies.
Il n’est plus limité à de simples conversions ponctuelles, mais permet pour la première fois de remplacer ou restaurer un gène complet, de façon précise et contrôlée. L’année 2025 marque le premier succès clinique d’une telle thérapie – une étape historique pour l’édition génomique. En effet, le 19 mai 2025 la société Prime Medicine fondée par David Liu, inventeur du prime editing, a annoncé la première administration humaine de sa thérapie, destinée à un jeune patient atteint de granulomatose chronique, une maladie immunitaire rare liée à une mutation de l’ADN. Les premiers résultats biologiques de ce « CRISPR ultrapuissant » se sont révélés très prometteurs, ouvrant une nouvelle ère pour l’édition génomique. Il faudra toutefois patienter encore quelques mois avant de mesurer réellement le succès du prime editing : les premiers essais cliniques restent très récents et le manque de recul ne permet pas encore d’en tirer des conclusions définitives, notamment en termes de sécurité – l’absence d’effets secondaires – et de stabilité à long terme.
Ces stratégies d’édition du génome s’inscrivent pleinement dans le mouvement de la médecine personnalisée, où chaque traitement est conçu sur mesure pour un patient donné, en fonction de sa mutation spécifique – un véritable médicament « pour lui seul ». Pour la suite, des sociétés annoncent déjà vouloir continuer l’aventure avec des stratégies consistant à administrer directement les traitements dans le corps, sans passer par la modification in vitro de cellules prélevées chez le patient – une procédure complexe et onéreuse.
D’un prototype de laboratoire, on est donc passés en un temps record à une technologie polyvalente, et on entre désormais dans l’ère de la médecine personnalisée même pour des pathologies très rares. Le champ d’application s’élargit : on ne se contente plus des pathologies sanguines – des essais et projets explorent des maladies métaboliques, des infections chroniques (ex. thérapies pour hépatite B) ou des maladies héréditaires rares. De nouvelles avancées viennent constamment enrichir le potentiel de CRISPR, élargissant sans cesse ses possibilités. Tous les types de maladies ne sont pas encore éligibles : les pathologies monogéniques (mutation simple, bien identifiée) sont les plus adaptées. Pour des maladies multifactorielles, complexes, ou dépendant de l’environnement, l’édition reste beaucoup moins directe. De plus, certaines cibles (cellules non accessibles, tissus spécifiques, traitement in vivo) restent techniquement très difficiles. C’est également un défi économique, tant les traitements de médecine personnalisée restent extrêmement coûteux.
Carole Arnold a reçu des financements de l'INSERM, la Région Grand-Est, le FEDER et l'ANR.
07.01.2026 à 11:49
Que sont les xénobots, ces robots biologiques qui bouleversent les frontières entre vivant et machine ?
Texte intégral (2918 mots)
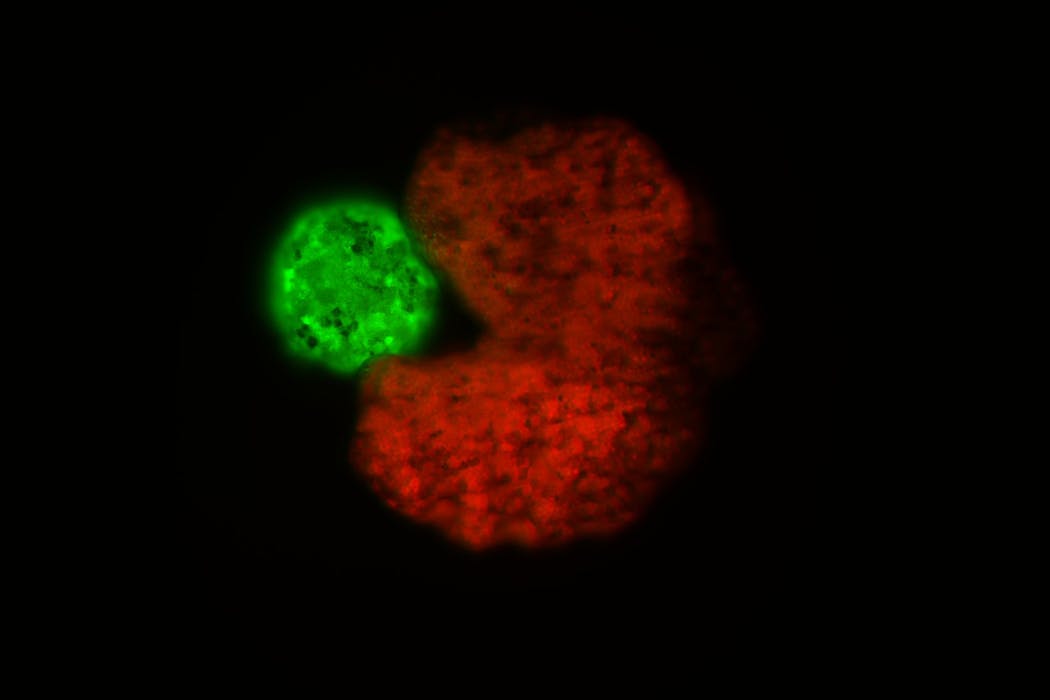
Les xénobots attirent aujourd’hui l’attention. Cette nouvelle catégorie de « robots vivants », fabriqués à partir de cellules d’amphibien et conçus grâce à des algorithmes, est capable de se déplacer, de se réparer et même, dans certaines expériences, de se reproduire en assemblant de nouveaux agrégats cellulaires. Ces entités questionnent la frontière entre machine et organisme. Des études récentes détaillent mieux leur fonctionnement moléculaire et ravivent les débats éthiques sur le contrôle de ces formes de vie programmables.
Les xénobots sont des entités biologiques artificielles entièrement composées de cellules vivantes issues d’embryons de xénope (Xenopus laevis), un amphibien africain. Prélevées sur des embryons de stade précoce, ces cellules sont encore indifférenciées : elles ne se sont pas encore spécialisées pour devenir des cellules de peau ou du foie par exemple. Elles sont cependant déjà « programmées » naturellement pour devenir des cellules qui tapissent les surfaces internes et externes du corps (peau, parois des organes, vaisseaux) ou des cellules contractiles du muscle cardiaque. Les contractions de ces cellules cardiaques agissent comme de minuscules moteurs, générant une propulsion, qui permet aux xénobots de se déplacer dans un milieu aquatique.
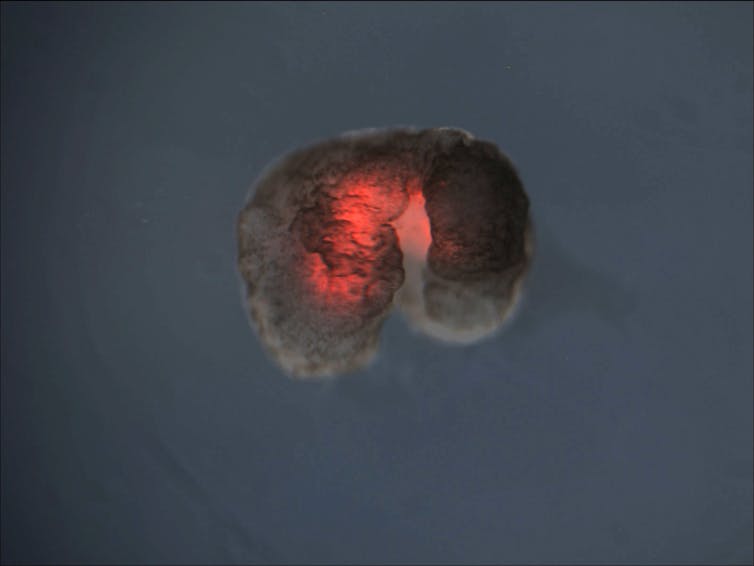
Pour fabriquer un xénobot, on isole et on assemble manuellement des groupes de cellules, comme des « briques biologiques ». À l’issue de cette phase de microchirurgie et d’organisation tridimensionnelle, les xénobots sont des entités de moins d’un millimètre de morphologies variables selon la fonction recherchée. Ils ne disposent d’aucun système nerveux ni organe sensoriel. Leur comportement est uniquement dicté par leur forme et leur composition cellulaire, toutes deux déterminées lors de leur création via des techniques de bio-ingénierie.
Bien qu’ils soient constitués uniquement de cellules vivantes, on parle de robots biologiques ou biobots, car ils obéissent à des tâches prédéfinies par l’humain : déplacement, coopération en essaim, transport d’objets, voire contrôle et assemblage d’autres xénobots à partir de cellules libres présentes autour d’eux (on parle d’autoréplication). Le terme « robot » prend ici un sens élargi, fondé sur la capacité à accomplir une tâche, en l’occurrence programmée par la forme et non par un logiciel interne.
Des robots biologiques conçus avec de l’IA
Avant de fabriquer un xénobot en laboratoire, des programmes d’intelligence artificielle (IA) sont utilisés pour tester virtuellement et simuler des milliers de formes et d’agencements cellulaires. Des algorithmes calculent quelles combinaisons fonctionneraient le mieux pour atteindre l’objectif fixé par le cahier des charges : par exemple, maximiser la vitesse de déplacement, transporter une charge ou induire de l’autoréplication.
Le lien entre l’intelligence artificielle et les cellules n’existe que lors de l’étape théorique de la conception. L’IA sert exclusivement à prédire et à optimiser la forme la plus adéquate, qui sera ensuite réalisée par microchirurgie et assemblage par des humains. Elle ne fournit aucun processus cognitif embarqué dans le xénobot, qui n’est donc pas contrôlé par une IA et ne possède aucune autonomie décisionnelle, contrairement à d’autres types de robots en développement.
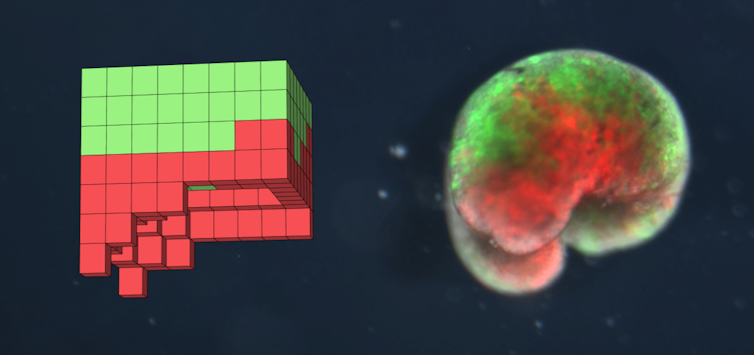
Les xénobots ont d’abord été conçus sous forme de sphères, de triangles ou de pyramides, des géométries simples choisies pour être faciles à construire, afin d’étudier de manière contrôlée la manière dont la forme et la disposition des cellules influencent le mouvement.
La forme en croissant, dite Pac-Man, a été identifiée par intelligence artificielle comme la plus performante pour s’autorépliquer. La réplication est cependant limitée à trois ou quatre générations en laboratoire et les xénobots se dégradent après environ dix jours, limitant leurs applications à plus long terme.
Quelles applications pour les xénobots ?
Toutes les applications envisagées demeurent pour l’instant expérimentales. Certaines fonctions (locomotion, agrégation de particules, autoréparation, réplication limitée) ont été démontrées in vitro, ce qui constitue des preuves de concept. En revanche, les usages proposés en médecine ou pour l’environnement restent pour l’instant des hypothèses extrapolées à partir de ces expériences et de modèles informatiques, sans validation chez l’animal.
Dans le domaine environnemental, grâce à leur petite taille, leur forte biodégradabilité et leur capacité à fonctionner en essaim, les xénobots pourraient être utilisés pour concentrer des microparticules ou des polluants en un même endroit, avant une étape de récupération ou de traitement adaptée, les xénobots eux-mêmes se dégradant ensuite sans laisser de trace biologique.
Des versions plus complexes de xénobots pourraient être utilisées comme marqueurs visuels de modifications dans un environnement. Un tel xénobot, exposé à un certain type de polluant, subirait un changement de structure et de couleur. Cette propriété permettrait en quelque sorte de lire ce que le xénobot a rencontré dans son environnement, à l’image d’un capteur lumineux. Cette application n’a cependant pas encore été démontrée expérimentalement.
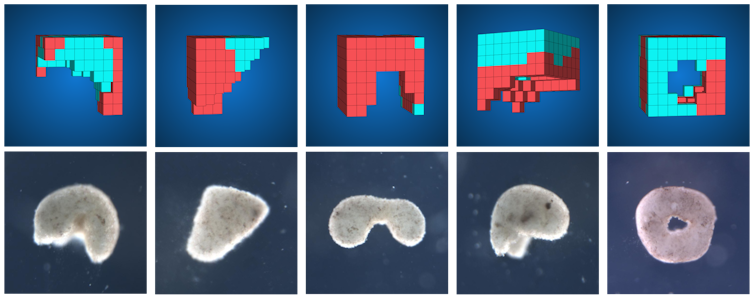
Dans le domaine médical, les xénobots pourraient être utilisés, tout comme d’autres microrobots, pour transporter localement des molécules thérapeutiques autour de cellules cibles, en réduisant ainsi la toxicité sur les tissus sains. La possibilité que les xénobots puissent servir à la livraison de molécules, comme des anticancéreux, reste cependant une extrapolation à partir d’expériences in vitro préliminaires sur d’autres microrobots.
Enfin, la recherche fondamentale pourrait bénéficier de l’existence de ces objets. L’organisation cellulaire des xénobots, hors du contexte embryonnaire, offre un modèle pour explorer la plasticité cellulaire ou tissulaire, la coordination cellulaire collective et l’auto-organisation, domaines clés pour comprendre l’évolution d’entités vivantes.
Des propriétés inattendues
Au-delà des tâches programmées, des propriétés remarquables ont été identifiées expérimentalement. Par exemple, des xénobots exposés à des vibrations sonores modifient significativement leur comportement moteur, passant d’une rotation à un déplacement linéaire rapide, une réaction absente chez les embryons de xénope au même stade.
En regroupant des cellules selon des architectures originales, les xénobots obligeraient ces cellules à reprogrammer en partie leur activité génétique : des analyses des gènes activés par ces cellules montrent l’activation de voies de stress, de réparation tissulaire ou de remodelage, qui ne sont pas utilisées de la même façon dans l’embryon intact.
De plus, dans ces expériences, plusieurs xénobots sectionnés se réparent spontanément et retrouvent un mouvement coordonné, ce qui suggère une communication à courte distance entre cellules, probablement via des signaux bioélectriques et chimiques, alors qu’aucun nerf n’est présent. Ces comportements illustrent une forte plasticité cellulaire, dont l’ampleur varie selon la manière dont les tissus ont été assemblés et les conditions de culture employées.
Derrière les promesses, des enjeux éthiques majeurs
Les promesses d’applications médicales ou environnementales ne doivent pas occulter l’ambiguïté de statut de ces entités, ni organismes naturels ni machines traditionnelles. Les xénobots sont des assemblages cellulaires conçus par l’humain appuyé par des systèmes d’intelligence artificielle. Leur déploiement reste, aujourd’hui, de l’ordre de l’hypothèse.
Plusieurs risques sont discutés par les bioéthiciens. Écologique d’abord, en cas d’acquisition par les xénobots d’une capacité de survie ou de réplication inattendue dans l’environnement. Sanitaire ensuite, en cas d’utilisation chez l’humain sans maîtrise complète de leur comportement à long terme. Un risque de détournement enfin, par exemple pour la libération ciblée d’agents toxiques.
À lire aussi : Xénobots, biobots : doit-on avoir peur des « robots vivants » ?
À cela s’ajoutent des enjeux plus symboliques : brouiller davantage la frontière entre vivant et non-vivant pourrait fragiliser certains cadres juridiques de protection du vivant, d’où les appels à un cadre réglementaire international spécifique à ces biorobots. Les promesses d’applications médicales ou dans le domaine de l’environnement ne doivent pas occulter l’ambiguïté de statut de ces entités, qui exigent une réflexion éthique et un cadre réglementaire international.
L’extension de l’utilisation de ces outils biologiques à des cellules humaines ne devra se réaliser que dans un cadre strictement contrôlé et sous supervision d’un comité éthique pluridisciplinaire. Plusieurs travaux dans ce domaine recommandent déjà des évaluations systématiques des risques (écologiques, sanitaires et de détournement), une transparence des protocoles et une implication du public dans les décisions de déploiement.
Il a été proposé de créer des instances spécifiques à cette technologie, chargées de vérifier la biodégradabilité, la limitation de la réplication, la traçabilité des essais et le respect de la dignité du vivant. Dans ce contexte, l’usage éventuel de xénobots ou d’organismes similaires dérivés de cellules humaines devrait s’inscrire dans un cadre réglementaire international inspiré de ces recommandations, avec des garde-fous comparables à ceux mis en place pour les organismes génétiquement modifiés (OGM) ou les thérapies géniques.
Jean-François Bodart ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
07.01.2026 à 11:49
D’où venons-nous ? Un voyage de 4 milliards d’années jusqu’à l’origine de nos cellules
Texte intégral (4270 mots)
Entrée à l’Académie des sciences en janvier 2025, Purificación López García s’intéresse à l’origine et aux grandes diversifications du vivant sur Terre. Elle étudie la diversité, l’écologie et l’évolution des microorganismes des trois domaines du vivant (archées, bactéries, eucaryotes). Avec David Moreira, elle a émis une hypothèse novatrice pour expliquer l’origine de la cellule eucaryote, celle dont sont composés les plantes, les animaux et les champignons, entre autres. Elle est directrice de recherche au CNRS depuis 2007 au sein de l’unité Écologie- Société-Évolution de l’Université Paris-Saclay et a été récompensée de la médaille d’argent du CNRS en 2017. Elle a raconté son parcours et ses découvertes à Benoît Tonson, chef de rubrique Science et Technologie.
The Conversation : Vous vous intéressez à l’origine du vivant. Vivant, que l’on classifie en trois grands domaines : les eucaryotes, des organismes dont les cellules ont un noyau, comme les humains ou les plantes par exemple ; les bactéries, qui ne possèdent pas de noyau, et un troisième, sans doute le moins connu, les archées. Pouvez-vous nous les présenter ?
Purificación López García : Ce domaine du vivant a été mis en évidence par Carl Woese à la fin des années 1970. Quand j’ai commencé mes études, à la fin des années 1980, cette découverte ne faisait pas consensus, il y avait encore beaucoup de résistance de la part de certains biologistes à accepter un troisième domaine du vivant. Ils pensaient qu’il s’agissait tout simplement de bactéries. En effet, comme les bactéries, les archées sont unicellulaires et n’ont pas de noyau. Il a fallu étudier leurs gènes et leurs génomes pour montrer que les archées et les bactéries étaient très différentes entre elles et même que les archées étaient plus proches des eucaryotes que des bactéries au niveau de leur biologie moléculaire.
Comment Carl Woese a-t-il pu classifier le vivant dans ces trois domaines ?
P. L. G. : On est donc à la fin des années 1970. C’est l’époque où commence à se développer la phylogénie moléculaire. L’idée fondatrice de cette discipline est qu’il est possible d’extraire des informations évolutives à partir des gènes et des protéines codées dans le génome de tous les êtres vivants. Certains gènes sont conservés chez tous les organismes parce qu’ils codent des ARN ou des protéines dont la fonction est essentielle à la cellule. Toutefois, la séquence en acides nucléiques (les lettres qui composent l’ADN : A, T, C et G ; U à la place de T dans l’ARN) et donc celle des acides aminés des protéines qu’ils codent (des combinaisons de 20 lettres) va varier. En comparant ces séquences, on peut déterminer si un organisme est plus ou moins proche d’un autre et classifier l’ensemble des organismes en fonction de leur degré de parenté évolutive.
Carl Woese est le premier à utiliser cette approche pour classifier l’ensemble du vivant : de la bactérie à l’éléphant, en passant par les champignons… Il va s’intéresser dans un premier temps non pas à l’ADN mais à l’ARN et, plus précisément, à l’ARN ribosomique. Le ribosome est la structure qui assure la traduction de l’ARN en protéines. On peut considérer que cette structure est la plus conservée dans tout le vivant : elle est présente dans toutes les cellules.
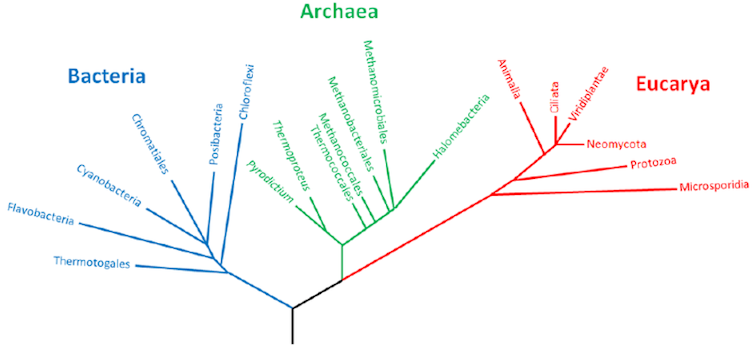
Avec ses comparaisons des séquences d’ARN ribosomiques, Woese montre deux choses : que l’on peut établir un arbre universel du vivant en utilisant des séquences moléculaire et qu’un groupe de séquences d’organismes considérés comme de bactéries « un peu bizarres », souvent associées à des milieux extrêmes, forment une clade (un groupe d’organismes) bien à part. En étudiant leur biologie moléculaire et, plus tard, leurs génomes, les archées s’avéreront en réalité beaucoup plus proches des eucaryotes, tout en ayant des caractéristiques propres, comme la composition unique des lipides de leurs membranes.
Aujourd’hui, avec les progrès des méthodes moléculaires, cette classification en trois grands domaines reste d’actualité et est acceptée par l’ensemble de la communauté scientifique. On se rend compte aussi que la plupart de la biodiversité sur Terre est microbienne.
Vous vous êtes intéressée à ces trois grands domaines au fur et à mesure de votre carrière…
P. L. G. : Depuis toute petite, j’ai toujours été intéressée par la biologie. En démarrant mes études universitaires, les questions liées à l’évolution du vivant m’ont tout de suite attirée. Au départ, je pensais étudier la biologie des animaux, puis j’ai découvert la botanique et enfin le monde microbien, qui m’a complètement fascinée. Toutes les formes de vie m’intéressaient, et c’est sûrement l’une des raisons pour lesquelles je me suis orientée vers la biologie marine pendant mon master. Je pouvais travailler sur un écosystème complet pour étudier à la fois les microorganismes du plancton, mais aussi les algues et les animaux marins.
Puis, pendant ma thèse, je me suis spécialisée dans le monde microbien et plus précisément dans les archées halophiles (celles qui vivent dans des milieux très concentrés en sels). Les archées m’ont tout de suite fascinée parce que, à l’époque, on les connaissait comme des organismes qui habitaient des environnements extrêmes, très chauds, très salés, très acides. Donc, c’était des organismes qui vivaient aux limites du vivant. Les étudier, cela permet de comprendre jusqu’où peut aller la vie, comment elle peut évoluer pour coloniser tous les milieux, même les plus inhospitaliers.
Cette quête de l’évolution que j’avais toujours à l’esprit a davantage été nourrie par des études sur les archées hyperthermophiles lors de mon postdoctorat, à une époque où une partie de la communauté scientifique pensait que la vie aurait pu apparaître à proximité de sources hydrothermales sous-marines. J’ai orienté mes recherches vers l’origine et l’évolution précoce de la vie : comment est-ce que la vie est apparue et s’est diversifiée ? Comment les trois domaines du vivant ont-ils évolué ?
Pour répondre à ces questions, vous avez monté votre propre laboratoire. Avec quelle vision ?
P. L. G. : Après un bref retour en Espagne, où j’ai commencé à étudier la diversité microbienne dans le plancton océanique profond, j’ai monté une petite équipe de recherche à l’Université Paris-Sud. Nous nous sommes vraiment donné la liberté d’explorer la diversité du vivant avec les outils moléculaires disponibles, mais en adoptant une approche globale, qui prend en compte les trois domaines du vivant. Traditionnellement, les chercheurs se spécialisent : certains travaillent sur les procaryotes – archées ou bactéries –, d’autres sur les eucaryotes. Les deux mondes se croisent rarement, même si cela commence à changer.
Cette séparation crée presque deux cultures scientifiques différentes, avec leurs concepts, leurs références et même leurs langages. Pourtant, dans les communautés naturelles, cette frontière n’existe pas : les organismes interagissent en permanence. Ils échangent, collaborent, entrent en symbiose mutualiste ou, au contraire, s’engagent dans des relations de parasitisme ou de compétition.
Nous avons décidé de travailler simultanément sur les procaryotes et les eucaryotes, en nous appuyant d’abord sur l’exploration de la diversité. Cette étape est essentielle, car elle constitue la base qui permet ensuite de poser des questions d’écologie et d’évolution.
L’écologie s’intéresse aux relations entre organismes dans un écosystème donné. Mais mes interrogations les plus profondes restent largement des questions d’évolution. Et l’écologie est indispensable pour comprendre ces processus évolutifs : elle détermine les forces sélectives et les interactions quotidiennes qui façonnent les trajectoires évolutives, en favorisant certaines tendances plutôt que d’autres. Pour moi, les deux dimensions – écologique et évolutive – sont intimement liées, surtout dans le monde microbien.
Sur quels terrains avez-vous travaillé ?
P. L. G. : Pour approfondir ces questions, j’ai commencé à travailler dans des environnements extrêmes, des lacs de cratère mexicains au lac Baïkal en Sibérie, du désert de l’Atacama et l’Altiplano dans les Andes à la dépression du Danakil en Éthiopie, et en m’intéressant en particulier aux tapis microbiens. À mes yeux, ces écosystèmes microbiens sont les véritables forêts du passé. Ce type de systèmes a dominé la planète pendant l’essentiel de son histoire.

La vie sur Terre est apparue il y a environ 4 milliards d’années, alors que notre planète en a environ 4,6. Les eucaryotes, eux, n’apparaissent qu’il y a environ 2 milliards d’années. Les animaux et les plantes ne se sont diversifiés qu’il y a environ 500 millions d’années : autant dire avant-hier à l’échelle de la planète.
Pendant toute la période qui précède l’émergence des organismes multicellulaires complexes, le monde était entièrement microbien. Les tapis microbiens, constitués de communautés denses et structurées, plus ou moins épaisses, formaient alors des écosystèmes très sophistiqués. Ils étaient, en quelque sorte, les grandes forêts primitives de la Terre.
Étudier aujourd’hui la diversité, les interactions et le métabolisme au sein de ces communautés – qui sont devenues plus rares car elles sont désormais en concurrence avec les plantes et les animaux – permet de remonter le fil de l’histoire évolutive. Ces systèmes nous renseignent sur les forces de sélection qui ont façonné la vie dans le passé ainsi que sur les types d’interactions qui ont existé au cours des premières étapes de l’évolution.
Certaines de ces interactions ont d’ailleurs conduit à des événements évolutifs majeurs, comme l’origine des eucaryotes, issue d’une symbiose entre procaryotes.
Comment ce que l’on observe aujourd’hui peut-il nous fournir des informations sur le passé alors que tout le vivant ne cesse d’évoluer ?
P. L. G. : On peut utiliser les communautés microbiennes actuelles comme des analogues de communautés passées. Les organismes ont évidemment évolué – ils ne sont plus les mêmes –, mais nous savons deux choses essentielles. D’abord, les fonctions centrales du métabolisme sont bien plus conservées que les organismes qui les portent. En quelque sorte, il existe un noyau de fonctions fondamentales. Par exemple, il n’existe que très peu de manières de fixer le CO₂ présent dans l’atmosphère. La plus connue est le cycle de Calvin associé à la photosynthèse oxygénique de cyanobactéries des algues et des plantes. Ce processus permet d’utiliser le carbone du CO₂ pour produire des molécules organiques plus ou moins complexes indispensables à tout organisme.
On connaît six ou sept grandes voies métaboliques de fixation du carbone inorganique, qui sont en réalité des variantes les unes des autres. La fixation du CO₂, c’est un processus absolument central pour tout écosystème. Certains organismes, dont les organismes photosynthétiques, fixent le carbone. Ce sont les producteurs primaires.
Ensuite vient toute la diversification d’organismes et des voies qui permettent de dégrader et d’utiliser cette matière organique produite par les fixateurs de carbone. Et là encore, ce sont majoritairement les microorganismes qui assurent ces fonctions. Sur Terre, ce sont eux qui pilotent les grands cycles biogéochimiques. Pas tellement les plantes ou les animaux. Ces cycles existaient avant notre arrivée sur la planète, et nous, animaux comme plantes, ne savons finalement pas faire grand-chose à côté de la diversité métabolique microbienne.
Les procaryotes – archées et bactéries – possèdent une diversité métabolique bien plus vaste que celle des animaux ou des végétaux. Prenez la photosynthèse : elle est héritée d’un certain type de bactéries que l’on appelle cyanobactéries. Ce sont elles, et elles seules, chez qui la photosynthèse oxygénique est apparue et a évolué (d’autres bactéries savent faire d’autres types de photosynthèse dites anoxygéniques). Et cette innovation a été déterminante pour notre planète : avant l’apparition des cyanobactéries, l’atmosphère ne contenait pas d’oxygène. L’oxygène atmosphérique actuel n’est rien d’autre que le résultat de l’accumulation d’un déchet de cette photosynthèse.
Les plantes et les algues eucaryotes, elles, n’ont fait qu’hériter de cette capacité grâce à l’absorption d’une ancienne cyanobactérie capable de faire la photosynthèse (on parle d’endosymbiose). Cet épisode a profondément marqué l’évolution des eucaryotes, puisqu’il a donné naissance à toutes les lignées photosynthétiques – algues et plantes.
À l’instar de la fixation du carbone lors de la photosynthèse, ces voies métaboliques centrales sont beaucoup plus conservées que les organismes qui les portent. Ces organismes, eux, évoluent en permanence, parfois très rapidement, pour s’adapter aux variations de température, de pression, aux prédateurs, aux virus… Pourtant, malgré ces changements, les fonctions métaboliques centrales restent préservées.
Et ça, on peut le mesurer. Lorsque l’on analyse la diversité microbienne dans une grande variété d’écosystèmes, on observe une diversité taxonomique très forte, avec des différences d’un site à l’autre. Mais quand on regarde les fonctions de ces communautés, de grands blocs de conservation apparaissent. En appliquant cette logique, on peut donc remonter vers le passé et identifier des fonctions qui étaient déjà conservées au tout début de la vie – des fonctions véritablement ancestrales. C’est un peu ça, l’idée sous-jacente.
Finalement, jusqu’où peut-on remonter ?
P. L. G. : On peut remonter jusqu’à un organisme disons « idéal » que l’on appelle le Last Universal Common Ancestor, ou LUCA – le dernier ancêtre commun universel des organismes unicellulaires. Mais on sait que cet organisme était déjà très complexe, ce qui implique qu’il a forcément été précédé d’organismes beaucoup plus simples.
On infère l’existence et les caractéristiques de cet ancêtre par comparaison : par la phylogénie moléculaire, par l’étude des contenus en gènes et des propriétés associées aux trois grands domaines du vivant. En réalité, je raisonne surtout en termes de deux grands domaines, puisque l’on sait aujourd’hui que les eucaryotes dérivent d’une symbiose impliquant archées et bactéries. Le dernier ancêtre commun, dans ce cadre, correspondrait donc au point de bifurcation entre les archées et les bactéries.
À partir de là, on peut établir des phylogénies, construire des arbres, et comparer les éléments conservés entre ces deux grands domaines procaryotes. On peut ainsi inférer le « dénominateur commun », celui qui devait être présent chez cet ancêtre, qui était probablement déjà assez complexe. Les estimations actuelles évoquent un génome comprenant peut-être entre 2 000 et 4 000 gènes.
Cela nous ramène à environ 4 milliards d’années. Vers 4,4 milliards d’années, on commence à voir apparaître des océans d’eau liquide et les tout premiers continents. C’est à partir de cette période que l’on peut vraiment imaginer le développement de la vie. On ne sait pas quand exactement, mais disons qu’autour de 4-4,2 milliards d’années, c’est plausible. Et on sait que, à 3,5 milliards d’années, on a déjà des fossiles divers de tapis microbiens primitifs (des stromatolites fossiles).
Et concernant notre groupe, les eucaryotes, comment sommes-nous apparus ?
P. L. G. : Nous avons proposé une hypothèse originale en 1998 : celle de la syntrophie. Pour bien la comprendre, il faut revenir un peu sur l’histoire des sciences, notamment dans les années 1960, quand Lynn Margulis, microbiologiste américaine, avance la théorie endosymbiotique. Elle propose alors que les chloroplastes des plantes et des algues – les organites qui permettent de réaliser la photosynthèse dans les cellules de plantes – dérivent d’anciennes bactéries, en particulier de cyanobactéries, qu’on appelait à l’époque « algues vert-bleu ». Et elle avance aussi que les mitochondries, l’organite eucaryote où se déroule la respiration et qui nous fournit notre énergie, proviennent elles aussi d’anciennes bactéries endosymbiotes – un endosymbiote étant un organisme qui vit à l’intérieur des cellules d’un autre.
Ces idées, qui avaient été déjà énoncées au début du vingtième siècle et que Margulis a fait revivre, ont été très débattues. Mais à la fin des années 1970, avec les premiers arbres phylogénétiques, on a pu démontrer que mitochondries et chloroplastes dérivent effectivement d’anciennes bactéries endosymbiotes : les cyanobactéries pour les chloroplastes, et un groupe que l’on appelait autrefois les « bactéries pourpres » pour les mitochondries.
L’hypothèse dominante, à cette époque, pour expliquer l’origine des eucaryotes, repose sur un scénario dans lequel un dernier ancêtre commun se diversifie en trois grands groupes ou domaines : les bactéries, les archées et les eucaryotes. Les archées sont alors vues comme le groupe-frère des eucaryotes, avec une biologie moléculaire et des protéines conservées qui se ressemblent beaucoup. Dans ce modèle, la lignée proto-eucaryote qui conduira aux eucaryotes et qui développe toutes les caractéristiques des eucaryotes, dont le noyau, acquiert assez tardivement la mitochondrie via l’endosymbiose d’une bactérie, ce qui lancerait la diversification des eucaryotes.
Sauf que, dans les années 1990, on commence à se rendre compte que tous les eucaryotes possèdent ou ont possédé des mitochondries. Certains groupes semblaient en être dépourvus, mais on découvre qu’ils les ont eues, que ces mitochondries ont parfois été extrêmement réduites ou ont transféré leurs gènes au noyau. Cela signifie que l’ancêtre de tous les eucaryotes avait déjà une mitochondrie. On n’a donc aucune preuve qu’une lignée « proto-eucaryote » sans mitochondrie ait jamais existé.
C’est dans ce contexte que de nouveaux modèles fondés sur la symbiose émergent. On savait déjà que les archées et les eucaryotes partageaient des similarités importantes en termes de protéines impliquées dans des processus informationnels (réplication de l’ADN, transcription, traduction de l’ARN aux protéines). Nous avons proposé un modèle impliquant trois partenaires : une bactérie hôte (appartenant aux deltaprotéobactéries), qui englobe une archée prise comme endosymbionte, cette archée devenant le futur noyau. Les gènes eucaryotes associés au noyau seraient ainsi d’origine archéenne.
Puis une seconde endosymbiose aurait eu lieu, avec l’acquisition d’une autre bactérie (une alphaprotéobactérie) : l’ancêtre de la mitochondrie, installée au sein de la bactérie hôte.
Toutefois, à l’époque, ces modèles fondés sur la symbiose n’étaient pas considérés très sérieusement. La donne a changé avec la découverte, il y a une dizaine d’années, d’un groupe particulier d’archées, appelées Asgard, qui partagent beaucoup de gènes avec les eucaryotes, qui sont en plus très similaires. Les arbres phylogénétiques faits avec des protéines très conservées placent les eucaryotes au sein de ces archées. Cela veut dire que les eucaryotes ont une origine symbiogénétique : ils dérivent d’une fusion symbiotique impliquant au minimum une archée (de type Asgard) et une alpha-protéobactérie, l’ancêtre de la mitochondrie. Mais la contribution d’autres bactéries, notamment des deltaprotéobactéries, des bactéries sulfato-réductrices avec lesquelles les archées Asgard établissent des symbioses syntrophiques dans l’environnement, n’est pas exclue.
Aujourd’hui, l’eucaryogénèse est un sujet étudié activement. La découverte des archées Asgard a renforcé la vraisemblance de ce type de modèle symbiogénétique. Des chercheurs qui considéraient ces idées comme trop spéculatives – parce qu’on ne pourra jamais avoir de preuve directe d’un événement datant d’il y a 2 milliards d’années – s’y intéressent désormais. Tous ceux qui travaillent sur la biologie cellulaire des eucaryotes se posent la question, parce qu’on peut aujourd’hui remplacer certaines protéines ou homologues eucaryotes par leurs variantes Asgard… et ça fonctionne.
Purificación López García ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
06.01.2026 à 16:56
Quelle est la différence entre matière noire et antimatière ?
Texte intégral (2180 mots)

« Qu’est-ce que la matière noire et qu’est-ce que l’antimatière ? Sont-elles la même chose ou différentes ? » Cet article est issu de notre série pour les plus jeunes lecteurs, Curious Kids, et répond à la question de Namrata, 13 ans, Ghaziabad, Inde.

Imaginez un jeu vidéo d’aventure avec votre héros préféré comme personnage principal. Un autre personnage, son jumeau miroir, apparaît de temps en temps et fait exploser tout ce qu’il touche. Pour corser encore le tout, le jeu inclut une ruche mystérieuse peuplée de minions cachés à chaque coin, qui changent les règles du jeu sans jamais se montrer.
Si l’on considère ces personnages comme des types de matière, ce jeu vidéo représente en gros le fonctionnement de notre Univers.
Le héros est la matière ordinaire, c’est-à-dire tout ce que nous pouvons voir autour de nous. L’antimatière est le jumeau miroir explosif que les scientifiques arrivent à comprendre, mais plus difficilement à trouver. Et la matière noire représente les minions invisibles : elle est partout, mais nous ne pouvons pas la voir, et les scientifiques ignorent de quoi elle est faite.
Antimatière : le jumeau miroir
Toute la matière ordinaire autour de vous est constituée de blocs de base appelés atomes. Les atomes possèdent des particules chargées positivement appelées protons entourées de minuscules électrons chargés négativement.
On peut considérer l’antimatière comme le jumeau de la matière ordinaire, mais avec des charges opposées.
Toutes les particules, comme les protons et les électrons, ont des « frères et sœurs » d’antimatière. Les électrons ont des positrons, qui sont des anti-électrons, tandis que les protons ont des antiprotons. Les antiprotons et les positrons forment des atomes d’antimatière, ou anti-atomes. Ils ressemblent à des images miroirs, mais avec leurs charges électriques inversées. Quand la matière et l’antimatière se rencontrent, elles se détruisent mutuellement dans un éclair de lumière et d’énergie avant de disparaître.
Heureusement, l’antimatière est très rare dans notre Univers. Mais certains atomes de matière ordinaire, comme le potassium, peuvent se désintégrer et produire de l’antimatière. Par exemple, lorsque vous mangez une banane ou tout aliment riche en potassium, vous consommez de très petites quantités de ces atomes producteurs d’antimatière. Mais la quantité est trop faible pour avoir un effet sur votre santé.
L’antimatière a été découverte il y a presque cent ans. Aujourd’hui, les scientifiques peuvent créer, stocker et étudier l’antimatière en laboratoire. Ils en comprennent très bien les propriétés. Les médecins l’utilisent même pour les PET-Scan. Ils injectent de toutes petites quantités d’atomes producteurs d’antimatière dans le corps et, au fur et à mesure que ces atomes circulent, le scanner prend des images des éclairs de lumière produits par l’annihilation de l’antimatière et de la matière dans le corps. Ce processus permet aux médecins de voir ce qui se passe à l’intérieur du corps.
Les scientifiques ont également découvert qu’à la naissance de l’Univers, il y avait des quantités presque égales de matière et d’antimatière. Elles se sont rencontrées et annihilées. Heureusement, une très petite quantité de matière ordinaire a survécu pour former les étoiles, les planètes et nous tous.
Matière noire : les minions invisibles
La matière noire est beaucoup plus mystérieuse. Avez-vous déjà tourné très vite sur un tourniquet ? Si oui, vous savez combien il est difficile de rester dessus sans tomber, surtout si vous êtes seul sur le tourniquet.
Maintenant, imaginez qu’il y ait plein de minions invisibles sur ce tourniquet avec vous. Vous ne pouvez ni les voir ni les toucher, mais ils vous retiennent et vous empêchent de vous envoler quand il tourne à toute vitesse. Vous savez qu’ils sont là parce que le tourniquet est plus lourd et difficile à faire tourner qu’il n’y paraît. Les minions ne jouent pas et ne parlent à personne ; ils restent simplement là, ajoutant leur poids à l’ensemble.
Il y a environ cinquante ans, l’astronome Vera Rubin a découvert un mystère similaire dans les galaxies spirales. Elle a observé des galaxies en rotation, qui sont comme des tourniquets cosmiques, et a remarqué quelque chose d’étrange : les étoiles situées à l’extérieur de ces galaxies tournaient beaucoup plus vite qu’elles ne devraient. Elles auraient dû être projetées dans l’espace comme des étincelles d’un feu d’artifice. Mais ce n’était pas le cas.
C’était comme regarder des enfants tourner à une vitesse incroyable sur un tourniquet mais rester parfaitement en place.

La seule explication ? Il doit exister un océan de « choses » invisibles qui maintiennent tout en place grâce à leur gravité supplémentaire. Les scientifiques ont appelé cette matière mystérieuse « matière noire ».
Depuis, les astronomes ont observé des comportements étranges similaires dans tout l’Univers. Les galaxies au sein de grands amas se déplacent de manière inattendue. La lumière est plus courbée autour des galaxies qu’elle ne devrait l’être. Les galaxies restent bien plus solidaires que ce que la matière visible seule pourrait expliquer.
C’est comme si notre terrain de jeu cosmique avait des balançoires qui bougent toutes seules et des tape-culs qui basculent alors que personne n’est assis dessus.
La matière noire n’est pour l’instant qu’un nom provisoire, en attendant que les scientifiques découvrent ce que c’est réellement. Depuis cinquante ans, de nombreux chercheurs mènent des expériences pour détecter la matière noire ou la produire en laboratoire. Mais jusqu’à présent, ils sont restés bredouilles.
Nous ne savons pas ce qu’est la matière noire, mais elle est partout. Il pourrait s’agir de particules que les scientifiques n’ont pas encore découvertes ou de quelque chose de complètement inattendu. Mais les astronomes peuvent constater, en observant la vitesse de rotation des galaxies, qu’il y a environ cinq fois plus de matière noire que toute la matière ordinaire de l’Univers.
Dipangkar Dutta bénéficie d'un financement du ministère américain de l'Énergie et de la National Science Foundation.
05.01.2026 à 15:44
Une nouvelle étude met en lumière le rôle du climat dans la disparition de l’homme de Florès
Texte intégral (1982 mots)

L’analyse de stalagmites et de fossiles d’éléphants pygmées révèle comment le climat et la présence d’eau douce ont façonné la vie et la survie de l’homme de Florès.
Il y a environ 50 000 ans, l’humanité a perdu l’un de ses derniers cousins hominines survivants, Homo floresiensis (ou homme de Florès, également connu sous le nom de « Hobbit » en raison de sa petite taille). La cause de sa disparition, après plus d’un million d’années passées sur l’île volcanique isolée de Florès, en Indonésie, demeure une énigme de longue date.
De nouvelles preuves suggèrent toutefois qu’une période de sécheresse extrême, commencée il y a environ 61 000 ans, pourrait avoir contribué à la disparition des hommes de Florès. Notre nouvelle étude, publiée le 8 décembre dans Communications Earth & Environment, révèle une histoire d’essor et d’effondrement écologique. Nous avons établi le relevé climatique le plus détaillé à ce jour du site où vivaient autrefois ces anciens hominines.
Une île aux grottes profondes
La découverte d’Homo floresiensis en 2003 a bouleversé notre conception de ce qui fait de nous des êtres humains. Ces hominines de petite taille et au cerveau réduit, qui ne mesuraient que 1,1 m, fabriquaient des outils en pierre. Contre toute attente, ils ont atteint l’île de Florès, apparemment sans disposer de technologie maritime.
Les ossements et outils en pierre d’H. floresiensis ont été retrouvés dans la grotte de Liang Bua, dissimulée dans une petite vallée des hauteurs de l’île. Ces vestiges datent d’une période comprise entre 190 000 et 50 000 ans.
Aujourd’hui, Florès connaît un climat de mousson, avec de fortes pluies pendant les étés humides (principalement de novembre à mars) et des précipitations plus légères durant les hivers plus secs (de mai à septembre). Cependant, durant la dernière période glaciaire, la quantité de pluie et le moment où elle tombait variaient considérablement.
Pour comprendre à quoi ressemblaient ces pluies, notre équipe s’est tournée vers une grotte située à 700 mètres en amont de Liang Bua, appelée Liang Luar. Par pur hasard, au fond de cette grotte se trouvait une stalagmite qui s’est formée précisément pendant la période correspondant à la disparition d’H. floresiensis. En grandissant couche après couche grâce à l’eau qui goutte du plafond, sa composition chimique variable enregistre l’histoire d’un climat en mutation.
Les paléoclimatologues disposent de deux principaux outils géochimiques pour reconstituer à partir des stalagmites les précipitations passées. En observant une mesure spécifique de l’oxygène, appelée δ18O, ils peuvent identifier les variations d’intensité de la mousson. Parallèlement, le rapport entre le magnésium et le calcium permet d’estimer la quantité totale de précipitations.
Nous avons combiné ces deux types de mesures sur les mêmes échantillons, les avons précisément datés, puis avons reconstitué les niveaux de précipitations estivales, hivernales et annuelles. L’ensemble offre un aperçu inédit de la variabilité saisonnière du climat.
Nous avons identifié trois grandes phases climatiques. Entre 91 000 et 76 000 ans, le climat était plus humide qu’aujourd’hui tout au long de l’année. De 76 000 à 61 000 ans, la mousson est devenue très nettement saisonnière, avec des étés plus pluvieux et des hivers plus secs. Enfin, entre 61 000 et 47 000 ans, le climat s’est considérablement asséché durant l’été, à l’image de celui que connaît aujourd’hui le sud du Queensland en Australie.
Les « Hobbits » suivaient leurs proies
Nous disposions donc d’un relevé précis des grands changements climatiques, mais restait à savoir quelle en avait été la réponse écologique, s’il y en avait eu une. Il nous fallait établir une chronologie précise des fossiles d’H. floresiensis retrouvés à Liang Bua.
La solution est venue de manière inattendue grâce à notre analyse du δ18O contenu dans l’émail des dents fossilisées de Stegodon florensis insularis, un lointain parent pygmée disparu des éléphants modernes. Ces jeunes éléphants pygmées figuraient parmi les proies préférées des « Hobbits », comme le montrent les traces de découpe sur les os retrouvés à Liang Bua.
Fait remarquable, les variations du δ18O observées dans la stalagmite de Liang Luar correspondaient parfaitement à celles relevées dans les dents provenant de couches sédimentaires de plus en plus profondes à Liang Bua. Cette concordance nous a permis de dater avec précision les fossiles de Stegodon ainsi que les restes associés d’Homo floresiensis.
La chronologie ainsi affinée montre qu’environ 90 % des restes d’éléphants pygmées datent de la période comprise entre 76 000 et 61 000 ans, soit une période au climat fortement saisonnier, ni trop humide ni trop sec – une sorte de climat idéal. Ce contexte semble avoir offert des conditions favorables au pâturage des éléphants pygmées et à leur chasse par Homo floresiensis. Mais les deux espèces ont presque disparu lorsque le climat est devenu plus sec.
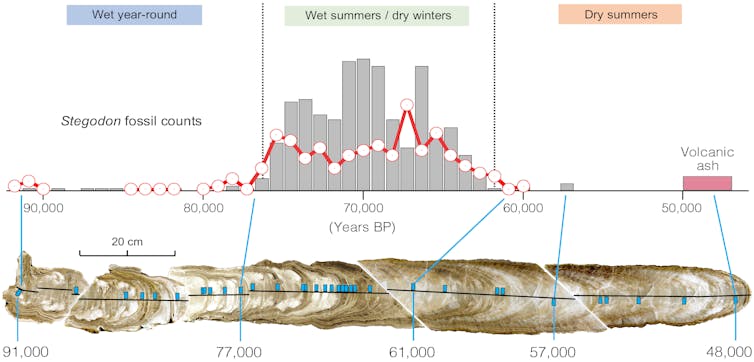
Le recul des précipitations, des éléphants pygmées et des « Hobbits » au même moment indique que la raréfaction des ressources a joué un rôle crucial dans ce qui ressemble à un abandon progressif de Liang Bua.
Avec l’assèchement du climat, la principale source d’eau en saison sèche, le petit fleuve Wae Racang, a peut-être diminué au point de ne plus suffire, privant les Stegodon d’eau douce. Les animaux ont alors pu migrer hors de la région, Homo floresiensis les suivant.
Un volcan impliqué ?
Les derniers restes fossiles de Stegodon et les outils en pierre de Liang Bua sont recouverts d’une épaisse couche de cendres volcaniques, datée d’environ 50 000 ans. On ne sait pas encore si une éruption volcanique à proximité a constitué « la goutte d’eau » dans le déclin des hommes de Florès de Liang Bua.
Les premières traces archéologiques attribuées à Homo sapiens se trouvent au-dessus de cette couche de cendres. Même s’il est impossible de savoir si Homo sapiens et Homo floresiensis se sont croisés, de nouvelles preuves archéologiques et génétiques indiquent que les Homo sapiens parcouraient déjà l’Indonésie, sautant d’île en île jusqu’au supercontinent de Sahul, il y a au moins 60 000 ans.
Si Homo floresiensis a été contraint par des pressions écologiques de quitter leur refuge pour se rapprocher de la côte, il est possible qu’ils aient croisé la route des humains modernes. Et si tel était le cas, la concurrence, les maladies, voire la prédation, auraient pu devenir des facteurs déterminants.
Quelle que soit la cause ultime, notre étude fournit un cadre pour de futures recherches sur l’extinction de l’emblématique Homo floresiensis dans le contexte de grands changements climatiques. Le rôle fondamental de la disponibilité en eau douce dans le déclin de l’un de nos cousins humains rappelle que l’histoire de l’humanité est une expérience fragile de survie, et que les variations des précipitations peuvent avoir des conséquences profondes.
Nick Scroxton a reçu des financements de de la Sustainable Energy Authority of Ireland et a réalisé ce travail tout en bénéficiant d’un financement de l’Australian Research Council.
Gerrit van den Bergh a reçu des financements de l’Australian Research Council.
Michael Gagan a reçu des financements de l’Australian Research Council.
Mika Rizki Puspaningrum ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
04.01.2026 à 14:03
Ce que révèle une vaste enquête citoyenne sur la qualité de l’eau en France
Texte intégral (2455 mots)

En 2023, des milliers de citoyens ont pris part à un projet de recherche participative visant à cartographier la qualité de l’eau sur le territoire français. Une démarche qui en apprend beaucoup aux chercheurs et qui sensibilise les bénévoles.
Le 29 septembre 2023, partout en France, des milliers de personnes ont endossé, le temps d’un week-end, la casquette du chercheur. Armés de leur smartphone, d’une bandelette colorée et d’une fiche d’instructions, ils se sont lancés dans une expérience collective inédite : mesurer la qualité des eaux de France dans les rivières, les fontaines, les lacs, les puits et les flaques. En quelques jours, près de 800 échantillons ont été collectés et plus de 20 000 données ont été mesurées.

Derrière ces chiffres impressionnants se cache une aventure humaine et scientifique : la Grande Synchr’Eau, une initiative massive de science participative récompensée par l’une des médailles de la médiation du CNRS en 2025 pour son originalité et son impact sur la société. Cette expérience participative inédite a permis de révéler la diversité chimique des eaux françaises.
Le principe est simple : tremper une bandelette dans l’eau, observer les pastilles se colorer, puis les comparer à une échelle. Ce geste, à la fois simple et ludique, cache en réalité des mesures précieuses : le pH (ou l’acidité), la concentration en nitrates issus des engrais, en chlore, ainsi qu’en métaux lourds tels que le cuivre ou le plomb. Pour beaucoup, l’expérience provoque un effet « waouh » : « On avait l’impression de jouer, mais en fait, on faisait de la vraie science », racontait une mère venue vivre l’expérience avec sa fille. C’est là toute la force de la science citoyenne : permettre à chacun de participer à la recherche, tout en produisant des données utiles aux scientifiques.

Une mosaïque de réalités locales
Les résultats, compilés par les équipes de l’INSA Toulouse et du Toulouse Biotechnology Institute, révèlent une France de l’eau pleine de contrastes. En Bretagne et dans le Massif central, l’eau est plus acide, en raison des sols granitiques et volcaniques, car ces roches contiennent peu de minéraux capables de « tamponner » l’acidité. L’eau de pluie, naturellement légèrement acide, n’est donc pas neutralisée en traversant ces terrains, contrairement aux régions calcaires où les roches relarguent du carbonate qui remonte le pH. Dans les plaines agricoles de la Beauce et de la Champagne, les nitrates dépassent parfois 100 mg/L, témoins directs de l’usage intensif des engrais.
En ville, d’autres signaux apparaissent : à Lyon, Toulouse ou Marseille, les citoyens ont détecté du cuivre jusqu’à 6 mg/L, un niveau trois fois supérieur à la limite de qualité de l’eau potable (2 mg/L), généralement lié à la corrosion des vieilles canalisations en cuivre. Dans certaines zones rurales, le chlore est quasi absent, alors qu’en Île-de-France ou dans le Rhône, la concentration atteint des niveaux dix fois supérieurs à ceux observés dans les campagnes du Massif central. Cela reste compatible avec les normes, mais reflète une désinfection beaucoup plus marquée des grands réseaux urbains, expliquant parfois les goûts d’eau chlorée rapportés par certains usagers.
Autrement dit, il n’existe pas une eau française, mais une mosaïque d’eaux locales, chacune portant la marque de son sol, de ses usages et de ses infrastructures.
Des flaques chlorées et des puits ferrugineux
Parmi les échantillons, certaines eaux sortent franchement du lot. Si, globalement, le pH reste dans des valeurs normales (entre 6 et 7,6), la diversité chimique surprend. Le chlore total, c’est-à-dire à la fois le chlore libre (désinfectant actif) et le chlore combiné (qui a déjà réagi avec d’autres substances), atteint parfois 10 mg/L, soit cinq fois la concentration d’une piscine publique.
Certaines flaques urbaines semblent avoir reçu un traitement sanitaire involontaire : ruissellement des trottoirs, résidus de produits ménagers, lessivage des surfaces. Bref, si l’eau des flaques n’est pas potable, certaines sont surprenamment bien désinfectées !
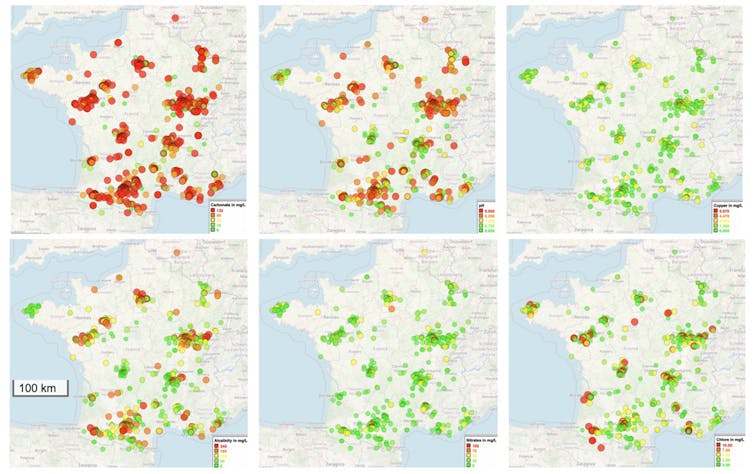
Certains puits battent tous les records de fer, avec des concentrations pouvant atteindre 25 mg/L, soit 500 fois la limite de potabilité. À ce stade, l’eau prend une teinte orangée et un goût métallique prononcé. Sur le millier de prélèvements effectués, 8,4 % des eaux ont été jugées brunes par les citoyens, un signe d’oxydation intense du fer dans les captages locaux. Ce phénomène, fréquent dans certaines zones rurales, n’est pas dangereux en soi, mais rend l’eau impropre à la consommation et peut entraîner des dépôts, des taches et un encrassement des installations domestiques. Il illustre la forte variabilité chimique des eaux locales et les enjeux propres aux puits non traités.
Autre découverte : l’ammonium, présent jusqu’à 40 mg/L dans certains échantillons. Ce composé, issu de la décomposition de la matière organique ou du ruissellement agricole, témoigne d’une activité biologique intense : en clair, une eau très vivante, mais pas forcément celle qu’on a envie de boire.
L’eau, miroir de nos modes de vie
Derrière les anecdotes et les chiffres, ces mesures citoyennes racontent une vérité simple : l’eau enregistre nos modes de vie. Elle circule, transporte et mémorise nos activités. Dans les villes, elle se charge de chlore, de cuivre et de résidus ménagers. Dans les campagnes, elle emporte du nitrate, de l’ammonium ou du fer. Et dans les zones naturelles, elle reste souvent plus équilibrée, mais jamais totalement vierge de l’empreinte humaine.
En plus des cartes, la Grande Synchr’Eau dessine une France curieuse et engagée. L’enquête menée auprès de 120 participants révèle une mobilisation intergénérationnelle : 22 % ont moins de 18 ans, 21 % sont entre 46 et 55 ans, et 45 classes de primaire et de collège ont participé à l’expérience. Les motivations sont variées : 54 % y voient une façon de protéger l’environnement, 43 % de contribuer à la recherche, 28 % pour apprendre et 25 % par curiosité. Autrement dit, mesurer devient un moyen de comprendre et d’agir.
Nourrir la recherche tout en sensibilisant les citoyens
Les effets de la démarche sur les volontaires sont marquants : 81 % des participants estiment que l’expérience a changé leur regard ou leurs comportements, et 82 % ont eu le sentiment de participer à la protection de l’environnement. Lorsqu’on leur demande les mots auxquels ils pensent pour qualifier l’eau, ceux qui reviennent le plus sont vie, vitale et précieuse, ce qui traduit un rapport sensible, presque affectif, à cette ressource commune.
Enfin, à la question « Qui doit agir pour préserver l’eau ? », 83 % citent l’État, 79 % les scientifiques, 71 % les associations et 54 %… eux-mêmes. La science n’est plus perçue comme un domaine réservé : elle devient un espace partagé, où la connaissance se construit à plusieurs et où chacun assume sa responsabilité sociétale.
Au final, peut-on boire l’eau des flaques d’eau ? Non, car elles contiennent parfois plus de chlore qu’une piscine. Mais on peut toujours les observer, les mesurer et les comparer. Ces expériences rappellent qu’il n’y a pas besoin d’un laboratoire pour faire de la science : un peu de curiosité, une bandelette colorée et l’envie de comprendre suffisent à faire émerger une connaissance collective. La Grande Synchr’Eau en est la preuve : la science peut jaillir de partout, même d’une simple flaque.
Nicolas Dietrich a reçu des financements dans le cadre du projet Grande Expérience Participative (2023), financé par l’initiative Nuit Européenne des Chercheur·e·s dans le cadre des Actions Marie Sklodowska-Curie. Un financement complémentaire a été obtenu dans le cadre du projet SMARTER, soutenu par le programme Horizon 2020 de l’Union européenne (Grant Agreement No. 772787)
Johanne Teychené et Nathalie Clergerie ne travaillent pas, ne conseillent pas, ne possèdent pas de parts, ne reçoivent pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'ont déclaré aucune autre affiliation que leur poste universitaire.
18.12.2025 à 14:54
Des Néandertaliennes et des enfants victimes de cannibalisme il y a 45 000 ans
Texte intégral (2351 mots)
Des ossements retrouvés dans la grotte de Goyet en Belgique prouvent que les Néandertaliens pratiquaient le cannibalisme. S’agit-il d’un épisode unique ou d’une pratique répétée dans le temps ? Ce comportement est-il propre à ce site ou pourrait-il être reconnu sur d’autres ?
La pratique du cannibalisme chez les Néandertaliens est bien documentée. À ce jour, et d’après nos calculs, le nombre d’individus néandertaliens montrant des traces de cannibalisme dépasserait même celui des individus inhumés pour cette espèce humaine disparue, ce qui en ferait une pratique mortuaire récurrente.
Une nouvelle étude menée par notre équipe et publiée dans la revue Scientific Reports apporte de nouveaux éclairages sur cette pratique, à la toute fin de l’histoire des Néandertaliens en Europe.
À Goyet, en Belgique, il y a environ 41 000 à 45 000 ans, des femmes et des enfants néandertaliens ont été les victimes d’un cannibalisme hautement sélectif. Cette sélection témoigne d’abord de pratiques exocannibales, c’est-à-dire qu’elle a été exercée sur des individus non locaux, considérés comme externes au groupe qui les a consommés.
L’étude révèle ensuite que la composition de l’assemblage (quatre femmes, un enfant et un nouveau-né) ne peut s’expliquer par le hasard : elle résulte d’un choix délibéré qui a spécifiquement ciblé des individus jeunes et des femmes parmi les plus petites et les moins robustes jamais documentées chez Néandertal. Ce comportement pourrait représenter l’un des premiers indices tangibles de tensions ou de conflits entre groupes humains au Paléolithique moyen (de - 300 000 à - 40 000 ans).
Un assemblage exceptionnel
Les restes osseux néandertaliens de la troisième caverne de Goyet (Belgique) représentent l’une des plus grandes collections de restes néandertaliens au monde. Les individus ont pu être identifiés grâce à un long travail de réexamen des collections anciennes, amorcé en 2008 par Hélène Rougier (qui cosigne cet article).
Conservée à l’Institut royal des sciences naturelles de Belgique (IRSNB), à Bruxelles, depuis les premières fouilles menées sur le site de Goyet à la fin du XIXe siècle, cette collection anthropologique était encore largement inédite au début du XXIe siècle, car mélangée aux restes animaux du site. Un effort de plus de dix ansn mêlant tri de la faune, remontage de pièces osseuses et analyses biochimiques, a permis de reconstituer et de réanalyser cet assemblage exceptionnel fragment par fragment, malgré la perte du contexte archéologique originel.
Une précédente étude de notre équipe a montré qu’environ un tiers de ces ossements présentent des traces de cannibalisme. Visibles sur la surface des os, des traces de découpe laissées par des outils en pierre (liées à la désarticulation et au décharnement des corps) ainsi que des impacts de percussion et des fractures réalisées sur os frais (pour en extraire la moelle osseuse) attestent d’une consommation de ces restes humains, avec un traitement identique à celui de la faune chassée et consommée dans ce site. Certains de ces ossements ont même été utilisés comme outils pour affûter les silex taillés.
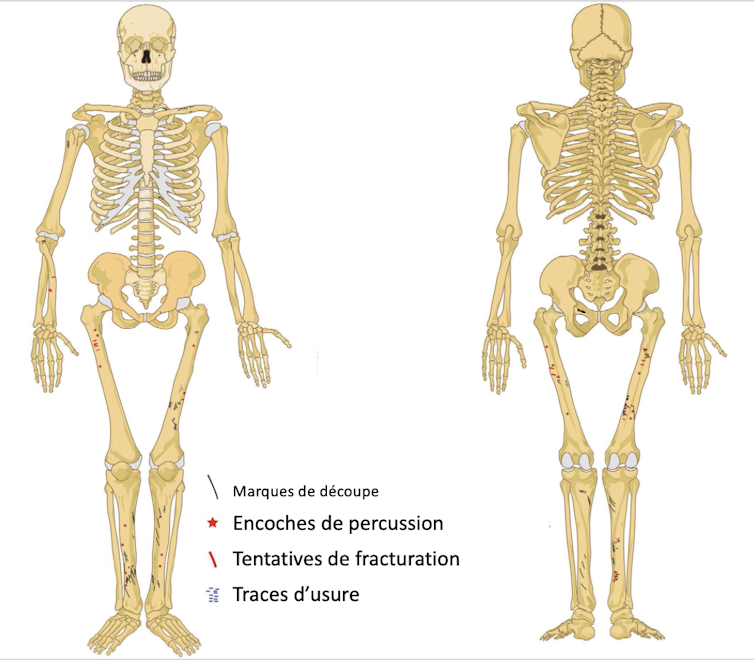
Dans cette nouvelle étude, notre équipe interdisciplinaire et internationale menée par des chercheuses et chercheurs du laboratoire PACEA (Université de Bordeaux-CNRS-Ministère de la culture) et de l’Université d’État de Californie à Northridge, a poussé les analyses encore plus loin afin d’identifier le profil biologique des individus cannibalisés, malgré l’état fragmentaire des restes.
Une combinaison de données paléogénétiques (analyse de l’ADN ancien) et isotopiques (donnant des informations sur la provenance géographique ou l’alimentation), associées à une analyse fine de la morphologie des ossements (principalement des os des membres inférieurs, les fémurs et les tibias) indique un assemblage tout à fait singulier : sur un minimum de six individus identifiés, quatre sont des femmes adultes ou adolescentes et deux sont des individus immatures de sexe masculin.
La comparaison avec un profil de mortalité attendu à cette époque ou avec d’autres sites attestant d’un cannibalisme entre Néandertaliens montre que la probabilité d’obtenir la composition retrouvée à Goyet est proche de zéro. En somme, l’association de ces individus ne peut résulter du hasard, elle est le résultat d’une sélection délibérée de certains individus.
Une approche interdisciplinaire pour faire parler les ossements
Nous avons pu dresser le profil de ces individus cannibalisés, parmi les derniers représentants néandertaliens au monde.
Les données de l’ADN ancien montrent que les individus adultes/adolescents sont tous de sexe féminin, mais n’ont pas de liens de parenté proche. Cette caractéristique pourrait suggérer l’appartenance des individus à différents groupes, et donc renvoyer à plusieurs évènements de cannibalisme, mais pourrait aussi s’expliquer par une origine exogame des individus féminins d’un même groupe, c’est-à-dire avec des femmes venant d’autres groupes avant d’intégrer celui où elles vivaient, une pratique déjà documentée chez les Néandertaliens.
Pour aller dans ce sens, nos analyses montrent que les individus consommés n’étaient pas originaires de la région. Ce sont les isotopes du soufre présents dans leurs os qui montrent une signature distincte de celle de la faune locale et des Néandertaliens voisins du site de Spy – une indication forte que les victimes ne faisaient pas partie du groupe local, confirmant ainsi la dimension exocannibale de cette pratique sur le site de Goyet.
Enfin, l’étude de la morphologie des ossements eux-mêmes apporte des précisions essentielles sur l’identité des individus, en particulier des quatre femmes adultes/adolescentes. Cependant, cette analyse a représenté un véritable défi : les ossements sont extrêmement fragmentés, conséquence directe des multiples fracturations survenues lors de leur consommation. Ce travail, mené à l’Université de Bordeaux, s’est appuyé sur une analyse virtuelle des restes à partir de scanners par rayons X réalisés à l’IRSNB.
Les résultats montrent que les indices de robustesse des fémurs et des tibias sont très faibles en comparaison de ceux d’autres spécimens de la même période : ces Néandertaliennes étaient remarquablement graciles (minces). Plus encore, les estimations de stature obtenues indiquent une petite taille : 1,51 mètre en moyenne pour l’ensemble des individus et autour de 1,43 mètre pour la plus petite d’entre elles, baptisée GN3. Bien qu’il s’agisse d’estimations, ces valeurs placent les Néandertaliennes de Goyet parmi les plus petites représentantes de cette humanité disparue.
Des indices de conflits préhistoriques ?
Qu’il s’agisse d’un ou de plusieurs évènements, la pratique d’un cannibalisme ciblé sur les femmes et sur les enfants d’un autre groupe social suggère la présence de tensions ou de conflits entre groupes. À cette époque (la fin du Paléolithique moyen), les données archéologiques témoignent de la coexistence de plusieurs traditions culturelles associées à Néandertal dans le nord de l’Europe et touchant à la façon de tailler les outils en pierre.

Dans ce contexte, l’arrivée des premiers groupes d’Homo sapiens, déjà présents à quelques centaines de kilomètres à l’est de Goyet, a pu engendrer une pression sur les groupes néandertaliens de la région et notamment dans l’accès aux ressources, les deux groupes humains chassant les mêmes animaux. Si l’on ne peut pas exclure qu’Homo sapiens ait été à l’origine de l’assemblage de Goyet, les données archéologiques, et notamment l’utilisation de certains ossements comme outils (pratique documentée dans d’autres sites avec traces de cannibalisme où seul Néandertal pouvait en être l’auteur), vont plutôt dans le sens d’une pratique intra-spécifique.
Des perspectives pour le futur
Malgré ces avancées, plusieurs questions demeurent ouvertes : s’agit-il d’un épisode unique ou d’une pratique répétée dans le temps ? Ce comportement est-il propre à Goyet ou pourrait-il être reconnu sur d’autres sites si l’on disposait des mêmes outils d’analyse ? Travailler sur des restes issus de cannibalisme reste particulièrement complexe : il faut d’abord identifier des fragments, puis tenter d’en extraire un maximum d’informations.
Dans le cas présent, c’est précisément la combinaison de plusieurs approches réunissant des spécialistes internationaux de disciplines différentes qui a permis d’éclairer la spécificité de ces vestiges longtemps restés muets.
Désormais, l’existence de méthodes fiables pour analyser des fragments très réduits ouvre des perspectives considérables : la reprise d’anciennes collections non étudiées, la réévaluation de sites connus pour leur cannibalisme ou l’identification de nouveaux assemblages pourraient, dans les années à venir, profondément renouveler notre compréhension des interactions sociales, des dynamiques territoriales et de la diversité biologique des derniers Néandertaliens.
Quentin Cosnefroy a reçu des financements du Projet-ANR-22-CE27-0016 NeHos : De l'Homme de Néandertal à l'Homo sapiens - Comprendre une (r)évolution culturelle en Europe au Paléolithique.
Hélène Rougier et Isabelle Crevecoeur ne travaillent pas, ne conseillent pas, ne possèdent pas de parts, ne reçoivent pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'ont déclaré aucune autre affiliation que leur poste universitaire.
