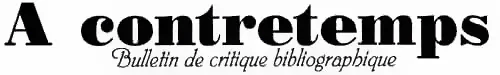
19.05.2025 à 07:50
1895, Carmaux : les Verreries en grève
F.G.
Le 1er août 1895 à Carmaux – la « ville sainte », selon les journaux hostiles au socialisme – éclate un nouveau conflit. Après la grève des mineurs, trois ans plus tôt, ce sont les 1 200 ouvriers qui, à l'appel de la chambre syndicale, se mettent en grève, suivis d'ailleurs par leurs collègues des verreries du Bousquet d'Orb. La veille, deux délégués syndicaux, Baudot et Pelletier, ont reçu la notification de leur renvoi pour « absence de dix jours afin de se rendre au congrès de la (…)
- Sous les pavés la grèveTexte intégral (3078 mots)

Le 1er août 1895 à Carmaux – la « ville sainte », selon les journaux hostiles au socialisme – éclate un nouveau conflit. Après la grève des mineurs, trois ans plus tôt, ce sont les 1 200 ouvriers qui, à l'appel de la chambre syndicale, se mettent en grève, suivis d'ailleurs par leurs collègues des verreries du Bousquet d'Orb.
La veille, deux délégués syndicaux, Baudot et Pelletier, ont reçu la notification de leur renvoi pour « absence de dix jours afin de se rendre au congrès de la verrerie sans avoir sollicité I'autorisation ». Quelques jours plus tôt, le maire de Carmaux, Mazens, agent de la compagnie, a refusé la proclamation de leur élection au conseil d'arrondissement au prétexte qu'ayant été condamnés à quatre mois de prison pour injure, ils seraient devenus inéligibles. À la lettre syndicale de suspension du travail, le directeur Maffre répond : « La décision prise à l'égard de Baudot est irrévocable, l'usine reste ouverte pour ceux qui voudront venir travailler. »
La verrerie Sainte-Clotilde
En 1895 la verrerie de Carmaux jouit d'une situation économique exceptionnelle. Elle fabrique des bouteilles de toutes sortes – du 1/8e de litre à la bonbonne de 80 litres – en verre extra-clair, clair, jaune, noir, rouge... sauf lilas et blanc. Les matières premières (sable et chaux) se trouvent sur place, ainsi que l'énergie (charbon de la Société des mines de Carmaux). L'usine a bénéficié des difficultés des concurrents : en 1894, elle a étendu ses activités au moment de la grève des verriers de Rive-de-Gier.
La verrerie emploie 1 200 ouvriers répartis en trois catégories : verriers, ouvriers similaires (gaziers, fondeurs, ajusteurs) et manœuvres (surtout des femmes employées à la vannerie, au mesurage, au gravage des bouteilles). Il existe des syndicats différents. L'organisation des verriers compte 490 membres, parmi lesquels une cinquantaine d'enfants de moins de seize ans qui ne peuvent voter. La première tentative d'implantation syndicale remonte à 1888 ; la seconde à 1890. Ce n'est qu'en 1891 que Rességuier, ancien verrier devenu dirigeant de l'entreprise, a accepté la formation de l'organisation, espérant se concilier les ouvriers. Il accorde même une subvention. Dans sa polémique avec les verriers, Rességuier mettra en avant les salaires plus élevés à Carmaux qu'ailleurs et les « sacrifices » faits par la direction : création, aux frais de l'usine, d'une école pour les enfants, organisation d'un économat aux mains des ouvriers. Les intéressés répliqueront sur les conditions très éprouvantes du travail (la chaleur) ainsi que la variété de la production qui explique, diront-ils, « l'élévation » des salaires.
La grève ouvrière…
Bien que le calme règne dans la ville, le préfet du Tarn, Doux, dépêche des unités de gendarmerie sur Carmaux. Le 2 août, Jean Jaurès, député de la circonscription depuis 1893, arrive sur les lieux, pour se rendre compte de la situation et se mettre à la disposition du comité de grève. L'arrêt de travail est alors complet à la verrerie Saint-Clotilde. Jaurès, conciliateur, conseille des démarches auprès du directeur et prêche le calme. Se référant à la loi du 27 décembre 1892, il propose l'organisation d'une commission d'arbitrage devant le juge de paix. Celui-ci, réfugié auprès de la troupe, accepte de prendre des mesures pour arriver à une solution. C'est peine perdue : la direction de la verrerie refuse ses bons offices. Le 5 août, après un discours de Jaurès, les grévistes votent à l'unanimité la reprise du travail : « Les ouvriers ont décidé d'assurer l'existence de Baudot et Pelletier et de reprendre le travail ensemble. » La grève est donc terminée...
Le lock-out patronal
Le 7 août, Rességuier fait placarder un avis : « Les ouvriers des verreries de Carmaux ayant quitté te travail sans motif, l'usine est fermée par ce fait. La société, dans leur intérêt, croit devoir les avertir qu'elle ne peut prévoir quand et dans quelles conditions la réouverture aura lieu. À chacun par conséquent de prendre tel parti qui lui convient. »
L'affiche enlève toutes illusions à ceux qui doutaient de « la bonne volonté » du patronat. La presse de toute opinion s'interroge et la réprobation à l'égard des administrateurs est quasi unanime, à l'exception des feuilles gouvernementales. Dans Le Journal, Jaurès écrit : « Rességuier ne veut pas tuer une verrerie en pleine activité et prospérité. Il veut faire durer la grève pour affamer les ouvriers, les réduire à sa merci, leur faire accepter les conditions les plus dures, éliminer ceux qui le gênent, disloquer le syndicat, et peut-être diminuer les salaires. »
Une semaine passe. Le 14, Rességuier fait connaître ses volontés : les verriers seront payés le 17 août et leur livret de travail leur sera rendu. C'est donc le renvoi. Immédiatement après, le réembauchage aura lieu, mais les salaires seront diminués et les « meneurs » ne seront pas repris. Vive approbation du Figaro : « Les verriers de Carmaux ne pourront rien objecter aux conditions de rentrée qui leur sont ainsi posées. Ils jouissaient de salaires plus élevés que partout ailleurs. Ils ont voulu faire grève, c'est leur droit. Mais c'est aussi le droit du patron maintenant que la place est nette de n'embaucher que les ouvriers qui lui conviennent. Les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Si les ouvriers souffrent de cette situation, qu'ils s'en prennent à M. Jaurès et à ses amis. » Bonne occasion pour régler les comptes politiques : battu à Castres en 1889, Jaurès avait été élu et réélu en 1893 face au marquis de Solages, propriétaire des Mines de Carmaux, grâce aux voix des ouvriers de la ville.
Le 18 août les verriers repoussent ces conditions inacceptables : « Vous nous demandez de sacrifier, outre Baudot et Pelletier, ceux que vous appelez les “meneurs de la grève”. Nous n'avons pas besoin de savoir ni leur nom, ni leur nombre pour vous dire non ; en les frappant, c'est nous que vous frappez. Même si nous étions abandonnés, même si nous devions souffrir de la faim avec nos enfants et nos femmes, nous ne consentirions pas à une trahison. »
La solidarité
Abandonnés ? Non ! Les verriers ne le sont pas. Une formidable chaîne de solidarité se constitue, un immense courant de sympathie parcourt la France. Les réunions publiques et les meetings se multiplient, organisés par les élus socialistes : on y retrace l'historique de la grève et, à leur issue, des collectes permettent de réunir des fonds. Le 25, un meeting a lieu à la Maison du Peuple à Paris ; un autre, au Tivoli-Vauxhall, réunit 6 000 personnes. Roubaix, Reims, Narbonne, Lille, Dijon organisent des rassemblements identiques. Les souscriptions ouvertes dans la presse socialiste ou indépendante (La Dépêche, de Toulouse, La Petite République, L'Intransigeant, Le Peuple, de Lyon) affluent. On donne de tous les coins de France. Lorsque les préfets ne s'y opposent pas, on organise des loteries dont le bénéfice va aux grévistes. À Paris les chanteurs ambulants font quotidiennement de substantielles recettes en chantant la chanson de la grève composée par Lencou.
À Toulouse, un grand meeting a lieu au grand théâtre du Capitole et, le 22 septembre, jour anniversaire de la proclamation de la République, un festival populaire se déroule dans la ville. À Carmaux même, la solidarité s'organise : les propriétaires décident de réduire de moitié les loyers des grévistes, et ce, pendant la durée de la grève. Les mineurs abandonnent une journée de salaire par mois au profit des verriers (les patrons d'ailleurs déclareront en chômage forcé plusieurs journées pour éviter le versement). On se préoccupe aussi de l'avenir et déjà une idée germe : la verrerie aux verriers. C'est Rochefort, pamphlétaire du Second Empire, ancien communard déporté, désormais propriétaire de L'Intransigeant qui, le 22 août lance l'idée, reprise par Le Radical du 2 septembre. Ce dernier signale que les menuisiers de Toulon ont créé une menuiserie ouvrière, qu'à Rive-de-Gier les grévistes ont constitué une « verrerie aux verriers » qui prospère. Après un mois de grève, ces marques de solidarité soutiennent le moral des verriers. Les collectes permettent au syndicat de distribuer des secours proportionnellement aux besoins de chacun. Une distribution exceptionnelle sera même effectuée pour la rentrée des classes et l'approche de l'hiver. La presse hostile fulmine. Dans Le Siècle, l'ex-ministre Yves Guyot n'admet pas que les conseils municipaux votent des subsides en faveur des familles de grévistes. Les verriers font appel à Dupuy-Dutemps, ministre des Travaux publics, député de Gaillac. Celui-ci leur répondra dans un discours à Albi : « Il n'y a en France que deux partis : le Parti républicain, parti de l'ordre, et le Parti socialiste, parti du désordre. »
Provocations patronales
La grève continue, en se durcissant ; les provocations patronales vont se faire très précises. On joue d'abord sur la division. Des agents du patronat passent dans les foyers et répandent le bruit d'un embauchage proche : les premiers inscrits seraient les premiers appelés... On offre des permissions spéciales aux soldats fils de verriers. Enfin, on essaie de démontrer que le vote de la prolongation de la grève a été truqué : on aurait trouvé, dans le trou du souffleur du théâtre où avait eu lieu le vote, des bulletins hostiles à la grève. Rien n'y fait.
Les assemblées générales quotidiennes étant toujours aussi fréquentées, on va tenter une nouvelle méthode : les arrestations. Fin septembre, le préfet Doux vient en inspection. Pour le moindre motif on pratique des arrestations, aussitôt suivies d'un jugement devant le tribunal correctionnel d'Albi, la Cour de Toulouse confirmant les peines en appel. Aucouturier, membre du comité de défense et conseiller municipal, est condamné à quatre mois de prison « pour avoir tenté, au cours du mois de septembre, à l'aide de violence ou de menace..., d'amener ou de maintenir une cessation concertée du travail dans le but de porter atteinte au libre exercice du travail ou de l'industrie ». Belin, qui « apparaît comme un meneur dangereux et un futur orateur de réunion publique », écope de quarante jours sous l'accusation d'avoir injurié la police – le collaborateur du préfet n'ayant rien entendu mais ayant vu remuer ses lèvres... C'est encore la femme Hauser qui, pour avoir dit à un jeune voulant reprendre le travail : « Fainéant ! Si tu n'as pas de pain, je t'en donnerai ! », se voit condamnée à quatre jours pour délit de tapage injurieux. C'est enfin le sieur Huntziger qu'on condamne à quarante-cinq jours pour avoir déclaré : « Ceux qui accepteront de reprendre le travail seront des fainéants. » Ni la division ni les arrestations n'apportent, cela dit, les résultats escomptés. Aussi, Rességuier trouve une autre solution. Les manœuvres d'embauchage s'interrompent à Carmaux. On organise alors dans le Nord et dans la Loire des tournées de propagande. Seize hommes seront envoyés de Rive-de-Gier ou les patrons les ont obligés à partir sous peine de chômage. Des convois arrivent à Carmaux, souvent des ouvriers que l'on a copieusement fait boire. Quelques-uns, constatant la situation, se présentent au comité de grève et déclarent avoir été trompés : on leur avait dit que la grève était terminée. Ils décident de repartir. Pourquoi cette précipitation de la direction ? Raisons d'ordre économique ? La production est toujours paralysée après deux mois de grève, des marchés sont perdus. Raisons politiques ? La Chambre des députés doit se réunir le 22 octobre et les socialistes vont intervenir si la reprise n'est pas effective, et ainsi donner une nouvelle dimension au conflit.
L'état de siège
À Carmaux, les vexations et les arrestations redoublent. Mieux ! Rességuier provoque un rebondissement inattendu : il se plaint d'un coup de révolver qu'on aurait tiré sur lui en pleine rue. Ce « coup de pistolet confidentiel » (dixit Camille Pelletan dans Le Rappel) lui aurait troué la redingote ! La presse est sceptique et incrédule : comment I'assassin aurait-il pu s'échapper dans une rue remplie de policiers ? Un homme sera pourtant arrêté : le jeune Guilhem, connu pour ses idées anarchistes. Emprisonné un mois, il sera relâché. Cependant Carmaux est mis en état de siège. Les fonds de secours des grévistes sont saisis, on perquisitionne. À l'hôtel Malaterre, un triple cordon de police boucle les issues pendant que les agents fouillent la chambre de Jaurès, celle aussi de Gérault-Richard, député de Paris, ainsi que les combles. Des patrouilles de gendarmes à cheval balayent la rue de la gare et la route nationale. Les passants sont malmenés avec violence. Le commissaire spécial Frendel se tient, habillé de son écharpe et révolver au poing, à l'angle des deux rues. Alors que la Chambre des députés va se réunir, le travail reprend à la verrerie. Trois fours sont allumés, mais peu de verriers carmausins sont là, moins d'une dizaine. Le travail est loin d'être sérieux : disputes, flâneries, incapacité des nouveaux arrivants (certains ont été recrutés parmi les terrassiers de la route Quillan-Rivesaltes). Néanmoins, le plan de Georges Leygue, ministre de l'Intérieur, est réalisé : quelques fours fonctionnent.
Intervention gouvernementale ?
Au Parlement, après un discours de près de cinq heures et demie, Jaurès dépose l'ordre du jour suivant : « La Chambre, convaincue qu'un haut arbitrage moral peut seul résoudre ce conflit, invite M. Brisson (président de la Chambre) à accepter d'être l'arbitre. » Brisson hésite, mais Leygue, lui, refuse et réfute tout : « Un troisième tour a été allumé, la troisième équipe est prête ; il y aura 593 ouvriers. Avant la grève il y en avait 675, donc la grève est terminée. » Évoquant le manifeste envoyé par les verriers de Carmaux à tous les verriers de France, il le qualifie « de véritable déclaration de guerre ». Bonne âme, il conclut : « Le gouvernement a agi avec justice et il ne Iui reste plus, le conflit étant terminé, qu'à soulager les misères que la grève a fait naître. » Le vote de la Chambre est négatif, Jaurès est battu. À Carmaux, c'est la déception des verriers et le triomphe de Rességuier. Triomphe de courte durée, car le 29 octobre, le ministère Ribot fait place au ministère radical de Bourgeois, qui est bien décidé à résoudre le conflit. Des arbitres sont nommés.
La grève n'est cependant pas terminée. Rességuier n'est pas d'accord. « Le conflit de Carmaux ne comporte pas d'arbitrage ; le choix du personnel doit appartenir exclusivement à chaque citoyen. Le jour où il en serait autrement, toute liberté serait anéantie, l'industrie française serait perdue au détriment des ouvriers eux-mêmes et au grand avantage de l'industrie étrangère. » Malgré toutes les pressions, le patron refuse. Aussi, plus de trois mois après le début de la grève, le 10 novembre, « les ouvriers verriers et similaires de Carmaux, réunis au nombre de 850… constatent que M. Rességuier, en exigeant le sacrifice préalable de plusieurs d'entre eux, se refuse à foutes négociations... Ils demandent d'urgence aux pouvoirs publics la protection légale des syndicats... Ils décident en outre de fonder une verrerie aux verriers qui donnera du travail à tous ceux que M. Rességuier ne reprendra pas, et ils s'engagent à continuer la lutte unanimement. » Restait à trouver les fonds nécessaires à l'entreprise...
S'organiser eux-mêmes
Le 13 novembre, Rochefort télégraphie à Jaurès pour lui annoncer un premier don de 100 000 francs or – somme énorme à l'époque où un ouvrier de l'automobile de la région parisienne gagne environ 6 francs par jour ouvrable, aux dires de Pelloutier –, provenant d'une septuagénaire vivant chichement, Mme Dembour (à qui d'ailleurs on intentera un procès). À Carmaux, le travail reprend pour ceux que Rességuier veut bien embaucher ; les ouvriers malades et une vingtaine de membres du comité de grève sont renvoyés.
Une nouvelle aventure commence pour les verriers grévistes : la construction de leur entreprise. Après bien des discussions, le choix se porta sur Albi, où les terrains étaient moins chers et le charbon meilleur marché. Le 25 décembre, dans La Dépêche, à la fin d'un appel pour la souscription, Jaurès écrit : « Le succès doit être assuré pour montrer que l'on n'est pas des parleurs inconsistants, qui effleurent toutes les grandes questions et qui n'en résolvent aucune... En démontrant que les ouvriers peuvent s'organiser eux-mêmes, se discipliner eux-mêmes, elle accoutume les esprits à l'idée d'un affranchissement général des salariés et d'une organisation sociale nouvelle... »
André BORDEUR
[Sources : journaux de l'époque, surtout La Dépêche, de Toulouse.]
Le Peuple français, n° 16, octobre-décembre 1974, pp. 29-31.
12.05.2025 à 13:46
Georges Navel : travaux et parcours
F.G.
■ S'il fallait démontrer que nous avons les admirations fidèles, l'attesterait sans nul doute celle que nous nourrissons pour l'écrivain vagabond et libertaire Georges Navel (1904-1993), qui a fait l'objet, en 2003, à l'époque où nous paraissions en revue (papier), d'un double numéro spécial d'À contretemps, publication reprise en volume en 2011 . Dans un excellent article qu'elle lui avait consacré – « Le travail de la main à plume » –, Arlette Grumo y écrivait : « Auteur d'un seul livre (…)
- En lisièreTexte intégral (8617 mots)

■ S'il fallait démontrer que nous avons les admirations fidèles, l'attesterait sans nul doute celle que nous nourrissons pour l'écrivain vagabond et libertaire Georges Navel (1904-1993), qui a fait l'objet, en 2003, à l'époque où nous paraissions en revue (papier), d'un double numéro spécial d'À contretemps, publication reprise en volume en 2011 [1]. Dans un excellent article qu'elle lui avait consacré – « Le travail de la main à plume » –, Arlette Grumo y écrivait : « Auteur d'un seul livre sans cesse remis sur l'ouvrage – Chacun son royaume, Parcours et Passages n'étant finalement que d'admirables variations de Travaux, son premier livre –, Navel, écrivain de la “vie ordinaire”, inscrivit avec constance ses pas dans ceux de sa classe – dont il s'affirmait “moralement” solidaire. Mais, au-delà, de cette belle fidélité, ce “Navel, du Syndicat des terrassiers” – comme il l'écrivit à un juré du Goncourt – était d'abord un insoumis définitif, un réfractaire à tout enfermement, un franc-tireur de l'écriture. »
Datant d'avril-mai 1975, l'entretien de Georges Navel que nous reprenons ici fut originellement publié dans le premier numéro de la revue Les Révoltes logiques, paru au quatrième trimestre de 1975.
Retranscrire fidèlement du Navel est tâche impossible. Quiconque l'a entendu parler sait que le charme de son oralité, faite de silences suspensifs, d'hésitations réflexives, de quêtes des mots justes, d'allers et retours continuels, ne résiste pas à sa transcription. Lui-même le disait d'ailleurs : « L'enregistrement vocal exige la même voie de transmission. Il se fait par rapport aux gens auxquels on parle. On voit leurs yeux, ils ont compris, on ne s'étend pas. » Cette difficulté, nous l'avions déjà affrontée, en 2003, dans la transcription d'un entretien qu'il avait accordé à Phil Casoar sur son « aventure espagnole » au temps de la révolution sociale et dénouée en n'hésitant pas à retravailler l'entretien transcrit pour lui donner une forme écrite simplement lisible. C'est le même choix que nous avons opéré ici, en partant de sa version parue dans Les Révoltes logiques. Nous ne pensons pas nous être trompés, mais nous devions en avertir nos lecteurs. Et conclure en les incitant à lire Georges Navel, et notamment les dernières éditions ou rééditions qui ont récemment paru : Passages (L'échappée), Contact avec les guerriers (Plein Chant), Parcours et Près des abeilles (Gallimard). Ils ne le regretteront pas.– À contretemps.

À dix ans, dans les années 1914-1915, j'ai vécu près du front. Ma famille habitait aux environs de Pont-à-Mousson, un petit village qui s'appelait Maidières. C'était à 2 km du Bois-le-Prêtre ; Bois-le-Prêtre, eh bien, c'était les tranchées, ça ne se battait pas férocement, mais enfin il y avait des attaques, des obus, la vie près du front, quoi… Et la rencontre, une rencontre qui pour moi a été très heureuse, des marins, des gars du génie. Ce qui fait que quand j'avais dix ans, les bleus de la classe 16 se sont amenés. J'aurais pu leur parler comme d'égal à égal parce que j'avais plus d'expérience... Bon voilà. Mais j'ai quand même connu la guerre, j'en ai un souvenir. J'ai retrouvé parmi les soldats des gars qui ressemblaient un peu à mon frère Lucien par les idées, j'ai connu des socialistes. Une escouade de la Territoriale qui logeait chez nous, qui dormait par terre, sur des matelas ; eh bien j'entendais leurs discussions, je savais ceux qui étaient socialistes et ceux-là nous étaient sympathiques. Il y avait un gars barbu qui était auvergnat, je l'entendais dire : « Ces patriotes à la graisse de chevaux de bois, ils commencent à me plaire. »
Lucien était libertaire...
Oui c'est ça… Ils étaient assez rares, les libertaires. Il en avait fréquentés. Premièrement, il était allé à Paris. C'était un révolté. Par la vie des usines, par l'exploitation. Il avait participé à des grèves, même s'il n'y en avait pas beaucoup en Lorraine. Jeune, il avait donc fréquenté les groupes libertaires de Nancy ; fallait qu'il aille à Nancy pour rencontrer des copains, et puis à Paris. Quand il avait été adolescent, ramassé sur le trimard, il avait vu la misère de près. Et puis il recevait les canards. De temps en temps chez nous, les gendarmes apparaissaient pour fouiller sa valise, pour perquisitionner. Alors, après la guerre, quand il revient...
Votre frère avant-guerre était contre la guerre...
... et puis il s'est engagé, oui…
Comment vous expliquez ça ?
II ne faut pas oublier que dans le mouvement, les « grands » – Kropotkine, Jean Grave… – ont signé le « Manifeste des Seize ». Ce manifeste soutenait le bien-fondé de la position de la France. Nombreux d'ailleurs étaient ceux qui considéraient que la cause du droit et de la civilisation était de ce côté-là. À l'envers du Marx de 1870, en somme, qui, lui, préférait le triomphe de la Prusse avec l'idée que, si les Français prenaient une déculottée, ça rabattrait le caquet aux ouvriers parisiens. Là, les signataires du manifeste souhaitaient que la cause alliée triomphe ; ils ont peut-être, probablement, fait une erreur – elle leur a été reprochée –, mais ils l'ont faite au nom de certains principes, d'un attrait historique pour la France. C'est le cas pour le père Kropotkine. Il n'était pas le seul, c'était un mouvement : Sarajevo, l'attitude de l'Allemagne… Beaucoup ont perdu les pédales, mais les ont récupérées assez vite, dans les premiers mois ou dans l'année. Monatte, lui, et quelques autres, ne les ont pas perdues, mais pour des raisons qui m'échappaient alors. J'avais dix ans, je le rappelle. Moi, je suis surtout marqué par le retour de Lucien, mon frère. Après Maidières, nous nous sommes réfugiés à Lyon, en 1917 ou 1918. C'est par mon frère que je fréquente le groupe des syndicalistes ; et puis il y a tout ce qu'il me raconte, tout ce qu'il me dévoile.
Je l'ai dit, c'est un bouleversement que je ne souhaite pas aux adolescents de connaître. Je faisais confiance au monde des adultes, à leur sagesse, je croyais au respect. Et puis tout d'un coup, mon frère – c'était un frondeur, mon frangin – me dit en parlant des patriotes : « Ce sont des abrutis, des inconscients, on leur bourre le crâne ». Et il me révèle qu'il y a les marchands d'armes, l'exploitation industrielle, qu'on est de la chair à canon, etc. Ça tombe comme un couperet. J'ai fait, dans Parcours, un portrait des militants syndicalistes, de ces hommes bien, de ces militants de la première CGT. Ces gens qui lisaient, c'était des syndicalistes révolutionnaires – ou anarcho-syndicalistes. Ils avaient de la trempe. D'origine paysanne pour la plupart, ils étaient devenus ouvriers. Ils avaient de l'esprit, du bagout, de la force...
Ils étaient ouvriers qualifiés ?
Oui, ouvriers qualifiés, et pleins de ressources. Je suis de ceux qui pensent que les idées de révolte confèrent un certain génie. On peut les perdre, certes, ces idées, mais elles prédisposent à passer au crible de la critique un peu tout. De temps en temps, quand il y avait des discussions entre militants sur la société future, ça ne manquait pas d'humour. Ils se rendaient compte qu'il y aurait beaucoup de difficultés. Là où ils étaient positifs, c'était dans la lutte contre la guerre, leur action pour les lendemains qui chantent. À l'époque toute leur sympathie allait à la révolution russe...
Comment a-t-elle été perçue dans le milieu où vous viviez ?
Le milieu, c'était les copains, une petite société. Là, on la voyait comme une grande espérance, cette révolution. Lénine, Trotski, on connaissait leurs noms. Les soviets… On ne savait pas exactement ce que c'était que ces conseils d'ouvriers et de paysans – la forme de la dictature du prolétariat, nous disait-on –, mais on les regardait avec sympathie. J'avais assisté à un petit échange entre mon frère Lucien et le père Bécirard – dont j'ai fait le portrait dans Parcours –, qui était le type même de l'ouvrier-tribun. Il avait de l'allure, Bécirard, il parlait bien. « Tu sais, disait-il à Lucien, les masses sont indécrottables. Quand elles rentreront de la guerre, elles reprendront leurs pantoufles. » C'était des militants qui avaient le sens du tragique, mais ça ne les empêchait pas de lutter. Sans se créer de fausses espérances. Ils étaient défaitistes, ils étaient contre la guerre. Mon frangin, lui, avait participé aux manifestations défaitistes, en 17. Je connaissais déjà, quant à moi, des déserteurs. Dans le groupe de la Jeunesse syndicaliste, il y avait un gars dont je me souviens si bien que je pourrais en faire le portrait. C'était un ajusteur, très porté sur l'humour, à l'accent très parigot. On l'appelait « Mémoire chancelante », il était « désert' » – mais il n'était pas le seul, il y en avait deux ou trois parmi les mobilisés. Il avait trouvé un truc : il achetait du lait pour que sa logeuse soit convaincue qu'il était malade. En entrant chez sa logeuse, il toussait. Au boulot, il ne toussait pas. Pour expliquer sa présence à l'usine à ceux qui s'inquiétaient des embusqués qui échappaient à la mobilisation, « Mémoire chancelante » prétendait qu'il risquait une rupture d'anévrisme et qu'il ne lui fallait surtout pas soulever de fardeaux. Il y avait une sorte de chaleur entre nous. Nous faisions famille, en somme. Quant aux premières rencontres avec les aînés, ce fut, pour moi, comme un éblouissement. Ils avaient de belles gueules. Certains ressemblaient à Jésus-Christ ou à des penseurs. Ils lisaient. Ils vouvoyaient. Ils incarnaient la sympathie et la force. Parce que, parmi la classe ouvrière, les gars au boulot, il y a aussi de bonnes brutes.
J'ai commencé à travailler très tôt, à douze ans et de mon propre gré, chez le père Durand. C'était un gars de Montélimar. La guerre avait permis la création de beaucoup d'entreprises. Durand avait loué un terrain vague, monté quelques baraques et il y retapait du bidon de soldat et des casques bosselés : on faisait de l'étamage. Moi, je travaillais à côté de l'étameur, les pattes dans l'acide, dix heures par jour. Plus tard, j'ai bossé, à Lyon, avec des femmes et dans une meilleure ambiance. J'avais plaisir au boulot. J'étais réactif. Comme chez nous on est obligé, en somme, d'aimer le boulot, j'aimais le boulot. C'était avant le dévoilement, avant que je commence à comprendre quelque chose à la vie et à la société. Des conversations que j'avais, gamin, avec mon frère, tout ce que j'ai compris, c'est qu'on était une classe inférieure, parquée et méprisée. Du bétail en somme. Il ne s'est pas passé longtemps pour que je le comprenne. À quatorze ans, j'ai décidé que je ne passerais pas ma vie dans ce monde-là. C'est à ce moment qu'à peine converti aux idées avancées j'ai essayé de foutre le camp en Algérie, pays où, môme, j'avais vécu quelques mois comme réfugié. Je me suis dit : plutôt le pays du soleil que l'usine et ses règlements. Mais je crois que ce dévoilement fut un peu brusque. Mon frangin y allait un peu à coups de maillet. En plus, il n'y avait pas que mon frangin. J'avais lu La Vie tragique des travailleurs des frères Bonneff sur les conseils des gens de la Jeunesse syndicaliste, qui n'étaient pas des jeunes – ceux-là étaient mobilisés à Lyon –, et venaient d'un peu toutes les régions de France, avec des idées syndicalistes en tête et des livres dans leurs besaces.
Et les grèves de 1917 ?
Les grèves de 17 ont eu lieu dans les grandes boîtes. Nous, on était dans une petite boîte. Il faut bien se dire qu'en général, les gens sont passifs et que la guerre n'arrange rien. En 17, quand je voyais passer un drapeau rouge et des grévistes dans la rue, pour moi c'était la révolution. J'allais à la Bourse du travail, il n'y avait pas de bagarres, les orateurs parlaient de leur rencontre avec le ministre – je crois que c'était Albert Thomas [2] – à qui ils demandaient une augmentation. Il y avait des grèves, évidemment, mais aussi des courants d'idées, des émeutes, l'insurrection, la révolution en Russie, les mutineries au Chemin des Dames, tout cela se rejoignait. C'était comme un tissu, mais qui n'existait que pour les plus conscients, les militants. Ces idées passaient dans les discours et se communiquaient. Y'en a marre de la guerre, par exemple. Les gens qui n'y pensaient pas à ces idées se trouvaient donc entraînés, simplement parce qu'ils étaient là, qu'ils bossaient à tourner des obus. Quand mon frère était présent, j'avais des explications. L'amélioration du monde, la société future, on en parlait. Il me disait : « Tu comprends, quand il n'y aura plus de douaniers, plus de flics, plus d'armée, tout le monde travaillera ; il n'y aura que les malades qui ne travailleront pas. » Dans son esprit, tout s'organisait. En attendant, les gens qui développaient une sorte de pensée, il fallait qu'ils se retrouvent – comme dans une Église, en somme, même s'ils sont libres –, il fallait qu'ils voient leurs copains, qu'ils parlent des même choses, qu'ils se fortifient ensemble. J'allais avec mon frère à la Libre Pensée. On y rencontrait des socialistes. Il y avait des réunions fréquentes. En tout cas, je sais qu'à quatorze ans j'étais capable de faire le procès de l'action de Clémenceau.
Par la suite, il y eut la période des grands cortèges, des grèves, des occupations d'usine – de 1918 à 1920. Tout ça on le suivait, mais aussi les événements de Hongrie [3]. On s'exaltait de mots. Puis vint la retombée, l'échec de la grève des cheminots, le lock-out. La chambre patronale faisait le tri et n'embauchait plus les militants. Mon frère Lucien avait été assez violent, il s'était colleté avec un officier de police à la porte de son usine. On est venu à son domicile et il a foutu le camp à Paris. Après être revenu, il ne trouvait plus de travail et fut obligé de devenir manœuvre. Il a toujours dit qu'il avait un ange gardien. Par exemple, ce flic qui est venu le voir pour lui proposer… d'être mouchard. Au-delà de l'anecdote, ce fut la répression pour quelques années.
Vous avez travaillé chez Berliet, comment ça se passait ?
Avant Berliet, j'ai été manœuvre sur un chantier du bâtiment, je bossais 11 heures par jour, je gagnais autant que mon père et j'étais content de me faire une bonne paye. Un peu sur le modèle des sportifs, j'étais dur à la tâche et, comme chez tous les gamins, j'aspirais à la croissance, à devenir un homme. Vers quinze ans, j'étais donc manœuvre. Je tirais ma carriole. Là, j'ai rencontré un militant que j'avais connu à la Jeunesse syndicaliste. Lyon, ce n'était pas une ville où les hommes étaient atomisés. Ils se voyaient, les gars. Il y avait des liens de camaraderie. Pas de voitures, à l'époque, pas de trucs pour aller à la campagne, ils se rencontraient. C'était une tribu, les copains... Je rencontre donc Nury, un ajusteur, un Ardéchois, qui me dit : « Écoute, si tu veux, viens, tu pourrais embaucher à ma boîte. » Son patron, c'était Ladouard, ancien secrétaire de la métallurgie devenu petit patron qui travaillait derrière son tour. C'était l'exemple même du petit patron qui a toujours des relations d'estime professionnelle avec ses copains, qui n'est pas devenu un jaune. J'ai fait un apprentissage rapide d'ajusteur, j'ai tenu le balai pendant assez longtemps et j'ai fait des trucs plus difficiles.
Quand j'ai commencé chez Berliet, j'avais dix-huit ans. Là, c'était la grande boîte, l'usine de Vénissieux. Pour moi, enfin pour les outilleurs, c'était pas mal – même si on appelait la boîte « le bagne Berliet ». L'usine en hiver, le même train-train tous les jours : objectivement, je n'étais pas trop mal, j'avais un bon contremaître qui ne m'embêtait pas. Mais j'avais des crises. Des choses s'entrecroisaient, en somme. J'étais plutôt végétarien et buveur d'eau. Être végétarien, bouffer peu, en hiver et en pleine croissance, ce n'était pas simple. En plus je n'habitais plus avec ma famille et l'époque – 1922 – ne portait plus d'espérance. Comme j'étais un peu trop lucide sur moi-même, il me fallait un contrepoids de vie physique à mon existence.
Quels étaient les rapports entre les outilleurs et les autres ouvriers ?
Les rapports qu'on peut avoir en usine, c'est-à-dire aucun. D'autant que les outilleurs travaillaient derrière leur grillage, sans contact avec l'atelier. Par ailleurs, ce n'était pas une période d'agitation. Il n'y avait aucun mouvement. Le syndicat… néant ! En même temps, en 1922, j'ai croisé des gars parmi les outilleurs, des copains italiens qui avaient fait les combats de rue, je savais qu'ils étaient antifascistes, qu'ils avaient combattu. À cette période, c'était le grand reflux des gars qui avaient passé la frontière et avec lesquels on se retrouvait au boulot. Ça ne faisait pas beaucoup d'échanges sur les conditions de travail. Dans Travaux, j'ai parlé d'un copain, un aîné, Vacheron, qui avait 26 ans à l'époque et une sorte de gravité, de maturité. Bon ouvrier, il avait été syndicaliste, puis était devenu anarchiste individualiste. Il avait l'impression qu'il n'arriverait à la culture qu'en changeant de situation. Fallait faire son boulot, disait-il. Ce serait trop long de définir cet état d'esprit, une croyance dans la perfectibilité individuelle. On avait de la sympathie pour lui parce qu'il avait été délégué, on se connaissait. Nous étions marqués comme peuvent l'être des copains au sens où nous l'entendions, des copains qui lisent, des copains philosophes au fond, qui réfléchissent, qui critiquent, qui ont des idées, qui gardent les yeux ouverts, des copains conscients, en somme.
Où avaient lieu ces échanges d'idées, cette fraternisation ?
Dans les groupes. À Lyon, par exemple, il y avait, rue Marignan, le groupe libertaire, mais aussi le groupe des anarchistes individualistes, dit du Libre Examen. Le groupe libertaire était formé de compagnons d'un peu tous les métiers : des terrassiers, des peintres, des mécanos. Il y avait aussi des causeries, des polémiques aussi, par exemple sur Clérambault, le livre de Romain Rolland. En 1921, Million, secrétaire de l'Union des syndicats du Rhône, tenta de fonder une petite université populaire. On l'a appelée l'Université syndicale. Million, qui était réformiste, cherchait à former des militants préparés, mais tout ça n'a pas été suivi d'effets. Ça manquait d'éléments conscients de la tâche. Tout se faisait au petit bonheur la chance. Au même moment se créa un groupe qui aurait dû s'appeler « Jeunesse syndicaliste », mais prit le nom de « Jeunesse ouvrière ». À travers les influences exercées sur nous, les journaux que nous lisions, nous étions plutôt libertaires. Je me souviens du Réveil de l'esclave, de La Mêlée, de L'En-dehors. La cogitation intellectuelle allait très vite. Paraissait aussi un petit canard, créé par un armateur de Paris, qui s'appelait L'Ordre naturel, et qui défendait les thèses de l'École de Manchester, de Bastiat, de Spencer : il était antiétatique et antinationaliste et sa doctrine c'était le laissez-faire absolu. Pas de coalitions ouvrières, pas de trusts, pas d'interventions de l'État – ou suppression de l'État –, supra-nation. Ça imbiba très rapidement certains d'entre nous, dont un copain qui ne jurait plus que par Bastiat. En fait, ça contribua à démolir le groupe. Quand je discutais avec ce copain qu'on appelait Marcel, je lui disais : « Mais, Marcel, les hommes, c'est pas des boîtes d'allumettes ». Moi je me sentais très faible sur la théorie de la valeur, les lois de l'offre et de la demande, l'économie politique. Mon père travailla quarante ans à l'usine de Pont-à-Mousson. J'ai toujours eu un sentiment très vif, viscéral, d'appartenir au monde des serfs. Je l'avais en moi, ce sentiment. Je l'ai senti, à Lyon en octobre 1915, en revenant d'Algérie où j'avais passé six mois comme réfugié. Quand j'ai retrouvé ma famille à Lyon, j'ai eu le sentiment qu'on était mieux, qu'on avait échappé à la domination de la grande boîte, aux jetons pour aller à la coopérative, à la paye insuffisante.
J'ai en tête une discussion au sein du groupe lyonnais auquel j'appartenais – j'avais 19-20 ans. Appartenir à un groupe, c'était vivre la même aventure : quand les copains se dispersaient ou étaient bouffés par une sorte de disponibilité, ils n'entretenaient pas la foi, mais la critique ; ils s'ouvraient à justement ce qui pourrait nous démolir… On appelait ça la liberté d'esprit !
Je voulais voyager pour voir. À cette époque, je me sentais assez bien armé. Il y avait encore des groupes, je savais que dans telle ou telle ville où je pourrais aller, je retrouverais des copains. En 1925, j'ai repris mon projet, je suis parti vers l'Espagne : je me suis confronté à des travaux un peu au hasard de ma route, des travaux physiques. J'avais besoin de vivre au grand air. J'ai compris que ça m'équilibrait, que la critique aurait fini par ronger mon sentiment vital. À l'automne, je suis revenu vers les livres, les copains, l'usine à Lyon. J'ai eu l'occasion, à la fin de l'année 1926, d'être encore à Paris, mais le chômage venant, j'ai dû repartir dans le Midi bosser. Puis est arrivée l'année 1927 : j'avais été ajourné deux fois pour l'armée. J'étais passé deux fois devant le conseil de révision, avec des certificats. J'avais pas du tout l'intention d'être militaire, c'est la marque que m'avaient laissée les idées libertaires, l'idée que l'individu n'est pas le sujet de l'État ni même celui de la société. Ce contrat-là, je n'en voulais pas. Je n'étais pas sûr, moi, que le communisme soit possible, mais ne pas être militaire c'était mon bout de certitude. Et puis je ne pouvais pas, quoi, physiquement, enfin, totalement, je ne pouvais pas être militaire. J'avais été très accommodant, je n'ai pas été objecteur de conscience, je suis allé à l'armée pour être réformé. J'avais que six mois à faire parce que j'avais été déjà ajourné deux fois, et j'allais dans un corps d'armes assez privilégié : la DCA. Je suis allé à Toul, j'ai fait ce que je pouvais pour être réformé. J'avais 23 ans et l'impression que j'allais perdre six mois d'un temps extrêmement précieux. J'y ai passé trois semaines et je suis parti, je suis revenu à Paris.
La situation à Paris n'était pas très facile, j'ai pu embaucher chez Citroën avec les papiers d'un copain qui était lui-même insoumis. À l'époque, les bureaux d'embauche ne regardaient pas, ils avaient besoin d'outilleurs. C'était chez Citroën à Saint-Ouen. J'ai commencé dans un service d'entretien général, il y avait un certain désordre, ça cafouillait, je travaillais de nuit, on ne foutait pas grand-chose... Mais enfin, c'est dur le boulot, j'ai travaillé quelques mois et j'ai pris des vacances ; j'ai dit à mon chef que j'étais malade, que j'avais besoin de me reposer, que je reviendrais. Quand je suis revenu, j'ai repris dans une autre équipe où le boulot était extrêmement dur. Ça tenait aux conditions : quand, à la chaudronnerie, tous les ateliers se trouvaient réunis et qu'on devait faire un boulot de précision... (c'est le point qui m'a déterminé un peu à écrire Travaux), là, j'ai eu l'impression de vivre l'expérience des hommes primitifs quand ils étaient en face des diplodocus ou des dinosaures. Les monstres avaient changé. Désormais, c'étaient des machines. Alors, la vie vous dépasse, le sentiment naît d'être dans la société sans avoir droit à la vie. Quand on est dans la condition ouvrière, on est soumis, on peut râler mais on se plie aux conditions faite aux ouvriers, on est comme les autres, quoi, égaux dans l'exploitation, on ne lâche pas le peloton, car si on le lâche, on est dans la faiblesse. À cette époque, j'ai été blessé à la main : pour la première fois, je n'ai pas pris de feuille d'assurances, je suis resté avec un gros pansement à l'index, puis j'ai bossé. Ça m'avait d'ailleurs valu la sympathie du docteur ! Plus tard, le boulot est devenu plus difficile encore : la fatigue, le bruit, j'en avais ma claque. Je suis retourné voir le docteur, qui m'a facilité une embauche chez Citroën à Levallois : là, pas de vacarme, pas de grosses machines, du bruit mais normal... Mais commença une pratique de contrôle qui n'avait jamais sévi chez les ajusteurs-outilleurs, dont le travail restait artisanal. Pour la première fois, j'ai été chronométré par des gens qui n'y connaissaient que couic, des jeunes gens qui n'avaient jamais travaillé. Ça obligeait à une sorte d'intensité dans l'effort, comme s'il fallait être le champion ! Ce n'était pas la chaîne, ce n'était pas du travail en série qu'on faisait. Tout le contraire : on faisait des instruments de précision qui devaient servir à mesurer des pièces pour des ouvriers spécialisés sur leurs machines. Ce sont des pièces isolées, mais si on avait besoin de quinze heures et qu'on nous en donnait huit, on avait des bons. Quand les bureaux avaient cafouillé, le contremaître, le chef d'équipe, prenait sur lui : « Je t'arrangerai ça sur un autre bon »…
Comme je ne sortais pas à midi... parce que les petits bistrots c'est la zizique, le joueur d'accordéon, le coude-à-coude, ça gueule, je bouffais quelquefois sur mon étau... Mes neuf heures, ça se traduisait par onze heures de présence : alors le soir, je marchais à petits pas. Quand je me retrouvais à l'hôtel, si ma femme froissait un journal, je commençais à chialer. J'avais le sentiment que je ne tenais pas le coup, que j'étais à la limite de l'effort, que je frisais l'hystérie. À un moment donné, sentant que je ne pourrais plus tenir, je suis allé revoir le toubib, je lui ai présenté ma main et mon index, je voulais une feuille d'assurances pour une opération qui rétablirait mon tendon. J'ai un peu insisté, mais il me l'a refusée et il a appelé le gardien de service. Je me suis servi de cet exemple, dans Travaux, je ne faisais que défendre la nécessité du syndicat, de l'union. Là, il n'y avait pas d'entraide, il n'y avait rien, pas de délégués, pas de recours...
Il n'y avait rien comme syndicat chez Citroën ?
Ils existaient peut-être, les syndicats, mais il n'y avait pas de syndiqués dans la boîte, pas de syndiqués qui se faisaient connaître, du moins…
Y avait-il des accrochages avec les chronométreurs ?
Nous, on ne les voyait pas, les chronométreurs, ce n'était pas le même système. C'était les manœuvres spécialisés travaillant sur des machines et qui faisaient des gestes répétitifs qui étaient chronométrés. Il y avait le démonstrateur, le régleur, habile à la machine, qui faisait le geste, il avait 150 pièces à faire ou 1 000, il avait calculé tant de temps, tu les gagnais ou tu les perdais, tu perdais ton bon... Mais nous, il ne pouvait pas y avoir d'accrocs, c'était simplement un temps fixé par quelqu'un qu'on ne connaissait pas – et depuis son bureau. Dans l'atelier où j'ai bossé quand j'étais à Saint-Ouen, les chefs étaient sympas : on faisait un dur boulot, à partir de lecture de dessins, dans de rudes conditions de bruit, sans outillage. Un atelier de mécanique de précision lié à un atelier de chaudronnerie et d'emboutissage où les machines font quatre mètres de haut, ça n'allait pas ! On ne voit pas un chimiste travailler parmi l'éclatement des obus !
J'ai été très réactif à la pollution, aux bruits, au malaise que produisent ces trucs-là. Il pouvait y avoir des incidents, de temps en temps, avec les gardiens, mais ce n'était pas à proprement parler des accrochages, des mouvements organisés.
Muni d'une feuille d'assurances, je suis allé à la clinique de la CGTU. La CGTU existait en tant qu'organisation, mais elle était faible. À cette époque, il devait y avoir de 25 000 à 35 000 gars au Parti. On en voyait, de temps en temps, qui vendaient L'Avant-Garde à la sortie de Renault et à qui on pouvait serrer la main, mais des gars un peu ouverts ou réactifs, on n'en voyait pas, même si on sentait parfois une certaine forme d'assentiment à certains propos chez ceux qui avaient des souvenirs. Le mouvement syndical s'est noyé. On en a d'ailleurs ressenti les retombées un peu partout : moins de fêtes populaires, moins de groupes, moins de trucs partout. Sur le chemin de Paris, en 1923, je me suis arrêté à la colonie de Bascons pour y retrouver des copains, des libertaires. C'était comme une secte qui se distinguait par un style de vie et la pratique du végétalisme. À Paris, il y avait le foyer végétalien de la rue Mathis, créé par Buteau, un gars qui avait connu Lénine. Il était sur la lancée tolstoïenne, si on veut, et faisait sien le principe épicurien de liberté par la limitation des besoins. Au foyer, il y avait des Italiens, chassés par le fascisme, des Russes, des Bulgares, pas beaucoup de main-d'œuvre immigrée proprement dite. Il y avait aussi une effervescence parisienne d'après-guerre. Au Dôme, notamment, c'étaient les peintres d'origine scandinave qui dominaient. Il y avait beaucoup de curiosité, un mouvement de vie intellectuelle, spirituelle, dont on retrouvait la réplique dans ce restaurant végétalien où ça remuait comme à l'Odéon en 1968, avec les mêmes interventions drolatiques !
Ce n'est plus le mouvement ouvrier à proprement parler, en fait, ce sont des échappées. Avec des retombées, des moments où l'on ne croit plus, n'espère plus, où l'on prête l'oreille à d'autres voix : la libération par l'illégalisme, la révolte ouverte, et peut-être même la révolte à tombeau ouvert. Le père Buteau, lui, croyait avoir trouvé une autre forme d'évasion de la lutte de classes, une libération par la limitation des besoins : vous êtes libres, vous n'êtes plus dans le carcan de l'usine, vous pouvez même rejoindre les champs ou la nature. Ces petites aventures dont je parle, ça aurait pu éclore autour du syndicalisme, de la révolte ouvrière. Je me souviens de mon vieux copain Nury, dont j'avais été l'apprenti. À quarante-cinq ans, il a dû laisser tomber la boîte de Ladouard. Sa femme a travaillé dans une coopérative de chaussures. Il me disait : « Oh, tu comprends, nous maintenant, on décroche… » Il y avait quelque chose qui s'était passé dans la génération de ceux qui ont eu vingt, vingt-cinq ou trente ans en 1914. Ils avaient cru à la grève générale, à la solidarité ouvrière, à la révolution russe. Ils avaient été dans de grands espoirs. Tout ça, d'un coup, c'était retombé. Alors ils se disaient : « Les masses sont indécrottables, ce sont tous des abrutis... ». Ceux qui le pouvaient, ils décrochaient... Mon frangin Lucien a décroché après les grèves de 1920, d'abord parce que les gars de sa boîte n'avaient pas été solidaires. Il avait ressenti comme une défection ouvrière. Quand Lucien fut menacé de poursuites, c'est le directeur de l'usine Zénith de Lyon où il travaillait qui, adepte des théories fordiennes – qu'il avait déjà appliquées à ses managers avancés –, s'était mis en tête de créer le bien-être par le fordisme en s'annexant les syndicalistes les plus militants. Il suffisait, pensait-il, de leur filer de bonnes places. Si Lucien avait été minimalement opportuniste, il serait devenu chef d'atelier.
Pendant un certain temps, j'ai éprouvé le sentiment qu'il n'y aurait peut-être pas la révolution, mais qu'un état d'esprit persisterait, fondé sur le refus d'entrer dans les rouages, sur le grignotage du système. C'était aussi un courant, le courant de la société future l' « ici et maintenant » des individualistes anarchistes qui faisaient petite société close, entre copains.
En 1928, je me retrouve chez Renault, dans un petit atelier très agréable, sans bruit ni temps compté. J'avais une blouse blanche. Il y avait là un gars assez intelligent, le père Calflèche, qui avait travaillé avec les Voisin, les premiers créateurs de l'automobile. Il avait connu les ouvriers de la première automobile. Calflèche, c'était une sorte d'autorité morale. Il ressemblait à Paul Valéry, petites moustaches, façon élégante de rouler sa cigarette, un côté parigot, fin. Dans l'équipe, il y avait des gars qui roulaient les épaules, qui parlaient argot un peu fortement. Pour le père Calflèche, j'étais le gars qui lisait, et ça, ça faisait une amitié. Je n'y étais pas mal dans ce monde, mais je pensais à un retour vers la vie, vers le Midi. Alors je suis parti. J'ai quitté ma compagne. À cette époque, je lisais une petite nouvelle de Gobineau, insérée dans Les Nouvelles asiatiques, avec un côté amour chevaleresque. Au fond, me disais-je, moi, si j'écrivais, ce ne serait pas autour de l'homo œconomicus, l'ouvrier. Si j'écrivais, je ferais passer l'homme dans beaucoup de trucs que la société ne peut pas satisfaire et que la révolution ne satisfait pas non plus, tout ce qui est relatif à la vie dans les profondeurs, au courant des aspirations. Toute société aspire à donner à tout un chacun ses 11 à 15 m2 de logement ou un peu de verdure ; elle a de la vie une définition purement matérielle. Moi, toute la vie qui m'est passée dans le carafon, c'est un peu grâce à la littérature que c'est venu, car ça ne vient pas tout seul.
En 1925, avant de partir vers les Pyrénées, j'avais expliqué mon projet à Malespine [4] : partir en Espagne, m'engager dans le Tercio [5], puis déserter et rejoindre le Rif pour me battre avec les Marocains. Ce n'était pas la cause marocaine en soi qui m'importait, mais j'étais porté par une sorte de vision stendhalienne, j'avais compris des trucs, je voulais vivre pour l'énergie, le développement physique. De toute façon je ne voulais pas être du côté impérialiste. Heureusement, je n'ai pas pu réaliser mon projet. Je suis arrivé à la frontière, je ne l'ai pas traversée ; le voyage avait un peu trop duré et la griserie du rêve s'en était un peu allée. Un copain m'a dit : « Surtout, ne va pas en Espagne, y a pas de boulot. Je ne lui avais pas parlé de mes projets… Reste ici, tu pourras t'embaucher, et effectivement, j'ai embauché. Une fois que j'ai travaillé physiquement, j'ai compris. Je me suis dit : tiens, les rêves ce sont des rêves où la volonté de faire ceci ou cela relève de l'instinct. C'est comme un langage qui envoie une sorte de message sur la vie physique, le besoin et l'emballement qu'elle procure… En réalité j'avais besoin de soleil et de grand air.
À Perpignan, je me suis rapproché de la tribu. Il y avait de très beaux arbres à l'époque dans cette ville, des platanes, c'étaient comme des fûts, une chose unique en Europe, ils ont été coupés, probablement à cause du vent. Là, j'ai rencontré un gars avec des cheveux un petit peu longs et des sandales ; il n'y avait que les anars qui portaient des sandales – un peu à l'imitation d'Isadora Duncan. Je me suis approché de lui, mais je ne savais pas parler l'espagnol. Alors je lui dis : « Anarchiste ? », ce qui était facile à deviner vu qu'il avait des brochures plein ses poches un peu flottantes. Le gars devait appartenir à la catégorie végétarienne et individualiste. Il me dit : « L'anarchisme est la perfección individual », puis il me présente ses copains, des copains qui travaillaient, des Catalans, des gars de la Fédération anarchiste ibérique (FAI). L'après-midi, je les ai suivis. Ils avaient une organisation un peu clandestine qui tenait réunion à la campagne, en petits cercles. Un peu plus tard, il m'a mis en relation avec l'unique libertaire de Perpignan, un copain dont j'ai oublié le nom, père de famille de deux enfants – sa fille s'appelait Vérité et son fils Spartacus. Lui, c'était un anarchiste œcuménique. Il plaçait dans les kiosques de Perpignan la presse anarchiste : L'En-dehors, journal d'Armand, qui avait succédé à La Mêlée, L'Idée libre, d'André Lorulot, petit feuille d'éducation populaire et sans doute aussi Le Libertaire.
En me rapprochant des copains catalans, j'ai rencontré Carlos, un maçon andalou qui avait vécu les années de répression qui précédèrent la dictature de Primo de Rivera, le temps des pistoleros. Enchaîné, il avait été baladé à travers l'Espagne. C'était un gars à l'aspect un peu arabe qui avait pas mal lu, mais avec qui on ne pouvait guère parler, car c'était un type froid. Quand il entendait les copains libertaires discuter, il disait : « Ce sont des enfants... ». Il en était revenu, en somme, de l'idée que les choses pourraient changer, il avait acquis une sorte de sagesse intérieure qui l'avait plongé dans la solitude, l'isolement. Ses seuls camarades, cela dit, c'était des révolutionnaires, des libertaires. Chef de chantier, il construisait une église de briques. C'était un beau chantier, le chantier de Carlos... Il est vrai que, quand on a vingt-et-un ans, on développe une sorte d'imagination poétique. Derrière les gars du chantier, je voyais des Velasquez. Il faut avouer que c'était une belle race, l'espagnole, elle n'était bouffée ni par l'alcoolisme, ni par le cynisme gaulois français.
C'est en 1932 que vous vous manifestez aux autorités militaires ?
Non, en 33… Ça n'a pas beaucoup d'importance, d'ailleurs. À l'époque, c'était difficile pour moi. Sans être réellement informé de ce qui se passait en Russie, je manifestais une vague sympathie à l'égard de la révolution russe. Si j'avais bossé chez un employeur bourgeois, il aurait dit que j'étais rouge. Dans le Midi, j'ai fait une expérience marquante : quand je travaillais sur les chantiers, j'existais physiquement. Par comparaison, quand j'ai bossé en usine, je me sentais diminué, je ne ressentais pas le même influx.
En somme, j'éprouvais que ce rapport qu'il pouvait y avoir entre une sorte de santé physique et le lyrisme – et même l'appétit pour la vie – n'opposait pas la vie physique à la vie mentale. Avant de quitter Renault, j'avais bien réfléchi à cela. Je m'étais dit que je n'étais pas disposé, pour être un bon ouvrier, à vendre ma cervelle. Car, en effet, pour être un bon ouvrier, il faut y mettre beaucoup de soi, ce qui signifie ne pas trop lire – et je lisais beaucoup – ou ne pas trop aller au théâtre – et je trouvais ma respiration au Vieux-Colombier à l'époque des Pitoëff et de Copeau. Je ne pensais pas qu'au boulot, je n'étais pas disponible que pour l'usine. Partant de cette réflexion, j'en suis vite arrivé à la conclusion qu'en devenant terrassier je ne vendrais ni mon intelligence ni cette part profonde de moi-même qui m'inclinait à rêver, à remuer, à aimer la vie. En fait, je n'étais peut-être pas doué pour être un as du travail en usine. Je me débrouillais pas mal chez Renault, mais je n'étais pas le compagnon le mieux payé ; ce n'était pas à moi qu'on donnait le boulot le plus difficile à faire. Il m'arrivait d'ajuster très bien une pièce au 1/100e, mais c'était parce que je m'étais trompé de 1 cm dans le tracé.
En 32, on avait ce sentiment – que certains « marginaux » peuvent encore éprouver aujourd'hui – qu'il fallait grignoter du temps au travail, ne pas être militaire, ne pas se marier, ne pas se prêter à l'exploitation. En attendant mieux, il fallait vivre. Fin 29-30 je suis entré chez Mossekoust, une société d'import-export qui avait un magasin de produits soviétiques : des dentelles d'Orenbourg, des poupées d'ici ou là, des étuis à cigarettes en bouleau, etc. L'affaire était sous la dépendance de la délégation commerciale soviétique. À l'époque, j'habitais Auteuil. Moi ce truc de la grande ville, même pas mal, ça ne m'allait pas, je ne m'y sentais pas bien. Je suis donc retourné dans le Midi. J'ai pris la pioche. C'était dans la région de Cavalaire ; je revenais pour trouver une petite propriété à louer et finalement je l'ai eue. Pendant deux ans et même si la vie n'a pas toujours été facile j'étais – poétiquement, je veux dire – dans une sorte d'accord, j'éprouvais un sentiment lyrique de la vie, je travaillais avec un certain plaisir, je n'étais ni dans l'ennui ni dans le regret. C'était une sorte d'existence des plus agréables, mais qui, à la fin, au bout de deux ans, me parut limitée. Ça tombait bien parce qu'il s'est trouvé que mon propriétaire avait besoin de reprendre le domaine qu'il m'avait loué pas cher.
De là, je suis parti pour Nice où j'ai retrouvé un pote, Isaac Fresco. Il était venu me visiter dans mon petit domaine. Il était végétalien, Fresco, il m'a donné à manger quelques petites salades et des cacahuètes le soir, 10 balles de temps en temps. J'ai fini par trouver un boulot, mais j'étais quand même passé près de la cloche. C'était une expérience… Quand je me suis retrouvé à Paris, c'était le Paris des clochards, le Paris des soupes populaires, du chômage, y avait pas de boulot. Au fond, à l'époque, c'est comme si j'avais dû réviser mes principes. Je n'ai pas touché au marxisme, mais je m'intéressais au parti des bolchos, des vestes de cuir, je lisais L'Huma. Il faut dire que je ressentais un grand malaise dans les quartiers d'Auteuil, le grand bourgeois entrant dans son auto, tout ça... Mieux vaut pas trop ressentir les choses en prolo révolté, quoi, mais enfin, à l'époque, c'était un peu comme si j'étais battu... Pas par l'objection de conscience mais par le grignotage, qui ne prévoyait pas les crises cycliques ! Apparemment, donc, il n'y avait que l'action révolutionnaire. À l'époque, j'avais retrouvé à Lyon, dans l'entourage de Malespine, Pierre Laurent Darnar, journaliste à L'Huma du temps de Gabriel Péri. Il était devenu bolcho. Je sentais que je me rapprochais. Et puis j'en avais marre, j'avais sept ans d'illégalité, ça devenait gênant. Alors j'avais décidé qu'un jour je me rendrais aux autorités et que j'apprendrais à me servir d'une mitrailleuse...
Il y avait les meetings, il y avait L'Huma. Quand je suis rentré à Paris, j'ai retrouvé ma compagne. Elle était chômeuse et vivait dans un petit meublé où je ne pouvais pas rester parce que le concierge m'aurait repéré. Le copain qui m'avait préparé des papiers vivait aussi à Paris ; j'avais donc une double identité à la même adresse. Comme il fréquentait un cours à la CGT, un cours sur le marxisme, il y rencontra un gars qui s'appelait Bertholet, un Suisse qui appartenait à un mouvement à part, un petit mouvement socialiste. Il habitait Bourg-la-Reine dans l'atelier d'un sculpteur allemand qui s'appelait Ilmari. En 1933, Ilmari était parti faire la révolution en Allemagne. Un soir, Bertholet m'annonça qu'Hitler venait d'être élu chancelier. Deux mois plus tard, il y avait une forte campagne pour exiger la libération de Thälmann, le chef communiste.
Mais enfin, tout ça ne change pas mon truc. À Nice, j'avais fait une sorte d'expérience de rêve éveillé, de marches nocturnes, des tas de trucs, je rêvais... Quand je me suis retrouvé à Paris, je bossais mais je vivais aussi un moment de dépassement, une illumination, tout d'un coup. C'est comme si j'avais été rattrapé par la marche de l'histoire. En même temps, à Paris, petit à petit, je sentais que je me ratatinais, que je rentrais dans la tristesse. Un jour, j'ai décidé d'aller me promener : j'ai fait un tour à pied des champs de bataille de Verdun ; je cherchais toujours l'équilibre, les raisons d'être, les raccords. Le sentiment de la vie, c'est le sentiment d'un manque. Je pourrais dire que j'étais très malheureux, en tout cas que je n'étais pas heureux… Il y avait la vie dans ce qu'on pourrait appeler le rapport aux choses profondes et la vie ordinaire : le chômage, l'évolution idéologique. Un jour j'ai décidé que ce serait en hiver que je me rendrais de préférence. Pour être franc, je ne me suis pas rendu pour des raisons idéologiques. Avec ma compagne, la vie était devenue un peu difficile. Un soir de paye, je rentrais et il n'y avait ni haricots ni carottes cuites ; j'ai dit des mots, ce fut une scène de ménage. J'ai foutu tous mes poèmes au feu ; tout ce que j'avais, je l'ai foutu au feu. Et je me suis dit qu'en taule je deviendrais fou, mais que j'échapperais au reste. Enfin, il se passa toujours autre chose que ce qu'on avait prévu, mais c'est comme ça que je me suis rendu.
Entretien avec Georges NAVEL, avril-mai 1975
[Source : Les Révoltes logiques, n° 1, quatrième trimestre 1975].
[1] À contretemps, L'Écriture et la Vie. Trois écrivains de l'éveil libertaire : Stig Dagerman, Georges Navel, Armand Robin, Les Éditions libertaires, Chaucre, 2011, 336 p.
[2] Le socialiste Albert Thomas (1878-1932), partisan de l'Union sacrée, était, depuis septembre 1914, en charge de coordonner les chemins de fer, l'État-Major et le ministère des Travaux publics. Il démissionnera de sa fonction en septembre 1917.
[3] Le 21 mars 1919 fut proclamée la République hongroise des conseils, qui s'effondra le 6 août.
[4] Émile Malespine (1892-1952), médecin psychiatre et fondateur, en 1925, de Manomètre, revue surréalisto-dadaïsante lyonnaise, noua une relation d'amitié avec Navel et lui publia son premier poème. Le jeune Navel suivait avec beaucoup de constance et d'intérêt les cours que Malespine donnait à l'Université syndicale de Lyon sur « Esthétique et psychologie ».
[5] Équivalent de la Légion étrangère.
05.05.2025 à 07:32
Anselme ou la question manquante
F.G.
Anselme Plisnier n'aimait pas attendre. J'avais été prévenu : le moindre retard, même minime, le mettait hors de lui. Or, ce jour, malgré la grande marge que je m'étais octroyée, je me perdis lamentablement dans le dédale banlieusard avant de trouver ce coin paumé où il créchait. Il faisait de surcroît un temps de chien et le trajet sur ma bécane m'avait réservé quelques mauvaises surprises. C'est vrai que l'engin tenait de l'antiquité. Quand j'avais appris d'un anarchiste espagnol de (…)
- Passage des fantômesTexte intégral (4376 mots)

Anselme Plisnier n'aimait pas attendre. J'avais été prévenu : le moindre retard, même minime, le mettait hors de lui. Or, ce jour, malgré la grande marge que je m'étais octroyée, je me perdis lamentablement dans le dédale banlieusard avant de trouver ce coin paumé où il créchait. Il faisait de surcroît un temps de chien et le trajet sur ma bécane m'avait réservé quelques mauvaises surprises. C'est vrai que l'engin tenait de l'antiquité.
Quand j'avais appris d'un anarchiste espagnol de l'armée des ombres que l'Anselme habitait Deuil-la-Barre, ça m'avait fait sourire. Drôle de nom pour quelqu'un qui, aux dires de notre ami commun – Juanel, l'anarchiste en question – avait risqué cent fois sa vie du temps de la Résistance, qu'il avait faite dans les rangs de la Main-d'œuvre immigrée (MOI).
À ma montre, j'avais une bonne demi-heure de retard quand j'agitai la clochette de la « Villa des cyprès », ça ne s'invente pas. Pour sûr, ça sentait vraiment le cimetière, ici ! Du perron, son hôte, gapette vissée sur le crâne, me fit signe de pousser le portail. Je lui trouvai la mine peu avenante. À mes excuses pour le retard, la réplique fusa : « L'heure, c'est l'heure, mon petit camarade. Il fut un temps où ça se jouait à la seconde près. » La suite fut encore plus nette : « Oui, gamin, la vie exigeait, pour ne pas la perdre, d'être ponctuel aux rendez-vous. » J'étais bien chez Anselme Plisnier, nom de résistance de Max Minczelez, casquettier de profession.

À l'intérieur, le bordel frisait le génie. « Fais pas attention, avait lancé l'Anselme en poussant la porte d'entrée du château, je vis en vieux garçon depuis belle lurette. » La cuisine relevait du plus parfait capharnaüm. La visite n'était pas prévue, mais le vieux terroriste à la retraite me fit faire halte pour activer sa bouilloire. « Tu comprends, on va monter à l'étage et, une fois calé dans mon fauteuil, j'ai la flemme de redescendre. Or le thé, petit, c'est ma drogue, j'en bois plus d'un litre par jour, comme Bakounine. Ça me réchauffe le corps et l'âme. » Du coup, je pouvais profiter du point de vue, et c'était pathétique : des assiettes sales en pile, des bouteilles vides encombrant une table branlante, une gazinière d'avant le déluge. Même dans les communautés les plus cradingues que j'avais fréquentées du temps de la grande migration campagnarde de l'après-68, je n'avais jamais connu ça. Et mon étonnement devait être visible puisque l'Anselme se crut obligé de me rassurer : « Te bile pas, c'est mieux rangé ailleurs. » À condition de fermer les yeux, n'allais-je pas tarder à constater… Quand la bouilloire siffla, mon hôte versa sans trembler son contenu dans une thermos, chercha sa boîte à thé noir, deux verres à anse, un paquet de gâteaux secs entamé et carra le tout sur un plateau décoré de foireux motifs japonais. Il me mit le tout dans les mains et organisa la manœuvre. « Tu prends l'escalier à droite et tu montes au premier. C'est la porte en face. Tu entres et tu t'installes. Deux trois choses à terminer et je te rejoins. » J'obtempérai aux ordres de l'Anselme.

Sur la porte, un carton punaisé indiquait « Atelier ». Et ça y ressemblait. Au sens fourre-tout. L'espace était tellement encombré que je ne voyais pas où poser le plateau. Par bonheur, il restait une place. Une vingtaine de minutes plus tard, c'est la voix d'Anselme qui m'arriva en premier : « Mais merde, t'es où ? », claironnait-elle. La porte fut ouverte avec vigueur : « Je t'ai dit en face, pas à droite. En face, c'est à côté. » La situation avait quelque chose de surréaliste. L'Anselme s'empara du plateau et, d'un signe de tête, me désigna la sortie, non sans ajouter un commentaire de son cru :
– Finalement, t'es aussi mauvais dans la ponctualité que dans le repérage, pas vrai ?
– Vrai, camarade, j'ai beaucoup de choses à apprendre. C'est d'ailleurs pour ça que je suis ici.
Ma réponse fit mouche.
– Te bile pas, gamin, tout s'apprend, même le pire.
À côté, c'était mieux, mais spartiate. Un fauteuil, une table basse et des étagères croulant sous le poids des livres. Anselme posa le plateau sur la table et se cala dans son fauteuil à oreilles. Je cherchais en vain une chaise.
– Y'en a une à côté, me dit l'Anselme.
– Par terre, ce sera bien.
– C'est bien de vivre un peu à la dure, ça forge le caractère. Alors, c'est Juanel qui t'a rancardé sur moi ?
– Oui, il m'a dit que tu aurais peut-être des choses à me raconter…
– Dans quel cadre ?
– Disons que je recueille des témoignages sur les combats passés et que je les collectionne avec l'idée d'en faire quelque chose.
– Un mémorial ?
– Non pas vraiment, ce n'est pas mon genre.
– Et ça t'est venu comment d'archiver la mémoire des défaites ?
– D'une passion pour les combats les plus beaux, ceux qu'on perd.
La réplique plut à l'Anselme. Ce coup-ci, son sourire était différent, plus tendre.

Cette première rencontre avec Anselme Plisnier devait me permettre d'établir le contact. C'était ma méthode. Il me fallait d'abord faire lien, tisser une relation de confiance. C'est à cela que je pensais quand l'Anselme me harponna :
– Alors, que sais-tu de moi si ce n'est pas indiscret, que t'as raconté Juanel ?
J'avoue que je fus déstabilisé par la hardiesse de l'Anselme. En général, on laisse venir. Lui prenait les devants. Je compris vite que je n'étais pas le seul à tester l'autre.
– En vrac, je sais que, dès le début de la guerre d'Espagne, tu as rejoint le bataillon international de la Colonne Durruti sur le front d'Aragon ; que tu as été rapatrié en 1937 en France à la suite d'une blessure grave ; que, contre toute attente, tu as adhéré par la suite au PC et, plus précisément, à la MOI ; que tu as eu une intense activité de résistance dans Paris occupé ; que, pour échapper aux nazis et aux staliniens qui, les premiers, te traquaient comme juif communiste et, les seconds, comme renégat trotskiste, tu eus la chance de te sortir de ce double piège en quittant Paris et, après bien des aventures dont j'ignore les détails, de rencontrer Juanel qui te cacha dans sa cabane ariégeoise de berger, qui elle-même servait de refuge et de base arrière aux guérilleros anarchistes espagnols qui luttaient contre Franco. Voilà, c'est tout.
– C'est déjà pas mal, constata l'Anselme, la mine réjouie.
– Oui, mais pas assez pour qui s'intéresse aux détails ?
– Oh ! les détails, c'est ce qui part en premier. Après tout, une vie n'est qu'une vie. Ça tient en peu de lignes sur un faire-part. Je parle des vies ordinaires, celles des « bas de casse », comme on dit en typographie pour désigner le casier des lettres minuscules. Le tableau que t'a fait Juanel est assez juste, mais – hésita-t-il avant de poursuivre –, entre les faits, au cœur des décisions, il y a des nœuds, des mystères qui font effectivement détails, si précisément détails que le passage du temps rend leur remémoration, et a fortiori, leur élucidation difficile, voire impossible.
Sa réponse me déconcerta :
– Alors, on fait quoi ?
– On fait connaissance, camarade, on parle… On parle, ça veut dire qu'on échange, qu'on ouvre un chemin. Je commence, si tu veux : ça te vient d'où cette manie de traquer les vieux et les dernières vérités qui leur restent ? Hein ? Tu peux brancher ta machine, si tu veux…

L'Anselme avait marqué un point. J'étais pris à mon propre piège. Touche « on » enfoncée, je n'avais plus qu'à me lancer à l'eau :
– C'est la première fois qu'on me demande mes motivations. Je vois ça comme un retournement de situation, mais je ne m'y dérobe pas. J'ai vingt-quatre ans, je suis fils d'anarchistes espagnols, j'ai fait quelques études d'histoire et je préfère fréquenter les vieux de ton âge que les jeunes du mien… Ils m'apprennent davantage.
– J'espère que ce n'est pas une règle générale, que tu t'accordes des exceptions, parce que les vieux c'est chiant, ça radote, ça pontifie. Moi, c'est exactement le contraire : les vieux m'emmerdent tous. Ils puent la mort. Alors, si j'ai bien compris, c'est la défaite qui te fascine. La double défaite des vieux révolutionnaires, en particulier, qui ont connu le ravage de leurs idéaux et qui éprouvent, pour finir, celui du temps qui passe…
– Je ne le dirais pas comme ça…
– Comment, alors ?
– Je dirais qu'il y a des défaites préférables aux victoires et des combats perdus qui maintiennent vivante la flamme de la révolte nécessaire contre l'ordre du monde. Je sais, c'est un peu grandiloquent, mais c'est ainsi que je vois les choses. Vous, vous êtes des passeurs d'histoires. Nous, nous les enregistrons. C'est une manière de maintenir la mémoire vivante, de ne pas en perdre le fil…
– Et ce « nous », c'est qui ?
– Au choix, un groupe affinitaire ou une bande organisée.
– Les deux me conviennent. Commençons…
– Par quoi ?
– Le début, le milieu, la fin, comme tu veux…
– Qu'est-ce qui fait sens, à tes yeux, dans cette aventure ?
– Quelle aventure ? Ma vie ou ce que je suis disposé à t'en raconter ?
– L'aventure de l'enregistrement, dans un premier temps. Je connais des témoins qui hésitent longtemps, qui tournent en rond, d'autres qui posent des conditions, qui souhaitent décider de ce qui est utilisable ou pas, qui exigent un droit de regard. Là, on discute tous les deux à bâtons rompus. Tu cherches d'abord à comprendre ce que je fabrique, quelles sont mes intentions et, d'un coup, tu te lances. C'est inhabituel, original, inattendu. J'aimerais comprendre…
– Disons que je suis un personnage singulier et que, l'âge venant, j'ai commencé à voir ma vie comme un tout, avec des cohérences et des contradictions, des fidélités et des ruptures, toutes choses que j'assume entièrement. Qu'on s'intéresse à mon parcours, c'est flatteur, mais je ne souhaite pas te faciliter la tâche en te donnant un fil à saisir. C'est à toi de le trouver. Et, pour ce faire, il te faudra te fier à ta seule boussole. Si elle te mène à des fausses pistes, tu t'en rendras vite compte… Quant à la raison de mon acquiescement à ton offre, elle est simple : ma vie m'emmerde, ma vie actuelle je veux dire, celle de la longue attente d'une fin qui, à coup sûr, ne sera pas brillante. Voilà, c'est pas plus compliqué que cela. Pour un temps, me suis-je dit, il se passera quelque chose dans mon existence, ce qui n'est pas rien. Et puis, étant d'un naturel curieux, il n'est pas exagéré de te dire que, n'ayant pas eu beaucoup d'occasions de vérifier ce que la nouvelle génération de révolutionnaires soixante-huitards a dans le crâne, c'eût été lamentable de rater celle que tu m'offrais, mon jeune camarade. À toi, donc, de m'instruire sur tes capacités à démêler mes embrouilles militantes…
– C'était quoi la révolution pour toi quand tu avais mon âge ?
– D'abord, j'étais plus jeune que toi et, ensuite, ça dépendait du moment et des circonstances. Sur le front d'Aragon, à l'été et à l'automne 1936, c'était du palpable, un devenir présent. Du Paris occupé de 1942, le souvenir qui me reste, c'est la sensation d'extrême bonheur intérieur que je ressentais après chaque action armée contre les nazis, un bonheur concret, tangible. Il n'y avait rien de commun, bien sûr, entre ces deux moments d'histoire, sauf précisément ce sentiment et l'idée que nous étions dans le vrai – ou dans le sens de l'histoire, comme on disait alors. Et nous l'étions sans doute, même si, aujourd'hui comme hier, des démocrates nous disent qu'on ne construit rien à partir de la violence. En clair, ils cherchent surtout à nous effacer de leur histoire pacifiée. À vrai dire, je ne sais pas si une révolution est encore possible, mais ce dont je suis sûr c'est qu'il faut toujours situer l'espoir révolutionnaire en dehors des idéologies qui l'alimentent, mais qui toujours s'arrangent pour le contrarier au nom du principe de réalité…
Je n'eus pas l'occasion de commenter. L'Anselme s'était levé de son fauteuil. Déjà sur le seuil de la porte, il se contenta d'exprimer son intuition du moment : « C'est l'heure de la graille, camarade, je commence à avoir les crocs. Je vais nous préparer un petit fricot. »

Cette première rencontre avec Anselme Plisnier fut suivie de beaucoup d'autres, à rythme rapproché, puis plus espacé. Quand j'étais indisponible, il m'appelait pour m'engueuler. « Alors, lassé, camarade ? » J'avais beau lui expliquer qu'il y avait des impondérables, des charges dans la vie. L'Anselme ne voulait rien comprendre. « L'impondérable pour moi, c'est le temps qui passe, gamin, et la mémoire qui part en quenouille. » Au vrai il exagérait, il avait plus de mémoire que moi. « Mais toi, on se fout, disait-il, à ton âge c'est normal, les souvenirs encombrent peu. » Sur ce point il avait raison, c'est même pour ça qu'on s'intéresse à ceux des autres, pour s'en nourrir, pour se les approprier.
Chaque rencontre avec lui avait quelque chose de singulier, de troublant, de suspensif. Ça tenait à sa méthode discursive, à sa capacité de déstabilisation, à la manière dont il savait ne répondre qu'aux questions que lui-même se posait. Un jour, je le lui ai fait remarquer.
– Bah, oui, camarade, c'est toujours la question manquante que je traque, celle qui ne vient pas ou qu'on n'ose pas énoncer. Sans doute parce que la poser pourrait avoir des conséquences et que tenter d'y répondre engagerait trop de ce qu'on a été ou pas été. Tu n'y es pour rien, d'ailleurs, tes questions sont excellentes. C'est dans ma tête que ça se joue, et pas parce qu'elle serait devenue une passoire, mais parce que l'exercice de remémoration auquel tu me soumets a, chez moi, des effets prolongés.
– Tu peux me dire lesquels ?
– Non, à question manquante, réponse manquante… Te bile pas, je rigole. Ce que je peux te dire, c'est que, depuis qu'on se connaît, depuis que Juanel a eu l'idée de te mettre dans mes pattes, ce sont précisément ces questions qui me taraudent et qui me font passer quelques nuits blanches, moi qui dormais comme un bébé. Alors, j'écris. Je noircis des pages, je m'auto-analyse comme on dit, ce qui n'est pas de tout repos quand on essaye de jouer le jeu. Tu dois savoir que l'image que renvoient les vieux révolutionnaires est toujours fausse, car retouchée par la mémoire collective des défaites et les mythes qu'elles fondent. Sur le front d'Aragon, j'ai vu un compagnon éclater en sanglot parce que Durruti l'avait chargé de garder, durant la nuit, un jeune prisonnier fasciste, un gamin de seize ans, qui devait être fusillé le lendemain. Ce sont les larmes du môme, ses implorations, qui l'ont fait craquer. Il a ouvert la porte et lui a dit de se casser. La question manquante, c'est comment on agit, en révolutionnaire je veux dire, dans ce cas-là. Avant de libérer le gamin, le compagnon m'a demandé mon avis. Je lui ai conseillé de ne pas prendre cette responsabilité. Il n'en a pas tenu compte. Aujourd'hui je crois qu'il a eu raison, mais je ne suis pas sûr d'avoir raison de le croire. Car rien ne dit que le môme, quinze jours plus tard, n'a pas repris les armes contre nous. La question manquante, c'est souvent une question éthique.
– Et comment a réagi Durruti ?
– Comme il fallait, en sermonnant le gardien défaillant et en lui demandant de quitter la colonne. Sans plus. Autrement dit en anarchiste discipliné, mais pas en chef de guerre. J'ai compris là, moi le bundiste de formation, que la qualité morale de l'anarchisme espagnol lui conférait sa force, mais aussi sa limite. Parce qu' « une révolution n'est pas un dîner de gala », comme disait Mao, qui s'y connaissait en immoralité.
– J'imagine que tu as été particulièrement exposé à cette question manquante – celle de ce qu'on peut faire ou ne pas faire – pendant ton expérience résistante à Paris dans les rangs de la MOI ?
– Non, pas une seule fois. D'abord parce que nous ne décidions pas des actions à exécuter et, ensuite, parce que nous étions en guerre totale contre les nazis. Je te l'ai déjà dit, et je le répète : j'éprouvais un sentiment de bonheur personnel à tuer le maximum de nazis et de collabos. La cause était claire, limpide. Elle ne suscitait aucun état d'âme, aucun remords, jamais. De la peur, oui ; du doute, jamais. À la fin de la guerre, la MOI me proposa de me mettre au vert quelque part à travers un réseau du Parti. C'était juste après les exécutions de Manouchian et de ses camarades. Pour moi, le Parti c'était fini. Il nous avait non seulement envoyé au casse-pipe, mais trahi. C'est là que Juanel, que j'avais connu à Barcelone, me proposa de le rejoindre à Boussenac, village ariégeois où il avait sa base. « Tu seras mieux avec nous », m'avait-il dit. Il avait raison. Nous, c'était un groupe de maquisards anarchistes espagnols. En août 1944, des éléments d'un bataillon de marche allemand, formé à Saint-Gaudens et se dirigeant vers la vallée du Rhône, incendièrent le village de Rimont et se livrèrent, le 21, à un véritable carnage. Il est vrai que, sur le chemin, le maquis FTP de La Crouzette en avait dézingué quelques-uns. À Rimont, je connaissais un type admirable, Jean Alio, un instituteur d'une trentaine d'années, qui était devenu mon ami. Il fut dans la liste des fusillés d'office et sa femme fut violée par la soldatesque. Deux jours après, avec Juanel et quelques maquisards espagnols, nous nous sommes rendus au village pour constater les dégâts. Tout était brûlé. Au retour, dans un fossé, à l'orée d'un petit bois, nous avons entendu crier « Hilfe ! » (Au secours !). C'était un très jeune gars que la troupe avait abandonné dans le fossé. Je l'ai regardé, j'ai armé mon flingue et je l'ai abattu. « T'as raison, m'a dit Juanel, il était en train de se vider de son sang. » « Non, je ne l'ai pas achevé pour ça, par bienveillance, mais parce qu'un bon nazi est un nazi mort », ai-je répliqué. « Mais qui te dit qu'il était nazi ? La colonne, c'était une colonne de la Wehrmacht, pas de la Waffen-SS… » Voilà un bon exemple de ce qu'est une question manquante.

Nos rencontres se poursuivirent pendant presque deux ans, toujours à Deuil-la-Barre. Jusqu'au jour où l'Anselme me fit savoir qu'il en avait assez dit. « Trop, même », ajouta-t-il. C'était un jour sans âme, d'hiver sans lumière, de neige sale. Je manifestais mon désaccord, mais en sachant d'avance que je ne le convaincrais pas. Quelque chose s'était passé que je n'avais pas prévu. Nous nous séparâmes sur un silence suspensif. Je lui demandais de réfléchir. Il acquiesça à ma proposition, même si j'étais sûr que sa décision était prise. Et puis rien.
Quelques mois plus tard, Juanel m'appris sa mort. « Il se savait malade, m'a-t-il dit, très malade. Il n'en avait parlé qu'à moi et ne voulait pas que ça se sache. » Il ajouta qu'il avait quelque chose à me transmettre de sa part, un paquet que lui avait confié l'Anselme la dernière fois qu'ils s'étaient vus, deux jours avant son décès. Ce quelque chose, c'était une liasse de quinze cahiers d'écolier entièrement noircis, marges comprises où, d'une écriture nette, méticuleuse, expressive et sans rature, il y consignait les réflexions, les interrogations et les repentirs que nos discussions lui avaient suggérés.
C'est lui – Max Minczelez, alias Anselme Plisnier – qui parle, désormais :
« Il y eut quelque chose de bouleversant à avoir face à soi comme interlocuteur un jeune gars qui se consacre à recueillir des bribes de mémoire des anciens combats. Non pour les glorifier, mais pour en révéler l'essentielle vérité : il existe des moments dans l'histoire où un processus révolutionnaire – comme celui que j'ai connu en Espagne à l'été 1936, dans le cadre d'une guerre civile entre fascistes et républicains – et une résistance antifasciste armée – comme celle que mena la MOI, où j'ai apporté ma part, contre les occupants nazis –, tissent des liens de fraternité si intenses qu'ils fondent en eux-mêmes une autre manière d'appréhender le genre humain. Dans la défaite – comme celle que subirent les républicains espagnols –, il reste l'idée que le jour viendra de la revanche. Dans celui de la victoire – celle des Alliés contre Hitler –, le retour à une normalité de paix civile efface plus ou moins vite des mémoires les raisons du combat. On s'y fait, bien sûr. On oublie même, le temps passant, ce qui s'est joué d'authentique du temps de la lutte à mort contre le nazi-fascisme et pour la révolution sociale. Quand Juanel, mon compagnon de toujours, mon ombre tutélaire, m'incita à répondre à la sollicitation de ce jeune gars, fils d'anarchiste espagnol, qu'il connaissait, je n'ai pas hésité longtemps. Je savais qu'il ne fallait pas tarder. Aujourd'hui, c'est à lui que je dédie ces notes écrites à la va-vite. »
C'est sur ses mots que se concluait le quinzième cahier de La Part du sable. Car tel était le titre que l'Anselme avait choisi pour ces notes et commentaires. « Peut-être parce que tout finit par s'ensabler dans l'oubli », avança son indéfectible Juanel alors que, un jour sans ciel, lui et moi revenions du cimetière municipal de Deuil-la-Barre où l'Anselme fut enterré. « Peut-être, dis-je à Juanel, mais moi j'ai une autre explication et elle me semble évidente. Je vois dans ce titre un hommage à Georges Henein, dont l'une des revues qu'il anima portait ce titre. La « part du sable », pour lui, c'était celle de l'instant, de la rencontre, de la connivence et de la conversation. Et c'est exactement, je crois, ce que l'Anselme et moi avons vécu ensemble : des instants, des rencontres et des conversations conniventes. Juanel avait une moue dubitative.
– C'est une explication d'intellectuel…
– Peut-être, mais je n'en démords pas.
Quelques semaines plus tard, je reçus de lui un appel téléphonique.
– Tu as peut-être raison, compañero. Je viens de m'acquitter d'une mission que m'avait confiée l'Anselme : vider sa bibliothèque et la distribuer à tout-vent à qui lisait encore. Et dans ses piles de livres, je suis tombé sur une plaquette sur ton Georges Henein. Je te la mets de côté ?
Freddy GOMEZ
- GÉNÉRALISTES
- Ballast
- Fakir
- Interstices
- Lava
- La revue des médias
- Le Grand Continent
- Le Monde Diplo
- Le Nouvel Obs
- Lundi Matin
- Mouais
- Multitudes
- Politis
- Regards
- Smolny
- Socialter
- The Conversation
- UPMagazine
- Usbek & Rica
- Le Zéphyr
- Idées ‧ Politique ‧ A à F
- Accattone
- Contretemps
- A Contretemps
- Alter-éditions
- CQFD
- Comptoir (Le)
- Déferlante (La)
- Esprit
- Frustration
- Idées ‧ Politique ‧ i à z
- L'Intimiste
- Jef Klak
- Lignes de Crêtes
- NonFiction
- Nouveaux Cahiers du Socialisme
- Période
- Philo Mag
- Terrestres
- Vie des Idées
- ARTS
- Villa Albertine
- THINK-TANKS
- Fondation Copernic
- Institut La Boétie
- Institut Rousseau
- TECH
- Dans les algorithmes
- Framablog
- Goodtech.info
- Quadrature du Net
- INTERNATIONAL
- Alencontre
- Alterinfos
- CETRI
- ESSF
- Inprecor
- Journal des Alternatives
- Guitinews
- MULTILINGUES
- Kedistan
- Quatrième Internationale
- Viewpoint Magazine
- +972 mag
- PODCASTS
- Arrêt sur Images
- Le Diplo
- LSD
- Thinkerview
- Fiabilité 3/5
- Slate
- Ulyces
- Fiabilité 1/5
- Contre-Attaque
- Issues
- Korii
- Positivr
- Regain