Lundi soir Lundi matin Vidéos Audios
27.10.2025 à 18:54
Un particularisme juif
dev
Texte intégral (8900 mots)

En parallèle des assassinats perpétrés par le proto-État Hamas et des crimes de guerre de l'État d'Israël [1], nous aimerions revenir sur ce qui se passe aujourd'hui à partir d'une tout autre problématique que celle de l'État, étant bien entendu que nous sommes, dans l'absolu contre tous les États, ceux existant et ceux à venir. C'est pourquoi nous partirons plutôt de l'idée de tension entre individu et communauté, parce que si nous avons perdu le communisme et même son idée (n'en déplaise à Alain Badiou), il nous reste ça de notre passé encore « présentable ».
Peuple ou communautés ?
Les Juifs ont présenté cette particularité d'être un ensemble de communautés, éventuellement un peuple, même si tous ne sont pas d'accord là-dessus. Par exemple, Shlomo Sand, dans Comment le peuple juif fut inventé [2], cherche à déconstruire ce qu'il pense être une historiographie juive fondatrice. Mais ceux qui liraient ce livre seulement pour se rassurer que le peuple juif n'existe pas, puisqu'écrit par un intellectuel juif, voyant là le moyen de légitimer à rebours la cause du peuple palestinien, qui, lui, existerait bien, seront premièrement déçus puisque Sand dit lui-même dans son livre : « Tout grand groupe humain qui se considère comme formant un “peuple”, même s'il ne l'a jamais été et que tout son passé est le résultat d'une construction entièrement imaginaire, possède le droit à l'autodétermination nationale » (p. 390) ; et deuxièmement font fausse route, parce que le peuple palestinien est lui aussi « inventé », si on le juge à l'aune de la « pureté ». Les Palestiniens se perçoivent comme un peuple, ils sont donc un peuple et, comme peuple, ils ne sont ni plus ni moins inventés que le peuple juif [3].
Le propos de Sand n'est pas de contester l'existence d'Israël, mais de réduire à néant sa prétention à une légitimité préalable de quelque nature que ce soit et particulièrement d'antériorité territoriale. Au mieux, elle ne pourrait s'entendre qu'a posteriori, comme l'expression d'une exceptionnalité historique et politique du fait de l'advenu de la Shoah, et non pas comme expression d'un particularisme national dont ils seraient les seuls, finalement, à ne pas pouvoir se prévaloir.
Mais au cours de leur histoire, ils n'ont pas formé un État, hormis dans l'Antiquité avec les royaumes de Judée et d'Israël, puis à nouveau à partir de 1948 et pas une nation car ils n'ont pas pu d'abord et voulu ensuite délimiter précisément un territoire, indétermination qui perdure encore aujourd'hui dans la pratique de l'occupation de territoires comme en Cisjordanie.
Mais revenons à l'origine religieuse. La forme communautaire juive perdure depuis plus de deux mille ans et a échappé à la destruction de l'État hébreu par les Romains sans que cela n'empêche le développement de communautés juives dans l'Empire romain. Elles participent tôt à un universalisme dont le monothéisme yahviste fut l'expression (il est le Dieu de tout le monde et non des seuls juifs). Ce n'est qu'après l'arrivée du messie que Dieu reconnaîtra son peuple comme le peuple élu. À l'origine, on était juif parce que membre de la communauté et même si elle connaissait des différenciations de statuts et une catégorisation en groupes donc des privilégiés et des non privilégiés, l'antagonisme des classes reste embryonnaire sous la couverture communautaire qui la subsume et aussi dans la mesure où les juifs vivent relativement en marge, au moins dans les sociétés féodales et jusqu'au XIXe siècle. Spinoza, par exemple, mettait en avant la notion de « peuple élu » non pas en tant que peuple supérieur par essence ou de par sa religion mais en raison d'une structure sociale et d'une législation hébraïque multiséculaire qui faisaient du peuple une seule entité jamais dominée par une classe de propriétaires, et combattant (par l'intermédiaire d'un peuple armé en permanence) pour une terre qui ne faisait pas l'objet d'une appropriation privative définitive, mais pouvait être redistribuée au moment du jubilé [4]. En tout cas, il y a une confrontation dialectique présente dès l'origine entre particularisme et universalisme [5]. Les juifs européens étaient peu incités à se fondre dans la société environnante avant les Lumières (les ghettos de l'époque féodale). Par ailleurs, cette perspective ne les tentait pas vraiment, d'autant qu'ils vivaient concentrés dans la partie la plus arriérée économiquement et culturellement du continent, entourés de paysans analphabètes (alors que la plupart des hommes juifs, eux, savaient lire) et que la Torah leur avait enjoint de se tenir à l'écart des peuples « idolâtres » (qualificatif qui s'étendait pour eux à l'art représentatif chrétien et à la notion même de Sainte Trinité, jugée polythéiste). C'est la modernité qui les a placés devant le choix de rejoindre ce nouveau courant des Lumières, fondant leur universalisme d'origine dans un autre (à l'image de Mendelssohn) ou, à l'inverse, de renforcer et/ou renouveler leurs propres traditions sur le modèle hassidim. Moses Mendelssohn (1729-1786) est le plus grand représentant de la Haskala, les Lumières juives. Pour lui, le mouvement émancipateur ne doit pas conduire à l'assimilation, mais à l'intégration, des notions encore actuelles, mais qui ne concernent plus vraiment les Juifs. Un processus dialectique qui doit produire une dynamique intégrants/intégrés et c'est tout le travail de l'Europe des Lumières que de le piloter et la Révolution française essaiera de le réaliser. En tant que philosophe juif et allemand, il veut remplacer les deux langues véhiculaires habituelles des communautés juives en un langage commun, l'allemand avec le projet de traduire les textes religieux de référence dans cette langue. Et d'ailleurs ce judaïsme réformé ne se développa progressivement qu'en Europe occidentale et particulièrement en Allemagne donnant lieu à une réaction du judaïsme orthodoxe.
LE MESSIANISME JUIF ET SON CARACTERE CONTRARIE DANS L'HISTOIRE
La position originale de Moses Hess et plus généralement la question de la communauté
Dans Rome et Jérusalem (Albin Michel, 1981), ce co-auteur, certes secondaire, de L'Idéologie allemande part du communisme pour aller vers l'émancipation de toutes les « races » opprimées (p. 58) — l'histoire ne se réduisant pas à celle des luttes de classes — et donc l'établissement d'une démocratie socialiste en Palestine, la « nouvelle Jérusalem ». En effet, la réalisation du messianisme juif lui paraît compatible avec l'idée de nation juive. Il refusait l'opposition entre universel et particulier et l'État ne pouvait pas être la synthèse qui dépasserait cette opposition ; il n'était qu'un moyen, une médiation vers autre chose, vers la communauté. Or la communauté juive, de par son mode de vie diasporique en marge, avait maintenu un caractère d'autonomie par rapport aux sociétés dans lesquelles elle était confinée : les communautés juives avaient conservé leurs propres structures d'autorité (l'organisation communautaire locale) et leur différence culturelle et religieuse. Cela ne pouvait que les aider à accomplir leur « destin ». Pour cela il fallait refuser la Réforme rationaliste à laquelle adhérait Marx parce qu'il déniait au peuple juif tout caractère d'historicité, réforme qui s'avérait de nature assimilationniste [6].
Il ne faut donc pas opposer individu et communauté, l'homme social reproduisant à la fois son individualité et sa communauté comme le dira Camatte (Invariance, série I, no 4).
Max Weber reprend cette idée d'une prédisposition juive au messianisme avec la conception d'une « révolution future d'ordre politique et social sous la conduite de Dieu ». Ce messianisme juif serait le pendant du millénarisme chrétien et d'après Karl Mannheim (Idéologie et utopie) on trouverait une sorte de synthèse de ces deux mouvements en la personne de Gustav Landauer, l'anarchiste juif qui sera un des dirigeants de la Commune de Munich en 1919. Une synthèse que G. Lukács a qualifiée « d'athéisme religieux » mêlant références juives et chrétiennes à des références proprement révolutionnaires. Plusieurs de ces dirigeants, juifs aussi, auraient été pénétrés de la conscience d'appartenir à un messie collectif (cité par M. Löwy dans Rédemption et utopie, PUF, 1988). Ce messianisme [7] juif, comme l'anarchisme d'ailleurs, est empreint d'éléments utopistes « progressistes » et d'éléments restaurateurs, en l'occurrence de romantisme pré-capitaliste pour les Juifs, de références à la communauté paysanne et à l'artisanat pour les anarchistes. Par exemple, Martin Buber adhère à un cercle « La nouvelle communauté » et il y prononce une conférence intitulée « La nouvelle et l'ancienne communauté » dans laquelle il distingue l'ancienne qui serait « pré-sociale » car fondée sur la parenté de sang ; alors que la nouvelle serait « post-sociale » car résultat d'affinités électives et tend à englober l'espèce tout entière… et le cosmos, rajoutera Landauer. Là aussi on retrouve nouveau et ancien puisque cette nouvelle communauté est aussi critique de la vie urbaine et retour à « l'unité vitale de l'homme primordial » mais à un degré plus élevé que dans l'ancienne communauté (Löwy, op. cit., p. 64).
On a ici un raisonnement proche, mais aussi peu fondé, que celui du communisme primitif de Marx. Non pas revenir en arrière donc, mais dépasser par l'action consciente et atteindre à une nouvelle organicité qui remplacerait la « mécanique » interactive des sociétés modernes. Ce dépassement n'est pas le fait d'une progression et encore moins d'une recherche du progrès, mais la perspective de convoiter l'impossible, un monde libéré du mal et donc de la nécessité de la contrainte. Là encore un point commun avec l'anarchisme. Dans l'ère messianique, il se produira un dépassement dialectique de l'État dans une forme supérieure de société composée de l'association libre de communautés. Ainsi s'établit un rapport entre religion et utopie. Mais Buber est aussi influencé par les exemples concrets de la Commune de Paris et du mir russe (une communauté paysanne locale autonome) dans lequel Marx avait cru voir une possibilité pour la Russie paysanne de sauter la phase bourgeoise, comme en attestent ses échanges avec Vera Zassoulitch à la fin de sa vie.
En 1934, à Francfort, Buber prononce une conférence où il dit (source : Löwy, p. 71) : « La Gemeinschaft est une catégorie messianique, non historique. En tant qu'historique, elle indique son caractère comme messianique » et il souligne que les soviets sont des communes authentiques sur lesquelles aurait dû se construire « l'être communautaire révolutionnaire ». Cela ne pouvait que l'amener à s'opposer à l'idéologie sioniste en tant qu'idéologie particulière d'un État.
Ce double caractère disparaîtra après la Seconde Guerre mondiale malgré certaines traces au sein des premiers kibboutz. En Israël comme en Europe, une immigration massive de juifs orientaux ou originaires du Maghreb rendra minoritaires les références, souvent intellectuelles d'ailleurs, au Yiddishland et renforcera les éléments restaurateurs. Löwy signale aussi que ce Yiddishland ne touchait que l'Europe centrale et surtout les intellectuels, très peu l'Europe occidentale avec les juifs rationalistes et assimilationnistes français et pas l'Europe orientale, où un prolétariat juif était plus important et adhérait aux partis sociaux-démocrates ou au Bund, l'organisation socialiste spécifiquement juive et ensuite à la révolution russe, stalinisme inclus.
Mais selon G. Scholem (Le messianisme juif, Calmann-Lévy, 1974, p. 31), le messianisme juif se distingue du millénarisme chrétien par le fait qu'il se déroule sur la scène concrète de l'histoire. « Le messianisme juif est dans son origine et dans sa nature — on ne saurait jamais assez y insister — une théorie de la catastrophe. Cette théorie insiste sur l'élément révolutionnaire, cataclysmique dans la transition du présent historique à l'avenir messianique ». « La rédemption signifie une révolution dans l'histoire » (cité par Löwy, op. cit., p. 27), un saut vers l'avenir en rupture avec le caractère « unidimensionnel » (Marcuse) du temps quantitatif, avec ce « progrès régressif » (Adorno). À noter que ce caractère révolutionnaire catastrophiste qui relie Adorno, Benjamin, Bloch et Marcuse les rapprochent des penseurs irrationalistes, même s'ils n'en tirent pas les mêmes conclusions politiques, et les exposent par ailleurs aux risques d'une assimilation entre utopie et totalitarisme.
Une autre vision originale, celle d'Ernst Bloch
Elle est marquée par de nombreuses influences d'auteurs juifs comme l'anarchiste Gustav Landauer (La révolution, Champ Libre, 1974), qui bâtit une théorie du rôle messianique des juifs dans l'Histoire mais qui comme Bloch sera attiré par un médiévalisme romantico-chrétien qui oppose cette civilisation de l'esprit à l'époque moderne, caractérisée par la montée de la puissance de l'État. Pas question donc pour Bloch de partir de la critique hégélienne ou « jeune hégélienne » de la religion d'où découlent tous les a priori sur la place spécifique des juifs dans l'histoire. On peut dire au contraire qu'il inverse la démarche de ces prédécesseurs en partant du messianisme juif qui exprimerait un ferment révolutionnaire intrinsèque à cette religion. Il lui permet aussi de faire pièce au rationalisme de son maître Weber et son idée d'une éthique neutre de la vérité et de la science. En effet, pour Bloch, « le monde tel qu'il est n'est pas vrai [8] » et la vérité n'est pas justification du monde mais hostilité au monde. C'est qu'une deuxième « vérité » existerait qui est d'un ordre suprasensible et non encore apparue (L'esprit de l'utopie, Gallimard, 1977, p. 217). Contre Hegel, Bloch parle d'une « réalité utopique », d'une « réalité du non encore réalisé ». « Hegel ne détourne pas les faits, comme on avait coutume de le dire, mais il les corrige comme si tout ce qui est rationnel était effectivement réel et comme si la vie elle-même avait chaussé les bottes de sept lieues qui permettent à l'homme de mieux se penser. Cependant, il ne les corrige qu'en pensée et, malgré cela, il présente ce qui est simplement expliqué en pensée comme effectivement réel, réel à un point tel qu'il ne reste même plus un espace, un au-delà consolateur, intelligible pour l'exigence insatisfaite devant tant de paix, tant de démission luthérienne de la conscience au profit de l'État et de ce qui est (ibid., p. 222).
Bloch affirme la « religiosité de la conscience » et son espoir en la révolution ou plutôt l'« essence révolutionnaire de l'espérance » d'après la formule de Raphaël Lellouche [9]. Sa critique de Marx vise l'économisme de ce dernier, qui ne lui fait concevoir la religion que comme un domaine de la superstructure idéologique productrice de valeurs pour l'idéologie de la classe dominante. Bloch refuse donc naturellement la conception marxiste d'une religion opium du peuple (cf. L'athéisme dans le christianisme), lecture unilatérale d'après lui qui néglige le potentiel de révolte que peut contenir la religion si on la prend dans sa dimension messianique et qu'on la relie à la perspective de l'utopie. Pour lui, cet économicisme de Marx ne débouche que sur un anti-capitalisme et non pas la remise en cause de toute domination des puissants. Le socialisme est second par rapport à l'utopie ; il est universalisation de l'utopie dans la « vie intermédiaire ». Bloch reconnaît bien que le matérialisme de Marx et son souci du mode de production participe positivement du « désenchantement du monde » (Weber), « mais précisément, quand celui-ci dure trop longtemps, l'homme reste à nouveau sous le harnais de la vie économique, l'oppression n'est que raccourcie, mais pas supprimée. […] et nous voilà confronté à un processus fantomatique global, à un développement économique en soi qu'on idolâtre comme cause occasionnelle, sans échappée vers l'avenir. Marx, même quand il n'atténue pas le coup pour en faire une « évolution révolutionnaire », ne le dirige cependant que contre le capitalisme — mal relativement récent et dérivé — et non contre le centre durable et très ancien de tout esclavage, de toute brutalité et de toute exploitation, c'est-à-dire contre le militarisme, le féodalisme, le monde où l'on considère les autres de haut ; ici, même face à l'adversaire, le très ancien mouvement socialiste est diminué, égaré de multiple façon et perd tout caractère. […] C'est pourquoi l'on peut dire que l'accentuation de tous les facteurs déterminants (économiquement) et la présence latente, mais encore secrète de tous les facteurs transcendants ramènent le marxisme dans le voisinage d'une critique de la raison pure pour laquelle aucune critique de la raison pratique n'aurait encore été écrite. Ici, l'économie est supprimée et conservée (aufgehoben), mais sont absentes l'âme et la foi pour lesquelles on devait faire de la place ». [10]
Pour conclure sur le judaïsme de Bloch, on peut se risquer à dire que comme Marx, pour lui, la « question juive » existe bel et bien, mais pas parce que c'est une survivance à éliminer. Au contraire, elle exprime le maintien d'une promesse vers autre chose, elle maintient une dimension utopique par delà le contexte historique et politique.
Le Thomas Münzer (op. cit.) de Bloch marque le passage de son messianisme juif au millénarisme chrétien. Il y développe l'idée d'un double mobile de toute action révolutionnaire d'envergure. Tout d'abord une interrogation sur la destinée humaine qui s'inscrit dans une profonde religiosité de l'homme qui n'a rien à voir avec la religion et ses institutions [11], ce qui fait que l'athéisme ne lui est pas incompatible. Donc une sorte de nécessité intérieure quasi générique. Ensuite une nécessité extérieure et historique cette fois qu'impose la lutte contre l'oppression et la misère. C'est la conjonction de ces deux nécessités qui pousse à transformer le réel, à passer de la réflexion à l'action [12]. Cette conjonction se fait plus ou moins bien ou est aussi parfois manquée ou encore absente et nous en rendons compte, il me semble, à travers notre idée de tension individu/communauté, une tension éminemment variable, mais toujours présente aujourd'hui malgré le niveau atteint par le processus d'individualisation dans la société capitalisée.
L'interprétation de Bloch prend donc ses distances avec celle que développe Engels dans La guerre des paysans, où ce dernier n'a vu dans la lutte des anabaptistes qu'une première étape de la lutte des classes, qui ne pouvait que prendre la forme religieuse parce que premièrement l'Église avait à l'époque le monopole de la pensée et deuxièmement, parce que les attaques contre le pouvoir féodal ne pouvaient qu'être aussi des attaques contre l'Église officielle, tant les liens entre les deux étaient étroits. L'hérésie prenait donc une double forme, bourgeoise comme chez Luther parce que l'Église coûtait cher de par ses privilèges, paysanne et plébéienne ou proto-prolétarienne (Münzer) chez les pauvres. Dans cette perspective, la religion semble un passage obligé des formes de conscience, une vision assez proche de celle des « trois états » d'Auguste Comte. Le « scientisme » d'Engels ne constitue d'ailleurs pas une révélation, lui qui reprend aussi l'évolutionnisme darwinien en comparant la loi du développement organique de ce dernier avec la loi de Marx du développement de l'histoire humaine. La dimension messianique au sein des œuvres de jeunesse de Marx qui embrasse la perspective lointaine de la communauté humaine est ici sacrifiée à l'objectivité des conditions d'une plèbe qui ne s'est pas encore faite prolétariat. Luther ne pouvait donc que gagner contre Münzer. En tout cas, ce matérialisme vulgaire d'Engels n'est pas identique au matérialisme sophistiqué de Marx, qui déniait à la religion tout caractère de forme de conscience, celle-ci n'apparaissant qu'avec la philosophie.
Engels ne saisit pas vraiment le sens de la lutte des paysans allemands parce qu'il ne comprend pas le rapport à la communauté dans la lutte. Il y voit bien quelque chose d'autre qu'une revendication défendant des intérêts [13], mais il ne perçoit pas l'importance du rapport à l'ancienne forme collective de propriété germanique de la terre, ce que Marx reconnaîtra à la fin de sa vie dans ses contacts avec les populistes russes et sa référence au mir. Mais Engels était trop obsédé par l'idée d'une succession historique et automatique des modes de production, qu'il ne pouvait jeter un coup d'œil en arrière. Pour lui, ce qui est à retenir, c'est que la religion peut être une forme de conscience à une période historique donnée dans la mesure où elle est l'expression d'une protestation [14]. Une protestation qui prend le masque de la religion. Il ne peut alors expliquer pourquoi on ne retrouve pas alors cette religiosité dans les jacqueries françaises ni dans la révolte des Ciompi en Italie.
Pour en revenir à Bloch, sa perspective communautaire a beau faire appel au « pressentiment » (ibid., p. 304) plutôt qu'au ressentiment, nous sommes bien loin de notre dialectique de la tension individu/communauté [15] et plus proche d'une philosophie prophétique à qui on peut reprocher sa non-contemporanéité, pour reprendre un terme blochien. Lukács est à la même époque en phase avec cela, avec une perspective de « communauté théocratique » dont le modèle serait l'obchtchina russe (cf. Lellouche, op. cit., p. 32, note 53).
Mais aujourd'hui, la glose syncrétique élaborée par Bloch et le « principe espérance » sont en butte, plus qu'au « désenchantement du monde » déjà présent à son époque, à une sorte de fatalisme face à la techno-science et à ses applications en tant que définition de notre modernité. Le développement de nouvelles sectes (scientologie, illuminati, évangélisme télévisé et médiatique) ne se fait pas contre le monde mais en son sein. Il n'y a pas de perspective de sortie de ce monde, même si certains courants se pensent dans la « sécession [16] ».
Le messianisme juif en Israël
Après avoir accompagné les gouvernements travaillistes porteurs d'un sionisme laïc, la victoire israélienne de juin 1967 fut perçue par la jeune génération des croyants du pays comme un événement miraculeux par lequel la présence divine s'était manifestée de façon éclatante. Comment en effet, pour eux, interpréter autrement le triomphe militaire d'Israël, qui lui avait permis de reprendre pied dans ces hauts lieux de la mémoire juive que sont Hébron et la vieille ville de Jérusalem ? La prise de possession de l'intégralité de la Terre d'Israël (de la Méditerranée au Jourdain) marquait, à leurs yeux, un progrès qualitatif dans la voie du messianisme : désormais, le peuple juif était censé se trouver pleinement engagé dans le processif rédempteur. Cela donna l'élan pour la colonisation de la Cisjordanie et de Gaza, le développement de la présence juive étant vu comme un impératif religieux susceptible de hâter la fin des temps. Mais ce retour du messianisme religieux rend difficile toute négociation avec les Palestiniens. Les accords d'Oslo puis le désengagement de la bande de Gaza en 2005 sont perçus comme une trahison interne à la communauté juive et vont précipiter son éclatement et bouleverser les alliances politiques.
La tentation sioniste
Cette tendance catastrophiste, présente dans ses différentes variantes révolutionnaires présentées sommairement ici, est en revanche étrangère au sionisme travailliste de Ben Gourion dont le progressisme et la croyance en la science le placent plutôt dans le camp des rationalistes.
Nous l'avons déjà dit, le capital cherche à détruire toutes les communautés pour ne faire subsister que celle des citoyens, médiatisée par l'État et la démocratie. À cet égard, la révolution de 1789 a accompli son œuvre puisqu'elle a émancipé les juifs en tant qu'individus et non en tant que communauté humaine. Cette communauté juive ne fut pas défendue par les communistes ou anarchistes russes [17] dans leur majorité, mais seulement par les membres polonais ou russes du Bund. Ils la défendirent contre les mencheviks d'origine juive comme Martov et Trotsky puis contre les bolcheviks qui tous estimaient, de façon assez contradictoire, il faut bien le dire, la perspective d'une communauté humaine proche et forcément universaliste, qui renvoyait la communauté juive à son particularisme ou alors sa disparition tout aussi prochaine sous les coups du capitalisme montant en Russie.
On sait ce qu'il en a été avec la « solution finale » proposée par la contre-révolution sous la direction nazie. Une part importante de ce qui restait de la communauté juive a trouvé, faute d'une autre perspective, une « solution » de survie dans la création d'un État qui ne sera donc pas l'œuvre de la bourgeoisie juive pas plus que du prolétariat juif, ces classes n'existant pas en tant que telles dans la diaspora. Même si l'idéologie sioniste sera plutôt d'origine bourgeoise avec Herzl et sera critiquée, par exemple par le Bund internationaliste, dans la pratique, elle sera accomplie par la classe ouvrière israélienne en formation. Ainsi, l'aile travailliste du sionisme laïc (Ben Gourion) pose la classe ouvrière comme sujet-objet de l'histoire juive parce que ses intérêts sont considérés comme universels, c'est-à-dire incarnant les intérêts de la nation tout entière, mais la création de l'État renversera cette perspective socialiste en perspective hégélienne, l'État devenant peu à peu le représentant de l'universel, les institutions socialistes comme le syndicat n'étant plus que des représentants du particulier (la société civile). Tous les avantages d'une diaspora active et positive que Landauer signalait (elle formerait une base sociale pour la rédemption de l'humanité et permettrait de transcender l'idée de nation, libérant d'abord les juifs de tout nationalisme, puis émancipant toutes les autres nations avec la perspective de l'unité de l'humanité) ont été liquidés par l'Histoire récente.
Le messianisme juif aujourd'hui
Il faut tout d'abord se méfier d'une mise en avant du messianisme juif comme s'il relevait d'une essence particulière (Löwy) de la part d'un « peuple paria » (Max Weber). Une essentialisation de gauche dont le pendant à droite est celui du Juif nomade et mondialiste, cosmopolite et apatride. Il y a en effet, une certaine nostalgie ou une romantisation de la part de personnes de gauche et particulièrement si elles ont une origine juive, par exemple comme chez Pierre Stambul, les membres de l'UJFP ou encore Enzo Traverso, du bon vieux temps où les Juifs étaient presque surreprésentés dans les organisations révolutionnaires. Cela conduit souvent, de leur part et parfois, comme en filigrane, à une sorte d'obligation morale à vouloir rester du bon côté de l'histoire ; une obligation à laquelle le reste de l'humanité est apparemment moins tenue.
On peut dire ensuite que ce messianisme juif n'a pas de rapport avec ce qui a pu être vu comme messianisme révolutionnaire au tournant du siècle précédent ou de l'internationalisme prolétarien du XXe siècle. Il suffit d'observer le comportement raciste et violent des colons juifs en Cisjordanie en 2024 pour constater que le « messianisme juif » actualisé conduit à des perspectives politiques très différentes.
Au Moyen-Orient, la défaite des nationalismes laïcs arabes et les limites du nationalisme laïc juif [18], tous deux débarrassés de leur gangue « progressiste » ou socialisante d'origine, donne libre cours à une emprise religieuse dans la région et sous des formes radicalisées. Si certains produisent un nouvel internationalisme (le « Djihad islamique »), d'autres proposent un mixte entre l'ancien nationalisme et le retour au fondamentalisme religieux.
C'est le cas du Hamas, mais nous nous concentrerons plutôt sur le sionisme religieux. Il est surtout présent en Cisjordanie où se développe un messianisme d'État (une théocratie, disent Perle Nicolle Hasid et Sylvaine Bulle [19]) qui est pour le moins un oxymore, quand on pense au fait que les ultra-orthodoxes ne se rattachent à aucun territoire ou frontière définis, qu'ils n'hésitent pas à concrétiser leurs thèses sur le terrain en mettant en application l'idée d'un retour sur les terres ancestrales, en infiltrant la hiérarchie intermédiaire de Tsahal, en faisant alliance avec les partis d'extrême droite et en se prononçant, comme Netanyahu, pour une réforme de la Cour suprême et donc de la nature de l'État de droit israélien.
À côté de ce messianisme « réaliste », ce qu'on appelle les « jeunes des collines » (en fait des colons de deuxième génération), très proches de la ligne de front, représentent une sorte d'aile sécessionniste du sionisme. Ils ne participent pas à la défense d'Israël via l'armée car ils ne reconnaissent pas l'État ; ils refusent la technologie alors qu'ils vivent dans une start-up nation à faire pâlir Macron de jalousie. Ils se réfèrent à la « Terre promise » et mêlent références divines et valeurs new age. Comme nombre de djihadistes, ils n'ont pas lu les textes religieux de base et ils pratiquent un messianisme agressif au présent (encore un oxymore) en vue d'accélérer l'arrivée du royaume des Juifs dans le temps présent. Pourtant, à l'origine les courants religieux installés en Israël ne voyaient pas les Arabes comme ennemis, mais aujourd'hui, ceux-ci entacheraient la « pureté » du royaume.
En ce sens et même s'il est minoritaire, on a bien en Israël le développement d'un particularisme juif loin de tout universalisme, qui peut laisser place à toutes les accusations de suprématisme de la part du prétendument « peuple élu ». Or, ce terme de suprématisme, par ailleurs devenu à la mode, correspond à une tendance des intellectuels anglo-saxons (mais pas seulement) à calquer mécaniquement la situation américaine (ou leur vision de cette situation dans la première moitié du XXe siècle) sur la situation israélo-palestinienne. Ils en oublient que le mouvement des droits civiques ne prônait absolument pas la guérilla et que l'esclavage a existé pendant plusieurs siècles aux États-Unis, ce qui n'est pas le cas en Israël/Palestine depuis un siècle !
Cette métaphore de l'esclavage est d'ailleurs tellement répandue que dans une émission récente qui interviewait des Palestiniens d'Israël et de Cisjordanie, plusieurs d'entre eux ont expliqué : « Nous ne pourrons jamais faire la paix avec les Juifs parce qu'ils nous traitent comme des esclaves. » Les équations Israël=États-Unis, sionisme=suprématisme blanc ; Israël= Afrique du Sud de l'époque de l'apartheid sont erronées et procèdent d'une simplification/radicalisation du langage à gauche qui est le pendant de la simplification/radicalisation du langage à droite. Nous ne tracerons évidemment pas une équivalence entre les deux, mais en tout cas, c'est un signe de plus de la misère de la critique aujourd'hui. En outre, coller l'étiquette suprématiste aux Israéliens, c'est les « blanchir » dans le cadre de l'idéologie décoloniale (donc les européaniser). Ce qui est comique, vu que la majorité de la population juive israélienne aujourd'hui, vient des pays arabo-musulmans et que leurs origines ethniques sont en partie arabes, berbères, turques, perses, etc., et non européennes.
Revenons plutôt à ce que disait dès 1980 Gershom Scholem, spécialiste israélien de la Kabbale, dans une mise en garde prémonitoire : « Dès que le messianisme s'introduit en politique, il devient très dangereux. Cela peut seulement conduire au désastre ». C'est ce « sionisme religieux » et messianique que défendent les « jeunes des collines », par opposition à la position piétiste des ultra-orthodoxes.
Cette appréhension par le sionisme religieux d'une part, mais aussi de l'autre bord, palestinien, par ce qui serait une structure génocidaire depuis la Nakba [20] de 1948 ôte toute épaisseur historique aux événements en faisant comme si de toute façon rien d'autre n'aurait pu arriver, participant ainsi de ce que nous avons théorisé comme « l'achèvement du temps historique » et dialectique.
Pour conclure (provisoirement)
Le sionisme est-il un particularisme ou une tentative pour transformer les Juifs en un peuple comme les autres, pour les sortir de leur statut à part ? Difficile de trancher si ce n'est pour préciser que pour nous, le ou les particularismes juifs ne constituent pas un séparatisme [21]. Mais pourquoi ne pas élargir la question : comment expliquer le fait que tant d'individus d'origine juive dans un pays comme les États-Unis, dont la plupart sont descendants d'immigrés arrivés bien avant le nazisme et ayant quitté l'Europe centrale ou de l'Est pour des raisons multiples qui vont bien au-delà de la seule question de la persécution (notamment la pauvreté et la poussée démographique), et où ils ont connu une ascension sociale pratiquement sans équivalent, revendiquent encore aujourd'hui leur identité juive, au point même que certains (ils seraient environ 2000 par an) choisissent d'émigrer en Israël ? On a plutôt là un problème plus large de perte des repères de classes et de nation, religieux aussi, dans la société capitalisée, qui dépasse la question du particularisme juif : chacun se raccroche à ce qui lui apparaît comme le reste ou les retrouvailles avec une identité collective. Il faut dire que, dans l'ambiance ultra-ethnicisée qui règne aux États-Unis, ce n'est finalement pas si étonnant que cela. Aujourd'hui d'ailleurs, cette tendance cohabite avec une situation inédite qui voit de nombreux jeunes Américains dénoncer vivement la politique israélienne au nom de leur identité juive. Tout se passe comme s'ils voulaient renouer avec une fière tradition de fort ancrage à gauche de leur groupe, mis à mal par des décennies de réussite sociale et d'américanisation, sur fond de droitisation inquiétante de la société dont ils font pourtant profondément partie.
LC et JW pour Temps critiques, le 27 octobre 2025
[1] – Nous n'employons à dessein ni le terme de pogrom pour les premiers ni le terme de génocide pour les seconds, termes galvaudés qui ne servent qu'à mettre en miroir des situations historiques très dissemblables à une époque post-moderne où tout est mis en équivalence dans un relativisme revendiqué.
[2] – Cf. Shlomo Sand, Comment le peuple juif fut inventé, Paris, Fayard, 2008. Nous n'entrons pas ici dans les débats soulevés par les thèses de fond de cet auteur, par ailleurs de plus en plus fortement contestées.
[3] – Sur ce point, Sand ne fait que reprendre la notion de « communauté politique imaginée » formulée par Benedict Anderson dans son ouvrage célèbre L'imaginaire national : réflexions sur l'origine et l'essor du nationalisme, Paris, La Découverte, 1996.
[4] – On est ici bien loin de la manière de voir de Sand dont le livre s'achève sur la dénonciation du mythe du « peuple élu » auquel les juifs se raccrocheraient afin « de se glorifier et d'exclure l'autre. »
[5] – Dans les textes religieux, la tentation de « l'élection de droit » est maintes fois contrebalancée par « l'élection de devoir ». Et le modèle talmudique qui se posait déjà la question en termes strictement religieux et juifs, mais potentiellement universalistes (si Dieu est bon, comment ne peut-il rétribuer que les juifs pour leurs actions et abandonner ainsi le reste de l'humanité ?) va, via Moses Mendelssohn, la poser en extériorité à la religion juive, dans la Raison et l'éthique. Pour lui, rien dans la religion mosaïque ne décrète ce qu'il faut « croire ou ne pas croire », mais ce qu'il faut faire ou ne pas faire » (Jérusalem ou Pouvoir religieux et judaïsme, Paris, Presses d'aujourd'hui, 1982, p. 136.
[6] – Marx reprenait ici le point de vue hégélien comme quoi dans l'histoire de l'esprit la religion juive a fait son temps et doit être supprimée, que son aliénation ne peut se résoudre que dans l'assimilation complète. Mais alors, comment expliquer sa survie ? Cette aporie peut se généraliser aujourd'hui à l'ensemble des religions.
[7] – Le messianisme peut être défini, en langage hégélien, comme une tentative de « réaliser la religion sans la supprimer » (Yves Delhoysie, Georges Lapierre, L'incendie millénariste, Os Cangaceiros, 1987, p. 6). Réaliser le royaume de Dieu en ramenant l'image de la Cité céleste sur terre. Une Cité céleste dans laquelle, à travers l'unité immédiatement donnée de l'individu et du genre. Genre au sens feuerbachien du terme.
Cela s'explique par le fait que la religion imprègne toute la vie des individus et groupes et que ce sont les autorités religieuses et non la religion par essence qui créent les séparations. Delhoysie et Lapierre rajoutent : « Ce qui reste une tentative plus essentiellement révolutionnaire que la tentative inverse qui consiste à vouloir supprimer la religion sans la réaliser ». C'est effectivement le programme que s'étaient fixés les pays du « socialisme réel » mais avant eux aussi, d'une certaine façon, les révolutionnaires de 1789-93 en France et de 1936-37 en Espagne..
[8] – Cf. l'interview de Bloch par M. Löwy, in Pour une sociologie des intellectuels révolutionnaires, PUF, 1976, p. 294. De son côté, M. Buber perçoit la défaite de la révolution bavaroise (1918-1919) comme une erreur de sa direction juive à vouloir hâter l'arrivée du royaume de Dieu sur terre. Il critique la tragédie d'une politique messianique qui a de plus conduit à une grande campagne antisémite en Allemagne. Il théorise alors une politique anti-étatique et donc non sioniste, du nom de « théocratie directe ». Bloch, lui-même, est opposé au sionisme étatique car premièrement il reposerait sur une conception datée de l'État-nation (celle du XIXe siècle, « l'ère des nations ») ne conduisant qu'à l'établissement d'un « État balkanique d'Asie » (cf. Symbole : les juifs, op. cit., p. 140) et deuxièmement il sacrifierait la religiosité juive à un froid étatisme.
[9] – Raphaël Lellouche, « Les juifs dans l'utopie » in Ernst Bloch, « Symbole : les Juifs » : un chapitre “oublié” de L'Esprit de l'utopie (L'Éclat, 2009). À la même époque et grosso modo sous les mêmes influences, Lukács écrit son « Mysticisme juif » à propos des thèses de Martin Buber dont il relève l'aspiration messianique et eschatologique. Avec Bloch, ils partagent alors la tendance à faire fusionner mystique juive et mystique russe à la Dostoïevski (cf. M. Löwy, Rédemption et utopie, PUF, 1988). Tous les deux choisissent aussi dans le judaïsme ce qui est le plus anti-étatiste et le plus opposé à l'institution religieuse. De tout cela émane un romantisme anti-capitaliste, antiparlementaire et apocalyptique.
[10] – L'Esprit de l'utopie, Paris, Gallimard, 1977, p. 293
[11] – Bloch oppose aux Églises, à la foi compassée et compromise avec le monde et les puissants qui l'amène à regarder en arrière, l'enthousiasme charismatique des sectes (Münzer et les baptistes) et de certaines traditions monacales) héritées du christianisme primitif (le « communisme de l'amour », p. 246, op. cit.), syncrétisme de l'Ancien et du Nouveau Testament, de l'héritage grec et romain polythéiste. Pour lui, un nouveau messianisme se prépare qui, appuyé sur une immense tradition qui va des cathares à Tolstoï, peut « en finir avec la peur, avec l'État, avec tout pouvoir inhumain » (ibid., p. 306).
Sur les décombres d'une civilisation ruinée une manifestation communautaire doit s'atteler à reconstruire la planète terre. « Das dritte Reich, le troisième Empire annoncé par les millénaristes sera celui où disparaîtront enfin l'Église et l'État et où commencera le règne du Christ » (L'Esprit de l'utopie, op. cit., note 1, p. 210). Comme « Remarque terminale » en 1977, Bloch définit son Esprit de l'utopie comme « une gnose révolutionnaire » (p. 335).
[12] – Dans L'esprit de l'utopie, Bloch développe l'idée de « proximité messianique » qui justifie théoriquement la nécessité d'une pratique ici et maintenant. D'où sa critique des mystiques chrétiennes du lointain comme celle d'Eckart.
[13] – « Les exaltations chiliastiques du christianisme primitif offraient pour cela un point de départ commode. Mais en même temps, cette anticipation, par-delà non seulement le présent, mais même l'avenir, ne pouvait avoir qu'un caractère violent, fantastique, et devait, à la première tentative de réalisation pratique, retomber dans les limites restreintes imposées par les conditions de l'époque […] L'anticipation en imagination du communisme était en réalité une anticipation des conditions bourgeoises modernes » (Éditions sociales, 1974, p. 68). Engels confond Münzer et Luther !
[14] – Engels revient là-dessus dans ses « Contributions à l'histoire du christianisme primitif » in Marx et Engels, Écrits sur la religion, éd. Sociales, 1972, p. 310-338.
[15] – Landauer (op. cit.) est beaucoup plus soucieux de tenir les deux bouts en envisageant les rapports entre individualisation et communauté. Toutefois il a tendance à ne concevoir leur rapport que dans une temporalité qui ferait se rencontrer l'ancien (la communauté, l'histoire) et le nouveau (l'individu, l'utopie) comme si le rapport n'était pas dialectique mais chronologique, comme si les deux éléments n'existaient pas de tout temps historique mais pas dans la même proportionnalité de puissance, pas dans le même registre de subsomption).
[16] – Pour une critique de ces courants, on peut se reporter à J. Wajnsztejn et C. Gzavier, La tentation insurrectionniste, Acratie, 2012.
[17] – Plekhanov et Martov, qui deviendront des dirigeants mencheviks, quittent le Bund vers 1900, Trotski en 1903 ; quant à Lénine, il s'oppose à l'idée d'une nation juive et jusqu'à son décès en 1923, il est partisan de l'assimilation contre ce qu'il perçoit comme le particularisme juif. Le Bund répond en soulignant que cette assimilation à l'ouest de l'Europe est plus facile qu'à l'est où les Juifs sont plus nombreux, plus prolétarisés, « yiddischisés » et victimes de pogroms. Rosa Luxemburg et Karl Kautsky soutiennent l'appartenance du Bund à la Seconde Internationale, mais Rosa, si elle reconnaît le fait nationalitaire, refuse l'idée d'État-nation, tout en s'opposant bizarrement au yiddish qui n'est pourtant pas une langue nationale, pour les Juifs, mais un singularisme culturel. Tout aussi bizarrement, elle est jugée trop plébéienne.
[18] – Pour Zeev Sternhell, le sionisme a gagné comme nationalisme, c'est-à-dire son droit à l'existence, mais le prix à payer en est exorbitant, aussi bien du point de vue social que militaire et éthique.
[19] – In « Quand les messianiques rêvent pour de vrai », revue K, 10 septembre 2025.
[20] – Quoi qu'on pense de la position anti-deutsch que certains ex-participants allemands de la revue Temps critiques défendaient, au début des années 1990, contre la réunification du fait d'une toxicité quasi sui generis de la conception du Reich, il ne nous semble pas y avoir de raison d'en suspecter l'État d'Israël de par sa nature même, sauf à l'accuser d'être, dès l'origine, le fruit d'un colonialisme de peuplement et non celui d'une décision onusienne. La contradiction de la théorie sur l'aspect structurellement colonial de l'État juif, c'est qu'elle reconnaît de facto l'existence d'Israël sur son territoire de 1949 défini par le droit international. Donc, en toute logique, il n'y a que les Palestiniens qui peuvent se dire antisionistes sur la base de leur nationalisme. Cela ne veut pas dire que tous les autres antisionistes sont antisémites, mais ils n'ont aucune légitimité à jouer un nationalisme contre l'autre.
[21] – Même en Israël, les ultra-orthodoxes adoptent une position pragmatique qui les lie à l'État, ne serait-ce que par leur dépendance financière (les hommes n'ont aucune activité productive), mais le gouvernement actuel auquel ils sont pourtant liés, envisageait de revenir sur leur exemption du service militaire.
27.10.2025 à 17:07
Pourquoi faudrait-il s'en prendre à la « transition écologique » ?
dev
(Les éoliennes pourraient-elles aussi nous servir de sèche-cheveux ?) [Le Chiffon]
- 27 octobre / Avec une grosse photo en haut, 2, PositionsTexte intégral (2040 mots)

Pour son dernier numéro, le journal francilien d'investigation Le Chiffon s'est penché sur la transition écologique, ou plutôt contre. Ils y interrogent cette drôle de situation dans laquelle nous enserrent la réaction climatosceptique d'un côté et l'écologie responsable et inoffensive de l'autre. Arrêterons-nous le train de la catastrophe en nous lavant les mains avec du biocarburant ? Les éoliennes pourraient-elles aussi nous servir de sèche-cheveux ? Un datacenter peut-il rentrer dans la poubelle jaune ?
La rédaction du chiffon nous a transmis cette intervention tenue à l'occasion de la parution de leur numéro 18 au café Dorothy, le 9 octobre dernier.
— « Attention, vous allez finir par faire le jeu de l'extrême droite en vous en prenant à l'éolien ! », dit l'un d'eux.
— Un autre relativise : « Mieux vaut du photovoltaïque ou du nucléaire, plutôt que le drill baby drill, de l'idiot de Washington. »
— « Et puis, en plein génocide à Gaza, ajoute un troisième, y a peut-être plus urgent que de s'en prendre à ce qui est, certes, insuffisant, mais va tout de même dans le bon sens… ».
Eh bien non. Nous refusons cette logique du « moindre mal ».
Nous venons de vivre près de trois ans et demi, vous le savez, dévastateurs. Si la période d'autoritarisme politico-sanitaire du Covid semblait avoir fait germer quelques questionnements sur l'insoutenable croissance économique, sur la difficulté à donner sens à sa vie dans les métropoles, sur le devenir psychiatrique de sociétés largement numérisées, sur la finitude de notre Terre… nous semblons assez loin de ces questionnements aujourd'hui. Les zébulons de plateaux télé tentent d'entériner, en toute quiétude, « l'adaptation » à un réchauffement qui sera assurément de quatre degrés au début du siècle prochain.
En quelque trois années, l'écologie a été remisée dans le débat public à la place qu'elle occupait peut-être dans le courant des années 2000. Comment en est-on arrivé-là ? Comment se fait-il que des préoccupations écologistes puissent être balayées, même si ce n'est que pour un temps, avec cette vitesse et cette facilité ? Comment se fait-il qu'aux premières bourrasques, l'écologie tant vantée il y a encore peu s'enrhume si facilement ?
De quelle écologie s'agit-il, d'ailleurs ?
Eh bien de celle affublée du mot magique « transition ». La « transition écologique », et ses deux jambes que sont lesdites transitions énergétique et numérique. Une « transition » qui est un simulacre d'écologie. Pourquoi ?
Vous le savez sans doute, nous ne sommes pas en train de connaître une transition de sources d'énergies carbonées : du gaz, du charbon ou du pétrole – sale –, vers l'éolien industriel, le photovoltaïque, l'hydrogène, lesdits biocarburants – prétendus, eux, propres. Nous sommes en train de découvrir l'ampleur, non d'une transition écologique, mais d'une accumulation industrielle, sans égale, sous couvert de transformation vertueuse de nos sociétés. Pourtant, les fondateurs de l'écologie politique au début des années 1970 – Pierre Fournier, Alexandre Grothendieck ou Bernard Charbonneau – avaient déjà critiqué cette écotechnologie. On ne peut pas jouer la surprise.
Je rappelle que la notion de « transition énergétique » émerge dans le marigot nucléaire américain des années 1950. Elle caractérise le fantasme d'une énergie nucléaire propre et infinie qui serait permise par le nouveau procédé dit de « surgénération ». Mais nous pourrions remonter un peu plus loin.
La notion de transition accompagne en vérité un certain nombre de penseurs de la modernité occidentale pour décrire la « révolution industrielle » : pensons à Alexis de Tocqueville, à Auguste Comte ou à Émile Durkheim. Une transition qui a au moins deux siècles et qui prend, à cette lumière, les allures de la perpétuité [1].
Et pour cause, le cataclysme que représentent la contre-révolution industrielle et la régression anthropologique qui en est le fruit tente de se faire accepter en diffusant l'idée que ça passera, que l'on transitionne d'un point A à un point B. Et si la situation n'est pas jolie-jolie aujourd'hui, on va vers un ailleurs, vers autre chose, vers du mieux. Nous transitionnons. Ne vous inquiétez pas. Patientez.
Il faut bien ça pour faire accepter l'inacceptable.
Notez que la « transition », dans les bouches et les écrits divers, s'efforce de moins en moins de s'accompagner du complément « énergétique » ou « écologique ». Le mot a déclaré son indépendance, il s'élève sur ces petites jambes et marche tout seul, comme un grand. La prononciation de ce terme devenu talisman, de cette amulette verbale, se présente comme l'une des grandes illusions auto-justificatrice de nos sociétés.
Ainsi, nous pouvons avancer qu'il y a aujourd'hui deux manières dominantes de refuser une remise en question de la croissance économique, de la valorisation du capital et de la débauche technologique.
— La première, c'est la réponse hypocrite. C'est celle qui fait mine d'avoir compris la leçon sur les « 9 limites planétaires ». Celle qui opine du chef : « Bien sûr, il faut arrêter avec les SUV. » Celle qui prétend vouloir tout changer pour que rien ne change. Celle qui bâtit des usines de batteries au lithium pour les voitures électriques dans le nord de la France, qui justifie l'installation de la filière électro-hydrogénée le long de la Seine, celle qui accompagne l'ouverture de mines de tungstène dans l'Ariège. Celle du Shift Project, qui veut nous maintenir le nez dans les excréments de l'enfant terrible du complexe scientifico-militaroindustriel étatusien : le nucléaire. C'est celle d'une large partie des milieux dits « écologistes », qu'ils soient au Parlement ou dans la société civile, sans parler des imposteurs de la « technocritique » ou de la « décroissance » que l'université met de plus en plus en circulation sur le marché des idées. C'est celle du plug, baby, plug [2] d'un Macron et d'un Biden. C'est une écologie qui répand le cynisme dans les populations autant qu'une fausse contention psychique : elle est un refus – qui ne dit pas son nom – de l'autolimitation individuelle et sociale.
— Le seconde, c'est la réponse brutale. C'est celle qui proclame haut et fort : il n'y a pas de problème avec la croissance économique ou le dérèglement climatique. « Déculpabilisez-vous, chers amis. » Plutôt qu'un mensonge pseudo-écologiste, elle revendique, elle, une vérité de et dans la débauche. Il faut dire que, régulièrement, les populations préfèrent l'« originale » à la copie. La croissance qui s'assume sans phrase plutôt que celle qui se tortille. C'est donc celle de Trump et du dévergondage psychique : « Que ceux qui peuvent, proclame-t-elle, profitent autant qu'ils le veulent. » L'ironie, c'est qu'elle n'est pas pour autant étrangère à la « transition écologique », qu'elle accomplira également. Cette dernière étant dans tous les cas importante pour renouveler les leviers de croissance du capital.
Nous voilà en présence de deux pôles idéologiques et politiques. Deux pôles, l'hypocrite et le brutal, qui soutiennent en profondeur le même monde.
À l'heure des dévastations coloniales et à caractère génocidaire de Poutine en Ukraine et de Netanyahou à Gaza, à l'heure où les impérialismes se recomposent à une vitesse ahurissante, à l'heure de la prolifération des IA « dégénératives », où les populations (et notamment les jeunesses) se laissent dessaisir de notre principal moyen d'humanisation, à savoir notre rapport aux textes et la parole, et voient un peu partout leur sociabilité se détériorer, ces multiples effondrements laissent entrevoir que la période qui s'est ouverte à nous ces dernières années ne pourrait être qu'un apéritif.
C'est dire s'il est plus que jamais temps de remettre en avant une écologie véritable, une de celles qui ne boirait pas la tasse au premier creux d'ampleur, comme nous le vivons depuis 2022. Une écologie qui tienne la route, si je peux dire…
Plutôt qu'une transition, c'est en fait d'un « basculement » dont on a assurément besoin. Basculement dans une écologie radicale qui pense ensemble l'essor de la technoscience, de l'appareillage industriel, du capital, le renforcement des logiques patriarcales et des appareils d'État.
Dans ce contexte, il nous a semblé urgent d'écrire et de diffuser ce numéro : nucléaire dans la Bassée, datacenter à Dugny, logistique urbaine à Gonesse, « bioraffinerie » à Grandpuits, Grand Paris Express dans toute la région, heurs et malheurs du sabotage luddite dans la vallée de Chevreuse… Ce, pour documenter les raisons que nous avons de nous organiser contre la poursuite de l'électrification de la société, armature indispensable à la numérisation aliénante de nos quotidiens.
S'il fallait prendre le taureau par une corne et joindre le geste à la parole, nous avons une occasion intéressante, parmi d'autres, de nous organiser. Le roi Ubu annonçait en février 2025 un « campus IA », à Fouju, dans la campagne de Melun. Sans doute qu'il y a des effets d'annonce, toujours est-il qu'il se prévoit làbas un datacenter d'une puissance électrique de 1,4 gigawatt (une abstraction, dit comme ça), soit l'électricité consommée par un réacteur nucléaire EPR, ou la consommation domestique de près d'un million quatre cent mille personnes. Pour un seul datacenter !
Si nos milieux écolos ont combattu à très juste titre ces derniers temps contre les mégabassines et l'accaparement de l'eau, nous pourrions sans doute réfléchir à réitérer ce geste contre les datacenters et l'accaparement de l'électricité.
Certes, Fouju, c'est loin ! Dans la Seine-et-Marne... Mais le RER a quand même son charme. Sachez qu'un fumeux débat public sera lancé à partir du 15 octobre.
Les datacenters (dont le « campus IA ») pourraient bien devenir dans les prochaines années, s'ils ne le sont pas déjà, les infrastructures parmi les plus indispensables au pouvoir, sous toutes ses formes. À nous de les contester partout où nous pouvons.
Gary Libot
27.10.2025 à 16:44
L'ange est terrible (pour john « chance » carpenter)
dev
(Mélanges 3) - Alexia Roux & Saad Chakali
- 27 octobre / Avec une grosse photo en haut, Littérature, 2Texte intégral (2040 mots)

et nous ne l'admirons tant que parce que, impassible, il dédaigne de nous détruire.
Ce petit film sera diffusé sur notre chaîne youtube le soir d'Halloween.
27.10.2025 à 16:37
Qui a tué Emmanuel Macron ?
dev
Causes et conséquences de l'érosion du centre politique Michalis Lianos
- 27 octobre / Avec une grosse photo en haut, Positions, 2Texte intégral (1313 mots)

Cela fait à peine huit ans qu'Emmanuel Macron a représenté l'avènement d'une nouvelle époque. Appuyé par les puissances financières, précipité à la une de tous les médias, un jeune homme obtient en premier poste élu la Présidence de la République. Cela ne semblait inquiéter personne.
Un triomphe fondé sur des décombres
L'obtention d'une majorité parlementaire impressionnante complétait ce prétendu triomphe sans que la classe politique et ses observateurs relèvent le fait qu'il s'agissait en réalité de l'effondrement du centre, qui ne pouvait plus alimenter deux partis prétendant au gouvernement, en dépit d'une carte électorale taillée pour bloquer la droite radicale. L'ajustement immédiat de plusieurs femmes et hommes de gauche et de droite pour faire partie des gagnants fut traitée avec une indifférence stoïque, voire bienveillante, par leurs supporteurs qui abandonnaient aussi en grand nombre leurs précédents bateaux.
Illusions populaires
Il s'agirait, comme l'annonçait le livre d'Emmanuel Macron, d'une « Révolution » capable de libérer le potentiel du pays. L'espoir d'un changement profond traversait aussi les classes modestes, exposées depuis longtemps à la crainte du déclassement et de la perte d'un statut assurant la dignité de leur position sociale. Or, si les grands acteurs économiques avaient trouvé leur compte, les gens qui considéraient appartenir aux « classes moyennes » commençaient à voir clairement que le dynamisme et ses effets étaient réservés aux couches urbaines aisées. Ce que l'on appelait « la France d'en bas » entamait son mouvement tectonique dans un nouveau rapport avec la démocratie représentative. Ainsi, en novembre 2018 les ronds-points furent bloqués et en décembre les lieux de pouvoir et les « beaux quartiers » parisiens visités par une foule d'individus liés par leur expérience subalterne et ignorée. Ils se prétendaient « apolitiques », cherchant à se faire comprendre par leurs gouvernants. Non seulement ils et elles n'ont pas été compris, mais ils ont compris la cause de ce revers de main : ils n'étaient pas l'âme de ce pays comme ils le pensaient, mais son arrière-garde sociale, incapable de saisir les projets qui étaient faits pour leur compte, aussi bien par le progressisme marchand de droite que par le progressisme socioculturel de gauche. Ils et elles ne faisaient pas partie du plan et n'auraient pas voix au chapitre.
Initialement choqués, profondément blessés par ce mépris, ils ont vite montré leurs réflexes civiques profonds en décidant que la représentation politique partisane n'était plus aujourd'hui à la hauteur de la complexité sociale. Non seulement ils demandaient désormais le « RIC pour tout » mais ils refusaient de se faire représenter eux-mêmes en pratiquant la démocratie directe qu'ils et elles recherchaient. La réaction des divers pouvoirs institués était claire. Le gouvernement les a réprimés violemment sans ambages. Quant aux autres partis et les forces critiques, y compris les classes intellectuelles, une distance hygiénique a été mise en place. Ces forces acceptaient les revendications abstraites de justice sociale sans jamais s'associer à ces gens inconnus et à leur volonté de se mêler directement du pouvoir sans passer par les filtres des diverses intelligences supérieures.
Fractures et risques
Revenus dans leur condition subalterne, mais avec une nouvelle conception de leur société, ces gens d'en bas, arrêtés à tous les niveaux, ont naturellement pensé que la seule option qui leur restait était de perturber le jeu qui les méprisait, à défaut de pouvoir le transformer. Il suffit de voir les résultats des dernières élections européennes et législatives, et la composition actuelle de l'Assemblée, pour comprendre comment ils l'ont fait.
Alors, ce qui a tué Emmanuel Macron n'est pas le désaveu spontané de la classe dirigeante, toujours opportuniste, qui se tourne maintenant rapidement vers le Rassemblement National ; ni une opposition efficace, unie ou convaincante ; ni le Covid ; ni la situation géopolitique et les tensions qu'elle provoque au sein de la société française ; ni un défaut de progressisme idéologique dans les questions « de pointe » autour des identités et de la sexualité ; ni même les fameuses préoccupations de l'incertitude socioprofessionnelle, de l' « insécurité » ou du « pouvoir d' achat ».
Ce qui a tué Emmanuel Macron est d'avoir expliqué aux gens modestes et apartisans, qui se pensaient attachés à la République de façon irréfragable, que cela faisait longtemps que cette République leur réservait seulement l'obligation de se taire et de laisser les rênes à ceux qui sont compétents pour discuter et décider de leur sort. Mais, les humains supportent mieux la condition modeste, voire difficile, que l'humiliation ouverte, voire ostentatoire.
Ce qui a tué Emmanuel Macron est de ne pas avoir offert quelque chose qui ne lui coûtait rien : du respect. Tout simplement, du respect.
La tentation autoritaire
La situation de la France exemplifie le paradoxe apparent des sociétés fortement individuées, profondément diverses et pourtant en quête d'appartenance identitaire collective. Ce mélange contribue à la perception du pouvoir politique en tant que « système » agissant de façon arrogante, ignorante et autoritaire. En même temps, la radicalité d'avant-garde n'offre pas d'alternative politique, car elle ne souhaite cultiver aucun rapport avec les classes qui n'acceptent ni sa primauté intellectuelle ni ses priorités oppositionnelles.
Les « classes moyennes » sont donc devenues une population privée d'existence dans la sphère publique, priées de subir discrètement leur sort par toutes les forces républicaines, aussi bien opposantes que conservatrices. Or, souffrir silencieusement, de l'Argentine à l'Italie, des Etats-Unis à l'Allemagne, non seulement a ses limites, mais semble invariablement conduire à une issue qui promet la rupture avec l'expérience d'une démocratie hypocrite et méprisante. Le domino des impasses a ainsi commencé, et menace de transformer le désir de participation directe en quête de salut charismatique et communautaire. S'il est naturellement impossible de prédire la suite historique, il est possible d'affirmer que, sous la convergence d'un autoritarisme favorable au marché, russe, turque, étatsunien, chinois, israélien ou hongrois, la démocratie représentative agonise ; mais ses piliers préfèrent mourir au pouvoir que se transformer en acteurs de transition vers un régime où les citoyens lambda piloteront la gouvernance.
Un autoritarisme adapté à la liberté individuelle sur tous les plans, hormis l'opposition idéologique, est possible ; tout comme un capitalisme parfaitement réussi sous un régime communiste, ce que prouve l'évolution de la Chine. Des formes politiques jadis impensables se réalisent sous la régression des formes de pouvoir devenues obsolètes. Une nouvelle version de fascisme ‘favorable à l'individu' se développe, capable de combiner la poursuite des trajectoires personnelles désirées avec la répression de toute contestation collective. Malheureusement, cette version est tentante pour ceux qui ont collectivement échoué à contester le statu quo et individuellement échoué à se faire respecter. C'est une erreur de penser que les oublier est sans conséquences. C'est un manque de discernement politique de considérer que ceux qui se pensent « apolitiques » le sont vraiment. Et c'est une faute, à la fois idéologique et morale, de les priver de leur droit à l'histoire, au risque qu'ils l'exercent de façon vindicative pour nous engloutir tous dans une nouvelle modernité autoritaire.
Michalis Lianos
27.10.2025 à 16:34
Point d'étape sur l'ubique numérique
dev
Texte intégral (4511 mots)

On appellera « ubique » tout ce que l'on désigne tantôt par le signifiant « informatique », tantôt – et de plus en plus – par celui de « numérique ».
L'ubique est le nom et l'objet d'une enquête. Celle-ci a pour objectif de déterminer le caractère révolutionnaire ou contre-révolutionnaire de l'ubique. Peut-on se fier et prendre appui sur l'ubique dans une visée émancipatrice ? Ou, au contraire, l'ubique doit-elle être combattue en raison des incomparables moyens de contrôle et de domination qu'elle fournit ?
[Lire le premier épisode par ici.], le second par-là
Je comprends tellement que ce monde rêve d'un envers ! De quelque chose qui lui échapperait enfin, irrémédiablement, qui serait comme son anti-matière, le noir de sa lumière épuisante ! L'abracadata qui échapperait par magie à toutes les datas ! Je comprends que la fuite, […], la liberté pure, l'invisibilité qui surgirait au cœur du panoptique, soient les fantasmes les plus puissants que notre société carcélibérale puisse produire comme antidote pour nos imaginaires.
Alain DAMASIO, Les furtifs, Paris, Éditions La Volte, 2019, p. 298-299
Notre enquête en est arrivé à un point où, étant parvenu à distinguer ce qui dans l'ubique se conforme et accentue la logique capitaliste – et que nous avons appelé la face numérique de l'ubique –, nous pouvons désormais nous tourner vers l'autre face de l'ubique – si elle existe – susceptible au contraire denous émanciper de la domination du capitalisme. Pour ce faire, il paraît utile de récapituler dans un premier temps les éléments essentiels composant la substantifique moelle de ce que nous avons nommé « numérique ». S'il s'agit de le combattre, mieux vaut en effet diriger de manière efficiente la lutte sur les points saillants et fondamentaux de l'ennemi, plutôt que s'égarer à partir à l'assaut de ce qu'il laisse ostensiblement à découvert mais qui n'est que leurre, que l'ennemi peut se permettre d'abandonner, car ne remettant nullement en cause sa nature profonde.
La critique du numérique, dénonçant la domination qu'il permet d'imposer au monde avec les dégâts collatéraux qu'il génère et les dangers qu'il soulève, n'a pas attendu notre enquête pour émerger. Cette critique se développe de nos jours selon trois axes principaux : la tyrannie des algorithmes et de l'intelligence artificielle, l'assujettissement aux dispositifs de surveillance numérique, avec les violations de la vie privée que cela entraîne, et l'impact environnemental du numérique, aggravant la crise climatique. Passons en revue ces trois angles d'attaque, ce que nous a appris notre enquête jusqu'ici sur l'ubique nous permettra, d'une part, d'articuler celle-ci avec des questions désormais familières et, d'autre part, d'interroger l'essentialité et donc l'efficacité de ces champs de bataille.
S'il est un sujet qui, depuis quelques années, fait couler beaucoup d'encre, suscitant méfiance, opposition, voire animosité envers le numérique, ou au contraire une adoration béate et l'espoir invétéré qu'il s'agirait de la solution à tous nos problèmes, c'est bien les spectaculaires progrès de l'« intelligence artificielle » (IA). Au point qu'il est devenu commun de vouer aux gémonies tout algorithme, en assimilant grossièrement ce terme aux techniques du domaine de l'IA. Et que dénonce-t-on ou que loue-t-on dans cette IA honnie ou bénie ?
Principalement sa vocation à remplacer l'intelligence humaine. Les élèves, en rendant des devoirs générés par des IA, ne développeraient plus les capacités intellectuelles que le système scolaire est censé les aider à cultiver. Une myriade d'emplois, des journalistes aux artistes en passant par les juges, seraient menacés d'être remplacés par des IA génératives, capables d'accomplir les mêmes tâches, de manière plus rapide, plus économique, plus efficace et sans intervention humaine.
À l'inverse, les laudateurs de l'IA – aussi nombreux que ses contempteurs – voient en celle-ci l'opportunité pour l'humanité de se délester de certaines tâches intellectuelles rébarbatives ou d'en accomplir plus efficacement que ne le ferait le cerveau humain. Les voitures à conduite automatique permettraient ainsi de ne plus avoir à se concentrer sur la route et qu'il soit loisible de se consacrer à d'autre occupations lorsque l'on est au volant. La police et la justice dites « prédictives » seraient enfin à même d'anticiper les crimes afin de garantir à la société de vivre dans une sécurité totale et sans défaut.
Et au milieu de tout ça, dans le microcosme des offices de brevets et des instances régulant le copyright, on s'interroge sur la possibilité ou non de délivrer des titres de « propriété intellectuelle » pour des œuvres ou des inventions entièrement conçues par des IA.
Bref, l'« intelligence artificielle » semble avoir accompli à la perfection la promesse inéluctable à laquelle le choix de ce vocable la déterminait : être comparée – en bien ou en mal – à l'intelligence humaine, l'égaler, voire la surpasser.
La faute à Turing ! Après tout, c'est lui qui, avec son célèbre test, s'est attaché le premier, dans un article de 1950, à répondre à la question de savoir si les machines numériques pouvaient penser. Et à cloisonner les réponses à cette question en la reformulant dans les termes du « jeu de l'imitation » – où d'habitude un joueur masculin s'ingénie à imiter sa concurrente féminine, afin de duper un interrogateur sur son identité de genre : une machine serait décrétée être capable de penser si elle parvient lorsqu'on l'interroge à faire croire que c'est un humain qui répond.
Pourtant, c'est ce même Alan Turing – nous l'avons vu en cherchant la génétique de l'ubique et en en faisant l'archéologie avec son article de 1938 définissant les « machines de Turing » – qui a démontré théoriquement qu'une machine ubique était irrémédiablement incapable de décider s'il existait une solution à un problème si celui-ci n'était pas restreint au domaine du calculable.
Or en quoi consiste l'IA telle qu'elle fonctionne quelques six à huit décennies après ces articles séminaux ? D'une part, elle obéit à une logique très différente des machines de Turing. Celles-ci posent un ensemble de règles logiques explicites que la machine doit suivre pour exécuter ses opérations. C'est ainsi que le développement de logiciels est effectué lorsque l'on programme classiquement : on indique à l'ordinateur que s'il se trouve dans telle ou telle situation, alors il doit accomplir telle ou telle opération, qu'on le force éventuellement à répéter tant que telle ou telle condition est satisfaite. Il n'y a rien de plus intelligent dans le fonctionnement classique d'un ordinateur : il exécute bêtement les enchaînements logicomathématiques qu'on lui donne sous forme d'instructions explicites dans un langage de programmation. Et l'on a bien du mal à appeler cela « intelligence » !
Il en va tout autrement des algorithmes actuels dits « d'intelligence artificielle » et qui reposent principalement sur l'apprentissage profond – deep learning – de réseaux de neurones. De tels réseaux sont constitués de petits programmes ubiques n'ayant pour seule instruction que de s'activer ou rester en sommeil selon qu'un seuil est atteint par l'activité des cellules voisines auxquelles ils sont reliés. Ce qui donne lieu à la mise en branle de circuits permettant d'emprunter des chemins conduisant à tel ou tel résultat. Mais ces résultats restent largement inexplicables même par celles et ceux qui ont programmé ces réseaux artificiels de neurones, ceux-ci configurant eux-mêmes les chemins logiques qui seront effectivement empruntés sans que l'agencement de ces itinéraires soit connu a priori. On entraîne ces réseaux avec des corpus de données gigantesques, ce qui leur permet d'en déduire des règles statistique suffisamment fiables pour, après la phase d'apprentissage, prédire un résultat correct à partir de nouvelles données.
C'est ainsi que lorsque des millions d'utilisateurs auront indiqué reconnaître sur des images de captcha un passage piéton, l'algorithme d'IA d'une voiture à conduite automatique sera capable de déduire statistiquement, de manière probabiliste, que les données reçues en temps réel par une caméra embarquée reproduisent une configuration de son réseau neuronal similaire, avec un degré d'incertitude suffisamment faible, à la configuration qu'il a enregistrée à partir de ses données d'apprentissage… et qu'il faut donc ralentir et rester vigilant si une forme suffisamment proche d'un humain s'engage sur ce passage piéton.
De la même manière, en entraînant un algorithme d'IA, destiné à converser avec des humains, avec un modèle massif de langage – LLM : Large Langage Model –, il sera en capacité de prédire quel groupe de mots doit suivre statistiquement le précédent pour former une phrase correcte donnant l'impression que l'algorithme – avec sa faculté de capturer statistiquement une grande partie de la syntaxe et de la sémantique du langage humain – répond à la question de manière sensée, comme l'aurait fait un humain.
Mais, d'autre part, il a été démontré que ces réseaux de neurones – dans lesquels on aura reconnu les neurones formels de McCulloch et Pitts et les automates de von Neumann – étaient équivalents à une machine de Turing. C'est-à-dire qu'ils sont tout autant limités à n'exécuter que des fonctions mathématiques uniquement aptes à résoudre des problèmes du domaine du calculable. Il n'y a donc pas plus d'« intelligence » dans l'IA. Juste des mathématiques qui, plutôt que suivre un enchaînement logique explicite, reposent sur des calculs probabilistes.
La comparaison avec l'intelligence humaine n'a tout bonnement pas lieu d'être. L'« intelligence artificielle » aurait dû se nommer « calcul statistique automatisé ». Cela aurait certes été moins « vendeur » et généré moins de fantasmes alarmants ou enthousiastes, mais on aurait ainsi évité de considérer que ses risques ou ses apports résidaient uniquement dans la comparaison avec l'intelligence humaine. Lorsque l'on évoque l'IA, on parle en fait de la fiabilité des statistiques pour prendre des décisions, mais cela n'a rien à voir avec une quelconque intelligence. Et c'est cette fiabilité qu'il convient de mettre en doute selon les questions auxquelles elle est appliquée.
Le calcul statistique opéré par une IA pour faire des prévisions météorologiques ne pose en soi pas de gros problèmes la plupart du temps, d'autant plus que sa précision est susceptible de s'améliorer par rétroaction en comparant les prévisions avec les phénomènes réellement observés. S'imaginer qu'une œuvre produite par une IA puisse non seulement rivaliser mais tout bonnement être comparée à une création d'un cerveau humain, c'est ne pas comprendre que les deux jouent sur des terrains complètement différents : d'une part, la seule sphère du calculable, d'autre part, le champ non seulement de la logique rationnelle, mais également l'étendue infinie de l'intuition, de la sensibilité et des affects. Priver quelqu'un de liberté, parce qu'une IA aura statistiquement prédit que ce quelqu'un était susceptible de commettre un crime dans le futur dont il devrait automatiquement être jugé coupable, ne devrait pas sortir du domaine de la science-fiction. Même les précogs produisent des rapports minoritaires qui se révèlent cependant correspondre à ce qui s'est finalement passé dans la réalité.
Ce que notre enquête doit retenir de l'intelligence artificielle, c'est qu'elle n'est qu'une autre méthode mathématique, toujours aussi limitée à ne s'appliquer qu'à ce qui est du domaine du calculable – à quoi ne peut se résumer la réalité.
Et que ce soit précisément le domaine mathématique des probabilités et des statistiques – c'est-à-dire des lois sur les grandes quantités de nombres – qui s'applique à l'IA, devrait être un indice de sa conformité aux principes capitalistes de la comptabilité et des livres de comptes, de la valeur et de l'abstraction de la réalité à ce qui est quantifiable, réductible à un nombre, – bref, au numérique.
La surveillance permise par les technologies numériques est un autre objet de critique en vogue ces dernières années. Disons-le d'emblée : cette contestation, le constat qu'elle établit et les craintes qu'elles dénoncent, sont parfaitement justifiés. Oui, le numérique permet de mettre en place entre les mains d'États ou de corporations, une connaissance sans précédents des faits et gestes, des actes, et même des pensées de tout un chacun. Il a même été forgé le terme de « capitalisme de surveillance » pour désigner le stade actuel de la domination du capitalisme, reposant sur l'extraction de données numériques. Et oui, c'est quelque chose contre lequel il faut se battre, tant cela nuit à notre épanouissement individuel et collectif et à l'exercice de nos libertés afférentes, au profit d'une domination accrue d'une poignée d'individus sur le reste d'entre nous. Encore faudrait-il s'attaquer au mal à la racine… Car à quoi se résument ces critiques de la surveillance numérique ? À deux effets pervers selon le type d'acteur visé.
D'un côté, lorsqu'il s'agit des États et services de renseignement, la critique est dirigée contre la démultiplication des moyens de surveillance de leur population que confèrent les outils numériques. Le numérique n'est au fond pas en cause. Ce qui l'est, c'est la surveillance en elle-même, le numérique ne venant jouer qu'un rôle de facilitateur, d'accélérateur et d'amplificateur de cette dernière. Au fond, la critique est la même qu'elle l'était, avant l'avènement du numérique, lorsque la surveillance d'État s'exerçait par des moyens analogiques : espionnage, mouchardage, délation, interception des correspondances, écoutes téléphoniques, etc.
Quelle que soit la manière dont l'État épie ses propres citoyens, que ce soit analogiquement ou numériquement, cela lui procure des moyens coercitifs de contrôle sur sa population, privant incidemment celle-ci de libertés fondamentales, telles, qu'entre autres, celle d'aller où bon lui semble, d'exprimer ses pensées quelles qu'elles soient ou de se réunir avec qui l'on désire. Et c'est ce contrôle étatique qui est inacceptable et que l'on doit combattre.
D'un autre côté, l'État, à l'heure du numérique, n'est plus le seul acteur à exercer une surveillance. Les entreprises privées se livrent également à cette activité avec une ampleur qui n'a rien à envier aux services étatiques, au point que ceux-ci recourent fréquemment à celles-là pour bénéficier de la masse astronomique de renseignements qu'elles collectent déjà pour leurs propres besoins. Ces besoins qu'ont les entreprises de se livrer à une surveillance de leurs usagers relèvent de deux ordres. Tout d'abord, il peut s'agir d'améliorer le service qu'elles vendent – ou plus souvent, qu'elles offrent – à ces utilisateurs. Et cela ne soulève aucun émoi. Là où les critiques se font jour, c'est justement lorsque les usagers ne sont absolument pas considérés comme les clients des entreprises et que la surveillance qui s'exerce sur eux a pour objectif la satisfaction des véritables clients ou, plus prosaïquement, l'accroissement des bénéfices propres des entreprises. L'exemple paradigmatique est celui de Google, qui se sert des données collectées par l'utilisation de son moteur de recherche pour améliorer les résultats de ce dernier, mais également – et de plus en plus principalement – pour fournir aux annonceurs qui sont ses véritables clients, des renseignements suffisamment détaillés et pertinents sur les profils d'utilisateurs pour placer des publicités ciblées.
La critique est alors que les utilisateurs abandonnent gratuitement une masse de données personnelles dont les entreprises se servent et qu'elles monnaient pour leurs propres profits. En agissant ainsi, on leur reproche, d'une part, d'attenter au droit fondamental à la vie privée des usagers et, d'autre part, de générer des bénéfices sur le dos de ceux-ci sans qu'ils n'en voient la couleur. Ces deux critiques nous semblent mal placées.
Celle sur l'attentat à la vie privée car elle n'a pas lieu d'être, dans la mesure où aucune donnée personnelle n'est collectée qui n'a été livrée par l'utilisateur lui-même sur le réseau public qu'est Internet. Pour faire court, rien n'est privé sur Internet. Par nature, tout ce qu'on y fait ou dit doit être considéré comme public. Ne serait-ce que parce qu'on le fait ou qu'on le dit dans des commentaires sur un site web, dans une publication sur un réseau social ou dans un courriel, auquel l'éditeur de ce site, les employés du réseau social ou ceux du service gérant les mails, sans parler des intermédiaires techniques par lesquels transitent ces données, comme notre fournisseur d'accès Internet par exemple, ont techniquement accès. Tout au plus peut-on cacher par des moyens cryptographiques le contenu de ce que l'on échange. Mais, outre le fait qu'aucune méthode de chiffrement n'est garantie ne pas pouvoir être cassée un jour ou l'autre, on ne masque pas ainsi un certain nombre de métadonnées – le destinataire du message, la date et l'heure à laquelle il est émis et reçu, etc. – qui peuvent tout autant intéresser la surveillance, qu'elle soit privée ou étatique.
Au passage, c'est pourquoi la surveillance numérique d'État qui prend pour prétexte la lutte contre le terrorisme, au mieux sous-estime l'intelligence de ses ennemis, au pire est un leurre. Toute activité criminelle, pis encore si elle risque d'être qualifiée de terroriste, ne saurait se dérouler en ligne. Car elle serait alors de fait publique et susceptible d'être découverte. Au grand dam des décideurs politiques, facilement enclins à rassurer leurs électeurs en invoquant un solutionnisme technologique, les professionnels du renseignement ne cessent de le rappeler : ce dont ils ont besoin, c'est de moyens humains davantage que de légalisation de leurs moyens numériques.
Quant à la critique sur le profit engrangé sans rétribution des utilisateurs, elle se condamne à être malvenue tant qu'elle vise un des principes du capitalisme sans remettre en cause celuici. Quoi ? Une entreprise capitaliste fait du profit et ce serait intolérable ? Mais allons ! C'est là sa raison d'être. Oui mais elle gagne de l'argent grâce aux actions des utilisateurs – certains vont même jusqu'à dire : grâce à leur travail – qui devraient être de ce fait rémunérés. La belle affaire ! Quand bien même les usagers d'un service numérique seraient considérés comme ses clients, la valeur d'une marchandise d'un point de vue capitaliste n'est jamais réalisée que grâce à ceux-ci lorsqu'ils l'achètent. Et faire entrer dans le rapport spécifiquement capitaliste du travail, des actes effectués librement sans la contrainte du cadre du salariat, est une hérésie renforçant la sphère d'emprise du capitalisme. Si l'on veut critiquer le fait que la surveillance numérique engendre des profits, c'est plutôt à la notion même de profit qu'il conviendrait de s'attaquer.
Non, ce qui nous paraît plus pertinent serait de bien voir que la surveillance, tant étatique que privée, repose sur la mise en données numériques des actions et comportements des personnes et qu'elle les réduit à cela et uniquement à cela. Car ce sont uniquement ces données numérisées qui peuvent être manipulées, analysées, recoupées et, par la suite, permettre d'anticiper des actes et comportements futurs et contrôler, ainsi qu'orienter ceux-ci.
C'est ce que notre enquête a très tôt soulevé : l'ubique consiste en une abstraction de la réalité, modélisant celle-ci sous forme mathématique, opérant sur ces modèles et restituant les résultats de ces opérations au réel, agissant ainsi sur celui-ci et le modifiant à sa guise – ou presque. « Presque », car c'est une illusion de croire que les modèles numérisés captent l'intégralité du réel. Les données numériques collectées par les États ne représentent jamais dans toute leur complexité les personnes réelles qu'ils veulent surveiller. Celles compilées par des entreprises afin de vendre des profils d'utilisateurs ne seront jamais qu'une pâle imitation incomplète de ceux-ci.
Ce qui devrait être critiqué dans la surveillance numérique, c'est l'opération même de numérisation de la réalité. Dans la mesure où une fois celle-ci effectuée, on en oublie l'irréductible incomplétude de cette numérisation et l'on en tire des décisions comme si elle ne l'était pas, décisions qui ont pourtant des effets directs sur le réel complet et entier.
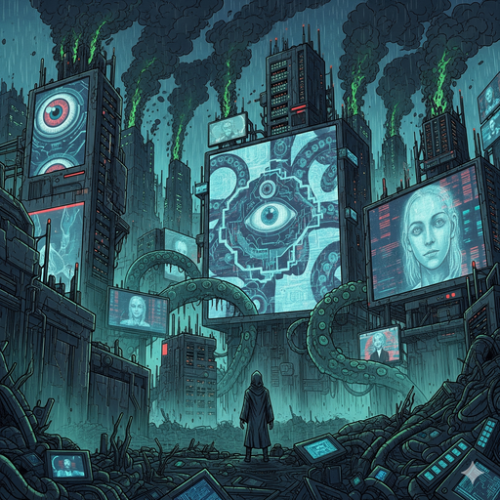
Il en va de même en ce qui concerne le troisième
type de critique que nous nous somme proposés de passer en revue ici : celle sur l'impact écologique du numérique. Cette dernière critique a l'immense mérite de soulever que les opérations mathématiques abstraites du numérique reposent sur des ressources bel et bien concrètes. On a besoin de matériaux pour construire les équipements et éléments de réseaux et l'on a besoin d'énergie pour les faire fonctionner. Le constat est juste, important et salutaire.
De ce constat, la critique environnementale du numérique n'en tire guère d'autre conclusion que la recommandation d'une incitation à la sobriété numérique, que celle-ci prenne la forme de réglementations contre l'obsolescence programmée, de préconisation d'achats d'occasion ou de matériels reconditionnés, de limitation du nombre et de la taille des écrans ou du volume et de la qualité des vidéos, ou qu'elle aille jusqu'au questionnement des besoins en matière de conception de logiciels pour éviter les fonctionnalités inutiles. Le point le plus avancé de cette critique semble atteint lorsqu'elle affirme que tout n'a pas besoin d'être numérisé mais – est-ce par crainte d'aller trop loin ? – les exemples cités sont alors les services publics et d'entreprise.
Sans nous étendre davantage dans la critique de la critique, constatons que ce que notre enquête a montré nous permet de pousser cette critique environnementale à un stade supérieur, seul susceptible d'avoir une effectivité réelle.
En effet, qu'est-ce qui motive cet accroissement de la numérisation et corrélativement des besoins en matériels et énergies préjudiciables à l'environnement ? Ici encore, c'est la croyance en la complétude des modèles numériques pour représenter et agir sur la réalité. Et in fine cette croyance est celle de la phase du capitalisme que nous avons qualifiée de cybernétique. C'est la logique même du capitalisme d'exiger une croissance sans cesse renouvelée de la production de valeur et des profits ainsi générés. Le numérique – et plus globalement les technologies – ayant été élevé comme source de valeur à notre époque – à tort ou à raison, nous y reviendrons dans un futur volet de notre enquête –, le capitalisme ne peut que souhaiter et imposer son extension.
Ouvrons ici une parenthèse pour remarquer que cela rejoint le problème de la surveillance numérique. À un stade précoce, sa principale incarnation résidait dans le projet Échelon d'interception des communications numériques, mené conjointement par les États-Unis, le Royaume-Uni, le Canada, l'Australie et la Nouvelle-Zélande dès l'après-guerre. Lorsqu'il fut révélé à la fin des années 1980, une stratégie de lutte contre la surveillance d'Échelon a été de sursaturer ses capacités d'interception en générant ponctuellement une masse de données numériques telle qu'Échelon ne pouvait digérer. Une telle stratégie n'est plus possible aujourd'hui, car — et cela rejoint également le problème de l'« intelligence artificielle » – la surveillance numérique utilise de nos jours les techniques statistiques de l'IA, pour lesquelles plus le volume de données est important, plus le résultat sera fiable. Fin de la parenthèse.
Dès lors, la critique environnementale ne peut faire l'économie d'une remise en cause radicale du capitalisme.
Et c'est bien là tout l'objet de la de la suite de notre enquête. Il nous faut découvrir – tant est que cela est possible – ce qui dans l'ubique permettrait d'attaquer le capitalisme en plein cœur. C'est-à-dire contrecarrer le pôle numérique de l'ubique. C'est pour cette raison que nous avons ici plus parlé de numérique que d'ubique. Car ce qui doit être visé par la critique, c'est précisément sa face numérique. Et effectivement, même si elles n'en ont pas conscience et malgré les lacunes que nous avons soulignées, les trois grandes catégories de critiques présentées ici s'adressent explicitement au numérique. Jamais à l'informatique.
Il est donc grand temps d'explorer le pôle informatique de l'ubique.
27.10.2025 à 16:32
L'appel de Ghoulhou
dev
Texte intégral (897 mots)

Jamais il n'aurait cru rencontrer ces gens-là dans le désert, et pourtant, au fur et à mesure qu'il s'approchait, il voyait - plus qu'il n'entendait, comme dans un récit de Lovecraft - la voix molle coulant sur la tête des généraux « du sang de sable dans la bouche à sang et feu » et des soldats raides, les yeux crevés autour des pupilles « vous les dégraissés les os rasés à feu et sang car l'armée massacre jusqu'à ce que vos parents vous ignorent mes soldats mes langues coupées mes bourses chevrotantes dans le néant » tandis que du haut des miradors, des policiers masqués tiraient au hasard dans le public, sous les acclamations et les cris de terreur mélangés, et que s'affichait sur des écrans géants le nom des exécutés, avec leur visage, et une courte vidéo de synthèse qui les montrait aux anges, suçant les oreilles de Ghoulhou, le patriarche incorruptible qui gouvernait ce qu'il restait du pays dévasté.
Il savait qu'il avait eu tort de remonter des territoires communs du sud vers la monarchie du grand nord, mais il voulait revoir ce désert qui l'avait tant marqué, puisque c'est là qu'il avait senti, pour la première fois, que la Terre était une contemplation risquée avant d'être une sphère du vivant. Il avait oublié que le désert, rebaptisé concrete©, était désormais le lieu où le secrétaire de la pureté s'adressait rituellement à l'armée de la régénération. « Cette voix, cette voix », pensait-il, « elle s'est vidée de ce qui fait la voix humaine, elle s'est retournée contre elle-même, contre ses spectres, et les organes à découvert essayent de composer un semblant d'autorité humaine avec des ordres, je veux dire avec des ordures, des ordures de mots, des mordures ? Je ne sais plus moi-même très bien parler, comme si cette infection finissait par m'atteindre », se dit-il, en se demandant s'il ne ferait pas mieux de faire demi-tour au plus vite.
Mais le secrétaire de la pureté continuait à dévaler dans les orifices des militaires tremblants, « vous êtes nos déchets obéissants et par vos actions vous pourrez transformer tout en déchet vous nos virus aveuglés, et vous exploserez quand on vous le dira fini le bullshit fini l'autre fini les choses sans nom qui ne sont pas des hommes, la mascarade est brûlée, voici l'âge des pluies d'excréments bénis, l'âge des sans-peau des tortures civiques des ennemis de l'intérieur, pouvoir aux malfrats ! tout ce qui est libre est en prison ! prosternez-vous devant les menteurs que vous méritez ! désormais chacun pourra renier plus de trois fois tout ce en quoi il n'aura jamais cru assez, vos peurs sont inutiles car votre tour est venu, vous êtes dans la salle de balles, chez vous n'est plus chez vous ailleurs c'est chez Ghoulhou, votre parole est celle de Ghoulhou, votre argent est la survie que Ghoulhou vous octroie avant de vous broyer, votre futur est l'apocalypse au réveil, le son de votre corps mastiqué par Ghoulhou » mais il n'en pouvait plus d'entendre le surmoi des êtres déchus, et il craignait que ses pensées réfractaires soient repérées par les neurotaupes.
Il décida alors de repartir vers les territoires du sud, et se dit : « Me désespère plus encore que ces êtres, anémiés par l'absence de tout contact avec le cœur de la vérité, une fois retournés au néant qu'ils n'ont jamais vraiment quitté, dépecés par les foules qui finiront par les renverser, seront de retour. Encore, encore une fois », dit-il, sur la piste qu'il suivait dans la nuit obscure, accablé par le poids de l'éternel retour, « parce que les sociétés à peine cicatrisées oublieront l'Histoire et qu'à nouveau déferleront les vagues de fer et de sang, à nouveau les faux guides, les faux penseurs, les faux artistes servants les machines en vigueur, pourront infliger leur cruauté ».
Il cessa de marcher. La mélancolie pesait sur ses épaules, et il s'enfonçait dans les sables. À ce moment précis, un jet de lumière lunaire perça l'obscurité, rien qu'un instant, avant de disparaître. Mais ce sont tous les échos stellaires qui alors lui apparurent, « la lune emprunte sa lumière au soleil », pensa-t-il, et il entendit un son qui avait la lenteur des pierres, et traversait le mur du temps, « quel philosophe déjà disait que nous sentons que nous sommes éternels ? Oui », se dit-il reprenant son chemin inexistant, « le retour dernier, c'est celui du non-créé, notre souveraineté ».
Mais, tandis qu'il revenait dans les territoires communs, et qu'il passait devant les gardiens de l'aurore, une pensée le tourmentait : il savait bien qu'un jour il leur faudrait faire face aux adeptes de la monarchie du grand nord.
Atom de Seth
- GÉNÉRALISTES
- Ballast
- Fakir
- Interstices
- Lava
- La revue des médias
- Le Grand Continent
- Le Diplo
- Le Nouvel Obs
- Lundi Matin
- Mouais
- Multitudes
- Politis
- Regards
- Smolny
- Socialter
- The Conversation
- UPMagazine
- Usbek & Rica
- Le Zéphyr
- Idées ‧ Politique ‧ A à F
- Accattone
- Contretemps
- A Contretemps
- Alter-éditions
- CQFD
- Comptoir (Le)
- Déferlante (La)
- Esprit
- Frustration
- Idées ‧ Politique ‧ i à z
- L'Intimiste
- Jef Klak
- Lignes de Crêtes
- NonFiction
- Nouveaux Cahiers du Socialisme
- Période
- Philo Mag
- Terrestres
- Vie des Idées
- ARTS
- Villa Albertine
- THINK-TANKS
- Fondation Copernic
- Institut La Boétie
- Institut Rousseau
- TECH
- Dans les algorithmes
- Framablog
- Gigawatts.fr
- Goodtech.info
- Quadrature du Net
- INTERNATIONAL
- Alencontre
- Alterinfos
- CETRI
- ESSF
- Inprecor
- Journal des Alternatives
- Guitinews
- MULTILINGUES
- Kedistan
- Quatrième Internationale
- Viewpoint Magazine
- +972 mag
- PODCASTS
- Arrêt sur Images
- Le Diplo
- LSD
- Thinkerview
- Fiabilité 3/5
- Slate
- Fiabilité 1/5
- Contre-Attaque
- Issues
- Korii
- Positivr



