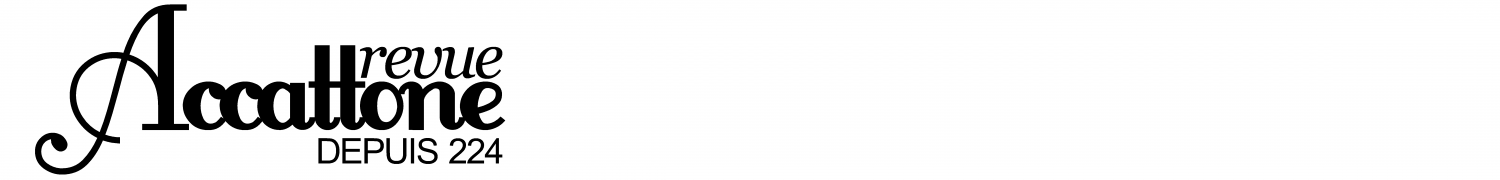05.03.2022 à 14:10
Le Mythe comme réalité
Fabrizio Tribuzio-Bugatti

Texte intégral (2707 mots)

L’attachement au sacré est l’une des spécificités pasoliniennes les plus singulières. Plus qu’aucun autre intellectuel ou littérateur, Pasolini insistait pour affirmer le mythe comme partie intégrante de la réalité. Reprenant le concept de hiérophanie à Mircea Eliade – soit la manifestation du sacré dans le réel, manifestation perçue subjectivement bien sûr – il le traduisit cinématographiquement, dans Médée entre autre, mais aussi dans sa propre lutte contre la société de consommation. Ainsi, « seul celui qui est mythique est réaliste et seul celui qui est réaliste est mythique. » Toutefois, Pasolini ne s’y trompait pas : « Par sa nature même le cinéma ne peut pas représenter le passé. Le cinéma représente la réalité à travers la réalité : un homme à travers un homme ; un objet à travers un objet. » Il faut appréhender ses films comme Médée ou Œdipe Roi, par exemple, comme des métaphores du temps présent. Il ne faut pas oublier qu’en tant que marxiste, même hétérodoxe, Pasolini conserve une certaine démarche historiciste dans ses œuvres cinématographiques, l’Histoire est donc toujours contemporaine. Ou, à l’inverse, « la réalité ne fait pas partie de notre vie – en tout cas telle qu’elle se présente à nos yeux –, c’est en fait un plan-séquence infini. […] Le cinéma n’est rien d’autre qu’une caméra capable de saisir ce mouvement continu. » Bref, « Le cinéma n’est rien d’autre que la réalité. Disons-le ainsi : le cinéma est la langue écrite de la réalité. »
« Seul celui qui est mythique est réaliste et seul celui qui est réaliste est mythique »
Une autre des distinctions importantes de la pensée pasolinienne est incontestablement celle qu’il posa entre l’idée de Dieu et de sacré. Laïc, agnostique et athée, comme il se définissait lui-même, Pasolini croyait cependant au divin, à la hiérophanie plus exactement. Dans son entrevue enregistrée à New-York en 1969, le poète répondit en ces termes au journaliste qui l’interrogeait : « Je suis persuadé de cela : l’homme d’autrefois, l’homme pré-industriel, l’homme qui vivait dans une civilisation paysanne, pouvait percevoir la présence du sacré, dans chaque objet, quel que soit l’évènement, à chaque instant de sa vie. » Bref, « n’importe quelle apparition terrestre, à n’importe quel moment de sa vie, pouvait être une hiérophanie. » C’est un point sur lequel Pasolini diverge grandement de Gramsci. Si ce dernier reconnaissait que le paysan fait partie d’un monde de superstitions et de crainte envers ce que Pasolini nommait la hiérophanie, c’est pour illustrer la nécessité de l’école obligatoire afin d’en faire un citoyen éclairé et rationnel. À l’inverse, Pasolini désavouait l’école obligatoire en ce qu’elle pourvoit un enseignement unique, lequel ne serait rien d’autre, selon lui, que la première étape de l’enrégimentement des masses par le « nouveau Pouvoir ». Ce qu’il appelait justement « les petites patries » à l’intérieur de la grande, se caractérisaient non seulement par leurs idiomes et leurs cultures, mais aussi par leur réalité paysanne, réalité dont le paradigme mythique lui était indissociable jusqu’à la fin du second conflit mondial.
Or, le propre de la société de consommation et la culture de masse qu’elle produit selon Pasolini est l’anéantissement des anciennes valeurs. C’est un vase clos, « qui a des lois internes et une autosuffisance idéologique capables de créer automatiquement un pouvoir qui ne sait plus que faire de l’Église, de la Patrie, de la Famille et autres semblables lubies », comme il l’écrit dans ses Écrits Corsaires. Ainsi, son film L’Évangile selon Saint Matthieu ne correspond pas à une ode au christianisme ecclésiastique, mais à la mystique chrétienne originelle, à la force poétique de l’Évangile, et donc à cette société précapitaliste qu’il chérissait tant. Malgré son anticléricalisme, Pasolini distinguait la dimension cultuelle du christianisme de sa dimension culturelle, et admettait volontiers : «Il me semble qu’il soit ingénu, superficiel, factieux d’en nier ou d’en ignorer l’existence. […] Je serais fou de renier une puissante force pareille qui est en moi. » Néanmoins, l’Évangile demeure une œuvre artistique avant tout : « C’est une œuvre de poésie que je veux faire. Pas une œuvre religieuse au sens courant du terme, ni une œuvre idéologique de quelque manière que ce soit. » Cette ambivalence est illustrée dans cette seule citation : « Peut-être est-ce parce que je suis si peu catholique que je pus apprécier l’Évangile et en faire un film. » Nonobstant cela, L’Évangile demeure tout de même l’œuvre où Pasolini illustrait cette hiérophanie qui lui semblait si importante et caractéristique de l’ancien monde. Si de son point de vue il n’était pas question d’aborder le Christ comme fils de Dieu, il n’en dépouilla pas pour autant le Fils de l’Homme de sa nature divine. Dans Sept poésies et deux lettres se trouve un éclaircissement de la part du poète qui exprimait ainsi sa projection de Jésus : « En des termes plus simples : je ne crois pas que le Christ fut le fils de Dieu, parce que je ne suis pas croyant, au moins consciemment. Mais je crois que le Christ fut divin, parce que ce fut en lui que l’humanité fut si haute, rigoureuse, idéale, d’aller au-delà des lieux communs de l’humanité. » Sa vision de la figure du Christ ne dérogeait donc absolument pas à son paradigme de la hiérophanie.
Cette ambivalence lui fut souvent reprochée, notamment à la suite de la présentation de L’Évangile à Paris en 1964, où Pasolini fut violemment apostrophé par la caste intellectuelle de la gauche française, qui lui reprochait au mieux une certaine schizophrénie, au pire de n’être qu’un sombre fumiste. L’article « Cristo e Marxismo » paru dans la presse italienne quelques jours plus tard relata les rapports houleux entre Pasolini et ses détracteurs, notamment le cas d’un journaliste du Nouvel Observateur qui lui lança : « C’est un film fait par un prêtre pour les prêtres », avant de quitter la salle en refusant de « serrer la main d’un hypocrite. » Cet affrontement, qui confirma le surnom d’« hérétique » de Pasolini vis-à-vis d’une certaine gauche, nous offrit cependant l’une des réparties les plus cinglantes du poète envers le dogme de la Raison cultivé en France : « Je vois clairement le danger qui court en France : il est laborieux pour l’intellectuel français de reconnaître l’irrationnel, le moment de la faim, du sous-prolétariat. Sa surdité, qu’il justifie de toutes les façons possibles, l’a aujourd’hui mis en dehors de la réalité historique du monde entier. » Il enfoncera le clou dans son film Des oiseaux, petits et gros, dont le corbeau symbolisa les milieux parisiens marxistes et rationalistes. C’est cependant dans l’entrevue new-yorkaise que Pasolini explicite le mieux cette ambivalence. Si le monde paysan sacral n’existait plus, il en était cependant issu, et malgré lui, « cependant, et c’est là la contradiction, la réalité est toujours une hiérophanie. » Dès lors, comment concilier le sacré sans la croyance en Dieu, soit sans théophanie, alors que l’ancien monde croyait parfois voir l’ombre de Dieu dans la manifestation du sacré, pour un athée comme Pasolini ? Ce dernier offrit une réponse légèrement tirée à quatre épingles : « ma religion est une forme d’immanentisme ; la réalité est hiérophanie ; mais puisque je ne crois pas en un dieu transcendant – et que d’autre part la réalité est hiérophanie – cela signifie que la réalité même est Dieu. Autrement dit, la réalité est une théophanie. Autrement dit, il s’agit bien d’une forme d’immanence ; énoncées aussi simplement, toutes les contradictions se résolvent. »
Pasolini procéda par syllogisme pour résoudre ce paradoxe personnel, chose assez paradoxale étant donné que son objet est irrationnel. Il traita la question, laquelle échappe à la raison, par un raisonnement logique. Bref, en conférant une justification rationnelle à un objet irrationnel. En creusant philosophiquement et même théologiquement la question, il est possible s’interroger sur l’hypothèse qu’ici Pasolini esquissa prudemment – et peut-être inconsciemment – les contours d’une mystique païenne, dont sa région d’origine, le Frioul, garda longtemps des survivances.
Dès lors, on comprend mieux le cinéma pasolinien, tout du moins on saisit mieux ce qui semblait nous échapper en visionnant Médée ou Œdipe Roi. Pasolini y conjugua nombre d’éléments de sa culture personnelle ; de l’historicisme à la hiérophanie en passant par la confrontation entre l’ancien monde sacral et le nouveau monde rationnel.
« Le cinéma représente la réalité à travers la réalité […] : c’est-à-dire en représentant un temps moderne, en quelque sorte analogue au temps passé »
En tout état de cause, le péplum de Pasolini n’est pour ainsi dire pas celui qu’on s’imagine. Lorsqu’il tourna Médée ou Œdipe Roi, Pasolini rompit les habitudes cinématographiques auxquelles le public fut habitué par la machine hollywoodienne. Les costumes et décors représentent toujours la réussite de Pasolini à réinventer l’Antiquité, loin des toiles de la Renaissance ou de la peinture d’histoire du XIXe siècle : l’antiquité pasolinienne est visuellement barbare et sacrée, comme le note Olivier Maillart dans son entrée sur Pasolini du Dictionnaire du Cinéma Italien. Quant à la question du choix du mythe de Médée, là encore, on peut lire dans Poesie e pagine ritrovate que Pasolini y voyait la représentation manifeste de la hiérophanie, et son choix s’arrêta sur La Callas pour une raison bien spécifique : « Cette barbarie qui est profondément en elle, qui s’échappe de ses yeux, dans ses linéaments, mais ne se manifeste pas directement, au contraire la surface est presque lisse. » Malgré la « déréalisation » des corps qu’exerçait déjà la société de consommation, c’est encore vers eux, au moment de Médée, que Pasolini se tournait. Réalisé avant sa Trilogie de la Vie, le corps incarnait encore, à ce moment-là, la résistance au nouveau Pouvoir selon le poète. Le dualisme pasolinien entre l’ancien monde sacral et le nouveau monde rationnel y est perceptible. Pasolini décrivit en effet Médée comme: « la confrontation de l’univers archaïque, hiératique, clérical, avec le monde de Jason, monde au contraire rationnel et pragmatique. Le drame entier repose sur ce contraste réciproque de deux « cultures », sur l’irréductibilité réciproque de deux civilisations. » Le monologue du Centaure que Jason retrouve une fois adulte nous éclaire bien sur ce contraste ; apparaissant sous des traits totalement humains, il reprend sa forme mythique lorsque Jason lui demande pourquoi il lui apparaît ainsi. L’explication du Centaure est alors d’une logique des plus brutales : sa forme mythique n’existait que parce que Jason croyait le percevoir ainsi, sans que cela ne fût réel. La hiérophanie se retrouva ainsi rationnalisée par le monde moderne de Jason. Pasolini reprit ici totalement la thèse d’Eliade dans Le sacrée et le profane : « L’homme areligieux descend de l’homo religiosus et, qu’il le veuille ou non, il est aussi son œuvre […]. Il se constitue par une série de négations et de refus, mais il continue encore à être hanté par les réalités qu’il a abjurées. »
Dans son Essai sur la littérature et sur l’Art où l’on retrouve quelques déclarations et entrevues, Pasolini précisa bien que, selon lui, « le cinéma représente la réalité à travers la réalité », « par sa nature même le cinéma ne peut pas représenter le passé ». Son cinéma est pour ainsi dire analogique. Médée, par exemple, fut tourné parce qu’il entrait en écho avec l’époque de Pasolini, comme il l’explicitait lui-même : « dans mes films historiques, je n’ai jamais eu l’ambition de représenter un temps qui n’est plus ; si j’ai tenté de le faire, je l’ai fait à travers l’analogie : c’est-à-dire en représentant un temps moderne, en quelque sorte analogue au temps passé. » Les plans sur le monde de Médée, brutal, archaïque, mais hiérophane, sont donc l’illustration des propos de Pasolini : « Il existe encore des lieux du Tiers Monde où sont pratiqués des sacrifices humains ; et il existe encore des tragédies d’inadaptation d’une personne du Tiers Monde au monde moderne ; c’est cette persistance du passé dans le présent que l’on peut représenter objectivement. » Le procédé cinématographique de Médée repose donc entièrement sur la métaphore, et pour qu’icelle ait une force poétique irrésistible, son cadre nous apparaît intemporel, inactuel, en un lieu qui pourrait aussi bien se trouver en Anatolie qu’au Maghreb alors que le mythe se déroule en Grèce. Cela découle de la volonté de Pasolini d’universaliser le génocide culturel perpétré par le consumérisme. Comme il l’affirma lui-même dans Le rêve du Centaure : «Ce pourrait être aussi bien l’histoire d’un peuple du Tiers-monde, d’un peuple africain, par exemple, qui connaîtrait la même catastrophe au contact de la civilisation occidentale matérialiste. »
05.03.2022 à 12:00
La Force révolutionnaire du Passé
Fabrizio Tribuzio-Bugatti

Texte intégral (3534 mots)

Le passé selon Pasolini se caractérise par le sacré, et réciproquement. L’importance que Pasolini attachait au passé n’était nullement conservatrice ou réactionnaire ; c’est une notion qu’il oppose à la modernité et la société de consommation pour en illustrer le désenchantement. Il ne s’agit pas d’une nostalgie nourrie envers une époque à laquelle il rêvait de retourner, comme il s’en expliquera par ailleurs, mais avant tout un repère pour désigner la dérive qu’a pris la notion de progrès en se confondant avec celle de développement.
« Le passéiste célèbre les cicatrices, le révolutionnaire les rouvre pour guérir l’avenir »
Le passé chez Pasolini peut se rapprocher de l’appréhension qu’en avait Simone Weil. Il est non seulement la source de toute révolution, mais surtout sa matrice : une révolution qui ne s’inscrit pas dans la sauvegarde du passé n’en est pas une. Pasolini rejoignait cette vision où la fonction revivifiante du passé est la caractéristique de toute révolution, qui n’a aucunement pour but d’incarner une tabula rasa des anciennes valeurs au profit de celles homologuées par le Progrès. Les fameux vers tirés de Poésies Mondaines du recueil Poésie en forme de rose en sont l’illustration la plus connue : « Je suis une force du Passé/Tout mon amour va à la tradition/Je viens des ruines, des églises,/des retables d’autel, des bourgs/oubliés des Apennin et des Préalpes/où mes frères ont vécu. » La conclusion du poème laisse cependant entrevoir la véritable originalité de Pasolini : « Et moi je rôde, fœtus adulte,/plus moderne que n’importe quel moderne/pour chercher des frères qui ne sont plus. »
Cette « modernité pasolinienne » est caractéristique de l’ambivalence qu’aimait manier le poète en se jouant des acceptions nouvelles que prenait le langage lors du « miracle économique italien », où le champ du moderne recouvrit indifféremment le progrès, le développement, et la notion même de modernité, qui prirent tous un sens uniforme tandis que Pasolini s’acharnait à rétablir les distinctions conceptuelles de chacun de ces termes. En affirmant être « une force du Passé » amoureux de la tradition, Pasolini ne se posait absolument pas en coreligionnaire de Julius Evola, mais en véritable moderne. L’idée d’une modernité qui se prétend vertueuse en rompant avec l’Histoire est un contresens, une sortie de l’Histoire irrémédiable entraînant la société dans un cycle nihiliste que Pasolini qualifiait de « post-histoire ». Selon lui, ce sont les valeurs authentiques du passé, précapitaliste et paysan, qui doivent incarner une boussole pour l’avenir ; le progrès ne serait jamais rien d’autre qu’une tautologie, une espèce d’immanence purement sémantique mais fallacieuse ; le progrès ne peut valoir, selon lui, uniquement pour lui-même, mais en reposant sur des valeurs populaires. Au contraire, le passé pour Pasolini est synonyme de vie, comme on le voit dans les vers de Pilade : « La plus grande attraction de chacun d’entre nous/ Est vers le Passé, parce qu’il est l’unique chose/ Que nous connaissons et aimons vraiment./Tant que nous le confondons avec la vie. » Il y a donc, pour Pasolini, un lien direct entre le passé et la vie, l’amour du passé et la sacralité de la vie sont les deux faces d’une même médaille. La nostalgie n’est pour lui qu’un instinct normal chez l’individu. Or, le vers « Tant que nous le confondons avec la vie » dévoile un élément important ; c’est lorsque le Passé devient un symbole méprisable que la vie est à son tour méprisée, et avec elle tout ce qui touche au monde sensible, annihilant ainsi toute volonté de révolution. Les dénonciations de Pasolini envers l’objectivation du corps, de l’uniformisation d’iceux, ou encore de l’annulation de la personnalité de chacun, en découlent directement. Ce processus, selon Pasolini, est typique de la modernité et de sa fausse tolérance, qui ne tolère en réalité rien d’autre qu’elle-même, comme il le dit si bien dans ses Lettres Luthériennes : « J’entends déjà leurs argumentations : est passéiste, réactionnaire, ennemi du peuple, quiconque ne sait pas comprendre les éléments de nouveauté, même dramatiques, qu’il y a dans les fils. »
Les procès en nostalgie envers Pasolini furent le florilège de la presse italienne ; notamment de la part d’Italo Calvino qui, comme le disait Pasolini, affirmait la même chose que lui mais refusait de lui donner raison parce qu’il ne le disait pas de la même manière. Pasolini fût ainsi contraint de consacrer un article entier à démentir sa nostalgie pour « l’Italietta », surnom désignant l’Italie des années d’après-guerre qui se caractérisait certes par son miracle économique, mais surtout par la toute-puissance de ce que Pasolini nommait le « clérical-fascisme », phase politique où le pouvoir italien dominé par la Démocratie Chrétienne qui entretenait une relation politique forte avec le Vatican dans la manière de gouverner la péninsule, notamment dans les domaines sociaux et culturels. Le film Cinema Paradiso de Tornatore mettant en scène la censure du curé du village qui visionnait les films avant leur sortie était l’une des traductions quotidiennes des plus banales.
Donc, Pasolini, dans sa réponse à Italo Calvino dans un article du 8 Juillet 1974 titré « Étroitesse de l’histoire et immensité du monde paysan » dans les Écrits Corsaires mais parut originellement dans Paese Sera (sous le titre de « Lettre ouverte à Italo Calvino : Pasolini : ce que je regrette »), eut à répondre des accusations d’une nostalgie déplacée pour l’« Italietta ». « Tout le monde dit que je regrette quelque chose, en faisant de ce regret une valeur négative, et donc une cible facile. Ce que je regrette (si tant est que l’on puisse parler de regret), je l’ai dit clairement, et même en vers. Que d’autres aient fait semblant de ne pas comprendre, c’est naturel, mais je m’étonne que tu n’aies pas voulu comprendre, toi qui n’a aucune raison pour cela. »
Il est déjà possible de saisir dans ce début de réponse une caractéristique de la rhétorique pasolinienne ; celle de prendre ses détracteurs à parti – comme ici Calvino – pour les mettre face à leur autisme envers Pasolini lui-même plus qu’envers son propos. Tout est affaire de langage chez Pasolini, et même si de temps à autre cela put lui nuire, il s’en expliqua à chaque fois qu’il l’estimait nécessaire. Par ailleurs, ces lignes nous donnent un autre élément représentatif de son attachement au passé mais aussi au symbolisme. Pasolini s’étonnait que le regret, et la nostalgie – ou sa nostalgie – plus généralement, pussent recouvrir une valeur négative. Le propre de Pasolini lorsqu’il interrogeait la pertinence des arguments ou des préjugés inhérents au discours « progressiste » demeurait justement en sa volonté d’interroger avant tout l’origine et la légitimité des valeurs que le Progrès impose. Ainsi, si Pasolini admettait bien qu’il regrettait, sa rhétorique ne consistait pas à défendre la notion de regret, mais la valeur qui lui est attribuée à l’aune des temps modernes, contre-argument qui la plupart du temps laissait ses contradicteurs dans l’embarras d’être pris au piège avec leurs propres… contradictions.
« Moi, regretter l’Italietta ? Mais alors tu n’as pas lu un seul vers des Cendres de Gramsci, ou de Calderon, tu n’as pas lu une seule ligne de mes romans, tu n’as pas vu une seule photo de mes films, tu ne sais rien de moi ! Car tout ce que j’ai fait, tout ce que je suis, exclut de par sa nature même que je puisse regretter l’Italietta. »
En raillant Calvino de la sorte, Pasolini laissait entendre plusieurs choses. La première concerne l’attaque infondée de Calvino en tant qu’intellectuel qui émit un procès d’intention envers Pasolini comme s’il le découvrait pour la première fois. Or, en tant qu’intellectuel, Calvino n’avait pas l’excuse de ne pas connaître l’une ou l’autre œuvre de Pasolini, au contraire. De plus, l’affirmation « tout ce que je suis, exclut de par sa nature même que je puisse regretter l’Italietta » nous livre deux niveaux de lecture. Le premier, plus simple, concerne l’activité artistique de Pasolini, c’est donc l’artiste lui-même, de par ses choix, ses œuvres, qui exclut tout regret. Le second concerne Pasolini en tant que personne, avec sa culture personnelle et ses mœurs. Or, la vie de Pasolini fut ponctuée par les procès d’atteintes aux bonnes mœurs, mais aussi par son homosexualité revendiquée et méprisée par ce pouvoir clérical-fasciste. Ce sont ces deux dimensions, artistiques et personnelles, qui font que Pasolini ne pouvait qu’incarner une résistance vivante face à un régime dont il affirmait la continuité fidèle avec le ventennio. Pasolini opérait une véritable distinction entre le passé qu’il chérissait et celui des mœurs policée qu’il méprisait et qui le persécutait. Si certains font l’amalgame entre l’amour du passé et la réaction, la rhétorique de Pasolini permet de couper court à pareilles arguties : « il me faut rompre les barrières naturelles (et innocentes) des classes, défoncer les murs de l’Italietta, et donc me mouvoir dans un autre monde : le monde paysan, le monde sous-prolétarien, le monde ouvrier. […] C’est ce monde paysan éclairé, prénational et pré-industriel, qui a survécu jusque-là il y a quelques années, que je regrette ». Ce n’est pas un âge d’or que regrettait Pasolini, au contraire : « les hommes qui peuplaient cet univers ne vivaient pas un « âge d’or », parce qu’ils n’étaient pas liés, sinon formellement, à l’Italietta. Ils vivaient ce que Chilanti a appelé l’âge du pain, c’est-à-dire qu’ils étaient consommateurs de bien de toute première nécessité. »
Cette dichotomie est primordiale pour comprendre la nostalgie pasolinienne. Ce que le poète aimait dans la société précapitaliste, c’était cette proéminence de l’abondance frugale, en opposition avec la société de consommation, « c’est sans doute cela qui rendait leur vie pauvre et précaire extrêmement nécessaire, tandis qu’il est clair que les biens superflus rendent la vie superflue (cela dit pour être très élémentaire, et en finir avec cet argument.) » Son amour du passé était « de toute façon [son] affaire », comme il l’ajoutait lui-même, puisque cette nostalgie, en lui permettant de se détacher de la société de consommation, lui permettait justement de la critiquer lucidement. Pasolini tient beaucoup du stoïcisme en cela ; ses fuites aux Tiers-Monde, et notamment en Inde, pour satisfaire son plaisir coupable de plonger dans des sociétés encore préservées du monde consumériste et moderne (mais, comme il le relevait, déjà en train de pénétrer dans « l’orbite du soi-disant développement » au fil des années 1970) ne sont rien d’autre que le retrait du sage dans la contemplation, pour mieux se réinvestir dans la vie de la cité.
Enfin, Pasolini, en bon gramscien, était historiciste. L’Histoire est contemporaine, et la rupture avec le Passé entraînait pour lui une sortie irrémédiable de l’Histoire : « Où je regarde les crépuscules, les matins/ Sur Rome, sur la Ciociaria, sur le monde,/ Comme les premiers actes de la post-histoire,/ À laquelle j’assiste, par privilège d’anagraphe ». C’est toutefois dans La Rabbia qu’il exprimera le plus clairement sa fureur contre le nihilisme consumériste, et pourquoi la Révolution, si elle ne sauve pas le passé, n’en est pas une : « Mais seule la révolution sauve le passé. Quand il ne restera plus rien du monde classique, quand tous les paysans et les artisans seront morts, quand l’industrie aura fait tourner sans répit le cycle de la production et de la consommation, alors notre histoire sera finie. » Dans le poème Projet d’œuvres futures qui clôt Poésie en forme de rose, Pasolini affirme en effet que : « Pour celui qui est crucifié à sa rationalité navrante,/ Macéré dans le puritanisme, il n’a plus de sens/ Qu’un aristocrate, et ah ! impopulaire opposition./ La Révolution n’est plus qu’un sentiment. »
« Je suis en ce moment apocalyptique »
À la fin de sa vie, dès le début des années 1970, Pasolini changea cependant son point de vue. Déchiré par la mutation provoquée par l’italien comme langue nationale issue non pas d’une base populaire mais du monde des entreprises, atterré par les jacqueries estudiantines de Mai 1968, et finissant par abjurer sa Trilogie de la Vie au moment de tourner Salò, le poète amplifia sa dimension de Cassandre. C’est justement dès 1969, dans son poème Patmos où il exprima son pessimisme vis-à-vis de l’oppression culturelle due au consumérisme en recourant largement aux versets de l’Apocalypse qu’il inséra entre ses vers, se faisant l’apôtre annonçant le fameux « génocide culturel ».
Ce n’est pas tant que Pasolini renia ce que nous avons évoqué plus haut, bien au contraire. Comme il l’affirma lui-même dans Rinascita, le 27 Septembre 1974: « Ma vision est une vision apocalyptique. Mais si à côté d’elle et de l’angoisse qu’elle produit il n’y avait aucun élément d’optimisme en moi, l’idée que la possibilité de lutter existe contre tout cela, je ne serais tout simplement pas ici, parmi vous, en train de parler. » Pasolini crut plus que jamais à la révolution comme seule solution pour sauver le passé, et c’est justement parce que la révolution incarnait à ses yeux un impératif qu’il connut un désarroi intellectuel face aux phénomènes mentionnés. Il faut bien comprendre que, pour Pasolini, sans poésie innervant les âmes, une révolution ne peut qu’échouer. Lorsque les contestations n’expriment plus que des insatisfactions égoïstes et hédonistiques, elles ne sont en rien révolutionnaires. C’est ce qui le poussera à dire sur le plateau télévisuel d’Enzo Biagi que : « Pour un certain temps, jeune, j’ai cru à la révolution comme y croient les jeunes d’aujourd’hui. Aujourd’hui je commence à croire un peu moins à cette palingénésie. Je suis en ce moment apocalyptique, je vois devant moi un monde douloureux et toujours plus laid. Je n’ai pas d’espoir, donc je n’imagine même pas de monde futur. »
Les années 1970 sont une gradation « apocalyptique » pour Pasolini. Désillusionné par le monde moderne, affirmant qu’il serait désormais incapable de tourner Accattone parce que « le consumérisme a bouffé la réalité » et ayant même déjà dû renoncer à tourner L’Évangile en Palestine à cause de la colonisation du « développement », le poète empruntera définitivement la voie du cinéma comme lanceur d’alerte, seul langage selon lui qui puisse résister à l’homologation du « nouveau Pouvoir » consumériste. Bien que tournant la Trilogie de la Vie entre temps, la réalisation de Salò, adaptation des 120 Journées du divin marquis, affirmera sa rupture complète avec l’alliance du pessimisme de la raison et de l’optimisme de la volonté. Bien que reniant tout « qualunquisme» (équivalent du poujadisme en Italie), on ne peut que constater le désespoir de Pasolini envers l’évolution de l’Italie et du monde. Cette rupture sera consacrée dans le fameux article dit « La disparition des Lucioles », titré originellement « Le vide du pouvoir en Italie », où Pasolini fit poétiquement coïncider la mort définitive de l’ancien monde avec la disparition de la dernière luciole. Comme il l’écrivit en 1973 dans le journal Il Tempo : « Ce n’est pas un changement d’époque que nous vivons mais une tragédie. Ce qui nous bouleverse, ce n’est pas la difficulté de nous adapter à une époque nouvelle, mais une inguérissable douleur semblable à celle qu’ont dû éprouver les mères qui voyaient leur fils partir pour émigrer en sachant qu’elles ne le reverraient jamais plus. La réalité nous lance un regard de victoire, intolérable : son verdict est que tout ce que nous avons aimé nous est enlevé à jamais. »
Salò, ou les 120 Journées de Sodome couronnèrent ainsi le combat pasolinien, avec son roman Pétrole, inachevé et dont plusieurs chapitres auraient mystérieusement disparus après son assassinat. Véritable brûlot contre la société de consommation et contre la réification du corps humain, il fait toujours partie des films les plus sulfureux qui soient au début du XXIe siècle. En adaptant le Marquis de Sade, mais surtout en actualisant le propos sadien avec la corrélation du « fascisme fasciste » et du fascisme consumériste, Pasolini est allé au-delà de ce que tout système politique, philosophique et cinématographique pourrait appréhender. Comme il le disait lui-même, le cinéma restait selon lui le dernier langage pouvant échapper à la « normalité », Salò constitue à ce titre le summum du langage cinématographique pasolinien, ce qui empêche encore de nombreux critiques et chroniqueurs d’appréhender ce film du fait qu’il n’entre dans aucune grille de lecture préconçue.
Cette vision apocalyptique de Pasolini n’était toutefois pas seulement due au seul désamour du Passé, mais aussi à la nature sacrée qui était, selon lui, inhérente au Passé, ou plus exactement sa hiérophanie, terme qu’il emprunta à Mircea Eliade. Le Passé se caractérisait socialement par un paradigme où le sacré se manifestait directement dans la réalité ; c’est l’absence de sacré du monde consumériste qui lui permet d’engendrer ces « étranges machines qui se cognent les unes contre les autres. » Bref, « Plus personne ne te demande de la poésie/ Et : « Il est passé ton temps de poète/ Les années cinquante sont finies dans le monde ! »/ tu jaunis avec les Cendres de Gramsci,/ et tout ce qui fut la vie te fait mal/ comme une blessure qui se rouvre et se donne la mort. »
05.03.2022 à 10:30
C’était Accattone
Fabrizio Tribuzio-Bugatti

Texte intégral (694 mots)

Accattone était créée il y a presque sept ans, à l’occasion du quarantième anniversaire de la disparition de Pier Paolo Pasolini.
En sept ans, notre revue a connu un succès auquel nous ne nous attendions pas. Lancée en province, sans financement ni soutien, elle a su se faire une place dans le microcosme des revues littéraires qui évoluent en marge des titres de presse.
Durant ces sept années, Accattone a voulu creuser la pensée politique véhiculée par la littérature, à commencer par celles des auteurs eux-mêmes, dont évidemment Pasolini, mais aussi Jules Verne ou Aldous Huxley, dernier numéro en date, sans compter les articles qui ont alimenté directement le site. Notre ligne a toujours été la même : faire la part belle aux auteurs qui ont interrogé, sinon défié, la modernité ou qui ont été rejetés par elle. Chacun des contributeurs d’Accattone a également suivi la même rigueur : celle de ne jamais démembrer un auteur de son œuvre, ou de sa vision du monde, au profit d’une interprétation partisane et idéologique comme c’est hélas trop souvent le cas.
Sans nier le fait qu’Accattone avait un faible pour les vaincus, comme Curzio Malaparte ou Ezra Pound, la revue a toujours appuyé le fait qu’un auteur fait corps avec son œuvre, et ne peut en aucun cas en être dissocié, et que c’était ainsi qu’il faut les appréhender. C’est sans doute ce qui nous a valu l’intérêt d’être lu comme de nous attirer le mépris du Monde qui, dans un fameux article en 2017, brocardait sans essayer de la comprendre cette jeunesse désenchantée qui remettait en cause l’idée de progrès.
Si nous avions bien sûr l’envie d’aborder d’autres auteurs, d’autres horizons littéraires, la crise du Covid-19 a hélas mis à mal l’aventure de la revue, qui a parfois commis quelques soubresaut depuis le printemps 2020. Le centenaire de Pasolini, le 5 mars 2022, sera le point final de l’aventure d’Accattone. Nous n’avions ni le désir, ni la faiblesse de céder au tour de piste en trop. Le radotage est bon pour les revues qui n’ont rien à dire.
Si Accattone a commencé avec Pier Paolo Pasolini, elle ne pouvait s’achever qu’avec lui. C’est pourquoi plusieurs articles inédits seront mis en ligne au cours de la journée, les derniers qui alimenteront le site. Loin des chapelles qui tentent de l’arracher à son amour de la tradition ou à son marxisme, ils aborderont le long sillon de sa pensée, parfois ampoulée certes, mais qui restera toujours hors de portée de ces automates qui s’épuisent à tenter de le convertir rétroactivement aux dogmes du moment. Pasolini n’est pas un vulgaire label politique ; il n’appartient à personne. « Avant de s’exprimer, on ne doit jamais, en aucun cas, craindre une instrumentalisation par le pouvoir et sa culture. Il faut se comporter comme si cette dangereuse éventualité n’existait pas. Ce qui compte, c’est avant tout la sincérité et la nécessité de ce que l’on doit dire. Il ne faut pas les trahir en aucune façon, et encore moins en gardant un silence diplomatique, par parti pris ».
14.01.2022 à 17:55
Alonso Quijada, anti-héros errant
mathieulavarenne

Texte intégral (2242 mots)

Selon Cervantès lui-même, le Don Quichotte serait « une invective contre les romans de chevalerie » qui n’aurait pas d’autre intention « que de ruiner le crédit et l’autorité qu’ont dans le monde et parmi le vulgaire » lesdits romans, afin de « démolir ces inventions chimériques » (T. 1, prologue). Indirectement, l’auteur pose la question de l’influence de la lecture d’ouvrages théoriques tant sur l’âme elle-même que sur la vie pratique et le quotidien. De fait, les lectures compulsives d’ouvrages romanesques ont littéralement gâté la tête du héros de l’histoire. Alonso Quijada (ou Quesada, peut-être Quejana) était en effet un gentilhomme de la noblesse castillane, originaire de cette région nommée La Mancha, en plein cœur de l’Espagne. Passionné par ces romans de chevalerie, « dont Cicéron n’a jamais rien su », au point de « vendre plusieurs arpents de bonne terre » pour s’acheter encore davantage de livres, il s’adonne au plaisir de la lecture, au détriment même de l’administration de son propre domaine. Au style souvent ronflant, ampoulé, farci de citations et de grandes formules jargonnantes, les quêtes chevaleresques ont fait « perdre la tête au pauvre gentilhomme », peinant « des nuits entières pour en débrouiller le sens », un sens « qui aurait échappé à Aristote s’il était revenu parmi nous tout exprès ». L’hidalgo « dormait si peu et lisait tellement que son cerveau se dessécha et qu’il finit par perdre la raison ». Son esprit, baigné de fantaisies, a ainsi succombé aux effets de la lecture : « il avait la tête pleine de tout ce qu’il trouvait dans ses livres » et « il crut si fort à ce tissu d’inventions et d’extravagances que, pour lui, il n’y avait pas d’histoire plus véridique au monde » (T. 1, chap. 6). C’est ainsi que pour Alonso la fiction devint le réel. Et qu’elle le transforma en Don Quichotte.
L’IDÉALISTE BON ENFANT
Don Quichotte n’est devenu que très postérieurement cette figure de l’idéaliste bon enfant, certes pour le moins excentrique, qui se décide, sur le tard de son existence, à saisir l’occasion de réaliser ses rêves en s’en donnant enfin les moyens : devenir un chevalier redresseur de torts, un modèle de justice « au service de la veuve et de l’orphelin ». Une telle vision positive s’enracine certes dans le texte lu au premier degré, mais surtout à la fin du XVIIIème siècle, lorsqu’en réaction avec le classicisme de culture latine, des penseurs du romantisme allemand comme Schlegel et Schelling feront de Don Quichotte un héros tragique incarnant l’antagonisme entre la vie et le rêve, entre la prose et la poésie. Cette représentation de Don Quichotte en chevalier de l’idée et de l’idéal s’épanouira durant le XXème siècle, dans une forme plus politisée. Parmi bien d’autres, Jacques Brel fera du Quichotte un homme courageux sortant des sentiers battus, un être persévérant qui refuse de se mettre à genou face à l’adversité quelle qu’elle soit, et plus largement un idéaliste au sens positif du terme, s’affrontant, certes maladroitement, à la misère humaine et faisant face à la mort. Avant cela, Don Quichotte n’était qu’un fou ridicule, un grotesque et risible bouffon, et l’œuvre tout entière un délassement par le rire mis à la disposition de ses lecteurs. Cervantès n’est de fait jamais tendre avec son héros qu’il qualifie notamment d’« épouvantail en armes » (T. 1, chap. 4), marchant « si lentement » sous un soleil qui « montait si vite et tapait si dur que, s’il avait eu un tant soit peu de cervelle, elle aurait fondu à la chaleur ». Auscultons plus avant quelques aventures de Don Quichotte, comme symptôme de sa folie et symbole de ce dont il est le nom.
LE POUVOIR DES MOTS
Avant son premier départ, avant même de rencontrer Sancho, le futur Don Quichotte prépare son expédition. Il récupère dans le grenier de sa masure une vieille armure, rouillée et moisie, ayant appartenu à ses aïeux en une époque lointaine où un tel attirail se portait encore (l’invention de l’arbalète puis du mousquet ont rendu l’armure intégrale obsolète, tout comme le canon a périmé le château-fort, car autant gagner en vitesse et en mobilité ce que l’on perd en poids et en épaisseur désormais inutile). Comme le heaume manquait à la panoplie, Alonso décide de s’en confectionner un, sur la base d’un vieux casque auquel il accroche une visière en carton, produisant ainsi « l’apparence d’un heaume » (T. 1, chap. 1). Il en teste alors la solidité avec un coup d’épée, évidemment fatal à son misérable bricolage. Apparemment bien peu porté sur le travail manuel, l’aristocrate vieillissant recommence alors en renforçant cette fois-ci sa visière factice au moyen de quelques fils de fer supplémentaires, mais il ne souhaite plus tester sa réalisation de peur qu’elle ne se casse une nouvelle fois : « ne voulant pas renouveler l’expérience, il décréta qu’il possédait le plus parfait des heaumes ». Don Quichotte est celui qui par la puissance de son langage est capable de « changer son casque en heaume ». Et parce qu’il y croit dur comme fer, parce que sa foi est profonde, cela devient réel pour lui. Son décret vaut réalité. Ses mots sont des choses. Il pense ainsi sa parole comme performative, comme lorsqu’un maire prononce la phrase « je vous déclare unis par les liens du mariage », entraînant illico des conséquences effectives, les mêmes mots n’ayant pas la même teneur dans la bouche de toute autre personne. Même Sancho finira par croire aux affirmations péremptoires de son maître qui, de facto, lui font modifier lui aussi son regard sur les choses. Or, une même chose vue sous deux angles, avec une intentionnalité différente, peut ne pas produire les mêmes effets de réel. Dans sa version idéalisée de Don Quichotte, Jacques Brel soulignera cette réalité du pouvoir des mots pointé par Cervantès : « Les choses ne sont que ce que nous voulons bien croire qu’elles sont. Je peux, moi devant toi, me dire ‘cet homme est un salaud’. Si je le pense et si à une réflexion que je fais tu le sens, tu vas te conduire comme un salaud. Si peut venir de moi le sentiment que je te considère comme un type très bien, non seulement cela te fera plaisir, ce qui en soi n’a pas beaucoup d’importance, mais tu vas te conduire comme un type très bien. Il faut dire aux Hommes qu’on les aime, pour qu’ils puissent nous aimer. Don Quichotte, c’est en fait le premier type qui tend la main » (interview de 1968). Les humains étant des êtres de langages, les mots ont de ce fait souvent une portée symbolique qui dépasse largement leur simple définition. Un symbole, et les mots sont des symboles, peut parfois être plus réel que le réel lui-même, du moins que les choses matérielles. Ce que le poète et homme d’action, Armand Gatti, que ses compagnons de maquis avaient surnommé « Donqui » confirmait à sa façon en reprenant la formule d’un révolutionnaire guatémaltèque : « l’arme décisive du guérillero, c’est le mot ». Et Don Quichotte n’est pas loin du guérillero, lui qui s’arme pour partir en guerre au nom d’une cause idéale qu’il considère comme éminemment juste.
ET ROSSINANTE FUT
En plus de son propre nom, dans une sorte de dédoublement de la personnalité, Alonso Quijada, devenu par acte d’auto-baptême Don Quichotte de la Mancha, change aussi celui de son cheval, une « pauvre bête », pleine de tares et de défauts : « il lui donna celui de Rossinante, qui lui parut noble et sonore, et signifiait clairement que sa monture avait été antérieurement une simple rosse, avant de devenir la première de toutes les rosses du monde ». Les défauts s’effaceraient-ils en n’étant plus nommés, ou parce qu’ils seraient renommés positivement ? La novlangue quichottienne est fascinante. À propos de cette chevaleresque monture dont Don Quichotte parvient régulièrement à tomber, souvent au pire moment pour lui, le lecteur apprendra ceci : « nulle part il n’est dit dans cette véridique histoire que Rossinante ait jamais réussi à galoper » (T. 1, chap. 49). Les mots qui se prennent pour des choses peuvent certes parfois changer le monde. Don Quichotte répétera infantilement que « tout est possible » (T. 2, chap. 17 et chap. 23), mais le réel peut aussi devenir un mur sur lequel se fracassent douloureusement les idées. Renommer positivement sa monture n’a ainsi pas suffi à la transformer en cheval de course. Les mots sont puissants, mais le réel résiste bien souvent. Si le fatalisme est toujours coupable, tout n’est pas pour autant « construit ». Attitude de résignation d’une part et sentiment de toute-puissance infantile d’autre part sont deux écueils contraires auxquels il nous faut échapper.
LE HEAUME DE MAMBRIN
Don Quichotte remplacera par la suite son heaume de pacotille par un plat à barbe tout cabossé, particulièrement reconnaissable du fait de son encoche caractéristique qui permettait de placer le récipient au niveau de l’encolure du futur rasé. Ayant en effet croisé un des nombreux barbiers de la contrée qui utilisait son outil de travail pour protéger son chef lors d’une averse, Don Quichotte croit y reconnaître le célèbre « heaume de Mambrin », pièce d’une incommensurable valeur selon ses sources livresques. À partir de ce moment, le héros se promène non seulement avec une armure sur le dos, en un temps où ce costume était largement démodé, mais en plus il portera ridiculement sur la tête un objet du quotidien qui pouvait faire en son temps le même effet que s’il se promenait aujourd’hui avec un égouttoir à pâtes sur la tête, à la façon des Pastafariens. Un jour, dans un sursaut de lucidité, Sancho s’interroge : « comment entendre quelqu’un vous dire qu’un plat à barbe est le heaume de Mambrin, et le voir s’obstiner dans cette erreur plus de quatre jours, sans penser que, pour affirmer une chose pareille, il faut qu’il ait la cervelle dérangée ? » La réponse de Don Quichotte est imparable. L’esprit de Sancho est borné ce qui l’empêche d’entrevoir la vérité : « il y a sans cesse autour de nous une troupe d’enchanteurs qui changent et transforment les choses à leur guise, selon qu’ils souhaitent nous aider ou nous nuire ». En l’occurrence, un enchanteur bienveillant protégerait subtilement le chevalier en ayant donné l’apparence d’un plat à barbe à cette précieuse relique afin que personne ne pense à la voler. Comment détromper quelqu’un qui englue son esprit dans une telle logique conspirationniste ? Clément Rosset, dans la conclusion de son essai Le réel et son double, défendait l’idée que le déni et l’illusion ont avant tout pour fonction de se « protéger du réel ». Ce ne semble pas être le cas de Don Quichotte qui au contraire, du fait même de ses illusions, ouvre grand sa porte pour se jeter dans le monde et exercer sa témérité.
Mathieu Lavarenne
13.12.2021 à 16:52
La valeur du Patriarche et la signification de l’État
Fabrizio Tribuzio-Bugatti

Texte intégral (2672 mots)

L’Automne du patriarche de Gabriel Garcia Marquez, plus connu pour Cent ans de solitude, est peut-être la quintessence de cette spécificité littéraire latino-américaine qu’est le roman du dictateur. Puisant dans les réalismes magiques et merveilleux qui caractérisent cette littérature, il use lui aussi de l’ambivalence entre ce qui relève ou non du réel et du surnaturel, du visible et de l’invisible, sans que la nature objective de ce qui serait merveilleux ou non ne soit problématique contrairement au fantastique. Dans le roman du dictateur, ce n’est pas tant la dictature que l’homme qui l’incarne qui est paré d’atours merveilleux, et c’est surtout vrai dans L’automne du patriarche. Dictateur des milliers d’années, qui a été, est et sera toujours là, le patriarche « entre 107 et 232 ans » semble être le firmament immobile qui recouvre sa patrie. Il n’est cependant pas un dictateur au sens exact du terme, ni décrit comme un authentique tyran par Marquez ; à la rigueur un despote au sens grec du terme, c’est-à-dire maître de maison, qui règne en père de famille à défaut d’avancer « en bon père de famille » comme la formule consacrée le veut. Néanmoins, le roman de Marquez est riche en enseignements sur la pratique du pouvoir, parce qu’il met en scène ses corollaires essentiels que sont la légitimité, la légalité, les notions de puissance et d’autorité. À la lecture, nous nous rendons compte qu’il n’est pas possible de qualifier le patriarche de dictateur, de tyran ou de despote véritable parce qu’il n’a pas de potestas, mais seulement l’auctoritas, pour reprendre des notions romaines. Dit autrement, il possède l’autorité, une autorité qui lui est propre, consubstantielle, en tant que patriarche justement, mais il n’a pas la puissance ; il ne légifère pas, gouverne avec un conseil des ministres et doit s’en accommoder, du moins jusqu’à un certain point.
C’est d’ailleurs par la légitimité du patriarche que l’analyse de son pouvoir pourrait être la plus judicieuse. Le roman nous le présente comme éternel, c’est-à-dire présent depuis toujours, comme hors du temps. La narration de Marquez accentue volontiers cette temporalité élastique du fait qu’il démarre son récit par la mort du patriarche en rendant les personnages découvrant son corps incapables de le reconnaître, « eût-il même été épargné par les charognards, étant donné qu’aucun d’entre nous ne l’avait jamais vu, et bien que son profil figurât sur l’avers et le revers des monnaies, les timbres-poste, les étiquettes des dépuratifs, les bandages herniaires et les scapulaires, […] nous n’ignorions pas que c’étaient là des copies de copies de portraits jugés déjà infidèles au temps de la comète, quand nos parents savaient qui il était pour avoir entendu leurs parents le leur raconter, comme précédemment les parents de leurs parents l’avaient raconté à leurs parents ». Nul ne semble donc se souvenir comment il a accédé au pouvoir, ni comment il s’y maintient indéfiniment. Pour réutiliser du vocabulaire latin, il semble faire l’objet d’une superstitio : « harcelé par une foule de lépreux, d’aveugles et de paralytiques qui le suppliaient de recevoir de ses mains le sel de la santé, et par des politiciens lettrés et des adulateurs sans vergogne qui le proclamaient grand chef des tremblements de terre, des éclipses, des années bissextiles et autres bévues de Dieu ». Si la légitimité répond à un système de croyance auquel il faut se conformer ou à une idée de justesse, aucun de ces critères ne semble être satisfait dans L’Automne du patriarche. La seule légitimité qui est connue, c’est celle qui découle de l’immuabilité même du patriarche, l’habitude, voire la résignation, des citoyens à le croire éternel. Marquez a peut-être, sans le vouloir ou sans le savoir, mis en exergue la notion d’auctoritas à travers son patriarche. Ce dernier tire sa légitimité non pas de la légalité, mais de son autorité, laquelle lui est reconnue non pas parce qu’il occupe un titre ou une fonction – qui ne fait qu’incidemment coïncider avec sa personne – mais justement parce qu’il est le patriarche. C’est en quelque sorte son double corps du roi. Cependant, il faut garder en mémoire que l’auctoritas est plus une fiction politique que juridique, elle n’a pas de définition arrêtée en droit et est toujours définie par ses composantes, ses effets ou ses pratiques mais jamais pour elle-même. Elle n’est pas une simple magistrature, comme nous l’avons dit ; le patriarche en dispose parce qu’elle lui est propre, donc unique et indivis. Il n’occupe pas tant une fonction qu’il se contente d’être lui-même, et c’est de cette immanence que procède l’auctoritas, au même titre par exemple que le Duce et le Führer ne pouvaient être d’autres personnes qu’elles-mêmes. Dans L’Automne du patriarche, l’État n’est ni une féodalité, ni la République romaine. Le patriarche dispose toutefois lui aussi d’un corps visible et d’un corps invisible que lui confèrent respectivement sa magistrature de chef d’État et son auctoritas, double corps qui est renforcé par le réalisme merveilleux de l’œuvre et du style employé par Marquez. Outre la superstitio dont il fait l’objet, son auctoritas le voile d’une aura mystique, au sens romain de religio. À défaut cependant de convoquer les auspices, il sait interpréter les augures : « une telle tranquillité s’effondra soudain dans le gallodrome d’un trou perdu alors qu’un coq assassin arrachait la tête de son adversaire et la dévorait à coups de bec devant un public grisé par le sang et une fanfare d’ivrognes qui célébraient l’horreur par des airs de fête, il fut le seul à surprendre le mauvais augure, il le sentit si claire et si imminent qu’il ordonna secrètement à son escorte d’arrêter l’un des musiciens, celui-là, celui qui joue du bombardon, en effet, on découvrit sur l’autre un fusil au canon limé et il avoua sous la torture qu’il pensait l’utiliser dans le remue-ménage de la sortie » ; est maître du temps ou tout comme : « retardez l’horloge, qu’elle ne sonne pas midi à midi mais à deux heures pour que la vie paraisse plus longue ». Marquez a subtilement mêlé superstitio et religio. Le folklore qui entoure le patriarche lui donne des allures magiques, mais outre cette dimension merveilleuse, il mène la vie auguste : ce qui relève du domaine privé et du domaine public se confondent. Le palais présidentiel en est la représentation parfaite, parce qu’il « ressemblait moins à une maison présidentielle qu’à un marché où il fallait se frayer un chemin parmi des ordonnances aux pieds nus qui déchargeaient des couffins de légumes et des cageots de volaille dans les couloirs en sautant par-dessus des commères avec leur enfants faméliques qui dormaient pelotonnées sur les marches dans l’attente du miracle de la charité officielle, il fallait éviter les eaux sales des concubines qui remplaçaient dans les vases les fleurs de la nuit par des fleurs du jour […], tout cela mêlé au chambard des fonctionnaires à vie qui trouvaient des poules en train de pondre dans les tiroirs de leurs bureaux, et au trafic des putains et des soldats dans les cabinets, au vacarme des oiseaux, aux bagarres des chiens errants au milieu des audiences, personne ne sachant qui était qui ni qui venait de la part de qui dans ce palais aux portes grandes ouvertes dont le désordre fantastique empêchait d’établir où était le gouvernement. » Tout bien, même numéraire, qui lui serait propre appartient en réalité à sa mère, mais cette dernière n’est pas totalement épargnée par la confusion entre ce qui est public et privé. Elle bénéficie des privilèges induits par son rapport maternel au patriarche sans même en avoir conscience, poursuivant sa vie de prolétaire malgré le personnel de maison à sa disposition.
Lors de la tentative de coup d’État, il apparaît au lecteur que le patriarche n’est pas le seul à commander, et donc qu’il ne détient pas la potestas, c’est-à-dire la puissance de légiférer ou de juger. Il doit collaborer avec un conseil ministériel qu’il surprend après l’échec de l’assassinat contre lui, « et vit, à travers la fumée, qu’il y avait là tous ceux qu’il avait voulu qu’il y eût, les libéraux qui avaient vendu la guerre fédérale, les conservateurs qui l’avaient achetée, les généraux du haut commandement, trois de ses ministres, l’archevêque primat et l’ambassadeur Shnontner, tous groupés pour le même leurre, invoquant l’union de tous contre le despotisme séculaire afin de se partager entre tous le butin de sa mort. » Ils sont présentés par Marquez comme suffisamment puissants pour empêcher le patriarche de gouverner comme le ferait un dictateur ou un tyran, laissant bel et bien entrevoir la distinction entre auctoritas et potestas. En les éliminant, il fait non seulement ressortir la pureté de la première, qui à la source de sa légitimité, contre la dimension légale de la potestas mais surtout la capacité de l’auctoritas à suspendre la potestas en cas d’état d’exception, bref, « est souverain celui qui décide de la situation exceptionnelle. » Preuve en est de la réaction desdits conseillers et autres politiciens lors de sa réapparition miraculeuse : « personne ne remarqua l’apparition du président sans sépulture lequel frappa un seul coup sur la table la paume de la main et cria ah ah et qui n’eut rien d’autre à faire car lorsqu’il releva la main la panique les avait déjà volatilisés. » À l’image d’Auguste, le patriarche était jusqu’à ce moment-là le primes inter pares, il l’emporte sur eux par l’auctoritas mais pas par la potestas à l’image du princeps : Post id tempus auctoritate omnibus praestiti, potestatis autem nihilo amplius habui quam ceteri qui mihi quoque in magistratu conlegae fuerunt (« À partir de ce moment, je l’ai emporté sur tous par l’auctoritas ; en revanche, je n’ai aucunement eu plus de potestas que tous ceux qui ont été mes collègues dans chaque magistrature »).
L’État est-il alors toujours l’État lorsque le patriarche élimine tous ses opposants ? Si, comme le disait Carl Schmitt, « L’homme politique d’envergure ne peut pas être contredit par une théorie, pas plus que cette dernière ne peut être prise en défaut par la portée, aussi importante soit-elle, de sa politique », le patriarche infirme ici l’idée d’une « harmonie préétablie et la coïncidence présumée entre droit et loi, justice et légalité, matière et procédure ». Il ne réduit pas l’État, mais refuse la réduction de l’État à la simple activité normative. L’auctoritas qu’il incarne lui permet de suspendre la potestas ou, autrement dit, l’État suspend le droit pour se conserver lui-même et, comme le souligne Agamben dans L’état d’exception, l’auctoritas est ce qui reste du droit lorsque le droit est suspendu. Cette suspension qui entraîne véritablement la dictature est symbolisée dans le roman par la saillie du patriarche tandis que les conjurés sont éliminés : « on a fini de s’emmerder, désormais, je vais commander seul ». En ajoutant « il faudra voir demain matin dès la première heure ce qui sert et ce qui ne sert pas dans ce chambardement », l’auctoritas est d’autant plus valorisée qu’ici est mise en exergue sa capacité de réactiver une potestas en sus de la suspendre lorsqu’est décidée la situation exceptionnelle : « je ne nomme plus de ministère, nom d’un bordel, rien qu’un bon ministre de la Santé, la seule chose qui soit nécessaire dans la vie ». Le patriarche abolit donc l’opposition aristotélicienne entre la délibération et l’exécution, entrant dans la définition que donne Machiavel de la dictature : « délibérer pour soi-même » et « faire toute chose sans aucune consultation ».
09.12.2021 à 16:55
Les Morticoles, ou la comédie hypocondriaque
Fabrizio Tribuzio-Bugatti

Texte intégral (1111 mots)

Léon Daudet fait peut-être partie de ces auteurs dont il serait de mauvais goût de s’intéresser aujourd’hui. Ardent polémiste membre de l’Action Française et duelliste, sa physionomie bonhomme ne donnait pas l’impression d’une personnalité aussi passionnée et peut-être exubérante du fils d’Alphonse Daudet. Pourtant, Les Morticoles est la seule œuvre de Léon Daudet continuellement rééditée depuis sa première publication en 1894. Écrite avant son engagement royaliste, l’écrivain est encore républicain à cette époque, quoi que plus modérément que le jour où il huait le général Boulanger.
La rédaction de cet ouvrage fut notamment motivé par la perte de son père, que Léon Daudet pensait liée à la déficience empathique du médecin de famille, pour lequel Alphonse Daudet relevait plus du spécimen médical qu’il fallait soigner à grands renforts de traitements aussi douteux que douloureux. Ce mépris affiché pour la vie humaine au profit d’une approche mécaniste de la vie alimente chez Léon Daudet un autre mépris, dont le roman fera office d’exutoire. Véritable dystopie où le lecteur suit l’errance d’un navire qui se retrouve près des côtes de l’île fictive des Morticoles, récupéré par une équipée qui brûle tous ses vêtements, lesquels sont substitués par des combinaisons à la texture étrange avant une mise en quarantaine. Le lecteur suit Félix Canelon, jeune homme de 17 ans qui s’était embarqué pour découvrir le monde. C’est par son biais que nous aurons un panorama complet de la société morticole, et par la même occasion le talent de Léon Daudet en tant qu’écrivain d’un genre de ce qui n’est pas encore appelé la Science-Fiction. Si sa définition peut être empruntée à Friedrich Jünger comme « le possible qui émerge dans le présent », Les Morticoles de Léon Daudet a pris une tournure des plus singulière depuis le début de la pandémie de Covid-19.
L’île des Morticoles n’est pas une démocratie, mais un régime hygiéniste où les médecins ont les pleins pouvoirs. Cette plénipotence est liée chez Daudet à l’évacuation de toute mystique, qu’elle soit politique comme religieuse. Les Morticoles ne croient en rien, sauf en leur nihilisme qui serait l’assurance de leur liberté : « Nous sommes des hommes libres ; nous ne croyons en aucun dieu. » Toute cette société se rabat donc sur la médecine et ses acteurs. Les riches bénéficient des traitements expérimentés sur les pauvres mais, plus avant, toute cette population est malade. Là où un individu normal voit en son compatriote un citoyen, le médecin ne voit que des patients. Tandis que le premier est responsable de lui-même, le second s’en remet toujours à un tiers pour son plus grand bien. De là une vision pervertie de la vie de la cité, puisque les médecins ne voient que des patients, il leur est impossible de les percevoir comme des individus responsables. « Hors nous, tout le monde est malade. Ceux qui le nient sont des simulateurs que nous traitons sévèrement, car ils constituent un danger public ». Comment telle chose est-elle rendue possible ? Tout simplement parce que « Les Morticoles sont des sortes de maniaques et d’hypocondriaques qui ont donné aux docteurs une absolue prééminence ».
Quelle différence entre cette île d’hypocondriaques et la France du XXIe siècle ? Notre pays est le premier consommateur d’antidépresseurs et panique devant un virus qui frappe une portion infinitésimale de la population. Le talent de Léon Daudet dans cette oeuvre est d’avoir confronté la sauvegarde biologique de la vie à la qualité de la vie, ou en des termes plus savants le bios à la zoé chez les Grecs. Léon Daudet adorerait sans doute — dans un cynisme exacerbé — voir la Morticolie s’insinuer en bas de chez nous, nous qui devons rédiger des attestations adressées à nous-mêmes pour sortir masqués parce que chez nous aussi, depuis un an, « La police est médicale, l’édilité aussi, aussi l’université, l’ensemble des pouvoirs publics, le gouvernement. » La faiblesse du citoyen, névrosé qui a peur de tout, délègue toute responsabilité à un être tout puissant qui prétendra s’occuper de lui. Cet être n’étant pas Dieu, voici notre patient tourmenté par celui qui prétend le soigner d’une maladie dont la gravité est accessoire, seule compte la prééminence du médecin, mandarin qui s’impose par son sabir latinisant auquel le quidam ne comprend rien mais se sent impressionné. Abandonnant son esprit critique, le citoyen se laisse maltraiter pourvu qu’il soit materner. Voilà donc la résultante de cette affaire : « le peuple est de malades, riches ou pauvres, de détraqués, de déments. Nous laissons circuler ceux dont l’affection ne présente nul danger. Quant aux autres, nous les cloîtrons dans des hôpitaux, hospices maisons de retraite et les étudions là à loisir. » Les moyens de l’État sont mis à contribution d’une hégémonie hygiéniste plus que sanitaire voulue par cette forme incongrue de biopolitique. La tyrannie en blouse blanche peut à loisir mettre à l’Index tout propos contraire au sien au nom de sa prétendue supériorité intellectuelle afin d’asseoir une vision du bonheur se trouverait dans une seringue.
06.12.2021 à 16:55
Cervantès, le goût de la poudre et des lettres
mathieulavarenne

Texte intégral (2398 mots)

Publié en deux parties en 1605 puis en 1615, le Don Quichotte de la Manche de Miguel de Cervantès est l’un des plus grands romans modernes. Milan Kundera le considère même comme l’acte de naissance de la modernité en littérature au même titre que le Discours de la méthode de René Descartes en philosophie.
Longtemps considéré comme un personnage purement burlesque, Don Quichotte n’est que récemment devenu une figure positive d’engagement, de courage héroïque ou de sincérité politique, au point que le sous-commandant Marcos, charismatique chef de file de la rébellion zapatiste au Mexique, en fait « le plus grand livre politique jamais écrit ». Quant à de Gaulle, voici ce qu’il confie à Malraux dans Les chênes qu’on abat, en un mélange d’humour et de sérieux : « Pourquoi les Espagnols ne m’aimeraient-ils pas ? Ils aiment Don Quichotte ». À travers cette identification au second degré, le Général laisse entendre combien son pragmatisme politique se teintait d’idéalisme, voire d’un certain mysticisme de la France, impossible à ranger dans la catégorie de la seule Realpolitik et de son cynisme opportuniste.
Le personnage de Don Quichotte est devenu une figure incontournable, comme un repère conceptuel auquel s’identifier ou tout au moins se comparer. Omniprésente dans la conscience populaire, l’œuvre est toutefois souvent méconnue de façon proportionnellement inverse à la notoriété de son titre et du nom de son héros, associé à celui de Sancho Panza son fidèle écuyer.
Comment l’hidalgo Alonso est-il devenu le chevalier Don Quichotte (et vice-versa) ? Comment le bachelier Carrasco se transforme-t-il en un chevalier aux miroirs, figure inversée du chevalier à la Triste Figure, afin d’aller le chercher à l’intérieur même de son monde, sorte de doublure idéologique du monde réel ? D’ailleurs, la frontière entre ledit réel et la fiction n’est pas si claire, Cervantès démultipliant lui-même les niveaux de lecture de son œuvre par une ingénierie littéraire fascinante. La raison et la folie peuvent-elles devenir complices ? Héros ou anti-héros, de quoi Don Quichotte est-il le nom ?
La joyeuse farce du « chevalier à la Triste Figure » est bien plus complexe et plus profonde qu’on peut le penser au premier abord, si l’on se contente d’une vague connaissance du bref épisode des moulins à vent rendu célèbre par l’iconographie. Ses figures sont multiples. À l’image de son auteur, dont la vie n’a jamais été un long fleuve tranquille et qui, à travers la littérature, avec à la fois une mordante ironie et un sens aigu de la nuance, produit une subtile philosophie de l’action.
UN HOMME D’ACTION
Miguel de Cervantès Saavedra (1547-1616) n’était pas un écrivain professionnel, dénomination qui n’avait d’ailleurs aucun sens en son temps, où un tel statut n’existait pas. Dès sa jeunesse, il s’est certes pris d’amour pour le théâtre et frotté à l’écriture – quelques poèmes de ses 20 ans ont traversé les âges –, mais ce n’est qu’anachroniquement et de façon posthume qu’il est devenu romancier, poète et dramaturge au sens où nous l’entendons aujourd’hui, en tant que principal représentant du Siècle d’Or espagnol, rangeant ainsi le père de Don Quichotte dans une de ces boîtes à idées pédagogiques qui séquencent, plus ou moins arbitrairement, et néanmoins utilement, l’histoire littéraire de l’humanité. Que Cervantès ait atteint le niveau universitaire durant sa formation, rien n’est moins sûr, mais celle-ci s’est surtout façonnée en plein air, incessamment enrichie par un esprit curieux de tout. Homme d’action plutôt que souris de bibliothèque, il était une intelligence en marche, très prosaïquement en quête d’aventures, comme le sera, mais d’une autre façon, son héros errant, dont on ne pourra faire si facilement son double littéraire. Afin d’y voir plus clair, commençons par suivre Cervantès lui-même dans ses pérégrinations on ne peut plus terrestres. Fuyant peut-être la justice espagnole suite à un duel qui aurait mal tourné, après avoir vécu à Cordoue, Séville puis Madrid, le jeune homme prend le chemin de l’Italie, où il vivra notamment à Rome et à Naples à une époque d’apogée culturelle pour ces colossales capitales de la Renaissance humaniste. Il décide alors d’embrasser la carrière des armes, engagé volontaire dans une compagnie militaire entre 1570 et 1574. Cervantès n’a pas été soldat par défaut.
Le 7 octobre 1571, le jeune soldat se retrouve notamment en prise avec la « bataille prodigieuse » de Lépante, au large du Péloponnèse — où la Sainte-Ligue, dominée par la puissante République maritime de Venise, marque un coup d’arrêt à l’expansionnisme ottoman du « Grand Turc » qui étendait alors ses rets jusqu’au Maghreb. Suite à cette bataille navale hors-norme que l’on compare parfois à la bataille d’Actium (en 31 avant notre ère, non loin de là, et qui voit la fin des guerres civiles romaines), Cervantès hérite d’un surnom qui le suivra durant toute sa vie : celui de « manchot de Lépante ». Blessé par trois coups d’arquebuse, deux à la poitrine, un autre à la main gauche, il perdra définitivement l’usage de cette dernière mais restera fier d’avoir subi ce stigmate au combat pour ce qu’il considérait comme une noble cause ayant pesé sur le destin de l’Europe, plutôt que de s’être bêtement estropié dans une stupide rixe de bistrot. Il ira jusqu’à affirmer que, s’il avait le choix, il préférerait perdre une nouvelle fois sa main plutôt que de ne pas participer à cette grande bataille (prologue du tome 1, dans la traduction d’Aline Schulman – 1997). Malgré son irrémédiable handicap, il retournera sous les drapeaux après une longue convalescence de plusieurs mois.
D’ESCLAVE À ALGER À LA CASE « PRISON »
En 1575, alors qu’il est sur le chemin du retour pour l’Espagne, son navire est arraisonné par des corsaires commandés par l’amiral de la flotte ottomane d’Afrique du Nord. Tout comme son frère Rodrigo, Miguel est fait prisonnier et emmené à Alger, connue alors comme la ville de la piraterie. Le hasard fait qu’il a sur lui une lettre de recommandation, ce qui le désigne comme captif de valeur, laissant espérer à ses ravisseurs une forte rançon. Cela lui épargnera probablement la torture, mais prolongera néanmoins sa captivité du fait des difficultés à rassembler la conséquente somme d’argent exigée. Malgré quatre tentatives d’évasion, dont il semble avoir toujours été la tête pensante, mais qui ont toutes achoppé du fait soit de l’imprudence, soit de la couardise, soit de la trahison d’un autre protagoniste de l’opération, Cervantès demeure ainsi en esclavage cinq années durant, accomplissant travaux de terrassement ou de jardinage pour de puissants Ottomans.
À partir de 1580, l’ancien soldat changera plusieurs fois de métier, exerçant alors les fonctions de commissaire aux vivres, de collecteur d’impôts, d’affairiste ou encore de camérier du pape (sorte de domestique attitré et à tout faire). Accusé à plusieurs reprises d’avoir détourné de la marchandise ou des fonds, mais ayant toujours nié ce qui lui était reproché, il se retrouve pas moins de quatre fois emprisonné.
La fertilité créatrice de la prison et de sa mélancolie solitaire est de notoriété publique, nombre d’œuvres littéraires ayant germé derrière les barreaux d’un cachot. Dans son Prologue, Cervantès présente ainsi son Don Quichotte comme « l’histoire d’un homme sec, rabougri, fantasque, plein d’étranges pensées que nul autre n’avait eues avant lui […], comme peut l’être ce qui a été engendré dans une prison, séjour les plus incommodes, où tout triste bruit a sa demeure ». On saisit ainsi combien l’œuvre cervantine exhale tout autant sinon plus l’odeur de la poudre à canon que celle du plomb de l’imprimerie.
LE BRAS ET L’ESPRIT
Ce n’est pas un hasard si l’une des plus célèbres citations de Cicéron fera mouche dans l’esprit de Cervantès : « cedant arma togae concedat laurea linguae », les armes cèdent à la toge, les lauriers [du général victorieux] à l’éloquence ; fameuse formule du consul-philosophe qui dut affronter la conjuration de Catilina, projet de coup d’État militaire contre la res publica, que Cicéron déjoua, secondé par la redoutée puissance de son art oratoire. Cette formule métaphorique, l’orateur romain la commentera notamment dans son plaidoyer Contre Pison : « Je n’ai pas dit « ma » toge, celle dont je suis revêtu, ni entendu par le mot d’armes le bouclier et l’épée d’un seul général, mais, parce que la toge est le symbole de la paix et du calme, les armes, au contraire, celui des troubles et de la guerre, j’ai voulu faire entendre, à la manière des poètes, que la guerre et les troubles doivent s’effacer devant la paix et le calme ». Remettant en cause la prédominance des seigneurs de la guerre dans la vie publique à Rome, tels César ou Pompée, Cicéron proposait de célébrer les victoires politiques de l’éloquence au même titre, sinon davantage, que les faits d’armes des stratèges militaires, à travers la pragmatique réconciliation de la philosophie et de la rhétorique. En écho assurément cicéronien, Cervantès met ainsi dans la bouche de son Don Quichotte : « Qu’on ne vienne pas dire devant moi que les lettres l’emportent sur les armes » parce que les « armes font appel à l’esprit tout autant que les lettres » (T. 1, chap. 37-38).
En effet, « l’homme de lettres » comme « l’homme de guerre » font tous deux travailler leur esprit, précise Cervantès qui, étant les deux, ressentait manifestement le besoin de contrebalancer les propos de Cicéron dans le sens d’une revalorisation intellectuelle du métier des armes. Plus tard, lorsque le personnage du Duc nommera l’écuyer Sancho gouverneur d’une illusoire île, il le préparera à assumer cette fonction : « vous serez vêtu à moitié en lettré, à moitié en capitaine car, dans cet archipel que je vous donne, on a autant besoin des lettres que des armes, et autant des armes que des lettres » (T. 2, chap. 32). Très probablement, les personnages cervantins se faisaient-il ici les porte-paroles de leur créateur. Une de ses nouvelles publiées en 1613, Le licencié de verre, voit son héros, un ancien fou ayant pourtant recouvré la raison mais encagé par l’opinion publique dans son précédent état de folie, faire le choix de l’engagement militaire afin de « tirer parti de la valeur de son bras, puisqu’il ne le pouvait plus de celle de son esprit », ainsi stérilisé par les préjugés, et « d’immortaliser par les armes une vie qu’il avait commencé par immortaliser par les lettres ». Ledit licencié laissera « à sa mort, le souvenir d’un soldat très avisé et très brave », figure inversée de Cervantès qui, ayant débuté par les armes, rêvera ultérieurement de s’immortaliser par les lettres.
Cervantès a beaucoup voyagé dans l’Europe de la renaissance et dans le pourtour méditerranéen. « Personne dans la littérature espagnole n’a avalé autant de kilomètres que lui, traversé autant de villages, ni si souvent dormi à la belle étoile », explique l’écrivain Andrés Trapiello, dans la biographie qu’il lui a consacrée, Les vies de Cervantès (1993) : « en lisant ses livres, nous avons la certitude qu’il a posé les pieds, quand ce n’était pas son âme, sur chaque centimètre carré dont il parle » (p. 161). C’est cette générosité cervantine tournée vers l’aventure, contre la résignation petite-bourgeoise, que le grand admirateur de Don Quichotte qu’était Jacques Brel trouvait si formidable : « Les gens prudents, les gens précautionneux ont plus d’avenir que de présent », disait-il lors d’une interview de 1968, « ils sont assis et ils se croient debout, c’est effrayant, cela me glace le sang » (documentaire Jacques Brel : Don Quichotte, sur le site de l’INA, 1968). Le Don Quichotte est une aventure, une aventure littéraire certes, mais à laquelle son auteur a donné l’épaisseur de la vie, parce qu’il faisait de sa propre vie un roman.
Mathieu Lavarenne.
07.09.2021 à 17:55
LA FIGURE DU GRAND INQUISITEUR À TRAVERS LA DYSTOPIE
Fabrizio Tribuzio-Bugatti

Texte intégral (1898 mots)

Le Grand Inquisiteur est bien connu des amateurs de Dostoïevski. Récit dans le récit des Frères Karamazov, son inspiration proviendrait de l’inquisiteur du Don Carlos de Schiller dont Dostoïevski écrivait qu’« Il a pénétré dans le sang de la société russe… Il a fait notre éducation, il est nôtre. » Dans Les frères Karamazov, le Grand Inquisiteur se caractérise par son rejet du message christique, le jugeant naïf comme gênant, parce qu’il surestime les capacités de l’être humain. Ce dernier étant, selon le Grand Inquisiteur, lâche et veule, incapable de rejeter la tentation comme le Christ repoussa le diable dans le désert au profit de la liberté, il en tire une souffrance insoluble. Au contraire, pour le Grand Inquisiteur, mieux vaut épouser une vision pratique d’un bonheur certain compatible avec la nature humaine que de la pousser vers le rêve d’une liberté incertaine qui apporterait une souffrance certaine. La simple possibilité de choisir est, au-delà du libre arbitre, le plus sûr moyen qu’à l’homme de provoquer sa propre perte. Dit autrement, pour le Grand Inquisiteur, l’être humain n’est pas assez mûr pour la liberté, mieux vaut pour son plus grand bien qu’il soit contingenté et manipuler par quelques personnes éclairées qui sauraient ce qui est bon pour lui. Si les sédiments du Meilleur des mondes et de 1984 sont déjà perceptibles, tous deux ne sont pourtant que des déclinaisons de Nous autres de Zamiatine. Roman écrit en 1922 et traduit en France dès 1929, il a non seulement restitué la figure du Grand Inquisiteur lui-même à travers celle du Bienfaiteur, mais surtout appliqué son message au possible émergeant dans le présent. Le totalitarisme de Nous autres est caractérisé par la réalisation de la promesse du bonheur par le pouvoir. Le Bienfaiteur est l’avatar de Zamiatine qui, en lettré soviétique, a lu Dostoïevski et a saisi l’élasticité pratique du Grand Inquisiteur au moment où de nouveaux régimes émergeaient en Russie comme en Europe. Huxley et Orwell n’ont fait que reprendre schématiquement cette figure dans leurs propres adaptations de Nous autres que sont Le meilleur des mondes et 1984.
Si Zamiatine a lu Les Frères Karamazov, sans doute comme Huxley et Orwell après lui, c’est néanmoins grâce à Nous autres que l’ombre du Grand Inquisiteur s’est étendue jusqu’à la Science-Fiction. À ce titre, peut-être serait-il opportun de distinguer dans la famille des dystopies celles qui sont issues de Zamiatine du fait qu’elles réutilisent, volontairement ou non, la figure du Grand Inquisiteur. Toutes les dystopies évoquant ainsi un dirigeant aussi occulte que total en procèdent d’une manière ou d’une autre, avec plus ou moins d’habilité… Ce qui distingue le Bienfaiteur de l’Administrateur d’Huxley ou de Big Brother d’Orwell est cependant déterminé par ce qu’ont retenu Huxley et Orwell de leur lecture de Nous autres en fonction de leurs sensibilités respectives. Le meilleur des mondes et 1984 sont tous deux finalement des extrapolations d’une des facettes de la dystopie de Zamiatine. En cela, malgré leur justesse dialectique, ils sont fatalement moins aboutis que l’œuvre dont ils s’inspirent. Huxley aura porté son attention sur la régulation extrême de la société par un pouvoir technique, Orwell sur le contrôle et la manipulation, d’où l’eugénisme mis en scène par le premier et la répression chez le second. Cependant, aucun des deux ne sut ainsi mettre en corrélation régulation, réification et manipulation de l’individu, et tous deux passèrent plus ou moins à côté du message de Zamiatine : l’essence du totalitarisme n’est rien d’autre que le bonheur.
Ce serait néanmoins faire une injustice à Huxley que de le juger aussi sévèrement. Comme Zamiatine, il a saisi qu’utopie et dystopie sont de même nature, toutes deux prétendant œuvrer pour le plus grand bien ; la différence étant que l’utopie est une dystopie qui a réussi. Toutes deux sont totales, c’est-à-dire totalitaires comme totalisantes. Elles exercent leur emprise non seulement tout le temps et partout, mais elles emplissent les individus eux-mêmes jusqu’à emporter l’adhésion de leurs âmes. C’est sur cette adhésion que se situe la différence, l’utopie n’a pas besoin de recourir à la répression parce que ses sujets adhèrent totalement à son projet. C’est pour cette raison que Zamiatine eût l’intelligence d’utiliser un mode narratif qui lui a permis, par le point de vue de son protagoniste, de décrire son univers totalitaire comme s’il s’agissait du meilleur des mondes. Son attrait pour l’époque que le lecteur connaît est en lien direct avec la parabole du Grand Inquisiteur : au bonheur stable, certain mais rationalisé, il préfère de plus en plus la liberté et sa précarité. Que se passe-t-il alors ? « On nous attacha sur des tables pour nous faire subir la Grande Opération. Le lendemain, je me rendis chez le Bienfaiteur et lui racontai tout ce que je savais sur les ennemis du bonheur. Je ne comprends pas pourquoi cela m’avait paru si difficile auparavant. Ce ne peut être qu’à cause de ma maladie, à cause de mon âme. » Le Bienfaiteur coïncide à la perfection avec le Grand Inquisiteur : le choix, l’âme, conduisent nécessairement l’homme à sa perte, tandis que lui, dirigeant éclairé ayant percé la condition humaine, sait que la rédemption n’est pas dans la liberté, mais dans le bonheur afin que nul ne souffre plus. La manipulation, la réification ou même la régulation des individus jusqu’à leurs esprits devient dès lors un moyen parfaitement justifié pour réaliser ce but. Huxley a repris la substance de ce message dans Le meilleur des mondes, en citant en premier lieu Nicolas Berdiaeff : « Les utopies apparaissent comme bien plus réalisables qu’on ne le croyait autrefois. Et nous nous trouvons actuellement devant une question bien autrement angoissante : comment évier leur réalisation définitive ?… Les utopies sont réalisables. La vie marche vers les utopies. Et peut-être un siècle nouveau commence-t-il, un siècle où les intellectuels et la classe cultivée rêveront aux moyens d’éviter les utopies et de retourner à une société non utopique moins « parfaite » et plus libre. » Il enrichit sa fiction d’une préface en 1946 où il indique qu’« on n’offre au Sauvage qu’une seule alternative : une vie démente en Utopie, ou la vie d’un primitif dans un village d’Indiens, vie plus humaine à certains points de vue, mais, à d’autres, à peine moins bizarre et anormale. » Le choix ne peut-il que se faire entre démence et bizarrerie selon Huxley ? Le meilleur des mondes apparaît en effet comme une utopie ayant échouée de peu, elle devient dystopique parce qu’il y a des éléments de résistance. La conclusion du roman rejoint la parabole du Grand Inquisiteur par la bouche de l’Administrateur : mieux vaut une société stable bien qu’imparfaite que prendre le risque de la liberté. L’Administrateur confie ainsi, semblablement au Grand Inquisiteur, que si « le bonheur universel maintient les rouages en fonctionnement bien régulier ; la vérité et la beauté en sont incapables. » Lui-même ayant manqué de peu d’être exilé sur une île à cause de sa passion pour la science, et donc pour la vérité, a fini par « faire son choix ».
Au contraire, chez Orwell, Big Brother n’apparaît jamais physiquement, tant et si bien qu’il a une existence chimérique. La manipulation passe avant l’idée de régulation qu’exprimait Zamiatine dans ce qu’en retint Orwell. Si la manipulation est présente dans Le meilleur des mondes, elle n’est pas articulée autour d’une répression physique comme dans 1984, où elle ne prend jamais fin. Son lien avec le monopole de la contrainte physique légitime forme une dimension janusienne du Pouvoir qui semble se résumer à cela. D’ailleurs, Big Brother est-il vraiment l’avatar du Grand Inquisiteur dans le roman ? Où est-ce plutôt O’brien lorsqu’il torture Winston ? Le message qu’il dévoile n’est pas substantiellement identique à celui du Grand Inquisiteur, contrairement au Bienfaiteur de Zamiatine ou à l’Administrateur d’Huxley. O’brien présente la manipulation comme l’oppression comme des fins en soi, là où Nous autres et Le meilleur des mondes ont restitué la subtilité du message originel : le bonheur nécessite de vivre libre dans une prison plutôt que de vivre libre en liberté. Orwell est finalement resté dans un schéma classique, celui de la tyrannie. 1984 ne perçoit pas qu’un autre fascisme est possible, comme l’avaient fait Zamiatine puis Huxley, parce qu’Orwell n’a pas envisagé d’homme nouveau dans sa dystopie, se tenant à un simple schéma de la répression. Il dénonce l’autoritarisme le plus débridé qui soit, mais jamais la nature profonde du totalitarisme qu’il résume à une surveillance généralisée organisée par un État policier. Big Brother se contente au fond d’une adhésion formelle, pas d’un véritable enrégimentement des âmes qui lui conférerait la dimension totalisante qu’Orwell n’a pas perçu dans Nous autres ou Le meilleur des mondes, ou qu’il a assimilé d’une façon simpliste. Puisque « les prolétaires sont libres » parce qu’ils relèvent du régime juridique des choses, le pouvoir n’est pas total, et l’exécution de Winston prouve cette déficience parce que même après l’avoir réduit à l’état de coquille vide, le pouvoir a besoin de le liquider physiquement, ce qui induit un aveu de faiblesse.
11.08.2021 à 17:55
LE MEILLEUR DES MONDES, ROMAN COMIQUE
emirichard

Texte intégral (4092 mots)

BEWARE OF CHAWDRONISM
En bon dilettante qu’il est, plutôt que de l’écrire, il se met à raconter comment il a assisté à la dissolution de cet « impitoyable Napoléon de la finance » en « bouillie à cochons » : c’est une loi de la nature, ajoute–t–il, que « tous ceux qui se sont trop durcis, […] tous ceux qui aspirent à être non humains – ange ou machine, cela n’a pas d’importance » finissent toujours par être aspirés et noyés dans leur propre flaccidité, car « la surhumanité est aussi néfaste que la sous–humanité, c’est en fin de compte la même chose. » En côtoyant Chawdron pendant des années, il a vu comment il avait été manipulé par deux femmes, une violoncelliste d’abord, et une étrange créature ensuite, qu’il nommait sa petite Fée et qui avait réussi, à grand renfort de mysticisme de pacotille, de grimaces de martyre de la migraine, de baragouin métaphysique et d’un sérieux impeccable, à faire de lui un « bébé » et à révéler sa nature de « crétin émotionnel ».
Pour Tinley, cette expérience – petit bijou d’absurdité concentrée – constitue une puissante mise en garde : « le Chawdronisme est dangereux. Une société construite par et pour des hommes ne peut pas fonctionner si tous ses composants sont émotionnellement des sous–hommes. Lorsque la majorité des cœurs sera faite de bouillie cochons, une catastrophe doit se produire. » Les intellectuels ne sont évidemment pas à l’abri du chawdronisme, bien au contraire, ils doivent même être tout particulièrement sur leurs gardes.
donc entendit parler de leur disparition quand le monde avait les yeux rivés sur la rutilante Lincoln Conitnental dans laquelle le président Kennedy venait d’être assassiné ? Heureusement, l’éclipse ne fut que temporaire et les hommages affluèrent, mais à la lecture de certains, on ne peut qu’être frappé par leur ambiguïté. Si Chawdron était érigé au rang de saint et d’homme de lettres, Huxley, lui, est évoqué en ces termes dans un article de la toute jeune Psychedelic Review signé Timothy Leary :
« Aldous Huxley is not just a literary figure, and for that matter not just a visionary writer. Which adds to the critic’s problem. The man just wouldn’t stop and pose for the definitive portrait. He just wouldn’t slide symmetrically into an academic person pigeonhole. What shall we call him ? Sage ? Wise teacher ? Calypso guru ? Under what index-heading do we file the smiling prophet ? The nuclear age bodhisattva ? »
Nous voilà bien ! Voilà notre écrivain transformé en saint ! Et notre critique assurément atteint d’une forme aiguë de chawdronisme (à la différence près qu’on ne peut guère soupçonner Huxley d’être un escroc). Un peu de grandiloquence ne nuit pas dans certaines circonstances, me répliquera-t-on peut-être. Ce n’est pas tant elle qui me gêne que l’étrange postulat qui hante ces lignes : être écrivain, fût-ce un écrivain visionnaire, ne suffit pas, sans le chatoyant costume du Sage, sans les illuminations prophétiques et mystiques de l’Inspiré.
Il est vrai qu’Huxley a sans aucun doute largement contribué à construire son propre mythe, mais il a surtout, Dieu merci, écrit une œuvre grâce à laquelle il est possible de démolir joyeusement le petit temple de Saint Aldous.
KUNDERA, KAFKA, ORWELL,… HUXLEY
Dans Les Testaments trahis, Kundera consacre des pages acerbes à ce qu’il appelle la kafkologie et aux kafkologues, au premier rang desquels se trouve l’ami et exécuteur testamentaire de Kafka, Max Brod. Non content d’avoir fait publier ses textes et croyant, sans doute sincèrement, œuvrer pour sa mémoire, Brod fait paraître en 1926 un récit intitulé sobrement Le Royaume enchanté de l’amour, puis toute une série d’ouvrages dans lesquels il s’efforce d’édifier un véritable mythe, de faire de Kafka un prophète, un martyr, un saint ! Kundera relève en particulier ces phrases qui résonnent étonnamment avec celles de Leary :
« De tous les sages et les prophètes qui ont foulé cette terre, il a été le plus silencieux […]. Peut-être ne lui aurait-il fallu que la confiance en lui-même pour être le guide de l’humanité ! Non, ce n’était pas un guide, il ne parlait pas au peuple, ni à ses disciples comme les autres chefs spirituels des hommes. Il gardait le silence ; était-ce parce qu’il a pénétré plus avant dans le grand mystère ? Ce qu’il entreprit était sans doute plus difficile encore que ce que voulait Bouddha, car s’il avait réussi, c’eût été pour toujours. »
Encore un cas tout à fait avéré de chawdronisme ! Car ne nous y trompons pas, la kafkologie est un chawdronisme. En quoi consiste-t-elle exactement ? À « examiner les livres de Kafka non pas dans le grand contexte de l’histoire littéraire (de l’histoire du roman européen), mais presque exclusivement dans le microcontexte biographique. » À transformer « la biographie de Kafka » en « hagiographie ». À « déloger Kafka systématiquement du domaine de l’esthétique ». À « être une exégèse » qui ne voit dans les romans de Kafka que des allégories dont seul importe le sacro-saint message. Il suffit de remplacer Kafka par Huxley et on aura sans doute posé le problème que soulève aujourd’hui la lecture de son œuvre, complaisamment parasitée par des considérations sur ce qu’il fut et fit, ou sur le monde comme il va – et les totalitarismes ou le transhumanisme n’arrangent rien à l’affaire ! Pourtant Huxley n’est pas un mage, c’est un écrivain, rien qu’un écrivain. Quant au Meilleur des mondes, ce n’est pas la représentation cauchemardesque du monde qui se prépare, c’est un roman, rien qu’un roman. Si Huxley est un témoin, il l’est en tant que romancier.
Si on accepte de replacer Le Meilleur des mondes dans l’histoire du roman, il se rattache à la grande tradition des romans utopiques, genre qui ne va pas nécessairement de soi et dont on peut penser qu’il est bancal. De nouveau, je me permets un petit détour par un autre essai de Kundera en partie consacré à Kafka, toujours dans Les Testaments trahis. Il y compare Le Procès et 1984 de George Orwell :
« Dans ce roman qui veut être le portrait horrifiant d’une imaginaire société totalitaire, il n’y a pas de fenêtres ; là, on n’entrevoit pas la jeune fille frêle avec une cruche se remplissant d’eau ; ce roman est imperméablement fermé à la poésie ; roman ? une pensée politique déguisée en roman ; la pensée, certes lucide et juste mais déformée par son déguisement romanesque qui la rend inexacte et approximative. Si la forme romanesque obscurcit la pensée d’Orwell, lui donne-t-elle quelque chose en retour ? Éclaire-t-elle le mystère des situations humaines auxquelles n’ont accès ni la sociologie ni la politologie. Non : les situations et les personnages y sont d’une platitude d’affiche. Est-elle donc justifiée au moins en tant que vulgarisation de bonnes idées ? Non plus. Car les idées mises en roman n’agissent plus comme idées mais comme roman, et dans le cas de 1984 elles agissent en tant que mauvais roman avec toute l’influence néfaste qu’un mauvais roman peut exercer.
L’influence néfaste du roman d’Orwell réside dans l’implacable réduction d’une réalité à son aspect purement politique et dans la réduction de ce même aspect à ce qu’il a d’exemplairement négatif. Je refuse de pardonner cette réduction sous prétexte qu’elle était utile comme propagande dans la lutte contre le mal totalitaire. Car le mal, c’est précisément la réduction de la vie à la politique et de la politique à la propagande. Ainsi le roman d’Orwell, malgré ses intentions, fait lui-même partie de l’esprit totalitaire, de l’esprit de propagande. Il réduit (et apprend à réduire) la vie d’une société haïe en la simple énumération de ses crimes. »
Essayons d’examiner précisément quelques-unes des questions soulevées par Kundera.
1984 serait un mauvais roman parce qu’il réduirait la vie humaine à sa seule dimension politique, sans qu’aucune fenêtre ne s’ouvre sur autre chose. Orwell y déploierait une logique absolument identique à la logique totalitaire qu’il prétend combattre ou du moins mettre à nu. Voilà qui est sans doute un peu injuste pour deux raisons : d’abord, ces fenêtres existent. Elles sont même littéralement là, dans le texte : à deux reprises en effet, alors qu’il se trouve dans la petite chambre au-dessus du magasin d’antiquités, Winston regarde par la fenêtre et il y voit une femme qui étend infatigablement des couches sur une corde et dont les gros bras rouges et la ritournelle qu’elle chantonne, l’arrachent, certes très brièvement, à « l’horreur de la politique ». Ensuite, Orwell lui-même a vu les problèmes que posait son « Utopie en forme de roman » : comment réintroduire du romanesque dans un monde profondément a-romanesque ? Comment lutter contre la tentation d’une écriture politisée ? Comment ne pas céder à la satire partisane et laisser se déployer ce que Kundera appelle l’ironie romanesque ? On peut donc reprocher à Orwell d’avoir échoué à résoudre l’équation dans 1984, mais pas d’y avoir été insensible.
La manière dont Kundera poursuit sa condamnation du roman est également éclairante :
« Quand je parle, un an ou deux après la fin du communisme, avec les Tchèques, j’entends dans le discours de tout un chacun cette tournure devenue rituelle, ce préambule obligatoire de tous leurs souvenirs, de toutes leurs réflexions : « après ces quarante années d’horreur communiste », ou : « les horribles quarante ans », et surtout : « les quarante ans perdus ». Je regarde mes interlocuteurs : […] tous, ils ont vécu dans leur pays, dans leur appartement, dans leur travail, ont eu leurs vacances, leurs amitiés, leurs amours ; par l’expression « quarante horribles années », ils réduisent leur vie à son seul aspect politique. Mais même l’histoire politique l’ont-ils vraiment vécue comme un seul bloc indifférencié d’horreurs ? […] S’ils parlent, tous, de quarante années horribles, c’est qu’ils ont orwellisé le souvenir de leur propre vie qui, ainsi, a posteriori, dans leur mémoire et dans leur tête, est devenue dévalorisée ou même carrément annulée […]. »
C’est faire sans doute beaucoup d’honneur à Orwell que de lui prêter une telle influence ! Mais surtout, c’est mélanger un peu tout : Orwell invente un monde, il n’est pas responsable de ce que ses lecteurs ont le sentiment qu’il décrit précisément le leur. Singulièrement, au moment même où il reproche à Orwell d’avoir réduit la vie à la politique et la politique à la propagande, Kundera lui-même réduit son roman à sa seule dimension politique et en oublie toutes les autres.
Cette lecture parcellaire menace également Le Meilleur des mondes dont on parle volontiers en termes de tableau apocalyptique, de génial réquisitoire contre toutes les dérives du monde : n’oublie-t-on pas un peu trop vite, là encore, qu’il s’agit d’un roman ?
DE BIEN REGRETTABLES REGRETS
Dans la préface à l’édition de 1946, Huxley explique pourquoi le remords, celui de l’individu comme celui de l’artiste, est un sentiment non seulement désagréable, mais parfaitement inutile. Fort de cette saine disposition d’esprit, il explique qu’il n’a pas retouché son roman, tout en admettant qu’il a quelques regrets, comme par exemple celui d’avoir péché contre la vraisemblance en faisant parler son sauvage, John, de manière trop rationnelle, celui d’avoir ignoré l’importance que prendrait la découverte de la fission nucléaire, ou encore de n’avoir pas proposé de troisième voie à son personnage.
Examinons un instant ces regrets : le premier est celui du romancier (le souci de la vraisemblance et de la cohérence d’un personnage), le deuxième celui du prophète (le souci de refléter la vérité du monde). Et le dernier ? Que faut-il en penser ? Écoutons Huxley :
« Si je devais réécrire maintenant ce livre, j’offrirais au Sauvage une troisième possibilité. Entre les solutions utopienne et primitive de son dilemme, il y aurait la possibilité d’une existence saine d’esprit – possibilité déjà actualisée, dans une certaine mesure, chez une communauté d’exilés et de réfugiés qui auraient quitté Le Meilleur des mondes et vivraient à l’intérieur des limites d’une Réserve. Dans cette communauté, l’économie serait décentraliste, à la Henry George, la politique serait kropotkinesque et coopérative. La science et la technologie seraient utilisées, comme si, tel le Repos Dominical, elles avaient été faites pour l’homme, et non (comme il en est à présent, et comme il en sera encore davantage dans le meilleur des mondes) comme si l’homme devait être adapté et asservi à elles. »
Je m’arrête là, mais la description, conceptuelle et volontiers jargonnante, se poursuit et envisage les différentes caractéristiques de ce troisième monde. À ce stade, on se dit que le prophète, le wise teacher – un brin austère et, admettons-le sans ambages, sacrément ennuyeux –, a éclipsé le romancier et que si une telle version existait, elle aurait éventuellement des allures de fable, de parabole, mais qu’elle n’aurait plus rien d’un roman.
Heureusement, nous ne la lirons jamais, si ce n’est sous la forme de ce court repentir ou sous celle de l’essai publié par Huxley en 1958 et intitulé Retour au Meilleur des mondes ; ce que nous lisons, c’est tout autre chose, c’est un roman qui part d’une idée qui a plu à Huxley parce qu’elle était « amusante » et qu’elle lui semblait « vraie », à savoir que « le libre arbitre a été donné aux êtres humains afin qu’ils puissent choisir entre la démence, d’une part, et la folie, de l’autre ». C’est donc le rire – le rire malgré la folie – qui a présidé à la création duMeilleur des mondes et qui en fait une œuvre infiniment plus riche qu’une simple satire ou qu’un génial ouvrage d’anticipation.
« LE SÉRIEUX D’UN ENFANT : LE VISAGE DE L’ÂGE TECHNIQUE. »
Les premiers chapitres du Meilleur des mondes nous invitent à visiter le Centre d’Incubation et de Conditionnement de Londres-Centrale. Sous la houlette de son sémillant directeur, puis de l’Administrateur mondial lui-même, de jeunes étudiants découvrent les lieux et les techniques utilisées, ainsi que les grands principes qui les sous-tendent, ils prennent des notes avec un sérieux inébranlable, posent des questions, opinent avec ferveur, sont parfois gênés ou écœurés quand le monde d’avant est évoqué, mais ils ne rient pas, ils ne rient jamais et pourtant tout le spectacle auquel ils assistent est parfaitement grotesque. Prendre au sérieux toute cette ouverture, c’est donc admettre que nous sommes des étudiants nous aussi, conditionnés à acquiescer, impressionnés par le kitsch du décorum et de la rhétorique. En réalité, la lecture de ces quelques pages, le discours du directeur, digne de celui d’un bonimenteur de foire, la platitude philosophique que dissimulent très imparfaitement ses envolées lyriques, tout nous plonge d’emblée dans la farce – farce monstrueuse, certes, mais farce quand même.
Celle d’un monde magique (frustration et souffrance ne durent jamais, souhaits et désirs n’ont qu’à être éprouvés ou exprimés pour être exaucés) et littéralement en-chanté, tant tout y chante sans cesse. Les individus y sont d’éternels bébés, plongés durant toute leur existence dans une « extase enfantine », pleine de gaieté synthétique, résumée dans les joyeux nursery rhymes qui leur tiennent lieu de réflexion et dont voici un petit échantillon :
« Comme j’aime à voler en avion, comme j’aime à avoir des vêtements neufs… Les vieux habits sont affreux. Nous jetons toujours les vieux habits. Mieux vaut finir qu’entretenir, mieux vaut finir… Plus on reprise, moins on se grise… Chacun travaille pour tous les autres. Tout le monde est heureux à présent.
Il n’est pas de Flacon au monde profond, pareil à toi, petit Flacon que j’aime. Un gramme à temps vous rend content. Avec un centicube, guéris dix sentiments. Un gramme vaut toujours mieux que le « zut » qu’on clame. « Fus » et « serai », ça n’est pas gai, un gramme, et puis plus rien que « suis ».
Ne remettez jamais à demain le plaisir que vous pouvez prendre aujourd’hui. Dès que l’individu ressent, la communauté est sur un sol glissant.
La propreté est l’approche de la Fordinité. La Civilisation, c’est la Stérilisation. Un médecin par jour – foin du mal alentour. A B C, Vitamine D. L’huile est au foie, la morue a nagé. »
Nous voilà en pleine infantocratie – « l’idéal de l’enfance imposé à l’humanité », pour reprendre les mots de Kundera. Pas question de rire, tout ceci est très sérieux, évidemment.
Face à ces enfants éternels, on peut, comme John, éprouver un légitime effroi empreint d’une compassion paradoxalement désireuse de leur imposer la liberté, on peut aussi, comme Bernard Marx, les mépriser et ricaner de leur bêtise crasse tout en souhaitant ardemment susciter leur respect et leur admiration. D’ailleurs, Bernard, pourtant si critique, se réconcilie pleinement, bien que provisoirement, avec ce monde car « pour autant qu’il reconnaissait son importance à lui, Bernard, l’ordre des choses était bon. » Et voilà notre redresseur de torts autoproclamé qui rêvait déjà d’accepter stoïquement son destin de révolté mis au ban, très heureux de pouvoir coucher avec toutes les femmes qui autrefois l’auraient rejeté. Rien n’est donc figé : il existe précisément un jeu, au cœur même de l’excès d’ordre, pour une liberté et une ambiguïté proprement romanesques.
Lire Le Meilleur des mondes comme une fable apocalyptique, c’est ne pas voir ce jeu, cette fenêtre entrebâillée, c’est ne pas entendre le rire qui y éclate ici et là et qui est peut-être la plus haute forme de résistance car tout, y compris le sérieux de la bêtise, est emporté sur son passage. Non pas le rire revanchard de Bernard qui n’est ni plus ni moins que le triste et ridicule étendard d’un désir de reconnaissance et qui, d’ailleurs, disparaît dès qu’il croit l’avoir obtenue, mais plutôt celui de son grand ami, Helmholtz Watson ou encore celui de l’Administrateur mondial, Mustapha Menier et en dernière analyse, celui du lecteur.
Mustapha Menier rit à la lecture du rapport que Bernard lui a fait parvenir au sujet de John et de son intégration dans Le Meilleur des mondes :
« La pensée que cet être-là lui servait – à lui – un cours solennel sur l’ordre social était véritablement par trop grotesque. Il fallait que cet homme fût devenu fou. « Il faudrait lui donner une leçon », se dit-il, puis il rejeta la tête en arrière et se mit à rire aux éclats. »
Plus loin, il rit de l’idéalisme indigné de John qui réclame la Liberté pour les hommes et lui suggère qu’il s’agit là tout bonnement d’une absurdité.
Quant à Helmholtz, il éclate de rire en racontant à Bernard qu’il est un « homme repéré » depuis qu’il a lu à ses étudiants, pour voir l’effet que cela produirait, un poème sur la solitude. Plus loin, il se jette, hilare, dans la rixe provoquée par John quand il veut libérer les Epsilons de leur servitude en les empêchant d’accéder à leur dose quotidienne de soma. Il rit enfin au moment d’être reçu par Mustapha Menier après leur arrestation, alors que Bernard, lui, est vert d’angoisse. Son rire, qui éclate face au danger et qui accompagne l’action, n’est jamais ni coercitif, ni triomphant, il est tout à la fois vivifiant et généreux : né du spectacle de « la poignante incongruité des choses », il semble correspondre à ce qu’Huxley écrit dans un de ses essais :
« Le plus énergique dissolvant du satanisme, comme des autres prétentions surhumaines, c’est le rire sans malice de gens qui sont restés hommes. »
Helmholtz, plus encore que Mustapha Menier, nous invite à rire du Meilleur des mondes, car rien n’est plus dangereux, face aux rêves totalitaires et autres délires transhumanistes ou même, plus simplement, aux idéaux de toute nature, que de les prendre trop au sérieux. Ne voir dans Le Meilleur des mondes qu’un ouvrage d’anticipation sombre et accablant de vérité, c’est oublier qu’il propose aussi une forme d’antidote au désespoir. Tant qu’il se trouvera des lecteurs capables de rire de Bernard, de John et des situations imaginées par Huxley, « la santé de l’esprit » – question qui l’a beaucoup préoccupé – ne sera pas encore tout à fait hors d’atteinte.
- GÉNÉRALISTES
- Ballast
- Fakir
- Interstices
- Lava
- La revue des médias
- Le Grand Continent
- Le Diplo
- Le Nouvel Obs
- Lundi Matin
- Mouais
- Multitudes
- Politis
- Regards
- Smolny
- Socialter
- The Conversation
- UPMagazine
- Usbek & Rica
- Le Zéphyr
- Idées ‧ Politique ‧ A à F
- Accattone
- Contretemps
- A Contretemps
- Alter-éditions
- CQFD
- Comptoir (Le)
- Déferlante (La)
- Esprit
- Frustration
- Idées ‧ Politique ‧ i à z
- L'Intimiste
- Jef Klak
- Lignes de Crêtes
- NonFiction
- Nouveaux Cahiers du Socialisme
- Période
- Philo Mag
- Terrestres
- Vie des Idées
- ARTS
- Villa Albertine
- THINK-TANKS
- Fondation Copernic
- Institut La Boétie
- Institut Rousseau
- TECH
- Dans les algorithmes
- Framablog
- Gigawatts.fr
- Goodtech.info
- Quadrature du Net
- INTERNATIONAL
- Alencontre
- Alterinfos
- CETRI
- ESSF
- Inprecor
- Journal des Alternatives
- Guitinews
- MULTILINGUES
- Kedistan
- Quatrième Internationale
- Viewpoint Magazine
- +972 mag
- PODCASTS
- Arrêt sur Images
- Le Diplo
- LSD
- Thinkerview
- Fiabilité 3/5
- Slate
- Fiabilité 1/5
- Contre-Attaque
- Issues
- Korii
- Positivr