25.04.2025 à 19:13
Point de conjoncture #5 – Avril 2025
Émilien Cabiran
Texte intégral (8178 mots)
Cette note est la cinquième édition du « point de conjoncture » de l’Institut La Boétie.
Le département d’économie vous propose régulièrement, dans ces points de conjoncture, une lecture critique pour décrypter et mettre en perspective l’actualité économique. Dans chaque note, vous découvrirez un focus spécifique sur une question économique d’actualité.
Vue d’ensemble : une économie mondiale en panne et menacée par le retour de l’inflation
Les observations à l’échelle internationale confortent l’hypothèse avancée dans notre point de conjoncture de novembre 2024 : l’inflation persiste et rebondit, dans un contexte de ralentissement économique. C’est le spectre d’une stagflation durable[1] qui devient chaque jour plus probable.
Les hausses spectaculaires des droits de douane annoncées par Donald Trump en avril vont alimenter ce scénario puisqu’elles vont faire augmenter les prix et vont freiner le commerce.
Dans un premier temps, Trump a annoncé le 2 avril des hausses spectaculaires des droits de douane, portant le taux moyen à 24 %, contre 2 % avant son arrivée à la Maison-Blanche. Ce taux a été porté à 21 % pour l’Union européenne, soit une hausse de 20 points, et à 64 % pour la Chine, soit une hausse de 54 points. Puis, suite à la dégringolade des marchés financiers, Trump a annoncé le 9 avril une suspension pour 90 jours, laissant tout de même un taux uniforme de 10 % partout… sauf pour la Chine où le taux est porté à 145 % !
Aux États-Unis, après une croissance soutenue de 2,8 % en 2024, le ralentissement devrait être prononcé en 2025. La banque centrale (la Federal Reserve ou Fed) a réduit ses prévisions de croissance pour le premier trimestre 2025 de 2,1 % à 1,7 %. La Réserve fédérale d’Atlanta[2] prévoit même une baisse du produit intérieur brut (PIB).
Le déficit commercial[3] s’est envolé au début de l’année, avec une hausse significative des importations : les entreprises états-uniennes ont anticipé leurs achats à l’étranger pour éviter d’être impactées par les hausses de droits de douane, qui font augmenter les prix des biens importés. Dans le même temps, les prévisions d’inflation ont été revues à la hausse pour 2025, avant même les annonces de Trump sur les droits de douane : elles s’élèvent désormais à 2,7 % en moyenne annuelle, contre 2,4 % selon les prévisions de septembre 2024. L’inflation est alimentée par la hausse des prix alimentaires et des prix de l’énergie.
En raison de ce contexte inflationniste, la banque centrale a pris la décision, contre la volonté de Donald Trump, d’interrompre sa politique de baisse de taux d’intérêt[4], ce qui va avoir pour conséquence de freiner l’investissement[5] et d’augmenter le risque d’une crise financière en raison de la déconnexion entre la bulle financière et les profits réels[6].
Donald Trump accentue la pression sur la banque centrale pour imposer une politique monétaire favorable aux marchés financiers. Il installe un capitalisme de plus en plus mafieux, cherchant à satisfaire les spéculateurs au mépris des besoins de la population. L’administration multiplie ainsi les dérégulations et les baisses d’impôts pour doper les cours boursiers et ceux des cryptomonnaies[7]. Si Trump exige aujourd’hui une baisse des taux d’intérêt, c’est en réalité pour amortir l’impact de sa guerre commerciale sur l’économie réelle, mais surtout sur les marchés financiers. Malgré ses efforts, l’inquiétude gagne les marchés.
Au Royaume-Uni, la croissance déjà très faible stagne et l’inflation repart à la hausse : 3 % en janvier 2025 contre 1,7 % en septembre 2024. La banque centrale prévoyait, avant l’annonce de la hausse des droits de douane par Donald Trump, une inflation de 3,7 % en fin d’année et une croissance inférieure à 1 %.
En Allemagne, le PIB a baissé de 0,2 % au 4e trimestre 2024. Fait extrêmement rare pour l’économie allemande : la croissance recule pour la deuxième année consécutive, en raison d’une profonde crise industrielle[8].
La production industrielle a reculé de 4,5 % en 2024, notamment dans les secteurs qui constituent le point fort de l’Allemagne : l’automobile et les biens d’investissement, notamment les machines-outils. Dans le même temps, l’inflation a augmenté, passant de 1,8 % en septembre 2024 à 2,6 % en février 2025. La consommation populaire reste donc faible et se concentre essentiellement sur les dépenses contraintes[9].
La future coalition gouvernementale a annoncé un plan de réarmement massif, impliquant de modifier la Constitution pour lever le « frein à l’endettement » et allouer à la défense des fonds colossaux d’environ 900 milliards d’euros[10]. Cela devrait avoir un impact positif sur la croissance, puisque l’activité de l’industrie de l’armement va augmenter significativement[11], mais la baisse marquée du taux de profit en Allemagne, malgré une baisse importante des salaires réels pendant l’épisode inflationniste, empêche un véritable redémarrage de la croissance[12].
Avec une croissance de 3,2 % en 2024, l’Espagne continue à afficher des performances économiques largement supérieures à celles de ses voisins européens. Mais cette bonne santé économique est fragile car la croissance espagnole est essentiellement tirée par l’économie du tourisme de masse. Or, il s’agit d’un secteur à faible productivité, aux conditions de travail dégradées, et qui contribue par ailleurs à accentuer la crise du logement dont souffre la population espagnole. En parallèle, la consommation populaire a diminué en proportion du PIB au cours des cinq dernières années et l’investissement demeure largement inférieur à son niveau de 2007[13].
C’est la faiblesse persistante des gains de productivité[14] au niveau mondial qui est à l’origine de la stagnation économique combinée à la reprise de l’inflation (« stagflation »). Dans un tel contexte, les capitalistes cherchent à imposer une hausse des prix, malgré la faiblesse de la demande, pour maintenir leurs marges.
La guerre commerciale lancée par Donald Trump dans le triple but d’exercer une pression politique, d’accroître les recettes fiscales de l’État fédéral et de réindustrialiser le pays, va alimenter cette stagflation. Car cette guerre est loin d’être un jeu à somme nulle. Les taxes douanières vont frapper la consommation et se répercuter directement sur la population états-unienne, et en priorité sur les ménages les plus précaires[15].
Quel que soit leur comportement, les consommateurs seront pénalisés. Soit ils continueront d’acheter des biens importés et ils paieront alors plus cher, puisque les droits de douane feront mécaniquement augmenter les prix ; soit ils se tourneront vers les biens produits aux États-Unis, mais ils paieront aussi plus cher car la production locale sera plus coûteuse.
Au final, Donald Trump va importer… de l’inflation. De plus, les États-Unis ne bénéficieront pas de la guerre commerciale car même s’ils parviennent à « forcer » certaines entreprises à rapatrier leur production sur leur sol[16], ils resteront dépendants aux importations[17] : les multinationales états-uniennes sont elles aussi insérées dans les réseaux de production internationaux où la production et l’assemblage des biens sont fragmentés et répartis entre plusieurs pays et aires du monde.
Croissance atone en France
Après une légère baisse du PIB en fin d’année 2024, la croissance resterait atone début 2025 selon l’Insee[18] : + 0,1 % au premier trimestre et + 0,2 % au deuxième trimestre.
D’ores et déjà, l’objectif du gouvernement de 0,9 % de croissance en 2025 est caduc. Pour l’atteindre, il faudrait une croissance très dynamique de l’ordre de 0,6 % aux troisième et quatrième trimestres, ce qui semble impossible. La Banque de France a d’ailleurs enterré cet objectif en prévoyant, avant l’annonce de la hausse des droits de douane de Trump, une croissance de 0,7 % pour l’année 2025[19]. La croissance pourrait même en réalité être proche de zéro en incluant l’effet de la hausse des droits de douane, puisque François Bayrou a indiqué qu’elle pourrait avoir un impact négatif de « plus de 0,5 % » en 2025.
C’est du côté de l’investissement que la situation est la plus mauvaise. L’investissement des entreprises a connu une baisse de 2,8 % en cumulé entre le troisième trimestre 2023 et le quatrième trimestre 2024. L’investissement des ménages, c’est-à-dire l’achat de logements, s’est lui aussi effondré : – 19 % entre le deuxième trimestre 2021 et fin 2024. Le seul investissement qui résistait jusqu’au premier semestre 2024 était l’investissement des administrations publiques, mais il a fléchi à la fin de l’année du fait de la pression massive sur les finances publiques.
Le commerce extérieur et les dépenses publiques formaient les deux moteurs du peu de croissance de ces derniers trimestres. Ils vont s’enrayer en 2025. D’une part, les hausses des droits de douane imposées par Trump risquent de freiner le commerce mondial. Les exportations françaises vers les États-Unis pourraient ralentir, notamment dans les secteurs de l’aéronautique, des vins et spiritueux, de l’industrie chimique et des produits laitiers. Les exportations vers l’Allemagne seraient également concernées, puisque l’Allemagne assemble des composants produits en France avant de vendre les produits finaux sur le marché états-unien. Le déficit du commerce extérieur français devrait donc se détériorer, alors qu’il tendait justement à se réduire ces derniers mois en raison d’une diminution des importations[20].
D’autre part, la diminution drastique de la dépense publique nuit lourdement à l’activité économique. Le blocage des crédits publics, imposé par le gouvernement au prétexte de la censure du gouvernement de Michel Barnier, a mis un coup d’arrêt à la consommation des administrations publiques[21]. Le budget d’austérité que François Bayrou a fait adopter par 49.3 en février dernier va à son tour fortement limiter la contribution des dépenses publiques à la croissance tout au long de l’année 2025.
Dans ce contexte, aucune perspective de dynamisme ne se dégage. L’investissement productif des entreprises devrait continuer à baisser. Et la consommation des ménages ne sera pas le moteur de la croissance, compte tenu des prévisions de stagnation du pouvoir d’achat.
Pour espérer une croissance positive, il faudrait donc compter sur une baisse du taux d’épargne[22]. En effet, la fin de la crise Covid, durant laquelle la consommation des ménages a été empêchée, n’a pas marqué un retour à la normale en matière d’épargne. Il y a toujours au contraire une « surépargne » : le taux d’épargne demeure supérieur à la tendance de la décennie pré-Covid. Si l’inflation et le contexte d’incertitude ont pu pousser certains ménages à épargner davantage préventivement, la « surépargne » s’explique surtout par un accroissement de l’épargne financière des ménages les plus riches, qui font fructifier leur argent en le plaçant plutôt que de consommer et investir[23].
Il n’y a rien à attendre non plus du côté de la production industrielle. La crise de l’industrie s’approfondit. La « réindustrialisation » annoncée par Emmanuel Macron est un mirage. Les plans de licenciements se succèdent, dans la filière automobile notamment mais aussi dans le secteur de la chimie, avec récemment le cas de Vencorex.
Les délocalisations menacent en cascade les fournisseurs et les sous-traitants : sur un an, près de 200 000 emplois industriels seraient directement et indirectement mis en danger[24]. La valeur ajoutée[25] dans l’industrie manufacturière[26] a baissé tout au long de l’année 2024, et cela devrait continuer début 2025, avec une baisse de – 0,4 % au premier trimestre puis de – 0,1 % au deuxième trimestre. Au total, entre fin 2023 et mi-2025, la baisse de la valeur ajoutée dégagée par l’industrie manufacturière serait de – 2,5 % !
Stagnation du pouvoir d’achat
Sur l’ensemble de l’année 2024, le pouvoir d’achat[27] moyen des ménages a augmenté en moyenne annuelle de presque 2 %. C’est l’indexation sur l’inflation de l’année précédente des pensions de retraite, conséquence de la censure du gouvernement Barnier, ainsi que des prestations sociales, qui a tiré le revenu des ménages vers le haut[28], car la hausse des prix avait été plus forte en 2023 qu’en 2024.
En réalité, la hausse du pouvoir d’achat en 2024 est loin de bénéficier à tout le monde. C’est une moyenne, qui est calculée en intégrant indistinctement l’évolution des salaires réels[29], qui ont stagné, et celle des revenus du patrimoine, qui ont eux beaucoup augmenté.
L’explosion des revenus du patrimoine dope donc superficiellement les chiffres du pouvoir d’achat. Car dans le même temps, la grande pauvreté, soit le manque d’accès aux biens et services fondamentaux, a progressé. En 2024, plus de 1,2 million de foyers n’ont ainsi pas pu payer leur facture et ont subi des coupures ou réductions de puissance d’électricité : c’est 24 % de plus que l’an dernier, et 85 % de plus qu’en 2019.
Le pouvoir d’achat moyen a cessé d’augmenter : il a stagné au dernier trimestre 2024 et devrait légèrement baisser au premier semestre 2025. Sur l’ensemble de l’année 2025, il devrait diminuer de 0,4 point à cause des coupes budgétaires et de l’obsession austéritaire du gouvernement, qui auront pour effet de ralentir la consommation et l’investissement.
En 2025, les salaires devraient progresser légèrement, au rythme annuel de 1,1 %. Mais ce chiffre pourrait être revu à la baisse, car les précédentes prévisions de hausses de salaires se sont quasiment toutes révélées trop optimistes[30]. Parallèlement, les revenus du patrimoine, qui ont tiré vers le haut le pouvoir d’achat moyen ces derniers mois, devraient ralentir. Après plusieurs trimestres d’euphorie, les rendements des placements (livret A, livret d’épargne populaire…) devraient baisser en lien avec la baisse des taux d’intérêt de la Banque centrale européenne[31]. Les versements de dividendes ralentiraient en raison de profits moins élevés en 2024 et du fait de la hausse ponctuelle de l’impôt sur les sociétés sur les grands groupes, décidée uniquement pour 2025.
Destructions d’emplois et hausse du chômage
C’est dans ce contexte que les annonces de « plans sociaux » se multiplient partout en France. Au quatrième trimestre 2024, les suppressions d’emplois salariés ont surpris par leur ampleur : 90 100, dont 68 000 dans le privé et 22 100 dans le public[32]. Et ces suppressions devraient se poursuivre en 2025, avec au minimum plus de 100 000 emplois salariés détruits[33].
Les défaillances d’entreprises[34] sont au plus haut : 65 844 en cumul sur 12 mois en janvier 2025, contre 59 000 en moyenne dans les années 2010.
Habituellement, ces chiffres sont gonflés par les échecs et les abandons des auto-entrepreneurs, qui surviennent peu de temps après le lancement de leur activité. Mais en 2024, ce sont les défaillances d’entreprises de grande taille, avec plus de 250 salariés, qui ont été importantes[35]. Elles sont aujourd’hui deux fois plus nombreuses que dans les années 2010[36].
Au total, 260 000 emplois sont concernés par une procédure judiciaire, sans même compter les incidences potentielles sur l’emploi pour les fournisseurs des entreprises défaillantes[37].
Le taux de chômage officiel va progresser tout au long de l’année 2025. De 7,3 % fin 2024, il devrait atteindre 7,6 % au deuxième trimestre[38] et même 7,8 % au quatrième trimestre[39].
Seuls les emplois à faible productivité[40] des micro-entrepreneurs, c’est-à-dire des emplois non-salariés de travailleurs indépendants, devraient continuer à progresser en 2025. Le nombre de créations de micro-entreprises a augmenté de 7,3 % sur la seule année 2024[41]. Les entreprises sont de plus en plus nombreuses à recourir à l’externalisation de missions auprès de travailleurs indépendants, qui gagnent en moyenne 800 € par mois et dont un tiers est obligé de cumuler son activité avec un emploi salarié pour joindre les deux bouts[42]. Ainsi, plus d’une micro-entreprise sur dix est créée à la demande d’une entreprise qui recherche une alternative à l’embauche d’un salarié, y compris en intérim[43].
Encadré : Bilan de 7 ans de macronisme : deux quinquennats d’inégalités
Les résultats de la politique économique d’Emmanuel Macron sont édifiants. Les inégalités ont explosé, sur fond d’appauvrissement général de l’essentiel de la population.
Figure 1 : Évolution de quelques indicateurs économiques et sociaux entre 2017 et 2024
| Évolutions entre le deuxième trimestre 2017 et le quatrième trimestre 2024[44] | |
| Salaire horaire réel (secteur marchand) | – 3,5 % |
| Salaire par tête réel (secteur marchand) | – 2,7 % |
| Dividendes réels | + 79,8 % |
| Productivité horaire | – 1,7 % |
| Profits réels des sociétés non financières (SNF) | + 12,4 % |
| Prélèvements nets des subventions[45] pour les SNF | – 0,8 % |
| Taux de marge des SNF | + 1,1 point |
| Consommation de produits alimentaires en volume | – 8,0 % |
| Taux de privation matérielle et sociale (2017-2023) | + 1,7 point (+ 1,2 million de personnes) |
| Taux de pauvreté monétaire (2017-2022) | + 2,0 points (+ 1,4 million de personnes) |
Lecture : Entre le deuxième trimestre 2017 et le quatrième trimestre 2024, les salaires ont diminué de 3,5 % en moyenne et la consommation de produits alimentaires de 8 %. Sur la même période les profits des entreprises ont augmenté de 12,4 %.
Les salaires réels ont fortement baissé : environ – 3 % en l’espace de sept ans. C’est un phénomène inédit sur une période aussi longue depuis la Seconde Guerre mondiale. Ils ont d’abord stagné entre 2017 et 2021, avant de chuter d’environ 4 % entre fin 2021 et fin 2023 pendant la période de forte inflation. Depuis, ils progressent très modestement : mais la hausse récente d’environ 1 % est très loin de compenser la baisse qui précède. Dans le même temps, les dividendes réels perçus par les ménages les plus riches se sont envolés, eux, d’environ 80 %.
L’inflation sur les produits alimentaires a frappé de plein fouet la population. La précarité alimentaire a ainsi connu une forte hausse. Depuis 2017, la consommation alimentaire a baissé de 8 %. Aujourd’hui, les ménages se privent toujours de nourriture, sautent des repas ou se replient vers des produits de moins bonne qualité.L’industrie agroalimentaire est la première responsable de cette situation : elle a sciemment alimenté l’inflation sur fond de guerre en Ukraine afin d’augmenter ses marges.
Avec l’explosion des inégalités, la pauvreté a progressé de façon importante. Le taux de pauvreté monétaire, qui mesure la part des ménages dans la population ayant un niveau de vie inférieur à 60 % du niveau de vie médian[46], a augmenté de 2 points en cinq ans. Il est passé de 13,4 % à 15,4 % de la population entre 2017 et 2022, dernière année où cet indicateur est connu. Cela représente 1,4 million de personnes supplémentaires qui sont tombées dans la pauvreté.
La part des personnes en situation de « privation matérielle et sociale », c’est-à-dire qui disposent d’un logement mais ne parviennent pas à couvrir certaines dépenses de la vie courante nécessaires pour avoir un niveau de vie acceptable, a augmenté dans des proportions identiques : elle est passée de 11,4 % de la population en 2017 à 13,1 % en 2023 – soit 1,2 million de personnes en plus dans cette situation.
Sept années de macronisme ont profondément accentué le rapport de forces en faveur du capital à un niveau inégalé. Alors que la productivité horaire a diminué de 2 % depuis 2017, le taux de marge[47] des entreprises a lui augmenté de 1 % et les profits de 12 %. C’est absolument inédit.
Dans les années 1970, le ralentissement des gains de productivité, dont l’ampleur était bien moindre que la situation actuelle, s’était répercuté de façon négative sur le niveau des profits : si l’on produit moins de richesses tout en employant la même quantité de travail, alors on dégage logiquement moins de marges. À l’inverse, aujourd’hui les entreprises parviennent aujourd’hui à préserver leurs profits : elles s’enrichissent quel que soit l’état de l’économie réelle. Ce sont donc bien des mécanismes artificiels qui dopent leurs profits :
- d’une part, les entreprises ont imposé avec succès des hausses de prix supérieures aux hausses de salaires nominaux.
- d’autre part, elles ont bénéficié de mesures socio-fiscales très avantageuses qui maintiennent leurs profits à flot : subventions sans restrictions, crédits d’impôts, exonérations fiscales. Ainsi, malgré une hausse conséquente des profits, les prélèvements nets des subventions des entreprises ont quand même baissé…
Trois secteurs économiques ont particulièrement bien tiré leur épingle du jeu (voir figure 2) : d’abord, le secteur de l’énergie, de l’eau et des déchets, où le taux de marge a explosé de 20 points alors que la productivité a diminué de 12,3 %. Deuxièmement, le secteur des industries agroalimentaires ; et troisièmement, celui des services de transports.
Dans ces trois secteurs économiques, non seulement les salaires réels ont fortement baissé, mais les prix ont augmenté bien plus que l’inflation moyenne : comme les grands groupes de ces secteurs sont en situation d’oligopole, ils ont la possibilité d’agir fortement sur les prix pour générer de juteux profits sur le dos des consommateurs. Dans ces secteurs, les profits contribuent ainsi fortement à la hausse des prix de production, bien au-delà de leur poids dans le prix de production.
On voit ainsi se dégager une « boucle prix-profits » : c’est la volonté des entreprises de maintenir leurs marges menacées qui est le premier facteur d’augmentation des prix. Cela infirme la thèse libérale sans cesse évoquée par les économistes mainstream d’une « boucle salaire-prix », selon laquelle la hausse des salaires entraînerait un cercle vicieux d’inflation.
Figure 2 : Secteurs qui ont profité de la crise inflationniste. Évolutions entre le deuxième trimestre 2017 et le quatrième trimestre 2024
| Énergie, eau et déchets | Industries agroalimentaires | Services de transports | |
| Taux de marge | +19,4 points | +7,1 points | +6,5 points |
| Productivité horaire | – 12,3 % | – 11,3 % | – 9,3 % |
| Salaire horaire | – 6,8 % | – 4,6 % | – 5,1 % |
| Profits | + 168,6 % | + 40,1 % | + 31,4 % |
| Hausse des prix de production | + 81,6 % | + 32,7 % | + 25,6 % |
| Poids des profits dans les prix de production en 2017 | 17,4 % | 8,8 % | 14,1 % |
| Contribution des profits à la hausse des prix de production | 47,4 % | 20,3 % | 20,7 % |
Lecture : Entre le deuxième trimestre 2017 et le quatrième trimestre 2024, le taux de marge a augmenté de 19,4 % dans le secteur de l’énergie, de l’eau et des déchets, de 7,1 % dans l’industrie agroalimentaire et de 6,5 % dans les services de transports.
FOCUS – La France, championne du monde des prélèvements obligatoires ?
La France est le pays de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) qui a le taux de « prélèvements obligatoires » le plus élevé, en pourcentage du PIB[48]. Cette situation est souvent décriée et présentée par les institutions patronales, les éditorialistes et les représentants politiques du bloc libéral et du bloc d’extrême droite comme une tare qui frapperait lourdement l’économie française.
Cela relève d’abord d’un présupposé négatif très idéologique contre la dépense publique et le système de protection sociale[49].
Mais surtout, il s’agit d’une instrumentalisation malhonnête des comparaisons internationales : l’expression de « prélèvements obligatoires » amalgame en effet tous les paiements faits à des services collectifs, tout en ignorant totalement les prélèvements privés, comme si ceux-ci ne pouvaient par nature être « obligatoires ».
Encadré : Les « prélèvements obligatoires »
Les prélèvements obligatoires sont les impôts et cotisations sociales prélevés par les administrations publiques et par les institutions européennes.
On en distingue trois types :
- Les impôts, qui sont prélevés sur l’ensemble des contribuables sans contrepartie, dans le but de financer les dépenses de l’État. On dit des impôts qu’ils sont « sans contrepartie » parce que les prestations fournies par les administrations au contribuable ne sont pas proportionnelles à la quantité d’impôts versés.
- Les cotisations sociales, qui s’ajoutent au salaire net et sont versées aux organismes de protection sociale.
- Les taxes fiscales, qui sont versées par les usagers d’un service, par exemple la taxe d’enlèvement des ordures ménagères.
Comprendre les écarts de taux de « prélèvements obligatoires »
Le Conseil des prélèvements obligatoires (CPO) et l’OCDE suggèrent d’ailleurs eux-mêmes de manier les comparaisons internationales avec précaution[50]. Les pays peuvent en effet utiliser des conventions de mesure différentes pour comptabiliser leurs prélèvements obligatoires dans la richesse nationale, ainsi que leur PIB. À cela peuvent s’ajouter des imprécisions dans les calculs. De quoi entraîner au total des écarts de taux de prélèvements obligatoires entre pays allant jusqu’à deux points, faussant considérablement les comparaisons.
Mais surtout, constater un écart de prélèvements obligatoires entre deux pays ne signifie absolument rien en soi : pour l’interpréter, il est indispensable de regarder de plus près de quels prélèvements on parle et quelles sont leurs fonctions.
La Sécurité sociale, une spécificité française
Les écarts de taux de prélèvements obligatoires entre les pays s’expliquent avant tout par le fait que la santé et/ou la protection sociale relèvent d’un financement public dans certains pays, et d’un financement privé pour d’autres[51].
Dans certains pays, les besoins de santé sont pris en charge en très grande partie par les administrations publiques (État, collectivités locales ou Sécurité sociale), à partir des cotisations sociales ou des impôts.
Ainsi, en Suède ou en Finlande, ce sont principalement l’État et les collectivités locales qui financent les besoins de santé grâce aux impôts. Dans d’autres pays comme la France, c’est la Sécurité sociale qui finance ces besoins à partir des cotisations sociales mais aussi, et de plus en plus, à partir de l’impôt, avec la fiscalisation croissante des ressources de la Sécurité sociale[52].
Dans d’autres pays encore, la couverture des besoins de santé laisse une grande place au marché privé. Dans ce cas, le système n’est pas financé principalement par les cotisations et les impôts : ce sont les ménages qui souscrivent par leurs propres moyens des contrats auprès d’assurances privées, généralement à but lucratif[53].
C’est notamment le cas aux États-Unis, où près d’une personne sur deux y est couverte par une compagnie d’assurance-santé dans le cadre de son emploi[54], et où 8 % de la population n’est pas assurée du tout, y compris par une base minimale de protection publique : essentiellement les Latino-américains et les Afro-américains, auto-entrepreneurs, ou privés d’emplois[55].
Figure 3 : Taux de prélèvements obligatoires, en points de PIB, 2022
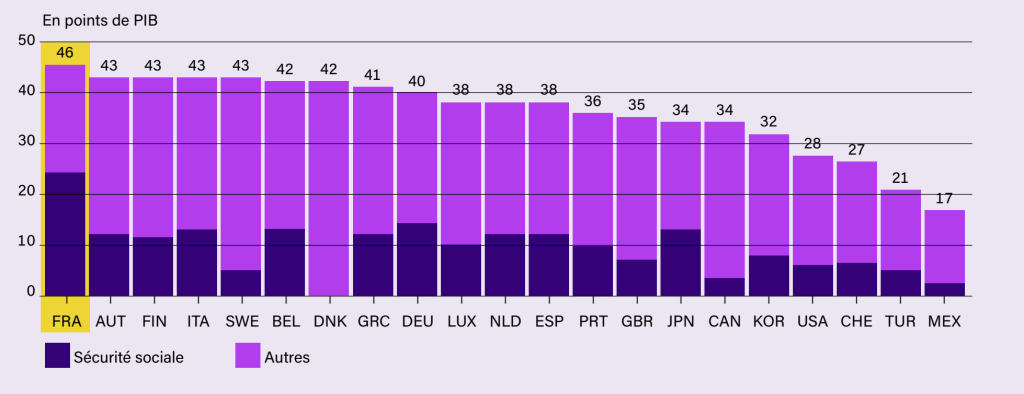
Lecture : Le taux de prélèvements obligatoires en France s’élève à 46 % du PIB, contre 43 % en Autriche, en Finlande et en Italie. La part des prélèvements obligatoires consacrés au financement de la Sécurité sociale représente près de 24 % du PIB en France, contre environ 12 % en Autriche.
Par rapport à la moyenne des pays de l’OCDE, la structure de la fiscalité en France se caractérise par une part des impôts faible[56] et une part des cotisations élevée (figure 4). Un tiers des prélèvements obligatoires correspond ainsi à des cotisations sociales.
Figure 4 : Structures fiscales en 2021 (en pourcentage du total des recettes fiscales)
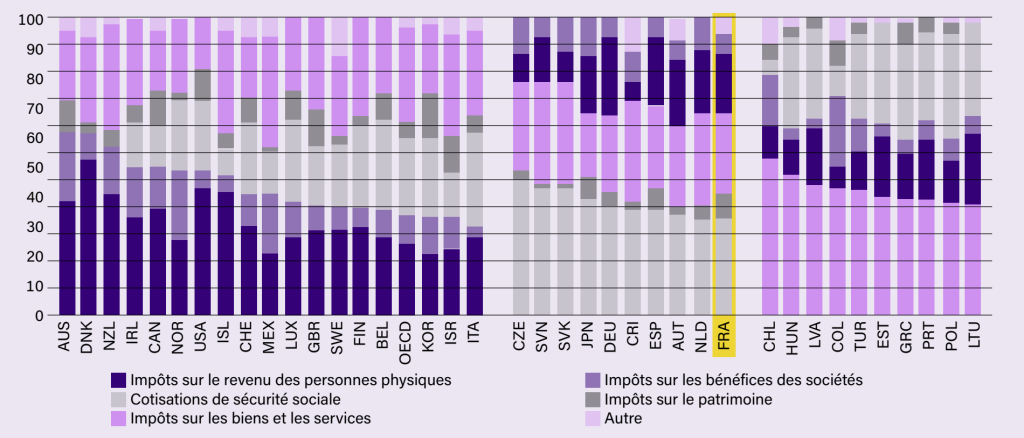
Lecture : En Australie, les impôts sur le revenu des personnes physiques représentent près de 40 % du total des recettes fiscales du pays, tandis qu’en France ils s’élèvent à environ 20 % des recettes fiscales totales. En France, les cotisations de Sécurité sociale représentent environ 30 % des recettes fiscales totales, soit la contribution la plus importante aux recettes publiques.
Si le niveau de prélèvements obligatoires est un peu plus important en France que dans d’autres pays ayant un niveau de vie comparable, c’est donc essentiellement parce que la France a fait le choix de mutualiser un certain nombre de risques sociaux. Le choix de développer un système de protection sociale où sont socialisés à la fois le système de retraites et de santé implique que les cotisations sociales sont comptabilisées dans les prélèvements obligatoires en France.
Dans des pays qui n’ont pas fait ce choix, les dépenses des ménages pour financer leur santé ou leur retraite ne sont tout simplement pas comptabilisées dans les prélèvements obligatoires. Mais c’est une réalité avant tout comptable : dans la vie réelle, les ménages doivent s’acquitter de ces prélèvements, qu’ils aillent à un organisme de sécurité sociale, ou à une assurance privée. S’ils ne le font pas, ils en payent un prix beaucoup plus cher au final.
Figure 5 : Tendances des ratios impôts/PIB, 1965-2022 (en pourcentage du PIB)[57]
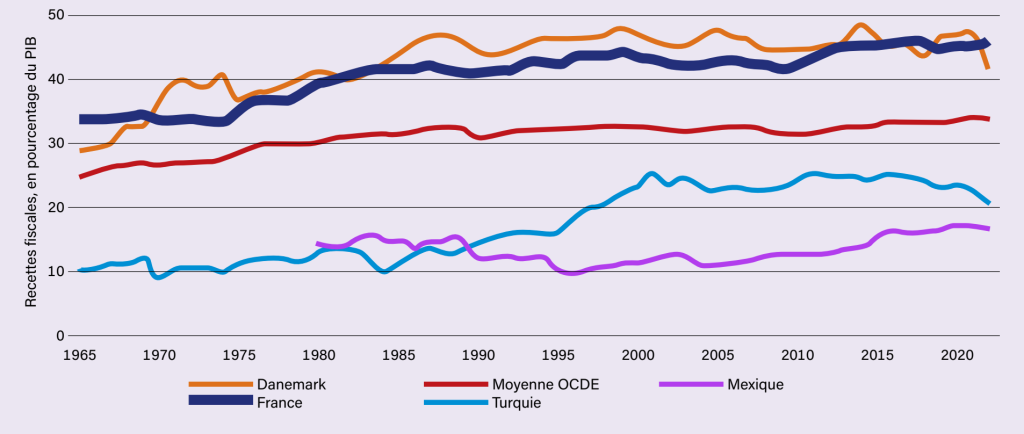
Lecture : Les recettes fiscales dans les pays de l’OCDE sont passées d’une moyenne de 25 % du PIB moyen de l’OCDE en 1965 à plus de 30 % en 2022.
Pour l’ensemble des pays de l’OCDE, le taux de prélèvements obligatoires a tendance à augmenter sur le long terme. C’est la conséquence du vieillissement de la population, qui exige une forte hausse des dépenses de santé et de retraite. Mais c’est aussi la conséquence du fait que ces besoins croissants sont en grande partie couverts par des dépenses socialisées, ce dont on peut se féliciter !
Surtout, les pays avec les plus forts taux de prélèvements obligatoires sont aussi ceux avec les taux de pauvreté monétaire les plus faibles ! Le fait d’avoir des « prélèvements obligatoires » élevés réduit en réalité la pauvreté. C’est logique, puisque ces prélèvements servent généralement à financer des prestations sociales qui réduisent les inégalités et sortent des personnes de la pauvreté.
Si l’on intégrait au revenu des ménages le bénéfice des services publics (éducation, hôpitaux…), on observerait d’ailleurs une corrélation encore plus négative entre taux de prélèvements obligatoires et taux de pauvreté !
Figure 6 : Corrélation entre taux de pauvreté et taux de prélèvements obligatoires (en pourcentage du PIB et en pourcentage de la population)
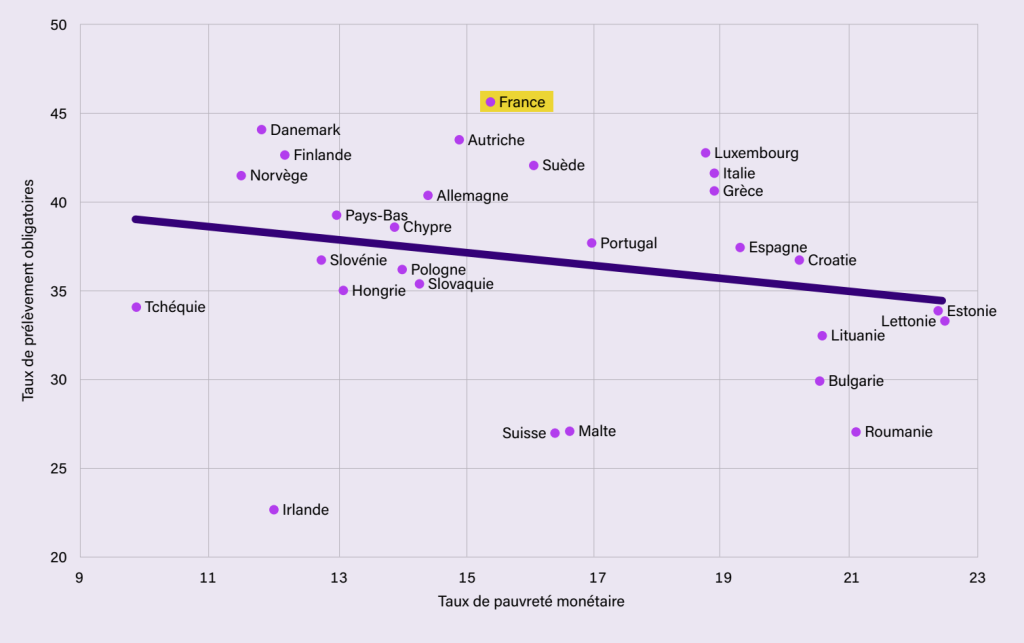
Lecture : La Norvège a un taux de prélèvements obligatoires qui s’élève à 41,5 % du PIB et un taux de pauvreté monétaire de 11,5 % de la population. À l’inverse, en Roumanie, le taux de prélèvements obligatoires correspond à 27 % du PIB et le taux de pauvreté monétaire atteint 21 % de la population.
Des dépenses sociales « collectives » plus efficaces
L’efficacité d’un système de santé se mesure d’abord par le poids de ses dépenses de gestion[58] : plus ce poids est faible, plus le système est efficace, puisque les dépenses de santé financent directement les actes médicaux pour la population. Les organismes publics de santé se révèlent à ce titre beaucoup plus performants que les organismes privés.
En France en 2023, les frais de gestion de la Sécurité sociale et de l’État pour la santé sont moins importants que ceux des organismes complémentaires, c’est-à-dire les mutuelles, assurances, et institutions de prévoyance : ils s’élèvent à 7,8 milliards d’euros, contre 8,3 milliards d’euros pour le privé[59]. Et ce alors même que les organismes publics prennent en charge une proportion bien plus importante des dépenses de santé : 78 %, contre 12 % seulement pour les organismes privés[60]. Si les organismes privés consacrent autant d’argent aux dépenses de gouvernance, c’est notamment parce que, pour survivre dans un marché compétitif, elles doivent payer des dépenses supplémentaires comme la publicité.
Mieux encore, les organismes publics continuent à gagner en efficacité, tandis que l’efficacité des organismes privés ne fait que se dégrader ! En effet, les dépenses de gestion des organismes complémentaires ont augmenté de 1,9 milliard d’euros en dix ans, alors que celles de la Sécurité sociale ont baissé dans le même temps de 700 millions[61].
Au niveau international, la présence importante d’assurances privées dans le système de santé tend aussi à faire baisser l’efficacité du système, en augmentant les dépenses de gestion. Moins il y a d’organismes publics, et plus il y a de dépenses de fonctionnement.
Aux États-Unis, où la part des organismes publics dans les dépenses de santé est de 53 %, les dépenses de gouvernance représentent 8 % des dépenses totales de santé. En France, elle n’est que de 5 %, pour une prise en charge des frais de santé à 78 % par le public. Et en Suède, elle est de 2 % seulement, pour une prise en charge des frais de santé à 86 % par le public[62].
En outre, lorsque la part des organismes publics est faible, la part des dépenses de santé dans le PIB tend à être importante pour des résultats médiocres.
Aux États-Unis, les dépenses de santé représentent 16,5 % du PIB, contre 11,8 % pour la France[63]. Les prix des produits de santé sont pourtant 2,4 fois plus élevés aux États-Unis qu’en France et l’accès aux soins est significativement dégradé : il y a 272 médecins pour 100 000 habitants, contre 340 en France[64]. Enfin, l’espérance de vie aux États-Unis est inférieure de quatre années à celle en France[65].
Ainsi, non seulement n’y a-t-il pas de sens à décrier le taux élevé de prélèvements obligatoires en France, mais il conviendrait plutôt de s’en féliciter : notre modèle de Sécurité sociale, financé par ces prélèvements obligatoires, est plus efficace, et moins coûteux pour une meilleure qualité de service, que le système de santé états-unien. Cette spécificité française représente un bien commun et un bénéfice net pour la santé de la population.
Conclusion
Les méfaits de l’organisation néolibérale de l’économie continuent de s’amplifier, sur fond de guerre commerciale. L’économie est aujourd’hui engluée dans une spirale qui mêle inflation, ralentissement de l’activité et destruction des emplois.
L’inflation repart à la hausse et menace le pouvoir d’achat des ménages, déjà durablement affaibli par l’explosion des prix endurée ces deux dernières années. Le capital continue de préserver son taux de profit par la hausse des prix. Et la hausse brutale des droits de douane va agir comme une taxe à la consommation dont la population sera la première victime. En conséquence, la consommation populaire stagne, ce qui prive la croissance économique de son principal moteur.
La menace du chômage de masse refait son apparition. Les destructions d’emplois connaissent une intensité alarmante. L’emploi indépendant précarisé semble être la norme sous le néolibéralisme.
Huit années de macronisme ont fait exploser les inégalités et fortement fragilisé l’économie française. D’un côté, les profits n’ont fait qu’augmenter, essentiellement grâce à la hausse des prix et aux aides publiques. De l’autre, les moyens de subsistance de la population se sont considérablement réduits : les salaires réels ont baissé, la précarité alimentaire et la pauvreté ont augmenté.
C’est le tableau d’une économie incapable d’assurer les besoins du plus grand nombre, mais pleinement disposée à semer le chaos pour enrichir le capital. La prochaine cible principale de ce capitalisme prédateur est ainsi la protection sociale, discréditée dans les discours et attaquée par des coupes budgétaires massives que le gouvernement compte intensifier.
Pourtant, la prise en charge collective des besoins fait ses preuves et se révèle même bien plus performante en termes économiques que l’organisation par le marché. Souvent présentée à tort comme championne des prélèvements obligatoires, sur la base d’instrumentalisation de comparaisons internationales, la France garantit une mutualisation des risques qui assure à chacun un accès à la santé. La Sécurité sociale coûte en réalité moins cher que les organismes de santé privé et elle diminue le coût des dépenses de santé.
03.03.2025 à 19:42
Rapport – Face à la crise industrielle : un plan de production pour répondre aux besoins
Émilien Cabiran
Texte intégral (10583 mots)
Ce rapport est le premier publié par l’Institut La Boétie. Il est coordonné par le département d’économie.
Les rapports ont vocation à fournir un état des lieux des secteurs et des composantes clés de la société, en proposant des perspectives de transformation tournées vers l’action. Ils mettent à contribution chercheur·ses et forces vives de la société, notamment à travers des auditions.
Introduction
En détruisant toute la politique du libre échange mondial d’abord imposée par son pays, Donald Trump cherche par des droits de douane à restaurer la base industrielle productive des États-Unis. Si condamnable que soit un tel changement avec des méthodes et des buts impériaux, cette orientation a sa rationalité. Elle montre qu’une limite est atteinte pour les pays hier dominants quand ils acceptent de sacrifier au profit financier leur capacité productive concrète. De fait, les décisions de Trump vont évidemment couper des chaînes d’approvisionnement car il s’agit bien d’un choix délibéré de défragmentation globale de la division internationale du travail. En France il n’y a ni réflexion ni stratégie gouvernementale concernant la nécessaire reconstruction de la base productive industrielle de notre pays. La logique financière reste au poste de commande. L’aberrante délocalisation massive des capacités productives vers l’est de l’Europe continue. Notre propos est de montrer comment et pourquoi cette politique a été mise en place, pourquoi elle mène à la ruine du pays et comment en sortir. L’actualité se charge hélas de vérifier nos pronostics. La fin d’année 2024 a vu l’industrie faire son retour dans les gros titres de l’actualité, à la faveur de la nette accélération de la fréquence des plans de licenciements. La liquidation spectaculaire de la filière automobile et les plans sociaux dans quelques entreprises emblématiques comme Michelin ont éclipsé des dizaines de fermetures et réductions d’activités touchant tout le territoire et des secteurs très variés. Sur un an, la CGT estime à 200 000 le nombre d’emplois directement et indirectement menacés[1].
Cette nouvelle crise de l’industrie interpelle à plus d’un titre.
Cette nouvelle crise de l’industrie est d’autant plus insupportable qu’elle ne coïncide pas, dans de nombreux cas, avec une baisse des bénéfices. En effet, alors que les grands groupes moteurs de l’industrie française dégagent de larges bénéfices, les fermetures de sites industriels et les suppressions de postes s’enchaînent dans le même temps. En revanche, les petites et moyennes entreprises (PME) sous traitantes font face à de véritables difficultés économiques, car elles sont dépendantes de donneurs d’ordre qui choisissent de se fournir à l’étranger.
Ensuite, l’ampleur de cette crise peut étonner au vu des niveaux déjà faibles de la production et de l’emploi industriels. En portant un nouveau coup significatif à ces secteurs, déjà au plus bas après cinquante années de désindustrialisation, cet épisode pourrait être un coup fatal ou au moins obscurcir pour longtemps toute possibilité de rebâtir une industrie répondant aux besoins du pays et adaptée à la bifurcation écologique.
Le gouvernement renonce à toute forme de réaction politique. L’incarnation de cet abandon revient au ministre délégué chargé de l’Industrie, Marc Ferracci, quand il affirme avec résignation que les suppressions d’emplois se poursuivront dans les prochains mois[2].
Ces nouveaux coups portés à l’industrie française doivent au contraire susciter une réaction à la hauteur des enjeux pour qui veut poser les bases d’un renouveau de la production pour répondre aux besoins du pays, gagner en emploi et savoir-faire et augmenter l’indépendance productive de la France..
Pour ce faire, l’Institut La Boétie propose dans ce rapport d’éclairer la crise actuelle à la lueur de la longue désindustrialisation dans laquelle le pays est plongé, pour en identifier les causes. Ces analyses permettent à la fois de dégager des pistes de politiques industrielles nouvelles qui s’attaquent à l’urgence actuelle et à la nécessaire transformation de long terme de notre production, mais aussi de réfléchir à la finalité de la politique industrielle et aux objectifs qu’elle doit poursuivre.
Il s’agit de dire comment produire plus en France, mais avant tout quoi produire et pour qui. Autrement dit, de proposer les bases d’un plan de production industrielle pour le pays, qui n’a aucunement été envisagé par les gouvernements successifs, celui d’Emmanuel Macron, comme ceux qui l’ont précédé.
Ce rapport a été élaboré avec le concours des chercheurs en économie de l’Institut La Boétie, à partir de la production d’instituts de recherche, de syndicats, mais aussi de personnalités et associations spécialisées auditionnées en amont de la rédaction du rapport[3].
Enfin, il a été enrichi des débats économiques contradictoires qui ont eu lieu dans le cadre des Journées économiques 2025 de l’Institut La Boétie, consacrées à la question « Que faire de l’entreprise ? », notamment lors des deux tables rondes « Comment mener à bien la transformation écologique des entreprises ? Le cas de l’industrie automobile » et « Quel rôle pour l’État dans le financement et la régulation des entreprises ? »[4].
I- Le bilan de la désindustrialisation et ses causes
L’ampleur de la désindustrialisation
La désindustrialisation n’est pas un phénomène nouveau. L’universitaire spécialiste de l’industrie Nadine Levratto fixe l’apogée de l’industrie française en 1975, lorsque l’industrie atteint son plus grand nombre d’emplois. Depuis, la désindustrialisation est amorcée. La part de l’industrie dans la valeur ajoutée[5] est passée de 25 % à son maximum à moins de 10 % aujourd’hui. Plus significatif encore que ces chiffres qui dépendent du développement des autres secteurs, la valeur ajoutée est, en termes absolus, plus faible qu’avant la crise du Covid, et au même niveau qu’à la veille de la crise de 2008.
Graphique n°1 : Évolution de la valeur ajoutée dans les branches industrielles[6]
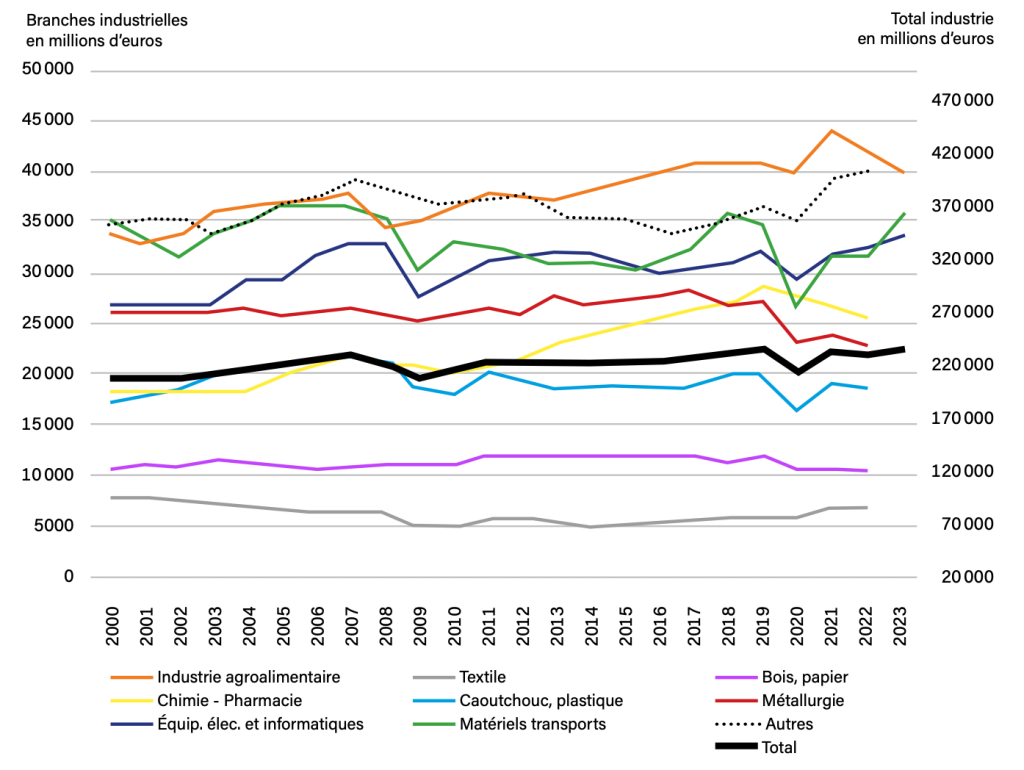
Lecture : La valeur ajoutée annuelle dans le secteur de la métallurgie est passée de 26 milliards d’euros en 2000 à 22,9 milliards d’euros en 2023.
Les emplois industriels représentent aujourd’hui moins de 10 % des emplois salariés totaux, suite à la perte de 2 millions d’emplois en 40 ans, soit plus d’un tiers des effectifs.
Graphique n°2 : Part de l’emploi industriel dans l’emploi total
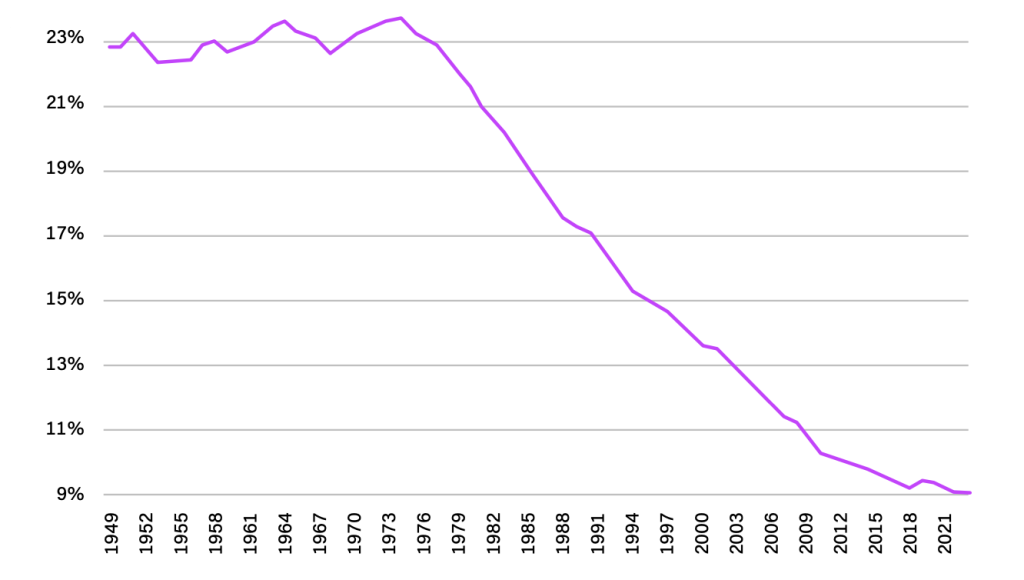
Lecture : En 1949, près de 23 % de l’ensemble des emplois étaient des emplois industriels, soit presque un emploi sur quatre. En 2023, les emplois industriels représentent 9 % de l’emploi total, soit moins d’un emploi sur dix.
Graphique n°3 : Évolution de l’emploi dans les branches industrielles
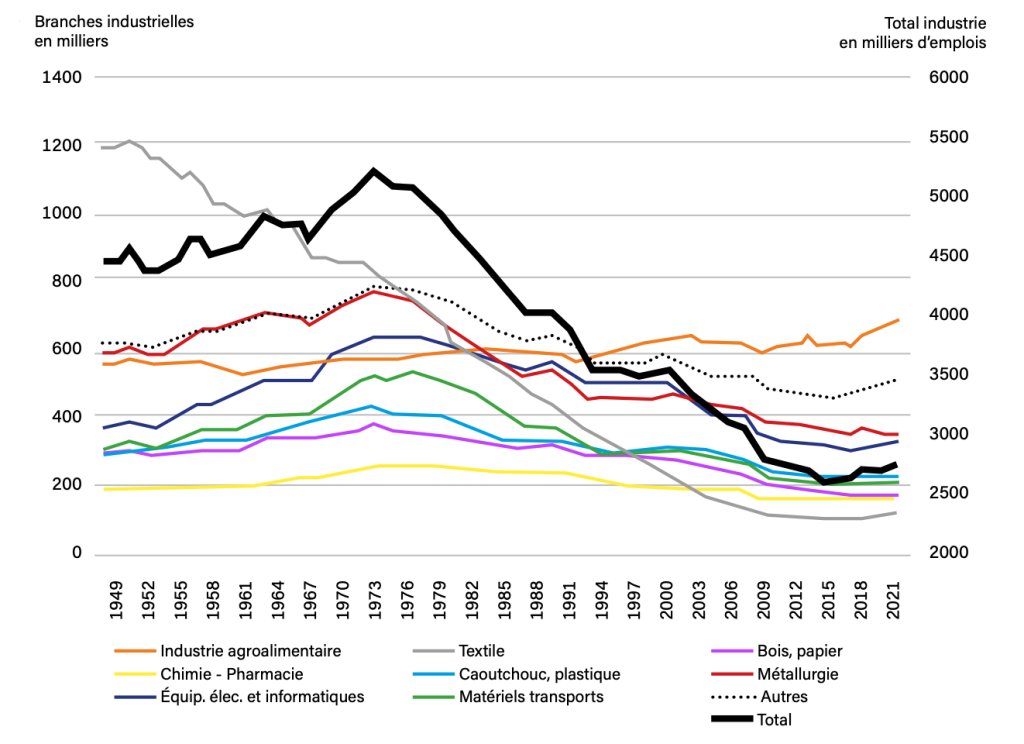
Lecture : Dans le secteur du textile, le nombre d’emplois s’est effondré, passant de 1,2 millions en 1949 à 118 000 en 2022. Sur la même période, le nombre d’emplois industriels total, toutes branches industrielles confondues, est passé de 4,4 millions en 1949 à 2,7 millions en 2023, avec un pic à 5,2 millions d’emplois en 1974.
La perte des emplois industriels est une tendance observée dans une certaine mesure par d’autres pays figurant parmi les plus riches au monde, particulièrement en Europe de l’Ouest et du Sud. Elle s’explique en partie par l’externalisation d’activités de services[7], comme le nettoyage, et par les gains de productivité réalisés[8]. Ces deux facteurs sont à l’origine de la moitié environ des pertes d’emplois entre 1980 et 2007[9].
Mais ces explications ne suffisent pas à comprendre le décrochage massif de l’industrie dans la valeur ajoutée, et surtout l’écart avec d’autres pays pourtant comparables. La désindustrialisation est beaucoup plus forte en France que dans les pays voisins : l’industrie manufacturière compte encore pour plus de 16 à 17 % du PIB en Italie et en Allemagne[10] par exemple, contre 9,7 % seulement en France.
L’antagonisme entre financiarisation et industrie
Comment expliquer cette singularité hexagonale ? Nous pouvons tout d’abord souligner l’objectif, partagé par les industriels comme par de nombreux élus, d’engager une politique volontariste de désindustrialisation. Les uns défendaient « l’entreprise sans usine[11] » quand les autres faisaient de la tertiarisation de l’économie une priorité.
Cette politique suit en réalité les mutations du capitalisme français. Sous l’impulsion des grandes mesures de déréglementation financière de la fin du 20e siècle, il est passé d’une forme dite rhénane à un capitalisme financiarisé sur le modèle anglo-saxon[12]. La France a suivi le modèle britannique qui a abouti à une désindustrialisation rapide et profonde.
La financiarisation de l’économie[13] est lourde de conséquence pour l’industrie. Pressés par leurs actionnaires, les grands groupes déploient des stratégies de maximisation de la rentabilité du capital qui mettent sur la touche des sites français rentables mais insuffisamment rémunérateurs aux yeux des propriétaires. Les conséquences sur le reste de l’économie sont d’autant plus importantes en France, où le tissu industriel est constitué avant tout de nombreuses PME dépendantes d’une poignée de grands champions, sans échelon intermédiaire à la gestion plus long-termiste.
La financiarisation et ses effets délétères sont rendus possibles par le libre échange, qui organise la mise en concurrence entre sites internationaux. C’est d’abord le cas à l’échelle mondiale : l’Union européenne (UE) multiplie les signatures de traités commerciaux et continue de jouer la « bonne élève » du commerce international en refusant de protéger sérieusement son industrie face au dumping de pays comme la Chine.
Mais c’est aussi le cas au sein de l’Union européenne, qui abrite des pays de production à bas coût, où les conditions de travail et de rémunération sont dégradées par rapport aux standards à l’ouest de l’Europe. L’UE applique une politique de concurrence interne, déconnectée des enjeux industriels, notamment en favorisant jusqu’ici les groupes allemands qui utilisent l’Europe de l’Est comme arrière-cour industrielle.
L’UE est ainsi le premier ennemi de l’industrie française, puisque que c’est en son sein que se font la majorité des délocalisations [14].
La délégation de la conduite des industries françaises à des acteurs financiers, notamment des gestionnaires d’actifs anglo-saxons, éclaire les décisions prises par plusieurs groupes ces derniers mois. Pour l’automobile par exemple, la situation des constructeurs est plutôt bonne et ne justifie absolument pas la vague de plans sociaux qui ont des conséquences sur toute la filière. Alors que certaines années ont effectivement donné lieu à des pertes (PSA en 2012, Renault en 2020, etc.), les constructeurs dégagent aujourd’hui des bénéfices importants, comme le souligne l’économiste spécialiste du secteur Bernard Jullien.
Le secteur automobile connaît actuellement un simple retour à la normale après une parenthèse dorée. L’industrie automobile a en effet connu un âge d’or au tournant des années 2020. Plusieurs facteurs ont fait bondir la rentabilité du secteur automobile au-delà de 10 %.
D’abord, les pénuries de semi-conducteurs ont raréfié l’offre de véhicules et fait augmenter les prix : le prix d’achat moyen d’une voiture neuve est ainsi passé de 24 000 à 30 000 euros sur la période. Paradoxalement, la pénurie a donné aux constructeurs un certain pouvoir sur les prix. Ensuite, les constructeurs ont également récolté les fruits financiers de leur stratégie de montée en gamme, consistant à privilégier la production de modèles de véhicule à forte marge comme les SUV[15] plutôt que des petits modèles. Enfin, le chômage partiel financé par l’État durant la crise sanitaire a permis aux constructeurs de maintenir leur rentabilité alors même qu’ils faisaient le choix d’arrêter leur production.
Ces facteurs conjugués ont permis une rentabilité exceptionnelle pour les actionnaires, mais par nature temporaire. Depuis, le secteur automobile a finalement retrouvé les marges standards autour de 6 ou 7 % du chiffre d’affaires. Or, c’est désormais insuffisant aux yeux des actionnaires qui se sont vu promettre et expliquer par les dirigeants des entreprises automobiles que la rentabilité à deux chiffres durerait encore longtemps.
Dans le cas de Michelin, qui a dégagé 3,6 milliards d’euros de résultat d’exploitation en 2023, le groupe fixe dans sa stratégie des objectifs toujours plus élevés en faveur des actionnaires, composés pour deux tiers de fonds d’investissement et de gestionnaires d’actifs étrangers[16]. La rentabilité du capital est ainsi passée de 10 % en 2019 à 11,4 % en 2023. Alors que le groupe reversait 21 % de son bénéfice aux actionnaires en 2019, cette proportion atteint 49 % en 2023, à un point de la cible de 50 % poursuivie par Michelin. Pourtant, malgré cette rentabilité grandissante, le groupe a annoncé la fermeture du site de Cholet, dont la production sera notamment redéployée en Pologne.
Ainsi, nous ne faisons pas face à des industriels désemparés par une situation économique difficile, mais bien à des stratégies d’optimisation de la rentabilité du capital incompatibles avec le maintien d’emplois en France. L’État ne fait rien pour empêcher cela. Bien au contraire, la loi El Khomri de 2016 a assoupli largement la définition du licenciement économique pour permettre aux industriels de licencier même si le groupe fait des bénéfices.
La doctrine d’Emmanuel Macron est impuissante
Ces travers de l’industrie française ont été renforcés par Emmanuel Macron depuis son arrivée au ministère de l’Économie en 2014. Sa politique industrielle s’est en effet résumée à une politique d’attractivité débridée dont le seul but est d’attirer n’importe qui, peu importe le secteur et la pertinence de l’investissement au regard des besoins du pays.
La politique d’Emmanuel Macron a consisté à tenter de capter des investissements étrangers en diminuant la fiscalité des entreprises, en intensifiant les subventions sans contrepartie et en laissant faire les opérations de rachat et les fusions d’industries françaises par, ou avec, des groupes étrangers, quelles qu’en soient les conséquences.
L’État et les institutions publiques chargées de la politique industrielle se sont alignés sur les intérêts privés. Plusieurs personnes auditionnées s’accordent ainsi à dire que l’État et la Banque publique d’investissement (BPI), présents au capital de nombreuses entreprises industrielles, se comportent comme des actionnaires classiques, avant tout préoccupés par la rentabilité et le niveau de dividendes et qu’ils ne défendent pas de stratégie industrielle. Le néolibéralisme imprègne ainsi les agents de l’État et les hauts fonctionnaires, qui intériorisent l’illégitimité de l’action publique sur la production : ils sont de ce fait convaincus que l’État ne doit pas s’immiscer dans les mécanismes de marché capitalistique.
Les résultats sont jusqu’ici peu probants. La France est en voie de désindustrialisation[17]. Après une forme de pause dans la désindustrialisation sur les deux premières années de mandat d’Emmanuel Macron, la tendance a repris après la crise du Covid. En décembre 2024, la production manufacturière était 6 % inférieure à celle d’avant-crise sanitaire[18]. Nadine Levratto parle par conséquent d’une « décroissance industrielle » en cours.
Le nouveau budget austéritaire de 2025 va amplifier cette désindustrialisation. La baisse des dépenses publiques plombe à la fois la demande intérieure et les investissements publics, qui à leur tour se répercutent négativement sur les carnets de commande des industries françaises[19].
Le recul de l’industrie française prend des formes différentes en fonction des filières, qui font chacune face à des enjeux industriels et commerciaux singuliers. Le Réseau Action Climat (RAC) s’est par exemple intéressé aux filières de l’industrie dite « verte ». Dans le photovoltaïque, c’est avant tout l’abondant dumping chinois, couplé à l’absence de véritable réaction de l’Union européenne et des États membres, qui a conduit à la quasi liquidation de la filière. Les secteurs de l’éolien offshore et des pompes à chaleur illustrent tous deux l’absence de planification publique. Le premier secteur se trouve dans un creux entre deux vagues de commandes de parcs ; le second est échaudé après avoir investi sur les bases d’un développement rapide, prévu dans la loi de programmation pluriannuelle de l’énergie, tandis que dans le même temps l’État réduit massivement la rénovation thermique.
| Les boucs émissaires de la désindustrialisation Une partie des industriels et des économistes libéraux attribuent à la désindustrialisation des causes qui servent plus leur agenda qu’elles ne collent à la réalité. Or, les politiques industrielles sont le plus souvent menées sur la base de ces diagnostics erronés. N° 1 : Le « coût du travail » Première cible du patronat et des libéraux : le déficit de compétitivité dû à un « coût du travail » qui serait trop élevé. S’il est évident qu’une heure de travail est davantage rémunérée en France qu’en Europe de l’Est ou en Asie, l’argument reste un peu court. Premièrement, des pays avec un « coût du travail » similaire ont une industrie bien plus performante. C’est le cas de l’Allemagne, souvent érigée en exemple, où l’heure de travail dans l’industrie des biens est plus chère qu’en France[20], sans que cela ne l’empêche d’être la 4e puissance industrielle mondiale. La baisse de 3 % des salaires réels[21] depuis la réélection d’Emmanuel Macron n’a pas amélioré notre performance industrielle. Deuxièmement, la course à la baisse du « coût du travail » a conduit à un enfermement dans des productions à faible valeur ajoutée. La politique de compétitivité-prix[22] qui cible des exonérations de cotisations sur les bas salaires est totalement contradictoire avec les injonctions à l’innovation et à la montée en gamme. Enfin, le déficit de compétitivité est un choix. La production française pourrait devenir compétitive dans de nombreux domaines si des protections étaient apportées. À défaut, nous continuerons à mener une course absurde au moins-disant social avec des concurrents hors d’atteinte : ce qui revient à acter la fin de l’industrie française dans la plupart des productions. N° 2 : Les normes et la transition écologique Les industriels pointent le rôle des normes et surtout celui de la réglementation environnementale. La crise de l’industrie automobile serait ainsi causée par l’électrification imposée du parc de véhicules. Or, le Réseau action climat (RAC) rappelle que 100 000 emplois avaient déjà été supprimés en France entre 2010 et 2020, soit avant les contraintes d’électrification. Les normes et réglementations, si leur pertinence peut être interrogée au cas par cas, visent à assurer une production de qualité, compatible avec la bifurcation écologique et effectuée en sécurité. De même que diminuer le coût du travail pour s’aligner sur les pays low cost est absurde, revenir sur des réglementations environnementales ne permettrait pas de rivaliser avec des pays où elles sont inexistantes et dégraderait également la qualité de la production. Le problème est donc le même : on ne peut pas exiger que des productions respectant des conditions sociales et environnementales d’un certain standard concurrencent d’autres productions qui en sont loin. Par ailleurs, les normes peuvent être utilisées comme des éléments de protection de la production industrielle domestique, mais aussi, comme c’est le cas pour la Chine, comme des outils de stimulation de l’innovation. Enfin, la bifurcation écologique ne signifie pas inévitablement une saignée des emplois industriels. Le RAC s’appuie sur les plans de transitions sectoriels des industries lourdes de l’Agence de la transition écologique (l’ADEME), qui chiffrent l’impact emploi de la bifurcation écologique sur l’industrie entre – 10 et + 10 %. N° 3 : Le coût de l’énergie Une des particularités de la nouvelle vague de désindustrialisation est qu’elle se propage à l’échelle européenne, notamment en raison de l’augmentation brutale du prix de l’énergie ces dernières années. En ce qui concerne le gaz, le prix est 3 à 5 fois plus élevé en Europe qu’aux États-Unis. L’Europe paie son électricité trois fois plus cher que la Chine. L’industrie de la chimie risque de perdre 15 000 emplois d’ici à trois ans pour cette seule raison[23]. Le premier responsable de cette situation est l’absurde marché européen de l’énergie qui pousse les prix à la hausse en marchandisant un bien essentiel et en alignant les prix sur les centrales les plus chères. Il faut revenir sur ce système pour privilégier un prix fondé sur les coûts de production[24]. L’Espagne et le Portugal ont fait un pas en ce sens, obtenant un plafonnement du prix du gaz utilisé pour la production d’électricité, avec à la clé une baisse des prix de 15 à 20 %. La France doit également faire un effort massif dans le développement des énergies renouvelables ainsi que dans la substitution de l’électricité aux énergies fossiles, notamment au gaz. Le bouquet énergétique de l’industrie est en effet composé à 36 % de gaz et à 10 % de pétrole[25]. En plus d’être un impératif écologique, cela permettrait d’être plus indépendant des prix de marché du gaz. Mais le prix de l’énergie ne doit pas être utilisé comme un prétexte justifiant l’intégralité des plans sociaux. D’abord, les industries les plus électro-intensives bénéficient en France d’un dispositif de soutien spécifique par l’État. Ensuite, tous les secteurs ne sont pas énergivores, et certains sont donc moins sensibles à la variation des prix, notamment lorsqu’ils bénéficient de contrats pluriannuels. |
Que fabriquons-nous encore ?
Que reste-il donc de l’industrie française après des décennies d’effondrement et une nouvelle vague de fermetures d’usines ces derniers mois ?
Le « made in France » fait face à une hécatombe[26]. Aujourd’hui, seuls 38 % des biens manufacturés consommés en France viennent de France, contre 50 % en Allemagne et en Italie : en l’espace de cinquante ans, la production française de biens manufacturés a été divisée par deux.
Les laboratoires d’idées Intérêt général et X-Alternative ont récemment proposé de s’appuyer sur l’indicateur du taux de couverture des besoins[27]. Cet indicateur permet de poser la question dans les termes suivants : produisons-nous, exportations comprises, plus ou moins que ce que nous consommons ? Ou autrement dit, dans quelle mesure la production nationale industrielle est-elle capable de répondre à la demande intérieure. Il donne ainsi une indication de la couverture des besoins du pays par la production sur le territoire national.
Selon cet indicateur, seules quatre branches sur treize (produits chimiques, pharmaceutiques, agroalimentaires et transport) y sont définies comme « résilientes », c’est-à-dire ayant un taux de couverture qui dépasse 100 %. Quatre branches sont dites « contractées » (métallurgie, bois/papier, réparation/installation d’équipements, caoutchouc/plastique) : elles bénéficiaient d’une relative bonne santé dans les années 1980 et parviennent tant bien que mal aujourd’hui à maintenir un taux de couverture entre 80 % et 100 %. Enfin, cinq branches sont « déficientes » et se situent sous les 80 % : machines et équipement, cokéfaction/raffinage, équipements électriques, textile et produits électroniques. En comparaison, en 1980, huit branches dépassaient les 100 % et aucune ne se trouvait en dessous de 80 %.
Le taux de couverture demeure un indicateur imparfait. D’une part, il ne permet pas d’entrer dans les dynamiques internes aux branches. Et d’autre part, il prend en compte les productions selon leur valeur monétaire. Cela peut cacher des pénuries sur certains produits. Les articles pharmaceutiques, par exemple, sont selon cet indicateur en apparence produits en quantité suffisante : or, en réalité, nous importons les médicaments essentiels et compensons cela par des exportations de produits pharmaceutiques plus chers.
Ajoutons que le déclin de certaines industries menace des branches encore porteuses. Ainsi, la fermeture de la quasi-totalité des fonderies françaises, la Fonderie de Bretagne étant la dernière en date[28], et les difficultés de la sidérurgie et de la métallurgie posent aujourd’hui problème pour la fabrication des matériels de transport et des équipements d’énergies renouvelables.
En somme, quand on ne fabrique pas les ingrédients de base, que les profits générés ne sont pas réinjectés dans la production française et que la production est exportée avant de répondre à la demande nationale, il ne peut pas y avoir de tissu productif durable. Nous sommes ainsi réduits à une organisation de l’économie réelle qui laisse sa gouvernance aux financiers et qui déconnecte les lieux de production et de consommation.
II- Quoi produire et comment : gouverner par les besoins
De nouveaux indicateurs pour mesurer les besoins
La désindustrialisation massive est à la fois un facteur aggravant et aggravé par l’ère de l’incertitude écologique dans laquelle nous sommes entrés.
Facteur aggravant, car les externalités négatives provoquées par les délocalisations, par l’abaissement des normes sociales et environnementales et par l’obsolescence programmée concourent à la destruction des écosystèmes et au réchauffement climatique.
Aggravée, car les conséquences du réchauffement climatique nuisent déjà concrètement à la production, à l’instar des centrales nucléaires mises à l’arrêt en période d’extrêmes chaleurs.
Produire pour produire, sans fin ni principe et au bénéfice de quelques-uns, appartient à une époque révolue. L’objectif de notre appareil productif doit désormais avoir pour cap de satisfaire les besoins essentiels du plus grand nombre, dans les limites de notre planète. Garantir les conditions collectives et individuelles d’existence suppose de faire coïncider les rythmes de nos productions avec les rythmes de la nature elle-même. C’est le sens même du terme « planification ».
Gouverner par les besoins nécessite d’abord d’élaborer de nouveaux indicateurs.
D’une part, nous avons besoin d’indicateurs pour connaître l’état de notre production et déterminer sa capacité ou non à couvrir les besoins de la population. Identifier les lacunes et les priorités est un préalable pour fonder une nouvelle politique, ce que le taux de couverture ne permet pas parfaitement. D’autre part, comme la production repose sur l’utilisation et la transformation de ressources naturelles, il est essentiel d’intégrer matériellement les écosystèmes dans les indicateurs de production.
Il faut passer à un raisonnement en « nature »[29]. Il s’agit de disposer d’un inventaire de la nature en termes physiques, et non financiers, et de quantifier nos besoins également en termes naturels. En effet, si certains indicateurs économiques doivent être pris en compte, il convient d’y associer des indicateurs physiques qui fixent le niveau du besoin : par exemple, plutôt qu’un nombre de voitures, un nombre de tonnes d’acier. André Vanoli suggère d’élaborer une « comptabilité développée des actifs d’écosystèmes (comptes du capital naturel) en termes physiques, avec la recherche d’une unité non monétaire de valeur écologique »[30], qui serait alors nécessaire pour mesurer constamment l’état des écosystèmes.
Cette nouvelle organisation de l’économie au service de l’intérêt général implique de fixer des objectifs, de développer des filières et d’anticiper les métiers dont nous avons besoin.
Les conditions d’une réindustrialisation écologique
La planification de la réindustrialisation écologique doit permettre de faire bifurquer l’appareil productif existant par la mise au point de procédés moins polluants, de matériaux plus durables, de gestes métiers adaptés aux nouvelles technologies et le raccourcissement des chaînes d’interdépendance économique par la relocalisation des activités. Des milliers d’emplois sont à la clé de cette nouvelle approche, fondée sur une économie régénérative.
La réorientation des productions doit être guidée par les grands chantiers visant à la fois à s’adapter à la part irréversible du changement climatique et à tout mettre en œuvre pour ne pas l’aggraver : rénovation des canalisations, infrastructures ferroviaires et transports collectifs en nombre suffisant, isolation thermique des bâtiments, modèle 100 % renouvelables…
Comme préconisé par le RAC et X-Alternative, cela suppose de développer une approche par filière pour concentrer les aides en priorité dans les secteurs les plus stratégiques. Mais il s’agit de penser des dispositifs qui donnent de la visibilité aux industriels, assurent la solidarité de filières entre les donneurs d’ordres et les sous-traitants et indexent la politique industrielle sur un double objectif de décarbonation et de recherche de scénarios favorables en emplois.
| La décarbonation, trompe-l’œil de la réindustrialisation verte ? La décarbonation de l’industrie française est loin d’être achevée. Même si les émissions de l’industrie diminuent tendanciellement depuis les années 1990, il demeure un déficit d’investissements total de l’ordre de 21 milliards d’euros[31]. Il faut aussi prendre garde aux faux-semblants : la baisse de 7,8 % des émissions de CO₂ entre 2022 et 2023 est en réalité due pour moitié à la baisse de la production de ciment et d’acier. Surtout, il faut se demander de quelle décarbonation nous parlons. Le Réseau Action Climat (RAC) alerte sur la mise en place d’une stratégie de décarbonation techno-solutionniste, qui privilégie le recours subventionné à l’hydrogène et aux technologies de captage et de stockage du carbone, au détriment des leviers principaux de la décarbonation que sont l’évolution des procédés et la sobriété. En clair, la décarbonation doit être appréciée qualitativement. De la même façon, son impact sur les emplois et les compétences reste actuellement un angle mort et doit être mieux anticipé. Enfin, la décarbonation ne doit pas être le seul objectif écologique assigné à l’industrie. Les enjeux de pollution des sols et des eaux ou encore d’impact sur la biodiversité sont aussi prégnants. |
Ce à quoi il faut s’atteler : redresser et relocaliser
Certains secteurs en déclin sont à redresser d’urgence : ceux de pointe comme le numérique (des câbles aux logiciels), mais aussi ceux fournissant les matières premières (acier, chimie) ou encore les machines-outils qui ont un effet d’entraînement important sur la chaîne industrielle. D’autres secteurs sont à développer : véhicules électriques et ferroviaires, énergies renouvelables (dont les énergies marines), approvisionnement en métaux stratégiques.
Dans les secteurs à redresser et à transformer (acier, chimie, ciment), la priorité est de conditionner les aides publiques au respect d’une trajectoire de décarbonation et de la loi climat et résilience. Pour ce faire, les contrats de transition écologique[32] ne sont pas un outil obsolète : l’État doit en être l’acteur principal de suivi. L’autre priorité est de prendre des mesures de protection pour soutenir les filières nécessaires à la transition écologique.
Dans les secteurs à développer massivement, tel celui des énergies renouvelables, l’État doit structurer les filières, soutenir l’offre mais aussi directement créer la demande par la commande publique. Le déploiement des parcs éoliens offshore doit permettre en priorité de remplir les carnets de commandes du tissu industriel national. C’est aussi le cas dans le secteur de l’automobile, où la flotte de véhicules d’entreprise peut être remplacée par des véhicules électriques produits en France[33].
La relocalisation des activités industrielles renforce notre souveraineté économique mais elle a aussi des vertus importantes pour l’économie[34]. Il y a un intérêt majeur en termes de PIB, d’emplois et d’écologie à relocaliser la production manufacturière, en particulier dans les filières de l’automobile et de l’agro-alimentaire.
Ainsi, si un établissement s’installe en France plutôt qu’à l’étranger, le coefficient multiplicateur de valeur ajoutée[35] est égal à 2,6 dans l’industrie agro-alimentaire et l’industrie automobile, et 2,2 dans l’industrie du bois et du papier.
Enfin, l’effet multiplicateur est aussi écologique, l’Insee établissant que « si l’activité manufacturière était rehaussée en France de 1 point de PIB en substitution de production ailleurs, les émissions mondiales baisseraient de 15 MtCO et l’empreinte carbone de la France baisserait d’environ 8 MtCO[36] ».
En tout état de cause, ce coefficient multiplicateur peut être un indicateur clé permettant d’identifier les secteurs à relocaliser en priorité.
III – Perspectives et mesures pour une réindustrialisation écologique
1 – Mettre en place une planification nationale de l’industrie
Les personnes auditionnées ont unanimement relevé la contradiction entre la multiplicité de leviers aux mains de l’État pour mener une politique industrielle et leur très faible utilisation. Pourtant, ce sont autant d’outils permettant de mettre fin au désordre dans les orientations industrielles actuelles au profit d’une coordination nationale de la politique industrielle et d’un ciblage affiné des filières de production stratégiques pour répondre à nos besoins face à la crise écologique. La planification industrielle nécessite un État stratège, qui à la fois s’empare de ces outils et en développe de nouveaux.
➝ Réinvestir les comités stratégiques de filières (CSF), où l’État, les industriels et les syndicats concernés sont chargés de piloter les projets structurants de la filière. Les CSF forment un embryon de concertation intéressant, dont l’ambition a été largement dévoyée, notamment avec la nomination d’entreprises étrangères à la présidence de certains d’entre eux. S’ils étaient élargis et réinvestis par l’État avec un but planificateur, ils pourraient fonder les réflexions sur la planification par filière.
➝ Créer une Agence nationale pour la relocalisation, destinée à planifier à l’échelle nationale la transformation de l’industrie française. En lien étroit avec le Conseil national de l’industrie et avec les CSF, elle associerait les différents services de l’État et mettrait à contribution les syndicalistes, les industriels, les chercheurs, les associations ainsi qu’une portion de citoyens tirés au sort.
➝ Conditionner les aides publiques à des contrats de bifurcation écologique. Aujourd’hui, l’État consent des soutiens massifs à l’industrie, de l’ordre de 27 milliards d’euros par an sur les dernières années[37] tout en laissant aux seules entreprises le soin de définir la politique industrielle.
Pour mettre fin à cette logique d’aide inconditionnelle, des contrats de bifurcation écologique pourraient être mis en place, sur le modèle des contrats de transition écologique passés en 2023 entre l’État et les 50 sites industriels les plus émetteurs en carbone, mais avec cette fois-ci un caractère contraignant. Les industriels établissent une feuille de route qui détaille leurs orientations en ce qui concerne la transformation écologique de leur activité selon un calendrier précis et ils reçoivent sur cette base des aides publiques adaptées à leurs besoins. En cas de non-respect des engagements pris, l’accompagnement financier de l’État est interrompu et les entreprises concernées sont dans l’obligation de rendre des comptes.
➝ Garantir l’emploi et la souveraineté stratégique pour les filières industrielles renouvelables. L’urgence climatique et la crise internationale de l’énergie rendent essentielle la conquête de la souveraineté énergétique par le développement des énergies renouvelables. Il est donc impératif de structurer et de développer les filières industrielles.
Cela passe premièrement par un plus grand partenariat entre monde de la recherche et industriels. Le financement des laboratoires publics de pointe dans le photovoltaïque doit être pérennisé. Des appels à projet annuels par filière de production d’énergie pourraient être lancés, afin de favoriser la recherche et les innovations de pointe liées aux énergies renouvelables mais aussi afin de soutenir la massification des technologies mises au point.
Cela passe ensuite par une plus grande planification du développement des énergies renouvelables. Un comité de l’emploi et des compétences liées aux énergies renouvelables pourrait être créé, à l’échelle nationale mais aussi régionale, dans le but d’anticiper les besoins en matière de main-d’œuvre et de coordonner la gestion des parcours professionnels. Un comité départemental de l’énergie, associant l’État, les communes et les établissements publics, pourrait aussi être chargé d’élaborer un plan climat-air-énergie départemental[38].
➝ Abroger l’ordonnance de 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique (EDF, Airbus, Renault, Naval Group, Safran). Cette ordonnance vise à faire de l’État un actionnaire standard, aligné sur les règles des milieux financiers, possédant les mêmes droits et les mêmes devoirs que les actionnaires financiers alors même qu’il représente l’intérêt général et la collectivité. Ces dispositions ouvrent notamment la possibilité pour l’État d’être représenté au conseil d’administration par des personnalités issues du monde de l’entreprise, et non plus par des fonctionnaires.
➝ Construire un pôle public industriel puissant, où l’État pèse en faveur de stratégies justes socialement et écologiquement. Dans les entreprises publiques et dans les entreprises où l’État possède des participations, via l’Agence des participations de l’État et via la Banque publique d’investissement (BPI) ou la Caisse des Dépôts et Consignations, l’État doit s’opposer systématiquement à tout ce qui va à l’encontre des intérêts de la bifurcation écologique. Par exemple, ne plus laisser EDF, dont l’État détient à lui seul 36 % des droits de vote, faire du lobbying pour les chaudières à gaz et continuer à développer des usines à charbon.
➝ Présenter chaque année devant le Parlement la stratégie industrielle globale des administrateurs de l’État, avec un débat en hémicycle suivi d’un vote.
➝ Auditionner une fois par an devant la commission des Affaires économiques de l’Assemblée nationale les représentants de l’État dans les conseils d’administrations des entreprises à participation publique.
➝ Développer des pôles territoriaux industriels, conçus comme des écosystèmes spécialisés, regroupant des secteurs complémentaires au sens large. Ces dispositifs accroissent la dépendance des sites et des entreprises entre eux et, ce faisant, rendent plus difficile leur délocalisation.
Des exemples peuvent être trouvés dans l’économie régénérative. C’est le cas en Isère où les savoir-faire existants pourraient être le creuset de la dépollution chimique. Il en est de même pour le nucléaire : avec un parc de centrales nucléaires vieillissant, la France a tout intérêt à se spécialiser dans les activités liées au démantèlement des centrales. Le dispositif « Territoires d’industrie », mis en place en 2018 pourrait avoir pour mission principale le déploiement de cette ambition stratégique, si l’État l’investissait comme une instance de planification industrielle et en assurait un financement pérenne.
2 – Définanciariser l’industrie
La bifurcation des modes de production ne peut être opérée sans rupture avec le capitalisme financier. En effet, la recherche du profit à court terme et l’abaissement continu des coûts sociaux et environnementaux, deux des facteurs principaux de la désindustrialisation massive, sont incompatibles avec le respect des limites planétaires. Le sort de l’industrie française ne doit plus être soumis à l’appétit de quelques actionnaires qui ont une emprise sur les orientations industrielles et contrôlent la gestion de la production. Définanciariser l’industrie permet de reprendre la main sur la production et d’organiser démocratiquement celle-ci.
➝ Interdire les licenciements boursiers. Un groupe qui fait des bénéfices, et donc verserait des dividendes à ses actionnaires, ou encore qui bénéficierait d’aides publiques destinées à soutenir son activité, ne doit pas pouvoir se séparer de ses salariés. Pour cela, la loi El Khomri, qui a significativement assoupli le droit du travail pour permettre les licenciements boursiers, doit être abrogée.
➝ Interdire les rachats par LBO[39]. L’acquisition d’une entreprise industrielle doit s’accompagner de garanties claires d’investissements.
➝ Étendre et renforcer la responsabilité des donneurs d’ordre sur les sous-traitants[40]. Le devoir de vigilance sanitaire et environnementale auxquels les donneurs d’ordre sont astreints sur toute leur chaîne de fournisseurs doit être étendu aux risques sociaux et économiques qu’ils font peser. La relation qui unit les donneurs d’ordre et les sous-traitants est en effet structurellement asymétrique et nécessite des garanties importantes.
Premièrement, les sous-traitants doivent être intégrés au comité de groupe du donneur d’ordre et prendre part aux discussions stratégiques. Deuxièmement, des contrats types de sous-traitance doivent être négociés dans chaque filière : ils reposent sur le principe de faveur et doivent donc assurer aux sous-traitants des dispositions plus favorables que celles prévues dans la loi. Troisièmement, la loi doit contraindre le donneur d’ordre à assumer ses responsabilités en cas de restructuration de l’activité et des licenciements pour motif économique que ses décisions peuvent provoquer chez les sous-traitants : le donneur d’ordre a l’obligation de contribuer à la création d’activités et d’atténuer les effets de ses décisions sur l’ensemble de la chaîne de valeur.
➝ Renforcer le pouvoir des salariés dans les entreprises. Premièrement, obliger à une représentation significative des salariés dans les conseils d’administration et garantir leur participation aux discussions sur la stratégie de l’entreprise. En tant que premiers concernés, les salariés doivent également bénéficier d’un droit de veto sur les plans de licenciements via le comité social et économique (CSE). Deuxièmement, accompagner, notamment par des prêts d’État, le développement de modèles alternatifs au modèle actionnarial.
Les coopératives sont un exemple intéressant d’un autre régime de propriété de l’entreprise et de répartition de la valeur en faveur des salariés. La Scop Acome, fabricante de câbles pour la télécommunication, l’automobile et le bâtiment, est un exemple de réussite : elle réunit ainsi plus de 1 000 associés et figure parmi les plus grandes coopératives du pays. L’échelle des salaires y varie de 1 à 10[41]. Un droit général de préemption des salariés doit être imposé en cas de difficultés de l’entreprise, afin qu’elle puisse être transformée en coopérative.
3 – Mettre en place une politique de la demande industrielle
L’obsession des derniers gouvernements pour la politique de l’offre[42], confectionnée sur mesure pour les intérêts du capital et des actionnaires, a fait oublier qu’une politique industrielle est aussi une politique de demande. En effet, à quoi bon produire si personne n’a la possibilité d’acheter ou si tout le monde préfère acheter chez les concurrents internationaux ?
Il est essentiel d’assurer aux industriels des débouchés, en échange de garanties. La visibilité dans le carnet de commandes et l’anticipation d’une consommation soutenue et pérenne des entreprises et des ménages favorisent l’investissement et l’emploi. La politique de la demande est ainsi à l’origine d’un cercle vertueux économique, qui se traduit notamment par une augmentation de la compétitivité des entreprises.
➝ Garantir une commande publique stabilisée en échange d’engagements des industriels : dans les énergies renouvelables, le modèle des pactes entre l’État et les filières doit être développé et généralisé aux autres champs de l’industrie.
Le pacte éolien en mer entre l’État et la filière illustre cette logique de contrepartie mutuelle : la puissance publique garantit des appels d’offre réguliers en échange de la création d’emplois. Bernard Jullien préconise une contractualisation similaire avec la filière automobile en Europe. En contrepartie d’une hausse de la production locale et le développement de petits véhicules électriques abordables[43], l’État pourrait s’engager à assurer une commande publique importante.
➝ Guider la demande et la commande privée par les normes écologiques. Le recours à la norme, pourtant si décrié par les tenants de la dérégulation néolibérale, est un moyen d’orienter la demande, notamment celle des entreprises.
Par exemple, dans le secteur automobile, on pourrait assurer un débouché massif aux constructeurs automobiles en obligeant les entreprises à rouler en électrique. En 2024, les 3 700 grands groupes qui possèdent une « grande flotte » de véhicules, c’est-à-dire plus de 100 véhicules, ont représenté 66 % des voitures et utilitaires mis en circulation[44]. Ces entreprises représentent donc un véritable débouché stratégique, d’autant plus qu’elles revendent très rapidement leurs véhicules sur le marché de l’occasion, où se fournissent plus de 8 particuliers sur 10 en France.
La loi les oblige désormais à respecter des quotas de véhicules électriques, mais trois quarts d’entre elles ne la respectent pas : la moitié n’ont même pas acheté un seul véhicule électrique sur toute l’année 2024[45]. L’État pourrait sanctionner financièrement les manquements à la loi et approfondir la réglementation sur l’achat des voitures par les entreprises afin d’imposer une plus grande proportion obligatoire de véhicules électriques[46], fabriqués et assemblés localement, dans le renouvellement des flottes d’entreprise.
Dans un tout autre secteur, celui très polluant de la construction, de nouvelles normes pourraient encourager l’utilisation de matériaux à faible empreinte carbone, comme le ciment bas carbone et inciter au recyclage et à la réutilisation des matériaux.
➝ Solvabiliser la demande grâce à une politique d’aide publique à l’achat. La politique sociale est l’une des composantes essentielles d’une politique de la demande cohérente : elle est garante d’une transformation écologique populaire.
Le bonus écologique à l’achat de véhicules électriques est aujourd’hui l’un des principaux outils de la politique d’aide à l’achat. Il faut le protéger de la menace austéritaire du budget de François Bayrou et le développer afin qu’il bénéficie en priorité aux ménages aux faibles revenus. D’autre part, on pourrait abaisser le plafond d’éligibilité des véhicules au bonus écologique : si seules les voitures électriques plus petites et plus légères, et donc moins chères, permettaient de bénéficier du bonus écologique, les constructeurs seraient incités à en produire davantage[47].
➝ Augmenter les salaires pour relancer la consommation populaire. La population doit pouvoir s’offrir les produits fabriqués localement et qui présentent un intérêt écologique. Pour cela, il est bien sûr nécessaire d’encourager les industriels à baisser les prix en rognant les marges des actionnaires, comme l’a fait le gouvernement chinois sur les véhicules électriques.
Mais il est surtout primordial de rémunérer dignement les salariés. Il faut revenir sur la politique de modération salariale : la baisse des salaires au nom de la concurrence avec des pays sans salaire minimum légal a des conséquences contre-productives pour les industriels eux-mêmes, puisqu’elle fait diminuer la consommation populaire. La politique industrielle est ainsi indissociable d’une politique sociale.
4 – Instaurer un protectionnisme solidaire et raisonné
La production française engagée dans la bifurcation écologique sera par définition plus chère que dans les pays où la production ne respecte aucun standard social et écologique. Dans ces conditions, la concurrence sur le marché international est absurde : non seulement parce qu’elle est structurellement déséquilibrée mais surtout parce qu’elle menace nos besoins.
Il est donc essentiel de mettre en place des protections ciblées et évolutives à l’échelle nationale. C’est tout le sens du « protectionnisme éducateur »[48], dont l’ambition est de protéger les industries naissantes face à une concurrence internationale débridée. Cette logique de sauvegarde pourrait être appliquée aux industries qui font un effort pour bifurquer dans le cadre de la transformation écologique des activités, et qui contribuent en cela à un regain de souveraineté en matière industrielle.
➝ Plaider pour le rétablissement de barrières douanières aux frontières européennes. Aujourd’hui, la concurrence internationale expose la production européenne à des offensives économiques violentes.
Dans le secteur de l’automobile, il est urgent d’instaurer une politique protectionniste coordonnée, pragmatique, coopérative vis-à-vis des constructeurs automobiles asiatiques mais aussi vis-à-vis des équipementiers et des fabricants de batteries électriques étrangers, qui mènent actuellement une guerre des prix dans le but d’empêcher le développement des sites de production de batteries européens.
Cette urgence est renforcée par la politique commerciale et douanière agressive de Donald Trump depuis son retour à la Maison Blanche. Des droits de douane renforcés et étendus à l’ensemble des composants des véhicules doivent être mis en place afin de protéger l’ensemble de la chaîne de valeur en France. Si ces mesures de sauvegarde vitales rompent avec la logique libre-échangiste qui domine le champ économique, elles peuvent être mobilisées en conformité avec les traités et l’Organisation mondiale du commerce, qui ménagent des possibilités de protection face au dumping.
➝ Rétablir des protections sur le territoire national pour donner la priorité aux productions nationales. Ces protections passent (i) par la préférence pour des produits français dans les marchés publics, (ii) par le conditionnement des aides publiques au maintien de l’emploi et de la production en France, s’agissant de l’entreprise aidée comme de ses sous-traitants, (iii) éventuellement, par l’obligation d’un prix minimum ou d’un minimum de contenu en produits locaux pour la vente de produits finis (comme l’a imposé l’Inde pour les voitures).
Certaines de ces mesures peuvent être justifiées par la décarbonation et reposer sur un éco-score construit de façon pertinente pour prendre en compte le contenu carbone des importations (cas du secteur automobile). Elles pourront néanmoins nécessiter de désobéir aux traités européens.
5 – Développer la politique de formation
Contrairement aux idées reçues et aux discours qui opposent écologie et emploi, la bifurcation écologique ne nuit pas à l’emploi à une échelle globale. Selon le RAC, entre 150 000 et 500 000 emplois supplémentaires sont attendus d’ici à 2030[49]. Le Secrétariat général à la planification écologique évalue à 2,8 millions le nombre de personnes à former dans les secteurs prioritaires d’ici 2030[50].
Si dans certains secteurs la transition permet une création nette d’emplois, les secteurs polluants, voués à évoluer, pourront bénéficier d’un accompagnement à la reconversion. Il faut agir en conséquence sur tous les fronts : formation initiale et continue, insertion, reconversion. Les compétences techniques et savoir-faire indispensables doivent être remis au centre : écoles d’ingénieurs, écoles de techniciens supérieurs. Cela suppose également une revalorisation de l’image des emplois de la transition écologique. Le tout dans une logique de transition juste des emplois telle que définie par l’Organisation internationale du travail (OIT) et l’ADEME[51]. Il nous faut rebâtir un enseignement professionnel public à la hauteur des besoins.
➝ Ouvrir des lycées professionnels. Depuis 2010, plus de 130 lycées professionnels ont fermé. Il faut inverser cette tendance pour former à l’acquisition de qualifications essentielles. Cela suppose de rompre avec la logique du « tout apprentissage », en privilégiant l’investissement dans les lycées professionnels plutôt que le versement de subventions aux entreprises pour l’embauche d’apprentis.
➝ Rétablir le baccalauréat professionnel en 4 ans. Emmanuel Macron avait diminué la durée de formation à 3 ans pour des raisons budgétaires, tout en transformant la première année en « année de formation ». En réalité, quatre années sont nécessaires pour l’acquisition des savoirs de haut niveau permettant de répondre aux exigences face à la crise écologique.
➝ Revenir sur la libéralisation des centres de formation d’apprentis (CFA) de 2018, qui a eu pour effet de concentrer la formation sur les requêtes de court terme des entreprises en dehors de toute logique de planification.
➝ Entreprendre une révision générale des « diplômes » délivrés par les centres de formation privés et vérifier le niveau de qualification qu’ils prétendent certifier.
➝ Création dans chaque département d’au moins un centre polytechnique professionnel, c’est-à-dire d’un pôle de formation professionnelle, réunissant sur un même site tous les cursus : lycées professionnels, brevet de technicien supérieur (BTS), licences professionnelles, écoles d’ingénieurs, formation continue.
Auditions réalisées
- Bernard JULLIEN, économiste spécialiste du secteur automobile.
- Réseau Action Climat (RAC)
- Antoine DURAND, responsable transition écologique et emploi au RAC.
- Aurélie BRUNSTEIN, responsable industrie lourde au RAC.
- Bastien CUQ, responsable énergie au RAC, chargé du suivi des filières renouvelables.
- Nadine LEVRATTO, économiste au CNRS, directrice d’EconomiX.
- Groupe de travail sur l’industrie de X-Alternative.
- Intérêt général.
Pour en savoir plus, retrouvez les détails de la méthodologie de cette note, téléchargez l’annexe méthodologique
03.03.2025 à 18:02
Faut-il se passer du numérique pour sauver la planète ? – Livre de Cédric Durand
Una Jullien
Texte intégral (588 mots)
Le 14 mars 2025, l’Institut La Boétie a publié le deuxième ouvrage de sa collection aux éditions Amsterdam : Faut-il se passer du numérique pour sauver la planète ? de Cédric Durand. À retrouver et commander en librairie !
Ce livre est issu des conférences données par Cédric Durand, économiste et spécialiste de renommée internationale des mutations du capitalisme contemporain, pour l’Institut La Boétie.
Il s’attaque à un sujet d’actualité : le capitalisme numérique et son caractère à la fois dominant et prédateur, qu’Elon Musk incarne bien aujourd’hui. Il s’agit de montrer comment, au-delà du personnage, il y a bien un système – le « techno-féodalisme » – que Cédric Durand décrit et décortique avec beaucoup de pédagogie.
L’enjeu est de taille au moment où s’engage une course entre les géants de la tech à propos de « l’intelligence artificielle », une course de laquelle la France et l’Europe semblent être hors-jeu. Le livre aborde ainsi l’enjeu crucial de la souveraineté numérique, c’est-à-dire de la capacité à rester autonome vis-à-vis de grands groupes états-uniens ou chinois, à la fois sur les plans théoriques et des propositions concrètes.
Mais l’originalité de cet ouvrage réside aussi dans le fait qu’il défend un usage progressiste du numérique. Sans ignorer la critique écologique des technologies de l’information et de la communication, l’auteur tente de dessiner les contours de ce qu’il qualifie lui-même comme une « voie étroite » : le « cyber-écosocialisme ».
Faut-il en finir avec le numérique pour sauver la planète ? est donc à la fois une analyse critique du capitalisme numérique, mais aussi une base pour construire un projet de réappropriation démocratique de la technologie.
C’est le premier livre en français consacré au capitalisme numérique accessible, facile à lire, court (168 pages) et d’une écriture fluide et directe. Ainsi, il met à la disposition du grand public les secrets de la puissance des seigneurs de la tech.
À commander et retrouver en librairie !
Retrouvez aussi nos événements autour du livre et du thème de l’IA et du numérique :
08.01.2025 à 19:16
Quand les fonds d’investissement font la loi
Manuel Menal
Texte intégral (4622 mots)
| Note de lecture du livre de Benjamin Lemoine, Chasseurs d’États : les fonds vautours et la loi de New York à l’assaut de la souveraineté, Éditions La Découverte, 2024. |
| Benjamin Lemoine est chercheur en sociologie politique au CNRS, affecté au Centre Maurice Halbwachs (ENS). Médaillé de bronze du CNRS (2018), il a enquêté sur la financiarisation des États à travers le cas de la dette publique et des transactions auxquelles celle-ci donne lieu. Son travail actuel porte sur le pouvoir de la finance privée, l’extraterritorialité du droit des États-Unis et les dettes du Sud global. Il a publié aux Éditions La Découverte L’ordre de la dette. Enquête sur les infortunes de l’État et la prospérité du marché (2016, réédité en 2022) et La démocratie disciplinée par la dette (2022). Il est membre du conseil scientifique de l’Institut La Boétie. |
Les fonds d’investissements font-ils désormais la loi ? Le livre de Benjamin Lemoine nous montre qu’en tout cas, ils savent particulièrement bien s’en servir à leur avantage pour générer des profits sur le dos des États.
C’est particulièrement le cas des « fonds vautours », ou fonds procéduriers, une catégorie spécifique de fonds d’investissements privés. Apparus dans les années 1980, ces fonds entendent tirer profit des États endettés en défaut de paiement en rachetant leurs créances à bas coût avant d’entamer des poursuites judiciaires pour leur soutirer un remboursement au prix fort. Ils agissent particulièrement auprès des États du Sud – en Amérique latine et/ou issus de la décolonisation –, car ils ont pour particularité d’émettre leur dette en droit américain.
Dans Chasseurs d’États : les fonds vautours et la loi de New York à l’assaut de la souveraineté, Benjamin Lemoine décrypte les mécanismes qui ont mené à l’essor de ces fonds, notamment l’évolution du droit américain en faveur des intérêts de la finance privée. Il remonte minutieusement le fil des événements pour montrer comment des États souverains sont devenus vulnérables face au pouvoir de la finance new-yorkaise. On y découvre ainsi la manière dont les États sont poursuivis par les créanciers et la variété de leurs tactiques pour les soumettre à la discipline de marché.
Le département de sociologie de l’Institut La Boétie vous propose un aperçu de cette enquête sociologique.
I. La dette, un champ de bataille : du règne des États au règne des Contrats
Depuis les années 1950, la restriction progressive de l’immunité souveraine, principe selon lequel un État ne peut être poursuivi devant les tribunaux d’un autre État sans son consentement, est à l’origine de l’essor des fonds vautours. Leur développement s’inscrit dans le cadre d’un ordre juridique international de plus en plus dominé par le droit américain, lequel privilégie les droits des créanciers sur la souveraineté des États.

© Nick Youngson, CC BY-SA 3.0/Pix4Free
La longue bataille pour la levée de l’immunité souveraine
Plutôt réticente initialement à rendre justiciables les États étrangers devant les tribunaux américains, l’administration américaine a progressivement revu sa position sous la pression des financiers privés et à mesure que les intérêts financiers étatsuniens se heurtaient aux expropriations étrangères. À partir des années 1950-1960, le département d’État, l’équivalent du ministère des Affaires étrangères, et le Trésor américain, tous deux favorables à ce que le pouvoir exécutif conserve le droit de juger de l’immunité souveraine des États étrangers, vont être confrontés à la pression des associations de financiers privés, telles que le Rule of Law Committee, lobby juridique extra-puissant soutenu par l’industrie pétrolière. Celles-ci défendent ardemment la possibilité de soumettre les États étrangers souverains au droit des contrats américain, afin de protéger, voire d’augmenter, leurs profits.
La Cour suprême étatsunienne va progressivement adopter une théorie restrictive de l’immunité des États, dans le sillon du département d’État en 1952. Elle va décider de séparer les « actes publics » d’un État de ses « actes privés », dont les actes commerciaux. L’immunité souveraine s’appliquerait ainsi pour les actes publics, mais pas pour les actes privés. Une distinction aux frontières pas toujours très claire entre « souverain » et « commercial » qui sera critiquée par certaines voix dissonantes à l’international[1], sans beaucoup d’écho.
Le premier électrochoc intervient en 1960, lorsque le dirigeant de la république de Cuba, Fidel Castro, nationalise 36 sucreries, raffineries de pétrole, compagnies d’électricité et de téléphone, trois banques et 19 entreprises américaines. À la surprise générale, en 1964, la Cour suprême statue en faveur de Cuba au motif dela « doctrine de l’acte de l’État », principe de droit international selon lequel les actes d’un État, accomplis sur son propre territoire, ne peuvent être contestés par les juridictions nationales d’un autre État – dans la même logique que l’immunité souveraineté.
La décision va enflammer la scène judiciaire, financière et politique américaine. La bataille pour décider qui des États ou des juridictions américaines auront le dernier mot s’intensifie, d’autant que l’enjeu devient de plus en plus important face à la multiplication des expropriations décidées par des États au Pérou, au Venezuela, au Congo, en Zambie ou en Libye…

© Granma Archives
Vers la fin des années 1960, le quasi-monopole des États-Unis sur le pétrole s’effondre suite aux vagues de nationalisations et à la constitution de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP)[2]. Les administrations Nixon (1969-1974) puis Ford (1974-1977) veulent mettre un coup d’arrêt à ces nations émergentes, souvent issues de la décolonisation, qui décident de reprendre en main leurs actifs stratégiques et revendiquent même un « nouvel ordre économique international ». Elles vont ainsi s’atteler à modifier profondément le cadre juridique en place.
Soumettre la raison diplomatique à la raison financière : l’adoption du Foreign Sovereign Immunities Act en 1976
L’objectif des acteurs financiers américains est clair : il faut faciliter la poursuite devant la justice des États étrangers pour que cesse l’hémorragie. Pour les milieux de pouvoir étatsuniens, où se mêlent professionnels du droit, de la finance et bureaucrates de haut niveau, il faut absolument déposséder la puissance diplomatique du droit d’interférer dans les affaires commerciales entre États étrangers et créanciers privés.
En 1976, sous l’influence des lobbys financiers et mû par la volonté de préserver l’hégémonie américaine, le président Ford consacre la protection de la propriété privée des investisseurs en adoptant le Foreign Sovereign Immunities Act (FSIA), en français « loi sur les immunités des États étrangers ».
Dorénavant, le département d’État n’a plus son mot à dire sur la décision d’attribution de l’immunité à un souverain étranger : c’est au Tribunal fédéral du district Sud de New York de statuer. Cela signifie qu’il devient formellement possible pour une personne de droit privé (par exemple, un fonds d’investissement) de poursuivre un État devant le tribunal pour exiger le recouvrement de ses créances.
C’est l’exact inverse du « droit absolu de de nationaliser des pays décolonisés » proclamé par l’Assemblée générale des Nations Unies le 1er mai 1974 à l’instigation des pays non-alignés.

© UN Photo/x
Le Sud global face au dilemme de la dette
Contrairement aux principaux États de la finance mondiale (France, Allemagne, États-Unis…), les États du Sud global contractent en grande majorité leurs emprunts en droit new-yorkais. Ils sont donc visés en première ligne par ce changement de paradigme.
Pour résister à cette nouvelle réalité juridique, il faudrait s’extraire du système bancaire et financier international. À l’heure du libéralisme triomphant des années 1980, le prix à payer pour contester ces les impéralistes du droit international est trop important : mieux vaut désormais s’y soumettre.
Exit la souveraineté populaire et la raison diplomatique : l’enjeu pour les États doit être désormais de sécuriser coûte que coûte l’accès aux marchés de capitaux privés et se conformer aux attentes des riches créanciers mondiaux. C’est l’heure de la chasse aux actifs.
| « Le modèle d’État-souverain dominant – au centre comme à la périphérie – se donne pour devoir prioritaire de sécuriser la finance, d’en être la terre d’accueil, de lui fournir des actifs sans risques, de lui garantir la Rule of Law et d’exécuter ses contrats à domicile comme à l’étranger, au détriment du reste de la population et des engagements sociaux, qui laissent peu de recours judiciaires aux bénéficiaires. » (p. 329) |
Les conséquences de ce nouvel ordre juridico-financier : le cas de l’Argentine
Les conséquences du nouveau cadre juridique instauré par le FSIA sont immédiates. Au début des années 1980, l’Argentine est fortement touchée par l’augmentation des taux d’intérêts américains. En difficulté pour rembourser ses dettes en dollars, le Trésor argentin émet des obligations, libellées en dollars, pour permettre le paiement de créanciers étrangers. En 1986, face à une nouvelle pénurie de dollars, l’État argentin décide de prolonger unilatéralement l’échéance de remboursement. Trois créanciers étrangers refusent cette modification et portent plainte auprès du Tribunal fédéral du district sud de New York pour exiger le remboursement complet et immédiat. L’affaire marquera un tournant en matière de justiciabilité des États.
C’est finalement la Cour suprême des États-Unis qui tranche le litige. Elle est confrontée à une question capitale, qui se retrouve en filigrane dans toutes les affaires liées aux fonds vautours : les activités de la Banque centrale d’Argentine, destinées à soutenir la politique monétaire du pays, relèvent-elles d’une fonction régalienne ou d’un acte commercial ? L’Argentine plaide, logiquement, pour une activité souveraine. Le juge Antonin Scalia choisira, lui, de regarder plutôt la nature commerciale des instruments financiers utilisés, écartant les arguments fondés sur la finalité politique.
En affirmant que les États qui agissent avec des outils de marché doivent être considérés comme des acteurs commerciaux, conformément à la loi FSIA, la Cour consacre la justiciabilité des dettes souveraines et élargit la portée extraterritoriale de la juridiction de New York.

Sur les murs de Buenos Aires, le président Macri, critiqué pour ses positions trop indulgentes vis-à-vis du régime militaire qui avait pris le pouvoir 40 ans plus tôt, est figuré en marionnette manipulée par les vautours et les grands groupes industriels, bancaires et médiatiques (Clarín, Barrick, Shell, JP Morgan et Monsanto).
La fresque est signée par les syndicats des travailleurs de l’État (ATE).
II) L’offensive des vautours. Une chasse mondiale aux actifs souverains
En étendant son règne au-delà de ses frontières nationales, le droit des contrats américain a donc révolutionné le rapport des États à leurs créances. Désormais, tous les États endettés vivent sous le risque permanent de se voir attaqués en justice par des fonds d’investissements qui jugeraient leur solvabilité défaillante. Cette évolution a permis aux fonds vautours de développer leur activité de façon exponentielle à partir des années 1990. Résultat : une aggravation des difficultés des pays du Sud endettés, et une érosion certaine de leur souveraineté.
Plan Brady : la chasse aux actifs est ouverte
Le phénomène des fonds vautours prend toute son ampleur à partir de 1989, grâce aux opportunités ouvertes par l’adoption du Plan Brady. Initié par le secrétaire du Trésor des États-Unis, Nicholas Brady, le plan consiste en un allègement partiel de la dette des États emprunteurs du Sud afin d’éviter qu’ils fassent totalement défaut. Pour cela, les États-Unis émettent des obligations garanties par le Trésor américain, qui sont censées stabiliser la valeur des actifs financiers du pays emprunteur, et lui permettre ainsi de continuer à se financer sur les marchés de capitaux. Mais pour pouvoir bénéficier de cet « allègement », les pays du Sud (Mexique, Pérou…) sont contraints de privatiser des pans entiers de l’économie et de réduire les déficits publics.

© Wallpaperflare. Montage Financial Times
Le plan Brady va stimuler d’une manière inouïe le marché secondaire de la dette des pays en voie de développement, qui augmente de 4 000 % entre 1989 et 1995. Concrètement, cela signifie que la structure de la dette souveraine devient plus diffuse : autrefois détenue par une dizaine de grandes banques et une centaine d’autres plus petites, on passe maintenant à une centaine de milliers de créanciers qui peuvent à tout moment se débarrasser de leurs titres de dette en les revendant sur le marché. Un véritable business s’ouvre alors pour les fonds vautours : ils vont pouvoir spéculer sur ce marché secondaire et traquer les États déficients.
| À noter : Depuis 2010, la part de la dette publique extérieure détenue par des créanciers privés a augmenté dans toutes les régions du monde : elle représentait 61 % de la dette extérieure totale des pays dits en développement en 2022. |
Ces nouveaux acteurs excellent dans l’art des procès et des pressions sur les gouvernements. Plus question de soutenir des procédures de conciliation entre États emprunteurs et créanciers : la volonté de profit maximal est pleinement assumée.
Plus largement, le directeur de l’association des marchés de dette secondaires des pays émergents (EMTA), Michael Chamberlin, résume les exigences de ces oiseaux de proie : « Le maintien de la stabilité dans les marchés émergents nécessitera une dose régulière de discipline de marché, ainsi que le soutien du secteur public ». Entendre : si vous refusez de vous soumettre à cette « discipline de marché », alors les marchés de capitaux ne voudront plus vous prêter. Si vous n’avez plus de capitaux, vous faites faillite, et le gouvernement en place perd le pouvoir.
Pour ces États dits émergents, c’est la possibilité pour la population de se soigner, d’étudier et de bien vivre qui est menacée en cas de non-respect de ces injonctions. La nouvelle logique des marchés secondaires, co-construite par les pouvoirs publics des États-Unis, est semblable à celle du FMI ou de la Troïka dans le cas de la Grèce : imposer l’austérité en conditionnant systématiquement toute aide à des plans d’austérité. L’âge de la prospérité des vautours est déclaré : le consensus de Wall Street[3] est né.

© Radio France – Giv Anquetil
Dépouiller le Pérou pour une plus-value de 400 % : la recette magique des fonds vautours
L’exemple péruvien illustre la voracité de ces fonds d’investissements. En 1983, le Pérou fait face à l’incapacité de payer sa dette extérieure. Le pays entame alors des négociations infructueuses, accumulant des dettes auprès d’institutions internationales et de créanciers privés. En 1995, sous la présidence d’Alberto Fujimori, le pays applique le plan Brady pour restructurer sa dette, émettant des obligations dont la valeur se déprécie progressivement.
Profitant de la situation, le fonds spéculatif Elliott Associates rachète, pour 11,4 millions de dollars, des obligations valant initialement 20,7 millions. Faisant preuve d’une capacité d’agressivité hors pair, en 2000, Elliott Associates attaque le Pérou en justice à New York pour exiger le remboursement intégral de la dette, des intérêts et des frais de justice. En usant de saisies ciblées, le fonds bloque ainsi les paiements internationaux destinés aux créanciers ayant accepté la restructuration de la dette. Acculé, le Pérou finit par accepter un règlement à l’amiable pour 58,45 millions de dollars, offrant à Elliott une plus-value de 400 % par rapport au prix d’achat initial des obligations en défaut !

© afp.com/THOS ROBINSON
Une recette encore plus sophistiquée est pourtant en train d’être concoctée dans les arrière-cuisines des chasseurs de dette souveraine pour augmenter encore la plus-value possible :
- Acheter la dette d’un pays près du défaut de paiement à bas prix.
- Attendre le plan de restructuration : malgré la garantie des obligations par le Trésor, il est certain qu’alors la valeur des actifs se dépreciera.
- Exiger alors que le pays rembourse intégralement sa dette en le poursuivant en justice !
Si l’opération est complexe et risquée, la plus-value attendue en vaut la chandelle : le montant total inclut non seulement la somme qui aurait dû être remboursée, mais aussi, les intérêts dus sur cette somme et les « intérêts sur les intérêts », c’est-à-dire ceux représentant la valeur des gains potentiels perdus du fait du retard de paiement.
L’extension des techniques des fonds vautours
Progressivement, les fonds vautours vont développer des techniques toujours plus pernicieuses. Ainsi, en pleine crise de la dette argentine dans les années 2010, les fonds vautours, comme NML ou Elliott Associates (toujours) s’illustrent par une nouvelle tactique de harcèlement envers l’État argentin : ils obtiennent en 2014, grâce à une nouvelle décision de la Cour suprême des États-Unis, l’autorisation d’une procédure dite de « discovery » qui permet aux créanciers de demander des informations sur les actifs souverains à l’étranger. Ainsi, il devient possible de localiser facilement les biens de l’Argentine pour mieux les saisir.
Cette décision donne un puissant levier aux créanciers du monde entier. Surtout, elle transforme les tribunaux américains en de grands intermédiaires financiers mondiaux pour les groupes financiers américains, localisant et saisissant pour leur compte les actifs d’États souverains.
Ainsi, de 2017 à 2019, les enquêteurs de la société américaine Kroll, spécialisée dans le renseignement privé, vont cibler la compagnie pétrolière nationale du Venezuela, Petrо́leos de Venezuela SA (PDVSA) pour récupérer des créances via l’identification de ses biens saisissables – notamment des ports commerciaux. Le Venezuela, la République du Congo, l’Équateur et la Tanzanie – pour ne citer qu’eux – subiront ensuite les mêmes traques sans relâche.
Conclusion
Les fonds vautours ont ainsi pu se développer grâce à la transformation du système juridique étatsunien opérée à partir des années 1970. Celui-ci a progressivement priorisé, sous la pression des lobbys financiers et des politiques, les intérêts des créanciers privés face à ceux des États souverains, en leur permettant de poursuivre judiciairement des États endettés pour exiger remboursement.
Alors que la majorité des États du Sud contractent leurs emprunts en devises et en droit américain, ces évolutions juridiques ont très fortement contribué à renforcer l’hégémonie étasunienne sur la finance internationale. Jusqu’à mettre en péril la souveraineté de ces États, ou du moins à redéfinir profondément les contours de cette notion.
Ce qu’il faut également retenir de cette longue enquête que nous propose Benjamin Lemoine, c’est le caractère contingent du développement des fonds vautours. Car les États ne sont pas des entités monolithiques, pas plus que le milieu de la finance ne constitue un bloc homogène. Ces espaces sont des champs de bataille, travaillés par des contradictions entre des fractions de la classe dominante, dont les intérêts ne s’harmonisent pas automatiquement. Ce sont ainsi les compromis trouvés entre les acteurs de l’hégémonie étatsunienne (le Trésor américain, le département d’État, le Tribunal fédéral du district sud de New York et les fonds vautours), au cas par cas, avec les États endettés, qui participent à redéfinir les règles de la finance globale.
La construction globale du droit hégémonique des États-Unis s’est ainsi faite au détriment d’une régulation internationale des dettes publiques. Mais les choses auraient pu être différentes, et des visions distinctes s’affrontent au cœur même de l’appareil d’État américain quant à la meilleure façon de défendre les intérêts du pays autour de cette question financière. D’ailleurs, c’est aujourd’hui à New York que des voix dissidentes s’élèvent pour tenter de réajuster les règles du jeu de la finance globale au profit des États du Sud[4].
Enfin, il ne s’agit pas d’affirmer que les États-Unis et ses créanciers privés sont les seuls maîtres de la finance globale ad vitam aeternam. La Chine devient aujourd’hui un concurrent de taille : elle est désormais le premier créancier bilatéral des pays en développement. Au point de modifier en profondeur les règles du jeu au niveau mondial ? Rien n’est moins sûr pour l’instant. Car pour en finir réellement avec la « loi de New York », nous aurons surtout besoin du retour de l’outil diplomatique et d’un renforcement des prérogatives d’institutions internationales, comme l’ONU, essentielles pour encadrer les procédures de restructuration des dettes des États du Sud.
On comprend ainsi, grâce à l’ouvrage de Benjamin Lemoine, que désarmer les chasseurs d’États et réguler la finance globale seront des passages indispensables à la réalisation des grandes bifurcations politiques nécessaires à notre époque. Avec pour horizon la construction d’un ordre de la dette juste, écologique et résolument non-aligné.
13.12.2024 à 17:30
La bataille des prix : quand les travailleurs perdent le combat de l’inflation
Zoé Pebay
Texte intégral (4423 mots)
| Note de lecture du livre d’Éric Berr, Sylvain Billot et Jonathan Marie, Inflation. Qui perd ? Qui gagne ? Pourquoi ? Que faire ?, Paris, Éditions du Seuil, 2024. |
| Éric Berr est co-animateur du département d’économie de l’Institut La Boétie et maître de conférences à l’Université de Bordeaux, spécialiste des politiques macroéconomiques. Sylvain Billot est statisticien-économiste et a contribué à plusieurs notes de l’Institut La Boétie, dont récemment la 4e note de conjoncture de l’Institut La Boétie. Jonathan Marie est maître de conférences à l’Université Sorbonne-Paris-Nord et travaille sur les dynamiques inflationnistes et l’efficacité des politiques macroéconomiques. Les trois sont notamment co-auteurs de la note de l’Institut La Boétie « Inflation : la lutte des classes par les prix », publiée en décembre 2022, et collaborent régulièrement aux travaux du département d’économie de l’Institut La Boétie. |
Alors que l’inflation semble refluer en cette fin d’année 2024, Éric Berr, Sylvain Billot et Jonathan Marie se proposent dans leur livre de tirer un bilan de l’épisode inflationniste qui a suivi le déclenchement de la guerre en Ukraine, mais aussi d’interroger le rôle et les perspectives de l’inflation sur le long terme.
Contrairement aux discours dominants dans les sphères médiatique et économique, les auteurs soutiennent que l’inflation est avant tout le produit d’un conflit dans le partage de la valeur ajoutée. En un mot, l’inflation est politique avant d’être économique.
Cette recension du département d’économie de l’Institut La Boétie rend compte des principales thèses des trois économistes qui permettent d’éclairer sous un autre jour les débats omniprésents sur l’inflation.
| Rappels sur l’inflation La notion d’inflation est à la fois très claire, dans la mesure où elle évoque instantanément une hausse des prix, mais aussi brouillée par les nombreuses représentations qu’elle charrie. Il faut donc dans un premier temps balayer les idées reçues à son sujet pour mieux comprendre de quoi il s’agit. En tant qu’augmentation des prix à la consommation, l’inflation semble au premier abord forcément négative, puisqu’elle entraîne une baisse du pouvoir d’achat. Or, cela n’est vrai que si les revenus n’augmentent pas au même rythme. De même, l’inflation n’est pas un indicateur de la santé d’une économie. Ainsi a-t-elle été parfois élevée pendant les Trente Glorieuses, mais aussi durant des moments de crise. La déflation, c’est-à-dire la baisse généralisée des prix à la consommation, n’est en revanche, elle, jamais souhaitable. Elle implique que les entreprises ne parviennent pas à trouver des clients et donc que l’économie se porte mal. En ce qui concerne la mesure de l’inflation, les auteurs expriment leur préférence pour l’IPCH (indice des prix à la consommation harmonisé) utilisé pour les comparaisons européennes. Il permet notamment d’intégrer les prestations de santé ou d’éducation qui font défaut à l’IPC (indice des prix à la consommation), l’indicateur de référence publié par l’Insee, qui a en conséquence tendance à sous-estimer l’inflation réelle. |
I) Les gagnants et perdants de la dernière période d’inflation
L’épisode inflationniste de 2021-2023 a marqué la résurgence d’une forte inflation, disparue depuis une quarantaine d’années. En s’appuyant sur les données de la statistique nationale, les auteurs en détaillent l’impact précis. En deux ans, les prix ont grimpé de 12 %, cela principalement dans le sillage de l’énergie (+ 29 %) et de l’alimentaire (+ 20 %). Le pouvoir d’achat a dans le même temps subi une baisse de 1 %. L’ouvrage permet ici de rappeler que l’inflation n’a pas le même effet sur l’ensemble de la population : la moyenne cache en réalité des disparités importantes.
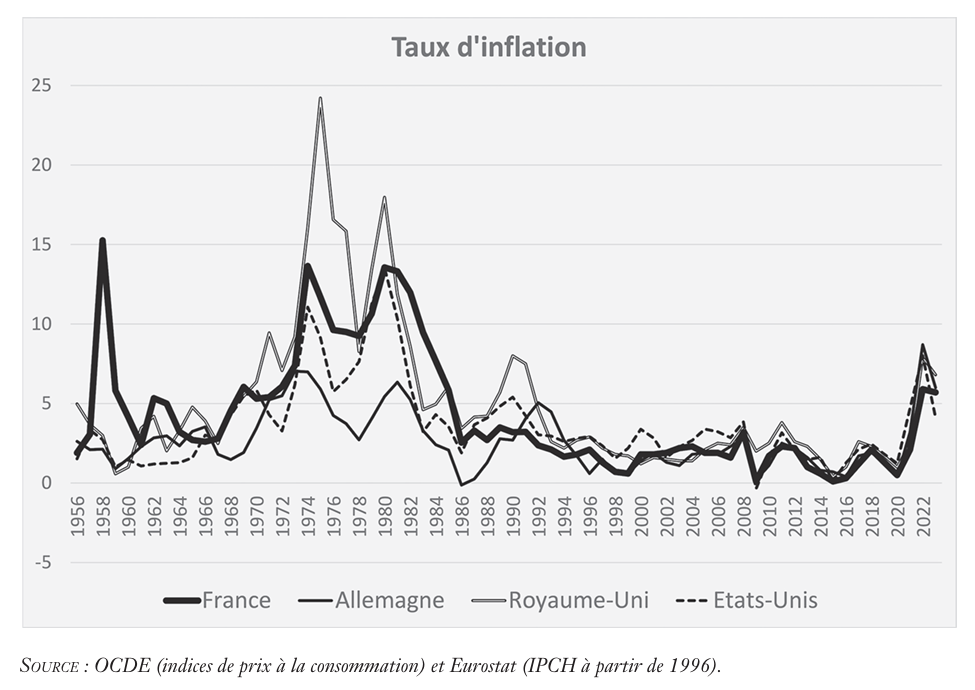
Depuis l’arrivée d’Emmanuel Macron au pouvoir, le salaire moyen par tête corrigé de l’inflation a chuté de 3,5 % en moyenne. Les auteurs reviennent notamment sur le mythe de la protection du SMIC face à l’inflation : oui, le mécanisme d’indexation permet de limiter la perte de pouvoir d’achat par rapport à d’autres salaires, mais il se fait sur des bases d’inflation sous-estimées, et de manière décalée dans le temps.
Sur la même période, les revenus du patrimoine corrigés de l’inflation ont, eux, crû de 19 %, et même de 85 % pour les dividendes ! Conséquence directe : les salariés se sont appauvris, quand les détenteurs de capital se sont enrichis. Les 10 % les plus riches ont été ainsi protégés de l’inflation : ils ont gagné 1,2 % de pouvoir d’achat sur la période.
| « Les disparités importantes entre ménages comme entre entreprises permettent de désigner des perdants (les catégories populaires), des gagnants (les détenteurs du capital), et des profiteurs de crise (les grands groupes de l’énergie, du raffinage, et de l’industrie agroalimentaire). » (p. 33) |
Du côté des entreprises, là encore, il serait faux de croire que l’inflation bénéficie uniformément à l’ensemble d’entre elles. Les conséquences de l’inflation sur les entreprises dépendent principalement de deux facteurs.
Le premier est leur sensibilité à la hausse du coût des intrants : ainsi, une entreprise qui produit de la farine est par exemple très sensible à une hausse du cours du blé, tandis qu’un cabinet de conseil est peu exposé à l’augmentation du coût des intrants.
Le second est la capacité à répercuter cette hausse dans les prix de vente. Par exemple, une boulangerie de quartier ne va pas pouvoir drastiquement augmenter ses prix sous peine de voir sa clientèle s’en détourner, et elle va donc être contrainte à rogner sa marge. Au contraire, une grande entreprise de l’agroalimentaire sera capable d’imposer des hausses de prix à la grande distribution qui a besoin d’avoir ses produits en magasin.
Par conséquent, un grand nombre de secteurs, et en particulier de petites entreprises, ont subi l’inflation, et la perte de pouvoir d’achat des ménages qui en a découlé. S’est opérée une redistribution des richesses au sein des entreprises vers quelques secteurs et entreprises bénéficiaires. Les auteurs citent ainsi les domaines de l’énergie, du raffinage et de l’agroalimentaire comme les grands gagnants de l’épisode.
L’étude précise des causes de l’inflation dans ces domaines fait apparaître que sur 2021-2023, la part de la hausse des prix due aux profits est de près d’un tiers dans l’énergie, et de 20 % dans le raffinage et l’agroalimentaire. Néanmoins, il faut distinguer deux périodes : une première, dans le sillage immédiat de la guerre en Ukraine, où les prix sont effectivement tirés par la hausse du coût des matières premières auxquelles ces secteurs sont sensibles ; puis une seconde, en 2022-2023, où ce sont les profits qui mènent la danse.
Sur la seconde période de 2022-2023, les profits représentent 41 % de la hausse des prix sur l’ensemble du secteur marchand ! Plus frappant encore, « dans le secteur de l’énergie, la totalité de la hausse des prix est expliquée par les profits », notent les auteurs.

© Kenzo Tribouillard, AFP
Mais comment ces entreprises ont-elles pu augmenter les prix sans subir une baisse de leurs ventes ? En effet, si une entreprise augmente fortement ses prix, elle devrait, selon la théorie libérale, voir ses consommateurs s’en détourner vers d’autres qui les augmenteraient moins.
Isabella Weber et Evan Wasner[1] suggèrent que certaines entreprises ont profité du choc de l’inflation, qui prépare les esprits des consommateurs à des hausses de prix, pour augmenter leur prix plus que nécessaire. Cela fonctionne particulièrement bien dans les secteurs où peu d’acteurs se partagent la plupart du marché, et peuvent donc tous en profiter pour faire passer de fortes hausses en même temps.
De ce point de vue, l’évolution de la gouvernance des entreprises joue un rôle important. Ainsi, la généralisation des phénomènes de « common ownership », c’est-à-dire quand plusieurs grandes entreprises d’un même secteur partagent les mêmes actionnaires – notamment des grands gestionnaires d’actifs comme Blackrock –, contribue fortement à la généralisation de l’inflation. En effet, les grands actionnaires vont avoir intérêt à ce que la hausse des prix soit suivie par l’ensemble des entreprises du secteur, sans quoi elle ne serait pas viable.
L’épisode inflationniste que nous avons connu est donc avant tout une inflation tirée par des profits.

© Sipa/Chang Martin
II) La protection des riches par la Banque centrale européenne
Pour comprendre l’attitude des responsables politiques actuels face à l’inflation, les auteurs retracent les différentes influences théoriques qui ont nourri leur action. La fameuse « relation de Phillips » d’abord, selon laquelle la baisse du chômage induirait une augmentation de l’inflation car les salaires augmentent. Les travaux de Milton Friedman ensuite, qui expliquent que la priorité doit être donnée à la lutte contre l’inflation, car il existerait un taux de chômage naturel qui assure l’équilibre de l’économie et ne peut donc pas être réduit durablement.
C’est cet héritage idéologique qui a inspiré la réaction de la BCE consistant à augmenter brusquement les taux d’intérêt. Dans cette logique, la hausse des taux, en freinant l’économie, devrait faire augmenter le chômage et donc faire baisser à la fois les salaires et l’inflation.

© Jay Eldy
Or, cette politique est contreproductive, expliquent les auteurs. En effet, l’inflation ne provenait pas, comme montré plus tôt, d’une surchauffe de l’activité ou d’une boucle prix-salaires. Ce cas de figure relève d’ailleurs avant tout de l’exception : il intervient seulement dans trois cas sur 22 épisodes d’inflation analysés par le FMI[2].
En revanche, il est clair que le choix de la réponse de la BCE revient à choisir les gagnants et les perdants de la séquence d’inflation. En effet, si l’inflation s’était accompagnée d’une hausse des revenus à la même hauteur, ce ne sont pas les salariés qui en auraient payé le prix, mais bien les rentiers, car l’épargne aurait alors perdu de sa valeur. En faisant en sorte de réduire les salaires et de casser l’économie, la BCE a fait le choix de faire payer les travailleurs plutôt que les rentiers.
| « Les politiques de hausse des taux d’intérêt menées par les banques centrales manifestent un aveuglement idéologique et mettent en œuvre une logique de classe brutale. » (p. 111) |
Les placements financiers des épargnants et les dettes détenues par les créanciers ont, en revanche, été protégés par la hausse des taux nominaux, qui se rapprochent du niveau de l’inflation. La « lutte contre l’inflation » mise en place par la BCE a en fait pour but de préserver les détenteurs de capital et l’épargne des plus riches. Elle le fait dans l’optique du « ruissellement » : préserver le capital et l’épargne est ainsi censé permettre l’investissement. Mais ce « ruissellement » n’est que théorique : pendant l’épisode inflationniste, les entreprises ont en effet privilégié la spéculation plutôt que l’investissement productif.
Cette politique de lutte contre l’inflation au détriment des travailleurs n’est pas uniquement le fait de la BCE : c’est la même politique qui est menée par Emmanuel Macron depuis son arrivée au pouvoir. Son objectif est la « modération salariale », c’est-à-dire le ralentissement de la croissance des salaires réels. Elle passe par l’augmentation de la concurrence sur le marché du travail à travers les réformes de l’assurance chômage ; par l’afflux de nouvelles personnes sur le marché avec la réforme des retraites ; et par le fait de favoriser les revenus qui contournent le salaire (primes, chèques).
La politique macroniste utilise donc la lutte contre l’inflation comme prétexte au service d’une politique générale de baisse de la rémunération du travail.
III) Perspectives de la bataille de l’inflation
Ce que les trois économistes nous montrent, c’est que l’inflation, au-delà de contingences de court terme, est le fruit d’un conflit sur la répartition de la richesse créée. Les auteurs expliquent que quatre facteurs agissent sur la hausse des prix : les actionnaires et les dirigeants ; les travailleurs, lorsqu’ils réclament collectivement des hausses de salaires ; l’État, par la fiscalité et les réglementations ; et enfin des causes extérieures telles que les guerres ou les phénomènes climatiques.
Ce sont les conflits entre ces acteurs qui modifient la répartition des revenus. Aujourd’hui, où en est le rapport de force dans le partage de la valeur ajoutée ? Le constat dressé par les auteurs est celui d’une inversion du rapport de forces, auparavant favorable aux salariés, en faveur du capital. La part des salaires dans la valeur ajoutée a en effet diminué de près de 10 points depuis le pic des années 1980.

Dans la configuration actuelle, la défaite des travailleurs pourrait se prolonger dans la mesure où la bataille autour de l’inflation va monter en intensité. Les auteurs identifient comme facteur clé de l’inflation présente et à venir le contexte de baisse des gains de productivité. En effet, en l’absence de gain de productivité, les entreprises sont obligées soit d’augmenter leurs prix, soit de freiner les salaires, soit de baisser leur marge. Pour maintenir à tout prix leurs profits, elles profitent donc de l’inflation pour augmenter les prix et freiner les salaires discrètement.
Jusqu’ici, depuis 2008, les États ont évité ce phénomène en subventionnant toujours plus les entreprises : les taux de marge ont été ainsi artificiellement maintenus avec de l’argent public, au détriment des déficits publics et du financement des services publics.
Les auteurs observent que, si l’inflation globale diminue aujourd’hui grâce à l’énergie et l’alimentaire, l’inflation structurelle reste élevée, notamment dans les services. L’inflation résultant de rapports sociaux, elle « s’accroît dans les périodes de remise en cause du compromis social en vigueur[3] » : une remise en cause rendue inévitable par la baisse des gains de productivité.
D’autres facteurs vont dans le sens d’un retour de l’inflation sur le long terme. D’abord, celui de la montée en puissance de l’inflation due aux dysfonctionnements de la mondialisation, ce que les auteurs nomment la « mondialisation inflationniste ». L’interdépendance croissante des économies est en effet source de fragilité : cela s’observe d’ailleurs déjà lorsque des tensions géopolitiques concernent des zones cruciales pour l’économie mondiale, ou lorsque le prix du transport flambe par exemple.
Mais c’est aussi le cas lorsqu’un phénomène comme une pandémie, ou des conditions climatiques particulières, viennent bloquer ou ralentir à un endroit de la planète une chaîne d’approvisionnement. C’est ce que l’on a vu dans la période des confinements, avec ces « goulets d’étranglement » qui ont créé des pénuries et donc des hausses de prix.

© L’insoumission
La crise climatique créera donc de l’inflation. D’une part, par les conséquences sur le système économique des dysfonctionnements climatiques, mais aussi parce que la bifurcation écologique implique de se priver de certaines méthodes de production, certes plus efficaces mais néfastes pour l’environnement. Cette bifurcation implique de « pouvoir compter sur une politique budgétaire ambitieuse, qui peut être source d’inflation » (p. 90).
IV) Que faire ?
En partant du constat que l’inflation pourrait s’installer durablement, les auteurs se demandent donc quelles politiques économiques et monétaires doivent être mises en œuvre. Celles-ci doivent permettre une augmentation des salaires plus rapide que l’inflation pour que ce soient les rentiers qui en paient le prix – et non plus les travailleurs – mais aussi pour rendre possible la bifurcation écologique.
En termes de politique monétaire, le mandat de la BCE doit être profondément élargi au-delà de la stabilité des prix pour intégrer des objectifs de plein emploi et de financement des déficits à coûts maîtrisés.
Pour mener à bien la bifurcation écologique, il apparaît essentiel de créer un pôle public bancaire car les investissements nécessaires ne sont pas les plus rentables dans un premier temps. Les auteurs estiment qu’il faut a minima augmenter la cible d’inflation, aujourd’hui à 2 %, pour permettre une hausse des salaires dans la livraison et les métiers de première ligne. Cette cible n’est que la face émergée de la politique d’austérité budgétaire prônée par Bruxelles, qu’il faut revoir de fond en comble.
| « Une chose est sûre : conserver une cible d’inflation à 2 % est incompatible avec la réalisation de la bifurcation écologique. » (p. 91) |
Ensuite, les auteurs prônent, dans le sillage d’Isabella Weber, une forme de contrôle stratégique des prix, « outil qui a fait ses preuves à plusieurs reprises dans l’histoire ». Cela consiste à bloquer certains prix, par exemple lorsqu’il existe une trop forte demande pour une certaine quantité d’offre, ou bien quand des entreprises profitent d’une position de force sur le marché. L’indexation des salaires sur l’inflation permettrait dans l’autre sens de garantir le niveau des salaires réels.

Les auteurs inscrivent ces mesures dans le cadre d’une transformation globale du système économique : réforme des régimes de propriété et de gestion des entreprises, nationalisation d’entreprises dont le but n’est pas l’accumulation de profits, augmentation des droits des salariés ou encore extension du champ de la Sécurité sociale pour satisfaire les besoins fondamentaux.
Conclusion
La lecture de ce court ouvrage apporte à la fois des rappels salutaires et des enseignements précieux. D’abord, l’inflation est politique et non pas une simple affaire de paramètres économiques neutres. Non seulement ses causes dépendent d’un rapport de force, mais les réponses qui lui sont apportées également.
Il ne faut pas craindre l’inflation en elle-même mais, puisqu’elle est inévitable sur le long terme, mais bien plutôt de modifier les politiques économiques pour que cette inflation soit adossée à une progression des salaires et à l’avancée de la bifurcation écologique, sans nourrir de comportements opportunistes de la part des entreprises.
Les auteurs appellent ainsi à affronter rationnellement l’inflation. Cela nécessite de sortir des politiques dogmatiques actuelles pour « réfléchir à la hiérarchisation des objectifs de la politique économique et aux moyens à mobiliser pour les atteindre » (p. 112). En somme, gouverner par les besoins.
Pour aller plus loin :
|
14.11.2024 à 15:39
Point de conjoncture #4 – Novembre 2024
Émilien Cabiran
Texte intégral (6723 mots)
Cette note est la quatrième édition du « point de conjoncture » de l’Institut La Boétie.
Le département d’économie vous propose régulièrement, dans ces points de conjoncture, une lecture critique pour décrypter et mettre en perspective l’actualité économique. Dans chaque note, vous découvrirez un focus spécifique sur une question économique d’actualité.
Vue d’ensemble : une économie mondiale toujours déprimée
L’économie française est engluée dans une profonde dépression, avec une croissance de la richesse produite faible : autour de 1 % en rythme annuel depuis début 2022. Elle peine à dégager des gains de productivité[1]. La consommation des ménages et l’investissement des entreprises, c’est-à-dire la demande nationale privée[2], sont atones. C’est le commerce extérieur et la dépense publique qui expliquent le reste de croissance que l’on observe depuis deux ans.
Les perspectives se dégradent encore pour les trimestres à venir. Après un léger effet JO pendant l’été, l’indice qui suit l’évolution de la production dans le secteur privé (PMI Flash HCOB[3]), s’est dégradé nettement en septembre, puis en octobre. Le « climat des affaires », qui synthétise tout ce qui pousse ou retient des décisions d’investissement ou d’embauche de la part des patrons, s’est effondré dans l’industrie en octobre. C’est même la plus forte baisse mensuelle depuis novembre 2008[4]. Le discours gouvernemental sur la réindustrialisation paraît ainsi plus que jamais en décalage avec la réalité. Les perspectives sont particulièrement sombres pour le secteur de l’automobile et des moyens de transport en général. Elles sont aussi fortement dégradées pour la production de biens d’équipement (les machines notamment), puisque l’investissement des entreprises continuerait à se dégrader dans les mois qui viennent.
Au niveau mondial, le Fonds monétaire international (FMI) anticipe la persistance à court et moyen termes d’une croissance « médiocre » autour de 3 %[5]. Depuis la fin du Covid, les pays de l’Europe du Sud (notamment l’Espagne) prennent leur « revanche » sur les pays de l’Europe du Nord : l’Allemagne connaîtra ainsi en 2024 une nouvelle récession (– 0,2 %), après celle de 2023 (– 0,3 %).
En 2025, la croissance ralentirait là où elle a été la plus forte (aux États-Unis, en Espagne ou en Chine). Elle se redresserait légèrement dans les pays qui ont connu la stagnation ou la récession (en Allemagne ou au Japon).
L’économie mondiale n’est pas sortie de la dépression qui a fait suite à la crise de 2008. Tout cela dessine le tableau général d’un capitalisme morbide où les entreprises tirent avant tout leurs profits des aides publiques et du blocage, voire de la baisse, des salaires réels.
Croissance : une faible croissance tirée par le commerce extérieur et les dépenses publiques
Sur ces deux dernières années (entre le 3e trimestre 2022 et le 3e trimestre 2024), le produit intérieur brut français a augmenté de 2,1 %. La consommation des ménages et l’investissement des entreprises y ont contribué négativement pour – 1,3 point, alors que le commerce extérieur y a contribué positivement pour 2,2 points, et les dépenses publiques pour 1,2 point.
| La fin de l’inflation ? Étudier le poids de chaque composante de la croissance du PIB[6] permet d’invalider la thèse d’une explication de l’inflation par une surchauffe de la consommation dopée par les revenus et le surplus d’épargne après la fin des confinements. En effet, on ne constate pas d’envolée de la demande privée interne. L’inflation a d’abord été provoquée par une augmentation de certains coûts de production : hausse des prix de l’énergie, perturbations des chaînes d’approvisionnement liées au Covid. Elle a ensuite perduré car les entreprises, en particulier les grandes, ont maintenu leurs marges à tout prix, alors que la productivité du travail baissait[7]. Puisqu’elles produisaient moins avec la même quantité de travail, les entreprises ont maintenu leurs marges en augmentant les prix. Ceci s’est traduit par une baisse des salaires réels, puisque dans le même temps l’évolution des salaires nominaux[8] n’a pas suivi celle des prix. Les grands groupes des secteurs du raffinage, de l’agroalimentaire[9], de l’énergie, du transport maritime ont même fortement augmenté leur taux de marge, et peuvent être caractérisés en tant que « profiteurs de crise » : dans ces secteurs en particulier, l’inflation a été directement alimentée par les profits. L’inflation a fortement ralenti ces derniers mois, tirée à la baisse par la chute des prix de l’énergie et par la modération des prix industriels (en raison des surcapacités de production chinoises). Mais l’inflation dans les services est, elle, toujours au-dessus de 2 %. D’autre part, la montée des tensions géopolitiques, menant à des tensions sur les prix et les circuits d’approvisionnement internationaux, ainsi que la faiblesse persistante de la productivité, nous font penser que l’inflation pourrait persister et rebondir, d’autant plus si le conflit de répartition entre salaires et profits s’intensifie en faveur des revenus du capital. |
La contribution positive du commerce extérieur à la croissance ne signifie pas que la France dégage des excédents commerciaux. Elle signifie que le déficit de la balance des biens et services[10] diminue, non pas tant en raison d’exportations particulièrement dynamiques, mais en raison d’une baisse des importations à mettre en lien avec la faiblesse de la consommation interne des ménages et des entreprises.
L’autre contribution à la croissance, les dépenses publiques, est directement menacée par le tournant austéritaire. Dès la fin de l’année 2024, la consommation collective des administrations publiques (services publics qui bénéficient à la collectivité dans son ensemble) ralentirait fortement, et le projet de budget du gouvernement amputerait la croissance de 0,8 point en 2025 selon l’OFCE[11].
La situation est particulièrement critique dans le secteur de la construction, qui a été pénalisé en particulier par la hausse des taux d’intérêt des banques centrales pour lutter contre l’inflation. En effet, cette hausse a été à l’origine d’une diminution de la capacité des ménages à emprunter pour investir dans l’immobilier. La France n’a jamais produit aussi peu de logements neufs qu’au cours de la période allant de juillet 2023 à juillet 2024[12]. Avec 2,7 millions de ménages en attente d’un logement social, une construction toujours à l’arrêt et 330 000 personnes sans domicile fixe – deux fois plus qu’il y a dix ans –, tous les voyants ont viré au rouge écarlate.
Les JO ont permis une hausse de la croissance au 3e trimestre[13], mais elle est anticipée comme nulle au 4e trimestre par l’Insee ou l’OFCE. En 2025, la croissance sera très faible, la consommation des ménages étant pénalisée par le maintien d’un taux d’épargne[14] nettement supérieur à l’avant Covid (d’environ 2,5 points). Le niveau élevé du taux d’épargne s’explique notamment par deux facteurs. D’une part, les plus riches ont vu leurs revenus fortement augmenter avec l’envolée des revenus du patrimoine, et notamment des dividendes, tandis que les revenus des plus pauvres diminuaient : or, les revenus supplémentaires des plus riches vont davantage vers l’épargne que vers la consommation. D’autre part, les consommateurs sont (légitimement) pessimistes quant à l’évolution de la situation.
Investissement : une baisse importante de l’investissement des entreprises qui risque d’entretenir la baisse de la productivité du travail et la stagnation économique
Les entreprises devraient connaître au moins cinq trimestres consécutifs de baisse de leur investissement[15]. Entre le 3e trimestre 2023 et le 4e trimestre 2024, l’investissement diminuerait de plus de 3 %, et même de 8 % en ce qui concerne les produits manufacturés. Même l’investissement en logiciels informatiques, jusqu’ici plus dynamique, ralentirait fortement fin 2024. Selon l’OFCE, l’investissement continuerait de baisser début 2025 avant de stagner à la fin de l’année. Les ressorts d’un rebond de la croissance sont donc absents.
La baisse de l’investissement devrait entretenir le ralentissement des gains de productivité. La productivité du travail est aujourd’hui inférieure à ce qu’elle était en 2017[16] ! Alors que les gains de productivité sont ordinairement plus forts dans l’industrie, la baisse y est aujourd’hui plus forte encore. On peut discerner deux grandes explications à cette baisse :
1. La faiblesse de l’investissement, notamment dans les nouvelles technologies de l’information et de la communication (en comparaison avec les États-Unis).
2. L’essor des emplois à faible productivité[17], comme les contrats en alternance et les micro-entrepreneurs (dont le revenu moyen est de 800 € pour ceux qui ne sont pas salariés en complément). Or, ceux-ci constituent environ la moitié des créations d’emplois depuis 2019.
C’est une proportion énorme qui met à nu l’arnaque derrière le discours sur le retour à un quasi plein-emploi. Le taux de chômage officiel, qui est par ailleurs reparti à la hausse (il devrait atteindre 7,5 % fin 2024, puis 8 % fin 2025 selon l’OFCE), masque un sous-emploi massif.
Figure 1 : Évolution de la productivité horaire du travail
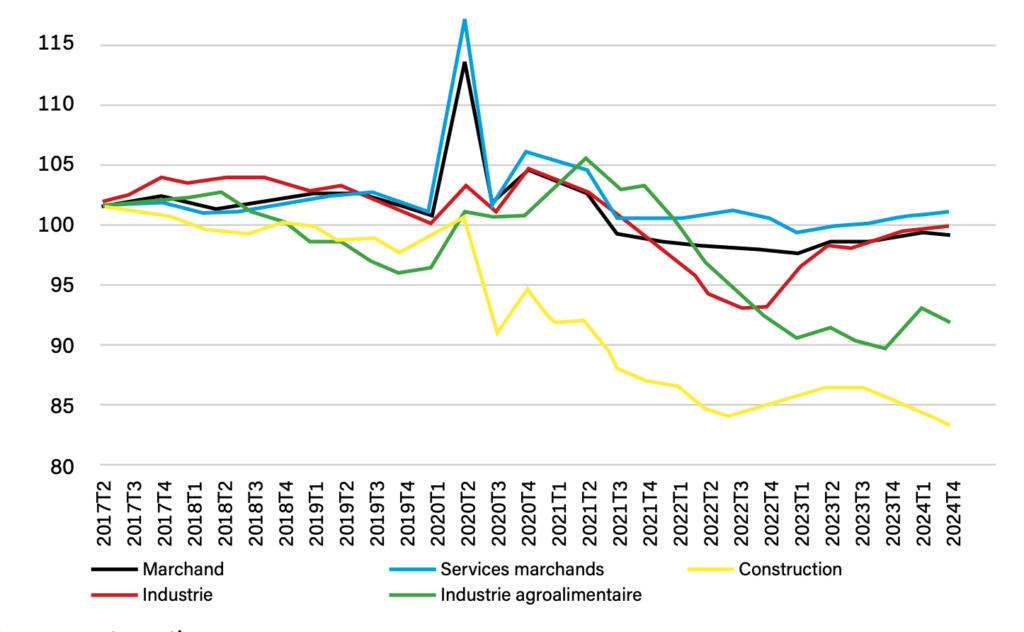
Salaires : une baisse marquée en 2022 et 2023 qui ne sera pas rattrapée de sitôt
L’Insee a rendu son verdict sur l’évolution du salaire net moyen dans le secteur privé en 2023[18] : celui-ci diminue de 0,8 %, après une baisse de 1 % en 2022 quand on tient compte de l’inflation telle que mesurée par l’indice des prix à la consommation (IPC). Si on prend en compte l’indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH)[19], plus approprié pour évaluer l’inflation réelle, la baisse du salaire est même presque deux fois plus forte : – 1,7 % en 2023 et – 1,6 % en 2022.
Le salaire net moyen a donc baissé de plus de 3 % en deux ans, quand, dans le même temps, les revenus réels du patrimoine, qui bénéficient très majoritairement aux plus riches, ont augmenté de près de 20 %. En 2024 et 2025, les salaires réels augmenteraient au mieux de 0,5 %, ce qui serait loin de compenser les pertes des années précédentes.
Selon l’OFCE, les destructions d’emplois ont commencé fin 2024. Elles devraient se poursuivre tout au long de l’année 2025. L’emploi total reculerait de plus de 200 000 postes entre le 3e trimestre 2024 et le 4e trimestre 2025. Seuls les emplois à faible productivité de micro-entrepreneurs continueraient à augmenter.
La nette dégradation du marché du travail devrait peser à la baisse sur les salaires. Récemment, les prévisions de hausse de salaires ont été révisées à la baisse. Aujourd’hui, on constate que les salaires nominaux refluent presque aussi vite que les prix.
La hausse annoncée des salaires réels en 2025 semble donc incertaine, et de toute façon insuffisante pour permettre une hausse du pouvoir d’achat moyen des ménages. Les coupes dans les prestations sociales planifiées par le gouvernement Barnier vont en effet plomber le pouvoir d’achat des ménages, qui baisserait de 0,2 % en 2025 selon l’OFCE.
Profits : un capitalisme sous perfusion d’aides publiques
Le patronat n’a de cesse de stigmatiser le poids des impôts et des dépenses publiques. Pourtant, depuis le début de la période dite « néolibérale », c’est-à-dire le début des années 1980, les politiques budgétaires se sont mises au service du capital. Cette période est celle des baisses d’impôts sur les entreprises et des hausses de leurs subventions. Ces politiques ont eu un impact massif sur la dette publique pour maintenir la rentabilité d’entreprises qui, sans elles, serait au plus bas.
Aux États-Unis, le taux de profit net (avant et après impôts) des sociétés non financières[20] a fortement chuté de la fin des années 1960 à la fin des années 1970[21]. Depuis cette période, le taux de profit net avant impôts est resté tendanciellement à un niveau bas, avec bien sûr des variations cycliques[22]. En revanche, le taux de profit net après impôts s’est fortement redressé, notamment après la crise de 2008, pour atteindre à nouveau les sommets atteints pendant les « Trente Glorieuses ».
Cette divergence entre taux de profit avant impôts et taux de profit après impôts montre que le redressement des taux de profit n’est pas dû à un redressement productif des entreprises, mais bien aux politiques de baisses d’impôts (et de hausses des subventions) des États envers les entreprises. C’est le signe d’un capitalisme au ralenti et sous perfusion.
Figure 2 : Évolution du taux de profit des sociétés non financières aux États-Unis
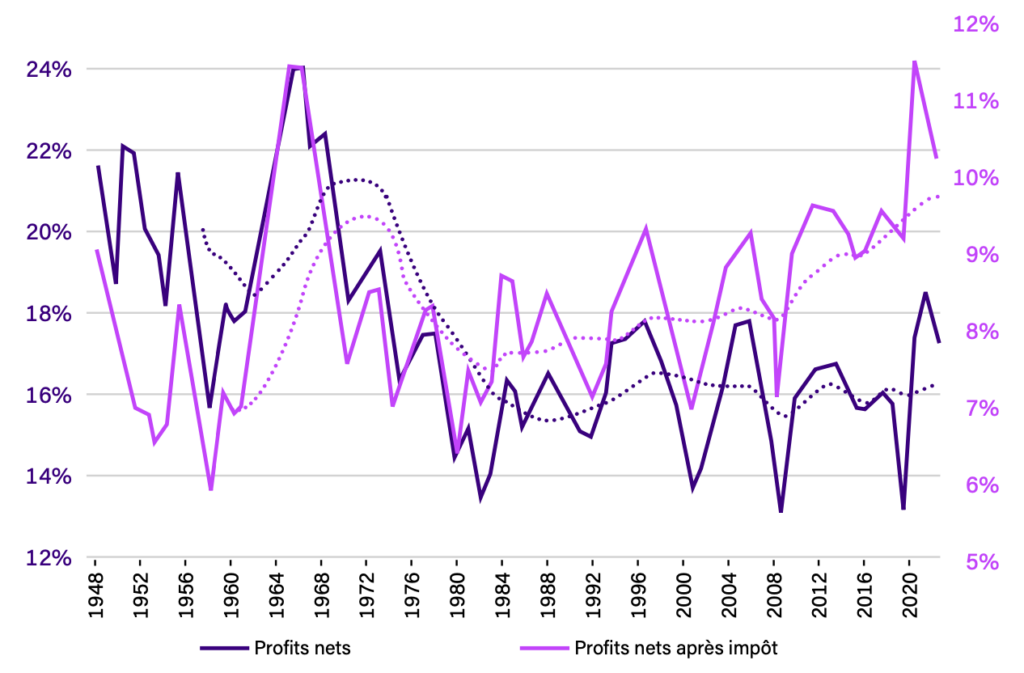
En France aussi, la part du profit « avant redistribution » dans la valeur ajoutée des sociétés non financières (SNF) décline depuis la crise de 2008[23]. Mais la politique budgétaire volontariste en faveur du capital conduit à l’inverse à une augmentation de la part du profit « après redistribution » ! Depuis 2012 (notamment grâce au CICE de François Hollande[24]), celle-ci augmente. Ce sont donc bien les politiques publiques qui permettent aux entreprises de sauver leurs marges, malgré la baisse de leur productivité.
Figure 3 : Évolution de la part représentée par le profit (avant et après redistribution) dans la valeur ajoutée des sociétés non financières
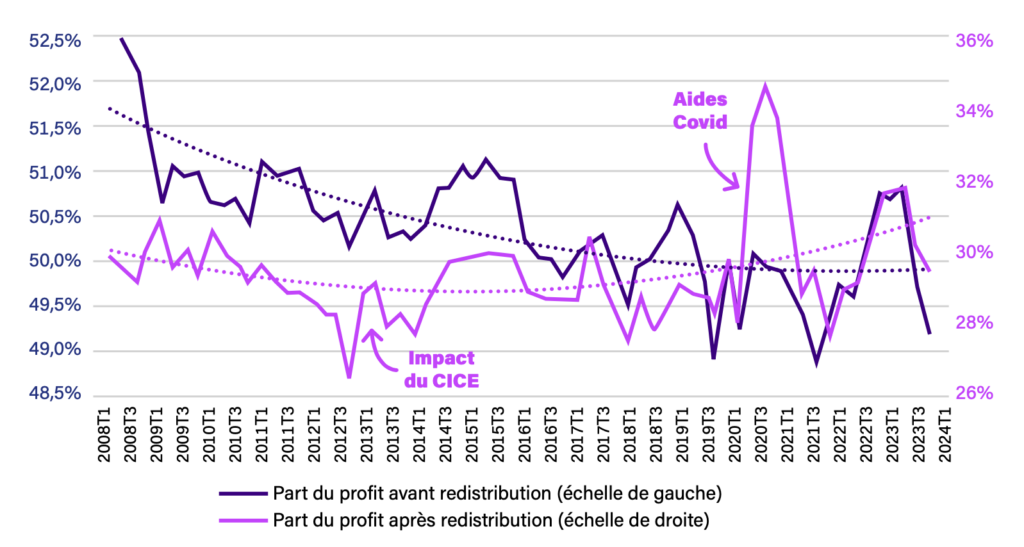
Dette publique : l’instrumentalisation du déficit public pour couper dans les dépenses sociales
Le déficit public actuel a été créé par les baisses d’impôts en faveur des plus riches et des grandes entreprises. Ces mesures, supposées stimuler l’activité économique, ont en réalité eu pour unique résultat d’enrichir une poignée de fortunés et de priver l’État de recettes précieuses.
Les mêmes qui en ont bénéficié exigent aujourd’hui que le déficit soit au plus vite réduit en imposant une baisse drastique des dépenses pour la protection sociale et les services publics.
Pour cela, un discours catastrophiste martèle que les niveaux du déficit et de la dette publics seraient devenus « insoutenables ». Or, en réalité, si la charge d’intérêt sur la dette publique a certes augmenté en 2022 (en pourcentage du PIB), elle est deux fois moins élevée qu’elle ne l’était au milieu des années 1990.
Figure 4 : Évolution des charges d’intérêts de la dette publique, en pourcentage du PIB et en pourcentage des dépenses publiques
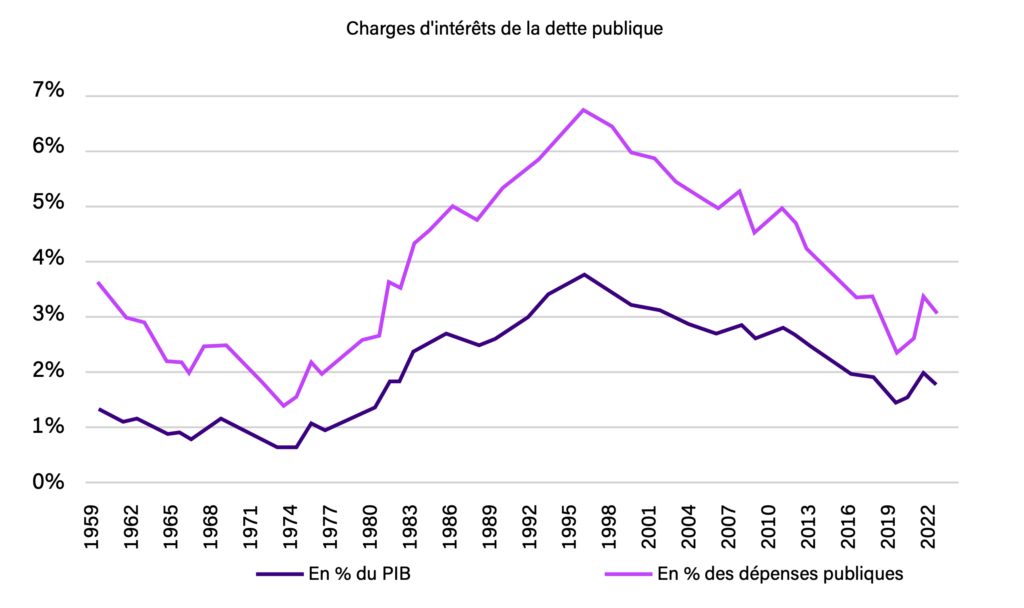
On nous explique qu’une politique d’austérité doit être mise en place pour « rassurer » les marchés, sans quoi nous serions « punis » par une hausse des taux d’intérêt sur la dette publique qui rendrait la charge d’intérêts insoutenable. Il n’y a aucune raison d’accepter cette logique : avant le tournant néolibéral, le déficit public était financé par les avances directes de la banque centrale[25] ou par le « circuit du Trésor »[26]. Ce financement « administré » de la dette publique permettait d’avoir une maîtrise du taux d’intérêt sur la dette publique.
FOCUS – Le budget 2025 sera-t-il mortel pour l’économie française ?
Le 14 octobre, avec beaucoup de retard par rapport au calendrier parlementaire traditionnel, le gouvernement Barnier a présenté le projet de loi de finances (PLF) et le projet de loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS) pour l’année 2025.
Selon le gouvernement, ce budget constitue une cure d’austérité de 60 milliards d’euros, même si le Haut Conseil des Finances Publiques (HCFP) suggère que l’ajustement budgétaire serait en réalité plutôt de 42 milliards d’euros (soit 1,4 point de PIB)[27].
Entre aveuglement idéologique et crainte sincère concernant la montée de l’écart entre le taux d’intérêt exigé pour les titres de la dette publique française et les titres allemands[28], le gouvernement souhaite envoyer des signaux à ses électeurs et aux marchés financiers concernant la crédibilité de son engagement austéritaire.
Or, on peut penser qu’un PLF bâclé, associé à une communication peu transparente[29], ne permettra de toute façon pas d’améliorer la crédibilité des comptes publics, mise à mal par la politique pratiquée depuis sept ans.
Le déficit actuel est la conséquence de la politique économique menée depuis 2017
Le manque de crédibilité des comptes publics français ne tombe pas du ciel. Il fait suite à sept années de gouvernements nommés par Emmanuel Macron. Durant cette période, les politiques publiques mises en place par les gouvernements Philippe, Castex, Borne et Attal ont creusé les soldes publics de façon permanente de 40 milliards d’euros[30], essentiellement du fait de baisses d’impôts non financées.
Les défenseurs du bilan de ces gouvernements mettent souvent en avant les dépenses et baisses de recettes dues à la crise du Covid-19 pour rendre compte de l’augmentation de la dette publique. Pourtant, près de la moitié de la dette supplémentaire peut être expliquée par leur mauvaise gestion budgétaire, à savoir des baisses d’impôts non financées. Le 26 mars 2024, déjà, l’Insee remarquait que son aggravation avait avant tout pour origine la baisse de recettes, puisque le poids de celles-ci dans le PIB avait diminué de 2,1 points en 2022-2023[31].
Après avoir « affamé la bête » en se coupant volontairement de recettes, la puissance publique se trouve exsangue. C’est d’autant plus grave au moment où il est nécessaire de se donner les moyens d’action pour faire la bifurcation écologique et répondre enfin aux besoins suscités par le vieillissement de la population (santé, dépendance), sans parler de la reconstruction des services publics.
Au-delà même des sept dernières années, depuis 2000 la dépense publique en subventions et transferts en capital aux entreprises a augmenté cinq fois plus vite que celle consacrée aux services publics. Alors que ces vingt-cinq dernières années ont vu une augmentation des besoins en services de la population du fait des conséquences du « baby boom » des années 2000 et du vieillissement de la population, la part des services publics dans la dépense publique a baissé de 5 à 6 points[32].
Des mesures fiscales qui vont peser sur la consommation populaire
Dans ce contexte, une hausse des prélèvements obligatoires peut sembler justifiée. Elle serait de 30 milliards d’euros selon le HCFP. Mais il faut faire la différence entre des mesures fiscales qui viseraient ceux qui ont profité le plus des baisses d’impôts depuis 2017, à savoir les ménages les plus aisés et les entreprises, et des mesures touchant l’ensemble des contribuables, qui constitueraient un danger pour le pouvoir d’achat des ménages populaires et de la classe moyenne, et donc pour la consommation et la croissance.
Parmi les nouvelles mesures incluses dans le projet de loi de finances, le gouvernement espère collecter 8 milliards d’euros grâce à la surtaxe sur l’impôt sur les sociétés des grands groupes ; 4 milliards avec la baisse des exonérations de cotisations sociales employeurs ; 2 milliards avec le taux plancher de 20 % pour les très hauts revenus ; mais aussi 7 milliards avec la hausse des taxes sur la consommation d’électricité (dont 4 milliards grâce au retour de la taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité (TICFE)[33] à son niveau pré-crise énergétique).
Si certaines mesures dans cette liste constituent clairement un aveu d’échec de la stratégie fiscale mise en place depuis 2017, il faut relativiser leur portée. D’abord, la surtaxe sur l’impôt sur les sociétés des grands groupes et le taux plancher de 20 % pour les très hauts revenus sont annoncés comme exceptionnels et temporaires. À l’inverse, les baisses d’impôt sur les grands patrimoines mises en œuvre depuis 2017, notamment la transformation de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) en impôt sur la fortune immobilière (IFI)[34] ou la mise en place du prélèvement forfaitaire unique (PFU)[35] ne sont quant à elles pas remises en cause. Par ailleurs, concernant l’augmentation de l’impôt sur les sociétés des grands groupes, on peut être sceptique quant à la réalité des montants de recettes prévus dans le projet de loi de finances : la mesure apparaît très à contretemps, car, s’ils ne sont pas totalement dissipés, les superprofits ne sont plus au niveau historique de la période 2021-2022.
En revanche, la hausse des taxes sur l’électricité va peser sur le pouvoir d’achat des ménages en augmentant le prix d’une dépense de première nécessité, contrainte. Entre décembre 2019 et septembre 2024, le prix de l’électricité a bondi de 49 %, alors que l’inflation totale était de 13 %. Même si la baisse de 9 % du prix total annoncée par le gouvernement se matérialisait, la hausse du prix de l’électricité depuis le pré-Covid resterait de 35 % après la hausse des taxes. Ainsi, la hausse de taxes prévue par le gouvernement entérine et prolonge les prix anormalement élevés de l’énergie, ce qui aura un effet durable sur la consommation des ménages et sur les capacités d’investissement des entreprises.
Des coupes dans les services publics, les budgets sociaux et la transition écologique
À côté des mesures fiscales décrites ci-dessus, le gouvernement propose des coupes dans la dépense publique pour un montant de 12 milliards d’euros selon le HCFP, et jusqu’à 40 milliards d’euros selon Bercy (l’écart entre les deux chiffres suggère une présentation mensongère du budget par le ministère de l’Économie et des Finances)[36].
Parmi les principales mesures de réduction de dépenses, la restriction des dispositifs de subvention de l’apprentissage, les coupes dans les soins de ville remboursés par la Sécurité sociale, la hausse du nombre de jours de carence pour les fonctionnaires et la baisse de la prise en charge des arrêts maladie, ainsi que le report de six mois de l’indexation des pensions de retraite impliquant une baisse des pensions sur 6 mois. Le budget Barnier opère aussi des suppressions de postes dans l’Éducation nationale, des coupes budgétaires dans les dispositifs de soutien à la transition écologique (notamment en ce qui concerne la rénovation thermique des logements ou les primes pour l’acquisition de véhicules électriques), dans les crédits spécifiques pour les Outre-mer ou encore dans les achats des hôpitaux publics.
La diminution des aides à l’apprentissage est un aveu d’échec de la politique en matière d’emploi menée depuis 2017. La politique de soutien à l’apprentissage était en effet devenue, selon tous les rapports d’évaluation[37], un puits sans fond. Mal conçue, mal ciblée, elle servait de plus en plus à financer tous les acteurs de la chaîne, sauf les jeunes plus en difficulté[38]. Pour donner une idée, le nombre de jeunes hors formation et emploi est aujourd’hui plus élevé qu’au début des années 2000, malgré le million de postes d’apprentis créés.
Un ajustement budgétaire historique : la France sur le chemin de l’Italie ?
L’ampleur de la consolidation budgétaire[39] est excessive même par rapport aux nouvelles règles européennes[40]. La France est en effet placée, depuis le 26 juillet 2024, sous une nouvelle procédure de déficit excessif[41] en raison de l’incurie des derniers gouvernements. La consolidation, évaluée à 1,4 point de PIB[42], dépasse largement les exigences du pacte de stabilité et de croissance. Celui-ci n’aurait nécessité qu’un ajustement de 0,6 point de PIB cette année, pour lequel les seules mesures fiscales proposées auraient suffi. L’ajustement exigé par les règles européennes était donc déjà assuré par les mesures fiscales prévues par le gouvernement pour l’année 2025. En réalité, quelques mesures fiscales ciblées sur les ménages les plus riches et les grands groupes auraient à elles seules suffi. Le gouvernement se veut donc « plus royaliste que le roi ».
Ceci est d’autant plus problématique que fournir un effort majeur en début de procédure de déficit excessif ne relâche en rien les exigences pour le futur. En effet, vu le niveau de sa dette publique, la France devrait théoriquement maintenir des efforts importants pendant de longues années après la réduction de son déficit, d’après la nouvelle version du pacte de stabilité et de croissance adoptée en 2024. Le gouvernement, qui a pris des mesures opportunistes, notamment en ce qui concerne une partie de la hausse de la taxation de l’énergie au moment où les prix reculent, ne sera donc pas forcément gagnant à se montrer excessivement dur.
L’ampleur de l’austérité atteint des niveaux historiques. Si l’on mesure l’orientation de la politique budgétaire à travers la variation du solde structurel primaire[43], alors une consolidation de 1,4 point de PIB n’avait été observée en France que pendant la moitié des années 1990 (la consolidation pendant la période 1992-1996 était très forte) ou en sortie du pic du « quoi qu’il en coûte » en 2022 (voir figure 5).
Figure 5 : Variation du solde structurel primaire, en points de PIB potentiel
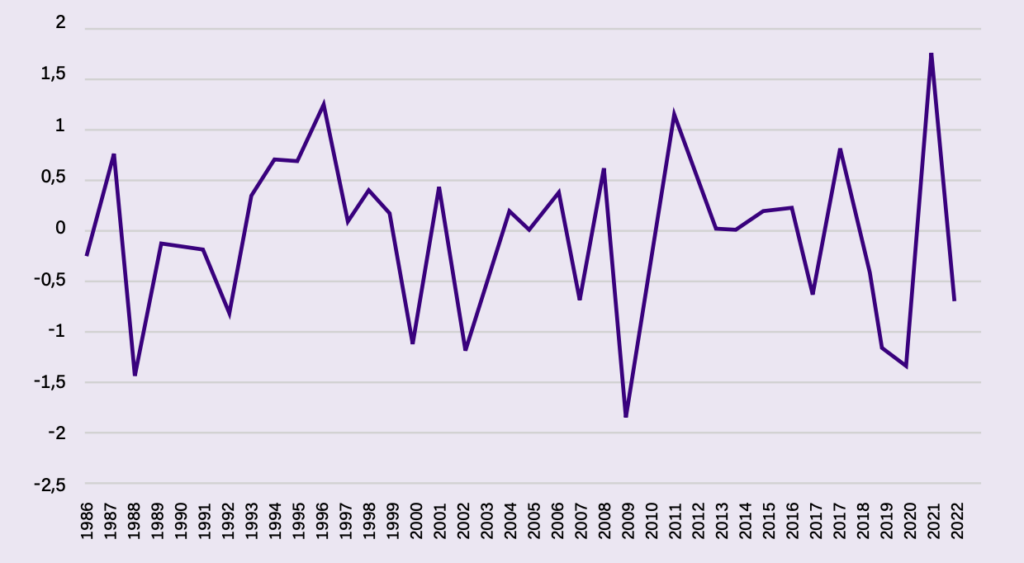
Si l’on compare l’ampleur de la consolidation proposée pour la France en 2025 par rapport à celle qui a eu lieu dans les pays du Sud pendant la crise de la zone euro, on peut constater qu’elle est supérieure à celle mise en place par l’Italie pendant la période 2010-2012[44].
Au cours de cette période, selon l’OCDE, l’Italie aurait fait une « consolidation budgétaire » annuelle de 1,1 point de PIB. Cela a conduit à une décennie entière de stagnation économique : 2012, 2013 et 2014 ont été des années de récession en Italie, et il aura fallu attendre 2024 pour que le PIB italien retrouve son niveau d’avant la crise de 2008. Le taux de chômage, lui, est monté jusqu’à atteindre 13 % de la population active en 2014 et n’a actuellement toujours pas retrouvé son niveau antérieur à la crise de 2008. Quant à la dette publique italienne, alors qu’elle s’élevait à 114 % du PIB en 2010, elle est aujourd’hui passée à 139 % du PIB.
L’Espagne, autre pays du Sud de la zone euro fortement affecté par la crise, a connu un ajustement supérieur (1,9 point de PIB par an pendant la crise de la zone euro). La Grèce, soumise à une politique particulièrement brutale, se distingue de tous ces pays (4,9 points par an), avec les conséquences dramatiques que l’on connaît. La baisse de 30 % des dépenses publiques y a provoqué une explosion du chômage, qui a atteint jusqu’à 28 %, avec la destruction d’un emploi sur cinq. Un tiers de la population grecque est tombé sous le seuil de pauvreté, notamment les retraités. Livrées à elles-mêmes, 1 million de personnes ont fui le pays, essentiellement les jeunes. Et pourtant, la dette n’a jamais cessé d’augmenter, sous l’effet de la diminution drastique de la consommation populaire et de la perte de recettes pour l’État[45].
Certes, la comparaison a ses limites, puisque les pays du Sud de la zone euro ont tardé à bénéficier de l’action modératrice de la Banque centrale européenne (BCE) sur leurs taux d’intérêt et ont connu une pression des marchés financiers et de la troïka[46] sans commune mesure avec ce que connaît la France actuellement.
Mais il reste une réalité : le gouvernement Barnier envisage un ajustement dont l’ordre de grandeur correspond aux plans imposés à l’Europe du Sud au début des années 2010. Et cela alors même que la situation financière française ne s’approche pas du tout de celle de ces États à cette période (niveau du taux sur sa dette souveraine bien plus faible, écart modéré entre les taux français et allemand).
Un grave coup porté à la croissance française
Selon les évaluations de l’OFCE, l’application du budget 2025 devrait amputer la croissance du PIB français de 0,8 point.
Les seules mesures qui ne contribuent pas à l’effet récessif de l’ajustement sont les mesures fiscales en direction des grands groupes et des ménages les plus aisés. En excluant la fin des mesures d’urgence passées, le multiplicateur serait à 0,7, selon l’OFCE[47]. Cela signifie qu’en moyenne, chaque euro de la consolidation budgétaire engagée par le budget 2025 réduirait l’activité de 70 centimes. Cela le situe à la limite du niveau auquel la consolidation budgétaire devient contre-productive du point de vue de ses propres objectifs car les pertes de recettes liées à l’effet récessif des mesures dépassent les économies réalisées par ailleurs[48]. Le plan d’austérité pourrait donc conduire à une aggravation du déficit et de l’endettement public.
Ainsi, pour le moment rien n’est gagné ni du point de vue de l’activité ou de l’emploi ni même du côté du rétablissement des comptes publics. Avec le retour de l’inflation à la cible de la BCE, il n’y aura pas de bouffée d’air du côté de la politique monétaire, c’est-à-dire pas de nouvelles baisses significatives des taux d’intérêt.
Conclusion
Les principaux voyants économiques tournent au rouge. La politique de soutien inconditionnel au capital n’a pas eu pour effet de redresser l’investissement des entreprises qui est en berne. Elle a simplement permis aux grandes entreprises de garder leurs marges intactes, malgré la baisse de la productivité.
Les résultats négatifs de cette stratégie de redressement des profits sous perfusion publique apparaissent désormais clairement : dégradation des comptes publics, sous-financement massif des services publics, baisse des salaires réels et une économie engluée dans une profonde dépression.
Le choix par le gouvernement d’un plan d’austérité d’une ampleur inédite risque d’aggraver très sérieusement ces tendances négatives, notamment en ce qui concerne la consommation des ménages et l’investissement des entreprises. Le projet de loi de finances prévoit en effet une cure d’austérité estimée à 1,4 point de PIB : davantage que l’Italie en 2010. Pourtant, les conséquences de tels plans sont bien connues, s’étant vérifiées partout, et notamment dans les États d’Europe du Sud dans les années 2010 : récession économique, hausse du chômage, et, faute de recettes, creusement du déficit public.
Politique de l’offre et austérité apparaissent ainsi clairement comme les deux faces d’une même pièce : celle d’un logiciel néolibéral qui a besoin, pour maintenir les profits, d’attaquer en profondeur les services publics en plus de la classe travailleuse.
C’est la double peine pour les catégories populaires : déjà durablement affectées par la baisse de leurs salaires réels du fait d’une inflation dopée par les profits, elles seront aussi les premières victimes des coupes budgétaires dans les services publics.
Pour en savoir plus, retrouvez les détails de la méthodologie de cette note :
Télécharger l’annexe méthodologique
- GÉNÉRALISTES
- Ballast
- Fakir
- Interstices
- Lava
- La revue des médias
- Le Grand Continent
- Le Diplo
- Le Nouvel Obs
- Lundi Matin
- Mouais
- Multitudes
- Politis
- Regards
- Smolny
- Socialter
- The Conversation
- UPMagazine
- Usbek & Rica
- Le Zéphyr
- Idées ‧ Politique ‧ A à F
- Accattone
- Contretemps
- A Contretemps
- Alter-éditions
- CQFD
- Comptoir (Le)
- Déferlante (La)
- Esprit
- Frustration
- Idées ‧ Politique ‧ i à z
- L'Intimiste
- Jef Klak
- Lignes de Crêtes
- NonFiction
- Nouveaux Cahiers du Socialisme
- Période
- Philo Mag
- Terrestres
- Vie des Idées
- ARTS
- Villa Albertine
- THINK-TANKS
- Fondation Copernic
- Institut La Boétie
- Institut Rousseau
- TECH
- Dans les algorithmes
- Framablog
- Goodtech.info
- Quadrature du Net
- INTERNATIONAL
- Alencontre
- Alterinfos
- CETRI
- ESSF
- Inprecor
- Journal des Alternatives
- Guitinews
- MULTILINGUES
- Kedistan
- Quatrième Internationale
- Viewpoint Magazine
- +972 mag
- PODCASTS
- Arrêt sur Images
- Le Diplo
- LSD
- Thinkerview
- Fiabilité 3/5
- Slate
- Ulyces
- Fiabilité 1/5
- Contre-Attaque
- Issues
- Korii
- Positivr
- Regain
