03.12.2025 à 12:16
Mettre du pain sur la table : au Moyen Âge, un enjeu politique
Texte intégral (2196 mots)

Si sa consommation baisse en France, le pain reste un aliment de base et son approvisionnement, les évolutions de son prix font l’objet d’une grande attention politique. Cette place centrale trouve sa source dans l’histoire. Pour bien la comprendre, il est important de revenir sur son rôle dans les sociétés du Moyen Âge.
« Est-ce la fin de la baguette ? » Le constat du média CNN, reposant sur une enquête récente de la Fédération des entreprises de boulangerie française, est sans appel : la consommation de pain a baissé dans l’Hexagone de plus de 50 % depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale.
Pourtant, son approvisionnement continue de faire l’objet d’une attention constante de la part des États, notamment dans un contexte d’accroissement des conflits armés et de crises sanitaires. Pour mieux comprendre la valeur sociale, politique et symbolique de cet aliment dans nos sociétés contemporaines, il est nécessaire d’interroger son rôle au fil des époques, en revenant notamment sur le sens de cet aliment au Moyen Âge.
Si le pain est considéré par la recherche contemporaine comme un ingrédient majeur de la survie de l’humanité, c’est parce que son usage simultané dans plusieurs sociétés, par ailleurs éloignées sur les plans géographique et culturel, constitue une forme essentielle de diversification alimentaire (au-delà des protéines et des végétaux). Les débuts du pain évoluent au gré des découvertes archéologiques, mais les premières galettes de riz, bulbe de jonc, maïs ou encore blé sont identifiées dès la fin du Paléolithique. Ce rôle central se perpétue au fil des siècles, dans l’Antiquité et jusqu’au Moyen Âge.
En Europe, le XIVe siècle marque progressivement l’instauration de sociétés de cour à la relative pérennité dont le schéma féodal, séparant le peuple, le clergé et la noblesse, s’organise autour du pain. Faisant parfois curieusement écho à l’organisation politique de notre monde actuel, la société médiévale se divise ainsi entre ceux qui reçoivent, ceux qui produisent, ceux qui donnent, dans un jeu de distinctions et de pouvoirs qui n’exclut ni la nuance ni l’ambiguïté.
Le pain et la couronne : un fragile équilibre
Les têtes couronnées de la fin du Moyen Âge le savent à leurs dépens, le pain est l’ingrédient premier d’une société apaisée. La célèbre maxime romaine « Panem et circences » (« Du pain et des Jeux ») synthétise à elle seule le contrat tacite qui lie le dirigeant à ses administrés. Le premier protège, le second travaille.
La paix sociale s’achète ainsi par un approvisionnement régulier et suffisant en pain. Ce dernier représente de très loin l’aliment le plus consommé par tous et, par conséquent, la part la plus importante du budget alimentaire des familles. C’est pourquoi, le roi cherche dès le XIIIe siècle à contrôler l’influente corporation des talemeliers (ancien nom des boulangers) par un encadrement de ses statuts qui régule également les conditions d’exercices et de production du pain.
L’équation est complexe et l’équilibre délicat pour parvenir à une denrée à la composition fiable, au poids raisonnable et au prix juste. La police du pain mise en place par Charles V en 1372 applique des taxes fluctuantes sur les matières premières, le produit fini, les ventes et se montre sans pitié sur les fraudes.
La profession est assujettie à des taxes d’installation, à des contrôles réguliers et à un encadrement permanent de la valeur marchande du pain. Par décret, seuls trois types de pains peuvent être fabriqués : le pain mollet (à la fine fleur de froment), le pain cléret (composé de farines de blé et de seigle) ou bourgeois, et le pain brun ou de « retraites » (uniquement constitué de farine complète, dense et roborative).

Néanmoins, ces restrictions sont rapidement contournées par les boulangers qui répondent à la demande de l’aristocratie pour un pain socialement différencié, qui lui permet, notamment de se distinguer de la bourgeoisie des villes, elle-même avide des mêmes privilèges que la noblesse.
C’est ainsi que des pains de fantaisie apparaissent, vendus en marge des recettes autorisées. Ces derniers s’appuient sur l’échelle de valeurs chromatiques qui régit alors l’appréciation de cet aliment en établissant une hiérarchie des consommateurs.
Les pauvres doivent ainsi se satisfaire d’un pain noir de son ou de sarrasin, à la mie épaisse et à la croûte dure, quand les plus riches se régalent de pains de Gonesse, fabriqués à partir d’une fine fleur de froment, au blutage serré. Littérature, iconographie et chansons participent à la promotion de ce système pyramidal qui valorise le gosier délicat d’un nanti par rapport aux rudes besoins des paysans.
« Charité bien ordonnée… » : collecter et distribuer le pain
Rappelons d’abord que les relations entre l’Église et le pain sont nombreuses, ne serait-ce que parce que la symbolique chrétienne s’appuie en grande partie sur la métaphore du pain comme signe de vie et d’espoir. La mise en place du sacrement de l’Eucharistie, au XIIIe siècle, confirme cette importance.
L’institution ecclésiastique incarne une forme de passerelle entre la couronne et le reste de la population à travers, par exemple, l’exercice de la charité. Les distributions de pains font en effet partie intégrante du quotidien des monastères. Ceux-ci centralisent les dons des nobles et des riches communautés marchandes qui assurent ainsi leurs saluts par leur générosité.
Les communautés religieuses entreposent ces dons alimentaires puis organisent les collectes en effectuant un tri dans les bénéficiaires. Les femmes, les enfants et les malades sont prioritaires au détriment de tous ceux qui ne contribuent pas à la vie économique et spirituelle de la communauté.
Cette charité du pain rythme ainsi les calendriers juif et chrétiens et constitue un ensemble de rituels importants qui participe à la relation de dépendance entre pauvres et riches, entre survie, devoir moral et achat d’une probité.
Le pain des pauvres
L’iconographie médiévale, de la tapisserie aux enluminures, offre un aperçu informé de la place de chacun au cœur du système féodal. Les populations rurales constituent la cheville ouvrière du pain à travers semences et moissons. Le travail des champs se conçoit autour de la vie de la cité, cette dernière garantissant le stockage et la protection du grain dans des granges dîmières, propriétés de la commune, gardées par des soldats qui contrôlent chaque sac entrant et sortant. Ces espaces sont de véritables ruches où se croisent paysans, commerçants, édiles et militaires.
Cette relation d’interdépendance encourage les villes, comme la cité-État de Sienne, en Italie du Nord, à promouvoir un chemin vertueux et sécurisé du pain. Celui-ci devient rapidement une métaphore plus générale d’une philosophie politique plaçant l’individu au cœur d’un système de réciprocité et d’équilibre collectif.
Mais le pain des pauvres, c’est aussi, en écho aux conflits actuels, celui de la révolte et du soulèvement. Les atroces récits des famines qui jalonnent la seconde partie du Moyen Âge (1030-1033, puis 1270, 1314-1318 et périodiquement jusqu’en 1347) marquent les esprits et fournissent un terreau propice à l’effroi collectif et à la contestation.
À lire aussi : Le pain, une longue histoire d’innovations techniques et sociales
Le blé ne manque pourtant pas toujours sur le territoire français ou dans les pays voisins. Mais son acheminement, depuis des territoires parfois éloignés, et sa distribution font l’objet de spéculations financières qui influencent le cours du grain et vont jusqu’à faire tripler le prix du pain.
Les meneurs des révoltes sont rarement les bénéficiaires de la charité ecclésiastique. Sans être nantis, ces paysans relativement aisés sont les premiers touchés par l’instabilité monétaire générée par la flambée du prix du blé et les levées d’impôts qui en découlent.
Les cibles de ces révoltes sont plurielles, à l’instar de tout mouvement contestataire : les « riches » qui se nourrissent au-delà de la satiété, les collecteurs de taxes, les usuriers et plus largement ceux qui incarnent une opulence indécente en des temps d’incertitudes chroniques.
L’Ancien Régime hérite et perpétue la plupart de ces représentations et de ces fonctionnements politiques. La couronne de France multiplie contrôles et régulations sur la profession, mais les famines qui jalonnent les XVIIe et XVIIIe siècles alimentent révoltes, suspicions et colères.
Prélude à la Révolution, la « guerre des farines » de 1775 synthétise trois siècles de cheminements politiques, sociaux et intellectuels autour de la question décidément centrale du pain pour tous.
Coline Arnaud a reçu des financements de la Bibliothèque nationale de France dans le cadre d'une bourse de recherche de "chercheuse invitée" en 2017.
03.12.2025 à 11:31
Paris au XIXᵉ siècle, ville des exilés et des révolutionnaires
Texte intégral (2214 mots)

Paris n’a pas seulement accueilli les artistes et les rêveurs du XIXᵉ siècle : la ville fut aussi la base arrière des bannis, des insurgés et des souverains déchus venus d’Europe et d’Asie. Dans ses cafés, ses imprimeries et ses hôtels, se tissaient des alliances improbables, parfois décisives. Comment la capitale française est-elle devenue un refuge où se réinventaient les luttes et les imaginaires politiques du siècle ?
Au XIXᵉ siècle, Paris est la terre d’asile : la ville offre aux exilés – malgré la barrière de la langue, leur isolement, leur anonymat et leurs différences culturelles – un espace où peuvent se former de grands mouvements politiques, faisant circuler des idées nouvelles et permettant de faire naître des courants de pensée.
Cette idée de Paris comme foyer révolutionnaire s’installe dès 1830 et les « Trois Glorieuses », ces trois journées de révolte qui renversent Charles X. La presse s’émancipe et les clubs secrets politiques fleurissent dans les décennies qui suivent. Paris devient un exemple et, ailleurs en Europe, l’élan révolutionnaire trouve un écho. Mais, quand l’élan se heurte – souvent – à l’échec ou à la répression, Paris accueille les premiers exilés. La tradition d’asile s’ancre dans la ville.
En 1848, le printemps des peuples porte l’élan à son paroxysme, le droit d’asile est réaffirmé par la Deuxième République. C’est à ce moment-là qu’Alphonse de Lamartine, ministre des affaires étrangères, et le gouvernement provisoire, seulement quelques jours après avoir fait tomber la monarchie de Juillet, envoient le Manifeste à l’Europe, déclarant une doctrine de non-agression, de fraternité, mais aussi d’accueil des persécutés. La tradition d’asile, héritage de la Constitution de 1793, est réaffirmée dans l’esprit de la souveraineté révolutionnaire et populaire. Il deviendra l’un des fondements des idées progressistes et libérales que la seconde République entend faire siennes.
La capitale des bannis : quand l’Europe converge vers Paris
Paris ouvre ses portes à celles et ceux qui, de Vienne, Berlin, Milan à Budapest, sont pourchassés. Des journalistes, des étudiants, des avocats, des officiers, des républicains convergent vers la ville, qui devint la capitale de la liberté d’expression, du libéralisme, et du progrès politique.
De grandes figures de l’exil y passent : Karl Marx, installé rue Vaneau (VIIᵉ arrondissement) entre 1843 et 1845, y rédige sa critique du libéralisme allemand (Manuscrits de 1844). Lénine vit rue Marie-Rose (XIVᵉ) entre 1908 et 1912. Oscar Wilde, proscrit non pour délit politique mais pour mœurs, y trouve un dernier asile en 1897, preuve que Paris accueille aussi les amours « dissidents ».
Anti-impérialisme et réseaux clandestins : Irlandais et Indiens
À Paris, les Irlandais tissent des réseaux clandestins contre la Couronne, les Russes y fomentent des complots contre le tsar, les Polonais y attendent le retour de l’indépendance.
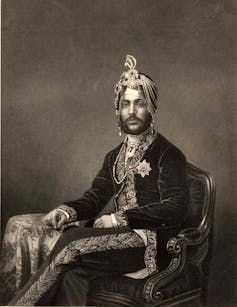
Dans l’adversité face à la couronne britannique se trouve un terrain fertile d’entente entre les Irlandais, déterminés à soustraire par la force leur patrie à la domination anglaise, et d’anciens rois déchus indiens, spoliés par la Compagnie des Indes orientales britanniques. Parmi eux : Suchet Singh (1841–1896), à la tête du petit royaume himalayen de Chamba réduit à l’impuissance, ou Duleep Singh (1838-1893), le dernier maharajah de la nation sikhe, dépossédé, puis exilé du Pendjab à vie.
Mes recherches m’ont amené sur les pas de Duleep Singh, qui rencontre les réseaux nationalistes irlandais chez Reynold’s, un bar irlando-américain situé rue Royale (VIIIᵉ), immortalisé dans un dessin d’Henri Toulouse-Lautrec. Parmi ce noyau de la révolte irlandaise à Paris se trouvent notamment les frères Joseph et Patrick Casey, mais aussi Patrick Egan, James Stephens et Eugene Davis. Ce dernier édite le journal United Ireland à Paris, interdit en Grande-Bretagne et mène une double vie : imprimeur le jour, il rejoint ses compagnons conspirateurs et militants la nuit tombée. En 1887, les nationalistes irlandais, en quête d’alliances contre Londres, facilitent les premiers contacts entre le maharajah déchu Duleep Singh et des intermédiaires dans ses démarches (vaines) pour tenter de reconquérir son trône.

Quelques années plus tard, le 22 octobre 1893, seul dans son appartement du VIIIe arrondissement de Paris, Duleep Singh s’éteint, après des années d’errance d’hôtel en hôtel. Au lendemain de sa mort, la presse française relaie la nouvelle : le « maharajah de Lahore » est mort à Paris, et toute la France s’intéresse à cet homme venu d’ailleurs.
Aujourd’hui, l’histoire de ces exilés est tombée dans l’oubli. Pourtant, tout espace est façonné par ses habitants, et tout lieu porte les traces de son histoire. Paris s’est transformé de ville d’accueil des expatriés et des immigrés en fabrique de libertés. Elle est devenue un espace de lutte des indépendances.
Et la colonisation française ?
Ville laboratoire de l’anticolonialisme mondial, la capitale française est pourtant – et d’abord – une capitale impériale. Elle accueillera des militants venus de ses propres colonies au début du XXe siècle. Les nationalistes indiens et les fenians irlandais seront suivis par des nationalistes algériens, des militants indochinois ou des écrivains antillais.
Des militants d’Afrique du Nord s’organiseront, sous Messali Hadj en 1926, jouant un rôle majeur dans la prise de conscience politique des travailleurs nord-africains installés en France. C’est ainsi que l’Étoile nord-africaine (ENA) revendique la fin du colonialisme français et la création d’un État algérien indépendant. Hô Chi Minh fonde à Paris une mouvance anticoloniale vietnamienne, en structurant un réseau révolutionnaire au début des années 1920. Il y crée le journal le Paria dès 1922, qui lui servira de tribune anticolonialiste. L’Antillais Aimé Césaire et son épouse, Suzanne Roussi-Césaire, y forgent le concept de négritude dans les années 1930 pour dénoncer le colonialisme. Paris tolère ces hommes et ces femmes sur son territoire, mais leur présence demeure étroitement surveillée par la police et les services de renseignement.
En laissant ces hommes et ces femmes penser, discuter, s’organiser, la France nourrissait sans le vouloir des aspirations qui finiraient par contester son pouvoir colonial. Ce phénomène s’accélère dans les années soixante, alors que la répression fait rage. On peut citer le cas de Djamila Boupacha, militante du Front de libération nationale algérien (FLN), violée et torturée par l’armée en 1960. L’avocate Gisèle Halimi et l’écrivaine Simone de Beauvoir dénoncent les faits et révèlent les pratiques de l’armée française en Algérie. Paris, éternelle capitale des révolutions, se réinventait alors à travers un nouveau chemin, celui de la défense des droits humains.
Andrew Milne ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
02.12.2025 à 15:59
Islam : comment se fabrique l’inquiétude dans le débat public
Texte intégral (1708 mots)
Après la production d’un rapport gouvernemental sur l’« entrisme des Frères musulmans » dans la société française, une étude de l’institut Ifop met en avant une progression de la religiosité chez les musulmans de France et l’interprète comme un signe de l’influence islamiste. Or, les chiffres avancés renvoient surtout à des pratiques ordinaires du culte. Cette approche interroge sur la façon dont l’islam est problématisé dans le débat public.
L’institut Ifop a récemment enquêté sur l’évolution, en France, des pratiques des musulmans, et notamment des jeunes, mettant en avant une forte dynamique de « réislamisation » (87 % des 15–24 ans se disent religieux, 62 % prient quotidiennement, 83 % jeûnent tout le ramadan, 31 % portent le voile). Cette lecture s’inscrit dans la continuité du rapport « Frères musulmans et islamisme politique en France » publié par le ministère de l’intérieur en mai 2025. Alors que ce rapport situait l’enjeu de l’« entrisme islamiste » au niveau des organisations et des institutions, l’enquête de l’Ifop esquisse l’idée d’une base sociale de l’islamisme dans des comportements ordinaires.
Pour étayer sa thèse, l’Ifop mobilise un ensemble d’indicateurs allant de la prière au jeûne, des comportements interpersonnels (bise, mixité) au rapport à la science ou aux règles religieuses. Or plusieurs de ces mesures, présentées comme les signes d’une religiosité accrue, soulèvent des difficultés méthodologiques : un écart important apparaît entre ce que les indicateurs mesurent et l’interprétation qui en est faite. Cette approche interroge sur la façon dont l’islam est problématisé dans le débat public.
Intensification religieuse : une réalité qui ne dit pas ce qu’on croit
Les données relatives à la « fréquence de la prière » offrent une première illustration de ce décalage. En islam, la prière rituelle (ṣalāt) consiste en cinq actes quotidiens obligatoires, pouvant être regroupés lorsque les circonstances l’exigent ; elle ne se décline pas selon des fréquences variables. La question « À quelle fréquence vous arrive-t-il de prier ? » repose ainsi sur un modèle catégoriel inadapté, fondé sur des échelles – « une fois par semaine », « une à quatre fois par jour », etc. – qui ne correspondent à aucune réalité du rite musulman. De telles formulations conduisent moins à mesurer une pratique effective qu’à enregistrer l’effort des enquêtés pour ajuster un rituel strictement codifié à une grille de lecture inadéquate. L’opposition graphique entre « prient quotidiennement » et « ne prient pas quotidiennement » produit ainsi des profils distincts là où la véritable distinction se joue entre accomplissement – même regroupé – et omission répétée.
Le même mécanisme apparaît dans la mesure du jeûne. Affirmer que « 73 % des musulmans ont jeûné tout le ramadan » est présenté comme un signe de « rigidification », alors qu’il s’agit de l’accomplissement ordinaire d’un pilier défini précisément comme un mois complet d’observance. La gradation introduite – « tout le mois », « quelques jours », « pas jeûné » – est étrangère au rituel, transposant à l’islam un modèle séculier de pratique modulable. La stabilité des chiffres (73 % en 2025, 74 % en 2019) reflète des dynamiques démographiques davantage qu’un durcissement doctrinal.
Dans les deux cas, l’étude ne décrit pas une radicalisation, mais elle réinterprète des pratiques rituelles à travers des catégories inappropriées, produisant artificiellement des niveaux d’engagement et des seuils de rupture qui n’existent pas dans les données. La prière et le jeûne deviennent ainsi des signaux idéologiques supposés, alimentant l’idée d’une « réislamisation » problématique alors qu’ils relèvent d’abord d’une normativité religieuse ordinaire chez les musulmans pratiquants.
Au-delà des chiffres qu’elle présente, l’étude mobilise un ensemble de catégories – « réislamisation », « orthopraxie », « absolutisme religieux », « tension avec la République », « séparatisme du genre », « halo de l’islamisme » – qui orientent fortement la manière dont les attitudes musulmanes sont interprétées. Ces cadres produisent une lecture homogénéisante de comportements pourtant très divers, en réinscrivant des pratiques ordinaires dans des désignations alarmantes. Ce type de catégorisation s’inscrit dans un biais bien documenté en sociologie des religions : la tendance à privilégier les registres normatifs ou les intentions supposées au détriment de l’analyse des pratiques elles-mêmes.
De la religiosité vécue au soupçon idéologique : un glissement méthodologique
Les conclusions de l’étude reposent sur une confusion centrale : elle tend à associer mécaniquement une religiosité plus visible à un durcissement idéologique. Or l’intensité du croire et l’intransigeance normative constituent deux dimensions distinctes. On observe des pratiquants rigoureux ouverts à l’altérité, tout comme des individus très peu ou non pratiquants adoptant des positions rigides. Rien ne permet donc de déduire qu’un niveau élevé d’observance rituelle traduit, en soi, une orientation idéologique particulière.
C’est pourtant cette assimilation hâtive que prolonge l’enquête lorsqu’elle interprète des comportements situés – abstinence d’alcool, refus de la bise, distance à la mixité – comme des signes de « séparatisme » ou d’« islamisme ». Le raisonnement opère alors un glissement : des gestes de piété ou des habitudes culturelles – comme le fait de ne pas pratiquer la bise, peu usitée dans de nombreuses régions du monde arabe – sont déplacés vers le registre du soupçon idéologique, non en raison de leur sens propre, mais du cadre interprétatif dans lequel ils sont insérés.
Ce glissement apparaît également dans l’usage d’items censés mesurer des orientations idéologiques, alors qu’ils ne saisissent que des arbitrages intellectuels généraux. La question opposant « science » et « religion » pour expliquer l’origine du monde en est une illustration. En imposant une alternative binaire – soit la science, soit la religion –, elle ne peut en rien indiquer une inclination vers l’islamisme ; un tel choix concerne d’ailleurs des croyants de nombreuses traditions.
Surtout, cette formulation peut laisser entendre que répondre « religion » révélerait une moindre capacité à adhérer au savoir scientifique ou à réussir scolairement. Or les données disponibles montrent exactement l’inverse : les enfants d’immigrés réussissent souvent mieux à l’école que les autres, et le niveau d’éducation des familles immigrées progresse nettement sur trois générations. L’item « science vs religion » ne fournit pourtant aucune indication sur une orientation idéologique : il mesure seulement la préférence déclarée pour l’un des deux registres explicatifs lorsqu’ils sont présentés comme incompatibles. Autrement dit, l’opposition est imposée par la question et non révélée par les convictions des répondants.
Ces attitudes sont ensuite corrélées à des mesures de « sympathie » pour des courants présentés comme islamistes. Pourtant, l’usage d’un terme aussi indéterminé crée une confusion. Ce terme peut recouvrir une simple absence d’hostilité, une familiarité culturelle ou encore une adhésion doctrinale. L’ambiguïté est renforcée par le regroupement, sous une même catégorie, d’univers religieux sans lien entre eux : le Tabligh, le salafisme/wahhabisme, les Frères musulmans et le takfir. Sans clarification, cette « sympathie » agrégée suggère un continuum idéologique qui n’existe pas, produisant mécaniquement des taux élevés.
Ces chiffres contrastent fortement avec un résultat pourtant décisif du même rapport : 73 % des musulmans estiment qu’un musulman a le droit de rompre avec l’islam, contre 44 % en 1989. Un tel indicateur de libéralisation normative aurait dû structurer la lecture de l’enquête. Or il est resté largement inaperçu dans le débat public, éclipsé par des items plus compatibles avec le récit d’une « réislamisation ». L’évolution des trente dernières années montre pourtant une dynamique inverse, celui d’un élargissement de l’autonomie individuelle dans le rapport à la foi, difficilement compatible avec l’idée d’un raidissement idéologique généralisé.
Au terme de l’analyse, une conclusion s’impose : un sondage comme celui de l’Ifop contribue surtout à façonner une manière de regarder les musulmans. Par ses catégories, ses regroupements et ses oppositions binaires, il produit un récit d’inquiétude qui relève davantage du cadrage de l’enquête que des données elles-mêmes. Un tel dispositif oriente la perception publique, suggère des liens fragiles et peut influer sur des décisions politiques – au risque d’accentuer chez certains musulmans le sentiment d’être injustement visés.
Ali Mostfa est coordinateur scientifique du parcours de formation Mohammed Arkoun sur l'islamologie, en partenariat avec les établissements d’enseignement supérieur lyonnais, financé par le Bureau Central des Cultes du Ministère de l’Intérieur.
01.12.2025 à 16:48
Le service militaire volontaire, un projet utile ?
Texte intégral (1792 mots)
Emmanuel Macron a annoncé la création d’un service militaire volontaire d’une durée de dix mois qui concernera 3 000 jeunes dès septembre 2026, puis 50 000 en 2035. Ces recrues seront-elles véritablement utiles, en soutien aux 200 000 militaires de métier ? Le chef de l’État estime qu’il « existe une génération prête à se lever pour la patrie ». Pourtant, l’armée peine à recruter des professionnels.
Les tensions internationales et plus particulièrement la guerre en Ukraine mettent en alerte les États européens. Ceux-ci augmentent leurs crédits militaires et s’interrogent sur les moyens de raviver leur système de réserves, bien souvent mis en sommeil depuis la fin de la guerre froide. Dans ce cadre, alors que Jacques Chirac avait annoncé en 1996 la suspension du service national, le président Macron a annoncé le 27 novembre 2025 sa résurrection selon des modalités différentes.
Il s’agirait d’un service militaire basé sur le volontariat, rémunéré au minimum 800 euros. L’objectif d’un tel service militaire serait de renforcer les régiments, dans le cadre de modalités encore inconnues, à hauteur de 3 000 jeunes en 2026, 10 000 à l’horizon 2030 pour une montée en puissance à 50 000 jeunes en 2035. Il s’agirait bel et bien d’une formation militaire incluant exercices tactiques, sport, exercices de tir. En outre, ces recrues n’auraient pas vocation à servir en opérations extérieures. Au-delà de former des jeunes à la chose militaire, l’espoir des autorités est de retenir suffisamment de personnes dans la réserve pour que celle-ci passe de 50 000 à 80 000 soldats.
Pour autant, un tel dispositif est-il de nature à véritablement renforcer les capacités de défense de la France ou constitue-t-il une simple mesure de communication politique ?
Un contexte de menaces et de résilience : pourquoi ce retour de l’uniforme ?
La guerre en Ukraine et les menaces russes ont rebattu les cartes de manière violente, en France et dans l’ensemble des pays européens. Les budgets de défense augmentent fortement. La France ne fait pas exception. La modernisation des forces est mise en avant. Reste désormais à mobiliser les citoyens.
Le chef d’état-major des armées a récemment tenté de sensibiliser la population au changement de la donne stratégique, pointant le risque que le pays ne soit « pas prêt à accepter de perdre ses enfants, de souffrir économiquement ». Il s’agit donc bien de préparer la société au pire dans un contexte où plusieurs pays européens pointent l’expansionnisme russe. Il ne s’agit pas seulement d’augmenter les effectifs de la réserve opérationnelle pour répondre à une guerre de haute intensité, mais bel et bien d’activer une mémoire républicaine où l’uniforme est perçu comme vecteur de cohésion et d’unité nationale.
Reste à s’interroger sur les difficultés qu’un tel projet peut rencontrer et sur le caractère politicien ou non d’une telle initiative dans un contexte où Emmanuel Macron tente de reprendre l’initiative dans un paysage politique instable et fragmenté.
Le service militaire volontaire : une force utile ou une armée symbolique ?
Le contenu du nouveau service militaire volontaire (SMV) vise à mobiliser les jeunes dans un cadre structurant. La formation initiale durera un mois permettant de délivrer une instruction militaire de base (maniement des armes, entraînement physique, combat). Il ne s’agit pas de créer des soldats professionnels projetables mais des citoyens-soldats capables de remplacer sur le territoire national les soldats professionnels partis guerroyer face à la Russie. En effet, dans une telle situation, les nouvelles recrues prendraient la charge de l’opération sentinelle, garderaient des bases, assureraient la mobilisation territoriale.
Plusieurs obstacles se dressent face à ce projet. Il y a d’abord le vote du budget. Si le budget de la défense n’est pas voté, celui de l’année dernière sera reconduit au moins partiellement. Une telle hypothèse entraînerait le report du projet budgété à deux milliards d’euros. Il y a ensuite l’attractivité du projet face à une jeunesse à remobiliser. L’armée française a du mal à recruter des soldats professionnels. Parviendra-t-elle à recruter des soldats dans le cadre du nouveau service militaire ?
On peut imaginer que les recrutements initiaux – 3 000 personnes pour 2026 – ne poseront pas de problèmes. Mais qu’en sera-t-il lors de la montée en puissance impliquant des projets de recrutement bien plus conséquents à hauteur de 10 000 personnes à l’horizon 2030 et 50 000 à l’horizon 2035 ? La question n’a pas de réponse aujourd’hui mais le doute est permis au regard de la solde proposée de 800 euros minimum et de la perception de l’engagement citoyen de la jeunesse. Les sondages montrent plutôt un accord des Français et même des jeunes à ce projet, mais accord sur le principe et engagement effectif sont deux aspects différents.
L’efficacité militaire du projet
En ce qui concerne la portée strictement militaire du dispositif, plusieurs interrogations se posent. Un engagement de quelques mois suffit-il à construire une réserve compétente ? Un des impératifs, dans tous les cas, sera la convocation régulière de la réserve à des exercices afin d’entretenir les compétences.
Autre problématique : le service militaire ne siphonnera-t-il pas de précieux fonds au détriment de la modernisation des équipements de l’armée professionnelle ? Là encore, il est difficile de répondre à ce stade. En effet, tout cela dépendra de la progression effective du budget global consacré à la défense.
En revanche, exiger des recrues, puis des réservistes, la même efficacité que l’armée professionnelle est un contresens : les missions attribuées aux uns et aux autres ne seront pas les mêmes et les volontaires ne seront pas projetables, à moins d’une menace majeure, généralisée, que l’on a du mal à entr’apercevoir.
Un signal politique plus qu’une révolution stratégique ?
Du point de vue politique, au sens noble du terme, le SMV se fonde sur le projet de « faire nation » et de « recréer du commun ». Face à cela, la droite est plutôt favorable, et une partie de la gauche défavorable. Il s’agit d’un clivage peu surprenant, en cette époque d’opposition politique intense. Une partie de la gauche s’en prend au « va-t-en-guerre » et la droite exige un sursaut.
Mais qui pourra nier la nature agressive du régime de Vladimir Poutine et la nécessité de se préparer à tous les scénarios ? Rappelons que les pays baltes se barricadent et que les Polonais se réarment à vitesse accélérée. Pour autant, s’il s’agit de « faire nation », le volontariat pourrait se limiter à n’attirer que des jeunes déjà convaincus ? La question mérite d’être posée.
Au plan politique, la création d’un grand chantier comme le SMV s’apparente certainement, pour le chef de l’État, à l’objectif de laisser une trace dans l’histoire, celle d’avoir su rassembler les Français autour de la défense du pays. En outre, une telle mesure lui permet de surfer sur le besoin d’autorité qui émerge dans nos sociétés. Mais là encore, il serait naïf de discréditer un projet au motif qu’il induit des préoccupations politiciennes. Dans un système démocratique, nombre de réformes impliquent un souhait d’améliorer le fonctionnement de la société et un souhait de renforcer son électorat voire sa clientèle politique ou encore l’image du prince. Tout cela est consubstantiel à la démocratie et ne dit rien de la valeur intrinsèque de la réforme.
Une initiative utile
Le nouveau service national présenté par le président s’inscrit dans un mouvement général européen allant dans le même sens, même si les modalités sont variables. Bien que dépendant des réalités budgétaires, cette réforme a l’immense avantage de constituer une force d’appoint en mesure de prendre la relève sur le territoire national en cas de projection des forces professionnelles. Il doit également permettre d’augmenter la réserve opérationnelle dans des proportions encore inconnues. Permettra-t-il par ailleurs d’augmenter le civisme de la jeunesse ? On peut émettre des doutes sur ce point. Le service national ne sera basé que sur le volontariat, ce qui constitue une limite évidente.
Finalement, le SMV ne constitue qu’une pièce de la panoplie permettant de réarmer la France. Sa réussite est encore une inconnue mais il s’imbrique parfaitement dans l’ambition française de montée en puissance de son armée, du point de vue matériel, de ses capacités diverses et variées (incluant la guerre informationnelle) et donc également du point de vue des capacités en effectifs. C’est désormais aux armées de communiquer efficacement pour rendre le projet attractif.
Laurent Vilaine ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
01.12.2025 à 15:22
Les syndicats sont-ils vraiment en crise ?
Texte intégral (1862 mots)
Mardi 2 décembre, la CGT, FSU et Solidaires appellent à manifester et à faire grève pour s’opposer au projet de budget 2026. L’occasion de revenir sur la perception que les Français ont des syndicats. Contrairement aux idées reçues, ils et elles font globalement confiance aux syndicats pour les défendre.
En France, les syndicats sont décrits, depuis les années 1980, comme éternellement en crise. Le taux de syndicalisation est faible (10,3 % en 2019), la participation aux élections professionnelles ou aux grèves recule et la confiance dans les syndicats est minoritaire. La construction de plusieurs mouvements sociaux en dehors des cadres syndicaux, comme le mouvement des gilets jaunes et plus récemment le mouvement « Bloquons tout », a également alimenté ce discours décliniste. Il en est de même du recours massif au télétravail consécutif à la crise sanitaire qui pourrait participer à accroître la distance aux syndicats sur les lieux de travail.
La défiance à l’égard des syndicats, un mythe à relativiser
Cependant, un examen plus attentif des rapports des salariés aux organisations syndicales vient nuancer un tel discours décliniste. Ainsi, les exemples de mobilisations impulsées par les organisations syndicales ayant connu un certain succès en termes de participation des salariés et de popularité ne manquent pas ces dernières années, à commencer par les mouvements contre les projets de réformes des retraites du printemps 2023 ou de l’hiver 2019-2020. Plus proches de nous, les syndicats ont rassemblé entre 500 000 et 1 million de personnes dans les rues, le 18 septembre 2025, et encore de 200 000 à 600 000, le 2 octobre. Et, si le mouvement « Bloquons tout » était soutenu par 46 % des Français, ce chiffre a atteint 56 % pour le mouvement intersyndical du 18 septembre.
Il est à ce titre pertinent de diversifier les formes d’engagement au travail en ne se limitant pas à l’adhésion syndicale ou au recours à la grève, par exemple en étudiant la participation aux élections professionnelles, les discussions syndicales entre collègues ou la participation par divers moyens aux mouvements sociaux, ce qui permet aussi de tenir compte de l’inégale exposition des salariés aux différentes formes d’engagement au travail.
Parallèlement, la « confiance » des salariés dans les syndicats n’a que très peu évolué depuis la fin des années 1970. En 1978, 50,1 % des salariés faisaient confiance aux syndicats selon l’enquête postélectorale du Cevipof, contre 44 % en 2024 selon le baromètre de la confiance politique du Cevipof alors même que, sur la même période, le taux de syndicalisation en France a fortement chuté.
Ce paradoxe se retrouve à l’échelle européenne. Comme le montre le graphique ci-dessous, la confiance dans les syndicats varie énormément d’une année à l’autre. Cela ne semble lié ni à des mobilisations sociales ni à des indicateurs macroéconomiques. En revanche, on remarque que les deux phases historiques où cette confiance est la plus faible coïncident avec les présidences des socialistes François Mitterrand et François Hollande. Ce résultat confirme que, avec un gouvernement de gauche, les Français adoptent une posture plus libérale alors que, avec un gouvernement de droite, ils et elles demandent plus de redistribution.
Graphique : Confiance des salariés dans les syndicats (en %) (1978-2024)
Enfin, dépasser cette notion de « confiance » permet de faire état d’une image plus positive des syndicats. En effet, cette notion apparaît problématique. Le degré de confiance peut s’exprimer de manière générale (sentiment de confiance) ou pour un objectif particulier (défendre l’emploi, les salaires, les conditions de travail… au niveau local, au niveau sectoriel ou au niveau national) et, dans ce dernier cas, la capacité d’action des syndicats ne dépend pas uniquement d’eux-mêmes, mais aussi du contexte politique, économique et social.
Ainsi, diversifier les indicateurs mesurant l’image qu’ont les salariés des syndicats fait apparaître une forte demande de syndicats et une certaine appréciation de leurs actions. C’est ce que montrent plusieurs enquêtes réalisées en France ou à l’échelle européenne. Selon des enquêtes postélectorales que nous avons réalisées en 2022 puis en 2024 dans le cadre du projet CERTES, plus de 60 % des salariés répondants sont d’accord avec le fait que les syndicats rendent des services aux salariés (64 % en 2022, 62,8 % en 2024).
La perception des syndicats en France, une question politiquement clivante
La perception des syndicats par les salariés est donc, en France, plutôt positive. Elle varie toutefois selon leurs positions professionnelles, selon leurs relations au travail avec la direction et avec leurs collègues et, dans une moindre mesure, selon leur profil social. Elle varie aussi très fortement selon leurs autres attitudes politiques.
Ainsi, en Europe comme en France, plus les salariés se situent à gauche, plus ils ont une perception positive des syndicats. Nous avons exploré plus en détail cette relation à partir de l’enquête postélectorale de 2024 réalisée en ligne par Cluster 17 en juillet 2024 auprès d’un échantillon de 5 109 répondants représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus selon la méthode des quotas.
Tableau : Rapport aux syndicats des salariés selon leurs attitudes politiques
Nous avons construit, de manière automatique et en nous limitant aux 2 287 répondants salariés, quatre classes à partir de 11 questions d’opinion (augmentation des salaires, conditionnalité des aides sociales, encadrement des licenciements, immigration, écologie, féminisme, droits des minorités sexuelles et de genre, reconnaissance de l’État de Palestine) :
Les « identitaires » se distinguent par leur hostilité à l’immigration, au féminisme, à l’écologie et aux droits des personnes LGBTQIA+, par des attitudes plutôt méritocratiques en matière d’emploi et par une opposition marquée à toute augmentation générale des salaires.
Les « méritocrates » ont des attitudes plus méritocratiques que le groupe précédent, mais sont plus tolérants en matière d’immigration ou de droits des femmes et des personnes LGBTQIA+, sans pour autant être progressistes.
Les « libéraux » se distinguent par leur opposition un peu plus marquée à toute augmentation générale des salaires et par une tolérance un peu plus grande en matière d’immigration, de droits des femmes et des personnes LGBTQIA+.
Les « progressistes » se distinguent par des attitudes progressistes sur tous les plans, y compris par un rejet de toute conditionnalité des aides sociales.
Alors qu’au premier tour des législatives de 2024, 68 % des progressistes ont voté Nouveau Front populaire (NFP) – 48 % des identitaires et 36 % des méritocrates ont voté Rassemblement national (RN) –, notre sondage révèle que 90 % des progressistes considèrent que les syndicats rendent des services aux salariés, contre la moitié des identitaires, des méritocrates ou des libéraux.
Les écarts sont aussi très importants si on considère le rapport des salariés au mouvement social du printemps 2023 contre la réforme des retraites : près de 90 % des progressistes disent y avoir participé ou l’avoir soutenu, contre autour de 45 % des identitaires et des méritocrates et à peine 30 % des libéraux.
Au contraire, les écarts sont bien moins importants si on considère la seule adhésion syndicale, alors même qu’en 2024, contrairement à de précédents scrutins, les syndiqués ont significativement plus voté à gauche que les non-syndiqués. Ainsi, si 30 % des progressistes sont syndiqués, c’est tout de même le cas de 16 % des identitaires, de 15 % des méritocrates et de 10 % des libéraux.
Des syndicats affaiblis par leurs prises de position politiques ?
La perception positive des syndicats et des mouvements sociaux est donc bien plus répandue que la seule adhésion syndicale, mais bien plus clivée politiquement.
Contrairement à une idée reçue, la défiance dans les syndicats est donc à relativiser : malgré la faiblesse de leurs effectifs, ils ne suscitent pas plus d’opinions négatives que par le passé et parviennent encore à mobiliser une partie conséquente du salariat. Mais ces nouveaux indicateurs de l’influence syndicale que sont leur perception par les salariés et leur capacité à mobiliser sont aussi plus clivés politiquement.
Ce résultat éclaire donc à nouveau frais les réflexions autour des liens entre syndicalisme et politique et des stratégies d’alliances qui peuvent exister. Il permet aussi de remettre en cause l’idée selon laquelle les prises de position politiques des syndicats, contre le RN, voire en faveur de la gauche pour certaines centrales, comme en 2024, participeraient à les affaiblir. Le contraire serait plutôt vrai : cela les met en phase avec les salariés qui, même non syndiqués, les apprécient et participent à leurs actions.
Tristan Haute a reçu des financements de l'Agence nationale de la recherche dans le cadre du projet Comportements électoraux et rapports à l'emploi, au travail et au syndicalisme.
