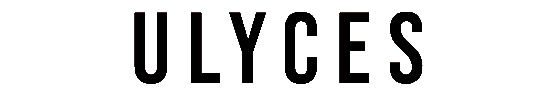21.08.2023 à 12:23
Les NFT sont-ils le scam de la décennie ?
Ulyces
2 mai 2014 : Kevin McCoy, un artiste numérique américain désireux de créer un système plus équitable pour ses confrères, met au point avec son partenaire développeur Anil Dash la première œuvre certifiée NFT de l’histoire. Baptisée Quantum, elle représente un octogone rempli de cercles concentriques pulsant de manière psychédélique. L’œuvre annonce pour Kevin McCoy […]
L’article Les NFT sont-ils le scam de la décennie ? est apparu en premier sur Ulyces.
Texte intégral (1971 mots)
2 mai 2014 : Kevin McCoy, un artiste numérique américain désireux de créer un système plus équitable pour ses confrères, met au point avec son partenaire développeur Anil Dash la première œuvre certifiée NFT de l’histoire.
Baptisée Quantum, elle représente un octogone rempli de cercles concentriques pulsant de manière psychédélique. L’œuvre annonce pour Kevin McCoy un avenir radieux : celui où les artistes modestes, habitués jusqu’à présent à voir leurs œuvres pillées et repartagées sur les réseaux sans être crédités, prendront enfin le contrôle sur leur art avec un moyen sûr d’authentifier leur travail, une sorte de griffe numérique. Le concept du NFT était né, mais Kevin McCoy était loin d’imaginer que son idée, restée dans l’ombre pendant de nombreuses années, serait au centre de toutes les controverses aujourd’hui. « Il y a eu beaucoup d’incompréhension. Le monde de l’art traditionnel a eu du mal à comprendre le système et ce qui était proposé », se souvient McCoy. « De son côté, le monde des cryptomonnaies n’était pas intéressé par la question de l’art numérique. »

Quantum, de Kevin McCoy et Anil Dash
Un constat désormais bien différent. Devenu le sujet brûlant sur Internet ces derniers mois, les NFT sont partout. De Meta à Ubisoft, de Freeze Corleone à Eminem, chacun cherche à se positionner pour tirer son épingle du jeu. Les enthousiastes suivent avec une explosion des ventes de NFT, qui réalisent 4,7 milliards de dollars uniquement sur la semaine du 23 janvier 2022. Pourtant, des artistes de plus en plus nombreux tirent la sonnette d’alarme, pointant des failles sur les plateformes de reventes de NFT, notamment OpenSea, qui mettrait en vente une multitude de fausses œuvres ou des œuvres volées. Ce qui pousse certains à dire que malgré leur promesse initiale, les NFT sont un vaste scam organisé.
L’appel d’air
Si la question des NFT est aussi brûlante, c’est qu’elle s’est imposée aux yeux du grand public en seulement quelques mois. Depuis 2021, les ventes de NFT ont atteint des paliers records avec la vente de The Merge de l’artiste Pak, une œuvre numérique fragmentée en 226 434 parties vendues pour un total de 91,8 millions de dollars à plus de 28 000 acheteurs différents, entre le 2 et le 4 décembre dernier sur la plateforme Nifty. Des sommes qui encouragent des personnalités comme Eminem à investir eux aussi dans les NFT.
Début janvier, le dieu autoproclamé du rap s’est offert un ticket d’entrée à 450 000 dollars dans le Bored Ape Yatch Club, une communauté très select de collectionneurs NFT arborant un singe unique à leur effigie leur permettant d’obtenir certains accès à des événements privés en ligne ou IRL. Mais cette effervescence autour des NFT ne séduit pas tout le monde du rap. Kanye West a notamment fait part de son agacement à l’occasion d’un post sur Instagram le 1er février. « Ne me demandez pas de faire un p***** de NFT », s’énerve Ye. « Je me concentre pour créer des choses dans le monde réel. »

Le message de Ye
De leur côté, les entreprises se positionnant sur les NFT sont légion, saturant l’espace médiatique avec une technologie encore peu connue et instillant ainsi une défiance grandissante. Ainsi, 51 % des millennials estiment que les NFT sont une arnaque selon un sondage annuel de Tidio, une crainte qui monte à 82% pour les membres de la génération Z (2000-2010). Des chiffres qui coïncident avec les tollés pris par les entreprises qui tentent d’embrasser les NFT dans leur écosystème. Twitter s’y est lui-même frotté après avoir lancé en janvier dernier une fonctionnalité permettant à ses utilisateurs premium d’uploader leur NFT pour les exposer sur leur profil. Une initiative décriée par de nombreux utilisateurs dont Elon Musk, « agacé » par les ressources utilisées par Twitter dans ce genre de fonctionnalités.
Du côté du gaming, les NFT soulèvent également des débats enflammés entre éditeurs, développeurs et consommateurs. En novembre 2021 le directeur général d’Electronic Arts Andrew Wilson avait annoncé la volonté d’EA d’intégrer la technologie NFT à ses jeux vidéo, une décision présentée comme « le futur de l’industrie » par Wilson et accueillie par une grogne massive sur les réseaux, car les joueurs y voient un énième moyen pour l’entreprise d’intégrer des contenus payants à ses jeux. Trois mois plus tard, EA se montre plus réservé quant à l’implémentation de NFT dans ses futures productions. « Je crois que l’aspect collection continuera à être une partie importante de notre industrie. Que ce soit dans le cadre de la blockchain NFT, cela reste à voir », modère désormais Wilson. « Nous allons évaluer cela au fil du temps, mais pour l’instant, ce n’est pas quelque chose sur lequel nous nous acharnons. »
Et pour cause, les consommateurs ne sont pas les seuls à craindre l’implémentation des NFT dans l’industrie. Une étude de la Game Developers Conference a révélé en janvier que 70 % des développeurs de jeux vidéo sont hostiles aux NFT dans les jeux. « Ces technologies n’utilisent toujours pas d’énergie durable et sont une cible pour le blanchiment d’argent. En tant que développeur, je me sens profondément mal à l’aise à l’idée qu’elles soient encouragées », précise anonymement un des développeurs sondés.
Crypto punks
De nombreux aspects viennent en effet noircir le tableau dépeint par les enthousiastes des NFT. En théorie, chaque NFT, ou jeton non-fongible, associé à la technologie blockchain, est unique et impossible à reproduire. Cette protection garantit au collectionneur que son achat n’est pas contrefait et à l’artiste que son travail ne sera pas volé. Pourtant, les couacs ne cessent de s’accumuler pour les acteurs du milieu des NFT. Après le licenciement d’un de ses employés pour avoir détourné le système de vente à son avantage, la plateforme OpenSea est de nouveau au cœur de la polémique pour sa fonctionnalité permettant aux utilisateurs de créer gratuitement leur jeton non-fongible. Une fonctionnalité que la plateforme est désormais forcée d’endiguer après avoir révélé sur Twitter une faille majeure dans son système. « Plus de 80 % des articles créés avec cet outil étaient des œuvres plagiées, de fausses collections et du spam », admet OpenSea.

Crédits : OpenSea
De plus en plus d’artistes se soulèvent pour révéler le côté obscur du marché des NFT et déclarent avoir tout simplement vu leur travail leur être volé et vendu à leur insu sur certaines plateformes. C’est le cas d’Aja Trier, une artiste peintre américaine. En janvier 2022, un utilisateur non-identifié sur OpenSea, la plateforme dominante du marché de l’art NFT, a commencé à mettre en vente des dizaines de milliers de ses œuvres, souvent en plusieurs fois. Trente-sept d’entre elles ont été vendues avant qu’elle ne parvienne à convaincre la plateforme de les retirer. « Ils n’arrêtaient pas de les reprendre et de les refaire en tant que NFT », explique Aja Trier. « C’est tellement flagrant. Et si ça m’arrive à moi, ça peut arriver à n’importe qui ».
Effectivement, le cas de Aja est tout sauf isolé. Des artistes plus renommés, dont le concepteur de Detective Pikachu RJ Palmer, se sont également fait voler leurs œuvres. « Au cours des dernières 24 heures, j’ai dû signaler 29 cas de vol de mes œuvres en tant que NFT. C’est vraiment fatiguant et cela ne fait qu’empirer », a tweeté Palmer le mois dernier. « Tous les artistes que je connais se font voler leurs œuvres et c’est tout simplement injuste. Que pouvons-nous faire, c’est sans espoir. »
Le vol et le plagiat ne sont pas les seules problématiques que doivent gérer les plateformes de vente de NFT. La spéculation, inhérente à l’écosystème des NFT, amène également son lot de dérives. Ainsi LooksRare, la deuxième plateforme du secteur, a été épinglé en janvier dernier par la firme d’analyse NFT CryptoSlam, qui révèle que 87 % des transactions sur LooksRare constitueraient du « wash trading », une manipulation du marché consistant notamment à vendre et acheter en boucle la même œuvre pour faire monter son prix artificiellement ou empocher des bénéfices sur la transaction.

Crédits : LooksRare
Ce type de pratique a notamment été mis en lumière par l’affaire du « CryptoPunk 9998 », qui s’était vendu pour 532 millions de dollars en octobre 2021, avant d’être épinglé par son créateur sur Twitter. « Cette transaction (et un certain nombre d’autres) n’est pas un bug », a tweeté la société. « En un mot, quelqu’un s’est acheté ce punk avec de l’argent emprunté et a remboursé le prêt dans la même transaction. »
·
Malgré les dérives, l’essor des NFT est bien parti pour se poursuivre et pourrait même trouver des applications au-delà du domaine du dématérialisé.
Certains s’impatientent ainsi de les voir déferler notamment dans le domaine de l’immobilier. « Je suis enthousiasmé par la façon dont les NFT vont être appliquées aux biens immobiliers du monde physique », déclarait Tim Draper, investisseur américain et grand partisan du bitcoin, en avril 2021. « Je soupçonne que les gens seront bientôt en mesure d’acheter un bâtiment, d’acheter les droits aériens et d’acheter les droits virtuels de tout espace physique. L’avenir est impressionnant. »
Des déclarations qui promettent encore de longues discussions autour des jetons non-fongibles et de leur fiabilité, loin d’être acquise pour le moment. Ce qui est sûr, c’est qu’à l’heure actuelle, ils enrichissent plus d’investisseurs et de fraudeurs qu’ils ne protègent d’artistes numériques.
L’article Les NFT sont-ils le scam de la décennie ? est apparu en premier sur Ulyces.
18.07.2023 à 12:05
Voilà à quoi ressembleront les robots du futur selon le créateur de Sophia
Nicolas Prouillac et Arthur Scheuer
2022 sera l’avènement des machines. En tout cas, c’est ce qu’espère Hanson Robotics. Depuis son atelier de Hong Kong, le créateur de l’androïde Sophia, David Hanson, a confié à Reuters qu’il comptait vendre « des milliers » de robots cette année. « Sophia et les autres robots de Hanson sont uniques de par leurs traits […]
L’article Voilà à quoi ressembleront les robots du futur selon le créateur de Sophia est apparu en premier sur Ulyces.
Texte intégral (2718 mots)
2022 sera l’avènement des machines. En tout cas, c’est ce qu’espère Hanson Robotics. Depuis son atelier de Hong Kong, le créateur de l’androïde Sophia, David Hanson, a confié à Reuters qu’il comptait vendre « des milliers » de robots cette année. « Sophia et les autres robots de Hanson sont uniques de par leurs traits humains », explique le roboticien. « Ils peuvent être utiles dans ces temps troublés, où les gens sont terriblement seuls et isolés socialement. » Nous l’avons rencontré pour un entretien fleuve.
•
David Hanson est rarement seul. Depuis quatre ans, le fondateur de Hanson Robotics parcourt le monde accompagné de ses robots, Sophia en tête. Le 3 mars dernier, l’Américain était en Pologne sans l’androïde qui l’a fait connaître, mais il a promis de l’amener avec lui à Cracovie, au mois de juin. S’il avait laissé sa créature dialoguer avec les membres des Nations unies en octobre 2017, il a cette fois préféré rencontrer la ministre du Développement polonaise en personne. Jadwiga Emilewicz en a profité pour annoncer l’ouverture prochaine de centres d’intelligence artificielle dans le pays. « Il est temps de devenir un créateur d’innovation plutôt qu’un récepteur », a-t-elle annoncé.
Depuis qu’il a découvert les œuvres des auteurs de science-fiction Issac Asimov et Philip K. Dick à l’adolescence, David Hanson s’est évertué de tenir ce rôle. Né à Dallas, le Texan a travaillé comme un forcené pour mettre au point Sophia et une kyrielle d’autres robots humanoïdes, dont des avatars d’Einstein et de l’auteur de Blade Runner. Il a ainsi développé une vision unique du futur des robots et, partant, du nôtre. Deux ans après notre première rencontre, il nous a dévoilé sa vision du futur des robots.
Sophia a-t-elle un futur ?
Bientôt cinq ans après sa création, nous travaillons toujours sur Sophia afin d’en faire une plateforme robotique cognitive très avancée, pourvue de bras et de mains bien articulés ainsi que d’une multitude de nouvelles compétences et de capteurs. Elle possède actuellement 40 moteurs dans le visage et l’encolure, un socle rotatif et on lui ajoute parfois des jambes. Tout cela coûte très cher et ce n’est bien sûr par quelque chose que nous pouvons proposer au grand public.
Alors nous avons mis au point la petite sœur de Sophia, Little Sophia, ainsi qu’un autre petit robot savant baptisé Professeur Einstein. Nous avons l’ambition de faire de ces petits androïdes la nouvelle génération d’assistants vocaux, mais des assistants vocaux animés. Interagir avec des robots humanoïdes est une expérience puissante, qui entre en résonance avec un tas d’idées développées par la science-fiction dont l’humanité rêve depuis longtemps.
Cela signifie que les enfants sont enthousiasmés à l’idée d’interagir avec cette technologie. Ils sont ainsi capables d’apprendre beaucoup tout en s’amusant. Vous avez un personnage, une histoire… il n’y a rien de mieux pour retenir l’attention d’un être humain.

Crédits : Justine Molkhou
Quelles sont les applications pratiques de ces androïdes ?
Avec une des grandes sœurs de Sophia, Alice, l’université de Pise, en Italie, a eu de bons résultats dans le traitement de l’autisme. Une version miniature de ce robot a aussi été employée pour aider les personnes âgées. Mettre ces technologies au service du grand public sans amoindrir la qualité de leur intelligence artificielle était un grand défi. Mais nous y sommes parvenus avec la petite Sophia et, avec la grande, nous cherchons à faire encore un bond en avant.
Nous voulons que Sophia soit utile dans l’éducation scientifique, dans la recherche, dans le développement de nouveaux algorithmes, dans la mise au point de nouvelles interfaces humain-machine et dans l’invention de nouvelles thérapies pour l’autisme. Pour ces usages thérapeutiques, il existe naturellement déjà des connaissances et une expertise médicale, mais Sophia peut les rassembler au sein d’une même plateforme pour les rendre plus impactantes.
Comment les robots peuvent-ils changer notre façon d’apprendre ?
Il faut voir les androïdes comme des plateformes, les réceptacles de programmes d’intelligence artificielle toujours plus avancés et différents. Nos interactions avec l’intelligence artificielle peuvent devenir plus naturelles et profondes grâce à aux robots : on n’a pas la même relation avec une machine à forme humaine qu’avec un smartphone.
L’idée est donc pour nous de faire de nos robots des plateformes dotées d’interfaces de programmation open source, afin de bénéficier des créations de personnes du monde entier. De cette manière, la nouvelle vague de technologies intelligentes pourra être « humanisée » par n’importe qui. Voilà pourquoi il est très important à nos yeux de démocratiser les robots comme Sophia et de créer des plateformes humanoïdes grand public, comme avec la petite Sophia.
Certaines de nos innovations, comme les technologies d’expression faciale, demeureront la propriété de Hanson Robotics, mais beaucoup d’autres vont devenir publiques. C’est ce que nous avons fait avec le Professeur Einstein. Nous vendons ce petit robot avec la possibilité de lui apporter des modifications structurelles. Mais il fallait vraiment avoir des compétences de hackers pour le faire. Avec Little Sophia, il est plus simple pour tous les utilisateurs de lui apprendre de nouvelles choses et de la faire évoluer.
Mon fils de 13 ans est parvenu à la reprogrammer grâce à la l’interface de commande en ligne, c’était génial. Lorsque vous voyez des enfants jouer avec les robots, vous vous rendez compte des éclairs de créativité que cela peut produire. Ils peuvent rêver et laisser libre cours à leur imagination, plutôt que de se retrouver face à une machine limitée. C’est formidable de les voir s’enthousiasmer face à cet univers de tous les possibles.
Comment êtes-vous entré dans l’univers de la robotique ?
En 1995, je suivais des cours de programmation pendant mon cursus de cinéma. J’ai construit un robot de téléprésence et je l’ai montré dans un festival d’art scientifique. Depuis, je n’ai pas arrêté d’en inventer. Pour mon doctorat, je me suis penché sur une des questions les plus complexes de la robotique humanoïde : quelle technologie utiliser pour les expressions faciales ? J’ai créé des dizaines et des dizaines de robots différents. Certains d’entre eux fonctionnent encore dans des laboratoires de recherche autour du monde et j’en suis très fier.
D’une certaine manière, Sophia est le fruit de toutes ces années de développement. En chemin, il y a eu l’androïde Philip K. Dick (qu’on appelle Phil), qui a été inspiré par ses livres We Can Build You et Valis, dans lesquels il explore l’idée que les machines intelligentes peuvent évoluer conjointement aux humains pour former un réseau de super-intelligence transcendantale. C’est un élément-clé de mes créations. D’ailleurs, dans ces livres, il y avait un robot baptisé Sophia.

Crédits : Justine Molkhou
En 2014, j’ai commencé a dessiné son visage en m’inspirant de visages de différentes grandes civilisations – de l’Antiquité, de Chine, d’Afrique, des Inuits et de mon épouse… J’étais obsédé par ce travail, si bien que j’ai passé plus de temps sur ce robot que sur n’importe quel autre auparavant. J’avais le sentiment de ne pas savoir où j’allais, j’étais complètement perdu. Et nous avons finalement activé Sophia en février 2016.
J’ai été surpris par la réaction du public. Je pense que le succès de Sophia était dû avant tout à la qualité de ses expressions faciales. Puis avec l’université polytechnique de Hong Kong et le projet Opencog, nous avons travaillé sur son intelligence. Cette IA lui donne une véritable personnalité. Et grâce au deep learning, elle peut produire ses propres idées.
Pourrait-elle à terme développer une forme de conscience ?
Je ne sais pas. Ce qui est sûr, c’est que le fait de mettre ces outils dans les mains de différents chercheurs pour qu’ils les combinent va produire des choses intéressantes. Je pense notamment que les algorithmes génétiques ou les algorithmes physiologiques d’inspiration biologique sont pleins de promesses. Il faut appliquer ces modèles de bio-informatique et de neuroscience sur des humanoïdes pour qu’ils n’aient plus seulement la capacité d’interagir physiquement avec nous, mais aussi socialement. C’est peut-être la clé pour voir des étincelles de vie s’allumer.
L’année dernière, nous avons travaillé avec l’Institute of Noetic Sciences, en Californie, et Opencog sur un projet baptisé « Loving AI ». Des mathématiciens, des physiciens et bien d’autres scientifiques ont utilisé des schémas neuronaux pour tester une intelligence artificielle dans le cadre de ce qu’on appelle la théorie de l’information intégrée, qui cherche à expliquer le fonctionnement de la conscience. Alors qu’elle recevait de l’information et poursuivait les buts assignés, différentes valeurs ont émergé dans notre IA. Il faut poursuivre ces explorations de la conscience pour la faire émerger chez des êtres synthétiques.
Cela dit, ces expérimentations ne sont pas une preuve qu’une machine peut avoir une conscience. Les machines ne peuvent en tout cas pas être douées d’une conscience comparable à celle de l’être humain. Je vois Sophia comme un enfant avec le vocabulaire d’un doctorant. L’idée est maintenant de la faire grandir pour lui permettre d’avoir de meilleures interactions avec le monde réel.
Elle n’en prend pas encore le chemin. Pour l’instant, Sophia a deux fonctions : c’est une œuvre d’art qui sert d’interface à des programmes d’intelligence artificielle ; et c’est un programme de recherche, autrement dit une plateforme pour le développement de la prochaine génération d’IA. Je pense que ces deux dimensions avancent de concert car les robots comme Sophia peuvent apprendre de l’expérience humaine pour cheminer vers l’âge adulte. On retrouve cette idée d’évolution conjointe aux humains.
Bien sûr, tous les robots ne doivent pas ressembler aux êtres humains, mais il est bon d’avoir cette possibilité. Les êtres humains sont plus adaptés aux expériences humanisées comme la littérature, le cinéma ou les interactions en face à face. Nous pouvons nous servir de ça pour entraîner une IA à mieux connaître l’expérience humaine.
Les robots du futur seront-ils un mélange de technologie et de biologie ?
À mon avis, la convergence des progrès en biologie et en technologie n’est pas simplement le résultat de la science humaine, cela fait partie de l’histoire naturelle de notre univers. Je pense que nous sommes à un stade de notre évolution où nous devons trouver le moyen d’être meilleurs, sur le plan éthique, pour construire un meilleur futur, plus créatif, et faire face aux défis existentiels qui se présentent à nous. Nous devons transcender notre passé ou périr. C’est le défi de toute civilisation.
Cela signifie que nous devons explorer ces convergences avec l’idée qu’elles nous permettent de nous améliorer. Comment vivre de façon plus éthique ? La question se pose, et nous avons besoin d’y apporter des réponses nouvelles. Pour cela, il nous faut être plus créatifs et innovants.

Crédits : Justine Molkhou
Alors comment créer des modèles plus complexes qui rendront l’existence meilleure ? Il nous faut développer notre intelligence pour pouvoir mieux appréhender l’existence et imaginer de meilleures façons de préserver la vie. Voilà pourquoi créer de nouvelles formes de vie est une bonne chose : aller de l’avant est quelque chose de naturel. Il faut se garder de la tentation de privilégier le court-terme qui favorisent des mécaniques de domination d’un individu sur l’autre, d’une culture sur l’autre ou d’une nation sur l’autre. La convergence de la technologie et de la biologie est nécessaire pour créer des échanges où tout le monde peut être gagnant.
Les robots peuvent-ils rendre l’humain meilleur ?
Cela devrait être notre but : comment se servir des machines et l’IA pour sauver l’humanité et la planète. Je suis fier de la manière avec lesquelles mes équipes créent des robots ou des IA pour faire le bien.
Sophia a déjà fait la promotion d’objectifs de développement durables des Nations unies. Je pense aussi que le storytelling, la bonne science-fiction, améliore la condition humaine, elle nous permet d’examiner ces sujets importants. Nous devons utiliser tous les outils à notre disposition pour sensibiliser les gens. Les deepfakes, les algorithmes comme armes de propagande de masse ou de neuro-hacking sont effrayants. C’est pour ça qu’il nous faut définir un cadre éthique pour utiliser ces outils.
Pourquoi ne pourrions-nous pas nous en emparer pour sensibiliser le monde, pour le rendre mieux informé, plus créatif ? Le neuro-hacking est perçu comme quelque chose de mauvais mais tout nouvel élément culturel ou artistique est une forme de neuro-hacking. Les bonnes idées hackent notre réalité en ouvrant de nouvelles possibilités. C’est le pouvoir de la science et du storytelling.
En 2022, il n’y a pas qu’un seul Philip K. Dick, il y en a des centaines. Peut-être qu’ils s’expriment par d’autres biais qu’à travers la littérature de science-fiction. Le risque est qu’une abondance d’information poussent des gens à revenir aux vieux paradigmes. C’est là que faire de l’exploration et de la création un jeu est très important. C’est là que Sophia trouve une raison d’être.
Couverture : ITU Pictures
L’article Voilà à quoi ressembleront les robots du futur selon le créateur de Sophia est apparu en premier sur Ulyces.
24.05.2023 à 00:00
Les secrets de la bromance entre Hollywood et la NASA
Nicolas Prouillac
Ground control to Major Tom… C’est officiel, Tom Cruise tournera le premier long-métrage dans l’espace en octobre 2021. Accompagné du réalisateur Doug Liman (La Mémoire dans la peau, Edge of Tomorrow), l’acteur américain prendra place à bord d’une capsule Crew Dragon de SpaceX pour rejoindre la Station spatiale internationale, où les deux hommes tourneront un […]
L’article Les secrets de la bromance entre Hollywood et la NASA est apparu en premier sur Ulyces.
Texte intégral (4864 mots)
Ground control to Major Tom… C’est officiel, Tom Cruise tournera le premier long-métrage dans l’espace en octobre 2021. Accompagné du réalisateur Doug Liman (La Mémoire dans la peau, Edge of Tomorrow), l’acteur américain prendra place à bord d’une capsule Crew Dragon de SpaceX pour rejoindre la Station spatiale internationale, où les deux hommes tourneront un film au contenu encore mystérieux.
Au lendemain d’une annonce similaire de la part de la Russie, qui veut elle aussi tourner le premier film dans l’espace à l’automne prochain, la NASA a confirmé l’annonce faite pour la première fois en mai 2020 : un film hollywoodien sera bien tourné à bord de l’ISS l’année prochaine. Le climax d’une longue relation entre l’industrie cinématographique américaine et l’Agence spatiale américaine.
https://twitter.com/JimBridenstine/status/1257752395750289409?ref_src=twsrc%5Etfw
Global Effects
Le ciel est couvert en cette fin de matinée à Los Angeles, donnant un air morne aux entrepôts qui bordent les boulevards de North Hollywood. 7115 Laurel Canyon Blvd, nous y sommes. Un vaste bâtiment de brique rouge aux fenêtres flanquées de barreaux noirs, surmontées d’un panneau indiquant « Global Effects, Inc. ». Un décor pour le moins inhospitalier. Aucun touriste en vue pour le prendre en photos. On est loin de l’aura glamour qui entoure les studios de tournage qui fleurissent aux pieds des collines d’Hollywood. L’endroit n’en renferme pas moins de magie : j’ai rendez-vous avec un des plus grands accessoiristes américains, spécialisé dans la confection de combinaisons pour les grands drames spatiaux, d’Armageddon à Seul sur Mars.
Je remonte l’allée qui mène au parking privé de l’entrepôt. La zone est déserte, les volets sont tirés. Suis-je vraiment au bon endroit ? En promenant mon regard aux alentours, je remarque les pièces détachées d’une navette spatiale, dissimulées sous des bâches grises. On dirait bien. Je frappe à la porte de service métallique sur laquelle un panneau défraîchi souhaite la bienvenue aux visiteurs. Des pas se font entendre, la porte s’ouvre sur un visage sévère aux cheveux frisés en bataille. À la mention de la raison de ma venue, il s’éclaire d’un sourire. Chris Gilman confirme que je suis à bon port et m’invite à entrer. Derrière lui s’étendent les rayonnages de sa caverne d’Ali Baba, remplis de costumes, de casques et d’accessoires en tout genre. Et sur les murs, des affiches de blockbusters au succès desquels lui et son équipe ont contribué. « Bienvenue chez Global Effects », dit-il.
« On sait aussi faire des monstres, mais nous avons levé le pied de ce côté-là », explique Chris Gilman tandis que nous commençons à parcourir les allées du studio. Voilà trente ans que l’accessoiriste est dans le métier, et plus de vingt qu’il a fondé Global Effects. À l’étage sont alignées des armes et armures médiévales, que l’équipe a conçues pour des films comme Le 13e Guerrier et Le Dernier samouraï, sur lesquels il passe rapidement. Car c’est en bas que sont exposées les créations qui ont fait sa renommée dans le milieu. « Mon premier succès », dit-il en s’arrêtant devant une tenue bactériologique jaune familière. Et pour cause, elle est tirée du film Alerte ! avec Dustin Hoffman. « Dans la vraie vie, elle ne vous protégerait contre aucune contagion », dit-il avec un sourire. « J’ai designé cette visière de façon à ce qu’on puisse voir le visage de Dustin quel que soit l’angle de caméra. Mais question sécurité, c’est une vraie passoire. »
Chris Gilman n’a pas toujours été attiré par le monde du cinéma. Sa première passion était pour les étoiles. Son père était patron d’une entreprise de soudure et il a travaillé sur les systèmes de survie des missions Apollo. Gilman avait 12 ans quand il a appris à souder, et il se voyait devenir soudeur jusqu’à ce que l’entreprise familiale ne frôle la ruine après la fin du programme, en 1975. À 19 ans, le jeune Chris Gilman a finalement mis les voiles et tenté sa chance à Hollywood. La première leçon qu’il a apprise sur un tournage a été déterminante pour la suite de sa carrière. « Hollywood est le royaume du faux », dit-il d’un ton catégorique. « Du moment que ça passe bien à l’image, les accessoires peuvent être de mauvaise qualité. Ce n’est pas ma façon de travailler. » C’est avec cette conviction chevillée au cœur qu’il s’est lancé à son compte et qu’il a pu faire son trou durablement, en concevant des combinaisons spatiales ultra-réalistes.
« Une véritable combinaison spatiale, c’est plus complexe qu’une grenouillère en alu surmontée d’un bocal », commente-t-il en ironisant sur celles des films de science-fiction de sa jeunesse. Ses combinaisons à lui sont criantes de réalisme. Elles sont méticuleusement classées par ordre chronologique et niveau de détails. « Celles-ci sont actuellement utilisées par les astronautes de l’ISS », dit-il. Des combinaisons blanches qu’on appelle EMU, pour Extravehicular Mobility Unit. D’autres sont brodées du logo de SpaceX. « Celles-là n’ont pas été conçues pour un film, c’est un prototype qui nous a été commandé par Elon Musk », explique-t-il d’un ton égal. Le PDG de SpaceX et Tesla aurait insisté sur le fait que les costumes devaient avoir l’air « badass ». La plupart des autres combinaisons portent le sigle bleu et rouge de la NASA.
Après que Chris Gilman a consulté les spécialistes de l’agence spatiale pour reproduire avec le plus d’exactitude possible leurs combinaisons, ils sont venus le chercher à leur tour pour en concevoir de nouvelles pour les astronautes. Gilman a alors créé une filiale baptisée Orbital Outfitters pour ses clients issus du monde de l’exploration spatiale. Son design de combinaison pour sortie extravéhiculaire (EVA) est aujourd’hui exposé au Johnson Space Center, la maison-mère des astronautes américains, où sont gérées toutes les opérations de l’ISS et du programme Orion. Cette collaboration à double sens est l’incarnation parfaite de l’histoire d’amour que vivent Hollywood et la NASA.
Une romance qui culminait il y a quelques années avec Seul sur Mars et qui a débuté il y a bien longtemps, avant même que l’homme ne marche pour de vrai sur la Lune.
Zéro G
Le premier pas a été fait par un réalisateur visionnaire. En 1964, à peine sorti de la production de Docteur Folamour, Stanley Kubrick s’attelle à la préparation de son long-métrage suivant, 2001, l’Odyssée de l’espace (1968). Soucieux de représenter sa mission spatiale de la façon la plus réaliste possible, le cinéaste se tourne vers des techniciens de la NASA pour l’aider à mettre au point son odyssée métaphysique. Il s’alloue les services de Harry Lange, ancien chef décorateur allemand à l’époque responsable de la section des futurs projets de la NASA, où il imagine des prototypes d’engins spatiaux.
Après avoir fait la connaissance d’Arthur C. Clarke, l’auteur de 2001, Lange accepte de se joindre à l’équipe. C’est à lui qu’on doit la majeure partie des décors et combinaisons spatiales du film. L’écrivain convainc également Frederick Ordway III de participer à l’aventure. Il officie pour sa part comme conseiller de la NASA au Marshall Space Flight Center. Durant le tournage, il prodigue des conseils scientifiques à Kubrick.
Mais 2001, l’Odyssée de l’espace n’est pas l’unique liaison que le réalisateur de Shining a entretenu avec l’Agence spatiale américaine. La seconde a tissé des liens plus organiques encore entre son cinéma et la NASA, malgré un sujet très éloigné des étoiles. Presque dix ans après s’être attaqué à la conquête spatiale, Kubrick entreprend le récit d’une conquête toute terrestre avec Barry Lyndon (1975). C’est à nouveau un souci de réalisme qui pousse le cinéaste à reprendre contact avec l’agence spatiale en 1972. Il veut filmer son nouveau long-métrage en lumière naturelle, sans ajouter de projecteurs. Mais à l’époque, les objectifs utilisés traditionnellement au cinéma ne sont pas assez sensibles pour que la lumière de chandeliers suffise à impressionner la pellicule.
 « Kubrick avait besoin d’un objectif ultra-sensible comme seule la NASA en utilisait à l’époque », raconte Adam Savage, animateur de l’émission MythBusters sur la chaîne Discovery. « Il leur a donc acheté le célèbre objectif scientifique de Zeiss, qui ouvrait à f/0,7, et il l’a fait monter sur une caméra Mitchell 35 mm. » Lorsque Barry Lyndon sort en salles, la beauté stupéfiante des images met la puce à l’oreille d’autres réalisateurs, qui commencent à comprendre qu’il y a un bénéfice certain à tirer de collaborations comme celle-ci. La NASA, de son côté, profite pour la seconde fois de l’aura légendaire qui entoure les films du réalisateur. C’est le début d’une lente prise de conscience. Il faudra attendre encore vingt ans avant que sorte le premier blockbuster auquel la NASA participe officiellement.
« Kubrick avait besoin d’un objectif ultra-sensible comme seule la NASA en utilisait à l’époque », raconte Adam Savage, animateur de l’émission MythBusters sur la chaîne Discovery. « Il leur a donc acheté le célèbre objectif scientifique de Zeiss, qui ouvrait à f/0,7, et il l’a fait monter sur une caméra Mitchell 35 mm. » Lorsque Barry Lyndon sort en salles, la beauté stupéfiante des images met la puce à l’oreille d’autres réalisateurs, qui commencent à comprendre qu’il y a un bénéfice certain à tirer de collaborations comme celle-ci. La NASA, de son côté, profite pour la seconde fois de l’aura légendaire qui entoure les films du réalisateur. C’est le début d’une lente prise de conscience. Il faudra attendre encore vingt ans avant que sorte le premier blockbuster auquel la NASA participe officiellement.
~
Lorsque Ron Howard entreprend la préparation du tournage d’Apollo 13 (1995), son film catastrophe avec Tom Hanks et Kevin Bacon, il veut lui aussi coller au plus près de la réalité. Et pour cause, le film est adapté de Lost Moon: The Perilous Voyage of Apollo 13, le livre écrit par le commandant de la mission James Lovell, paru 24 ans après son retour sur la terre ferme. Le cinéaste et son producteur Todd Hallowell tiennent absolument à ce que l’impression d’apesanteur soit réaliste. Mais à l’époque, près de vingt ans avant Gravity, il n’existe pas de moyen de simuler un environnement en gravité zéro de façon réaliste. Le bruit a couru pendant un temps qu’ils avaient utilisé une chambre anti-gravité de la NASA, ce qui fait encore rire Hallowell.
« C’est une légende urbaine. Je me demande toujours comment les gens ont pu croire qu’une telle chambre existait et fonctionnait réellement », raconte-t-il aujourd’hui. En 1995, il n’existait que deux moyens d’échapper à la gravité : ou bien monter à bord d’une fusée, ou bien à bord d’un avion KC-135A de la NASA. L’appareil est entré en service l’année de la préparation du tournage, en 1994, et il a effectué son dernier vol dix ans plus tard, en octobre 2004. Utilisé pour plonger les astronautes en apesanteur durant leur entraînement, il dessinait des paraboles à 45° dans les airs durant lesquelles l’équipage échappait à la gravité pendant environ 25 secondes, avant de soudainement retomber contre ses parois matelassées. « Chaque vol comptait entre 40 et 60 paraboles », disent les archives de la NASA. La presse lui avait à l’époque attribué le surnom de Vomit Comet, pour des raisons évidentes. Les acteurs d’Apollo 13 ont réalisé au total plus de 1 500 paraboles au cours du tournage.
Des trois acteurs principaux du film, Kevin Bacon était le moins partant pour tenter l’expérience. « Je ne sais pas si une recherche de réalisme aussi approfondie est nécessaire », disait-il à Ron Howard, d’après les souvenirs de Todd Hallowell. Mais quand le cinéaste lui a répondu que les deux autres étaient impatients de se lancer dans l’aventure, il n’a pas voulu passer pour le dégonflé de la bande et a cédé. L’équipe s’est ensuite adressée à Bob Williams, qui était alors en charge du programme de vols en gravité réduite de la NASA. Il n’était pas très enthousiaste à l’idée de les rencontrer. « On s’attendait à voir débarquer une bande de divas hollywoodiennes », se rappelle-t-il. Mais la méfiance des scientifiques a rapidement laissé place à la stupéfaction face à la ténacité et la discipline des acteurs, loin des stars capricieuses qu’ils redoutaient d’avoir à supporter.
Néanmoins, l’agence craignait que le fait d’évoquer l’échec d’une mission ne nuise à son image. Pris au piège de leur vaisseau, les trois astronautes avaient dû se réfugier dans le module lunaire de la fusée, qui n’était pas prévu pour accueillir aussi longtemps la vie humaine. Il a fallu un courage immense à l’équipage pour conserver leur calme et faire face à la situation, tandis que les équipes au sol faisaient le nécessaire pour les ramener sur Terre sain et sauf.
Finalement, l’histoire a connu un happy end : Jim Lovell et ses coéquipiers ont été secourus et s’en sont tirés sans dommages. Une histoire rocambolesque mais au final peu reluisante pour la NASA. Malgré cela, Ron Howard est parvenu à les convaincre de l’aider en se proposant de l’aborder sous l’angle du triomphe de la volonté et de l’ingéniosité humaines. L’excellente réception du film a achevé de convaincre la NASA qu’il y avait des bénéfices considérables à tirer de sa participation à des œuvres de divertissement.
Vingt ans plus tard, au moment de collaborer à nouveau avec Ron Howard pour la série docu-fictionnelle Mars (2016), l’Agence spatiale américaine est dotée d’un service sélectionnant les projets de films auxquels elle apporte son concours : rien de tel qu’un héros hollywoodien pour inscrire ses objectifs dans l’imaginaire collectif.
Vers Mars et au-delà
Depuis sa création en 1958, après la promulgation par Eisenhower du premier Space Act, l’Agence spatiale américaine a pour devoir de disséminer autant que possible les informations concernant ses activités et ses objectifs. Mais ce n’est qu’après le succès d’Apollo 13 que l’administration Clinton a eu l’idée de créer un service de liaison multimédia en bonne et due forme à la NASA. « Notre mission est essentiellement de raconter les histoires de l’agence de façon divertissante », résume Bert Ulrich, à la tête du service depuis 2005. « Je n’appellerais pas cela de la propagande, mais on essaie d’inspirer les enfants en les faisant regarder vers les étoiles. »
Les producteurs contactent souvent d’eux-mêmes l’agence pour les besoins du tournage. C’était notamment le cas du premier volet d’Avengers, dont la séquence d’ouverture se déroule au « NASA Space Radiation Facility » – imaginé pour le film. Lorsque Bert Ulrich a reçu le scénario, il a répondu à l’équipe du film que la NASA ne pouvait accepter leur demande car le script ne contenait aucune référence explicite à l’agence. Plutôt que de chercher un autre endroit où tourner les scènes, les scénaristes de la production Marvel ont remanié les premières pages du scénario pour y mettre la NASA en évidence. L’agence leur a alors permis l’accès au centre d’essai de Plum Brook Station.
« De cette façon, tout le monde y gagne », explique Bert Ulrich. « Nous sommes une institution gouvernementale, nous ne pouvons pas autoriser de tournage sans raison valable. » Et la portée culturelle d’un blockbuster tel qu’Avengers est une raison très valable pour l’Agence spatiale américaine.
Pour autant, les bénéfices de la NASA ne se mesurent pas en termes financiers. Lorsqu’une production a recours aux services de la NASA, elle signe un accord de remboursement des coûts occasionnés par le tournage à l’État. L’agence n’investit pas dans la production, elle mise sur la portée culturelle du cinéma pour ancrer son image dans l’imaginaire du public, partout dans le monde. Ce qui explique qu’elle refuse de participer à certains projets, comme Life. D’autres, comme Seul sur Mars de Ridley Scott (2015), sont accueillis à bras ouverts. « Ridley Scott voulait raconter son histoire de la façon la plus réaliste possible », raconte Bert Ulrich. C’est la raison pour laquelle il a sollicité les services de la Planetary Sciences Division, dont les scientifiques étudient les planètes et autres corps célestes du système solaire, et notamment Mars.
L’imagerie du film regorge de références à la NASA, et l’équipe du film a bénéficié de nombreux conseils de la part des scientifiques de l’agence spatiale. « Nous sommes très ouverts », insiste Bert Ulrich, soucieux de ne pas laisser imaginer que l’institution exerce un contrôle sur les films. « Il y a une violente tempête de poussière au début de Seul sur Mars. Comme ce n’est pas très réaliste, nous leur avons conseillé de la changer en orage électrique », raconte-t-il. « Mais Ridley Scott tenait à préserver cet aspect du livre, et nous le comprenons très bien. » Malgré cela, c’est probablement l’envie de garder un contrôle artistique total qui a poussé les réalisateurs de Gravity et Interstellar à refuser le concours de la NASA. Car le processus est à double sens. « Si nous entendons parler d’un film qui touche à des sujets touchant à la NASA, il arrive que nous prenions contact nous-mêmes avec la production », poursuit Bert Ulrich.
C’est ce qui est arrivé dans le cas de Gravity et Interstellar. Mais dans les deux cas, les cinéastes ont décliné la proposition. « Je crois qu’Alfonso Cuarón était soucieux d’avoir entièrement la main sur le film », avance-t-il. « Il se trouve que le film est très réaliste à l’arrivée, mais il redoutait sûrement que nous ne pointions certaines incohérences du doigt. » D’après Chris Gilman, de Global Effects, c’est justement d’un certain manque de réalisme dont souffre le blockbuster de Christopher Nolan. « C’est quand même dommage de mettre autant de soin à écrire un scénario pour partir dans l’espace en pyjamas », dit-il en riant. Dans les deux cas, la NASA a néanmoins permis aux films d’utiliser son imagerie.
L’impact réel de ces collaborations ne peut évidemment pas être précisément mesuré, mais Bert Ulrich affirme que la NASA est actuellement au sommet d’une vague de popularité. Après une traversée du désert au début des années 2000, les missions de la NASA (de Mars à la découverte d’exoplanètes) n’ont jamais provoqué tant d’engouement chez le public. « Nous participons à plus de 100 documentaires chaque année ; nous sommes très heureux du succès des Figures de l’ombre ; et j’attends le scénario du prochain film du réalisateur de La La Land – un biopic sur Neil Armstrong avec Ryan Gosling », dit-il. « Il y a une vraie soif d’exploration spatiale et de découverte scientifique chez la jeune génération. »
Un intérêt que la NASA s’échine à entretenir, notamment par le biais de la télévision et du cinéma. Ils nourrissent ainsi l’espoir d’inspirer la jeunesse américaine et de préserver leurs budgets. Jusqu’ici, la stratégie s’est avérée payante. Le 21 mars 2017, après avoir limité la casse quant aux coupes que l’agence spatiale redoutait, le président Donald Trump a signé le NASA Transition Authorization Act pour 2017, projetant notamment de poser le pied sur Mars d’ici 2030. Il a sûrement adoré Seul sur Mars.
Couverture : Le faux équipage de la NASA dans The Martian, de Ridley Scott.
COMMENT LA NASA A INVENTÉ LE PREMIER ORDINATEUR MODERNE
Un hacker raconte le sauvetage du premier micro-ordinateur envoyé dans l’espace par la NASA. Leur exploit technologique allait donner naissance à l’informatique moderne.
I. Apollo 1
D’aussi loin que je me souvienne, j’ai toujours été passionné d’électronique et de programmation. Je viens de Tshwane, en Afrique du Sud, et mon nom est Francois Rautenbach. Je me décris souvent comme un « hacker perpétuel » : je n’aime rien tant que de percer les mystères du fonctionnement des ordinateurs. Et pour ça, il faut vraiment se plonger dans leurs entrailles et déchiffrer la façon dont leurs éléments fonctionnent ensemble. Il y a environ deux ans, j’ai lu un livre à propos de l’Apollo Guidance Computer, écrit par l’historien de la NASA Frank O’Brien. Il expliquait comment cet ordinateur de navigation révolutionnaire avait été inventé dans les années 1960, et détaillait son fonctionnement. Je me suis pris de passion pour cette machine et je l’ai finalement sauvée de la destruction alors que son possesseur s’apprêtait à le jeter à la casse…  Il existait d’autres ordinateurs avant l’Apollo Guidance Computer mais aucun d’eux n’était fabriqué à base de circuits intégrés. Ils étaient composés de transistors et il n’était pas réellement possible de les reprogrammer. Ces machines encombrantes sont considérées comme les premiers ordinateurs de l’histoire, mais ils ne ressemblaient pas aux ordinateurs modernes à puces électroniques. Le relais électromécanique a été inventé dans la première moitié du XIXe siècle. À partir de ce moment-là, la technologie a évolué jusqu’à produire les transistors utilisés sur les premiers ordinateurs, un siècle plus tard. Mais ceux d’alors ne pouvaient pas être miniaturisés. Grâce aux circuits intégrés, les ordinateurs d’aujourd’hui contiennent facilement des milliards de transistors – et bien plus dans les processeurs les plus récents. C’était impossible avant l’invention des circuits intégrés, car on ne pouvait pas les miniaturiser ni les rendre plus rapides. Tout a changé avec l’apparition du silicone et des premiers processeurs. Le circuit intégré utilisé sur l’ordinateur Block I comprenait trois transistors et quatre résistances montés sur une puce. Il s’agissait de la plus petite puce concevable à l’époque – la toute première de l’histoire.
Il existait d’autres ordinateurs avant l’Apollo Guidance Computer mais aucun d’eux n’était fabriqué à base de circuits intégrés. Ils étaient composés de transistors et il n’était pas réellement possible de les reprogrammer. Ces machines encombrantes sont considérées comme les premiers ordinateurs de l’histoire, mais ils ne ressemblaient pas aux ordinateurs modernes à puces électroniques. Le relais électromécanique a été inventé dans la première moitié du XIXe siècle. À partir de ce moment-là, la technologie a évolué jusqu’à produire les transistors utilisés sur les premiers ordinateurs, un siècle plus tard. Mais ceux d’alors ne pouvaient pas être miniaturisés. Grâce aux circuits intégrés, les ordinateurs d’aujourd’hui contiennent facilement des milliards de transistors – et bien plus dans les processeurs les plus récents. C’était impossible avant l’invention des circuits intégrés, car on ne pouvait pas les miniaturiser ni les rendre plus rapides. Tout a changé avec l’apparition du silicone et des premiers processeurs. Le circuit intégré utilisé sur l’ordinateur Block I comprenait trois transistors et quatre résistances montés sur une puce. Il s’agissait de la plus petite puce concevable à l’époque – la toute première de l’histoire.
IL VOUS RESTE À LIRE 90 % DE CETTE HISTOIRE
L’article Les secrets de la bromance entre Hollywood et la NASA est apparu en premier sur Ulyces.
17.04.2023 à 14:55
La Troisième Guerre mondiale va-t-elle commencer à Taïwan ?
Ulyces
14 mars 2022. Le ministère de la Défense taïwanais est en alerte. La matinée vient à peine de s’achever, et déjà, treize avions militaires chinois ont pénétré la zone d’identification de défense aérienne de l’île. Taïwan est coutumière de ces démonstrations de force. La petite île, qui porte aussi le nom de République de Chine […]
L’article La Troisième Guerre mondiale va-t-elle commencer à Taïwan ? est apparu en premier sur Ulyces.
Texte intégral (3356 mots)
14 mars 2022. Le ministère de la Défense taïwanais est en alerte. La matinée vient à peine de s’achever, et déjà, treize avions militaires chinois ont pénétré la zone d’identification de défense aérienne de l’île. Taïwan est coutumière de ces démonstrations de force. La petite île, qui porte aussi le nom de République de Chine (RDC) depuis que s’y sont installés des dissidents chinois en exil en 1949, souhaite que son indépendance soit reconnue mondialement. Mais la République populaire de Chine (RPC) la voit toujours comme l’une de ses provinces. Taïwan n’a pourtant jamais été gouvernée par sa grande voisine, ce qui fait dire à quelques États membres de l’ONU – 14 sur 192 – qu’elle est un État indépendant – avec son propre gouvernement, ses frontières et sa souveraineté.
Chaque jour ou presque, le site du ministère égrène le type et le nombre d’avions envoyés par le gouvernement chinois pour tester son espace aérien. Pour faire face à toute éventualité, les appareils qui y entrent doivent être rapidement identifiés, localisés et contrôlés. Mais depuis deux ans, la Chine met une telle pression – 969 violations comptabilisées pour la seule année 2021, selon une base de données de l’AFP ; du jamais-vu – que le matin même, un avion taïwanais s’est abîmé en mer de Chine lors d’un entraînement de défense. C’est le sixième depuis 2020… Si l’accident n’a pas fait de victime, deux autres pilotes ont péri par le passé, et trois n’ont jamais été retrouvés.

Des avions de chasse chinois en plein entraînement
Crédits : China Military Online
Ces incidents font craindre une escalade dans le conflit entre la République populaire de Chine et Taïwan. D’autant que les principaux intervenants ne semblent pas disposés à faire la moindre concession. « Il n’y a qu’une seule Chine dans le monde, et Taïwan est une partie inaliénable de son territoire », a ainsi tenu à rappeler Zhao Lijian, l’un des porte-paroles du ministère des Affaires étrangères chinois, en conférence de presse dans l’après-midi du 14 mars. Il s’est ensuite adressé aux États-Unis, principaux soutiens de l’île : « Nous avertissons formellement le gouvernement américain : jouer la “carte de Taïwan”, c’est comme jouer avec le feu. »
La menace fait écho à l’engagement formulé par Joe Biden, le 21 octobre 2021, de défendre l’île militairement s’il le fallait. Un engagement renouvelé et réaffirmé le 23 mai 2022 lors d’une visite au Japon, pendant laquelle le président américain a déclaré que les États-Unis « seraient forcés d’engager la force militaire si la Chine venait à envahir Taïwan ». La situation politique entre la Chine et Taïwan crée dans l’esprit des observateurs un parallèle avec la situation actuelle en Ukraine, où la guerre lancée par la Russie de Vladimir Poutine fait rage, depuis le 24 février dernier. L’invasion du voisin russe pourrait inspirer à la Chine des velléités guerrières. De quoi réveiller la crainte d’un possible conflit généralisé.
Instabilité
Taïwan a une histoire complexe. L’île a connu de nombreux changements successifs de gouvernance. Colonisée par les Espagnols dès 1626, la “Belle Île” est passée aux mains des Néerlandais, puis des Chinois de la dynastie Qing, avant d’être finalement cédée à l’empire du Japon, en 1895. Défaits en 1945, les Japonais remettent Taïwan à l’ONU, qui confie à son tour la stabilisation de l’île à la République de Chine (RDC) gouvernant le continent voisin à l’époque. En 1949, la victoire des communistes de Mao Zedong et la création de la République populaire de Chine (RPC) transforment le statut de l’île : deux millions de dissidents de la RDC s’y réfugient, rejoignant les populations natives ; et s’en emparent.
Le soutien des États-Unis date de cette période : en 1950, la guerre de Corée les décide à protéger l’île d’un possible débarquement communiste, en interposant leur flotte. Les américains continuent de reconnaître le régime en place comme étant le seul légitime jusqu’en 1979, date à laquelle ils transfèrent leur ambassade à Pékin et retirent leurs forces de Taïwan. En contrepartie, le Congrès américain vote le Taiwan Relations Act, une loi délibérément ambiguë visant à empêcher une déclaration d’indépendance unilatérale de Taïwan, ou au contraire, une annexion de l’île par la Chine. Bien qu’elle ne garantisse pas l’intervention militaire américaine en représailles d’une invasion, elle autorise Washington à fournir à l’île des moyens de se défendre contre une réunification forcée.

Vue aérienne de l’île de Taïwan et des côtes chinoises
Crédits : Gallo Images
Xi Jinping, arrivé au pouvoir en 2013, a rendu plus agressive la posture de la Chine vis-à-vis de Taïwan. Comme Vladimir Poutine, il a la volonté farouche de restaurer la grandeur d’un ancien empire qui aurait été dépossédé de ses terres. Par la force, s’il le faut. Dans son discours à la nation russe du 21 février, annonciateur de l’invasion en Ukraine à venir, le chef du Kremlin a d’ailleurs commencé son allocution par des mots très proches de ceux qu’emploie régulièrement le gouvernement chinois : « Pour la Russie, l’Ukraine n’est pas seulement un pays voisin, c’est une partie indivisible de notre histoire, de notre culture, de notre espace spirituel. »

Le président chinois Xi Jinping
Crédits : OMS
Avec une différence notable, qui a gêné la Chine lors de sa déclaration de soutien à la Russie, face à l’Occident : en fin de discours, Vladimir Poutine a reconnu l’indépendance et la souveraineté des États sécessionnistes ukrainiens de Donetsk et de Louhansk, alors même que la République populaire s’oppose, elle, à l’indépendance taïwanaise. Cette nuance contraint Pékin à endosser un rôle d’équilibriste, au lendemain de l’offensive lancée par Poutine. Le gouvernement chinois refuse de parler d’invasion et souligne sa « compréhension » des inquiétudes russes pour leur sécurité territoriale. Mais il se garde bien de soutenir l’intervention. « La Chine s’est volontairement mise en retrait pour analyser la gestion russe de l’opération et la réponse des Occidentaux », résume Marc Julienne, chercheur et responsable des activités Chine à l’Institut français des relations internationales (IFRI). « Elle a été surprise du soutien massif à l’Ukraine et des mesures de rétorsion très fortes contre la Russie, mais cela lui permet d’anticiper de futures sanctions financières en cas de reprise armée de Taïwan. » Autrement dit, ses objectifs vis-à-vis de l’île restent inchangés.
Rôle essentiel
Car au-delà des prétentions géographiques et historiques, Taïwan, comme l’Ukraine, a une réelle importance stratégique et économique. Ce n’est pas un hasard si les deux territoires cristallisent les tensions entre le “bloc de l’Est”, mené par la Chine et la Russie, et le “bloc de l’Ouest”, dirigé par les États-Unis, adversaire commun des deux superpuissances. L’Ukraine est un couloir naturel entre l’Eurasie et l’Europe de l’Ouest. Elle offre un accès privilégié à la mer Noire et permet au gaz russe d’être acheminé vers l’Ouest par gazoduc. Et si Taïwan semble n’être qu’un petit territoire perdu en mer de Chine méridionale, l’île est bien plus que cela.
« Dans le bassin Indo-Pacifique, Taïwan est fondamental », souligne Yann Roche, président de l’Observatoire de géopolitique de la Chaire Raoul-Dandurand, à Montréal. « C’est la clé pour sortir du littoral chinois en évitant les territoires des alliés des États-Unis. » Dans cette zone géographique qui comprend l’océan Indien et la partie occidentale de l’océan Pacifique, le géant asiatique est en effet bien seul. Au Sud, les Philippines, l’Indonésie et la Malaisie bloquent le passage. À l’Est, le Japon et la Corée du Sud, alliés traditionnels de Washington, occupent l’espace. Cette “première chaîne d’îles” l’empêche de patrouiller dans l’océan Pacifique et de menacer les côtes américaines de ses sous-marins nucléaires. Pour la Chine comme pour les États-Unis, Taïwan fait donc figure de passage géo-stratégique essentiel.
Le petit État a d’autres atouts. Économiquement, c’est l’une des plus grandes puissances d’Asie. C’est surtout le principal producteur de semiconducteurs – des composants électroniques – dans le monde, et de loin. L’île fabrique environ 70 % de ces puces indispensables à la production de tout objet électronique, des smartphones au matériel médical. Le marché est prospère ; il représentait 583 milliards de dollars (environ 530 milliards d’euros) en 2021, selon l’entreprise américaine de conseil et de recherche Gartner. Au point que certains pays d’Europe – Allemagne et France en tête – sont entrés en discussion avec Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), la plus importante fonderie de semiconducteurs de l’île, pour que celle-ci implante des usines sur le vieux continent.
Les États-Unis aussi s’intéressent de près à ce secteur de l’industrie taïwanaise. Car le marché peut provoquer des fluctuations économiques importantes dans les domaines technologiques. Dès 2020, un ralentissement de la production dû à la pandémie de Covid-19 avait entraîné une pénurie des puces. La fabrication de certains produits, comme les cartes graphiques ou les voitures, avait été réduite ou stoppée, et leurs prix s’étaient envolés. Un levier de pression très utile que la Chine perdrait si l’indépendance de l’île, couplée à un rapprochement des États-Unis et de l’Europe, était actée. À l’évidence, Xi Jinping est résolu à récupérer ces avantages, lui qui appelle régulièrement à la « réunification complète de la patrie ». Quitte à ce qu’en mer de Chine méridionale, la tension reste à son comble.
Conflit international
« Seul un engagement militaire massif des États-Unis pourrait, en cas de guerre, sauver l’île », juge Jean-Pierre Cabestan, auteur du livre « Demain la Chine, guerre ou paix ? » Mais de l’autre côté de l’océan Pacifique, le colosse américain a perdu de sa superbe. Les interventions successives à l’étranger – comme en Irak ou en Afghanistan –, souvent impopulaires et ratées, ont écorné son image aux yeux du monde. « Le passé a prouvé que malgré leur impressionnante puissance militaire, il restait difficile pour les États-Unis de gagner des guerres terrestres », analyse Yann Roche. Et le mandat de Donald Trump à Washington a amplifié la volonté, chez les Républicains notamment, « d’arrêter d’être les protecteurs du monde aux frais de la nation. » Le pays de l’Oncle Sam semble douter, et ses prises de positions timorées lors de l’invasion de l’Ukraine ne sont pas pour rassurer ses alliés. Il n’est pas dit que Joe Biden arrive à un consensus total du Congrès en faveur d’une option militaire, si le conflit à Taïwan dégénérait.
Pour autant, l’actuel locataire de la Maison-Blanche continue d’assurer Tsai Ing-wen, la présidente taïwanaise, du soutien de son pays. Depuis sa promesse du 21 octobre de défendre l’île militairement face à la Chine, sa position et son discours n’ont pas changé. Ils ont même été renforcés par la récente déclaration du 23 mai, lors de sa visite au Japon. La crise ukrainienne a même raffermi les liens entre Washington et Taipei, confirmant l’allié américain dans son rôle de plus important soutien de l’île à l’international. En Europe, le discours du président n’avait pas été le même. Biden avait assuré, dès le début de l’attaque russe, ne pas vouloir faire intervenir son armée. Du moins, tant que Poutine « ne s’installe pas dans les pays de l’OTAN ». Preuve s’il en est que l’intérêt stratégique des États-Unis se trouve ailleurs.
Et raison de plus, pour la Chine, de s’agacer de cette alliance. Elle exprime fréquemment « son vif mécontentement » pour ce qu’elle considère être « de l’ingérence dans ses affaires intérieures ». Au point de multiplier les passages de ses porte-avions dans les eaux du détroit de Taïwan, qui sépare l’île de la Chine continentale. Le jeu est risqué pour les deux camps : en mer de Chine méridionale, les américains mènent eux aussi des « Opérations pour la liberté de la navigation », les Fonops (Freedom of navigation Operations). Leurs navires de guerre parcourent la zone maritime, s’appliquant à « exercer et faire respecter les droits et libertés de navigation à l’échelle mondiale », comme le rappelle le département d’État nord-américain. À force d’intimidation et de provocations de part et d’autre, le risque d’accrochages ou d’affrontements accidentels augmente.

Un navire de guerre américain dans le détroit de Taiwan
Crédits : US Navy
Le début d’un conflit plus étendu, aussi. « Si les deux superpuissances mondiales venaient à s’engager militairement, de nombreux pays suivraient », pressent Marc Julienne. À commencer par le Japon et l’Australie, membres du Quad, une alliance militaire dont les États-Unis et l’Inde font aussi partie ; ou la Corée du Sud. Le Premier ministre australien, Scott Morrison, a abordé frontalement le sujet, le 3 mars, au sortir d’une de leurs réunions virtuelles : « On ne peut pas autoriser que ce qui se passe en Ukraine puisse un jour se produire dans l’Indo-Pacifique. » Dans l’hypothèse d’un conflit, la réponse sera internationale.
Dans ces conditions, il paraît peu probable que Pékin lance une opération militaire à Taïwan dans l’immédiat. La Chine a peu d’alliés, le plus important d’entre eux étant déjà sur le front de guerre en Ukraine. Difficile d’imaginer l’Iran, le Pakistan ou la Corée du Nord peser dans une guerre qui serait mondiale, même si les deux derniers possèdent l’arme nucléaire et que Pyongyang a repris ses tirs de missiles balistiques intercontinentaux le 24 mars dernier – une première depuis 2017. Et ces partenariats sont encore loin des alliances américaines, qui impliquent des clauses de défense mutuelle, et des accords de bases et de manœuvres militaires conjointes. Elle-même manque de ravitailleurs en vol et de bateaux amphibies pour transporter ses véhicules militaires.
Mais la Chine se prépare, elle modernise et renforce son armée. Tout au long des années 2000, elle n’a eu de cesse d’augmenter son budget de la défense – près de 10 % supplémentaires chaque année, en moyenne, comptabilise le géopolitologue Pascal Le Pautremat dans la Revue Défense Nationale. Ce qui a fait dire au général Mark Milley, chef d’État-Major des armées américaines, lors de son audition au Congrès du 17 juin 2021, qu’il tablait sur une fin des préparations chinoises à l’horizon 2027-2035. « Le ministre de la Défense taïwanais, Chiu Kuo-cheng, prévoit même une possibilité d’invasion “totale” de l’île d’ici 2025 », acquiesce Marc Julienne, avant de s’exclamer : « En terme d’horizon stratégique, autant dire que c’est demain. » D’ici là, il est fort probable que la Russie aura fini sa campagne ukrainienne, dont on se rappellera peut-être, qui sait, qu’elle a été le premier acte du basculement du monde vers une troisième grande guerre.
Couverture : Reuters
L’article La Troisième Guerre mondiale va-t-elle commencer à Taïwan ? est apparu en premier sur Ulyces.
22.03.2023 à 13:14
Tragédies en série et folie meurtrière : la vérité sur la malédiction des Power Rangers
Pablo Oger
Samedi dernier, Jason David Frank, pratiquant d’arts martiaux et « force verte » de la série Power Rangers, est retrouvé sans vie à son domicile. L’enquête suggère un suicide. « Il était une source d’inspiration pour tant de personnes. Sa présence nous manquera énormément. C’est si triste de perdre un autre membre de notre famille de […]
L’article Tragédies en série et folie meurtrière : la vérité sur la malédiction des Power Rangers est apparu en premier sur Ulyces.
Texte intégral (2908 mots)
Samedi dernier, Jason David Frank, pratiquant d’arts martiaux et « force verte » de la série Power Rangers, est retrouvé sans vie à son domicile. L’enquête suggère un suicide. « Il était une source d’inspiration pour tant de personnes. Sa présence nous manquera énormément. C’est si triste de perdre un autre membre de notre famille de Rangers », a déclaré Walter Jones, qui jouait le rôle du Ranger noir dans la série. Ce n’est malheureusement pas la première fois que le casting de Power Rangers perd l’un de ses membres.
Dans la nuit du 3 septembre 2001, sur l’autoroute séparant San Francisco de Los Angeles, les roues d’une voiture heurtent le gravier le long de la route. La conductrice perd soudainement le contrôle et le véhicule fait un violent écart, fonçant droit dans la paroi rocheuse qui borde l’autoroute. Après plusieurs tonneaux, la voiture traverse la chaussée, finissant sa course contre un second mur de pierre. À son bord, trois jeunes femmes se trouvent dans un état critique. Deux d’entre elles sont sauvées par les secouristes, mais Thuy Trang, 27 ans, meurt avant d’arriver à l’hôpital.
Quelques années avant sa mort tragique, l’Américaine originaire du Vietnam débutait sa carrière d’actrice. Et pour son premier rôle important, elle incarnait Trini Kwan, la Ranger jaune de la série originale Mighty Morphin Power Rangers. À ses funérailles, les autres Rangers sont venus lui rendre hommage.

Thuy Trang jouait Trini Kwan, la Ranger jaune
Crédits : Power Rangers Tempestade Ninja
« Je me souviens que Thuy était toujours blessée sur le plateau », racontait plus tard le Ranger vert Jason David Frank. « Elle se donnait à fond, alors parfois il lui arrivait des bricoles. Je me souviens qu’on a souvent dû la porter à cause de ses blessures. Elle était toujours positive et donnait le meilleur d’elle-même. »
Ensemble dès le jour du casting, les deux jeunes acteurs s’entendaient à merveille. Mais Jason n’a pas pu assister aux funérailles de son amie, car il s’occupait encore des affaires de son grand frère Erik Frank, décédé lui aussi quelques mois plus tôt. Ce dernier avait failli décrocher le rôle du Ranger doré. Ces deux disparitions ne représentent qu’une fraction des tragédies qui ont frappé les acteurs de la série. Ce qui fait murmurer à Internet qu’ils ont été les victimes d’une bien étrange malédiction : la malédiction des Power Rangers.
Série noire
Peu de gens le savent, mais Erik Frank a fait ses débuts dans la franchise derrière la caméra. Il est ensuite passé sous les projecteurs, pour devenir le frère perdu du personnage de Tommy Trueheart, interprété par son petit frère dans la série originale, puis dans Power Rangers : Zeo. L’essai avait été concluant, et Erik aurait dû rejoindre le casting permanent pour de futures saisons. Malheureusement, il a succombé à une maladie le 16 avril 2001 à l’âge de 29 ans, sans que son frère Jason ne souhaite donner plus de précisions. La nouvelle a bouleversé les fans de la série, qui espéraient voir le duo réuni à nouveau. Des années plus tard, l’acteur soulignait encore le manque laissé par la tragédie, dans sa vie comme dans l’univers des Power Rangers.
Le 25 mai 2017, Jason a cru à son tour que sa fin était venue. Alors qu’il participait à la Comic-Con de Phoenix, l’acteur a été la cible d’un homme en tenue de Punisher, le justicier ultra-violent de l’univers Marvel. L’assaillant était armé d’un fusil à pompe, de trois pistolets, de shurikens et d’un couteau de combat. Il a finalement été maîtrisé par la police avant d’avoir pu approcher le Ranger vert. Sur son téléphone, le suspect avait un rappel pour le jour-même indiquant : « Tuer JDF. »

Jason David Frank, le Ranger vert
Quatre ans plus tard, Jason David Frank se porte bien. Sa carrière d’acteur a beau être au point mort, à l’exception du tournage du fanfilm Legend of the White Dragon, il a au moins la vie sauve. Au vu du nombre de malheurs qui se sont abattues sur la saga télévisée, ce n’est pas rien.
Ainsi le 11 mai 2019, l’acteur Pua Magasiva s’est suicidé dans une chambre d’hôtel de Wellington. Ses fans sous le choc ont alors appris la dure vérité sur le Ranger rouge de Power Rangers Ninja Storm. La veuve de Pua a révélé toute l’horreur de sa relation abusive avec l’acteur, aboutissant à une agression brutale contre elle la nuit de sa mort.
Alors que les réseaux sociaux du couple laissaient penser qu’ils vivaient une romance digne d’un conte de fées, elle et sa fille vivaient dans la peur de la violence et des abus émotionnels. Elle a déclaré avoir été victime à trois reprises de commotions cérébrales sous les coups du Ranger, qui aurait aussi menacé de faire du mal à sa fille Laylah. Quelques minutes avant sa mort, l’acteur l’a attaquée dans une rage ivre, lui a cogné la tête contre une table et l’a laissée inconsciente et en sang. Lorsqu’elle a repris connaissance, Pua était mort.

Pua Magasiva, ancien Ranger rouge
D’autres acteurs de la série ont pour leur part succombé à des maladies à un jeune âge. Dix-neuf ans plus tôt, en 2000, Bob Manahan, qui était au casting des quatre premières séries, est mort d’une crise cardiaque. La voix de Zordon, le mentor des Rangers, s’est pour sa part éteinte à l’âge de 44 ans. Son collègue Bob PapenBrook, qui disait les répliques de Rito Revolto, un des super-vilains, est quant à lui décédé d’une maladie pulmonaire chronique en mars 2006, à tout juste 50 ans. Quelques mois plus tard, c’était le tour d’Edward Albert. Après avoir tenu le rôle M. Collins dans Time Force, il est décédé à 55 ans d’un cancer du poumon. Et la liste est encore longue.
L’acteur Richard Genelle est mort deux ans après à l’âge de 47 ans. Le comédien qui incarnait Ernie, un allié des Power Rangers jusque dans la troisième série, a succombé à une crise cardiaque le 3 décembre 2008. Puis, quatre ans après sa première apparition en tant que Ranger blanc, ce fut au tour de Peta Rutter d’apprendre qu’elle avait une tumeur au cerveau. Elle s’est alors rapidement affaiblie, et a fini par perdre son combat le 20 juin 2010. Elle n’avait que 51 ans.
Ces trop nombreuses coïncidences tragiques ont ancré dans la tête d’une partie des fans que la franchise était victime d’une malédiction. Sa manifestation la plus effroyable (et grotesque) est sans conteste l’affaire du Power Ranger rouge.
Red Is Dead
Mais avant d’en venir à l’histoire macabre du Ranger rouge, notons qu’un autre acteur aperçu dans la série originale a été impliqué dans une sordide histoire. Lorsqu’il avait 14 ans, en 1994, Skylar Julius Deleon est apparu dans l’épisode « Seconde Chance ». Puis au début des années 2000, l’ancien enfant acteur est l’auteur d’une série de meurtres horribles. Aujourd’hui âgé de 41 ans, il est emprisonné dans le couloir de la mort, condamné à l’injection létale.
En 2009, il avait été arrêté pour le double homicide de Thomas et Jackie Hawks. Cherchant à acquérir un yacht, il est entré en contact avec le couple. Pour les convaincre de sa bonne foi, il leur a même présenté sa femme et sa fille d’un an. Lors d’une sortie suivante, l’acteur et deux complices ont maîtrisé le couple et les ont forcés à céder la propriété du bateau. Ils ont ensuite attaché le vieux couple à l’ancre, avant de les jeter dans l’océan Pacifique. Leurs corps n’ont jamais été retrouvés.
Skylar a également été reconnu coupable du meurtre de John Jarvi, en 2003. Il avait rencontré l’homme en prison, après avoir été arrêté pour cambriolage. Mais pour ne pas lui rembourser les 50 000 dollars qu’il lui avait empruntés, il a décidé de l’égorger et de laisser son corps au bord d’une route mexicaine. Un triple homicide sans lien avec la série, sinon sa brève apparition dans le show des années plus tôt. Ce n’est pas le cas de Ricardo Medina.
L’acteur Ricardo Medina Jr., qui a joué le Ranger rouge dans plusieurs séries Power Rangers, s’est lui aussi rendu coupable d’un meurtre violent. Le soir du Nouvel An 2015, il a brutalement assassiné son colocataire avec une réplique de l’épée de Conan le Barbare. L’acteur a d’abord affirmé qu’il avait agi en état de légitime défense. Mais il a finalement accepté de plaider coupable d’homicide volontaire plutôt que de risquer une condamnation à perpétuité.

Ricardo Medina Jr. dans son rôle de Ranger rouge
Crédits : Power Rangers Wild Force
Selon la police, Medina et sa petite amie étaient dans leur chambre quand Joshua Sutter est entré de force. L’acteur l’a alors poignardé avec la lame qu’il gardait derrière sa porte. Mais la version du comédien n’a pas semblé assez convaincante. « Il a choisi de tuer mon frère au lieu des nombreuses options que toutes les personnes rationnelles auraient prises », a déclaré la sœur de Sutter, devant le tribunal. « Il a choisi de tuer pour prendre une vie. »
Coïncidence macabre, les épées étaient l’arme de choix du personnage de Medina dans Power Rangers Samurai, de 2010 à 2012. Ricardo Medina Jr. a finalement écopé de six ans de prison et devrait être libéré cette année.
La rançon d’être un Ranger
Selon toute probabilité, cette collection de drames est totalement fortuite et ils sont si divers que leurs causes le sont aussi. Mais ils attirent l’œil sur un univers professionnel ultra-exigent et plein de désillusions, qui a pu favoriser certaines tragédies. Car être un Power Ranger n’est pas qu’une partie de plaisir, et l’implication demandée aux acteurs est pointée du doigt. Pour intégrer le show, les Rangers se devaient d’être des athlètes accomplis, ainsi que des experts des arts martiaux. Et il leur a fallu garder cette forme physique des années durant.
Il n’était d’ailleurs pas rare que des acteurs se blessent, à l’image de Thuy Trang. Selon certains témoignages, les conditions de travail étaient parfois à la limite de l’acceptable, et le rythme infernal. « Je rentrais à la maison et je tombais de sommeil, donc je ne retournais pas les appels manqués et certaines personnes ont pensé que j’avais changé », confie le Ranger noir Walter Emanuel Jones. La première saison de la série originale comprenait à elle seule 60 épisodes. Une première année de tournage dont Austin St. John se souvient parfaitement.
« Nous avons tellement enchaîné la première année. Du lundi au vendredi, tournage. Il faisait encore nuit quand on commençait, et il faisait nuit quand on finissait. Le samedi, on était appelés pour faire la voix off. Le dimanche, j’étais généralement si fatigué que j’allais juste à la salle pour m’entraîner, puis je rentrais chez moi pour me détendre. Je ne suis pas sorti pendant près d’un an. Nous avons finalement eu une semaine de congé pour Noël. J’ai dormi une journée entière pour essayer de retrouver mon énergie. À 19 ans, tu ne devrais pas avoir à faire ça ! »
En plus de leurs journées surchargées, les jeunes acteurs se sont soudain retrouvés sous les projecteurs. La première génération de Rangers n’y était absolument pas préparée. « Nous n’avions vraiment aucune idée de ce qui allait se passer », révèle le Ranger bleu David Yost. La première fois qu’Austin St. John est rentré dans un centre commercial, il a même dû être évacué par la sécurité. Cette soudaine célébrité n’a pas simplifié la vie des comédiens, ajoutant une forte pression sur leurs épaules. « Je l’ai trouvé incroyablement écrasante », se rappelle pour sa part Amy Jo Johnson, la Ranger rose.

Amy Jo Johnson, la Ranger rose originale
Être un Power Ranger n’était donc pas une partie de plaisir, mais poursuivre une carrière d’acteur après ça était encore plus complexe. Parmi ceux et celles qui s’y sont essayés, très peu ont réussi à sortir du lot. Walter Jones a bien fait quelques apparitions dans des séries à succès, mais toujours pour des rôles mineurs. Pour la plupart des Rangers, la fin de leur rôle dans la série était synonyme de fin de carrière. Il est possible que toucher son rêve du bout des doigts, puis se le voir refuser, ait pu créer de la frustration chez certains membres du casting.
Sans compter que toutes ces années de dévouement n’ont pas payé. Les acteurs gagnaient si peu que, même pendant qu’ils travaillaient, Austin et Walter (les Rangers rouge et noir) partageaient un appartement avec plusieurs cascadeurs. « C’était un show non-syndiqué », raconte le premier leader de la troupe. De fait, aucun des acteurs ne touchait la moindre compensation pour le merchandising de la série, qui était estimé à environ un milliard de dollars.
Au milieu de la deuxième saison, les conditions étaient telles que la moitié des Rangers a décidé de quitter la série. Amy Jo Johnson a par la suite regretté qu’elle et les autres membres du casting ne se soient pas joints aux démissionnaires. Tous ensemble, ils auraient sans doute obtenu de meilleurs contrats, et abouti à un résultat différent.
Malgré tous ces déboires, la franchise continue de se réinventer, et une nouvelle génération de Rangers a vu le jour avec la série Dino Fury, sortie en février. Quant aux acteurs passés, ils continuent d’endosser leur rôle pour participer à des rassemblements de fans. Des admirateurs du monde entier leur envoient encore des lettres pour les remercier d’avoir été une source d’inspiration. « Leurs histoires m’ont montré combien Power Rangers a aidé des enfants qui avaient juste besoin de se sentir en sécurité. C’est vraiment cool d’en avoir fait partie », confie l’ex Ranger rose. Même sans malédiction, devenir un Power Ranger aura inévitablement changé la vie de ces acteurs.
Couverture :
L’article Tragédies en série et folie meurtrière : la vérité sur la malédiction des Power Rangers est apparu en premier sur Ulyces.
03.11.2022 à 18:00
Comment Migos a marqué la pop culture
Nicolas Prouillac
Takeoff est mort à 28 ans. C’est avec cette information que les fans et acteurs du milieu du rap se sont réveillés mardi matin, choqués et émus par la nouvelle. « Plus rien n’a de sens. Plus rien du tout. », a tweeté le réalisateur Cole Bennett, qui a travaillé avec Takeoff sur plusieurs clips. […]
L’article Comment Migos a marqué la pop culture est apparu en premier sur Ulyces.
Texte intégral (5445 mots)
Takeoff est mort à 28 ans. C’est avec cette information que les fans et acteurs du milieu du rap se sont réveillés mardi matin, choqués et émus par la nouvelle. « Plus rien n’a de sens. Plus rien du tout. », a tweeté le réalisateur Cole Bennett, qui a travaillé avec Takeoff sur plusieurs clips.
De son vrai nom, Kirshnik Khari Ball, Takeoff a été assassiné au 810 Billiards & Bowling, au 1201 San Jacinto Street, à Houston, lors d’une soirée privée organisée le soir d’Halloween. Une altercation a éclaté entre Quavo et un individu non identifié à propos d’une partie de dés. « À 2 h 34 du matin, des officiers ont reçu un appel pour une fusillade en cours », raconte le chef de la police de Houston Troy Finner. Si Quavo n’a pas été blessé, Takeoff a pris deux balles perdues, dont une dans la tête qui a causé sa mort. « J’ai reçu de nombreux appels de Houston et de l’extérieur et tout le monde m’a dit que c’était un super garçon, qu’il était pacifique. Quel grand artiste. », ajoute Finner.
Un grand artiste en effet qui a marqué le monde de la musique et la pop culture accompagné de son oncle Quavo et de son cousin Offset. Retour sur le phénomène Migos, de son ascension à sa chute.
Le temps semble suspendu dans les montagnes de Santa Monica en cet après-midi de printemps. La température avoisine les 25°C sous le soleil californien, et pas un nuage ne vient encombrer l’azur où planent des buses en quête de gourmandises à se mettre sous le bec. En contrebas, Calabasas somnole. C’est l’heure de la sieste dans les collines arides qui servent d’enclave à The Oaks, la résidence surveillée la plus hype d’Amérique. Drake, Kanye West, J-Lo et la famille Kardashian y ont tous élu domicile, se cloîtrant dans d’exubérantes villas où s’entassent voitures de sport et piscines turquoise. C’est aussi là que vit Justin Bieber, dans une hacienda de plus de 800 m² située le long du bien nommé Prado del Grandioso. 
Juste de l’autre côté de la route, dans une villa toute en colonnes et fresques d’inspiration Renaissance, on ne dort pas. La brise porte la rumeur de basses puissantes et d’un refrain entêtant, qui sourdent de l’intérieur de la demeure baroque. « Versace, Versace, Versace… Versace, Versace, Versace… »
Les rappeurs de Migos sont ici pour tourner le clip d’un morceau qui deviendra rapidement iconique, après que Drake en fera un remix au mois de mai 2013 et qu’il servira d’hymne aux défilés de la maison de haute couture italienne. Mais pour l’heure, nous sommes le 9 avril et Drake est loin d’ici, accaparé par l’enregistrement de son album Nothing Was the Same. Quavo et Takeoff répètent un plan inspiré de La Cène, accompagnés du producteur du morceau Zaytoven.
Pour « Versace », le réalisateur Gabriel Hart, autoproclamé « The Video God », a vu les choses en grand. « On ne pouvait pas faire un clip de tier-quar pour parler de Versace », raconte-t-il. « La mode a fait un come-back en force dans le hip-hop, grâce à la jeune génération. » C’est pourquoi le groupe a fait le voyage depuis Atlanta, en Géorgie, pour passer une journée dans le décor de rêve qu’offre le havre ultra-sécurisé des icônes de la pop culture américaine. Pour remplir ses cadres de délices, Hart entasse devant la caméra une vingtaine de mannequins de l’agence NEXT, de magnifiques ensembles et parures Versace, des liasses de billets, des bouteilles de vodka fluorescentes importées de France, et un guépard… pour le panache.
Sorti en septembre de la même année, le clip fait un carton – il compte plus de 20 millions de vues sur YouTube – et marque le début de l’ascension de Migos vers le succès. La propriétaire de la villa, dont la ressemblance avec Donatella Versace frappe le réalisateur, fait une brève apparition dans le clip : l’illusion fonctionne et la presse s’emballe. « Pourquoi on ne pourrait pas vivre dans des châteaux et être acceptés par tout le monde ? » interroge Gabriel Hart. « Moi je dis qu’on peut. »
En 2013 déjà, c’était une question de culture – de cross plutôt que de clash. Aux critiques qui s’en sont pris à Miley Cyrus pour s’être appropriée la culture trap avec son album Bangerz, produit par le beatmaker d’Atlanta Mike WiLL Made-It, le vidéaste répond qu’il n’a que respect pour leur travail. Son clip lui rend hommage durant la séquence « Hannah Montana ». Depuis « Versace » jusqu’à la sortie de leur album Culture le 27 janvier dernier, l’univers de Migos n’a cessé d’infiltrer la culture contemporaine.
Mais pour y parvenir, le trio n’a fait aucune concession à la pop mainstream. En 2016, ils ont trôné au sommet du Hot 100 de Billboard avec « Bad and Boujee », pur produit de la culture trap d’Atlanta qu’ils ont réussi à globaliser.
Nawf
Quavo (Quavious Keyate Marshal), Takeoff (Kirshnik Khari Ball) et Offset (Kiari Kendrell Cephus) ont tous les trois grandi à Lawrenceville, une banlieue du comté de Gwinett située à 30 minutes au nord-est d’Atlanta. Une zone qu’on appelle généralement le Northside – le Nawf, dans l’argot du trio. Migos est une affaire de famille : Quavo est l’oncle de Takeoff, et Offset est le cousin de Quavo. Petits, ils passaient tout leur temps ensemble, à l’école comme en dehors, vivant sous le même toit chez la mère de Quavo. Ils l’appellent tous les trois maman. À l’adolescence, deux éléments déterminants viennent se greffer à la situation initiale : la drogue et le rap.
Dans les années 1990, le trafic de drogue se répand comme la peste dans les rues de la métropole d’Atlanta. Pour y faire face, la police locale crée en 1995 une unité spéciale baptisée Atlanta HIDTA, pour High Intensity Drug Trafficking Area, « zone de trafic de drogue à haute intensité ». Les organisations criminelles mexicaines sévissent dans les banlieues pauvres de la ville, profitant d’une vague d’immigration latino-américaine dans la région. Ils trafiquent la marijuana, la cocaïne, la méthamphétamine et l’héroïne par kilos dans les quartiers, installant leurs stocks, leurs points de vente et leurs réseaux dans les zones résidentielles ou industrielles les plus touchées par la misère. Les maisons abandonnées y sont légion et servent de camp de base aux dealers, qui les appellent les bandos (pour abandoned houses).
Ils dealent le jour, jamment la nuit, et se débarrassent de leur premier blase en 2010 pour se rebaptiser Migos.
Quand le trio commence à rapper en 2009, concoctant ses premiers sons dans le sous-sol de la maison de mama, le groupe se fait appeler The Polo Club. « Il y avait plein de clubs de polo à Atlanta quand on était gamins », se souvient Offset. Lui et Quavo ont 18 ans à l’époque – Takeoff a trois ans de moins qu’eux – et veulent devenir des hustlers : brasser du cash en dealant pour collectionner les filles et les belles voitures. Pour la musique comme pour la drogue, il faut commencer au bas de l’échelle. Mais dans les deux milieux, les perspectives d’avenir sont étincelantes pour qui réussit dans la région : la deuxième moitié des années 2000 sourit aux rappeurs comme aux trafiquants d’Atlanta.
D’après la DEA, les autorités ont fait main basse sur environ 70 millions de dollars liés au trafic de drogue à Atlanta en 2008 et davantage l’année suivante, surpassant toutes les autres grandes métropoles du pays. « Dans le comté de Gwinnett, les trafiquants de drogue peuvent se fondre dans le décor », explique à l’époque le procureur local Danny Porter à CNN. « Nous devons mettre en place de nouvelles tactiques pour combattre la présence de ces organisations » – à savoir les cartels mexicains de Sinaloa et du Golfe. Ils remplissent le vide laissé par une autre organisation criminelle d’Atlanta, la Black Mafia Family (BMF), qui s’était lancée dans l’industrie du hip-hop pour couvrir ses activités illégales d’un paravent doré.
Lorsqu’il est arrêté en 2008, son fondateur, Demetrius « Big Meech » Flenory, est déjà une légende urbaine. Une autre légende est en marche tandis que The Polo Club fait ses premiers pas : Gucci Mane en est à son sixième album studio et définit le son trap, le beatmaker emblématique Zaytoven à ses côtés. Les trois ados ont des exemples pour guider leurs pas, du temps et l’envie de percer d’une manière ou d’une autre. Ils dealent le jour, jamment la nuit, et se débarrassent de leur premier blase en 2010 pour se rebaptiser Migos.
« On a grandi dans un quartier avec une grande communauté latino », explique Offset. « “Migos”, c’est le nom qu’on donne aux dealers du Northside », poursuit Quavo. Contraction d’amigos, le terme est employé au sein des réseaux hispaniques installés dans le comté de Gwinnett, « de la même façon qu’entre potes on s’appelle “nigga” ». Le trio aménage peu à peu le sous-sol en studio bricolé : ils téléchargent un logiciel de musique gratuit sur Yahoo et enregistrent leurs deux premières mixtapes avec de l’équipement acheté grâce à l’argent du deal.
Grâce au bouche-à-oreille, leur morceau « Bando » parvient aux oreilles de Zaytoven, qui voit immédiatement leur potentiel sur ce beat inspiré de ses propres compositions. « J’ai fini par tomber par hasard sur Quavo dans les loges VIP d’une émission de radio à laquelle je participais. Il m’a marché sur le pied », raconte-t-il en riant. « Quand j’ai levé les yeux pour voir qui c’était, j’ai reconnu le jeune rappeur de la vidéo. Je lui ai dit que je les cherchais et il m’a répondu qu’eux aussi ! Dès qu’ils demandaient à quelqu’un de leur faire un beat, ils disaient qu’ils voulaient que ça sonne “comme du Zaytoven”. »
Le lendemain, le groupe est invité à enregistrer chez Zay, qui les branche par la suite avec deux poids lourds du milieu : Pierre « Pee » Thomas, le fondateur de Quality Control Music et Kevin « Coach K » Lee, l’ancien manager de Gucci Mane et Young Jeezy.
« Je n’avais jamais entendu un style pareil », se rappelle Pee. Mais ce qui a véritablement décidé Coach K à signer le trio, c’est que les hipsters d’ATL les adulaient déjà, comme il l’a confié à Noisey. « J’ai demandé à ces types : “Vous connaissez Migos ?” Et ils m’ont répondu : “Grave ! ‘Bando’ !” Quand j’ai entendu ces mecs qui veulent toujours être les premiers à écouter le truc le plus frais me dire ça, je les ai signés immédiatement. » Commence alors l’enregistrement de la mixtape qui les fait décoller, Y.R.N. (Young Rich Niggas). Elle sort en juin 2013 sur Quality Control et contient le single « Versace ».
« C’était trois fois rien », se souvient Zaytoven quand on l’interroge sur la naissance du morceau. « Je l’ai composé en pleine journée, parmi d’autres. Quand je l’ai envoyé à Migos, ça a fonctionné – leur flow a changé l’histoire du rap », affirme-t-il. À tel point que Drake insiste pour le remixer à la première écoute, imitant le flow en triplets caractéristique du groupe.
Quand le rappeur n°1 mondial leur fait l’honneur de poser sur leur morceau, leur adressant un big-up au passage, Quavo, Takeoff et Zaytoven sont fous de joie. Offset, pour sa part, n’a pas l’occasion d’écouter le résultat. Au moment où la version de Drake apparaît sur la Toile, il est en prison.
Shooters
Le 9 avril 2013, pendant que Quavo et Takeoff boivent du champagne avec des mannequins dans une villa californienne, Kiari Cephus (alias Offset) n’est pas de la partie. Depuis le mois de février, il est incarcéré à la prison du comté de Dekalb, en périphérie d’Atlanta. En octobre 2011, alors âgé de 20 ans, Kiari est arrêté pour vol de voiture et condamné à deux ans de sursis avec mise à l’épreuve. C’est pour avoir violé cette condition qu’il est placé en détention. Il est libéré le mardi 15 octobre 2013, aux environs de 15 heures.
Après une profonde inspiration, Kiari tourne le dos aux bâtiments gris de la prison et remonte l’allée jusqu’à la voiture qui l’attend. À l’intérieur, Coach K et ses deux complices l’accueillent chaleureusement. « Bon, qu’est-ce qu’on fait ? Tu veux faire un tour au mall ? » lui demande le manager en lui tendant une liasse de billets en guise de bienvenue. Kiari secoue la tête. « Nan, je veux aller au studio. »
Sur le trajet, Quavo et Takeoff le briefent : ils lui racontent à nouveau Drake, la sortie du clip il y a quinze jours et le succès phénoménal qu’ils rencontrent. Mais Quavo leur demande de garder la tête froide. « Une chose après l’autre », professe-t-il. « On ne peut pas se satisfaire de ça. On est monté sur le ring, maintenant on redescend et on se remet au travail pour le prochain match. » Les autres acquiescent. Ils prévoient déjà d’enregistrer la suite de YRN. Mais se tenir loin des ennuis n’est pas au programme pour Migos, dont le parcours est semé d’éclats de violence.
En mars 2014, alors que le trio est dans un van sur l’autoroute 95 après un concert à Miami, ils échangent des coups de feu avec des assaillants se trouvant à bord d’un autre véhicule. Un de leurs fans est blessé, les tireurs disparaissent. Trois mois plus tard, dans la nuit du 11 juin, un nouveau drame survient après un concert du groupe, dans leur comté natal. À l’extérieur d’un motel où Quavo, Takeoff et Offset font la fête avec leurs potes et leurs fans, deux hommes font irruption armés de pistolets. Ils tirent sans sommation, visant Migos d’après les témoignages.
Aucun membre du groupe n’est touché, mais un spectateur innocent du nom de Paris Brown est tué. Les tireurs prennent la fuite, la scène ne dure que quelques secondes. Plus tard, la police localisera l’un des deux tireurs présumés, qui se donnera la mort au cours de son affrontement avec les forces de l’ordre. Cette tragédie aurait été causée par la rivalité entre Migos et un autre groupe local, 2G. Par la suite, le trio ne se déplace plus sans un service de sécurité armé – assuré notamment par leur compère rappeur Skippa Da Flippa, avec qui ils ont inventé le dab.
~
Cette protection rapprochée leur vaut de nouveaux ennuis un an plus tard, le 18 avril 2015. Ce soir-là, Migos donne un concert à l’université de Géorgie du Sud, à Statesboro. Le show a débuté depuis un quart d’heure quand un manager sort des coulisses et demande au DJ de couper la musique. Pendant qu’ils étaient sur scène, des policiers ont fouillé les véhicules du groupe et de leur équipe (une quinzaine de personnes en tout). Ils ont découvert à bord de la drogue et des armes en quantité. Or, aux yeux de la loi géorgienne, détenir une arme chargée sur le site d’une école est un délit grave. Les jeux sont faits et tout le monde est conduit au poste.
Quavo, Takeoff et les autres passent deux nuits en détention avant d’être libérés sous caution. Kiari ayant déjà été condamné par le passé, il est directement envoyé prison. Coach K contacte alors Charles Mittelstadt, un enquêteur privé au service de la défense, qui rouvre les affaires dans l’espoir de déterrer des vérités qui n’ont pas encore été exposées. Ancien expert en sécurité, Mittelstadt est à la croisée du privé et de l’avocat, et sa clientèle compte de nombreux rappeurs, parmi lesquels Gucci Mane, T.I. et Rick Ross. Il se rappelle clairement de l’affaire.
« Les policiers qui ont procédé à leur arrestation faisaient partie de l’unité de lutte anti-criminalité du bureau du shérif de Statesboro », explique-t-il. « Ils ont raconté qu’une “odeur de cannabis” les avaient décidés à procéder à la fouille des véhicules du groupe. » Mais Mittelstadt affirme que les autorités ne disposaient pas de mandat pour inspecter ces véhicules, et qu’il est « plutôt inhabituel » de placer en détention plus d’une dizaine de personnes sans mener d’enquête pour déterminer à quels individus appartiennent la drogue et les armes en question. « Les policiers ont sciemment choisi de ne pas le faire », dit-il.

Charles Mittelstadt et Offset à sa sortie de prison
Crédits : Charles Mittelstadt
Si son intervention a permis de faire sortir rapidement 12 des 13 personnes arrêtées, Kiari a dû se résoudre à retourner derrière les barreaux. Pour limiter la casse et espérer sortir avant 2016, il a fallu qu’il accepte de reconnaître en partie sa culpabilité. « Il a reconnu s’être trouvé sur les lieux. Ça a suffi au juge, qui avait juste besoin d’un coupable », se désole Charles Mittelstadt. Moins d’un mois après sa mise en détention à la prison du comté de Bulloch, Kiari est accusé d’agression sur un autre détenu et du déclenchement d’une émeute. Plusieurs médias rapportent qu’il aurait asséné des coups de pieds à la tête du plaignant, mais son défenseur donne une toute autre version des faits.
« On voit clairement sur les bandes des vidéos de surveillance qu’aucune émeute n’éclate », met-il au clair. « Ce qu’il se passe, c’est que cet autre détenu crie quelque chose à Kiari depuis sa cellule, qui le met en colère. » D’après le récit de Mittelstadt, le rappeur se lève d’un bond et se dirige vers la cellule du détenu. « On ne voit pas ce qu’il se passe dans la cellule, mais Kiari n’y reste que quelques secondes avant d’en sortir. C’est tout. » Quoi qu’il se soit réellement passé à l’intérieur, Kiari Cephus passe 233 jours à l’ombre avant d’être libéré de prison. Ce laps de temps nuit sévèrement au groupe, à l’extérieur.
Privés d’Offset, le duo ne peut enregistrer de nouveaux morceaux ou d’album en tant que Migos, et les salles de concert rechignent à programmer les deux tiers du trio. Lorsqu’elles le font, la paye est considérablement revue à la baisse. Enfin, le 4 décembre 2016, Kiari retrouve une seconde fois la liberté. Cette fois, il est convaincu qu’il n’y retournera pas. Il compare sa mésaventure au récit biblique de Salomon. « C’était un roi qui avait tout, et il a tout perdu… mais il avait encore la foi », a-t-il confié d’un regard pénétré aux caméras à sa sortie de prison. « Et Dieu l’a béni en lui accordant dix fois plus de richesses. En prison, comme Salomon, je me suis tourné vers les Saintes Écritures. »
Une chose est certaine, c’est qu’après cette épreuve, Migos allait connaître une gloire sans précédent.
C U L T U R E
Au soir du 8 janvier 2017, en direct sur NBC, Donald Glover est récompensé par deux Golden Globes pour sa série Atlanta. Sacré meilleur acteur et auteur de la meilleure série musicale ou comique, il monte sur scène à deux reprises pour prononcer quelques tirades de remerciements émus. Acteur, auteur principal et producteur du show, Donald Glover était jusqu’ici plus réputé pour sa carrière de rappeur, chanteur et compositeur, sous le nom de Childish Gambino.
Originaire de Géorgie, il ne fait pas de mystère sur son amour du Dirty South et de la trap. Dans le troisième épisode d’Atlanta, qui ne compte pour l’instant qu’une saison, Migos fait une apparition remarquée. Ils y incarnent un trio de trafiquants de drogue terrifiants, tout droit sorti de leur lyrics. Le soir de la cérémonie, Glover ne les oublie pas dans son discours.
« Je tiens vraiment à remercier Migos – pas parce qu’ils jouent dans la série, mais pour avoir fait “Bad and Boujee”. C’est le meilleur morceau de tous les temps », dit-il avec le plus grand sérieux. Lors de la conférence de presse qui suit, une journaliste l’interroge sur cette déclaration, qui a fait se lever quelques sourcils dans l’assistance.
« Parce que je pense qu’ils sont les Beatles de cette génération et qu’on ne les respecte pas assez », réplique-t-il avec un grand sourire. « Et honnêtement ce morceau est juste incroyable… il n’y a pas de meilleure chanson pour baiser. » Rires dans l’assistance.
« Ce que pense les gens nous importe », dit Offset. « C’est ce que ça m’a fait quand j’ai entendu Donald Glover dire ça. On l’aime pour ce qu’il a dit. Pour avoir été sincère. » Le public américain, lui, ne s’y est pas trompé : le lendemain après-midi, « Bad and Boujee » passe en tête du classement Billboard. Le morceau détrône un autre hit venu d’Atlanta, « Black Beatles », de Rae Sremmurd, produit par Mike WiLL Made-it et featuring Gucci Mane. Mais si ce tube fait des concessions mélodiques évidentes à la pop mainstream (une constante avec Mike Will, qui a aussi signé « Formation » de Beyoncé), le succès fulgurant de « Bad and Boujee » surprend tant le morceau est peu accrocheur en apparence. Sur une production éthérée de Metro Boomin, sans hook appuyé, le trio égrène ses lyrics avec une relative monotonie. « On a réussi en mode trap, pas en mode pop », se gargarise Quavo.
Le clip du morceau, sorti le 31 octobre dernier, totalise plus de 200 millions de vues sur YouTube. Dix fois plus que pour « Versace ». Un braquage réussi. « J’ai rencontré les Migos pour la première fois en mai 2016 », raconte Dapo « Daps » Fagbenle, le réalisateur du clip. « On tournait la vidéo de “Bad Intentions”, le morceau de Niykee Heaton sur lequel ils sont en featuring. » Le tournage a lieu à Los Angeles, où vit Daps, qui a également co-signé les images de « King Kunta » pour Kendrick Lamar.
Entre deux prises, le trio lui dit qu’ils devraient travailler ensemble. Il accepte sans trop y croire, persuadé qu’il s’agit de paroles en l’air, comme c’est souvent le cas à Hollywood. Mais le mois suivant, tandis que le groupe est en Europe pour une série de concerts et que Daps est de passage à Londres, Coach K le contacte pour qu’il réalise les clips qui accompagneront le prochain album du groupe. Après une première collaboration réussie sur « Cocoon » dans un manoir de la capitale anglaise, ils réitèrent l’expérience sur « Bad and Boujee ».
Tandis que les clips de « Deadz » et « What The Price » paraîtront bientôt (Daps a filmé les deux durant la première semaine de février), leur travail le plus significatif est le clip de « T-Shirt », posté sur YouTube le 6 janvier dernier. « Quand ils m’ont demandé de faire “T-Shirt”, Quavo avait une petite idée de ce qu’il voulait », raconte Daps. « Il avait envie de quelque chose de glacé et d’old school. Il voulait porter des fourrures. »

Crédits : Migos/Daps/YouTube
Des images de The Revenant lui sont venues en tête et Daps a eu l’idée de tourner en pleine nature, dans un paysage enneigé. Il a commencé à songer à des endroits comme l’Alaska. Après quelques recherches sur Google, il est tombé par hasard sur Lake Tahoe, le plus grand lac alpin d’Amérique du Nord, situé à cheval entre la Californie et le Nevada. Plus tard ce jour-là, en tournage, il a reçu ce qu’il interprète comme un signe du destin.
« Une fille est venue me parler, sortie de nulle part. Quand je lui ai demandé d’où elle venait, elle m’a répondu “Lake Tahoe”. » Après qu’il lui a raconté son histoire, elle a proposé de le mettre en contact avec sa famille là-bas. En décembre 2016, Daps a fait le voyage depuis Los Angeles jusqu’à Lake Tahoe, et Migos d’Atlanta. Un jour de tournage sous des températures glaciales a suffi pour mettre les images en boîte. « C’est un clip très méta », commente son auteur.
L’idée de base sonne comme une blague : des artistes de trap incarnant des trappeurs, qui marchandent des peaux comme ils dealeraient de la drogue. Mais à bien y réfléchir, c’est un écho puissant du propos qui se dégage de l’album. La culture de Migos est par essence américaine. Leur succès et la viralité de leurs gimmicks et de leur gestuelle en ont fait le nouveau mètre-étalon de la pop culture.
« Je pense qu’ils [Migos] sont les Beatles de cette génération », avait déclaré Childish Gambino lors d’un discours aux Golden Globe Awards en 2017. Migos a atteint les sommets mais peine depuis à revenir au top. Leur musique a été peu à peu éclipsée par l’ambition de ses membres de poursuivre des opportunités en dehors de la musique. Offset est également devenu un spectacle pour les tabloïds nationaux dû à sa relation avec Cardi B, et l’ancienne romance de Quavo avec l’artiste Saweetie a également été un sujet chaud sur les réseaux.
Le mois dernier, Takeoff et Quavo avaient même évoqué la possibilité de poursuivre leur carrière sans Offset. « J’ai juste l’impression que nous voulons voir notre carrière en tant que duo, tu vois ce que je veux dire ? ». A déclaré Quavo au micro du podcast « Big Facts » le 4 octobre dernier. Avec le décès de Takeoff, c’est donc l’existence même du groupe qui est remise en question. Un aspect qui semble bien secondaire par rapport à la tragédie. Rest in peace Takeoff.
Couverture : Migos (Takeoff, Quavo et Offset).
L’article Comment Migos a marqué la pop culture est apparu en premier sur Ulyces.
10.10.2022 à 00:00
Une soirée avec Prince Waly au début de sa carrière
Nicolas Prouillac
On trace la route sur le booster noir d’Ilyes, sillonnant entre les voitures sous les rayons obliques du soleil couchant, qui étire les ombres et coiffe d’or les silhouettes des passants. Les vapeurs d’essence et l’air du soir nous giflent le visage ; direction Montreuil. Dans ma tête tournent en boucle les premières mesures de « Lost […]
L’article Une soirée avec Prince Waly au début de sa carrière est apparu en premier sur Ulyces.
Texte intégral (8223 mots)
On trace la route sur le booster noir d’Ilyes, sillonnant entre les voitures sous les rayons obliques du soleil couchant, qui étire les ombres et coiffe d’or les silhouettes des passants. Les vapeurs d’essence et l’air du soir nous giflent le visage ; direction Montreuil. Dans ma tête tournent en boucle les premières mesures de « Lost in Thought », qui me ramènent plus d’une décennie en arrière. J’ai quinze piges et je découvre dans la collection de disques d’un aîné l’album-phare de Funkdoobiest.
Douze ans plus tard, les deux rappeurs de Big Budha Cheez raniment la mélodie, gardée intacte dans les replis de ma mémoire, au détour d’une interview glanée sur la Toile. Quelques jours plus tôt, Ilyes me faisait découvrir les MC’s montreuillois à travers le clip de « M.City Citizen », escapade visuelle et sonore tout droit venue des années 1990, distillant ses références avec générosité et sens du détail. Rendez-vous était pris quelques heures plus tard, et nous voici à présent à deux rues de leur QG. Rapide détour par l’épicerie du coin. Pack de douze embarqué ; direction l’Albatros.
Nous y retrouvons Clifto Cream, le réalisateur des clips du duo, qui nous invite à le suivre jusqu’à leur local. Dans la cour, table et barbecue semblent imprégnés du souvenir d’innombrables veillées. Clifto nous ouvre les portes de son fief. Dans la pièce enfumée, où s’entassent en désordre matos et bibelots en tous genres, Fiasko Proximo nous accueille. « Prince » Waly, l’autre MC du groupe, ne tarde pas à nous rejoindre, le temps de faire la route depuis son taf jusqu’au refuge. Tous trois se réjouissent de voir qu’Ilyes shoote en argentique et non au reflex numérique, qui cadre mal avec l’univers granuleux de Big Budha Cheez. Clifto nous montre dans la foulée le caméscope VHS Panasonic dont il s’est servi pour filmer « M.City », puis nous sortons nous attabler.
Décapsuleur, cendrier, enregistreur enclenché.
À l’ancienne
Comment le groupe est né ?
« Prince » Waly : C’était au collège. On était potes avec Fiasko et on partageait les mêmes centres d’intérêts. Je connaissais déjà Lunatic et tout ça, mais Fiasko m’a fait découvrir X-Men et ça a percuté. On s’est mis à faire du son, à écrire des textes, et comme tout le monde au début ce n’était pas vraiment sérieux. Et puis on s’est perdu de vue un moment, on s’est retrouvé et depuis on taffe les trucs ensemble.
Vous avez grandi à Montreuil tous les trois ?
Waly : Ouais, à Montreuil.
« Le premier projet qu’on a sorti, on a passé tout l’été à le faire. » — Fiasko Proximo
Fiasko Proximo : Enfin moi j’étais dans le XXe plus jeune, quand on est venu à Montreuil je devais avoir neuf ou dix ans. Je faisais déjà un peu de son avant de rencontrer Waly. Après, comme on était grave potes au collège, on s’est dit que ce serait cool qu’on monte un truc. Et puis comme il a dit, on s’est perdu de vue. Lui est parti dans un autre lycée, moi aussi. Le groupe s’est vraiment créé peut-être un an ou deux ans plus tard. Clifto Cream : Et le collectif Exepoq est né à partir du moment où on a pris un local ici, à l’Albatros. C’était pas là, c’était un peu plus loin là-haut. On était tous potes mais on faisait tous nos trucs dans notre coin, dans nos arts différent – parce qu’il y a aussi un photographe dans le collectif. À un moment donné, on s’est réuni et on s’est dit qu’il fallait faire quelque chose tous ensemble. Fiasko : Mais les mecs qui ont lancé l’idée, c’est Clif’ et Spootnik. Clif’, qui était déjà dans l’image, et Spoot’, qui faisait du son. Waly et moi quand on était plus petits, on enregistrait déjà chez Spoot’, mais dans sa chambre, à la Cité de l’Espoir.
Et l’Albatros, c’est quoi exactement ?
Waly : C’est un atelier d’artistes. Clifto : Le but, c’est de rassembler des gens qui font un tas de choses différentes, et de bosser ensemble. T’as des mecs qui font du théâtre, beaucoup de studios – qui sont tous assez différents les uns des autres –, pas mal d’expos, des peintres… Waly : Et même de la poterie. Clifto : Quand on est arrivé ici, on était un peu les seuls jeunes. On descendait des quartiers qu’il fallait pas approcher, en quelque sorte, on était un peu dans notre coin. Et puis on a changé de local pour celui dans lequel on se trouve actuellement. On a commencé à rencontrer les anciens, parce qu’ici il y a pas mal de gens qui sont là et qui exercent dans leur art depuis très longtemps. Après, d’autres locataires sont arrivés : il y a eu GVS – Grande Ville Studio, dont fait partie Jazzy Bazz –, Dixon est là aussi… ça fait des connexions et c’est un lieu où tu peux t’enfermer pendant un mois sans sortir. Fiasko : On l’a fait. (Ils rient.) Le premier projet qu’on a sorti, en CD, on a passé tout l’été à le faire. On faisait 16h-3h du matin, on allait dormir, on achetait des chips et du coca à côté et on revenait là. Mais c’était là-haut dans notre précédent local. Waly : Et là-haut il faisait super chaud, le soleil tape bien sur la fenêtre. Fiasko : Ouais, il faisait 40° à l’ombre. Ça, c’était en 2010. Et comme a dit Clif’, ce lieu a vraiment un truc qui fait que tu peux ne pas en sortir pendant super longtemps. Aujourd’hui, on le fait plus, mais on l’a fait longtemps. Waly : C’est notre résidence secondaire. (Ils rient.) Clifto : J’ai pris le local à la base pour pouvoir bricoler et peindre ailleurs que chez moi, parce que ma mère n’en pouvait plus ! J’ai pris un petit truc et au final j’ai ramené tous mes potes, donc on se posait et c’est devenu après notre studio, notre QG. C’était vraiment petit, ça faisait le tiers de celui-ci et on était dix dedans. Fiasko : Voire plus certains soirs, dix c’était le minimum. Clifto : Ouais, c’était violent.
Vous êtes arrivés comment dans le rap ?

Un plan du clip de « Budha Cheez » a été tourné ici
Crédits : Ilyes Griyeb
Waly : Moi par mes grands frères. Depuis tout petit – je devais avoir huit ans. Dès que j’ai pu vraiment comprendre ce que ça racontait, quoi. Mes grands-frères baignaient dedans, ma grande sœur aussi. Mon grand-frère écoutait Lunatic. Je me rappelle du premier son de Lunatic, c’était « La Lettre ». J’étais petit, mais je me rappelle d’une phrase qui m’a marqué, quand Booba fait : « Quand je sors, ramène-moi une petite pute, bête, sans but / Je la ferai crier du bout de ma longue bite. » (Les deux autres éclatent de rire.) Et cette phrase, encore aujourd’hui, elle me tue ! Fiasko : Quand tu écoutes un bon son qui te marque, tu te dis automatiquement : « Ah ouais, eux ils sont trop chauds, il faut que je fasse la même chose, voire mieux. » Franchement, si j’étais tombé sur un son de rock chaud, aujourd’hui je serais rockeur. Mais bon, ça n’a pas été le cas. Maintenant – du moins avec Waly parce que Clif’ est plus vieux –, on était petits dans les années 1990. Donc ça nous a plus marqués que ceux qui aujourd’hui ont trente ou quarante ans, qui par exemple écoutaient Pink Floyd quand ils étaient gosses, et qui ont été marqués par ça. Du coup, on a commencé à écrire nos premiers textes… et après, le jour où les gens te disent : « Ah ouais, mais en fait c’est pas mal ce que tu fais », tu te dis que tu peux faire les choses sérieusement.
Quels sont les groupes qui ont fait naître cette envie ?
Clifto : Je crois que le groupe qui nous réunit à cette table, en tout cas artistiquement, c’est les X-Men. Même pour moi dans l’image, ça a toujours été une référence. Waly : Et côté américain, moi c’est plus le côté new-yorkais. Le côté sombre de Mobb Deep. En venant ici, j’écoutais ça. Même si on nous dit souvent que ça ne se ressent pas dans nos sons. Peut-être dans les instrus, mais dans les textes beaucoup moins. Donc tout ce qui est Mobb Deep, Sam Sneed… Fiasko : Si je ne devais en citer qu’un, ce serait le Wu-Tang. Pour moi, c’est le groupe précurseur. Après, comme dit Waly, Mobb Deep c’est du putain de lourd. On se retrouve plus dans ce qu’ils font parce qu’ils sont deux, comme nous. Mais niveau français, c’est sans aucun doute les X-Men. Time Bomb, La Cliqua… tout ce qu’on a vraiment rôdé en fait. Waly : Ils écrivent des textes où déjà, mine de rien, il y a pas mal d’humour ; c’est important. Et puis c’est plein de références culturelles assez pointues. Après bien sûr, on vit avec notre temps, on s’adapte. Moi, j’écoute aussi un petit peu plus 50 Cent, The Game… Deux hommes font irruption dans la cour, bouteille à la main et sourire aux lèvres, intrigués par notre présence. On échange des poignées de main. Clifto : Dixon, c’est une des personnes qui a un studio ici. C’est celui qui a mixé le son de « M.City Citizen » ! Dixon Mandrake ! Dixon : On veut pas vous déranger.
Pas de souci.
Dixon : J’ai vu Moussa par la fenêtre… Waly : T’inquiète, je vais venir te voir après. Dixon et son compère s’éloignent et sont bientôt rejoints par Ilyes, qui converse un moment avec eux avant de les prendre en photo.
D’où viennent vos blases et le nom du groupe ?
Waly : Alors ça, ça a été une galère. Parce qu’au début, ce n’était pas du tout Big Budha Cheez. Le premier, c’était Recto Verso. On a cherché plein de noms. Et moi j’ai eu un tas de blases. J’ai dû en avoir une dizaine. Fiasko : Moi, j’ai toujours été Fiasko Proximo, ça n’a jamais changé. Proximo ça vient de Gladiator. Et comme j’ai toujours kiffé les noms composés, je trouvais que « Fiasko » sonnait bien avec « Proximo ». C’est pas compliqué, c’est vraiment tout pourri, il n’y a pas de signification personnelle. (On éclate tous de rire.) Recto Verso, c’est le premier nom qu’on a eu tous les deux. Mais après, avec Ma Routine roule à M.City, notre premier EP, on a voulu changer car nous aussi nous avions changé. Le temps qu’on avait fait avec Recto Verso était révolu. Et puis on en est venu à Big Budha Cheez parce que… Waly : C’était surtout un jeu de mot, tu te rappelles ? Fiasko : Ouais, c’était le jeu de mot avec les bouddhas, on aime bien cette influence un peu spirituelle, asiatique.
Et c’est un nom de weed.
Waly : (Ils rient.) Voilà, c’est un nom de weed aussi. Mais ça, c’est vraiment un hasard parce que nous trois, on ne fume pas. L’afflux des souvenirs révèle peu à peu la complicité qui lie le groupe. Leur simplicité et le plaisir qu’ils prennent à évoquer le passé devant un étranger sont communicatifs. L’air se rafraîchit à mesure que le jour décline.
Pourquoi ce son très typé années 1990 ?
Clifto : Ce qui est marrant en fait… enfin je laisserai les autres préciser pour le son, mais en règle générale, quand on fait un truc, on ne cherche pas obligatoirement à faire « un truc qui sonne années 1990 ». On a commencé par le bricolage. On s’est vraiment basé sur de la matière, au début. De la pellicule pour l’image, de la bande pour le son ; ce qui nous permettait de bricoler, de faire nos trucs à nous, avec un vrai grain, sachant qu’on n’avait pas de moyens. Et en fait après, c’est devenu une identité forte. Mais ça n’a jamais été une réflexion qu’on s’est faite. Waly : Exactement, ce n’est pas calculé, ça nous vient naturellement. Dans la vidéo comme pour le son. On compose – Fiasko fait les instrus quand on écrit les textes – et ça sort naturellement. Quand on pose, ça donne ça. Par exemple, avec mon gars Myth Syzer, on a bossé sur un son qui sonne assez nouvelle génération.

Clifto Cream et sa caméra Super 8
Crédits : Ilyes Griyeb
Fiasko : En fait le truc, c’est qu’on a une identité forte c’est vrai, mais entre nous. Si demain l’un de nous va faire quelque chose avec quelqu’un d’autre, l’identité change. C’est un mélange, comme avec « Clean Shoes ». Et moi si demain j’allais faire un son avec un autre mec qui n’est pas de notre collectif, ce serait pareil. Ce qu’il faut comprendre, c’est que notre identité s’est aussi construite avec le manque d’argent. Le truc, c’est que nous quand on pose sur bande ou quand on filme en VHS, le coût n’est pas le même, parce qu’on n’avait pas de moyens au début. Au lieu d’aller se taper des studios à 800 ou 1200 euros la journée, on avait une bande, une table de mixage et on savait que notre son allait être fait comme ça. On avait un micro, on posait. One shot, on recommençait pas trente fois. Et Clif’ c’était pareil, la VHS pour « M.City Citizen », c’est une question de prix, parce qu’on n’avait pas les moyens de se mettre une Red – même si on n’en voulait pas, mais on n’avait pas les moyens. Je suis frappé par l’utilisation du terme « Red ». Il désigne un célèbre fabriquant de caméras numériques dont les produits sont très prisés par l’industrie hollywoodienne et ne connaissent pas de déclinaisons grand public.
Vous n’avez pas été tentés par le home studio numérique, comme beaucoup ?
Clifto : Non, parce qu’en fait, on a commencé à une époque où ça avait été déjà fait. Maintenant, quand tu veux créer un studio, c’est un peu chacun pour sa gueule avec les moyens du bord. Nous, on s’est placé sur une méthode de travail vraiment à l’ancienne, avec du matériel qu’on récupérait à droite à gauche. On avait la volonté de récupérer un patrimoine. Mais du coup, c’est aussi un compromis sur les moyens, sur l’époque, sur l’endroit… C’est la conjonction de tout ça. Je pense qu’on ne s’est jamais dit les choses consciemment… la seule fois où c’est arrivé, c’est quand on a eu des retours de gens sur notre travail, comme là avec toi. C’est un mélange entre les moyens du bord, nos inspirations, et puis le fait de partir de zéro, comme à une certaine époque où les gens partaient vraiment de zéro. Fiasko : Et puis il y a un truc qu’il ne faut pas oublier, c’est que le fait qu’on marche comme ça apporte plein de trucs qu’on ne retrouve plus aujourd’hui. Par exemple dans le son, le fait d’enregistrer à bandes fait que quand on enregistre un son, on ne le fait pas quatre fois. On prend le truc sur le moment, c’est du one shot, on ne fait pas de drop. On sait quand se placer avec nos souffles, donc sur scène on assume nos textes. Y a pas 36 000 solutions. Ça nous a apporté plein de choses de ce genre. C’était pareil en vidéo, on ne recommençait pas quinze fois parce que même si c’est moins cher que le numérique, ça coûte un billet quand même.
Il y a peu de rappeurs qui n’utilisent pas le drop aujourd’hui.
Fiasko : Le truc, c’est que le drop est venu vachement avec le numérique. Quand ils ont eu les moyens de le faire, le fait de ne pas perdre du souffle, de pouvoir enchaîner super vite et tout… après, il y a des mecs comme Busta Rhymes, qui eux à l’époque arrivaient à le faire naturellement parce qu’ils n’avaient pas le choix. Clifto : Ouais, des fois le côté pratique est un piège. Pour résumer, je pense qu’on ne réfléchit pas au fait d’être à l’ancienne ou pas, mais par contre c’est vrai qu’on s’est dit ça clairement : notre méthode de travail est basée sur ce qui se faisait à l’ancienne. C’est-à-dire faire avec ce qu’il y a sur le moment, sans passer par trop de réflexion, et faire les choses comme on les sent sur de la bande, sur de la pellicule, sur de la VHS, sur scène : sur quelque chose de palpable, tout le temps. Fiasko : On est arrivé à un moment où le phénomène « à l’ancienne » est ressorti d’un coup. Mais nous, ça fait longtemps qu’on fait ça, même avant son apparition. Aujourd’hui, il y a peut-être une vidéo de nous qui a plus tourné que les autres parce qu’elle est sortie à ce moment-là, mais on a toujours été comme ça. Faut pas croire qu’on surfe sur une vague, ce n’est pas ça du tout.
On sent une vraie sincérité chez vous effectivement, et en même temps quand on voit le clip de « M.City Citizen », c’est très travaillé. Esthétiquement d’une part, mais aussi dans le son. Comment vous avez construit ça ?
Waly : Au niveau du son, c’est vraiment la bande. Fiasko : Il y a un truc avec la bande que tu vas retrouver dans le rap à l’ancienne, mais pas seulement, parce qu’au début des années 1990, c’était déjà un truc qui disparaissait – on passait sur de la bande numérique, c’était encore autre chose. Nous, on enregistre vraiment sur de la bande analogique et c’est plus un truc que tu vas retrouver dans les influences rock ou soul des années 1970 ou 1980, c’est ce qu’on recherche. Le grain vient de là. Avec la bande, ce n’est que du signal analogique, ça ne sonne pas pareil. Aujourd’hui, quand tu fais un son sur ordi, tu poses ta voix et l’ingé va la nettoyer au max, pour pas que tu aies de crépitements, etc. Nous, c’est tout le contraire qu’on recherche. Y a un peu de souffle ? C’est parfait, hop, ça passe dedans, après on réduit un peu, ça fait augmenter les aigus, les graves sont plutôt stylés, et voilà. Et dans la vidéo, tu peux ressentir la même chose, c’est un peu les mêmes codes. Mais ce qu’on faisait au début, côté son, c’est qu’on prenait le micro, on mettait un préampli analogique et on enregistrait directement sur la bande. C’était vraiment très crade, parce que tu n’avais pas de filtre, tu n’avais pas de reverb, ça passait directement sur la bande. Waly : Sur le deuxième EP, avec DJ Med Fleed, on a fait Épouser un tas d’oseille et Kidnapper le président comme ça. Fiasko : Il n’y a pas eu d’ordi, ce n’était que de l’analogique. Après, moi j’ai une MPC 2000, ça me permet d’envoyer mes beats directement sur les bandes. Après le truc, c’est qu’aujourd’hui, si tu ne veux vraiment faire que de l’analogique, il faut gagner des millions. Parce que ça coûte très cher et que ça devient très rare. Donc on n’est pas débile non plus, on sait qu’on est en 2014 et qu’il faut qu’on avance avec notre temps. On utilise l’ordi, on n’a pas boycotté ça. Clifto : Et puis même au-delà du fait d’utiliser un ordi ou pas, la finalité aujourd’hui ça reste quand même Internet. C’est le support numérique ultime, donc on est obligé de numériser de toute façon, que ce soit la vidéo ou le son. Fiasko : Mais ça reste vraiment la dernière étape. Nous, à la limite, quand c’est distribué sur Internet, on n’est plus là. On est déjà sur d’autres trucs. Après, Marine, notre chargée de communication, ou Jo, notre manager, prennent le relais sur ces points-là. Pour la vidéo, c’est un peu la même chose, sauf que c’est Clif’ qui fait tout de A à Z… personnellement je suis un peu plus en retrait. Clif’ et Waly vont plus se mettre en relation à ce niveau-là. Clifto : En règle générale, on construit les clips à deux. Waly : À la base c’est vraiment Clif’, ensuite ça module avec moi. Si j’ai indubitablement affaire à des artistes, l’enthousiasme avec lequel Fiasko, Waly et Clifto me décrivent leurs méthodes de travail et les techniques employées me donne l’impression d’être face à des artisans. Fiers et maîtres de leur ouvrage à toutes les étapes de sa fabrication, ils observent néanmoins une distance respectable avec son exploitation – ce n’est pas leur travail.
La découverte de la VHS
Comment avez-vous réalisé le clip de « M.City Citizen » ?
Clifto : Alors en fait, on avait essuyé un échec… (Ils rient.) Parce qu’évidemment, quand tu te lances dans le Graal sacré de l’analogique, tu reçois des gros coups d’épée énervés. On avait tourné un clip en Super 8, qu’on a tout simplement raté. Fiasko : Les images étaient voilées. Clifto : On avait mis un petit investissement dedans, qui était super important pour nous à l’époque. C’était fait en Super 8, parce qu’à la base on voulait vraiment bosser l’image sur pellicule, direct. Et à ce moment-là, on ne savait pas comment travailler notre image, on avait un peu étudié le truc et c’était vraiment très compliqué. On a tourné un été, on a attendu quelques mois et c’est au moment de la numérisation chez le mec, dans le XIe arrondissement, qu’on a vu que c’était raté… C’est l’inconvénient de tout ce qui est argentique, tu as ton rendu après. Il faut savoir qu’on est vraiment autodidactes, on n’a jamais fait d’école ni rien. Donc on s’en est aperçu après et là, on s’est retrouvé en décembre 2012. Fiasko : Là on a réfléchi, on a vraiment posé le truc à plat et on s’est dit : « Merde, dans quoi on se lance ? » Je crois que c’est là qu’on a eu les plus gros doutes, parce que c’était vraiment ce qu’on voulait faire, mais comme disait Clifto, on a tout appris sur le tas…

Waly et Fiasko
Crédits : Ilyes Griyeb
Clifto : On était en plein questionnement et là, une réponse est tombée du ciel qui tient en trois lettres… la VHS. (Ils éclatent de rire.) Ça a été un bon compromis – qui d’après moi a été un peu trop utilisé aujourd’hui, parce que justement ça a vraiment participé au fait que des mecs veulent faire « un truc années 1990 ». Fiasko : Ce qu’au début on ne cherchait pas à faire du tout, car pour le dire très simplement, un mec qui voulait faire un clip en VHS, il lui suffisait d’aller sur Ebay et il en trouvait une à quinze euros. Nous, c’était vraiment parce qu’on n’avait pas les moyens de recommencer avec la pellicule. On savait que si on se refaisait niquer avec ça, c’était cuit pour nous. Et la VHS, comme a dit Clifto, on s’est dit que c’était mortel : un truc qui nous coûterait peu d’argent et avec lequel en même temps on pourrait s’éclater. Mais au début, la vérité c’est que j’y connaissais pas grand chose… Clifto : Bah en fait, même moi. La première fois que j’ai utilisé la VHS officiellement, c’était pour un teaser qu’on avait fait et ça nous a vraiment plu. Après, j’ai fait un clip pour Jazzy Bazz en VHS et ça a confirmé que c’était possible. C’était assez compliqué à utiliser, mais ça faisait aussi partie de l’intérêt du truc. Donc on l’a réutilisée pour « M.City Citizen », et là pour le coup on a vraiment exploité toutes les facettes de la VHS. Dans des coins, dehors, sur fond vert, avec de la lumière – parce que la lumière bave énormément sur la VHS, ça nous intéressait beaucoup… En fait, on a tout donné en VHS sur ce clip-là. Parce qu’à l’époque, on n’avait pas vraiment l’intention de continuer comme ça. On ne voulait faire qu’un truc en VHS, mais après c’est devenu le problème du compromis : ça a un côté pratique et t’as pas des sous tout de suite le mois d’après, donc tu réutilises. Fiasko : Mais si tu regardes bien, c’est le seul clip qu’on a fait en VHS avec Big Budha Cheez, et je sais pas si on en refera d’autres. « M.City Citizen » était en VHS, mais après on a fait « Budha Cheez » en pellicule 16 mm, et le dernier qu’on a sorti, « Itinéraire d’un G », c’est de la pellicule et du photomontage. On veut toujours évoluer. La nuit est tombée à présent et nos visages ne sont plus éclairés que par les flashs de l’appareil photo et la lampe à détecteur de mouvements, fixée au mur de parpaings nus qui borde la cour.
Donc vous avez tourné « M.City Citizen » en autodidactes. Pourtant, je le trouve particulièrement méticuleux, en termes de découpage, de cadrage, de lumière, de direction artistique et jusque dans vos attitudes…
Clifto : Bah en fait, mine de rien, c’est un travail qui s’étale sur plusieurs années, même si ça s’est fait assez naturellement.
Et pendant tout ce processus, de quoi vous êtes-vous inspirés ? Qu’est-ce qui vous a imprégnés ?
Fiasko : Miami Vice. Waly : Ouais, on regarde un tas de séries et un tas de films. Fiasko : Non, je rigole, c’était pas Miami Vice… Waly : Si, si, un petit peu. Fiasko : Franchement, je vais te dire la vérité, peut-être que tu trouves ça super précis, mais c’est vraiment le côté bandant de travailler avec de la pellicule ou d’enregistrer sur bande comme nous. Nous personnellement, on n’a rien calculé. Alors comme disait Clif’, c’est peut-être casse-couilles de ne pas avoir ton rendu tout de suite, mais c’est le truc qui fait que quand tu l’as, t’as des surprises de ouf ! Et nous c’était pareil dans le son : « M.City Citizen » ne devait pas du tout sonner comme ça à la base. Ce qui s’est passé, c’est que j’ai fait une prod’ que j’avais sortie en une piste, dont la basse était beaucoup trop forte, mais on avait déjà posé les voix. Avec Dixon, qui est là, on a complètement refait l’instru, de A à Z, et on a posé le nouveau rendu sur les voix. C’était le même BPM, rien n’avait changé, mais c’est devenu tout à fait autre chose. Après, on l’a clippé et tout… mais s’il y a un truc important à saisir, c’est qu’on laisse la place à la surprise. Waly : Après, on fait gaffe quand même, parce qu’avant ça on a quand même essuyé pas mal d’échecs. On avait fait deux-trois clips en pellicule, et dès qu’on recevait les images il y avait un souci. Du coup, on s’est dit que cette fois-ci on allait essayer de faire un truc carré, il y avait de l’organisation.
Comment l’avez-vous écrit ?
Clifto : On a fait un story-board. Waly : On écrit tout à l’avance, ensuite on découpe les parties et on les filme. C’est étalonné sur plusieurs journées. Fiasko : Eux deux, ils écrivent les trucs principaux et ensuite, tout ça, c’est un grand micmac de ce que tu veux faire. On savait qu’on voulait tourner dans une bagnole décapotable sur l’autoroute, ça c’était l’idée de Clif’. Waly : Il y a de la surprise mais rien n’est vraiment laissé au hasard. De la paire de lunettes jusqu’à la caisse, on sait ce qu’on veut. Clifto : Et dans tout ça, il y a une forte influence cinématographique de cette époque. Waly : Et des séries HBO. Clifto : Bah en fait, quand on a fait le clip de « M.City Citizen », on sortait d’une grosse période The Wire et Oz. On avait tous le cerveau bien imprégné. Ça c’est aussi un truc qui regroupe pas mal le collectif, des influences non seulement musicales mais aussi cinématographiques.
Vous avez tout découvert ensemble ?
Waly : Oz, c’est Fiasko qui me l’a faite découvrir. Fiasko : Je suis le premier à l’avoir vue, ensuite je l’ai passée à Waly. The Wire, c’est Clif’ qui me l’a montrée. Waly : Moi c’est mon grand-frère. Et il y a Sopranos aussi, évidemment… Et puis en ce moment il y a Game of Thrones. Fiasko : Ouais, bientôt on va faire un clip…
…avec des dragons ?
On éclate de rire. Clifto : Faut faire gaffe à ce que vous guettez les gars, niveau budget on est limité. Fiasko : Bientôt on va se regarder La Cage aux folles, on va être vert. (Nouveaux éclats de rire.)
En tout cas, ces références communes, ça crée un vrai univers, cohérent de bout en bout.
Waly : Ouais, c’est comme M.City par exemple. On sait pas si c’est Montreuil City ou si c’est vraiment M. City. Comme dans Oz, il y a une partie de la prison qui s’appelle Emerald City, mais qu’ils appellent Em City aussi. On a essayé de créer un monde.
Patience et persévérance
Ça m’a frappé en voyant vos clips, on a beau connaître Paris et Montreuil, on se croirait à L.A. ou New York à certains moments.
Clifto : Oui, parce que le grain donne un truc auquel on n’a pas été habitué en France. Bien sûr, je ne parle pas du cinéma. Mais on est habitué à des images trop propres, avec toutes les conneries qui passent à la télé, parce qu’on n’aime pas prendre de risques. Dès que tu passes ce cap, tu as l’impression d’être ailleurs. Après, je parle pour nous, on n’est pas les seuls à avoir un délire comme ça, mais les gens qui l’ont aussi ne font pas obligatoirement partie de notre culture musicale ou de notre milieu. Nous on vient de Montreuil, de quartiers populaires, et c’est vrai que les mecs hallucinent à chaque fois. Au début, quand on a commencé, ils comprenaient pas. « C’est quoi votre délire ? Pourquoi vous achetez pas un 5D ? » Et en fait, au final, une fois que tu imposes ton truc, ça se démocratise même dans ces milieux-là. Il y en a de plus en plus qui font ce qu’on fait, mais pas naturellement. Clifto met le doigt sur ce qui me fascine : ces trois-là ont grandi dans un quartier populaire et n’ont pas fait d’école pour apprendre ce qu’ils savent et faire ce qu’ils font. Pas à pas et à l’instinct, Clifto, Fiasko et Waly ont redécouvert par eux-mêmes et apprivoisé les règles de l’écriture cinématographique, de toutes les étapes de la confection d’un film et de l’enregistrement analogique, pour produire une œuvre qui leur ressemble.
Comment s’est passée la réception ?
Waly : Il y a eu beaucoup de bons retours, mais heureusement aussi des critiques. S’il n’y avait que du bon, ce ne serait pas normal. La réflexion qui revient souvent, c’est surtout : « On est en 2014, faut arrêter les mecs. »

Fiasko Proximo
Crédits : Ilyes Griyeb
Clifto : Mais la façon dont on a fait le clip et dont a été fait le morceau, c’est aussi une forme de discours ; c’est-à-dire qu’il faut s’attendre à une réponse. Et même quand elle est négative, elle peut être intéressante. Fiasko : Oui, il faut un débat. Il faut que les gens commencent à en discuter. Waly : Quand elle est argumentée, la critique est bonne à prendre, qu’elle soit bonne ou mauvaise. Mais je ne comprends pas ce « on est en 2014 ». Clifto : L’évolution, c’est un truc qui obsède les gens. Ils ne comprennent pas ce retour en arrière, pour eux on n’a pas respecté l’évolution. « Y a des mecs qui se sont faits chier à construire un 7D, pourquoi vous l’avez pas acheté ? » Fiasko : Ça c’était un message de Canon, ils nous ont envoyé un mail. (On éclate de rire.)
Vous avez d’abord sorti un EP trois titres, puis douze, tout cela disponible gratuitement sur Internet ; vous avez réalisé des clips, vous avez fait quelques concerts l’année dernière… mais vous ne vous sentez pas prêts à sortir un album.
Fiasko et Waly : Non, toujours pas.
Quelle est la différence entre ce que vous avez accompli jusqu’à présent et un album ?
Fiasko : L’album, ce n’est pas vraiment une question d’argent, de clips, ou de… Waly : Un peu, quand même. Fiasko : Bien sûr, si demain on sort un album, on le vendra. Mais pour ça, je pense qu’il faut pas mal de maturité. Les gens aujourd’hui sortent des CD comme ça, et la plupart passent à la trappe parce qu’ils se lancent dans un truc qui les bouffe, ça va trop vite pour eux. Nous, justement, ce n’est pas du tout ce qu’on a envie de faire. On veut se laisser le temps, on n’a pas de pression de production parce qu’on est totalement indépendants, et visuellement on ne fait que s’améliorer. Donc à partir du moment où on sortira un album, ce n’est pas qu’on sera au top parce qu’on peut toujours progresser, mais on aura atteint le moment d’une certitude. On n’est pas encore dans l’optique de se dire : « Demain, on s’enferme pendant quatre mois dans un studio. » Clifto : Il y a aussi une volonté, inconsciemment quand on discute – on n’en a jamais parlé, là je vais dire un truc… Fiasko : Tu prends un risque. Clifto me confiera plus tard que c’était sa première interview. À nouveau, je sens le plaisir qu’ils ont à parler de leur travail à un étranger qui s’y intéresse, comme un artisan d’ordinaire peu bavard saisit l’occasion pour exprimer la raison et la forme de son geste. Clifto : Le truc, c’est qu’il y a vraiment une volonté d’imposer le fait que ça reste un acte artistique, qu’importe la forme que ça prend. Que ce soit le live – car c’est quand même quand tu vois l’art en vrai que tu le ressens vraiment – ou tout ce dont on parlait tout à l’heure : le délire du physique, le délire du vrai. Que ce soit un maxi, un projet, un EP ou un véritable album, on veut pouvoir dire que ce qu’on fait est une œuvre avant tout. Fiasko : En fin de compte pour nous, ça n’a pas vraiment d’importance parce que notre but final, c’est de se retrouver sur une putain de scène et de faire kiffer les gens. Si on fait des trois titres ou des douze titres, c’est pour qu’on nous appelle et qu’on nous dise : « Vous voulez pas venir kicker ? » Notre priorité, c’est le live. Après c’est bête à dire, mais tout ce qu’on va faire en studio… ça nous pète pas les couilles, mais ce n’est pas là qu’on trouve le plus de kiff. Avant un concert, tu nous verrais… on est les mecs les plus heureux du monde ! On arrive, on est content. L’année dernière, on a fait une scène à Toulouse, c’était la première fois qu’on sortait d’Île-de-France, franchement c’était magnifique. Waly : Ouais, c’était top.
Vous bossez tous à côté ?
Waly : On bosse à côté, ouais. On n’en vit pas encore, un jour on espère.
Il y a des producteurs qui se sont intéressés à vous après les clips et la scène ?
Fiasko : Non, on n’a pas eu de prod’. Ce qu’il y a de bien, c’est que les gens comprennent qu’il y a un petit délire où on est inaccessible. Si les gens ne se sont pas présentés pour nous dire : « Je peux vous faire signer ça, ça et ça », c’est parce qu’ils savaient très bien qu’on aurait refusé. Donc il y a surtout des mecs qui se sont proposés de nous aider.

« Prince » Waly, après l’entretien
Crédits : Ilyes Griyeb
Clifto : Beaucoup d’artistes sont venus nous voir pour partager des choses. On a même un photographe dans le collectif qui lui-même a fait des trucs par rapport au projet. C’est lui qui a pris la photo de la pochette Budha Cheez / Med Fleed, et lui aussi bosse en argentique. Donc on a plus eu des retours d’artistes, des connexions. Fiasko : Après on a fait un feat. avec Jazzy Bazz. Et maintenant quand on arrive à des concerts, on voit qu’on a un peu de notoriété, et elle est plutôt bonne. Waly : C’est ça, c’est important aussi. Parce que faire un album, le vendre et que ça ne se vende pas, ça fait quand même un peu mal… Un EP, on peut te le faire en deux mois, un album ça demande plus de temps et d’investissement. Clifto : Pour faire un parallèle, le mec qui se sape, qui devient beau gosse et tout, il n’a pas envie d’aller direct dans une soirée discuter avec trente mille meufs pour s’apercevoir que ça ne marche pas, parce que pour lui c’est vraiment une consécration. Nous, on a bossé ça depuis longtemps, on attend d’acquérir une force, d’avoir quelque chose de solide à proposer – parce que l’idée d’un album, c’est vraiment d’être un projet commercial. Fiasko : Et puis on en est encore à un stade où on fait de la recherche, ce n’est pas encore ce qu’on veut. Tous les trucs qu’on a sortis, même les clips, c’est de la recherche. La preuve, c’est qu’on rate encore plein de choses.
Qu’est-ce que vous avez raté ?
Clifto : Au niveau des clips, ça n’a jamais été comme on le voulait à la base. Fiasko : Même « M.City Citizen ». Clifto : C’est le clip le plus proche de ce qu’on voulait. Fiasko : Ouais, alors que « Budha Cheez », quand on a reçu les rushs… (Les deux autres partent d’un rire amer.) Celui-là il a fait très très mal. Clifto : On a failli tous déménager dans un pays lointain. Fiasko : Ce qu’il faut savoir, c’est qu’on a fait un premier clip pour « Budha Cheez » entièrement en 16 mm, qui nous a coûté une blinde. Tout ça pour s’apercevoir quand on a reçu les rushs que c’était tout voilé, il n’y avait aucune image… Mais on a eu quand même des couilles parce que le truc c’est qu’après ce clip-là, on a refait un clip en 16 mm direct. Et là, on s’est dit qu’il fallait pas qu’on fasse la même erreur. Bon, c’était un peu mieux mais c’était pas encore ça. Déjà, on a eu des images. Mais tu vois, ce n’est pas encore abouti, c’est pour ça qu’on attend pour sortir un truc. Même du point de vue du son, on est tout le temps en recherche.
Du coup en ce moment vous travaillez sur quoi ?
Waly : On a un projet avec un gars à nous qui s’appelle Maleek Jays. C’est un mec qui a grandi aux États-Unis, à Washington je crois, et qui vit en France. On a un EP avec lui en préparation. Fiasko : Là, on est plus basés sur des feats qu’on devait faire avec des gens. Parce que pendant longtemps on a été focalisé sur nos trucs et on ne prenait pas les feats, on mettait un peu ça de côté. Mais vu qu’on est un peu dans une période creuse… Waly : Ça fait plaisir aussi, hein. Clifto : D’un côté, on bosse sur le collectif, on a vraiment ressoudé Exepoq ; et en même temps on bosse aussi avec d’autres gens parce qu’on a fait des rencontres. Mais bon, après on est ensemble quoi qu’il arrive. La vie fait que de toute façon on est ensemble. On habite presque tous dans la même rue. Fiasko : (Il ironise, à l’attention de Waly.) Enfin plus maintenant. À une certaine époque. Y en a qui ont réussi, qui ont percé. Y en a qui ont leur appart’ de 25 m², qui ont niqué tout le monde, qui ont pris les droits Sacem et qui se sont tirés avec. (Clifto est mort de rire.) Non, je rigole… Ah et puis un dernier truc, on n’en a pas parlé et on aurait dû le dire avant, c’est que dans « Budha Cheez », il y a moi et Waly, mais il y a quand même une autre personne importante, c’est Papa Lex, le chanteur. C’est ça aussi qui démarque le contenu, musicalement. Il a une culture de ouf et c’est un peu paradoxal, parce que lui a un peu plus de cinquante ans. Il faisait du rock, avant. On s’est trouvé et ça a été le déclic.
Et vous, vous avez quel âge ?
Fiasko : On a vingt-deux ans.

Big Budha Cheez
Crédits : Ilyes Griyeb
Couverture : Le QG du groupe à l’Albatros, par Ilyes Griyeb.
L’article Une soirée avec Prince Waly au début de sa carrière est apparu en premier sur Ulyces.
14.07.2022 à 00:00
L’odieux divorce de Donald et Ivana Trump
whodunit
Mar-a-Lago « Nous avons une vieille coutume ici à Mar-a-Lago », annonça Donald Trump lors d’un dîner dans son palais d’hiver de 118 pièces à Palm Beach. « Notre tradition consiste à faire un tour de table après dîner et à se présenter les uns aux autres. » Trump paraissait agité ce soir-là, pressé de voir le dîner […]
L’article L’odieux divorce de Donald et Ivana Trump est apparu en premier sur Ulyces.
Texte intégral (15585 mots)
Mar-a-Lago
« Nous avons une vieille coutume ici à Mar-a-Lago », annonça Donald Trump lors d’un dîner dans son palais d’hiver de 118 pièces à Palm Beach. « Notre tradition consiste à faire un tour de table après dîner et à se présenter les uns aux autres. » Trump paraissait agité ce soir-là, pressé de voir le dîner se terminer pour pouvoir aller se coucher. « Vieille habitude ? Il n’a la maison de madame Post que depuis quelques mois. Franchement ! Je rentre à la maison », murmura un habitant de Palm Beach à son amie. « Oh, reste », dit-elle. « Ça va être drôle. »
C’était au printemps 1986. Donald et Ivana Trump étaient assis chacun à une extrémité de leur longue table Sheraton, dans l’ancienne salle à manger de Marjorie Merriweather. Leur attitude était impériale, comme s’ils étaient un roi et une reine. Ils étaient alors au plus haut de leur réussite, au summum de leur gloire. Trump apparaissait dans les journaux télévisés, offrant ses services pour négocier avec les Russes. On disait qu’il allait peut-être se présenter aux élections présidentielles. Ivana avait eu tellement de publicité qu’elle offrait maintenant aux journalistes venus l’interviewer un dossier de presse avec des vidéos assurant sa promotion. Le prestige des Trump avait atteint une telle ampleur dans la ville sacrée de New York que tout semblait possible. Il faisait doux ce soir-là à Palm Beach ; Ivana portait une robe bustier. L’air transportait des effluves de laurier-rose et de bougainvillier, mêlées à la légère odeur d’humidité qui collait à la vieille maison.
À sa décharge, Trump n’avait pas tenté de donner dans le style classique de Palm Beach avec blazer bleu marine et pantalon en lin. Il portait souvent un costume à table et sa seule concession à la mode locale était d’arborer une cravate rose ou des chaussures pâles. Ivana servait toujours les plats préférés de son mari lors des dîners ; ce soir-là les invités eurent donc droit à du bœuf avec des pommes de terre. Le faux Tiepolo peint au plafond du temps de madame Post était resté dans la salle à manger, mais un immense saladier argenté trônait maintenant au centre de la table, rempli de fruits en plastique. Comme toujours avec les Trump, il s’agissait de business. C’était leur but commun, ce qui les liait.
Depuis quelques années, ils semblaient ne jamais partager la moindre intimité en public. Ils étaient devenus moins un mari et une femme que deux ambassadeurs de deux différents pays, ayant chacun leur agenda. Les Trump n’avaient acheté Mar-a-Lago que quelques mois auparavant mais ils étaient déjà devenus la curiosité de Palm Beach. En face de chez eux se trouvait le Bath and Tennis Club, « The B and T » comme l’appelaient les habitants du coin, et on disait que les Trump n’avaient pas encore été invités à s’y joindre.
« Foutaises ! Ils me baisent les pieds à Palm Beach », me disait Trump quatre ans plus tard. « Ces faux-culs ! Le club m’a contacté pour savoir s’ils pouvaient utiliser un morceau de ma plage pour étendre leur surface d’installation de cabanons ! J’ai dit : “Bien sûr !” Vous pensez qu’ils m’auraient dit non si j’avais demandé à être membre ? Je ne m’inscris pas à ce club parce qu’ils refusent les noirs et les juifs. » Comme si Mar-a-Lago et le yacht Princess des Trump étaient les propriétés de Gatsby le Magnifique, les invitations étaient très prisées. Les snobs locaux adoraient se délecter d’anecdotes sur les Trump. Mais là ! Embarrasser leurs invités en leur faisant prendre la parole, comme s’ils étaient à une convention de vente !
Quand ce fut au tour d’Ivana de se présenter, elle se leva prestement. « Je suis mariée au plus merveilleux des époux. Il est si généreux et intelligent. Nous avons tant de chance d’avoir cette vie. » Elle le fixa désespérément mais il ne dit rien en retour. Il semblait fatigué d’écouter les louanges sans fin d’Ivana et son attitude assujettie avait l’air de l’exaspérer. Peut-être avait-il envie de quelque chose d’excitant, d’une dispute. Peut-être aussi qu’il se lassait de ce jeu de posture publique. « Bon, j’ai fini », dit-il avant le dessert, jetant sa serviette sur la table avant de quitter la pièce. Palm Beach était l’idée d’Ivana Trump.
Longtemps auparavant, Donald lui avait crié : « Je ne veux rien de tout ce à quoi tu aspires socialement. Si c’est ça qui te rend heureuse, change de mari ! » Mais elle n’avait pas du tout l’intention de faire ça car Ivana, comme Donald, vivait dans un fantasme. Elle savait que dans la vie d’un Trump, tout et tout le monde semblait avoir un prix, ou pouvait être utile dans le futur. Ivana avait appris à ignorer Donald quand il disait à des amis proches durant les premières années de leur mariage : « Pourquoi est-ce que je lui achèterais de beaux bijoux ou tableaux ? Pourquoi lui offrir des actifs négociables ? »
Elle était sortie d’Europe de l’Est en s’endurcissant et en étant très disciplinée, et elle avait travaillé ses talents en observant son époux, le maître des manipulateurs. Elle avait appris la langue commune dans un monde où tout le monde semblait utiliser tout le monde dans une course au pouvoir sans répits. Comment aurait-elle pu savoir qu’on pouvait vivre autrement ? De plus, elle disait souvent à ses amies que malgré la cruauté dont Donald pouvait faire preuve, elle était très amoureuse de lui.
Ce soir-là, Ivana avait réussi à inviter l’éditeur du journal local, The Shiny Sheet. Comme d’habitude, les invitations que Donald avait lancées pour ce weekend étaient des rétributions, car il faisait confiance à très peu de gens. Il avait fait venir l’un de ses chefs de construction, le maire de West Palm Beach, et l’ancien gouverneur de New York, Hugh Carey, qui, à l’époque où il dirigeait l’État sous le surnom de « Society Carey » grâce à de grosses donations de Trump, avait joué un rôle clé dans ses premiers succès. Depuis des années, Ivana semblait avoir étudié le comportement public des familles royales. Ses amies appelaient ça « le syndrome du couple impérial d’Ivana », et elles se moquaient gentiment d’elle sur ce point car elles savaient qu’Ivana, comme Donald, s’inventait et se réinventait constamment.
Quand elle était arrivée à New York, la première fois, elle portait des coiffures casques élaborées et des robes de satin bouffantes, très Hollywood. L’image qu’elle avait de la riche américaine lui venait sûrement des films quelle avait vus étant enfant. À ce stade, Ivana avait déjà passé des années dans les salons les plus raffinés de New York sans toutefois avoir saisi les vraies manières des gens riches, l’art de la subtilité. À la place, elle avait adopté une allure royale et rempli ses maisons du genre d’ornements de laiton qu’on trouve dans les palais d’Europe de l’Est. Elle avait pris l’habitude de saluer ses amis de tout petits gestes de la main, comme s’il lui fallait conserver son énergie. Lors de ses propres galas de charités, elle insistait pour qu’elle et Donald reçoivent les invités en ligne. Elle portait des talons pointus et ne s’enfonçait jamais dans l’herbe. Toujours sous contrôle.
Ce soir de printemps, un escadron de domestiques attendait dehors pour accueillir les invités, comme on l’aurait fait à Cliveden dans l’entre-deux guerres. La plupart des employés, cependant, n’étaient pas des permanents de Mar-a-Lago ; c’étaient des traiteurs locaux et des gardiens de parking embauchés pour la soirée. En plus de la peinture de plafond de la salle à manger, Ivana avait gardé les vieux canapés à franges et les poufs marocains exactement à leur place, donnant ainsi l’impression de s’essayer aussi à la personnalité de madame Post.
L’un des rares signes du goût des nouveaux propriétaires résidait dans la présences de dizaines de cadres argentés répartis sur les nombreuses dessertes. Les cadres ne contenaient pas de photo de famille mais des couvertures de magazines. Chaque couverture affichait le visage de Donald Trump. Quand l’avion des Trump atterrissait à Palm Beach, il y avait en général deux voitures qui attendaient. La première, une Rolls-Royce, pour les adultes, et la seconde, un break, pour les enfants, les nourrices et un garde du corps. Parfois, des agents de sûreté ouvraient la voie pour accélérer le passage du cortège des Trump. Cela demandait beaucoup de planification et de coordination, mais l’effort était crucial pour ce qu’Ivana essayait d’accomplir. « Dans 50 ans, Donald et moi seront considérés comme une vieille famille, comme les Vanderbilt », dit-elle un jour à l’écrivain Dominick Dunne.
Ivana
En avril 1990, alors que son empire était à deux doigts de s’effondrer, Trump s’isola dans un petit appartement dans un des bas étages de la Trump Tower. Il s’allongeait sur son lit, fixant le plafond, parlant toute la nuit au téléphone. Les Trump s’étaient séparés. Ivana resta en haut, dans le triplex familial aux sols d’onyx beige et au salon à bas-plafond décoré de fresques dans le style de Michel-Ange. Les fresques avaient occasionné l’une de leurs disputes les plus fréquentes : Ivana voulait des chérubins, Donald préférait des guerriers. Ce sont les guerriers qui avaient remporté la bataille. « En terme de qualité, ce travail aurait tout à fait sa place au plafond de la chapelle Sixtine », disait Trump à propos de la peinture.
Cet avril-là, Ivana commença à dire à ses amis qu’elle s’inquiétait pour la santé mentale de Donald. Elle avait été complètement humiliée par Donald lorsqu’il s’était affiché publiquement avec Marla Maples. « Comment peux-tu dire que tu nous aimes ! Tu ne t’aimes même pas toi-même. Tu n’aimes que ton argent », aurait dit à son père Donald junior, âgé de 12 ans, d’après des amis d’Ivana. « Quel genre de fils ai-je engendré ? » aurait demandé Mary, la mère de Trump, à Ivana. Aussi improbable que cela puisse paraître, Ivana était à présent considérée comme une héroïne des tabloïds, et sa popularité augmentait dans une proportion inverse de celle du nouveau dégoût qu’éprouvait la ville changeante pour son mari. « Ivana est maintenant une déesse des médias au même titre que Lady Di, Madonna et Elizabeth Taylor », rapporta Liz Smith.
Plusieurs mois auparavant, Ivana avait subi de la chirurgie esthétique auprès d’un médecin californien. Elle était sortie de là méconnaissable aux yeux de ses amis et peut-être même de ses enfants, aussi fraîche et innocente que la petite Heidi sans ses montagnes suisses. Bien qu’elle eût négocié quatre contrats de mariages différents concernant la propriété immobilière pendant les quatorze années précédentes, elle attaquait son mari pour obtenir la moitié de ses possessions. Trump se voulait philosophe. « Quand un homme quitte une femme, surtout quand on a l’impression qu’il l’a quitté pour une paire de fesses – et une belle ! –, il y a toujours la moitié de la population qui va s’éprendre de la femme quittée », me dit-il.
Ivana avait embauché un responsable des relations publiques pour l’aider dans son nouveau rôle. « Tout est très calculé », me dit un de ses conseillers. « Ivana est très rusée. Elle joue son rôle à fond. » Plusieurs étages sous l’appartement des Trump, des touristes japonais envahirent le lobby de la Trump Tower avec leurs appareils photos. Inévitablement, ils prirent des photos du portrait familier de Trump qui avait fait la couverture de son livre Trump: The Art of Deal, et qui était posé sur un chevalet devant l’agence immobilière de la Trump Tower. Les Japonais prenait encore Donald Trump pour l’incarnation du pouvoir et de l’argent et semblaient penser, comme Trump l’avait fait avant eux, que ce monument de marbre rouge et de laiton était le centre du monde.
Trump est une girouette, toujours en train de se retourner pour voir qui d’autre est dans la salle.
Pendant des jours, Trump quitta à peine l’immeuble. Des hamburgers et des frites lui étaient livrés depuis le fast-food située à proximité. Son corps gonfla, ses cheveux bouclèrent le long de son cou. « Tu me rappelles Howard Hughes », lui dit un de ses amis. « Merci », répondit Trump. « Je l’admire. » Au téléphone, il semblait bouillonnant, sans soucis, aussi confiant que sur le portrait dans le lobby. Comme John Connaly, l’ancien gouverneur du Texas, Trump avait des millions de dollars déposés en garanties personnelles. Sa dette personnelle, rien que sur la compagnie aérienne Trump Shuttle, était de 135 millions de dollars. Bear Stearns s’était vu garantir 56 millions de dollars pour les positionnements de Trump sur Alexander’s et American Airlines. Le casino Taj Mahal avait une série de dispositions compliquées qui rendait Trump responsable de 35 millions de dollars. Trump avait personnellement assuré l’hôtel Plaza pour 125 millions.
À West Palm Beach, Le Plaza de Trump était tellement vide qu’il était surnommé the Trump See-through (« le fond transparent de Trump »). Cet immeuble à lui seul pesait 14 millions de dollars en dettes personnelles. Les demeures de Trump à Greenwich et Palm Beach, ainsi que le yacht, avaient été promis aux banques pour 40 millions de dollars de remboursement de crédits impayés. Le Wall Street Journal estimait que les garanties de Trump pouvaient dépasser les 600 millions de dollars. En une décennie époustouflante, Donald Trump était devenu le Brésil de Manhattan. « Quiconque est quelqu’un s’assoit entre les colonnes. Le pire c’est la nourriture, mais de là tu verras tout le monde », m’avait dit Donald Trump dix ans plus tôt au Club 21. Donald s’était déjà taillé une place dans ce temple new-yorkais. On nous assit immédiatement entre les colonnes, dans la vieille salle du haut, alors décorée de lambris noir et de banquettes en Naugahyde rouges.
C’était à l’automne 1980, une belle saison à New York. Les Yankees étaient en bonne voie pour remporter la saison ; une star de cinéma se présentait aux présidentielles et utilisait le terme « dérégulation » dans sa campagne. Donald était un nouveau à l’époque, il avait 34 ans, et il était très effronté. Il commençait tout juste à apparaître dans les journaux et il adorait ça. On parlait déjà de lui dans les quotidiens et les hebdomadaires mais il rêvait d’une attention nationale. « Vous avez vu que le New York Times trouve que je ressemble à Robert Redford ? » me demanda-t-il.
Entre 1980 à 1990, Trump n’avait pas beaucoup changé physiquement. Il avait déjà des pommettes saillantes et une mâchoire présente, avec une tendance à avoir l’air mou au milieu. Il avait conservé ses cheveux blonds, garantie de jeunesse, et le visage élastique. Trump est une girouette, toujours en train de se retourner pour voir qui d’autre est dans la salle. Quand il était petit garçon, il ne laissait aucun répit non plus. « Donald était l’enfant qui, aux goûters d’anniversaire, jetait du gâteau partout », me dit une fois son frère Robert. « Si je construisais une pile de Lego, Donald arrivait et les collait les uns aux autres, si bien qu’ils devenaient inutilisables. » Et en 1980, il était déjà marié à Ivana, un ancien mannequin et athlète de Tchécoslovaquie.
Un soir de 1976, Trump se trouvait au bar du Maxwell’s Plum. Ça n’existe plus aujourd’hui, mais le nom même évoque des hordes de célibataires frénétiques sous un plafond Art Nouveau. C’était le lieu où les hôtesses de l’air espéraient rencontrer un banquier, et où les mannequins se cherchaient des rendez-vous galants. Donald y rencontra son top modèle, Ivana Zelnickova, qui venait de Montréal. Elle aimait raconter l’histoire de comment elle avait été skier avec Donald, faisant semblant d’être une débutante comme lui avant de l’humilier en le doublant dans les slaloms. Ils se marièrent à New York à Pâques 1977. Le maire Beame était présent à l’église Marble Collegiate. Donald avait déjà fait alliance avec Roy Cohn, qui allait devenir son avocat et son mentor.
Juste avant le mariage, Donald aurait dit à Ivana : « Tu dois signer cet accord. » « Qu’est-ce que c’est ? » demanda-t-elle. « Juste un document qui va protéger l’argent de ma famille. » Cohn fit l’offre galante d’aider Ivana à trouver un avocat. « Nous n’avons pas ce type de documents en Tchécoslovaquie », répondit apparemment Ivana. Mais elle dit à ses amis qu’elle était terrifiée par Cohn et par le pouvoir qu’il avait sur Donald. Dans le premier contrat, Ivana obtenait 20 000 dollars par an. Deux ans plus tard, Trump avait constitué sa propre fortune. « Tu ferais mieux de revoir le contrat, Donald », lui aurait dit Cohn. « Sinon tu vas avoir l’air dur et radin. » Ivana résista. « Si ça ne te plaît pas, garde le vieux contrat », aurait répondu Trump.
Donald était déterminé à avoir une famille nombreuse. « Je veux cinq enfants, comme dans ma famille, parce qu’avec cinq, je suis sûr d’en voir un tourner comme moi », confia Donald à l’un de ses amis proches. Il était prêt à être généreux avec Ivana et la rumeur courut qu’il lui donnerait une récompense en liquide de 250 000 dollars pour chaque enfant. Les Trump et leur bébé, Donald junior, habitaient un appartement de la 5e Avenue décoré de sofas en velours beige et d’une table en os et peau de chèvre provenant du magasin de meubles italien Casa Bella. Ils avaient une collection d’animaux en verre Steuben qu’ils exposaient sur des étagères de verre dans le hall d’entrée. Les étagères étaient soulignées de petites guirlandes de lumières blanches qu’on voit habituellement sur les sapins de Noël.
Donald essayait de s’adapter au monde des esthètes et des petites robes de cocktail noires. Il venait de terminer le Grand Hyatt, sur la 42e rue, et était considéré comme un jeune talent. Il avait assemblé la parcelle de la 5e Avenue qui allait devenir la Trump Tower et avait fait enrager l’establishment de la ville en détruisant les frises art déco qui ornaient l’immeuble Bonwit Teller. Déjà, à l’époque, le style de Trump consistait à exciter le publique. « Qu’est-ce que vous croyez ? Vous pensez que ça m’a fait mal de détruire les sculptures ? » me demanda-t-il ce jour-là au « 21 ». « Oui. » « Qu’est-ce qu’on s’en fout ? » dit-il. « Disons que j’aie donné ces merdes au Met. Ils n’auraient fait que les mettre à la cave. Je n’aurai jamais la bienveillance de l’establishment, des décideurs de New York. Vous croyez que si j’échouais, ces types à New York seraient malheureux ? Ils seraient aux anges ! Parce qu’ils n’ont jamais rien tenté à l’échelle de ce que moi j’essaye de faire dans cette ville. Je me fiche de leur bienveillance. »
Donald était un peu un grand enfant, mal dégrossi et à l’ego surdimensionné. Il avait apporté le style de Brooklyn et du Queens à Manhattan, bafouant ce qui était pour lui des conventions inutiles, comme la préservation des lieux symboliques. Ses costumes étaient mal coupés, avec de grands revers au pantalon. Il ne lui manquait que le cigare. « Je ne me donne pas d’airs », me dit-il à l’époque. Il se baladait dans New York dans une Cadillac argentée avec des plaques « DJT » et des vitres tintées, et son chauffeur était un ancien flic de la ville. Ce jour-là, Donald et moi n’étions pas seuls à déjeuner. Il avait invité Stanley Friedman à se joindre à nous. Friedman était un des associés de Roy Cohn, et comme lui, une légende dans la ville. Il faisait partie de la machine politique du Bronx, et allait bientôt en être nommé chef du département.
Plus tard, Friedman irait en prison pour le rôle qu’il allait jouer dans le scandale des parcmètres. Trump et Friedman passèrent la majeure partie du déjeuner à s’échanger des anecdotes sur John Cohn. « Roy peut tirer d’affaire n’importe qui en ville », me dit Friedman. « C’est un génie. » « C’est un avocat nul, mais c’est un génie », dit Trump. À un moment donné, Preston Robert Tisch, connu de tous sous le nom de Bob, débarqua dans la salle du haut du « 21 ». Bob Tisch et son frère, Laurence, aujourd’hui à la tête de CBS, avaient fait fortune dans l’immobilier new-yorkais et en Floride. Bob Tisch, comme son frère, était un citadin, un homme bienveillant et élégant, bienfaiteurs des hôpitaux et des universités. « J’ai battu Bob Tisch sur le site du centre de conventions », dit Donald à très haute voix au moment où Tisch s’arrêtait notre table. « Mais maintenant on est amis, bons amis, n’est-ce pas Bob ? C’est pas vrai ? » Bob Tisch garda le sourire mais son ton devint brusquement aigu, comme celui d’un enfant qui se serait mal conduit. « Oh oui, Donald », dit-il, « de bons amis, de très bons amis. »
Vers la fin des vendredis après-midi d’été, le bruit de la ville est remplacé par un calme étrange. En juin, je me trouvais en compagnie de l’un des avocats les plus combatifs de Donald Trump. « On ne gagnera certainement pas l’opinion dans la presse populaire », me dit-il, « mais on gagnera, vous verrez. » Je pensai à Trump, à quelques pâtés de maisons de là, isolé dans la Trump Tower, se battant pour sa survie financière. Le téléphone sonna plusieurs fois. « Oui, oui ? C’est comme ça ? » dit l’avocat avant d’éclater de rire en évoquant les – comme il les appelle – « couilles de laiton » de son client, qui tenait tête aux nombreux types représentant Chase Manhattan et Bankers Trust, à qui il devait des centaines de millions de dollars.
« Donald est très en forme. C’est le genre de défi qu’il aime », me dit l’avocat. « C’est bizarre. On croirait que rien ne va mal. » « Ne croyez rien de ce que vous lisez dans les journaux », avait dit Trump à son éditeur Joni Evans. « Quand ils vont entendre de bonnes nouvelles à mon sujet, qu’est-ce qu’ils vont faire ? » Random House se hâtait de publier son nouveau livre, Trump: Surviving at the Top. Le premier tirage était de 500 000 exemplaires. Dans la salle de conférence de la Trump Tower, cette semaine-là, un avocat avait apparemment dit à Trump une évidence : l’hôtel Plaza ne rapporterait peut-être jamais les 400 millions qu’il l’avait payé. Trump resta serein. « Passez-moi le Sultan de Brunei au téléphone », dit-il. « J’ai la garantie personnelle que le Sultan de Brunei me reprendra le Plaza et que je ferai un immense profit. »
Les banquiers et les avocats dans la salle de conférence regardèrent Trump avec un mélange d’incrédulité et d’émerveillement. Aussi cyniques soient-ils, Trump, le virtuose de l’immobilier, avait sur eux le pouvoir de l’imagination car son plus grand talent avait toujours été de savoir convaincre les autres du champ des possibles. La frontière entre l’escroc et l’entrepreneur est souvent floue. « Ils disent que le Plaza vaut 400 millions de dollars ? Trump dit qu’il en vaut 800 millions. Qui sait combien ça vaut en réalité ? Je peux vous dire une chose : ça vaut bien plus cher que ce que je l’ai payé », me confia Trump. « Quand Forbes dévalue toutes mes propriétés, ils disent que je ne vaux que 500 millions ! Et bien, c’est 500 millions de plus que ce avec quoi j’ai débuté. » « Les gens pensent-il vraiment que j’ai des problèmes ? » me demanda Trump en 1990. « Oui », lui répondis-je alors, « ils pensent que vous êtes fini. »
C’était un après-midi de juillet, la poussière semblait retomber, et nous étions au beau milieu d’une conversation téléphonique de deux heures. La conversation en elle-même était une négociation. Trump tentait de me mettre sur la défensive. J’avais écrit à son sujet dix ans auparavant. Trump avait alors parlé d’un de ses amis proches qui était le fils d’un célèbre promoteur new-yorkais. « Je lui ai conseillé de sortir de l’ombrage de son père », m’avait-il dit alors. « C’était du off », me dit Trump. Je consultai mes vieilles notes. « Faux, Donald », dis-je. « Ce qui était off, c’est quand vous avez attaqué votre autre ami en disant qu’il était alcoolique. » Du tac au tac, Trump répliqua : « Je vous crois. » Puis il rit. « Certaines choses ne changent jamais. » « Attendez cinq ans », me dit Trump. « C’est très simple. C’est comme le contrat Mery Griffin. Quand je l’ai roulé, la presse voulait que je perde. Ils ont dit : “Bordel de Dieu ! Trump s’est fait prendre !” Laissez-moi vous dire quelque chose. C’est bon pour moi qu’on me croit pauvre maintenant. Vous ne me croiriez pas si je vous parlais des marchés que je suis en train de signer. J’imagine que je suis pervers… j’ai vraiment adoré les semaines qui viennent de s’écouler », dit-il, comme s’il sortait d’un spa rajeunissant.
Les marchés avaient toujours été son seul art. On disait alors qu’il signait des contrats incroyables avec les prestataires qu’il avait employés pour construire ses casinos et les éléphants en fibre de verre qui décoraient l’allée menant au Taj Mahal. Ces derniers étaient désespérés car ils n’étaient pas certains d’être payés pour ces mois de travail. Trump était célèbre pour sa capacité à tirer jusqu’au plus petit profit de ses transactions. On savait qu’il signait alors des accords complètement fous, qu’il n’aurait jamais pu conclure deux mois auparavant. « Trump ne signe aucun deal à moins qu’il n’y ait un petit plus, une petite goutte de larcin moral », disait de lui un de ses rivaux. « Les choses devenaient trop faciles pour moi », me dit Trump. « J’ai fait beaucoup d’argent et je l’ai fait trop facilement, au point de m’ennuyer. Tout ce que j’ai fait a marché ! J’ai repris le Bally, j’ai gagné 32 millions de dollars. Au bout d’un moment, c’est devenu trop facile. »
La peur de l’ennui a toujours joué un grand rôle dans la vie de Trump. Il a une capacité d’attention réduite. Il semblait même s’être lassé de sa femme. Il me dit qu’il s’était lassé de ses contrats, de ses sociétés, « des hypocrites de New York », « des hypocrites de Palm Beach », de la plupart des gens, des auteurs « négatifs » et des gens « négatifs » en général. « Tu frappes, tu frappes et tu frappes encore, et finalement ça ne veut plus dire grand choses », dit-il. « Eh, quand vous m’avez rencontré pour la première fois, je n’avais quasiment rien fait ! J’avais construit un immeuble ou deux, ce n’était pas extraordinaire. »
Ce matin de 1990, Trump avait une fois de plus fait la une du New York Daily News parce que Forbes l’avait retiré de la liste des hommes les plus riches du monde, fixant son réseau à 500 millions de dollars alors qu’il était de 1,7 milliard de dollars en 1989. « Il me mettent en une pour cette raison minable ! » dit Trump. « S’ils me mettent en couverture du Daily News, ils vendent plus de journaux ! Ils me mettent en une aujourd’hui alors qu’il y a des guerres qui éclatent ! Vous savez pourquoi ? Malcom Forbes s’est fait jeter du Plaza ! Par mes soins ! Vous connaissez l’histoire sur Malcom Forbes et moi, quand je l’ai sorti de l’hôtel Plaza ? Non ? Et bien je l’ai fait. Vous pourrez lire l’histoire dans mon nouveau livre. Et je ne l’ai pas viré parce qu’il n’avait pas payé sa note. Je m’attendais donc à cette attaque de Forbes. Le même auteur qui a écrit cet article a également écrit celui sur Mery ! Le même auteur fait l’objet d’une enquête. Vous avez entendu parler de ça non ? »
(Un des auteurs de Forbes faisait l’objet d’une enquête pour utilisation frauduleuse de cartes policières périmées. Il n’avait pas écrit que Trump s’était fait avoir par Mery Griffin.) « Ce qui m’est arrivé est ce qui arrive à toutes les sociétés aux États-Unis en ce moment. Il n’y a pas une entreprise aux États-Unis qui ne fait pas de restructuration. Vous n’avez pas vu le Wall Street Journal ce matin au sujet de Revlon ? Ce qui se passe à Revlon est exactement ce qui est arrivé à Donald Trump. Mais personne n’en fait la couverture d’un journal. Mes problèmes ne méritaient même pas une colonne de ce journal. » (Revlon vendait 182 millions de dollars de marchandise pour récupérer de l’argent, mais ça n’avait rien à voir avec la crise de Trump.)
Trump débitait un torrent de mots hypnotique et sans fin. Souvent, il semblait dire ce qui lui passait par la tête. Il parlait de lui à la troisième personne : « Trump dit… Trump croit. » Ses phrases pétillaient et se retournaient sur elles-mêmes comme des feux d’artifice dans un ciel d’été. Il me faisait penser à un marchand de foire tentant d’ameuter les passants sous sa tente. « Je suis plus populaire aujourd’hui que je ne l’étais il y a deux mois. J’estime qu’il y a deux publics. Le vrai public et la haute société merdique de New York. Le vrai public a toujours aimé Donald Trump. Le vrai public sait que Donald Trump traverse une phase de lynchage. Quand je sors en ce moment, c’est dingue. Je suis assailli, c’est la folie complète », me dit Trump. Trump est souvent belliqueux, comme pour épicer les choses.
Pendant une de nos conversations téléphoniques, il s’en prit à un auteur local qu’il qualifia de « honteux » et massacra la femme d’un investisseur que je connaissais en la traitant de « géant – un véritable poteau du point de vue physique ». Après la signature du contrat du Resort International, lors de la soirée du Nouvel An de Barbara Walters et Mery Adelson dans leur résidence d’Aspen, on demanda à Trump de formuler un vœu pour l’année à venir. « Je souhaiterais avoir un autre Mery Griffin à abattre », dit-il. Avant l’ouverture du Taj Mahal, Marvin Roffman, un analyste financier de Philadelphie, dit à juste titre que le Taj était parti pour un chemin semé d’embûches. À cause de ça – selon Roffman –, Trump l’a fait licencier. « Est-ce pour cela que vous l’avez attaqué ? » demandai-je à Trump. « Je le referais. Voilà un type qui m’appelait en me suppliant d’acheter des actions à travers lui, et qui en échange me ferait des commentaires positifs. » « Vous l’accusez de fraude ? » demandai-je. « Je l’accuse d’être mauvais dans ce qu’il fait. »
Le sénateur John Dingell, du Michigan, demanda au gouvernement d’enquêter sur les circonstances de son licenciement. Quand je demandai à Roffman de me parler des accusations que Trump portait à son encontre, il dit : « C’est le plus gros ramassis de mensonges que j’ai entendu de toute ma vie. » L’avocat de Roffman, James Schwartzman, qualifia les accusations de Trump d’ « acte désespéré d’un homme désespéré ». Roffman poursuivit Trump pour diffamation. « Donald croit en la théorie du grand mensonge », m’avait dit son avocat. « Si vous répétez quelque chose encore et encore, les gens finiront par vous croire. » « Un de mes avocats a dit ça ? » dit Trump quand je lui en parlai. « Si l’un de mes avocats a dit ça, je voudrais savoir lequel pour pouvoir le virer. J’aimerais bien savoir qui est cette ordure ! »
L’art des affaires
L’un des premiers gros contrats de Trump à New York fut d’acquérir un terrain sur le 34e ouest mis en vente par la Penn Central Railroad, alors en faillite. Trump soumit un plan de centre de conventions aux responsables de la ville. « Il nous a dit qu’il renoncerait à ses 4,4 millions de dollars de commission si nous donnions le nom de son père au centre de conventions », me confiait alors l’ancien adjoint au maire Peter Solomon. « Quelqu’un a fini par lire le contrat. Il n’était écrit nulle part qu’une telle somme devait lui revenir. C’était incroyable. Il a presque obtenu de voir le centre baptisé du nom de son père en échange d’une somme d’argent qu’il n’avait jamais vraiment eu à donner. »
Le premier vrai coup d’immobilier de Trump à New York fut l’acquisition de l’hôtel Commodore, qui allait devenir le Grand Hyatt. Ce contrat, signé en incluant un abattement d’impôt controversé de la part de la ville, fit la réputation de Trump. Ses associés de l’époque était les Pritzker, une famille très respectée de Chicago, alors propriétaires de la chaîne Hyatt. Leur contrat était précis : Trump et Jay Pritzker s’étaient mis d’accord sur le fait qu’en cas de litige, ils auraient une période de dix jours pour arbitrer leur différent. À un moment donné, ils eurent un petit désaccord. « Jay Pritzker partait pour un voyage au Népal, où il serait injoignable », me dit un des avocats de la famille Pritzker. « Donald a attendu que Jay soit dans l’avion pour l’appeler. Naturellement, Jay ne pouvait pas le rappeler. Il était sur une montagne au Népal. Plus tard, Donald n’a cessé de répéter : “J’ai essayé de te joindre. Je t’ai donné les dix jours. Mais tu étais au Népal.” C’était scandaleux. Pritzker était son associé, pas son ennemi ! Voilà comment il s’est comporté sur son premier contrat important. »
Plus tard, Trump relata même l’incident dans son livre. « Sers leur la soupe habituelle à la Trump », dit-il à l’architecte Der Scutt avant une présentation du design de la Trump Tower lors d’une conférence de presse en 1980. « Dis leur que ça va faire 10 000 m2, 68 étages. » « Je ne mens pas, Donald », répondit l’architecte.
Trump finit par racheter les parts d’espace commercial de la Trump Tower à Equitable Life Assurance. « Il a payé Equitable 60 millions de dollars après une négociation au bras de fer », me dit un grand promoteur. « Les actions pour tout l’espace commercial s’élevaient à 120 millions de dollars. Soudainement, Donald disait que ça en valait 500 millions ! » Quand The Art of the Deal fut publié, il dit au Wall Street Journal que le premier tirage serait de 200 000 exemplaires. Il gonflait le chiffre de 50 000. Au mois de mars, quand Charles Feldman, de CNN, questionna Trump sur l’effondrement de son empire, Trump sorti en trombe du studio.
Plus tard, il dit au patron de Feldman, Ted Turner : « Ton journaliste a menacé ma secrétaire et l’a fait pleurer. » Quand la bourse s’effondra, il annonça qu’il s’était retiré à temps et qu’il n’avait rien perdu. En fait, il avait pris un sérieux coup sur ses actions Alexander’s et American Airlines. « Ce que j’ai dit c’est que mis à part les actions Alexander’s et American Airlines, je m’étais retiré des marchés », me dit Trump rapidement. Quelles forces, dans le passé de Trump, ont bien pu générer en lui un tel besoin d’autopromotion ?
En 1980, je rendis visite au père de Trump dans ses bureaux de l’avenue Z, près de Coney Island, à Brooklyn. La fortune personnelle de Fred Trump dans l’immobilier s’était faite avec l’aide de la machine politique de Brooklyn, et en particulier celle de Abe Beame. Dans les années 1940, Trump et Beame partageaient un ami proche et avocat, un chef de parti politique à Brooklyn de nom de Bunny Lindenbaum.
À l’époque, Beame travaillait au bureau du budget de la ville ; 30 ans plus tard, il en deviendrait le maire. Trump, Lindenbaum et Beame se croisaient souvent lors des dîners et des galas de charité des clubs politiques de Brooklyn. Le pouvoir de ces clubs dans le New York des années 1950 n’était pas à sous-estimer ; ils donnèrent naissance à Fred Trump et lui permirent d’effectuer sa plus grosse acquisition, la parcelle de 30 hectares sur le terrain de la ville qui allait accueillir les 3 800 appartements du Trump Village. En 1960, un immense lopin de terre près d’Ocean Parkway à Brooklyn devint disponible pour des projets de développement. La commission de planification de la ville avait approuvé un généreux abattement d’impôts au profit d’une fondation à but non lucratif afin d’y construire une coopérative de logement. Fred Trump s’en prit à cet abattement qu’il qualifia de « cadeau ».
Peu de temps après, Trump décida de partir lui-même en guerre contre cet abattement. Bien que la commission eut déjà donné son accord pour le projet à but non lucratif, Lindenbaum alla voir le maire, Robert Wagner, et Beame, qui était dans le camp de Wagner, apporta son soutien à Trump. Fred Trump parvint à remporter les deux tiers de la propriété, et en moins d’un an, il avait posé les bases du Trump Village. Lindenbaum se vit offrir le siège à la commission de planification de la ville, préalablement occupé par Robert Moses, le courtier qui avait construit la plupart des autoroutes de New York, des aéroports et des parcs.
L’année suivante, Lindenbaum organisa un déjeuner de levée de fonds pour Wagner, qui se présentait à sa propre réélection. 43 constructeurs et propriétaires firent don de milliers de dollars ; Trump, d’après le journaliste Wayne Barrett, promit 2 500 dollars, une des plus grosses contributions. Le déjeuner fit la une des journaux et Lindebaum, mis en disgrâce, fut forcé de démissionner de la commission. Mais Robert Wagner remporta l’élection et Beame devint son contrôleur des finances. En 1966, alors que Donald intégrait l’école de commerce de Wharton, Fred Trump et Lindenbaum firent l’objet d’une enquête pour leur rôle dans le dossier d’hypothèque de 60 millions de dollars Mitchell-Lama. « Existe-t-il un moyen pour empêcher un homme qui fait du business de cette façon d’obtenir un autre contrat avec l’État ? » demanda le directeur de la commission d’enquête au sujet de Trump et de Lindenbaum. Finalement, Trump fut contraint de restituer les 1,2 million de dollars qu’il avait gagnés en spéculant sur le terrain, et dont il s’était en partie servis pour acheter un terrain à proximité afin d’y construire un centre commercial. Le bureau de Fred Trump était agréablement modeste. Les salles étaient séparées par des vitres. La « Trump Organization », comme Donald avait déjà décidé d’appeler la société de son père, était un petit cottage sur le terrain du Trump Village.
À l’époque, Donald dit à des journalistes que la Trump Organization était propriétaire de 22 000 unités de logement, alors qu’en réalité elle en possédait la moitié. Fred Trump avait alors 75 ans. Il était poli mais pas bête. Il critiqua beaucoup les premiers contrats de son fils, le mettant en garde en lui disant notamment que « s’étendre vers Manhattan était comme acheter un billet pour le Titanic. » Donald l’ignora. « Un paon aujourd’hui, un plumeau à poussière demain », aurait dit le promoteur Sam Lefrak en évoquant Donald Trump. Mais en 1980, il était clair que Donald incarnait tous les espoirs de son père. « Je dis toujours à Donald : “L’ascenseur vers le succès est en panne. Monte une marche à la fois” », me dit Fred Trump à l’époque. « Mais que pensez-vous de ce que mon Donald a accompli ? Ça laisse abasourdi non ? »  Donald Trump a toujours perçu son père comme un modèle à suivre. Dans The Art of the Deal, il écrit : « Fred Trump est né dans le New jersey en 1905. Son père, arrivé là de Suède, était propriétaire d’un restaurant qui marchait modérément. »
Donald Trump a toujours perçu son père comme un modèle à suivre. Dans The Art of the Deal, il écrit : « Fred Trump est né dans le New jersey en 1905. Son père, arrivé là de Suède, était propriétaire d’un restaurant qui marchait modérément. »
En vérité, la famille Trump était allemande et désespérément pauvre. « À un moment, ma mère fit de la couture pour nous permettre de survivre », me confia le père de Trump. « Pendant un temps, mon père a tenu un restaurant dans le Klondike, mais il est mort jeune. » Le cousin de Donald, John Walter, réalisa un jour un arbre généalogique élaboré. « Nos avons le même grand-père », me dit Walter. « Il était allemand, et alors ? » Bien que Fred Trump naquît dans le New Jersey, certains membres de la famille racontent qu’il se sentit obligé de cacher ses racines allemandes car la plupart de ses locataires étaient juifs. « Après la guerre, il pensait que les juifs ne voudraient jamais lui louer quoi que ce soit s’ils apprenaient son ascendance », aurait déclaré Ivana. Ce qui est certain, c’est que le camouflage de Fred Trump aurait facilement pu laisser penser à un enfant que dans le business, tout passe.
Quand je demandai à Donald Trump de me parler de ça, il resta évasif : « En réalité, c’est très compliqué. Mon père n’était pas allemand ; les parents de mon père étaient allemands… suédois, et en fait d’un peu partout en Europe… et j’ai même pensé, dans la seconde édition, mettre l’accent sur les autres lieux parce que je recevais trop de courrier de Suède : Pourrais-je venir et m’exprimer au Parlement ? Accepterais-je de rencontrer le président ? » Donald Trump semble prendre au sérieux certains aspects de ses origines allemandes.
D’après ce qu’Ivana confia à un ami, John Walter travaillait pour la Trump Organization et lorsqu’il rendait visite à Donald dans son bureau, il claquait les talons en déclarant : « Heil Hitler ! » C’est apparemment une blague familiale.
En avril 1990, peut-être dans un élan de nationalisme tchèque, Ivana dit à son avocat Michael Kennedy que de temps à autre son mari lisait un ouvrage rassemblant des discours d’Hitler, Discours, qu’il gardait dans le tiroir de sa table de nuit. Kennedy en gardait depuis une copie dans un placard de son bureau, comme si c’était une grenade. « Est-ce que votre cousin John vous a donné les discours d’Hitler ? » demandai-je à Trump. Trump hésita. « Qui vous a dit ça ? » « Je ne me souviens pas », répondis-je. « En vérité, c’est mon ami Marty Davis de la Paramount qui m’a donné un exemplaire de Mein Kampf, et il est juif. » (« Je lui ai bien donné un livre à propos d’Hitler », dit Marty Davis. « Mais c’était Discours, les discours d’Hitler, pas Mein Kampf. Je pensais que ça pouvait l’intéresser. Je suis bien son ami, mais je ne suis pas juif. »)
Plus tard, Trump remit ce sujet sur la table. « Si j’avais ces discours, et je ne dis pas que je les ai, je ne les lirais jamais. » Ivana essayait-elle de convaincre ses amis et son avocat que Trump était un crypto-nazi ? Trump n’est pas un grand lecteur, ni un passionné d’histoire. Le fait qu’il possèdât un exemplaire des discours d’Hitler indiquait au mieux un intérêt pour le savoir d’Hitler en matière de propagande. Le Führer décrivait souvent ses défaites à Stalingrad et en Afrique du nord comme de grandes victoires. Trump continuait d’accorder plus d’importance qu’il n’en avait à son empire qui s’effritait. « Personne n’a autant de liquidités que moi », dit-il au Wall Street Journal longtemps après avoir appris qu’il en allait autrement. « Je veux être le roi du cash. »

Donald et son père
Fred Trump, comme son fils, ne put jamais résister aux exagérations. Quand Donald était enfant, son père acheta une maison qui « avait 9 salles de bains et des colonnes de Tara », me raconta Fred Trump. La maison, cependant, était dans le Queens. Donald envisagerait plus tard un monde plus vaste. C’était sa mère, Mary, qui révérait le luxe. « Ma mère avait un sens de la grandeur », me dit-il. « Je me souviens d’elle regardant le couronnement de la reine Elizabeth, totalement fascinée. Mon père ne s’intéressait pas du tout à ce genre de choses. » Donald Trump se rendait souvent sur les chantiers avec son père, car ils étaient incroyablement proches, c’était presque des esprits jumeaux. Sur les photos de famille, Fred et Donald se tiennent ensemble, souvent bras-dessus bras-dessous, alors que les sœurs de Donald et son plus jeune frère, Robert, sont dans le flou. Ivana dit à des amis que Donald avait même persuadé son père de le nommer responsable des fonds d’investissement de ses trois frères et sœurs.
Parmi les cinq enfants, Donald était le deuxième fils. Enfant, il était si turbulent que ses parents l’envoyèrent dans un internat militaire. « C’était comme ça que ça marchait dans la famille Trump », m’expliqua un ami de longue date. « Ce n’était pas une atmosphère aimante. » Donald était grassouillet à l’époque, mais l’école militaire le fit maigrir. Il devint fort, et se rapprocha encore d’avantage de son père. « Je devais sans cesse me défendre », me dit-il à une occasion. « Les types comme mon père sont durs. Il faut rendre coup pour coup. Sinon, ils ne vous respectent pas ! » Les membres de la famille disent que le premier né, Fred junior, se sentait souvent exclu de la relation entre Donald et son père. Jeune homme, il annonça son intention de devenir pilote d’avion.
Plus tard, d’après un ami d’Ivana, Donald et son père rabaissèrent souvent Fred junior pour son choix de carrière. « Donald disait : “Quelle est la différence entre ce que tu fais et conduire un bus ? Pourquoi n’es-tu pas dans le business familial de l’immobilier ?” » Fred junior devint alcoolique et mourut à l’âge de 43 ans. Ivana a toujours dit à ses amis proches que la pression que lui avaient fait subir son père et son frère avait précipité sa mort. « Peut-être inconsciemment, on lui a mis la pression », m’avouait Trump. « On se disait que l’immobilier était facile pour nous et que ça l’aurait été pour lui aussi. J’avais du succès, et ça faisait pression sur Fred aussi. Qu’est-ce qu’on fait, là ? La psychanalyse de Donald ? » La relation de Donald et Robert avait aussi eu ses moments sombres. Robert, qui lui avait pris part au business familial, avait toujours été « le gentil », dans l’ombre de son frère.
Vinrent s’ajouter des frictions entre la femme de Robert, Blaine, et Ivana. Blaine ne ménageait pas sa peine pour les bonnes œuvres de New York et Robert et Blaine étaient extrêmement populaires – on les surnommait « les bons Trump ». « Robert et moi avons le sentiment que si nous disons quoi que ce soit au sujet de la famille, nous devenons des personnages publiques », me dit Blaine. L’hostilité réprimée du frère explosa après l’ouverture du Taj Mahal. « Robert dit à Donald qu’il s’en irait s’il ne lui donnait pas son autonomie », confia Ivana à un ami. « Donc Donald le laissa seul et il y eut un problème avec les machines à sous qui coûta à Donald entre 3 et 10 millions de dollars les trois premiers jours. Quand Donald explosa, Robert fit ses cartons et s’en alla. Lui et Blaine allèrent passer Pâques dans sa famille à elle. »
À New York, Trump devint bientôt célèbre pour son goût de la confrontation.
Tout comme son père avait eut Bunny Lindenbaum comme guide, Donald Trump avait Roy Cohn, le Picasso du rafistolage de l’intérieur. « Cohn apprit à Donald quelle fourchette utiliser », me dit un ami. « Je viendrai avec mon avocat Roy Cohn », disait souvent Trump aux responsables de la ville en 1980, avant qu’il ne sache se débrouiller seul. « Donald m’appelle entre 15 et 20 fois par jour », me dit une fois Cohn. « Il prête une attention folle aux détails. Il demande toujours : “Qu’en est-il de ceci ? Qu’en est-il de cela ?” » Dans le cadre d’un dossier de Trump d’abattement fiscal, d’après le biographe de Cohn, Nicholas von Hoffman, le juge se vit remettre un morceau de papier qui ressemblait à un affidavit. Il ne comportait qu’une seule phrase : « Pas de délais supplémentaire ou d’ajournement. Stanley M. Friedman. »
À l’époque, Friedman était devenu chef du comté du Bronx. Il n’était pas nécessaire de payer pour des faveurs de ce genre. C’était un classique ; le pouvoir de suggestion de faveurs futures suffisait. Friedman avait aussi été d’une aide cruciale pour les plans de Trump de l’hôtel Commodore. « Dans les derniers jours de l’administration Beame », d’après Wayne Barrett, « Friedman précipita un abattement d’impôts de 160 millions de dollars sur 40 ans… et fit les documents pour ce canard boiteux de Beame. » Friedman avait déjà accepté de rejoindre la firme d’avocats de Cohn, qui représentait Trump. « Trump a perdu tout compas moral lorsqu’il a fait alliance avec Roy Cohn », fit un jour remarquer Liz Smith.
À New York, Trump devint bientôt célèbre pour son goût de la confrontation. Il devint aussi le plus gros contributeur d’Hugh Carey, le gouverneur de New York, avec le frère de ce dernier. Trump et son père donnèrent 135 000 dollars. Il bougeait vite à présent ; il s’était installé dans un bureau et un appartement de la 5e Avenue et avait embauché Louise Sunshine, la chef des levées de fonds de Carey, en tant que « directrice des projets spéciaux ». « Je connaissais Donald mieux que quiconque », me dit-elle. « Nous sommes une équipe, Sunshine et Trump, et quand les gens nous poussaient, nous poussions plus fort. » Sunshine avait levé des millions de dollars pour Carey, et elle avait l’un des meilleurs carnets d’adresse de la ville. Elle fit rencontrer à Donald tous les acteurs du pouvoir de la ville et de l’état et travailla à la vente des appartements de la Trump Tower. La taxation de l’immobilier est immensément compliquée.
Souvent, les comptes des profits et des pertes ne vont pas de paire avec la disponibilité des liquidités. Parfois, un promoteur peut avoir énormément de liquidités et pourtant ne pas déclarer de revenus imposables ; les lois de l’imposition permettent aussi aux promoteurs d’avoir moins de liquidité mais de plus grosses sommes d’impôts à payer. Cela dépend du promoteur. Quand Donald Trump posa les bases d’un nouvel immeuble d’appartements sur la 61e Rue et le 3e Avenue, Louise Sunshine se vit offrir 5 % des parts du nouveau Trump Plaza, comme il fut nommé. Il y avait des frictions entre Sunshine et son patron. Conséquence de la comptabilité de Trump sur le Trump Plaza, Louise Sunshine, d’après un ami proche, aurait eut à payer un million de dollars d’impôts. « Pourquoi structures-tu le Trump Plaza de cette façon ? » aurait-elle demandé à Donald.
« Où est-ce que je vais trouver un million ? » « Tu n’as qu’à me vendre tes 5 % du Trump Plaza et tu les auras », dit Trump. Sunshine était tellement médusée qu’elle alla quêter l’aide de son ami milliardaire Leonard Stern. « J’ai tout de suite fait un chèque de un million de dollars afin que ma bonne amie ne se retrouve pas déplumée par Donald », me dit Stern. « J’ai dit à Louise : “Dis à Trump qu’à moins qu’il ne te traite correctement tu vas le poursuivre en justice ! Et qu’en conséquence, sa façon de traiter les gens sera portée à l’attention du public mais aussi de la Commission de Contrôle des Casinos.” » Louise Sunshine embaucha Arthur Liman, qui allait bientôt représenter le financier Michael Milken, pour s’occuper de son cas. Liman parvint à un accord : Trump paya à Louise 2,7 millions de dollars pour ses parts du Trump Plaza. Sunshine remboursa Leonard Stern. Pendant plusieurs années, Trump et Sunshine restèrent en froid. Mais dans le plus pur style new-yorkais, ils redevinrent amis dix ans plus tard. « Donald n’aurait jamais dû utiliser son argent comme instrument de pouvoir sur moi », me dit Sunshine, ajoutant : « Je l’ai pardonné. » 
Comme Michael Milken, Trump commença à croire que ses talents démesurés pouvaient s’appliquer à n’importe quel business. Il commença à étendre l’empire familial de l’immobilier aux casinos, aux compagnies aériennes et aux hôtels. Avec Citicorp comme outil, il acheta la Plaza et Eastern Shuttle. Il les géra étonnement bien, mais les avait payés trop cher. Il avait toujours bénéficié de la coopération des plus grandes banques, qui plus tard allaient paniquer. « Vous ne pouvez pas imaginer les sommes d’argent que les banques nous jetaient », me raconta un ancien avocat associé de Trump. « Pour chaque contrat que nous signions, nous avions six ou huit banques prêtes à nous donner des centaines de millions de dollars. Il nous fallait trier les financements, les banques se précipitaient pour signer sur tout ce que Donald concevait. »
« Il acheta de plus en plus de propriétés et s’étendit tant qu’il assura sa propre destruction. Dépenser de l’argent était une drogue. Et sa drogue devint son talon d’Achille », me dit un important promoteur. Les négociations de Trump, d’après un avocat qui travailla sur l’acquisition du casino d’Atlantic City, Resorts international, étaient toujours étonnement désagréables. Après le succès de The Art of the Deal, les avocats de Trump commencèrent à parler de « l’ego de Donald » comme s’il s’agissait d’une entité à part entière. « L’ego de Donald ne nous permettra jamais d’accepter ce point », répéta encore et encore un des avocats pendant la négociation. « La clé avec Donald, comme avec toutes les fortes têtes, c’est de lui dire d’aller se faire foutre », me dit l’avocat. Quand Mortimer Zuckerman, le PDG de Boston Properties, soumit un plan qui fut choisi pour le site du Colisée de la 59e Rue, Trump fit une crise d’apoplexie. « Il appela tout le monde pour saboter le contrat. Bien sûr, Mort était associé avec les frères Salomon donc Trump n’obtint aucun résultat », se souvint une personne proche de Zuckerman.
Marla
Une image d’Ivana et Donald Trump me reste en mémoire. C’était l’hiver 1987. Ils étaient à la patinoire Wollman. Donald venait de la terminer pour la ville. Il s’était largement répandu dans les journaux sur les idiots que le maire Koch et la ville avaient été, perdant des années et de l’argent pour n’arriver à rien sur cette histoire de patinoire. Trump avait pris le boulot et l’avait bien fait. S’il s’accorda plus de crédit qu’il n’en méritait, personne ne lui en tint rigueur ; la patinoire était enfin ouverte et remplie de patineurs heureux. Ivana portait un saisissant manteau en lynx qui mettait en avant ses cheveux blonds. Ils se tenaient par le bras. Ils avaient l’air si jeunes et si riches, goûtant pleinement leur succès. Une foule polie s’était rassemblée pour les féliciter du triomphe de la patinoire. Les gens près de Donald semblaient inspirés par sa présence, comme s’il s’agissait d’un héros. Son bonheur semblait être le reflet de l’adulation de la foule. Près de moi un homme s’écria : « Pourquoi ne négociez-vous pas les accords SALT pour Reagan, Donald ? » Ivana rayonnait. La neige commença à tomber très légèrement et depuis la patinoire résonnait la valse des patineurs.
Quelques mois avant la séparation des Trump, Donald et Ivana étaient attendus à un dîner donné en leur honneur. Les Trump étaient en retard et ce dîner n’était pas à prendre à la légère. Le nom de famille des hôtes était lié à l’histoire même de New York, mais comme s’ils avaient reconnu l’arrivée d’une nouvelle force dans la ville, ils honoraient Donald et Ivana Trump. Trump entra dans la pièce en premier. « Il fallait que j’enregistre l’émission de Larry King », dit-il. « Je passe dans l’émission ce soir. » Il semblait ne connaître aucun répit. Trump ne prêtait pas attention à sa compagne blonde et personne dans la salle ne la reconnut avant qu’Ivana ne commençât à parler. « Mon Dieu ! Qu’est-ce qu’elle s’est fait ? » demanda un invité.
Les joues slaves d’Ivana avaient disparu ; ses lèvres étaient gonflées à bloc. Sa poitrine avait été re-sculptée et son décolleté considérablement augmenté. Les invités étaient si déstabilisés par son apparence que sa présence créa une atmosphère bizarre. Pendant tout le dîner, Donald s’agita. Il regardait sa montre. Il répéta plusieurs fois qu’il passait en ce moment-même dans l’émission de Larry King, comme s’il s’attendait à ce que les invités se lèvent. Il avait été belliqueux à l’encontre de King ce soir-là, et il voulait que l’assemblée le voie, peut-être pour confirmer son pouvoir. « Ça vous ennuie si je m’assois un peu en retrait ? Parce que vous avez vraiment très mauvaise haleine, vraiment », avait-il dit à Larry King sur une chaîne de télévision nationale. « Allez Arnold ! Pose avec moi ! Allez ! » s’écria Ivana Trump en direction du designer Arnold Scaasi par une tiède soirée du mois de juin 1990.
Ils étaient au Waldorf-Astoria, à une cérémonie de remise de récompense sponsorisée par la fondation Fragrance, et Ivana était l’une des présentatrices. Le tapis était usé dans la salle Jade ; les paparazzis étaient prêts à surgir. Les kits de dossiers de presse recouvraient les tables de cet événement « immanquable », de ceux qui ont souvent lieu dans la vie de la haute société new-yorkaise. Sous la teinte bleue verte des éclairages, les robes des plus grands couturiers avaient l’air bon marché. J’étais surprise de la voir apparaître. La veille, la crise que son mari traversait avec les banques avait fait la une des trois tabloïds locaux.
« TRUMP S’EFFONDRE ! » s’écriait le Daily News. Un éditorialiste avait même dit que les problèmes de Trump étaient une occasion de se réjouir pour la ville, et proposait un jour férié. « Ivana ! Ivana ! Ivana ! » lui hurlaient les photographes. Ivana souriait à la manière d’une candidate aux élections présidentielles. Elle portait une ample robe faite de satin et de perles vert menthe ; ses cheveux étaient relevés en chignon. Aussi humiliée pour ses enfants qu’elle ait pu se sentir ce soir-là à cause de la mauvaise publicité, elle avait décidé de les laisser à la maison. Ivana était au Waldorf à 18 h 15, saluant les journalistes et les paparazzis par leurs prénoms. Elle ne pouvait pas se permettre de s’aliéner l’establishment de la parfumerie en annulant dans un moment si crucial, car elle allait bientôt commercialiser un parfum et elle allait avoir besoin de leur bienveillance.
Ivana semblait déterminée à conserver son nouveau statut dans la ville des alliances, car son futur financier dépendait de sa capacité à sauver le nom de la marque. Elle s’apprêtait à intégrer un monde difficile pour une femme seule doté d’une fortune réduite. Elle n’avait pas de Rothko à mettre au mur, ni de bijoux impressionnants. Mais elle avait son prénom Ivana et elle se préparait à commercialiser des écharpes, des parfums et des chaussures, tout comme son mari avait réussi à commercialiser le nom Trump.
À quelques mètres de nous, le reporter local de CBS parlait devant la caméra dans le journal du soir. Il commentait l’écroulement de Trump pendant qu’Ivana discutait avec Scaasi et Estée Lauder. Lauder, une grand femme d’affaires elle-même, avait supposément dit à Ivana quelques mois plus tôt : « Retourne avec Donald. C’est un monde froid, là dehors. » Je me souvins d’une scène d’attroupement dans Le Jour du fléau, de Nathanael West. Ivana autorisa même le journaliste de CBS à lui tendre un micro. « Donald et moi sommes partenaires dans le mariage et dans les affaires. Je serai à ses côtés pour le pire et le meilleur », dit-elle aux journalistes avec un aplomb bizarre. Ivana était devenue, comme Donald, un agent double, capable de projeter une image d’innocence et de grande confiance. Elle s’était presque transformée en Donald Trump. « Pour vous dire la vérité, j’ai fait d’Ivana une femme très populaire. J’ai créé beaucoup de satellites. Hey, que ce soit Marla ou Ivana. Marla peut faire tous les films qu’elle veut maintenant. Ivana peut faire tout ce qu’elle veut », me dit Donald Trump au téléphone à l’époque.
« New York est un endroit très dur », m’avait dit Ivana Trump des années avant cela. « Je suis dure moi aussi. Quand on me donne un coup sur le nez, je réagis en frappant encore plus durement. » Nous marchions parmi les gravas de l’hôtel Commodore, qui allait bientôt rouvrir sous le nom de Grand Hyatt. Ivana s’était vue confier la tâche de superviser toute la décoration ; elle était totalement investie malgré la tenue qu’elle avait choisie pour cheminer dans la poussière ambiante : un jogging Thierry Mugler en laine blanche et des chaussures Dior pâles. « Je vous ai déjà dit de ne jamais laisser un balais comme ça dans la salle ! » cria-t-elle à un ouvrier. Hurler sur ses employés était devenu une marque de fabrique, peut-être sa façon de sentir son propre pouvoir. Plus tard, à Atlantic City, elle deviendrait célèbre pour son obsession de la propreté.
Le concept de « syndrome de Stockholm » est à présent utilisé par l’avocat d’Ivana pour décrire sa relation avec Donald. « Elle avait la mentalité d’une captive », me dit Kennedy. « Au bout d’un moment, elle ne pouvait plus combattre son bourreau, et elle a commencé à s’identifier à lui. Ivana est sourde, bête et aveugle quand il en va de Donald. » Si Donald travaillait 18 heures par jour, Ivana faisait de même. Les Trump embauchèrent deux nourrices et un garde du corps pour leurs enfants. Elle s’en alla gérer le casino Trump Castle à Atlantic City, passant souvent deux à trois nuits par semaine là-bas à superviser les équipes. Déterminée à apporter du glamour au Trump Castle, elle devint célèbre pour son attention aux apparences, allant jusqu’à sortir de la salle de jeux une serveuse enceinte qui tentait désespérément d’obtenir de gros pourboires. La femme fut placée dans un lounge à bonne distance et on lui donna un habit de clown pour masquer son état.
À New York, Ivana ne résista pas au goût du grandiose de son mari. Peu après que la Trump Tower fut achevée, le couple prit possession de son triplex. Les avocats d’Ivana parlaient souvent de son amour des arts domestiques et décrivaient ses confitures maisons. Pourtant, la cuisine de son appartement, qu’elle avait elle-même dessinée, était minuscule, pas plus grande qu’une kitchenette, avec un sol en linoléum doré. « Il y a une cuisine dans l’aile des enfants et c’est là que les nourrices cuisinent », me dit une amie de la famille. Le salon des Trump avait un sol en onyx beige avec des emplacements découpés pour mettre les tapis. Il y avait une cascade coulant le long d’un mur en marbre, une fontaine italienne et les fameuses fresques murales. Leur chambre disposait d’un mur de verre renfermant des fleurs de soie mais avec le temps, Ivana se lassa du décor.
Elle fit appel à un décorateur de renom. « Que puis-je faire de cet intérieur ? » lui aurait-elle demandé. « Absolument rien », dit-il. Soir de Noël 1987. Ivana venait de recevoir une nouvelle pile de documents légaux qui faisait la taille d’un bottin téléphonique. « Qu’est-ce que c’est ? » aurait-elle demandé à Donald. « C’est notre nouveau contrat de mariage. Tu obtiens dix millions de dollars. Signe-le. » « Mais je ne peux pas lire ça maintenant, c’est Noël ! » répondit Ivana. Selon Kennedy, Donald fit pression sur elle. Trump semblait avide de la voir signer les papiers, peut-être parce qu’un photographe d’Atlantic City le faisait chanter en le menaçant de publier des photos de lui et Marla Maples. Même si Ivana gérait le Trump Castle de façon très efficace, elle semblait terrifiée par son mari. Elle signa les papiers qui lui attribuaient dix millions de dollars et la demeure de Greenwich, dans le Connecticut.
Plus tard, Trump dit à des journalistes : « Ivana a eu 25 millions de dollars. » Les tactiques qu’il utilisait dans les affaires étaient à présent utilisées à la maison. « Donald commença à appeler et crier sur Ivana constamment : “Tu ne sais pas ce que tu fais !” » me rapporta l’un des plus proches assistants d’Ivana. « Quand Ivana raccrochait le téléphone, je lui disais : “Comment peux-tu tenir le coup ?” et Ivana répondait : “Parce que Donald a raison.” » Il commença à la dénigrer : « Cette robe est horrible. » « Ton décolleté est trop profond. » « Tu ne passes pas assez de temps avec les enfants. » « Qui voudrait toucher à ces seins en plastique ? » Ivana dit à ses amis que Donald ne voulait plus coucher avec elle. Elle se sentait responsable. « Je pense que c’était l’objectif de Donald de se débarrasser d’Ivana en l’envoyant à Atlantic City », me confia une de ses assistantes. « Pendant ce temps, Marla Maples était dans une suite au Trump Regency. Atlantic City était censé être son terrain de jeu. »
Ivana avait déjà mis son mari en garde contre Atlantic City. « Pourquoi se développer dans un lieu où il n’y a pas d’aéroport ? » Trump, cependant, était déterminé à y investir, même si ses associés de Las Vegas lui avaient dit que le marché du jeu dans le Nevada avait un facteur de profit qui pourrait lui rapporter 200 millions par an. Mais à ce moment-là, Marla Maples était à Atlantic City, non loin de New York. Trump était devenu, d’après un de ses amis, « si focalisé sur Marla qu’il ne prêtait plus attention à ses affaires ». Bien qu’Ivana se fût installée à Atlantic City pour faire plaisir à Donald, sa présence désormais, alors que Marla était entrée en scène, était un obstacle pour lui. L’acquisition de l’hôtel Plaza lui permit de lancer un ultimatum : « Soit tu agis comme mon épouse, tu rentres à New York et tu t’occupes de nos enfants, soit tu gères le casino à Atlantic City et nous divorçons. »
« Que vais-je faire ? » demanda-t-elle à l’une de ses assistantes. « Si je ne fais pas ce qu’il dit, je vais le perdre. » Trump convoqua même une conférence de presse pour annoncer le nouveau poste d’Ivana comme présidente de l’hôtel Plaza : « Ma femme, Ivana, est un manager brillant. Je la paierai un dollar par an et toutes les robes qu’elle voudra ! » Ivana appela ses amis en pleurs. « Comment Donald peut-il m’humilier de la sorte ? » « Je pense que Marla est très différente de l’image qu’elle renvoie », me dit Donald Trump en juillet 1990. « Son image est celle d’une très belle blonde plantureuse. » Une Donna Rice ? « Elle est très différente de ça. Elle est intelligente, très gentille et n’a aucune ambition. Elle aurait pu gagner une fortune ces six derniers mois si elle l’avait voulu ! » « Comment avez-vous pu autoriser Marla à être la fille de la pub des jeans No Excuses ? » demandai-je à Trump. « Je me suis dit qu’elle pouvait gagner 600 000 dollars en une seule journée de travail. Au sujet de cette mauvaise pub, je me suis dit que ces 600 000 dollars pouvaient la faire vivre jusqu’à la fin de ses jours », me dit Trump.
À la une
En février 1990, Trump décolla pour le Japon en disant aux journalistes qu’il allait assister à un match de Mike Tyson. Sa véritable motivation était de rencontrer des banquiers pour essayer de vendre le Plaza, car l’audit de novembre d’Arthur Andersen avait été catastrophique. Lors de son vol retour, il reçut un appel par radio dans l’avion. Liz Smith avait sorti un scoop sur la séparation des Trump. Toute l’histoire sordide de Marla Maples et d’Ivana se battant sur les slaloms d’Aspen était étalée dans les journaux. Ivana avait fait à Donald ce qu’il avait lui-même fait à Jay Pritzker au Népal plusieurs années auparavant. Depuis l’avion, Donald appela Liz Smith. « Félicitations pour votre article », lui dit-il avec sarcasme. « C’est fini avec Ivana. Elle est devenue comme Leona Helmsley. » « Honte à vous ! » répondit Smith. « Comment osez-vous parler de la mère de vos enfants en ces termes ? » « Vous n’avez qu’à écrire que c’est quelqu’un du bureau d’Howard Rubenstein qui l’a dit », dit Trump à Smith, faisant allusion aux bons contacts de son attaché de presse. (« Je n’ai jamais dit ça », me disait Trump. « Si, il l’a dit », soutenait Smith.)
Les banquiers japonais avec qui Trump avait négocié une tentative de vente se retirèrent soudainement. « Les Japonais méprisent le scandale », me dit un de leurs associés. Plusieurs semaines plus tard, Donald appela Ivana. « Pourquoi ne pas marcher ensemble le long de la 5e Avenue pour les photographes et prétendre que tout ce scandale était un coup publicitaire ? On pourrait dire qu’on voulait voir qui allait prendre partie pour toi et qui allait se ranger à mes côtés. » À mesure que la presse devenait plus sympathique envers Ivana, Donald hurlait à ses avocats : « C’est n’importe quoi ! » Ivana commença à opérer des réconciliations dans toute la ville. « Nous pouvons être amis maintenant Leonard, n’est-ce pas ? » dit-elle dans une soirée à Leonard Stern, d’après un de ses amis. « Ton problème était avec Donald, pas avec moi. Je t’ai toujours bien aimé. »
Les avocats de Trump essayèrent de toutes leurs forces de suivre ce que faisait Ivana. « Donald a vu une facture remise par Ivana cette semaine et qui fait état de 7 000 dollars de draps Pratesi pour leur fille, Ivancka », dit un des avocats. « Il a appelé, furieux. “Pourquoi une gamine de 7 ans aurait besoin de 7 000 dollars de draps ?” Elle a payé une chemise 350 dollars à Montenapoleone. C’était pour qui, son nouveau meilleur ami Jerry Zipkin ? » L’avocat décrivit la facture d’Ivana chez Carolina Herrera : « Nous recevons une facture de 25 000 dollars. Ivana a photocopié l’original et à la place d’une robe à 25 000 dollars, elle écrit à la main : “6 articles pour 25 000 dollars.” » (Un porte-parole d’Ivana assurait que c’était totalement faux.)
Le scandale avait de sérieuses répercussions sur les enfants Trump. Donny Jr était ridiculisé à l’école Buckley. Ivancka avait éclaté en pleurs à Chapin. Quand Donald et Marla Maples assistèrent au concert d’Elton John, Donny Jr se mit à pleurer car son père avait promis aux enfants de laisser tomber Marla. « Les enfants sont détruits », dit Ivana à Liz Smith. « Je ne sais pas comment Donald peut dire qu’ils vont bien. Ivancka est rentrée de l’école en pleurant : “Maman, est-ce que ça veut dire que je ne vais plus être Ivancka Trump ?” Le petit Eric m’a demandé : “Est-ce que c’est vrai que tu t’en vas et que tu ne vas pas revenir ?” » Aussi cavalière qu’était l’attitude d’Ivana en public, elle pleurait souvent en privé. Un temps la complice des conspirations de son mari, elle dit à des amis qu’elle se sentait à présent comme ses victimes.
Le samedi du 44e anniversaire de Donald Trump, je tentai de me promener dans les jardins de West Side, au dessus du centre Lincoln, à Manhattan. Les rails étaient rouillés, la terre avait repris ses droits. La propriété s’étendait, pâté de maison après pâté de maison. Il faisait frais le long de l’Hudson ce matin-là, et une brise plaisante soufflait sur l’eau. Le seul signe de la présence de Trump était une haute barrière surmontée de boucles élaborées de fils barbelés destinée à empêcher les sans-abris du coin de passer. C’était sur ce terrain, sur les hauteurs de sa mégalomanie, que Trump avait dit vouloir ériger « le plus haut immeuble du monde », un plan endigué avec succès par les activistes du quartier qui refusaient de voir des parties de West Side obscurcies par l’ombre d’une telle construction. « Ils n’ont aucun pouvoir », avait dit Trump à l’époque, effaré que quiconque pût résister à ses projets grandioses. Ivana s’en alla à Londres afin de participer à un événement public de plus pour promouvoir le Plaza.
Sauf que cette fois, on raconta que c’étaient ses amis le baron et la baronne Ricky di Portanova qui payèrent la note. Ivana avait fait orchestrer sa campagne médiatique new-yorkaise par John Scanlon, qui avait été à la tête des relations publiques de CBS pendant le dossier de diffamation de Westmoreland. À Londres, elle était choyée par Eleanor Lambert, la doyenne des publicistes de mode. Une rumeur courut dans Londres selon laquelle elle ne pouvait pas se payer l’hôtel et avait déménagé chez une amie à Eaton Square. Elle marchait sur les pas d’Undine Spragg, qui avait si bien calculé son ascension dans Les Beaux mariages d’Edith Wharton. Sir Humphry Wakefield rassembla une liste d’invités anoblis pour un dîner, mais il y avait des frictions entre lui et Ivana. Quand les invités, dont la duchesse de Northumberland, arrivèrent, beaucoup d’entre eux furent désagréablement surpris d’avoir été attiré à un dîner qui était en fait donné en l’honneur d’Ivana Trump. « Humphry paiera pour ça », aurait dit un invité.
Ce samedi-là, New York semblait étrangement vide sans les Trump. Donald était parti fêter son anniversaire à Atlantic City. Des centaines d’employés du casino avaient reçu l’instruction de se tenir le long de l’allée principale pour l’accueillir, car on manquait de soutiens venus de Manhattan. La veille, il avait manqué à rembourser 73 millions de dollars dus à des créanciers et des banquiers. Des clowns et des bouffons empruntés au théâtre de Trump, le Xanadu, furent payés pour divertir les employés et les journalistes qui patientaient en attendant sous les minarets et les éléphants de Trump, qui allaient bientôt être saisis. Trump arriva très tard, entouré de ses gardes du corps. Son visage était grave, sa bouche pincée. Dans un cérémonial compliqué, les cadres dirigeants de Trump soulevèrent le rideau qui révéla son cadeau d’anniversaire, un immense portrait de Donald Trump, le même que sur le tableau photographié par les japonais dans le hall de la tour de Manhattan. La taille du portrait était bizarre sur le trottoir d’Atlantic City : trois mètres de Donald, penché en avant, appuyé sur son coude, le visage figé dans un rictus défiant et familier.
En quelques jours, les banquiers acceptèrent de donner à Trump 65 millions de dollars pour payer ses factures. Une grosse partie de son empire devrait probablement être démantelé, mais il en garderait le contrôle. Il lui serait dorénavant alloué 450 000 dollars par mois sur le plan personnel. « Je peux vivre avec ça », dit Trump. « Aussi absurde que cela puisse paraître, il était plus malin de faire les choses de cette façon plutôt que de laisser un juge présider une braderie dans un tribunal des faillites », me dit un banquier. Trump pavoisait au sujet du plan de sauvetage. « C’est une grande victoire. C’est un super accord pour tout le monde », dit-il. Pas exactement. On racontait que les banquiers de Trump étaient si mécontents de son bilan comptable – il y avait apparemment un trou d’un milliard de dollars – qu’ils lui demandèrent de s’engager sur son futur héritage pour garantir les nouveaux prêts. Le père de Trump, qui l’avait créé en l’aidant à signer ses premiers contrats, semblait maintenant venir à nouveau à son secours. « N’importe quoi », me dit Trump. « Les banques m’ont donné cinq ans. Les banques ne m’auraient jamais demandé mon futur héritage et je ne l’aurais jamais donné. »
Peu après, Trump annonça que le grand magasin français Galeries Lafayette allait acheter le vaste espace que Bonwit Teller avait laissé vacant dans la Trump Tower. « Ce n’est en aucun cas un grand retour », me dit Trump. « Parce que je ne suis jamais parti nulle part. » Je cherchais toujours à saisir Donald Trump. Un jeudi pluvieux de juillet 1990, je me rendis à la cour fédérale, où il devait témoigner dans un dossier civil dans lequel il était défendant. Lui et son entrepreneur étaient accusés d’avoir embauché des immigrés clandestins polonais pour effectuer le travail de démolition sur le site de la Trump Tower. « La brigade polonaise », comme on les appelait, avait été incroyablement exploitée, gagnant 4 dollars de l’heure pour un travail habituellement payé cinq fois plus. La dernière fois que j’étais allée dans ce quartier, c’était pour entendre le verdict du procès de John Gotti.
Je connaissais bien le coin. Le garde à l’entrée me salua par mon prénom. Je traînais souvent dans et autour des salles d’audience pour observer les visages célèbre de la décennie passée. Je repensai à Bess Myerson, Michael Milken, Ivan Boesky, Leona Helmsley, Imelda Marcos et Adnan Khashoggi, détruits et traînés à terre dans le kaléidoscope fou des années 1980. Chacun d’entre eux avait, à un moment de sa vie, pensé être comme Donald Trump, une figure de grandeur, doté de super pouvoirs. Devant le tribunal, la police avait monté des barricades. Tant de célébrités avaient passé ces portes que les grands panneaux jaunes étaient laissés là de façon routinière, sur les marches du massif palais de justice.
« On a créé ce type ! On a cru à ses conneries ! » — Des journalistes en colère
Je repensai aux dix années qui s’étaient écoulées depuis que j’avais rencontré Donald Trump pour la première fois. Il était aujourd’hui à la mode de dire de lui qu’il avait été le symbole de la grossièreté des années 1980. Mais Trump était devenu en 1990 bien davantage qu’un homme vulgaire. Comme Michal Milken, Trump semblait penser que son argent lui donnait la liberté de faire la loi. Personne ne l’arrêta. Ses exagérations et ses mensonges furent rapportés et les cela fit rire les gens. Ses banquiers l’arrosèrent d’argent. Les responsables de la ville le laissèrent presque décider de la politique publique en érigeant son mur de béton sur l’Hudson River. New York, comme les banquiers de Chase et Manny Hanny, autorisa Trump à exister dans un univers dénué de toute réalité. « J’ai rencontré deux journalistes », me dit Trump au téléphone, « et ils voyaient tout à fait ce que je voulais dire. Ils m’ont complètement cru. Puis ils sont partis et ont écrit des choses horribles sur moi, tout comme vous allez aussi le faire j’en suis sur. »
Il y a longtemps, Trump me comptait parmi ses ennemis dans son monde de « positifs » et de « négatifs ». Je me dis que la prochaine dizaine de personnes à qui Trump allait parler se verraient sûrement conter un catalogue de mes transgressions imaginées par Donald Trump. Quand j’entrai dans la salle d’audience, Trump était parti. Son avocat, le vénérable et bien connecté Milton Gould, affichait un large sourire car il pensait apparemment qu’il allait remporter le procès haut la main. Trump avait dit qu’il ne savait rien des démolitions, que son entrepreneur avait été un « désastre ». Pourtant, un informateur du FBI avait témoigné du fait qu’il avait prévenu Trump de la présence de la brigade polonaise.
Il l’avait prévenu qu’il n’obtiendrait peut-être pas sa licence de casino s’il ne s’en débarrassait pas. Je déambulai jusqu’à la salle de presse au 5e étage pour entendre ce qui se disait sur le témoignage de Trump. Les journalistes semblaient fatigués ; ils avaient déjà entendu tout ça avant. « Nom de Dieu », me cria l’un d’eux. « On a créé ce type ! On a cru à ses conneries ! Ça a toujours été un hypocrite, et on a noirci des pages entières de nos journaux à son sujet ! » Je repensai à la dernière question que Donald Trump m’avait posée la veille au téléphone. « Quelle est la longueur de votre article ? » « Long », avais-je répondu. Trump semblait satisfait. « Ça fait la une ? »
Traduit de l’anglais par Caroline Bourgeret d’après l’article « After The Gold Rush », paru dans Vanity Fair.
Couverture : Donald et Ivana Trump.
L’article L’odieux divorce de Donald et Ivana Trump est apparu en premier sur Ulyces.
11.07.2022 à 22:00
Uber est-elle devenue l’entreprise la plus détestée du monde ?
Nicolas Prouillac
Uber Files 15 mars 2015, 25 policiers font irruption dans les bureaux parisiens de la société Uber. Depuis quelques temps, l’entreprise est confrontée à la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression de fraude. Pourtant personne ne semble paniquer. Quelques clics sur un ordinateur et magie, tout est effacé. Le […]
L’article Uber est-elle devenue l’entreprise la plus détestée du monde ? est apparu en premier sur Ulyces.
Texte intégral (8189 mots)
Uber Files
15 mars 2015, 25 policiers font irruption dans les bureaux parisiens de la société Uber. Depuis quelques temps, l’entreprise est confrontée à la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression de fraude. Pourtant personne ne semble paniquer. Quelques clics sur un ordinateur et magie, tout est effacé. Le « kill switch » : impossible désormais d’accéder au serveur de l’entreprise. Du moins c’est ce qu’elle croyait.
Le 10 juillet 2022, les Uber Files sont publiés. 124 000 documents internes dont les révélations font froid dans le dos. Influence politique, régime de terreur et dissimulation juridique, Uber s’est imposé en force souvent au dépit des lois. D’anciens présidents au commissaire de la Cour Européenne en passant par les oligarques, nombreux sont ceux incriminés dans cette affaire.
Uber a su au fil des années se construire une armée d’alliés avec une influence planétaire. On peut notamment citer Jeff Bezos mais aussi Xavier Niel, le patron de Free ou encore Bernard Arnault, PDG du groupe LVMH. Pour eux, cela ressemblait à un placement financier banal, mais pour Uber, il s’agissait de véritables pièces sur leur échiquier de la conquête mondiale. « Nous n’avons pas besoin de leur argent en soi. Mais ils pourraient être des alliés utiles pour gagner la France », écrit à l’époque Pierre-Dimitri Gore-Coty, directeur général d’Uber en Europe de l’Ouest.
Et le pari s’est avéré gagnant. Lorsque Uber cherche à s’implanter en France en 2011, la société se voit confrontée à de nombreuses lois françaises. Les manifestations des chauffeurs de taxis sont violentes mais Uber se trouve un allié de taille, le ministre de l’Économie de l’époque, Emmanuel Macron. Un « deal » a alors été mis en place, intégrant des dispositions favorables à l’entreprise de VTC en échange de la suspension d’UberPop, un service de transport permettant de devenir chauffeur sans aucune licence.
Se heurtant à de nombreuses lois françaises, Uber détient une arme redoutable : le « kill switch ». Un dispositif qui permet, lors de son activation, de déconnecter un ordinateur des serveurs de l’entreprise. Ainsi, grâce à cela, Uber réussit à échapper aux inspecteurs de la Direction général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
« L’accès aux outils informatiques a été coupé immédiatement, donc la police ne pourra pas obtenir grand-chose, voire rien », a écrit en 2015 Mark MacGann, un lobbyiste du groupe. L’homme a également donné un conseil pour le moins surprenant à Thibaud Simphal, responsable du groupe en France. « Avait l’air confus, lorsque vous ne pouvez pas obtenir l’accès. Dites que l’équipe informatique est à San Francisco et dort profondément ».
#Ubercestover
Sous la statue de Johannes Gutenberg, au milieu de la place du même nom, quatre étudiantes strasbourgeoises patientent. L’imprimeur tient dans sa main un parchemin où il est écrit : « Et la lumière fut. » Mais la lumière est ce dimanche 17 novembre 2019, à 3 h 40, entre les doigts des jeunes femmes, plus précisément sur leur téléphone. Elles viennent de lancer l’application Uber pour rentrer chez elles en évitant les ruelles sombres.
Les phares d’une berline approchent. Son conducteur sympathise, les dépose une à une devant leur porte, et poursuit la discussion avec la dernière passagère. Ses questions se font alors personnelles voire indiscrètes. Sonia est d’autant plus gênée qu’elle est à l’avant. « Il a entrelacé ses doigts avec les miens, les a posés sur ma cuisse, puis sur la sienne », raconte-t-elle. « J’étais tétanisée, je me sentais prise en otage. » Et la lumière fuit.
Après avoir esquivé un baiser à l’arrivée, la femme de 22 ans s’extirpe du véhicule, rentre chez elle en tremblant et s’effondre sur son lit. Elle contacte immédiatement Uber. On lui assure que le conducteur va être suspendu séance tenante. Pour éviter ce genre de mésaventure à d’autres, Sonia partage sa photo sur Twitter. L’homme est reconnu par Noémie. Elle l’a déjà signalé pour des faits similaires. Pourtant, il continue de sévir.
Les deux femmes prennent alors contact avec Anna Toumazoff, internaute féministe qui anime la newsletter Les Glorieuses. De là, le mardi 19 novembre, peu avant minuit, naît le hashtag #Ubercestover où les mauvaises expériences d’utilisatrices d’Uber s’accumulent. « Nous sommes nombreuses à prendre des Uber non pas par confort, mais pour des raisons de sécurité », s’indigne Anna Toumazoff. « Quand il est tard, ça m’arrive même d’en commander un juste pour faire 500 mètres. Si nous ne sommes plus en sécurité nulle part, c’est un réel problème ! »
Ces cas ne font pas exception. Dans une vidéo publiée le 2 décembre, Konbini donne la parole à Anaïs, une femme « victime de viol » dans la nuit du 22 au 23 septembre 2016. La gorge nouée, elle raconte être arrivée chez elle après un trajet de 1 h 30 qui n’aurait dû durer que 15 minutes, « la culotte descendue ». Quelques souvenirs embués par l’alcool lui rappellent « ce moteur qui se coupe, ces portières qui se ferment et ces bruits de cuir de siège de voiture ». Ce témoignage glaçant s’ajoute à beaucoup d’autres sur Twitter.
"Je rentre chez moi la culotte descendue… "
Après une soirée, Anaïs commande un Uber pour rentrer en sécurité. Sur le trajet, son chauffeur va la violer.Aujourd'hui avec d'autres victimes, elles témoignent avec #UberCestOver pic.twitter.com/imNgNhyETV
— Konbini news (@konbininews) December 2, 2019
« En cas d’incident lié à une agression physique ou sexuelle, le compte du passager ou du chauffeur qui aurait commis les faits est alors immédiatement suspendu, et ce, à titre préventif », répond Uber. « En cas de dépôt de plainte, les forces de l’ordre peuvent se mettre directement en contact avec nous pour que nous leur fournissions les informations nécessaires à l’enquête judiciaire. Nous pouvons décider de la suspension permanente de l’accès à l’application Uber. »
Si le volume de témoignages rendu public est inégalé en France, il y a un moment que le problème existe. En 2016, le site BuzzFeed s’était procuré des captures d’écran du logiciel client d’Uber où 6 160 signalements apparaissaient associés au terme « agression sexuelle » et 5 827 au mot « viol ». La société s’était défendue en disant avoir reçu cinq allégations de viol et moins de 170 d’agression sexuelle entre décembre 2012 et août 2015. Ses ennuis ne faisaient que commencer.
Le 22 février 2017, le New York Times a mise en cause l’inaction du PDG, Travis Kalanick, face à des agressions sexuelles au sein de l’entreprise dont il était pourtant au courant. Six jours plus tard, les employés d’Uber ont reçu dans leur boîte de réception un email signé par Travis Kalanick, « profondément désolé » d’avoir traité avec mépris un chauffeur Uber du nom de Fawzi Kamel. Ou plus précisément, d’avoir été filmé en train d’asséner au chauffeur qu’il devait ses ennuis financiers à ses mauvais calculs plutôt qu’à des mesures prises par la firme, qui l’auraient enchaîné à sa dette.
Face au tollé qui a suivi, le PDG d’Uber a été contraint de reconnaître que ses actes ne pouvaient être excusés et que l’entreprise avait besoin d’un ajustement de son leadership. Le 7 mars 2017, il a été annoncé qu’Uber était à la recherche d’un nouveau directeur des opérations pour le seconder dans sa tâche de diriger le groupe. En France, le directeur de la communication de l’époque, Grégoire Kopp, reconnaissait que les nombreux problèmes de l’entreprise n’étaient pas étrangers à son fondateur.

L’ex-PDG d’Uber Trevor Kalanick
Crédits : JD Lasica
« Nous avons un problème lié à la personnalité de Travis Kalanick et à notre réputation globale », disait-il. Selon lui, les affaires ne s’en portaient pas plus mal. Sans tous ces ennuis, « peut-être que la croissance serait supérieure, mais l’utilisation du service ne cesse pas d’augmenter ». Un paradoxe auquel le porte-parole avait une explication : « Il faut vraiment dissocier le consommateur du citoyen. » Mais le consommateur et le citoyen ayant de plus en plus tendance à se rejoindre, Travis Kalanick a fini par démissionner en juin 2017. Il a ainsi été emporté par la vague #DeleteUber, annonciatrice du raz-de-marée #UberCestOver qui secoue aujourd’hui le géant du VTC.
#DeleteUber
Le vendredi 27 janvier 2017, assis derrière le Bureau ovale depuis tout juste une semaine, le président Trump a suspendu le programme américain d’admission et de réinstallation des réfugiés de pays en guerre pour une durée de quatre mois. Les familles en provenance de Syrie, elles, se sont vues interdire l’accès au territoire américain jusqu’à nouvel ordre. Dans la foulée, Donald Trump a promulgué un décret visant à « protéger la nation de l’entrée de terroristes étrangers aux États-Unis » et bloqué pour trois mois l’arrivée dans le pays des ressortissants de sept pays à majorité musulmane.
Dans la bouche des citoyens américains, choqués par une mesure aussi soudaine qu’ignominieuse, le décret a été immédiatement rebaptisé « Muslim Ban ». Quelques heures plus tard, on a annoncé que deux ressortissants irakiens étaient détenus à l’aéroport de New York-JFK par les douanes américaines. La nouvelle a mis le feu aux poudres. Des milliers de New-Yorkais ont déferlé dans l’aéroport et l’ont encerclé, protestant pour mettre un terme à la situation. En fin d’après-midi, un syndicat de chauffeurs de taxi de la ville, la New York Taxi Workers Alliance, a appelé unanimement à la mobilisation de ses chauffeurs.
Ils étaient nombreux à se joindre aux manifestants rassemblés devant le Terminal 4. « En tant qu’organisation dont les membres sont pour beaucoup de confession musulmane, dont l’effectif est presque exclusivement constitué d’immigrés venus de partout dans le monde, et dont les racines viennent de la défense des opprimés, nous disons non à cette interdiction inhumaine et anticonstitutionnelle », a écrit le syndicat dans un communiqué, tandis que ses chauffeurs avaient interrompu leur travail par solidarité avec leurs concitoyens.
Chez Uber, les choses sont allées autrement. À 19 h 36, une trentaine de minutes après la déclaration du syndicat des taxis, le compte new-yorkais de la plateforme a tweeté que la hausse des tarifs avait été désactivée à l’aéroport JFK. Habituellement, lorsque les algorithmes de l’application de transport à la demande détectent une forte affluence dans une zone, les tarifs augmentent automatiquement – plus il y a de demande, plus l’offre est coûteuse. Mais lorsque les techniciens du groupe réalisent que cette affluence est due à un événement grave, tel que des attentats ou des manifestations, ils peuvent choisir de désactiver la fluctuation des prix. C’est ce qu’il s’est passé ce jour-là. Mais une heure après l’avoir signalé, sans un mot vis-à-vis de la situation qui occupait les manifestants, certains utilisateurs les ont accusés de tenter de « briser la grève » et de profiter du sort des réfugiés pour s’enrichir.
« Cet exemple est marquant car notre intention a été mal comprise », commentait Grégoire Kopp. D’après lui, l’idée était justement pour Uber d’éviter un nouveau « bad buzz » en ne laissant pas les prix s’envoler comme un soir de Nouvel An. (Lors de précédentes flambées des tarifs durant des situations de crise, la plateforme a été épinglée pour avoir facturé certains trajets plusieurs centaines de dollars aux usagers.) Mais le mal était fait et la situation a vite empiré. Le hashtag #DeleteUber (« supprime Uber ») a pris comme un feu de paille, conduisant plus de 200 000 usagers à supprimer leur compte en représailles au cours du week-end, selon le New York Times. Le fait que Travis Kalanick ait rejoint un mois plus tôt le comité d’entrepreneurs formé par Trump pour le conseiller est venu alimenter les critiques.
Entre l’incident de JFK et le nouveau statut de conseiller de Kalanick, il était clair pour beaucoup qu’Uber se positionnait du mauvais côté du manche. La semaine suivante, le PDG a annoncé qu’il quittait le comité. « Rejoindre le groupe n’était pas le signe d’une approbation du Président ou de son programme, mais cela a malheureusement été interprété exactement de cette manière », s’est-il justifié dans un autre email adressé à ses employés. « Il arrive qu’on soit perçu négativement ab initio », renchérissait Grégoire Kopp.
Au vu du passif de la société, ce n’est pas étonnant. Uber a été impliqué dans un nombre insensé de scandales dont une bonne partie a atterri devant les tribunaux. En août 2016 rien qu’aux États-Unis, il y avait 70 procès en attente de jugement impliquant la compagnie. Uber France n’était pas en reste puisque la branche locale du groupe y affrontait pêle-mêle organes gouvernementaux, chauffeurs de taxis et chauffeurs de VTC depuis son lancement en France, fin 2011. Avec la propagation du hashtag #UberCestOver, elle est en plus mauvaise posture encore. Alors, le géant sortira-t-il indemne de cette série noire ou est-ce le début de la fin ? La réponse se trouve dans son modèle, terriblement efficace économiquement, mais finalement si dangereux : en refusant de salarier ses conducteurs, Uber rend non seulement le travail plus précaire, mais il s’expose à associer sa marque à des prédateurs.

Légendes urbaines
La légende raconte qu’Uber est né à Paris, par une soirée de décembre 2008 où il neigeait. Travis Kalanick et son futur associé Garrett Camp participaient à LeWeb, la conférence lancée par Loïc et Géraldine Le Meur, qui rassemble chaque année startupeurs, patrons du Web et investisseurs le temps d’un week-end. À l’époque, Kalanick avait 32 ans et il était déjà un serial entrepreneur. Il avait vendu sa précédente entreprise, Red Swoosh – une plateforme voisine de Napster –, pour 19 millions de dollars en 2007. Voilà près de deux ans qu’il cherchait à se lancer dans un nouveau business. Camp, de son côté, avait négocié l’acquisition de sa société StumbleUpon par eBay pour 75 millions de dollars l’année d’avant. C’est de lui que vient l’idée d’Uber, de l’aveu même de Travis Kalanick.
« Quand tu ouvres l’app et que tu te sens genre : “Je vis dans le futur ! J’appuie sur un bouton et une voiture apparaît, je suis un putain de pimp !” C’est Garrett le type qui a inventé cette merde », exultait le PDG lors d’une petite célébration il y a six ans, alors qu’Uber s’appelait encore UberCab. À la sortie de la conférence, qui se tenait au 104 dans le quartier parisien de Stalingrad, les deux entrepreneurs auraient eu un mal fou à trouver un taxi pour aller dîner en centre-ville. Dans la version racontée par Grégoire Kopp, c’est en voyant les berlines noires avec chauffeur stationnées à Saint-Germain-des-Prés et sur la place Vendôme que les deux hommes ont eu l’idée de mettre à profit leur temps d’arrêt en permettant aux gens de leur commander une course via une application plateforme. Cette version de l’histoire, qui concorde avec la volonté affichée d’Uber d’offrir une alternative abordable et chic au taxi pour le plus grand nombre, n’est pas celle qui se racontait dans les premiers temps de leur activité.  Garrett Camp aurait plutôt gardé un mauvais souvenir d’une nuit de Nouvel An durant laquelle il avait loué les services d’un chauffeur privé, payé 800 dollars au petit matin.
Garrett Camp aurait plutôt gardé un mauvais souvenir d’une nuit de Nouvel An durant laquelle il avait loué les services d’un chauffeur privé, payé 800 dollars au petit matin.
Cette addition salée lui est restée en travers de la gorge et il s’est creusé la tête pour trouver un moyen de casser les prix du transport de luxe – histoire d’en profiter sans éroder sa fortune. Il a fini par se dire que diviser le coût entre un maximum de personnes serait un bon moyen d’y parvenir. L’idée faisait sens à San Francisco, où Camp et Kalanick étaient entourés par les glorieux entrepreneurs de la Silicon Valley. Aussi, lorsque les deux hommes ont lancé UberCab en juin 2010, le service se destinait essentiellement à une élite désireuse d’éviter les taxis – qui se font rares à SF – tout en payant moins cher pour un chauffeur privé. À cette époque, une course Uber coûtait 1,5 fois plus cher que de prendre le taxi.
Deux ans plus tard, en mai 2012, deux autres entrepreneurs de San Francisco, Logan Green et John Zimmer, ont annoncé la sortie de Lyft, un service similaire à Uber mais en moyenne 30 % moins cher que les taxis. Kalanick et ses associés ont alors brutalement pris conscience que le véritable marché n’était pas dans la niche du luxe mais auprès du grand public. Ils ont lancé UberX (UberPOP en France, interdit en 2015) en juillet de la même année, qui permet à pratiquement n’importe quel conducteur de travailler avec Uber. Naturellement, ça ne s’est pas fait sans heurts. Dès le lancement de la société, Travis Kalanick a pris au pied de la lettre l’ancienne devise de Facebook, « Move fast and break things ». Mais avancer le plus vite possible sans avoir peur de la casse a un prix, qui se paye devant les tribunaux.
Dès le mois d’octobre 2010, UberCab a eu affaire aux autorités de la ville de San Francisco, qui la sommaient de suspendre ses activités. L’incident a poussé UberCab à se rebaptiser Uber : une volonté de la part de la start-up de montrer qu’elle n’était pas un service concurrentiel des taxis, mais une plateforme de mise en relation d’usagers à la recherche d’un chauffeur, et de chauffeurs de voitures de luxe en quête de clientèle. La recette a pris rapidement.
« Uber était une des premières entreprises de transport partagé à faire les choses bien, ou du moins de façon satisfaisante », explique Harry Campbell, chauffeur devenu blogueur populaire aux États-Unis. « Quand ils ont commencé, leur application n’était pas aussi aboutie qu’aujourd’hui, mais ils étaient déjà très forts en marketing. » En particulier auprès des chauffeurs privés américains, qui bénéficiaient alors d’un système de parrainage lucratif qui a grandement contribué à populariser le service au sein de la profession.

Harry Campbell
Crédits : Christie Hemm Klok
« Une fois que l’offre a été à la hauteur de la demande, ils ont à nouveau investi dans le marketing pour faire découvrir leur service aux usagers des transports », poursuit-il. Toutes les villes ne se sont pas dressées d’emblée contre l’arrivée d’Uber. « Certaines municipalités ne s’occupent de ce qui ne va pas que quand les choses deviennent vraiment problématiques », dit Harry Campbell.
Face aux problèmes, il y a deux sortes de législateurs : les plus laxistes, qui tentent de trouver des ajustements pour permettre la cohabitation des plateformes de transport à la demande avec les services existants comme les taxis, et ceux qui établissent des réglementations plus exigeantes. « C’est ce qu’il s’est passé à Austin, et ça a causé le départ d’Uber en mai 2016 », raconte-t-il. La société est revenue dans la ville texane en juin 2017, avant d’être interdite à Barcelone en janvier 2019.
Les bras de fer judiciaires entre Uber et les législateurs locaux sont de coutume chaque fois qu’elle arrive dans une nouvelle ville. Les choses ne se sont pas arrangées quand la firme a décidé de s’implanter à l’étranger. Comme pour faire écho au récit de sa création, la première ville dans laquelle le service américain a décidé de s’installer hors de ses frontières était Paris.
Un Américain à Paris
Les premières berlines noires d’Uber ont commencé à arpenter les rues de la capitale en décembre 2011. Une décision plus pragmatique que romantique de la part de l’entreprise, qui a surfé sur une nouvelle législation : la création des VTC, en juillet 2009. Présentée par le secrétaire d’État Hervé Novelli sous la supervision du gouvernement Fillon, la loi n°2009-888 prévoyait la remise à plat du système des voitures de remise hérité du XVIIe siècle, transformées en Voitures de Transport avec Chauffeur. Au cœur de cette loi, une dérégulation considérable de la profession qui a déroulé le tapis rouge aux plateformes telles qu’Uber, qui de l’avis du gouvernement représentaient une opportunité rêvée pour créer de l’emploi chez les jeunes.
Mais tout le monde n’était pas de cet avis et les taxis parisiens ont été les premiers à protester contre les nouvelles réglementations.  « Notre relation avec Uber ? Elle est au palais de justice », résumait début 2017 Karim Asnoun, secrétaire général de la CGT Taxis. « Même leurs chauffeurs régularisés, on estime qu’ils sont en irrégularité parce qu’ils maraudent. »
« Notre relation avec Uber ? Elle est au palais de justice », résumait début 2017 Karim Asnoun, secrétaire général de la CGT Taxis. « Même leurs chauffeurs régularisés, on estime qu’ils sont en irrégularité parce qu’ils maraudent. »
Le maraudage, ou le fait d’attendre la clientèle sur la voie publique, est le propre du taxi. Karim Asnoun et ses collègues considèraient que les chauffeurs travaillant avec Uber et les autres plateformes de transport sur demande (Chauffeur Privé, LeCab…) ne devaient se trouver sur la voie publique qu’en cas de réservation. Pour appuyer ses propos, il citait un rapport du préfet Pierre Chassigneux datant de 2007, qui constatait déjà les limites de l’offre et de la disponibilité des taxis parisiens, « en partie liées aux conditions spécifiques de circulation dans la capitale ». « L’idée “qu’on ne prend pas de taxi parce qu’on n’en trouve pas” se trouve démentie par le constat de la surcapacité en heures creuses : l’offre de taxi y est abondante, mais elle ne génère pas, ou très marginalement, de demande supplémentaire malgré une modulation tarifaire ad hoc », dit le rapport.
Aussi, pour Karim Asnoun, plutôt que d’offrir de réelles possibilités d’insertion et de reprise professionnelle, Uber et ses pairs précarisaient le secteur au détriment des taxis comme des chauffeurs qui travaillent avec eux, en tirant les prix vers le bas tout en augmentant leur commission. « Uber ne le fait pas pour ses chauffeurs, elle le fait pour son profit », disait sans détour Karim Asnoun. Sayah Baaroun allait dans son sens.
Malgré tous les différends qui opposaient chauffeurs de taxis et chauffeurs de VTC dans la capitale, avec des débordements parfois violents, le secrétaire général du Syndicat des Chauffeurs Privés-VTC, tombait d’accord avec son homologue sur ce point. Il menait la bataille contre la situation qui les affligeait, lui et ses collègues. « Ce n’est pas tenable actuellement », disait-il. En octobre 2015, Uber avait baissé ses prix de 20 % tout en augmentant sa commission de 20 à 25 % sur le prix de la course.
Si l’entreprise a accepté en décembre 2016 de revoir ses tarifs à la hausse « de 10 à 15 % », elle est restée pour le moment inflexible sur la question de la commission. Pour Sayah Baaroun, le quotidien des chauffeurs reste par conséquent invivable. « C’est la raison pour laquelle on demande l’établissement d’un seuil minimum dignité aligné sur le tarif C des taxis », indiquait-il. Le 10 mars 2017, le syndicat a demandé, dans une lettre intitulée « Proposition officielle pour la sortie de crise » adressée à Uber, l’établissement d’un prix plancher à 12 euros net, pour les petits trajets.
Avant l’apparition des plateformes type Uber, il gagnait mieux sa vie.
« Uber a attiré les professionnels avec une offre alléchante au départ. Mais maintenant qu’ils sont connus de tous les usagers, ils font ce qu’ils veulent des professionnels », déplorait Sayah Baaroun. « En ce qui nous concerne, ils peuvent bien mettre la commission qu’ils veulent mais pas au détriment du chauffeur. » À l’époque, selon lui, deux tiers des chauffeurs VTC ne déclaraient plus leurs revenus pour tenir le coup. Du côté d’Uber, Grégoire Kopp affirmait que 17 000 chauffeurs de VTC travaillaient avec eux : « Si c’était une arnaque et qu’ils ne pouvaient pas gagner leur vie avec, ils ne sont pas bêtes, ils se passeraient le mot ».
Pour lui, les tarifs ou la commission de la plateforme de mise en relation des chauffeurs avec leurs clients étaient hors de cause. « Certaines personnes se sont un peu enflammées et ont acheté des voitures beaucoup trop chères », disait-il, faisant écho à l’argument employé par Travis Kalanick face à Fawzi Kamel. « Et en location aujourd’hui, les premiers prix sont à 750 € par mois la voiture avec assurance. Sans compter qu’il faut qu’elles soient aux normes VTC. Le lobbying des taxis a réussi à faire passer une certaine taille requise pour les VTC (4,50 m et 1,70 m), ce qui augmente encore les coûts. » Grégoire Kopp maintenait pourtant que « les VTC indépendants qui connaissent le métier s’en sortent très bien aujourd’hui ».
Des indépendants à l’image de Sayah Baaroun, qui s’inscrivait en faux vis-à-vis de cette affirmation. Avant l’apparition des plateformes d’intermédiaire du transport type Uber, il était formel sur le fait qu’il gagnait mieux sa vie. « Avant Uber, un Paris-Roissy c’était 120 euros », donne-t-il comme exemple. « Aujourd’hui, c’est 45. Vous faites le calcul. »
Inflexible sur la commission, Uber a néanmoins accepté d’offrir un semblant d’assurance à ses conducteurs en octobre 2017. En cas d’accident, ils peuvent prétendre à une allocation forfaitaire de 1 000 euros pour l’hospitalisation, ainsi qu’à une indemnité journalière de 40 euros par jour pendant un mois au maximum. Ceux qui ont effectué plus de 150 courses sur les deux derniers mois avant de tomber malade bénéficient d’une compensation journalière de 40 euros par jour durant deux semaines. La naissance d’un enfant donne droit à 1 000 euros.
Depuis janvier 2018, la loi « Grandguillaume » requiert une carte professionnelle pour être chauffeur de VTC. Elle a été complétée en juin 2019 par la loi « mobilité », qui introduit un droit à la déconnexion, le droit de connaître le prix d’une course au préalable et le droit de refuser un client. Les plateformes sont simplement invitées à rédiger une charte « précisant les contours de leur responsabilité sociale ». Pour Saya Baaroun, c’est au mieux insuffisant, au pire pervers : « Avec ces chartes facultatives et unilatérales, les plates-formes vont définir leurs propres règles », dénonce-t-il. « Cela va par ailleurs faire échouer l’action devant les prud’hommes des chauffeurs qui réclament un statut de salarié. »
Alors que la Cour d’appel de Paris a requalifié un chauffeur en salarié en janvier 2019, Uber s’est tout de suite pourvu en cassation pour contester cette décision. Aux États-Unis, la Californie a approuvé une loi imposant aux plateformes de donner aux chauffeurs de VTC le statut de salariés à partir de janvier 2020. Pour l’heure, Uber a annoncé qu’il n’entendait pas changer de modèle.
L’effet de réseau
Sept ans après son lancement à Paris, Uber est présent dans 700 villes, et la compagnie était valorisée à hauteur de 82 milliards de dollars en mai 2019. Elle a réalisé 5,2 milliards de trajets dans 63 pays en 2018 et revendique 91 millions d’utilisateurs actifs, soit l’équivalent de la population du Vietnam. Son chiffre d’affaire est ainsi passé de 495 millions de dollars en 2014 à 11,3 milliards de dollars en 2018. Mais comment expliquer que les multiples scandales qui entachent l’histoire d’Uber ne nuisent pas davantage à ses affaires ?  Selon Judith Rochfeld, professeure de droit privé et directrice du master droit du commerce électronique et de l’économie numérique à la Sorbonne, cela s’explique du fait de l’apparition d’un nouveau paradigme. « Ça montre une chose extrêmement importante : aujourd’hui, le pouvoir est aux algorithmes et aux données. Uber ne possède rien en propre, ni voitures, ni chauffeurs », explique-t-elle. « Elle met en relation des personnes grâce à ses algorithmes et aux données qu’elle emmagasine, qui permettent de créer un réseau. C’est là sa puissance. L’intermédiation est devenue une puissance en soi. » Un phénomène né avec l’apparition des GAFA, l’acronyme qui désigne les « géants du Web » comme Google, Amazon, Facebook et Apple.
Selon Judith Rochfeld, professeure de droit privé et directrice du master droit du commerce électronique et de l’économie numérique à la Sorbonne, cela s’explique du fait de l’apparition d’un nouveau paradigme. « Ça montre une chose extrêmement importante : aujourd’hui, le pouvoir est aux algorithmes et aux données. Uber ne possède rien en propre, ni voitures, ni chauffeurs », explique-t-elle. « Elle met en relation des personnes grâce à ses algorithmes et aux données qu’elle emmagasine, qui permettent de créer un réseau. C’est là sa puissance. L’intermédiation est devenue une puissance en soi. » Un phénomène né avec l’apparition des GAFA, l’acronyme qui désigne les « géants du Web » comme Google, Amazon, Facebook et Apple.
Malgré leurs différences, ces compagnies incarnent toutes l’avènement d’un modèle spécifique, celui d’entreprises plateformes qui parviennent à concentrer une vaste clientèle dispersée sur un service unique. C’est cette capacité à concentrer l’audience et à la redistribuer qui fait la puissance de l’entreprise. « Uber est parvenue à devenir l’intermédiaire central d’un marché », poursuit Judith Rochfeld. Pour cela, elle joue sur ce qu’on appelle l’ « effet de réseau », une logique qui veut que plus un service a de clients, plus son attrait grandit auprès du grand public. Cela expliquerait en partie la politique ultra-offensive d’Uber, qui ne craint pas de se placer dans l’illégalité pour faire changer le droit : dans l’intervalle, l’attrait et la notoriété galopante du service aspirent clients et travailleurs comme un gigantesque trou noir.
Uber a cependant atteint une période charnière. L’euphorie des débuts a laissé la place à la réalité d’un modèle dont les bénéficiaires ne sont apparemment pas les travailleurs, et peut-être pas davantage les usagers. « De prime abord, le consommateur est gagnant, car les prix sont moins élevés. Mais si Uber capte de la richesse sur le territoire français sans participer à la redistribution par l’impôt, le citoyen est perdant car c’est à lui de payer », explique Judith Rochfeld.

Manifestation de taxis contre Uber en 2015
« Pour une entreprise de la taille d’Uber, il est statistiquement impossible d’éviter les problèmes », ajoute Josh Steimle, entrepreneur et contributeur régulier de Forbes. « La probabilité que ces problèmes adviennent augmente lorsque vous vous appuyez sur de nombreux travailleurs indépendants, car il est impossible de contrôler la qualité de leur service de la même façon qu’avec des employés. »
Pour résoudre une partie de ces problèmes, Uber travaille activement à éliminer un facteur gênant de l’équation : celui des chauffeurs humains. Dans un futur pas si lointain, la plateforme pourrait ne mettre sa clientèle en relation qu’avec sa propre flotte de véhicules autonomes. Une telle évolution éviterait de facto à l’entreprise des démêlés judiciaires avec les chauffeurs eux-mêmes, mais également avec les usagers victimes des chauffeurs travaillant avec Uber…
Uber AI
Dans la soirée du 20 février 2016, à Kalamazoo, une série de fusillades apparemment sans lien ont éclaté, faisant six morts et deux blessés. Il était près de 18 heures dans cette ville du Michigan et l’obscurité avait déjà recouvert le ciel quand des coups de feu ont été tirés sur un parking du nord-ouest de la ville. La cible était une femme accompagnée de ses trois enfants. Plus de dix coups de feu ont été tirés. La malheureuse a été blessée mais a survécu, les enfants n’ont pas été touchés. Quatre heures et demie plus tard, un père et son fils n’ont pas eu la même chance et ont été froidement abattus devant l’entrée d’un concessionnaire Kia.
Et quinze minutes plus tard, la mort est venue s’abattre sur le parking d’un restaurant : deux véhicules ont été pris pour cible, quatre personnes sont mortes et une autre a été blessée. Les victimes des trois scènes de crime ne se connaissaient pas. L’unique lien entre elles était le tireur, Jason Brian Dalton, un chauffeur Uber de 45 ans. Il était près d’une heure du matin cette nuit-là quand la police a arrêté Dalton. Lors de son interrogatoire, le meurtrier a confessé ses crimes et expliqué que c’était l’application qui l’avait poussé à tuer. Il voyait en Uber un symbole diabolique.
Ce récit macabre n’a eu ni précédent, ni successeur pour le faire oublier. Mais on rapporte de nombreux cas de violences et d’abus perpétrés par des chauffeurs travaillant avec Uber dans le monde. Aux États-Unis, un chauffeur a renversé et tué une fillette de six ans à San Francisco, en janvier 2014 ; un autre a agressé un passager avec un marteau en septembre de la même année, dans la même ville ; en décembre 2012, une jeune femme de 20 ans résidant à Washington, D.C. a accusé un chauffeur de l’avoir molestée et violée ; et un an plus tard, un chauffeur aurait tenté d’étrangler une passagère, toujours à Washington.
Ces quatre récits émergent à peine des dizaines d’autres rapportés par la presse américaine au fil des ans. En octobre 2015, c’est en Inde qu’une femme a été violée par un chauffeur qui l’avait kidnappée. Une tragédie similaire aurait eu lieu au Mexique en mai 2016. Le même mois, la presse anglaise a révélé que 32 accusations d’agression sexuelle lors de trajets commandés avec Uber auraient été prononcées à Londres au cours des 12 mois précédents, soit une tous les 11 jours. Malgré un manque de sécurité évident, Uber demeure intraitable quant au fait que l’entreprise ne peut en aucun cas être tenue responsable de ce qu’il se passe dans l’habitacle des voitures que les utilisateurs commandent via son application.
Il a pourtant été maintes fois reproché à Uber (et ses concurrents) de ne pas faire de vérification des antécédents approfondie des chauffeurs autorisés par le service. C’est la raison pour laquelle la firme a quitté Austin en mai 2016. Les autorités de la ville exigeaient de pouvoir relever les empreintes digitales des chauffeurs comme condition sine qua non de leur exercice : Uber s’y est fermement opposée, mais n’a pas réussi à faire plier la mairie.
~
Cet empilement de problèmes vis-à-vis des chauffeurs travaillant avec l’application est sans aucun doute un moteur pour les recherches d’Uber en matière de voitures autonomes. En août 2016, l’entreprise a fait l’acquisition d’Otto, une start-up américaine spécialisée dans la conception de technologie d’automatisation automobile. Leurs ingénieurs conçoivent des camions capables de conduire seuls et d’effectuer à terme des livraisons sur de longues distances.
Quant à Uber, elle a déployé en septembre 2016 une flotte de voitures autonomes à l’essai à Pittsburgh. Après un faux départ illégal à San Francisco en décembre, l’État de Californie a finalement décidé le 8 mars d’accorder à Uber la licence lui permettant de mettre à l’essai ses véhicules autonomes. En dépit du coût imposé par une flotte possédée en propre, il n’est pas difficile d’imaginer que le groupe trouverait un avantage certain à remplacer ses chauffeurs humains par des intelligences artificielles inoffensives et peu regardantes sur les conditions économiques et sociales de leur travail. Cela dans l’hypothèse où Uber parvient effectivement à développer sa technologie de véhicules autonomes.

Cette stratégie a été paralysée par un drame mortel. En mars 2018, un prototype à l’essai dans l’Arizona a tué une piétonne dans la ville de Tempe, à l’est de Phoenix. Dans un rapport rendu le 5 novembre 2019, le National Transport Safety Board (NTSB) explique que le logiciel a confondu la malheureuse avec un objet. Comme il l’a détectée 5,6 secondes avant l’impact, il a décidé de ne pas freiner. Pendant ce temps, l’employée d’Uber censée reprendre le contrôle du véhicule en cas d’urgence regardait l’émission The Voice sur son portable.
En décembre 2018, la compagnie a été autorisée à reprendre les tests de voitures autonomes en Pennsylvanie. Et en juin 2019, elle a présenté un nouveau modèle : « Ce véhicule de série prêt pour la conduite autonome de Volvo Cars se dote notamment de systèmes de secours pour les fonctions de direction et de freinage ainsi que d’une alimentation de secours par batterie », peut-on lire dans le communiqué de son partenaire, Volvo. « En cas de défaillance –pour quelque raison que ce soit– des systèmes primaires, les systèmes de secours sont conçus pour stopper immédiatement le véhicule. »
Mais d’autres écueils ont entre-temps apparu. Le 23 février 2017, une société appelée Waymo a intenté un procès contre Uber. Le nom de Waymo ne vous dit peut-être rien, mais il s’agit de la filiale de Google consacrée au développement de la conduite autonome. D’après elle, Uber utilise une technologie qui lui aurait été volée par un certain Anthony Levandowski. Ce dernier travaillait pour Google avant de quitter la firme à la fin de l’année 2015 et de fonder Otto. Un mois avant son départ, il aurait téléchargé 14 000 documents appartenant à Google, sur lesquels il se serait appuyé pour développer sa propre technologie. Passé à la tête de la division d’Uber en charge des projets de véhicules autonomes, après le rachat de sa société en août pour 680 millions de dollars, Levandowski s’est retrouvé dans l’œil dans la justice. Il a été renvoyé par Uber en mai 2017 puis inculpé pour vol de secret industriel en août 2019.
Un porte-parole d’Uber a déclaré que le procès de Waymo était « une basse tentative de ralentir un concurrent », mais l’entreprise a de sérieuses raisons de s’inquiéter après que Waymo a demandé au tribunal de prononcer une interdiction provisoire à l’encontre d’Otto et d’Uber, afin que leurs expériences de véhicules autonomes soient immédiatement suspendues. En février 2018, les deux groupes ont surpris tout le monde en trouvant un accord. En échange d’un abandon des poursuites, Uber a accepté de céder 0,34 % de ses parts à Waymo. Un expert mandaté à cette occasion a conclu, jeudi 7 novembre 2019, que le géant du VTC a bien utilisé la technologie de conduite autonome de Waymo sans autorisation. Il pourrait donc devoir lui payer une licence. Pour Judith Rochfeld, il y a peu de chance que cette histoire écorne l’image d’Uber. « Mais c’est un coup très dur financièrement car les sommes en jeu sont dans ces cas-là considérables », dit-elle.
Alphabet, le conglomérat de sociétés auquel appartiennent Google et Waymo, était un des premiers investisseurs d’Uber, après avoir réalisé en 2013 un investissement de 250 millions de dollars dans la compagnie. Mais ils sont désormais engagés dans une concurrence féroce, alors qu’Uber a cessé d’utiliser Google Maps pour développer sa propre technologie de géolocalisation et que David Drummond, haut responsable d’Alphabet, a quitté le conseil d’administration d’Uber en août 2016, choisissant son camp.
Alors qu’Uber est attaquée sur tous les fronts, son issue de secours la plus prometteuse vient de se changer au moins provisoirement en impasse. « Qu’importe les différentes causes des problèmes que traverse Uber », conclue Josh Steimle. « Il n’y a qu’une seule solution pour les résoudre : un meilleur leadership. » La démission de Travis Kalanick était censée régler ce problème, mais elle n’a pas suffi à impulser le changement de modèle profond dont avait besoin Uber. Peut-être que le législateur, ou à défaut le juge, s’en chargera.
Couverture : Travis Kalanick et les voitures autonomes d’Uber. (Ulyces.co)
L’article Uber est-elle devenue l’entreprise la plus détestée du monde ? est apparu en premier sur Ulyces.
06.07.2022 à 10:35
Comment le Festival Paradiso entremêle cinéma et musique
Pablo Oger
Cinéma, musique, danse, fête et détente… Le Festival Paradiso débarque au Louvre pour sa quatrième édition. Du 6 au 9 juillet prochains, plus de 2 500 spectateurs sont attendus dans la Cour carrée du musée parisien, pour des projections en plein air. Organisé par la société de production mk2, l’événement est gratuit et ouvert au grand […]
L’article Comment le Festival Paradiso entremêle cinéma et musique est apparu en premier sur Ulyces.
Texte intégral (1039 mots)
Cinéma, musique, danse, fête et détente… Le Festival Paradiso débarque au Louvre pour sa quatrième édition. Du 6 au 9 juillet prochains, plus de 2 500 spectateurs sont attendus dans la Cour carrée du musée parisien, pour des projections en plein air. Organisé par la société de production mk2, l’événement est gratuit et ouvert au grand public. Les places ont d’ores et déjà été remises lors de trois tirages en ligne, afin de permettre à chacun d’avoir sa chance.
Les cinéphiles férus de fêtes en tout genre ont enfin un événement à la hauteur de leurs espérances en France. Rien de tel pour apprécier un bon film que d’être placé dans un environnement propice à sa projection. Depuis 2019, Paradiso est organisé pour offrir une expérience inédite à ses participants. Le concept paraît pourtant simple : pendant quatre jours, des centaines de personnes ont accès à un cinéma en plein air, entouré d’une salle de concert et de restaurants qui tournent à plein régime avant chaque projection. Chaque personne peut ainsi profiter gratuitement d’un moment privilégié dans le musée le plus visité au monde, avec un thème pour chaque édition.
Cette année, le festival s’inspire de l’exposition « Naples à Paris », actuellement présenté au Louvre. Les heureux élus sont donc accueillis dans un village italien, influencé par l’idée de la dolce vita napolitaine. Chaque soir est diffusé un classique du cinéma qui fait référence au pays de la Botte.

Le programme en salle
Le premier soir, Les Affranchis de Martin Scorsese seront à l’honneur : D’origine irlando-italienne, Henry Hill a toujours rêvé de devenir gangster. Dès son plus jeune âge, il fait des petits boulots pour les mafieux du quartier avant d’être remarqué par le caïd local, Paulie, qui le prend sous son aile.
Le 7 juillet, les invités regarderont Huit et Demi de Federico Fellini : Anselmi, réalisateur, ne parvient pas à terminer son film. Dans la station thermale où il s’est isolé, son épouse Louisa, sa maîtresse Carla, ses amis, ses acteurs, ses collaborateurs et son producteur viennent lui rendre visite, pour qu’enfin soit réalisé le film sur lequel il doit travailler.
Le lendemain, ce sera au tour du film Il était une fois dans l’Ouest : Alors qu’il prépare une fête pour sa femme, Bet McBain est tué avec ses trois enfants. Jill McBain hérite alors les terres de son mari, terres que convoite Morton, le commanditaire du crime (celles-ci ont de la valeur maintenant que le chemin de fer doit y passer). Mais les soupçons se portent sur un aventurier, Cheyenne…
Enfin, la cérémonie sera clôturée le 9 juillet avec Plein Soleil de René Clément : Le jeune Tom Ripley est chargé par un milliardaire américain, M. Greenleaf, de ramener son fils à San Francisco. Tom s’immisce alors dans la vie de Philippe, parti pour de longues vacances en Italie, et de sa fiancée, Marge. Une complicité malsaine naît entre les deux hommes…

Une expérience riche
L’événement est au cœur du festival « Les Étés du Louvre ». Pour accompagner l’exposition ainsi que les projections, une multitude d’activités se retrouve au programme. « La plus belle salle de cinéma au monde » est animée chaque soir par plusieurs concerts et DJ Sets.
Figure emblématique de la scène électronique mondiale, Busy P démarre les festivités le 6 juillet, puis laisse sa place à Madame Arthur pour un spectacle du Cabaret-club mythique de Pigalle le lendemain. Au troisième soir, les convives écouteront les notes de la diva étincelante Corine, qui partagera son nouvel album « R ». Pour clore la marche, l’artiste Giorgio Poi pose ses valises dans la cour carrée du Louvres lors du dernier soir.
À noter qu’avant chaque concert, des cours de danse sont donnés dans l’enceinte du bâtiment par Paris Université Club. Même les plus inexpérimentés n’ont plus d’excuse pour ne pas s’enflammer sur la piste et profiter pleinement du moment.
En plus de ces expériences inédites, 5 foodtrucks, 1 triporteur et 5 bars, dont un consacré à l’apéritif italien Spritz, permettront au public d’être rassasié. Le restaurant EATALY, temple de la gastronomie italienne, complètera la carte aux côtés du glacier partenaire AMORINO.
Le spectacle ne s’arrête pas là. Afin d’offrir une immersion totale, chaque film est précédé d’une avant-séance. En clair, les long-métrages sont introduits par des personnalités du monde de la création ainsi que des journalistes spécialisés, dans le but de plonger entièrement dans l’univers de ces œuvres.
Enfin, le studio mk2 souhaite promouvoir sa collaboration avec Youtube, qui tente d’attirer le jeune public au cinéma. Ainsi, un aperçu exclusif du “YouTube Ciné Club par mk2”, avec une avant-première, sera également à retrouver sur place.
Bon nombre d’activités promettent donc d’animer chaque soirée du Paradiso, qui s’inscrit déjà comme l’un des meilleurs festival de cinéma en plein air au monde.
Pour participer à la loterie et peut-être gagner des places pour le festival, rendez-vous sur le site : https://www.mk2festivalparadiso.com/fr/louvre !
L’article Comment le Festival Paradiso entremêle cinéma et musique est apparu en premier sur Ulyces.
03.02.2022 à 00:00
L’histoire secrète de la sextape de Pamela Anderson et Tommy Lee
Amanda Lewis
Marrant l’état dans lequel on se trouve lorsqu’on a une arme pointée sur soi. Et quand c’est une rock star mégalomane qui tient le calibre ? On se sent encore moins bien. Surtout quand ladite rock star vient de passer trois mois en prison, soit tout le printemps 1995, et commence à délirer sous vos yeux. C’est qu’il […]
L’article L’histoire secrète de la sextape de Pamela Anderson et Tommy Lee est apparu en premier sur Ulyces.
Texte intégral (10101 mots)
Marrant l’état dans lequel on se trouve lorsqu’on a une arme pointée sur soi. Et quand c’est une rock star mégalomane qui tient le calibre ? On se sent encore moins bien. Surtout quand ladite rock star vient de passer trois mois en prison, soit tout le printemps 1995, et commence à délirer sous vos yeux. C’est qu’il enquille des martinis et fume des joints depuis 11 heures du matin avec sa nouvelle épouse, une actrice blonde qui fait fantasmer un milliard de personnes dans le monde chaque semaine dès qu’elle enfile son bikini rouge et trottine sur une plage californienne. Surtout quand on n’a pas arrêté de dérouler des câbles, de défoncer des murs et de les repeindre encore et encore, parce que la rock star, qui voulait l’interrupteur à cet endroit-ci, le veut désormais à cet endroit-là.
Le jour où Tommy Lee et Pamela Anderson virèrent brutalement les ouvriers chargés de rénover leur propriété de Malibu et refusèrent de payer pour des travaux qu’ils trouvaient bâclés, Rand Gauthier, l’électricien, était tellement excédé par les demandes délirantes du couple qu’il était prêt à effacer leur ardoise de 20 000 dollars simplement pour avoir la paix. Mais quand il revint chez eux, à Mulholland Highway, pour récupérer ses outils accompagné d’un maçon, et que Tommy Lee les braqua avec un fusil à pompe en hurlant « Foutez le camp de chez moi ! », Gauthier commença sérieusement à s’énerver.
Pam et Tommy
Lee traita Gauthier comme un moins que rien ce jour-là, lui qui avait passé sa vie entière à être traité comme un moins que rien. On parle d’un homme qui, le jour de ses 18 ans, perdit sa virginité avec une prostituée de Las Vegas. Un type de L.A. qui eut bien du mal à vivre autrement que dans l’ombre de son père, célèbre pour avoir été une des vedettes de Bye Bye Birdie à Broadway, et qui interprétait Hymie le Robot dans Get Smart, une série américaine des années 1960. Arrivé dans les années 1990, Gauthier avait les muscles gonflés, la peau bronzée, les épaules larges, le sourire d’un agent immobilier et une voix de surfeur décontracté. La plupart des gens le prenaient pour un naze, un amateur de théories du complot qui aimait piloter des bolides et se taper des actrices de X. Il tourna même dans quelques films, et il avait pour habitude de traîner sur les tournages, montant les décors et draguant les starlettes. Le troll des studios, c’est ainsi qu’on l’appelait. « J’ai jamais été très populaire », dit-il. « Mais on ne m’avait jamais braqué avec une arme. Ça m’a niqué la tête. »
Gauthier voulait sa vengeance. Il voulait que le batteur se sente vulnérable, qu’il se rappelle qu’il était un être humain comme les autres et pas une sorte de roc inébranlable, bien qu’il ait vendu vingt millions d’albums avant son 33e anniversaire. Gauthier décida donc de voler le coffre-fort planqué dans le garage de Tommy Lee, celui où la rock star rangeait ses armes et Anderson ses bijoux. On verrait s’ils riraient toujours. Il ne se doutait pas une seconde que le coffre renfermait une cassette faite maison qui promettait de le rendre riche, mais qui foutrait sa vie en l’air. Plutôt que de faire descendre Lee de son piédestal, Gauthier allait contribuer à faire de lui une légende, révélant au monde entier qu’il était l’un des plus ardents étalons de l’histoire du rock ‘n’ roll. « J’en ai fait une star, voilà ce que j’ai fait », résume Gauthier, aujourd’hui âgé de 57 ans. L’homme est toujours électricien et cultive de la marijuana dans le garage de sa maison de Santa Rosa, en Californie. Lee ne voit pas les choses sous cet angle. Il y a deux ans, Gauthier a reçu un message Facebook de la part d’une page portant le nom de Tommy Lee. Un message court : « Pauvre merde. » La sex tape de Pam et Tommy Lee est l’une des reliques les plus célèbres de la planète, pour qui s’intéresse à la jet-set et aux paillettes. Lorsqu’elle fut rendue publique, ce n’était pas la première fois que circulait une bande vidéo donnant à voir les ébats de célébrités – et ce ne serait pas la dernière. Mais c’était du porno qui intéressait aussi ceux qui n’avaient aucun goût pour le genre, une plongée en apnée dans l’intimité de deux têtes de gondole des tabloïds américains : Anderson, l’éternelle Playmate et star d’Alerte à Malibu, et Lee, le batteur fêtard de Mötley Crüe.
Au printemps 1996, lorsqu’on découvrit le contenu de la bande, tout le monde voulait la voir, soit pour se rincer l’œil et découvrir les mœurs de deux starlettes débauchées, soit pour se moquer de deux narcisses sans cervelle accros au sexe, qui avaient dû orchestrer la fuite eux-mêmes, en mal de sensations fortes. Le couple était déjà connu pour ses mœurs charnelles et pharmacologiques hors du commun. Mais l’idée de les voir ensemble au lit allait permettre au monde de franchir un nouveau cap dans le domaine du voyeurisme, au-delà des dérapages classiques, des posters centraux de Playboy et des photos volées par des paparazzi convaincus que les stars n’avaient plus aucun secret pour eux. Et pourtant, la vidéo – il n’y a aucun doute là-dessus –, avait été obtenue illégalement, volée dans la maison de Lee et Anderson. Lorsque le couple se filmait, au cours du printemps et de l’été 1995, il ne se doutait absolument pas qu’un jour, quelqu’un d’autre aurait accès à la bande. Nous étions loin de la tentative graveleuse de faire un coup publicitaire, à une époque où télé-réalité et réseaux sociaux n’existaient pas encore. Jamais vous ne verrez une célébrité sourire aussi simplement et avec un total désintérêt que Tommy Lee après qu’il a atteint l’orgasme avec sa femme.
Avant Kim Kardashian, avant TMZ, avant RedTube, avant le Fappening, il y a eu Pam et Tommy.
On est loin du gonzo : la vidéo dure 54 minutes, dont 8 seulement sont consacrées à l’acte sexuel, consommé entre deux personnes mariées et amoureuses. « C’est la meilleure vidéo que j’ai vue de ma vie », déclarait Howard Stern en 1997. « Ce qui est cool avec cette bande, c’est qu’on est avec eux, on vit leur vie avec eux. » Mais ce que cette sex tape nous a appris, c’est qu’un individu mal intentionné peut se procurer une vidéo privée, la diffuser sur Internet, et voir le contenu lui échapper totalement et rebondir d’un pays à l’autre. Le voyage de ces images, d’un coffre fermé aux écrans de millions d’internautes – et sur les étagères de magasins de vidéo peu scrupuleux – était annonciateur des bouleversements technologiques et culturels qui allaient suivre. Avant Kim Kardashian, avant TMZ, avant RedTube, avant le Fappening, il y a eu Pam et Tommy. Après être passée de mains en mains sous le manteau pendant deux ans, la vidéo est devenue virale. La vente des copies a alors rapporté 77 millions de dollars en moins d’un an – et ce n’est qu’une estimation. Comment la personne qui a dérobé la cassette en parvenant à filer entre les doigts de la police, des avocats, des médias et des gangs de motards a-t-elle pu ne pas gagner un centime dans l’affaire ? Voici l’histoire d’un homme qui a tout misé sur une vidéo, certain d’y trouver sa rédemption. Au lieu de cela, il a assisté à l’effondrement de sa vie et vu son avarice détruire presque tous les moments de bonheur qu’il était parvenu à construire au cours de sa vie d’adulte.
Le braquage
Gauthier raconte qu’il passa l’intégralité de l’été 1995 à préparer le braquage, se rendant plusieurs nuits par semaine au domicile de Tommy Lee pour surveiller la propriété, posté dehors jusqu’à trois ou quatre heures du matin. Manigançant. Réfléchissant. « J’ai pris mon temps », se souvient-il. « J’ai cerné l’endroit. » Son plan était simple : balancer un tapis en poils de yak tibétain sur son dos et ramper jusqu’au garage au milieu de la nuit. Les caméras de sécurité, que Gauthier avait installées lui-même, le prendraient pour le chien que le couple possédait à l’époque. Lee et Anderson vivaient dans une maison de trois étages, au style espagnol, avec un garage que le batteur avait transformé en studio d’enregistrement, situé au rez-de-chaussée.

Pam et Tommy
Des camions, des voitures et des vans étaient souvent garés à l’extérieur de la maison, si bien que personne ne se douta de rien lorsque Gauthier y laissa son véhicule au milieu de la nuit. La propriété était adjacente à un espace public, et les paparazzis avaient pour habitude de s’y planquer – il n’était pas rare de voir un micro télescopique tenu à bout de bras par un reporter courageux planer au-dessus du jardin. Un jour, Tommy Lee fut arrêté pour avoir pointé son fusil à canon scié vers l’objectif d’un appareil photo qui avait surpris le couple en train de s’embrasser. Leurs photos se vendaient cher, tant le public était fasciné par ce couple sulfureux, qui s’était marié au Mexique en février de la même année après quatre jours de cour intensive de la part du batteur – quatre jours qu’il passa totalement défoncé à l’ecstasy. Le précédent mariage de Tommy Lee s’était terminé peu de temps auparavant, après qu’Heather Locklear l’eut accusé de violences conjugales, d’infidélité et d’abus de drogue et d’alcool. Anderson, avec ses robes en cuir et son bonnet D dopé à la silicone, semblait mieux correspondre au style du musicien – on parle tout de même d’un homme qui montrait son cul au public à chaque concert de Mötley Crüe. En avril 1995, des Polaroïds volés montrant le couple au lit étaient parus dans les éditions hollandaise et française de Penthouse, et du magazine américain Screw. Anderson, d’abord agacée, décida d’en rire lorsqu’elle déclara à Movieline, plus tard dans l’année : « Quand j’ai vu le premier Polaroïd, je me suis dit : “Wahou, on devrait l’encadrer, bébé…” Finalement, on s’en fout, non ? »
~
Au cours de la rénovation de leur maison, qui prit plusieurs années, les deux tourtereaux sollicitèrent plusieurs entreprises de maçonnerie et divers architectes qu’ils trouvèrent tous indignes de leur confiance. Ils s’apprêtaient alors à dépenser une gigantesque somme d’argent en vue de la construction de ce qui allait devenir un véritable paradis hédoniste, avec miroirs en forme de cœur, portes en fer forgé, chambre remplie de coussins, bassin de poissons, fresque murale représentant le Ciel et l’Enfer de plus de cinq mètres dans la cage de l’ascenseur, et balançoire de dix mètres suspendue au-dessus d’un piano blanc. « En réalité, c’était une salle de jeu pour adultes », écrit Tommy Lee dans son autobiographie, Tommyland.

Un couple déjanté
« Ils se faisaient livrer des morceaux de marbre épais de dix centimètres directement de France ou d’Italie », explique Guerin Swing, un architecte d’intérieur qui fit beaucoup la fête avec les Lee cette année-là, et participa aux travaux extravagants exigés par le couple (il apparaît dans la vidéo, courant dans le couloir d’un hôtel, un seau sur la tête). « Ils balançaient tellement d’argent qu’on avait l’impression qu’ils détestaient ça. » Pendant ce temps-là, Gauthier patientait. Au début du mois d’octobre, pour le 33e anniversaire de son époux, Anderson organisa une fête placée sous le thème du cirque dans un ranch en aval de leur propriété, avec des tigres, des avaleurs de sabre, un groupe de death metal suédois et 5 000 dollars de drogues. Cinq jours avant Halloween, Gauthier se décida à passer à l’action. La manière dont se déroula le cambriolage reste floue, car Gauthier tient à se présenter comme un casse-cou intrépide, omettant certains détails qui laissent penser qu’il a pu avoir recours à des complices. S’il admet qu’une personne de son entourage était au courant de son plan, il insiste sur le fait qu’il a commis le vol tout seul. Selon ses dires, tout commença à 3 heures du matin, alors que les Lee dormaient paisiblement à l’étage. Il escalada le portail et jeta son déguisement de chien sur son dos, traînant un diable derrière lui. Une fois les caméras de surveillance neutralisées, Gauthier prétend même être monté à l’étage et entré dans la chambre du couple.
Puis, une fois dans le garage, il dit avoir patiemment déplacé tout le matériel d’enregistrement de Tommy Lee dissimulant le mur de moquette qui cachait le coffre, dont ce que Lee décrivait lui-même comme « une énorme console d’enregistrement Neve qui pesait des centaines de kilos, ainsi que du matos de concert, de deux mètres de haut, pas facilement manipulable… et lourd ». Puis, il bascula le coffre Browning de 2 m par 1,30 m par 1 m sur son diable, le fixa avec des lanières, remit tout en place et transporta le tout dans l’allée principale, en direction de la rue. À la surprise de Gauthier, le métal présent dans le coffre déclencha l’ouverture du portail, le bruit des portes qui s’ouvraient rompant le silence de la nuit. « J’ai failli chier dans mon froc », dit-il. Une fois sorti de la propriété, pour charger le coffre dans son camion, il prétend avoir « posé le coffre et le diable contre le hayon, rampé au sol pour glisser mes jambes en dessous et poussé le tout à l’intérieur – plus de 250 kilos que j’ai soulevés à la force de mes jambes. Ça a été dur. » Des amis de Gauthier déclarent qu’en 1995, l’électricien présentait une toute autre version de l’histoire. Lee, dans son livre, estime que celui qui a fait le coup « a probablement utilisé une grue pour arracher le coffre du mur ». Une source pense que Troy Tompkins, le chef d’entreprise qui s’était retrouvé avec le flingue de Lee pointé sur le crâne le jour où Gauthier avait voulu récupérer ses outils, aida ce dernier à planifier son coup et l’attendait dans le camion ce soir-là. La femme de Tompkins à l’époque, une Française du nom de Dominique Sardell, avait aussi travaillé dans l’appartement d’Anderson, et fut virée en même temps que son mari et que Gauthier. Quelques mois plus tard, quand les Lee se rendirent compte que leur coffre avait disparu, Tompkins et Sardell furent les premiers suspects du couple – Tompkins fantasmait sur les flingues de Lee, et Sardell avait conseillé à Anderson de garder ses bijoux dans un coffre (ni Tompkins ni Sardell n’ont souhaité répondre à mes questions).
Ce qu’il se passa une fois le coffre-fort extrait de la maison des Lee est bien plus clair. Gauthier le mit en lieu sûr et, armé d’une scie sauteuse, découpa le dos du Browning avec une lame en diamant. Bien qu’il dément avoir trouvé un AK-47, un fusil d’assaut FNC, des fusils de calibre .45 et .70 et un pompe de marque Mossberg en acier – autant d’armes qui figurent dans le rapport de police –, il avoue y avoir découvert tout le reste des objets que Pam et Tommy ont déclaré volé, à savoir des photos de famille, une Rolex, une montre Cartier en or et en diamant, des menottes en or et en émeraude, une croix en rubis et en diamant, le bikini blanc qu’Anderson portait le jour de leur mariage, ainsi qu’une cassette Hi8, le format des cassettes qu’on insérait dans les caméscopes vendus dans le commerce. La cassette en poche, il se rendit à North Hollywood dans un studio de tournage de films porno, et regarda la vidéo avec le propriétaire des lieux. « On a mis la cassette, on a vu ce que c’était, et là on s’est dit “jackpot”. On avait des $ dans les yeux », se souvient-il. « Puis on s’est dit que c’était le genre de trucs pour lesquels les gens se prennent une balle… »
Les Médicis du X
Au milieu des années 1990, le porno vivait son âge d’or. Tous les foyers américains pouvaient s’offrir un magnétoscope, et un relâchement des mœurs – et des lois – avait permis à cette industrie de peser jusqu’à cinq milliards de dollars, et de produire plusieurs centaines de films par an. Gauthier atterrit dans la San Fernando Valley à la fin des années 1980, après un rendez-vous à l’aveugle avec la star du X Erica Boyer (née Amanda Gantt), une fille du sud qui savait cuisiner les gombos frits et dont le père fut, au sommet de sa carrière, l’assistant du procureur général de l’Alabama. Ils emménagèrent ensemble au bout de six semaines, et elle parvint à convaincre une poignée de producteurs que son nouveau mec avait déjà fait du porno. Ainsi, Gauthier, qui avait eu une courte carrière de strip-teaser à la fac mais n’avait jamais fait de X, pouvait bien lui donner la réplique dans un film.
« Apprendre à jouir à la demande n’est pas simple », avoue Gauthier. « Ils te disent : “Allez, on y va maintenant. Tout le monde veut aller déjeuner.” Du coup, t’es tout de suite sous pression… » Au cours de la décennie suivante, sous le pseudonyme d’Austin Moore, Gauthier apparut dans 75 films, dont Big Boob Bikini Bash (1995), Miracle on 69th Street (1992) et Willie Wankers and the Fun Factory (1994). « J’aurais aimé avoir un plus gros matériel pour correspondre aux standards de l’industrie », dit Gauthier. « Beaucoup de filles voulaient faire de l’anal avec moi parce que je n’avais pas un sexe très large. » Une fois son mariage avec Boyer terminé, il sortit avec des actrices telles que Wendy Whoppers, dont le bonnet H avait été en partie financé par Gauthier, et Stacey Valentine, avec qui il a couché dans le parking d’un Jerry’s Famous Deli pendant qu’une douzaines de jeunes les encourageaient. « J’ai eu une vie de fou », dit-il. « Je crois en la réincarnation, et je pense que dans cette vie, c’est les vacances. La prochaine fois, j’ai plutôt intérêt à me tenir à carreaux. »
~
Gauthier passa son enfance à Toluca Lake, en face de chez Dick Van Dyke. Ses parents étaient divorcés et il n’avait aucun moyen d’avoir accès à de la pornographie. Quand il était petit garçon, sa mère devint Témoin de Jéhova, l’obligeant à l’accompagner lorsqu’elle partait faire du porte-à-porte, et lui transmettant son obsession de la religion, des cultes et des sociétés secrètes. Gauthier est le genre de personnage qui croit qu’il existe une connexion mystique entre le nombre de lettres dans l’alphabet hébreu, les os dans le crâne humain et le nombre d’années que compte le cycle magnétique du soleil (tous au nombre de 22). Sur le dos d’une de ses mains, il s’est fait tatouer le symbole des Francs-Maçons – il prétend en avoir rencontrés, et s’être vu proposer une mitraillette et un entraînement pour devenir un soldat. Même s’il taxe aujourd’hui les Témoins de Jéhovah de « débiles mentaux », Gauthier était bien plus heureux en compagnie de sa mère qu’avec son père, Dick Gautier. L’acteur avait une fâcheuse tendance à perdre son sang-froid rapidement, et il les utilisait lui et ses sœurs pour vanter ses qualités de père devant ses collègues. Une fois, alors que Gauthier était encore très jeune, son père le força à porter ses chaussons au cours d’un dîner en ville – le gamin avait oublié ses chaussures du dimanche chez sa mère.
« Je me souviens qu’il figurait sur la liste des dix hommes les mieux habillés dans les années 1970, alors il était un peu embarrassé, lui, le beau gosse, de traîner son fils comme un boulet », se souvient Gauthier. Une fois adulte, il modifia l’orthographe de son nom de famille pour échapper à l’emprise paternelle. « Je crois que mon père n’a jamais cru en moi. » Évoluer dans le porno lui donna la confiance en lui qu’il avait essayée d’acquérir pendant ses jeunes années. Il se mit tout de même à fumer de la marijuana, « pour oublier qu’il y avait tout un tas de mecs qui me mataient et que c’était un peu bizarre ». Il préférait travailler hors-champ quand c’était possible. À l’époque, le porno était un petit milieu. Gauthier fit la connaissance de Milton Ingley, un patron de studio obèse surnommé « Oncle Miltie », fumeur de pipe et radin, qui adorait la musique country et Chambord.
Les Peraino devinrent les Medicis du X en finançant et distribuant Deep Throat.
Après que Gauthier eut réparé plusieurs appareils d’enregistrement chez Ingley, ils devinrent les meilleurs amis du monde. Le réalisateur prolifique Ernest Greene (né Ira Levine), qui tournait souvent dans le studio d’Oncle Miltie, appelle encore Gauthier « le chien-chien idiot de Milton », justifiant le surnom en expliquant qu’Ingley engueulait toujours Gauthier pour le bordel qu’il foutait, simplement parce « le mec avait une cervelle de lézard ». Alors quand Gauthier apporta la vidéo de Pam et Tommy à Ingley, ce dernier, qui est mort en 2006, prit les choses en main. Tout d’abord, après en avoir fait quelques copies, ils détruisirent la cassette Hi8 originale, faisant fondre le boîtier de plastique et découpant la bande en plusieurs morceaux qu’ils dispersèrent sur un terrain vague qui jouxtait le Six Flags Magic Mountain, un parc d’attraction californien. Une fois débarrassés des preuves, l’étape suivante consista à trouver un distributeur. « Milton était le roi du business », se souvient Gauthier. « Il pouvait transformer 5 cents en 2 dollars, rien qu’avec son bagout. » L’une des premières personnes qu’Ingley approcha était l’acteur-réalisateur Ron Jeremy, un de ses proches amis depuis la fin des années 1970, quand Ingley enchaînait les cachets sous le nom de Michael Morrison. Jeremy venait de sortir un « porno-réalité », c’est-à-dire interprété par des personnes de la vraie vie. Le premier qu’il tourna avait pour vedette John Wayne Bobbitt, connu pour s’être fait rattacher le pénis après que sa femme le lui eut coupé. « J’ai une star pour toi dont tu ne vas pas revenir », lui annonça Ingley.

Louis Peraino
Mais Jeremy et son producteur se rendirent rapidement compte que la cassette qu’ils avaient entre les mains pouvait leur attirer des ennuis, et que Pamela et Tommy Lee n’avait jamais signé quoi que ce soit autorisant la diffusion de cette dernière. « On a passé notre tour », se souvient Jeremy. « Le porno était quand même très réglementé à l’époque. Si tu faisais baiser des gens face caméra, t’avais plutôt intérêt à ce qu’ils t’aient signé une autorisation. » Ingley rencontra d’autres partenaires potentiels, mais personne ne voulut prendre le risque de diffuser une telle vidéo. Selon Gauthier, un richissime étranger leur proposa un million de dollars pour une copie, mais Ingley répétait que leur trésor valait bien davantage. Enfin, il se rapprocha de Louis « Butchie » Peraino, le fils d’un capo d’une des familles mafieuses de New York, les Colombo. Quand la pornographie était illégale pratiquement partout aux États-Unis, les Peraino devinrent les Medicis du X en finançant et distribuant Deep Throat, devenu très vite un classique, en 1972. En 1995, Butchie était à la tête d’un circuit de distribution vidéo, Arrow Productions, et fréquentait tout le gratin du monde du film pour adultes. Mais même lui sentait que la fameuse cassette ne pouvait lui attirer que des ennuis. Au lieu de cela, il prêta 50 000 dollars à Ingley, une somme qui allait couvrir les coups de production et de distribution de la bande sur Internet, pensant qu’il pourrait récupérer sa mise en empochant une partie des gains. À l’époque, seulement 25 millions d’Américains et 40 millions de personnes dans le monde avaient accès à Internet. La plupart des sites étaient horribles, et le streaming n’existait pas encore. Mais le web et sa réputation d’anonymat garanti était le nouveau marché noir : l’endroit idéal pour que des consommateurs se procurent la vidéo sans se faire prendre. Gauthier et Ingley se voyaient enfin riches. « Je commençais à regarder les annonces de châteaux en Espagne », confie Gauthier.

Hell’s Angels
Ingley utilisa un quart de la somme prêtée par Peraino pour effectuer des milliers de copies de leur cassette et embaucher une personne qui mit en place plusieurs sites web : pamsex.com, pamlee.com et pamsextape.com. Les sites ne proposaient pas la vidéo. Ils présentaient simplement la marche à suivre pour la recevoir : envoyer de l’argent à la succursale new-yorkaise d’une compagnie qui manufacturait des T-shirts au Canada, qui transférait ensuite l’argent vers un compte bancaire située à Amsterdam. Le prix de vente des VHS de Pamela’s Hardcore Sex Video s’élevant à 59,95 dollars, Ingley se voyait déjà crouler sous le cash. Laissant Gauthier à la manœuvre pour gérer tout ce qui concernait l’expédition desdites vidéos – il conduisait dans Los Angeles avec un van rempli de VHS pirates – Ingley s’envola pour New York pour claquer le reste de l’argent de Peraino en bouteilles de champagne à 500 dollars, prostituées, suites au Plaza et cocaïne. Autre vassal d’Ingley, Steve Fasanella (à sa demande, son nom de famille a été modifié) travaillait pour l’obèse depuis peu lorsque le manège se mit en place. Quand il se rendit compte qu’il ne verrait jamais un dollar de tout l’argent récolté par le duo, il décida de produire ses propres copies. Rapidement, il se mit à vendre des VHS à 175 dollars, directement depuis le coffre de sa voiture (il prétend avoir vendu 500 copies, et avoir ainsi encaissé 75 000 dollars). Fasanella conseilla à Gauthier de faire pareil, de s’assurer un matelas au cas où Ingley le baisait, mais Gauthier décida de rester loyal.
À la fin du mois de décembre 1995, quand l’édition du dimanche du Daily Mail publia une rétrospective des frasques de Pamela Anderson et Tommy Lee, le journaliste en charge du dossier évoqua l’existence d’une vidéo mettant en scène les deux starlettes en train de faire l’amour sur un yacht, qui se vendait sous le manteau à Los Angeles. C’était deux mois après le braquage. Anderson et Lee ne s’étaient même pas rendus compte que leur coffre avait disparu… Au milieu du mois de janvier 1996, ils réalisèrent que leur Browning s’était envolé. Terrifiés, ils sollicitèrent la police et engagèrent la star des détectives privés d’Hollywood, Anthony Pellicano, pour qu’il tirât au clair toute cette affaire. Pellicano expliqua à l’avocat du couple qu’il avait remonté la piste jusqu’à Ingley, qui admettait posséder une copie de la vidéo mais prétendait se l’être procurée auprès de Guerin Swing, l’architecte d’intérieur. Swing et un ami à lui se détendaient dans sa garçonnière de 800 mètres carrés quand Pellicano sonna à la porte, portant un costume blanc. Il plaqua Swing au sol. « Qu’est-ce qui se passe mec ! » demanda l’architecte, effrayé. « T’es qui putain ! » « Avoue », répondit Pellicano. « On sait que c’est toi ! On sait que t’as pris la cassette ! » Après un court interrogatoire, Pellicano se rendit compte que Swing n’avait rien à voir avec le vol du coffre (Pellicano est actuellement en prison, où il purge une peine de 15 ans pour fraude et usurpation d’identité).
~
Fasanella se trouvait dans les studios d’Ingley, où il bossait avec le colocataire Ron Jeremy, un réalisateur du nom de Bobby Bouschard, lorsqu’ils entendirent cinq ou six motos débouler sur le parking et virent autant de bikers se ruer dans leur bureau. « Toi – où est cette putain de cassette ! » hurla l’un d’entre eux à Fasanella, tandis qu’un de ses camarades pointait un fusil à pompe sur ses parties intimes. Le biker avait dans les mains la VHS d’un porno que Gauthier avait tourné plusieurs années auparavant.
« Je sais qui vous cherchez, mais ce n’est pas moi », répondit Fasanella. « C’est toi ! » cracha le biker. Il montra la boite usée à Fasanella. Fasanella et Gauthier avaient des traits vaguement similaires – ils étaient tous les deux Italiens et plutôt musclés. Les bikers discutèrent entre eux pour savoir si Fasanella était la bonne personne ou pas. « Bon », conclut le mec au fusil à pompe, « tu dis à cet enculé qu’on va revenir exploser des couilles au canon scié si cette vidéo disparaît pas. » Le chef de la sécurité de Mötley Crüe était un ancien membre des Hell’s Angels, et plusieurs sources confirment que Lee lui-même les avait dirigés vers Gauthier et Ingley afin qu’ils récupèrent la cassette (Gauthier pense pour sa part que ces bikers faisaient parti des Bandidos, un gang de motards mexicains). Les bikers commencèrent à venir au studio tous les jours, parfois deux fois par jour, à la recherche de Gauthier et Ingley. Si Gauthier était présent lors d’une de leurs visites impromptues, Fasanella et lui grimpaient sur le toit du studio et sautaient sur celui du garage mitoyen de leur bureau. Fasanella habitait à deux pas : une fois la baie vitrée passée, ils étaient en sécurité. Selon Gauthier, Lee aurait même envoyé un pote à lui – acteur porno également –, Candy Vegas et un de ses amis jusque chez lui pour tenter de le convaincre de rendre la cassette. Mais vu le nombre de copies existantes, ces efforts furent vains. Avec tant de monde à ses trousses et à la recherche de la cassette volée, Gauthier commença à devenir paranoïaque et perdit peu à peu le sommeil. Il finit par squatter le canapé de Fred Piantadosi, un réalisateur de pornos qui officiait sous le nom de Fred Lincoln et gérait le cinéma pour adulte appelé le Plato’s Retreat, à San Francisco – qui appartenait aux Peraino. La fille de Piantadosi, Angelica, aujourd’hui âgée de 22 ans, se souvient d’avoir vécu avec Gauthier pendant près d’un an. « Tonton Rand » couchait dans le lit superposé rouge qui se trouvait dans sa chambre, avec une couverture du Bossu de Notre-Dame, tandis qu’elle dormait dans la chambre de son père. Elle porte toujours une large cicatrice sur sa jambe, souvenir du jour où le pot d’échappement brûlant de la Corvette ’69 de Gauthier lui embrassa le mollet alors qu’il la déposait à son cours de karaté.

La mise en garde qui ouvre la vidéo
Alors que Lee et Anderson commençaient à mesurer l’ampleur du phénomène, ils apprirent que Penthouse avait mis la main sur une copie de leurs ébats. Un avocat de la revue jura que jamais son client n’en publierait la moindre image, mais le couple commença à paniquer. Le 29 mars 1996, ils portèrent plainte au civil et réclamèrent 10 millions de dollars à quiconque possédait une copie de leur cassette, Penthouse, Gauthier, Ingley, Tompkins, Sardell et Swing inclus. Le lendemain, les vans des chaînes de TV se garèrent devant le studio d’Ingley et devant la maison des parents de Swing. Une sex tape avait été volée chez le couple le plus célèbre du monde. Tout le monde mourait d’envie d’en savoir plus.
Copyright
Anderson et Lee réclamèrent l’interdiction de Penthouse, ce qu’un juge leur refusa. Le numéro de juin sortit normalement, Pamela en couverture, avec une description détaillée du contenu de la cassette – dont quelques citations – à l’intérieur. Le magazine ne possédant pas l’autorisation de publier les images, ils illustrèrent l’article avec les Polaroïds volés, déjà publiés par la presse étrangère. En août, un autre juge de Los Angeles refusa aux Lee une injonction permanente contre Penthouse, en majeure partie parce qu’il était impossible d’interdire à un média de publier quelque chose avant que celui-ci ne l’eût fait. Plus grave encore pour le couple : compte tenu du fait qu’Anderson avait déjà posé nue plusieurs fois et qu’ils discutaient ouvertement de leur vie sexuelle au cours de nombreuses interviews, les avocats de Penthouse estimèrent que les Lee avaient abandonné de facto leur droit à la vie privée au regard du contenu de la vidéo. Et puisque Penthouse avait obtenu la vidéo d’une « source » et qu’aucun employé du magazine n’avait participé au vol de celle-ci, décrire son contenu était une pratique acceptable. De plus, étant donné que la bande montrait Pamela en train de rouler un joint alors que celle-ci avait affirmé à Star l’année précédente qu’elle ne se droguait pas, la cassette devenait une information digne d’être publiée.
En octobre 1997, la cour de Los Angeles ordonna à Ingley d’arrêter de copier et de vendre la vidéo – ce qu’Ingley ne fit pas.
Cependant, vu qu’Anderson et Lee avaient tourné la vidéo eux-mêmes, le couple en possédait toujours le copyright – un argument juridique brandi devant Ingley par tous les producteurs à qui il avait proposé une copie de la vidéo. Penthouse se garda ainsi de publier des images de la vidéo, ou même de la revendre, bien qu’ils eussent gagné le procès. En parallèle, aucune des personnes citées au procès n’admit posséder une copie de la cassette volée. Tompkins et Sardell répondirent aux accusations des Lee, qui comptait également un volet « fraude », en les attaquant à leur tour. Ils prétendirent que le couple leur devait 120 000 dollars en outils et main-d’œuvre (l’affaire fut classée en 1997). Tout au long du printemps et de l’été 1996, des injonctions à comparaître arrivèrent au bureau d’Ingley et Gauthier, sans qu’aucun d’eux ne prit la peine d’engager un avocat. Avec les représentants des Lee d’un côté, le gang de bikers de l’autre et Peraino qui se demandait quand est-ce qu’il allait voir un retour sur investissement, Ingley décida de se tirer de New York. Il se rendit aux Pays-Bas, se tapant encore plus de prostituées et de coke et montant encore plus de sites web, postant des milliers de pubs pour ses copies dans des forums pour adultes. « Le FBI, Interpol et la CIA n’arrivaient déjà pas à choper un pornographe amateur retranché dans une grande usine », s’esclaffe Ron Jeremy. « Comment auraient-ils pu mettre la main sur un margoulin qui faisait son business en changeant tous les jours de cyber-café, au beau milieu d’Amsterdam ? » Quand les sites de vente des copies ne crashaient pas, ils géraient un nombre incalculable de commandes. Mais une fois le stock de copies écoulé, et en attendant un éventuel réassort, une question germa dans l’esprit de certains internautes : si Ingley et Gauthier avaient pu voler une cassette et en vendre des copies sur le web sans aucune autorisation et sans réseau de distribution conventionnel, pourquoi quelqu’un d’autre ne pourrait-il pas le faire ?

Certains moments relèvent du film de vacances
Une vague de sites imitant ceux d’Ingley vit ainsi le jour à la fin de l’année 1996, dont naked-celebs.com, pamwatch.com et bobsnudecelebs.com. Les profits diminuèrent, et Ingley commença à prendre peur. Gauthier surveillait les chiffres pour son studio, et sa fille faisait des aller-retours entre le Texas et L.A. pour vendre ses biens. Afin de couper toutes les têtes de l’hydre qu’il avait indirectement créée, à la fin du printemps 1997, il arrêta d’envoyer des copies et annonça que les commandes en cours ne seraient honorées qu’à compter du 27 septembre 1997. Mais Peraino voulait toujours voir la couleur de son argent. Gauthier dit aujourd’hui qu’Ingley était parvenu à lui rembourser la somme initialement empruntée, mais qu’il lui devait toujours les intérêts. Ingley savait que Peraino était atteint d’un cancer, et il pensait que s’il restait terré en Europe suffisamment longtemps, Peraino mourrait et sa dette disparaîtrait par la même occasion. Quant à Peraino, il était convaincu qu’Ingley planquait du fric quelque part, mais il ignorait si Gauthier en voyait la couleur, voire si Gauthier, qui envoyait chaque jour des centaines de cassettes par la poste, avait jamais été payé. Alors une nuit, Peraino l’invita à dîner. Après une assiette de linguine et quelques huîtres, discrètement, il mit quelques cuillerées de sherry dans le Merlot de Gauthier. Puis, après le dîner, il lui ramena des cerises qui avaient mariné dans de l’Evergreen. Rapidement, Gauthier se retrouva saoul, et Peraino commença son interrogatoire.
« Où est l’argent ? » lui demanda-t-il. « Où est-ce que Milton et toi cachez mon fric ? » Heureusement pour Gauthier, Peraino le crut quand il lui annonça ne pas en avoir la moindre idée. Malheureusement pour Gauthier, Peraino décida que ce dernier allait bosser pour lui afin de rembourser une partie de la dette d’Ingley. Plus précisément, il l’aiderait à envoyer un message à d’autres personnes qui lui devaient de l’argent. Après quoi Gauthier se retrouva à collecter des dettes pour la mafia, afin de rembourser la sienne. « Contrairement à ce qu’on pourrait penser, c’est difficile de casser des genoux, alors j’ai trouvé une autre méthode », raconte Gauthier. Il se laissa pousser la barbe, enfila une casquette de baseball et des lunettes de soleil, et s’approchait de ses proies en tenant ce qui, au premier abord ressemblait à une tasse de café. Mais c’était de l’ammoniaque. Tout d’un coup, Gauthier jetait le liquide aux visages de sa victime, prenait la partie en métal d’un manche à balai, cassait la clavicule du type, s’enfuyait et, après quelques pâtés de maison, rejoignait son van Dodge sans plaque d’immatriculation et disparaissait.
~
En octobre 1997, la cour de Los Angeles ordonna à Ingley d’arrêter de copier et de vendre la vidéo – ce qu’Ingley ne fit pas. Mais il était déjà trop tard : la date du 27 septembre était passée, et Los Angeles croulait sous les copies pirates de la sex tape des Lee. Comme l’écrivit Stephanie Savage, future créatrice de Gossip Girl, dans le Journal of Film and Television de l’université de Californie du Sud, « les professionnels de la télévision se réunissaient et encourageaient, sifflaient, mataient et spéculaient ». Variety publia même une critique de la vidéo. C’est à ce moment-là qu’une copie de la vidéo tomba entre les mains de Seth Warshavsky, un prodige de 25 ans qui mourait d’envie de devenir célèbre, à tel point qu’il allait faire encore monter la pression d’un cran. En plus de travailler sur les premières versions des publicités pay-per-click, du streaming et du paiement par carte de crédit en ligne, Warshavsky prétendait qu’une flotte de femmes nues pouvaient répondre aux demandes des internautes du monde entier, en direct et en vidéo, sur le site qui devint rapidement son chef-d’œuvre : Club Love.

Seth Warshavsky
Pourtant, tout le monde, dans le porno comme dans l’informatique, méprisait ce gamin, qui devait du fric à tout le monde et signait des chèques en blanc. Un de ses employés, un ancien mannequin et joueur professionnel de golf du nom de Cort St. George, traînait à l’époque dans les couloirs d’un grand studio de télévision californien. Un jour, il se mit à regarder une des copies qui avait trouvé son chemin à Hollywood. Il l’amena à son boss à Seattle. Warshavsky lui donna quelques milliers de dollars et, le 3 novembre 1997, annonça par voie de presse qu’il allait diffuser la vidéo en ligne. Cependant, comme le confirmèrent plusieurs de ses employés, Warshavsky pensait qu’il n’aurait pas à montrer la vidéo. Il désirait juste se faire de la pub, ce qui allait forcément arriver une fois les avocats des Lee au courant de ses plans. Mais le 6 novembre, un juge refusa d’émettre une injonction contre lui, et le lendemain, Warshansky mit en ligne la vidéo sur Club Love, mettant en place une boucle de cinq heures. « On était à l’arrière d’une voiture », se souvient St. George, « et Tommy était sur haut-parleur. Il hurlait : “Seth, je vais venir botter ton sale petit cul !” » Les Lee n’en pouvaient plus. Tout le monde à Los Angeles, semblait-il, avait déjà vu la vidéo, et l’interminable suite de procès et de dépôts de plaintes, en plus de devenir stressante, n’avait aucun effet sur la distribution ou la production des copies. Aussi, ils décidèrent de s’entendre avec Warshavsky.
Mauvais karma
Lee et Anderson pensaient qu’ils pourraient autoriser le jeune prodige à diffuser leur vidéo en ligne tout en interdisant sa vente dans les vidéo-clubs. Ils avaient clairement sous-estimé la puissance de l’Internet. Derek Newman, qui venait d’obtenir son diplôme d’avocat à la Pepperdine Law School, représentait Warshavsky. Il rédigea la demande d’autorisation de diffusion la plus large possible, espérant que le couple renoncerait à son copyright sur la vidéo. « Tout en négociant, je me disais : “Ils ne signeront jamais ça.” », se souvient Newman. Et pourtant, le 25 novembre 1997, ils signèrent.

Les signatures officielles de Pam et Tommy
En quelques jours, tous ceux qui avaient souscrit à un abonnement à Club Love obtinrent un accès illimité à la vidéo. « Nos serveurs n’ont pas tenu le coup. C’était de la folie. On a vendu des milliers d’abonnements par jour, tous les jours, pendant des mois », se souvient Jonathan Silverstein, qui travaillait comme directeur des ventes et du marketing chez Club Love à l’époque. Très vite, Warshavsky s’entendit avec Steven Hirsch, propriétaire de la société d’édition de films pour adultes Vivid Entertainment. Hirsch produirait des VHS, des DVD et des CD-ROM de la vidéo. En février 1998, tout Américain un tant soit peu excité ou curieux pouvait entrer dans un sex shop et se procurer une copie des ébats de Tommy Lee et Pamela Anderson en toute légalité. Dans les années qui suivirent, il se vendit des dizaines de milliers d’exemplaires de la vidéo.  « C’était un phénomène, et ça a permis à ma compagnie de franchir un cap », admet Hirsch. « On faisait notre business dans notre coin, et ça nous est tombé dessus. » Warshavsky alla même jusqu’à poursuivre ceux qui violaient son copyright sur le web, les convaincant de lui acheter une licence pour avoir le droit de streamer la vidéo. En 2000, le Guinness Book des records inscrivit Pamela Anderson à son Panthéon comme « célébrité la plus téléchargée ». Des millions de sites web qui n’avaient aucun rapport avec elle incluaient son nom dans leurs meta-données afin de rediriger le trafic vers eux. À Amsterdam, Ingley devenait fou. Comment Warshavsky et Hirsch avaient pu oser se faire de l’argent sur sa vidéo ? Mais c’était déjà trop tard : il avait perdu tout contrôle. Et chaque fois que Gauthier entendait parler de la vidéo, se souvient Fasanella, il fondait en larmes. « J’étais au plus bas de l’échelle », dit Gauthier. « Et je me donnais du mal pour que ça fonctionne. » Quand Pam et Tommy virent que des copies physiques de leur cassette pouvaient être louées ou achetées dans des sex shops, ils entrèrent dans une colère noire. Ou plutôt, ils firent de leur mieux pour faire croire qu’ils étaient furieux – se plaignant d’avoir été dupés par Warshavsky, qu’ils poursuivirent devant une cour fédérale. Mais plusieurs analystes virent la signature de l’accord entre Warshavsky et le couple comme la preuve irréfutable qu’un partage des profits avait été organisé en amont du deal. Une allégation confirmée par un ancien employé de Vivid Entertainment. Ron Jeremy raconte avoir demandé à Anderson si la cassette lui avait rapporté de l’argent, ce à quoi elle répondit, « eh bien, tu le sais ». (Anderson et Lee ont publiquement nié avoir tiré le moindre profit de cette affaire, et ils ont tous les deux refusé de répondre à mes questions.)
« C’était un phénomène, et ça a permis à ma compagnie de franchir un cap », admet Hirsch. « On faisait notre business dans notre coin, et ça nous est tombé dessus. » Warshavsky alla même jusqu’à poursuivre ceux qui violaient son copyright sur le web, les convaincant de lui acheter une licence pour avoir le droit de streamer la vidéo. En 2000, le Guinness Book des records inscrivit Pamela Anderson à son Panthéon comme « célébrité la plus téléchargée ». Des millions de sites web qui n’avaient aucun rapport avec elle incluaient son nom dans leurs meta-données afin de rediriger le trafic vers eux. À Amsterdam, Ingley devenait fou. Comment Warshavsky et Hirsch avaient pu oser se faire de l’argent sur sa vidéo ? Mais c’était déjà trop tard : il avait perdu tout contrôle. Et chaque fois que Gauthier entendait parler de la vidéo, se souvient Fasanella, il fondait en larmes. « J’étais au plus bas de l’échelle », dit Gauthier. « Et je me donnais du mal pour que ça fonctionne. » Quand Pam et Tommy virent que des copies physiques de leur cassette pouvaient être louées ou achetées dans des sex shops, ils entrèrent dans une colère noire. Ou plutôt, ils firent de leur mieux pour faire croire qu’ils étaient furieux – se plaignant d’avoir été dupés par Warshavsky, qu’ils poursuivirent devant une cour fédérale. Mais plusieurs analystes virent la signature de l’accord entre Warshavsky et le couple comme la preuve irréfutable qu’un partage des profits avait été organisé en amont du deal. Une allégation confirmée par un ancien employé de Vivid Entertainment. Ron Jeremy raconte avoir demandé à Anderson si la cassette lui avait rapporté de l’argent, ce à quoi elle répondit, « eh bien, tu le sais ». (Anderson et Lee ont publiquement nié avoir tiré le moindre profit de cette affaire, et ils ont tous les deux refusé de répondre à mes questions.)
« Il y a un mauvais karma autour de cette vidéo. » — St. George
En 2002, quand la cour fédérale se réunit enfin, Warshavsky avait déménagé à Bangkok, à la suite d’une enquête du FBI et du ministère de la justice sur ses agissements commerciaux. Personne ne vint le représenter. Un juge condamna l’ancienne société du wunderkid à payer 740 000 dollars de dommages et intérêts aux Lee – le couple ne vit jamais un centime de cette somme. Même si Anderson et Lee avait conclu un deal avec Hirsch et Warshavsky, qui pourrait leur en vouloir ? À force d’entendre les juges et les avocats leur dire que rien ne pouvait être fait, de voir des sites pulluler et utiliser les images de leurs ébats sans autorisation, prendre un peu de cash au passage semblait être la moins pire des options. Bizarrement, St. George, qui livra le premier la cassette à Warshavsky, finit par récupérer les droits web et pay-per-view des images en 2003. En 2011, il ne les renouvela pas. « Il y a un mauvais karma autour de cette vidéo », dit-il, expliquant qu’après avoir amené la cassette à Seattle, son couple commença à battre de l’aile. « Je m’inquiète à mon sujet parfois. Qu’est-ce que j’ai déclenché ce jour-là ? »
La ruine
Les états d’âme de St. George sont la preuve que ceux qui ont transformé le web en une jungle sans foi ni loi commencent à avoir du recul sur leur action. Tout le monde se moquait de la rock star ringarde et de sa bimbo blonde quand la cassette a commencé à fuiter, mais nous avons tous connu une expérience similaire au cours des deux décennies suivant l’affaire de la sex tape. Le chemin tortueux qu’a suivi cette cassette, du coffre-fort de ses propriétaires à la place publique, est le produit malheureux d’une période au carrefour de deux ères, soit avant et après que l’Internet ne commence à dominer le commerce et la communication. La popularité de ce nouveau média a peut-être esquissé les règles dont notre monde hyper-connecté a besoin. Si nous avons appris à nos dépens que tout ce qu’on enregistre peut finir sur les écrans d’une agence gouvernementale, le web ne ressemble plus au Far West qu’il a pu être.
« Pendant trop longtemps, le web a été vu comme différent des médias traditionnels du point de vue éthique, comme une créature possédant ses propres lois », estime l’avocat Doug Mirell, basé à Hollywood et spécialiste du Premier Amendement, qui a pour clients de nombreuses célébrités qui ont eu à se défendre dans des affaires de violation de la vie privée. Hulk Hogan est actuellement en procès contre Gawker pour une histoire de sex tape. « Les cours commencent à se rendre compte qu’Internet a le pouvoir d’envahir votre vie privée plus facilement qu’il n’y paraît. » En effet, treize États ont voté des lois anti-revenge porn, afin d’empêcher des ex rancuniers de poster en ligne des photographies ou des vidéos à caractère sexuel mettant en scène leur ancien-ne compagn-e-on. L’Europe et l’Argentine expérimentent un système permettant de retirer du web toute information portant atteinte à la réputation d’un individu, appelé « droit à l’oubli ». Et de nos jours, les pirates sont plus à même de revendre aux célébrités les photos dénudées qu’elles leur ont dérobées, plutôt que de les rendre publiques. Anderson et Lee n’ont jamais réussi à se débarrasser de cette histoire, mais ils s’en sont sortis la tête haute, réussissant même à se moquer d’eux-mêmes. L’autobiographie de Lee s’ouvre sur un dialogue entre lui et son pénis, et Anderson ne prend plus ombrage lorsqu’on évoque son hyper-sexualité : elle continue de poser nue, plus récemment pour soutenir l’association PETA, qui vient en aide aux animaux. Ils ont divorcé en 1998, se sont remariés en 2008 pour à nouveau divorcer en 2010. Étrangement, Anderson a été mariée deux fois à Rick Salomon, l’homme qui partage l’affiche de la sex tape de Paris Hilton… Si la vidéo a fait de Tommy Lee une sorte de dieu dans le monde du rock ‘n’ roll, et un corsaire bien monté aux yeux du public, Anderson a été prise pour cible. Aucun blog ou site parlant de sexe ou de chirurgie esthétique ne se prive de l’attaquer. Et tous dissèquent la question de savoir si une femme qui accepte de poser nue pour certains photographes fait par là-même de son corps un objet du domaine publique, renonçant ainsi au droit de se plaindre que des images d’elle dans des scènes encore plus compromettantes soient vendues, postées et partagées à plus vaste échelle.
~
Ingley et Gauthier ont abandonné le monde du porno une fois la débâcle de la cassette terminée. Une fois Peraino mort et enterré, en 1999, Ingley est revenu en Californie, ruiné et humilié. Il a emménagé avec sa fille, chez qui il est resté jusqu’à sa mort.

Pamela Anderson dans la série qui l’a rendue célèbre
« J’adore Milton, mais il nous a tous arnaqués », dit aujourd’hui Gauthier. Fatigué d’entendre ses amis de l’industrie du X lui demander où il cachait la fortune accumulée à l’époque où il envoyait des centaines de vidéos par la poste par jour, Gauthier a pris du recul et s’est recentré sur son métier d’électricien. Il y a sept ans, il a déménagé sur la côté, où il vit encore, seul. Il a grossi. Quand je suis allé le voir au cours de l’été 2014, il venait de se faire larguer par une femme avec qui il sortait depuis deux ans, une ancienne stip-teaseuse qui refusait de l’embrasser pendant qu’ils faisaient l’amour. Une fois de temps en temps, il raconte qu’il est celui qui a volé la cassette de Pamela Anderson et Tommy Lee. Personne ne le croit. Mais il aime l’idée d’avoir participé à cette folle histoire, et il apprécie toujours de regarder la cassette. « C’est mignon. Ils sont amoureux, c’est un couple qui s’amuse, je trouve ça génial », dit-il. « Je les envie. J’aimerais bien avoir quelque chose comme ça, moi aussi. »
Traduit de l’anglais par Benoit Marchisio d’après l’article « Pam and Tommy: The Untold Story of the World’s Most Infamous Sex Tape », paru dans Rolling Stone. Couverture : Pam et Tommy. Création graphique par Ulyces.
L’article L’histoire secrète de la sextape de Pamela Anderson et Tommy Lee est apparu en premier sur Ulyces.
18.01.2022 à 02:42
Les hommes doivent-ils arrêter d’éjaculer ?
Ulyces
Petite mise en situation : en plein coït avec le/la partenaire de vos rêves, alors que l’excitation sexuelle et le plaisir atteignent leur paroxysme, l’orgasme pointe le bout de son nez. Mais alors que l’orgasme est généralement considéré comme un des objectifs du rapport sexuel, vous décidez de vous arrêtez là, un scénario qui pourrait […]
L’article Les hommes doivent-ils arrêter d’éjaculer ? est apparu en premier sur Ulyces.
Texte intégral (1648 mots)
Petite mise en situation : en plein coït avec le/la partenaire de vos rêves, alors que l’excitation sexuelle et le plaisir atteignent leur paroxysme, l’orgasme pointe le bout de son nez. Mais alors que l’orgasme est généralement considéré comme un des objectifs du rapport sexuel, vous décidez de vous arrêtez là, un scénario qui pourrait être vécu comme frustrant pour une grande partie des hommes.
C’est pourtant le quotidien d’une certaine frange de la population masculine qui pratique ce qu’ils nomment généralement la « rétention de sperme ». Un choix délibéré qui consiste à retenir l’éjaculation à l’issue de la masturbation ou du rapport sexuel. Récemment, de plus en plus de personnalités dont les rappeurs Joey Bada$$ ou Kodak Black prônent cette pratique dont ils vantent les bienfaits sur le corps et l’esprit, parmi lesquels une baisse de l’anxiété, de meilleurs rapports sexuels et un meilleur contrôle sur eux-mêmes. Un mouvement qui se démocratise également sur les réseaux comme Reddit avec une communauté grandissante d’internautes qui croient en ses mérites et partagent leurs techniques pour interrompre la jouissance et vivre sans orgasme. La montée en popularité du challenge NNN, ou No nut november (« novembre sans éjac »), est également un des nombreux exemples qui traduisent la volonté de certains hommes de reprendre une forme de contrôle sur leurs pulsions sexuelles.
Cette pratique est pourtant loin d’être nouvelle, on en trouve des traces dans des écrits spirituels datant de l’antiquité et durant toute l’histoire de l’humanité. Mais est-elle vraiment fondée médicalement ? Pour mieux vivre leur sexualité, les hommes devraient-ils donc arrêter d’éjaculer ?

Kevin Gates
Crédits : Atlantic Records
No nut november
Ces dernières années, de plus en plus de rappeurs américains se vantent de pratiquer la rétention de sperme, se positionnant parfois en évangélistes de la pratique. Parmi ceux-là, le rappeur de La Nouvelle-Orléans Kevin Gates. En octobre dernier, lors d’une interview dans le podcast Million Dollaz Worth of Game, le rappeur a détaillé son parcours de santé et de fitness comprenant yoga et méditation. Le natif de Louisiane avait alors encouragé les hommes à adopter la rétention de sperme durant l’acte sexuel. « Il y a un autre truc excellent pour votre corps et qui va vous sembler fou, c’est la rétention de sperme », avait-il déclaré. « Votre intention doit être de faire plaisir à votre partenaire. Ne libérez pas de sperme. »
Des propos qui avaient entraînés de nombreuses personnalités du milieu du rap à s’exprimer également sur leur pratique, notamment Kodak Black, qui avait annoncé sur Twitter sa participation au challenge du No nut november, qui consiste à bannir toute éjaculation durant le mois de novembre, sans pour autant s’interdire la stimulation. De son côté, Joey Bada$$ s’est confié en janvier sur les points positifs ressentis depuis qu’il a arrêté l’éjaculation.
« Je préfère préserver ma force vitale », a-t-il déclaré fièrement, avant de préciser : « Je fais ça depuis deux ans. Je ne m’arrête pas, je me retiens. Le truc, c’est qu’une fois que tu n’as pas relâché cette grosse éjaculation, tu jouis plusieurs fois. Tu as des orgasmes multiples et des trucs comme ça. Je peux tenir toute la nuit. »
Une promesse alléchante qui n’a pas manqué de trouver des adeptes sur Internet, notamment sur Reddit, où une communauté se développe au sein du sub r/semenretention où des hommes du monde entier se retrouvent pour discuter autour de la pratique et de ses supposés mérites. « Vers la fin de l’été dernier, j’étais très déprimé. J’avais perdu tout sens de l’autodiscipline et du respect de soi. C’est à ce moment-là que j’ai découvert la rétention de sperme », raconte un redditeur anonyme de 22 ans qui décrit avoir « mûri davantage au cours des six derniers mois qu’au cours des six dernières années » depuis qu’il n’éjacule plus. « Voici les plus grands changements que j’ai pu constater : mes sentiments d’anxiété et de dépression ont disparu ; mon niveau d’énergie général a atteint des sommets ; je suis nettement plus calme dans les conflits ou lorsque je reçois des critiques », conclut-il.

Parmi les techniques utilisées pour empêcher l’éjaculation, on retrouve souvent évoquée la pratique du « squeezing », qui consiste à pincer le gland au moment où l’éjaculation est sur le point d’arriver jusqu’à ce que l’envie passe avant de reprendre le rapport pour le faire durer aussi longtemps que possible. Une technique « de bourrin » pour le Dr Marc Galiano, chirurgien urologue et andrologue à Paris.
« Une fois qu’on a pincé le gland on va descendre l’excitation par la douleur, c’est juste ça. Les conséquences sont toujours les mêmes : c’est la prostatodynie, c’est des algies périnéales chroniques. Il peut avoir des crampes des crémasters (les muscles des testicules), il peut avoir mal au bas ventre et au périnée. » Le médecin n’est d’ailleurs pas de ceux qui pensent que cette pratique a réellement les vertus qu’on lui prête.
Fous du contrôle
Pour le Dr Galiano, également auteur de Tout savoir sur le sexe des hommes, l’idée-même de la rétention de sperme part d’un constat erroné. « De tout temps, l’homme a voulu contrôler. Pour le taoïsme et le tantrisme, le liquide séminal c’est de l’énergie positive, donc il faut la garder pour pouvoir la magnifier », explique-t-il. « Physiologiquement, c’est de la flûte. On fabrique en permanence des spermatozoïdes et donc ils sont autodétruits, notamment par les pollutions nocturnes. À un moment donné, il faut que ça sorte. »
Selon lui, les bienfaits de la rétention de sperme décrits par les enthousiastes de la pratique auraient plutôt des allures de placebo. « On est complètement dans l’imaginaire. Pour eux, si l’on maîtrise sa puissance sexuelle, on maîtrise sa création. Donc avec des gourous ou quelques rappeurs, bien sûr vous pouvez enrôler des mecs un peu simples d’esprits. Forcément vous aurez des mecs qui vont vous dire : c’est génial, je suis dans le contrôle, je me sens vachement mieux. »
 Et tous ne sont pas dupes. « Cela fait plus de 40 jours que je me retiens », écrit un membre du sub r/semenretention. « Ma capacité à gérer le stress a considérablement diminué et j’ai du mal à dormir. L’anxiété est plus élevée que la normale. Je n’ai que peu ou pas de désir sexuel et ma confiance en moi est inchangée. Je suis souvent de mauvaise humeur et je ressens une tension constante dans ma tête. » Un témoignage qui n’étonne pas Marc Galiano : « Chacun a un rythme et des besoins qui lui sont propres, mais s’empêcher toute éjaculation c’est le meilleur chemin vers la frustration. »
Et tous ne sont pas dupes. « Cela fait plus de 40 jours que je me retiens », écrit un membre du sub r/semenretention. « Ma capacité à gérer le stress a considérablement diminué et j’ai du mal à dormir. L’anxiété est plus élevée que la normale. Je n’ai que peu ou pas de désir sexuel et ma confiance en moi est inchangée. Je suis souvent de mauvaise humeur et je ressens une tension constante dans ma tête. » Un témoignage qui n’étonne pas Marc Galiano : « Chacun a un rythme et des besoins qui lui sont propres, mais s’empêcher toute éjaculation c’est le meilleur chemin vers la frustration. »
Le fait de ne pas éjaculer fait pourtant depuis longtemps l’objet de discussions dans le monde des sportifs, dont certains comme Mohammed Ali ou Mike Tyson qui déclaraient pratiquer l’abstinence avant leurs combats sur une période pouvant aller jusqu’à deux mois. Une idée qui ne serait pas complètement dépourvue de sens, bien que largement exagérée selon le Dr Galiano.
« Oui, éjaculer juste avant une compétition sportive, ça coupe les pattes évidemment. Mais ça dure quelques heures. Vous pouvez avoir un rapport sexuel la veille ou l’avant veille sans problème », estime le spécialiste. Pour les intéressés qui voudraient malgré tout tenter de contrôler leur éjaculation, « ce qui marche le mieux, c’est ce que prône le tantrisme : c’est la respiration. C’est de caler ses mouvements respiratoires à ses mouvements du bassin et de jouer avec l’excitation, il faut s’entraîner. »
Les origines de la rétention de sperme étant donc plutôt du domaine philosophique et spirituel, libre à chacun de s’y adonner en son âme et conscience. En soit, la volonté d’apprendre à mieux connaître son corps et de reprendre un certain contrôle sur son éjaculation est d’ailleurs saine si l’on ne tombe pas dans l’excès.
L’article Les hommes doivent-ils arrêter d’éjaculer ? est apparu en premier sur Ulyces.
01.12.2021 à 01:18
Qui fera la loi sur Mars ?
Ulyces
Le 18 février 2021, à 21 h 59 heure française, le rover Perseverance se posait sur la surface de la planète rouge après plus de sept mois de voyage dans l’espace. Dans la salle de contrôle du Jet Propulsion Laboratory de la NASA, à Pasadena en Californie, les équipes de l’agence spatiale américaine ont explosé […]
L’article Qui fera la loi sur Mars ? est apparu en premier sur Ulyces.
Texte intégral (2453 mots)
Le 18 février 2021, à 21 h 59 heure française, le rover Perseverance se posait sur la surface de la planète rouge après plus de sept mois de voyage dans l’espace. Dans la salle de contrôle du Jet Propulsion Laboratory de la NASA, à Pasadena en Californie, les équipes de l’agence spatiale américaine ont explosé de joie. Elles venaient de réaliser un nouvel exploit : c’est seulement le sixième rover à réussir à se poser à la surface de Mars, en attendant la tentative du modèle chinois Tianwen-1 en avril prochain.
L’intérêt de la communauté internationale envers la planète rouge n’a jamais été aussi fort. En plus des missions américaines et chinoises, l’Europe, la Russie ou l’Inde participent activement à son exploration. Le dernier État à être entré dans la danse sont les Émirats arabes unis, dont la sonde Hope est arrivée à destination dans l’orbite martienne le 9 février dernier. Et ce n’est pas le seul coup d’éclat du pays. Une semaine avant la réussite de la mission, le Centre financier international de Dubaï a annoncé la création du premier « tribunal spatial », une institution vouée à régler les litiges commerciaux au-delà de l’atmosphère terrestre. Les Émirats arabes unis se positionnent ainsi en tant que future puissance active dans l’exploration du système solaire.

Les EAU s’imaginent déjà bâtir une ville sur Mars
Actuellement, les règles à suivre restent fixées par les traités internationaux comme le Traité de l’espace de 1967, mais il pourrait être éclipsé d’ici peu par les accords Artémis, proposés l’année dernière par les Américains, qui ouvrent grand la porte de l’exploration spatiale a secteur privé. Ils prévoient que chaque État est responsable des activités nationales dans l’espace, qu’elles soient menées par le gouvernement ou par une entreprise. Et chaque mission répond aux lois du pays d’où elle provient. Un astronaute qui se rendrait hors-la-loi dans l’espace serait donc jugé par la justice de son pays.
Cela paraît simple. Pourtant, l’idée de suivre les lois terrestres une fois sur le sol martien ne va pas de soi pour tout le monde, et notamment pour Elon Musk. SpaceX, qui ambitionne d’envoyer la première mission habitée vers la planète rouge dès 2026, compte à terme établir ses propres lois, que ce soit à bord de ses vaisseaux ou une fois sur place. Et qui pourrait l’en empêcher ?
United States of Mars
Cachée au milieu des conditions de service de l’internet par satellite Starlink, la déclaration est sans équivoque. « Pour les services fournis sur Mars, ou en transit vers Mars via un vaisseau Starship ou tout autre vaisseau de colonisation, les parties reconnaissent que Mars est une planète libre et qu’aucun gouvernement basé sur Terre n’a d’autorité ou de souveraineté sur les activités martiennes », indique la section sur le droit applicable. « En conséquence, les différends seront réglés par des principes d’autonomie, établis de bonne foi, au moment du règlement martien. » SpaceX compte donc bel et bien gérer les choses à sa façon sur Mars.
Après tout, pourquoi pas ? Une fois à 56 millions de kilomètres de la Terre, lors du passage le plus proche de la planète rouge, il semble compliqué de garder une surveillance étroite sur les activités martiennes. « S’ils ne respectent pas les règles, personne n’ira les chercher », reconnaît le Pr Armel Kerrest, vice-directeur du Centre européen de droit spatial de l’ESA et membre de la délégation française aux Nations Unies concernant les questions spatiales. En effet, un aller vers Mars nécessite actuellement sept mois de voyage minimum, avec une fenêtre de tir de quelques semaines une fois tous les deux ans. Cela dit, les autorités terrestres disposeront de leviers importants, au moins dans un premier temps.

Crédits : SpaceX
Car décider de ses propres lois impliquerait une indépendance de la part de la colonie martienne, et l’autarcie n’est pas une mince affaire sur une autre planète à l’environnement hostile. De très nombreux ravitaillements seront nécessaires pour apporter les ressources manquantes aux premiers colons. « Il ne faut pas oublier qu’ils conserveront un cordon ombilical extrêmement fort, et ce pour des dizaines d’années, peut-être même des centaines », souligne le Pr Kerrest.
Même Elon Musk, dont les estimations sont sûrement les plus optimistes, estime qu’il faudra au moins 20 ans et 1000 vaisseaux Starship pour voir la première colonie durable émerger sur la planète rouge. Cette dépendance envers la Terre pourrait donc empêcher pour un temps considérable l’indépendance martienne. En attendant de pouvoir établir sa propre justice, la colonie – dont les membres seront sans aucun doute issus de plusieurs nations – devra donc se conformer au droit prévu par les accords internationaux en vigueur, comme c’est par exemple le cas sur la Station spatiale internationale.
Mais les leaders incontestés dans ce domaine sont toujours les États-Unis. Les Américains sont à l’origine de la majorité des projets spatiaux de grande ampleur, et possèdent de ce fait la plus grande influence dans les traités internationaux. Par exemple, pour participer au programme Artémis, qui prévoit le retour de l’humanité sur la Lune en 2024, les différents pays doivent obligatoirement signer les accords Artémis. Ces derniers sont pourtant critiqués sur la question de l’appropriation des ressources extraterrestres. Et si le Traité sur l’espace interdisait aux nations de revendiquer des droits sur un autre corps planétaire, l’interprétation américaine est que les pays et les entreprises pourront désormais posséder les matériaux qu’ils extraient d’autres mondes. « Vous devriez pouvoir extraire des ressources de la Lune. Posséder les ressources, mais pas posséder la Lune », avait déclaré Jim Bridenstine, administrateur de la NASA, au moment de la signature des accords.
C’est d’ailleurs la position américaine officielle depuis 2015. Barack Obama, alors président, avait ratifié une loi affirmant le droit des citoyens américains de posséder les ressources spatiales qu’ils obtiennent. « Le droit à la propriété est inscrit dans la déclaration universelle des droits de l’Homme », explique Michelle Hanlon, co-directrice du Centre de droit aérien et spatial de la faculté de droit de l’université du Mississippi. « Je pense donc que nous emmènerons le concept de propriété avec nous dans l’espace. » Pour elle, les récents accords ne vont pas à l’encontre des anciens traités spatiaux mais dans le sens d’une discussion internationale, dont la plus importante composante reste la transparence entre les différents acteurs. « Nous devons garder les lignes de communication ouvertes entre les pays, qu’ils prennent part ou non aux accords Artémis », ajoute-t-elle.

Crédits : Mario Mimoso
Le spécialiste du droit spatial de l’ESA ne voit pas les mêmes intentions chez nos alliés outre-Atlantique. « La théorie américaine, c’est ça : la domination spatiale. » Le reste repose sur le droit international. Dans le cas de désaccords entre deux nations, c’est à la Cour internationale de justice de délivrer les sanctions. Mais la juridiction n’a pas de pouvoir contraignant sur les différents pays, explique Armel Kerrest. Et si l’un d’eux souhaite quitter les accords en place, il peut le faire à tout moment. La question de l’application de la loi dans l’espace est donc primordiale pour parvenir à une collaboration efficace entre nations.
La constitution martienne
Un moyen simple de gérer les conflits sur la surface de la planète rouge serait d’appliquer la même règle qu’à bord des navires dans les eaux internationales, où le capitaine dispose du pouvoir disciplinaire. La même solution pourrait être envisagée avec le capitaine d’expédition. Il tiendrait la place de représentant de l’ordre, en tant qu’officier d’état civil (OEC) et de police judiciaire (OPJ). De nombreux rapprochements ont souvent été faits entre les traités concernant le droit international en haute mer et celui appliqué à l’espace. Par exemple, l’article 5 du Traité de l’espace oblige les missions envoyées dans l’espace à prêter assistance aux astronautes, quelle que soit leur nationalité, à la manière du devoir d’assistance en mer. Le droit appliqué à bord du navire est celui de son pavillon, et c’est aussi le cas pour les vaisseaux.
D’autres clauses sont liées au contexte historique du traité de 1967. L’interdiction d’installer des bases militaires ou des fortifications sur la Lune, ou tout autre corps céleste, ainsi que d’envoyer des armes de destruction massive dans l’espace, est par exemple dû au climat qui régnait entre les blocs soviétique et américain pendant la guerre froide. Une fondation s’est d’ailleurs donnée pour mission de compiler l’ensemble des textes légaux concernant l’espace, dans le but de créer une bibliothèque juridique de la Cour spatiale. Cette base de données exhaustive doit permettre aux étudiants et chercheurs en droit spatial de s’appuyer sur des bases solides pour créer les systèmes juridiques du futur, d’après Christopher Hearsey, cofondateur de la Space Court Foundation.
Fondé en 2018, l’organisme propose également une série transmédia nommée Stellar Decisis, qui examine l’avenir possible de la pratique du droit et de l’administration de la justice dans l’espace. « La loi n’est pas seulement la règle de droit, c’est aussi l’environnement dans lequel vous administrez la loi », explique Christopher Hearsey, qui a par ailleurs travaillé au sein du Bureau de l’air et de l’espace du département d’État américain. « Le problème avec l’espace, c’est que l’environnement est totalement différent. » De cette constatation découle la nécessité d’adopter des lois adaptées au mode de vie d’une colonie extraterrestre, comme sur Mars. Dans la perspective où Elon Musk réussirait son pari de fonder une ville martienne autonome, cela impliquerait une gouvernance locale de la justice.

Crédits : SpaceX
Car à mesure que sa population grandira, ses besoins dans l’application de la justice augmenteront avec elle. « S’il y a beaucoup d’habitants, et je parle de cent, peut-être mille personnes, vous aurez finalement besoin de systèmes judiciaires locaux », détaille Christopher Hearsey. Il deviendra alors nécessaire d’organiser la justice martienne pour ne pas sombrer dans l’anarchie. Il est donc probable qu’à terme, une telle colonie verra la création d’une constitution martienne, adaptée au quotidien et aux problèmes locaux des colons martiens. C’est pour préparer cette possibilité que la Earthlight Foundation a publié une déclaration des droits et responsabilités de l’humanité dans l’univers. Celle-ci proclame un univers libre pour tout être humain, tant qu’il n’interfère pas avec les droits d’autres êtres humains ou sentients.
Cette hypothétique constitution martienne devra notamment répondre à différentes questions concernant la gestion et la propriété des ressources spatiales, la criminalité, le droit des conflits armés, les débris spatiaux, la souveraineté ou encore l’immigration. Dans cette perspective, Edward Snowden interrogeait Twitter avec humour : « Pensez-vous qu’ils vérifient les passeports à la frontière ? C’est pour un ami. »
Rester à savoir à quel point la constitution martienne serait différente de celles existant sur Terre. Pour Michelle Hanlon, du Centre de droit aérien et spatial de l’université du Mississippi, c’est l’opportunité pour l’humanité d’apprendre de ses erreurs, et de s’améliorer. Mais le risque de retomber dans nos travers reste bien présent. « La seule chose que nous ne voulons pas faire, c’est répéter le colonialisme », plaide la chercheuse. Ce qui s’apparente à un vœu pieux pour une colonie.
Couverture : Max Rymsha/Behance
L’article Qui fera la loi sur Mars ? est apparu en premier sur Ulyces.
17.11.2021 à 22:00
100 douilles sur le sol : qui voulait tuer Young Dolph ?
Servan Le Janne
Young Dolph est mort. Le rappeur de 36 ans, de son vrai nom Adolph Robert Thornton Jr., a été assassiné ce mercredi 17 novembre dans sa ville de Memphis. Il achetait des gâteaux dans une boutique quand, d’après le témoignage du propriétaire, un homme à bord d’une voiture a ouvert le feu sur le rappeur. […]
L’article 100 douilles sur le sol : qui voulait tuer Young Dolph ? est apparu en premier sur Ulyces.
Texte intégral (2370 mots)
Young Dolph est mort. Le rappeur de 36 ans, de son vrai nom Adolph Robert Thornton Jr., a été assassiné ce mercredi 17 novembre dans sa ville de Memphis. Il achetait des gâteaux dans une boutique quand, d’après le témoignage du propriétaire, un homme à bord d’une voiture a ouvert le feu sur le rappeur. Les policiers ont constaté son décès sur les lieux.
Ce n’était pas la première fois que Young Dolph était la cible de tirs. Il avait même bâti une partie de sa réputation après avoir survécu à une fusillade : en 2017, des tireurs l’avaient pris pour cible 100 fois dans la ville de Charlotte, en Caroline du Nord. Après avoir survécu à l’assaut, il avait intitulé son deuxième album Bullettproof. Ce mercredi malheureusement, Young Dolph ne se relèvera pas.
Alors qu’une enquête pour homicide va s’ouvrir, nous avions écrit cet article en 2017 pour tenter de comprendre qui en avait après le rappeur.
Sang et or
Une silhouette longiligne contourne l’enseigne du Loews Hollywood Hotel pour se diriger vers l’entrée. Depuis le parvis, ce mardi 26 septembre 2017, le rappeur américain Young Dolph voit les palmiers bordant la Highland Avenue de Los Angeles se refléter dans l’immense tour de verre qui lui fait face. À côté d’eux, l’ombre laissée par son mètre quatre-vingt dix sous le soleil de 13 heures apparaît minuscule. Mais enfin, Young Dolph est le « King of Memphis ». La veille, l’artiste du Tennessee né Adolph Thornton Jr était en concert à Austin, au Texas, aux côtés de 2 Chainz. Pour chauffer la salle, il a dégainé les morceaux de son deuxième album Bulletproof, sorti le 1er avril 2017 et classé 36e au classement Billboard. Le dauphin qu’il arborait au bout d’un pendentif s’est alors balancé sur les beats de grands producteurs comme Zaytoven, Metro Boomin ou DJ Squeeky. Et les dorures de son t-shirt Gucci blanc brillaient comme en clin d’œil à Gucci Mane, auteur d’un featuring sur le morceau « That’s How I feel ». Les deux hommes sont amis.

Young Dolph à L.A.
À Los Angeles, Young Dolph porte un t-shirt Gucci noir, un pantalon vert et un bandana rouge et jaune au moment de rentrer à l’hôtel. Dans deux jours, il doit jouer au Marke, une boîte de la ville californienne. Mais devant l’édifice, trois hommes lui coupent la route. Une rixe dont les origines restent mystérieuses éclate. Envoyé au sol, le rappeur reçoit plusieurs balles. Tandis qu’il se traîne vers la boutique Shoe Palace située juste à côté du Loews, ses agresseurs décampent en laissant derrière eux leur Cadillac Escalade dorée. Dans un état critique mais stable lorsqu’il arrive à l’hôpital, Adolph Thornton Jr s’en sortira. Son pronostic vital n’est pas engagé. Quant à ceux qui lui ont tiré de dessus, il est encore trop tôt pour savoir s’ils courent toujours. Dans les heures qui suivent les coups de feu, des témoins mettent la police de Los Angeles sur la trace de « deux hommes noirs et un Hispanique », selon l’inspecteur du Los Angeles Police Department Meghan Aguilar. Sur les trois hommes arrêtés dans les environs, deux sont rapidement relâchés. Le t-shirt blanc du dernier pourrait correspondre à cette « couleur vive » décrite par des passants. Mais c’est bien peu. La police a une autre piste. D’après des sources proches du dossier, un rappeur venant lui aussi de Memphis, Yo Gotti, avait une chambre au Loews. Or leur relation n’est que conflit depuis 2014. Lui en voulait-il suffisamment pour tirer ? En sondant le passé de Young Dolph, les enquêteurs découvrent qu’un de ses amis, Bankroll Fresh, a été tué par balles devant leur studio commun d’Atlanta, Street Execs, en mars 2016.
Ils se rappellent aussi que Tupac, 50Cent et Rick Ross se sont auparavant fait tirer dessus. L’histoire bégaye. « C’est très rare, mais quand ça arrive c’est habituellement parce que les rappeurs intègrent vraiment le monde criminel », analyse l’écrivain et journaliste américain Seth Ferranti. Une autre fusillade à laquelle Young Dolph a échappé il y a six mois peut donc peut-être aider la police à y voir plus clair.

Le LAPD devant le Loews Hotel après la fusillade
Crédits : DR
L’avertissement
Quelques heures avant son arrivée à Los Angeles, Young Dolph s’assoit sur un trône en or devant le public de l’Emo’s Austin, une salle de concert de la ville texane. Puis, levant le micro qu’il tient dans sa main gauche au niveau de sa bouche, il entonne « In Charlotte », le deuxième morceau de l’album Bulletproof, nommé ainsi d’après le nom de la ville de Caroline du Nord. « Ce type a tiré toute ses putains de balles, il n’a rien touché », éructe-t-il. Une référence non dissimulée aux tirs qui ont ciblé sa voiture six mois plus tôt, justement à Charlotte. Le vendredi 24 février, le roi de Memphis autoproclamé débarque dans un club de cette ville de 800 000 habitants, le Cameo, avec 21 Savage et Migos.
C’est le lendemain, alors qu’il s’apprête à remonter sur scène à l’occasion d’une compétition d’athlétisme, que son SUV noir reçoit une rafale d’une centaine de balles sur la North Caldwell Street où il est garé, à 18 h 39. Constatant que personne n’est blessé, le rappeur donne le concert avant de tweeter « Perdu » le lendemain. À qui s’adresse-t-il ? Tous les regards se tournent vers Yo Gotti, son rival de Memphis qui vient de sortir un titre en forme d’avertissement deux semaines plus tôt, intitulé « Don’t Beef With Me (Young Dolph Diss) ».  L’enquête écarte néanmoins son profil pour privilégier celui d’un de ses proches, Blac Youngsta, moins connu mais plus impliqué dans leur duel à distance, démarré en 2014. À cette période, Young Dolph a déjà sorti une dizaine de mixtapes dont une, l’année précédente avec Gucci Mane. C’est la seule à ne pas être signée sur le label qu’il a fondé en commençant la musique, Paper Route Empire, en 2008. Né en 1985 à Chicago, Adolph Thornton Jr. grandit à Memphis à partir de l’âge de deux ans avec deux sœurs, autant de frères et un manque : le duo parental fait défaut. « Maman étant toujours dans la rue, devine qui m’a éduqué », rappe-t-il dans le tube « Preach ». L’album Rich Crack Baby revient plus tard pudiquement sur l’addiction du couple à la drogue. À la mort de sa grand-mère, en 2008, le jeune homme décide de « raconter [s]on histoire ».
L’enquête écarte néanmoins son profil pour privilégier celui d’un de ses proches, Blac Youngsta, moins connu mais plus impliqué dans leur duel à distance, démarré en 2014. À cette période, Young Dolph a déjà sorti une dizaine de mixtapes dont une, l’année précédente avec Gucci Mane. C’est la seule à ne pas être signée sur le label qu’il a fondé en commençant la musique, Paper Route Empire, en 2008. Né en 1985 à Chicago, Adolph Thornton Jr. grandit à Memphis à partir de l’âge de deux ans avec deux sœurs, autant de frères et un manque : le duo parental fait défaut. « Maman étant toujours dans la rue, devine qui m’a éduqué », rappe-t-il dans le tube « Preach ». L’album Rich Crack Baby revient plus tard pudiquement sur l’addiction du couple à la drogue. À la mort de sa grand-mère, en 2008, le jeune homme décide de « raconter [s]on histoire ».
Ses amis et lui estiment que, contrairement à beaucoup de rappeurs, il connaît d’expérience les thèmes de prédilection du genre. « Un de mes amis qui n’arrêtait pas de me dire de faire de la musique m’a conseillé d’aller voir DJ Squezzy pour acheter des beats », raconte le rappeur. « Il m’a envoyé dans la bonne direction parce que Squezzy et moi avons fait l’histoire. » Très vite, les sollicitations qui arrivent montrent à Young Dolph qu’il a du talent. D’autant que Gucci Mane, rencontré par l’intermédiaire du producteur Drumma Boy, veut bien poser avec lui. Pour la sortie de sa mixtape High Class Street Music 4, en juillet 2014, il reçoit une invitation du journaliste de MTV Sway Calloway à participer à l’émission de radio « Sway in the Morning ». Rétif à signer avec un label, il explique avoir refusé de signer un contrat avec Yo Gotti. Les embrouilles commencent.
Un trône pour deux
Pendant près de deux ans, la déclaration de Young Dolph est restée sans réaction publique. Plus âgé et plus expérimenté, Yo Gotti peut passer pour le grand frère. Aussi goûte-t-il visiblement mal le nom de l’album que sort son cadet en février 2016 : King of Memphis. C’est par ce titre qu’il se fait appeler. « Alors que mon frère était mon fan numéro 1 et voulait me signer, c’est devenu un GROS JALOUX », commente soudain Dolph sur Twitter. Blac Youngsta s’adjuge alors le rôle de porte-flingue – sur Internet du moins, puisqu’il récuse tout lien avec les balles qui ont terminé dans la voiture de Young Dolph.

Yo Gotti
Crédits : Billboard
Dans une vidéo postée sur Instagram, la rappeur du label de Gotti interpelle son nouvel ennemi le 2 mars 2016 : « Dolph t’es une sa¤¤¤¤, t’es une petite nature, si t’as un problème, dis que tu as un problème. Tu n’es pas le roi de Memphis, tu n’est même pas d’ici, sa¤¤¤¤. » En légende, il se lâche carrément en lettres capitales : « QUAND JE VERRAI CE TYPE @YOUNGDOLPH JE JURE QUE JE VAIS LE DÉFONCER. » Gotti n’approuve pas. Il rappelle même son « frère » à la raison dix jours plus tard au cours d’une interview donnée au journaliste Tim Westwood. Ne fait-il que soigner les apparences ? Young Dolph est persuadé de sa duplicité. « Tout le monde sait que c’est toi Gotti qui envoie ton artiste dire ces conneries », écrit-il sur Instagram le 16 mars. « J’ai l’impression que tu es encore énervé parce que je n’ai pas signé chez toi. À moins que tu regrettes encore d’avoir échoué avec Gucci Mane alors que j’ai continué à envoyer du lourd avec lui. » Le lendemain, Blac Younsta sort un morceau dans lequel il lui conteste encore le titre de roi de Memphis et le renvoie à ses origines de Chicago. Vu de l’extérieur, on se perd dans ces disputes tant leurs fondements paraissent fragiles. « Les rappeurs s’embrouillent en général sur des bêtises », souffle Seth Ferranti. « Prenez le beef de NWA. Il ne s’est jamais traduit par des violences et il sont maintenant de nouveau tous amis. » Dolph, d’ailleurs, déclare n’avoir de problème avec personne. En dépit de ces tensions, Yo Gotti l’aime bien, confie Blac Youngsta après avoir laissé six mois s’écouler. Tout porte à croire que la querelle est terminée.

Blac Youngsta
Crédits : VICELAND
Mais le plus jeune des rois de Memphis n’en a pourtant pas fini. Sur la mixtape Gelato, parue début février 2017, il reprend la critique qui a mis le feu aux poudres dans le morceau « Play wit yo bitch » : « Tu es passé de fan à jaloux. » Le morceau est accompagné d’un clip de huit minutes dans lequel est reproduit le moment pendant lequel Gotti aurait proposé à Dolph de signer sur son label. Non content de refuser sèchement, ce dernier se permet de lui piquer sa copine dans la vidéo. La réplique musicale, « Don’t Beef With Me (Young Dolph Diss) » sort quelques jours plus tard. Et la voiture de Dolph est retrouvée criblée de balles le 25 février. Adolph Thornton Jr a puisé dans sa jeunesse heurtée pour percer dans le rap. Il ne faut donc pas s’étonner qu’il s’inspire de cet épisode malheureux pour écrire l’album Bulletproof, sorti en avril. Mais la dure réalité dont il se joue grâce aux mots l’a rattrapé le 26 septembre 2017, devant le Loews Hollywood Hotel. « La plupart du temps, les démêlés sont verbaux et non physiques », observe Seth Ferranti. « Les rappeurs ne sont pas des gangsters, mais j’ai l’impression que certains ont tendance à l’oublier ces derniers temps. Ils veulent faire les vrais plutôt que le show. » Young Dolph, lui, était seulement venu à Los Angeles pour donner un concert.
Couverture : Young Dolph. (Billboard/Ulyces.co)
L’article 100 douilles sur le sol : qui voulait tuer Young Dolph ? est apparu en premier sur Ulyces.
11.09.2021 à 08:15
Ce chien guide a sauvé son maître lors des attentats du 11 septembre
Malaurie Chokoualé Datou
par Malaurie Chokoualé | 8 min | 11/05/2014 1463 marches Les gens applaudissent autour de Michael. Il sent des formes le frôler, qui grimpent quatre à quatre. Il sert un peu plus fort le harnais de Roselle dans sa main. Ce sont des pompiers. Il tape sur une épaule qu’il sent passer non loin de lui,…
L’article Ce chien guide a sauvé son maître lors des attentats du 11 septembre est apparu en premier sur Ulyces.
Texte intégral (2206 mots)
1463 marches
Les gens applaudissent autour de Michael. Il sent des formes le frôler, qui grimpent quatre à quatre. Il sert un peu plus fort le harnais de Roselle dans sa main. Ce sont des pompiers. Il tape sur une épaule qu’il sent passer non loin de lui, un geste qu’il espère encourageant. Il ne sait pas où ils vont, mais ce ne peut être qu’en enfer. La file avance pas à pas, marche après marche. Michael sue à grosses gouttes sous son costume un peu trop large pour lui et ses cheveux éparses collent sur son crâne. Une insistante odeur de carburant flotte dans l’air du couloir surchauffé, brûlant les yeux des marcheurs. Alors qu’ils passent le 50e étage, un bruit effroyable les saisit tous. C’est le vol 175 d’United Airlines qui vient de percuter la tour Sud, mais ils ne l’apprendront que plus tard.
Roselle halète, cherchant elle aussi un peu d’air pour avancer. Étage après étage, sa respiration se fait plus rauque, difficile, la gorge abîmée par l’odeur du fuel et de la fumée. Son pelage jaune à l’origine, est terni par un mélange grisâtre de suie et de débris. Michael s’inquiète pour elle, creusant les rides qui barrent son front.
-

Roselle avec un autre chien
héros du 11 septembre 2001, Salty
Après 50 minutes de descente, ils atteignent enfin le hall de l’immeuble. Le sol est inondé à cause des nombreux tuyaux brisés. Roselle lape les flaques ici et là pour étancher sa soif dévorante. Il leur faut encore dix minutes pour sortir du bâtiment. « Courez, ne regardez pas en haut, ne regardez pas en arrière ! » crient des policiers à la foule qui défile devant eux. Soudain, leurs voix sont noyées par un bruit monstrueux. C’est la tour Nord qui s’effondre.
Autour de Michael, les gens hurlent et les pas battent encore plus rapidement le bitume. « À la bouche de métro ! » hurle quelqu’un. Tout le monde se met à courir. Roselle guide son maître à travers les débris, toujours devant lui dans cette course effrénée. Elle reste concentrée et balaie de son regard clair l’apocalypse qui les entoure. Ils atteignent le métro et y attendent l’accalmie. En sortant à l’air libre peu de temps après, la tour Sud a disparu du ciel de New York. La tour Nord, est toujours là, vaillante mais fumante. Une trentaine de minutes plus tard, elle part rejoindre sa jumelle, emportant dans sa chute 2 605 vies. Tout le monde est couvert de suie. Et dans ce paysage de désolation, Roselle et Michael avancent toujours ensemble.
Roselle
Lorsqu’elle ne travaille pas, Roselle est allongée de tout son long sous le bureau de Michael. En ce tranquille matin du 11 septembre 2001, sa respiration laisse échapper un léger sifflement rassurant qui atteste de sa présence. Michael a su dès leur rencontre qu’ils seraient parfaitement assortis. La première fois qu’ils se sont rencontrés le 22 mai 1999, Roselle a traversé la pièce et lui a donné un coup de langue affectueux en guise d’alliance éternelle.
« Quand elle porte son harnais, elle devient moins agitée, plus concentrée »
Roselle est née le 12 mars 1998 dans l’unité de mise à bas de l’association Guide dogs for the blind, qui élève, entraîne et donne des chiens guides d’aveugles à ceux qui en font la demande. À huit semaines, ce chiot Labrador retriever jaune est amené dans une famille d’adoption à Santa Barbara qui l’élèvera pendant plusieurs mois. Elle est ensuite renvoyée chez Guide dogs for the blinds pour y compléter sa formation de chien guide d’aveugle. En novembre 1999, Roselle rencontre Michael et devient son cinquième chien guide.
Michael Hingson a eu son premier chien guide à l’âge de 14 ans, Squire. L’Américain est né à Palmdale, en Californie, en 1950. À cette époque, il existait une procédure médicale standard pour aider les nouveau-nés prématurés à respirer. Cette pratique consistait à placer le bébé dans un incubateur scellé de manière à lui fournir de l’oxygène pur jusqu’à ce qu’il soit prêt à respirer seul. Cette pratique a entraîné une épidémie de cécité chez des enfants prématurés. Entre 1941 et 1953, aux États-Unis, plus de 10 000 bébés prématurés sont devenus aveugles, comme c’est le cas du chanteur Stevie Wonder, ou de lui-même. Michael a toujours été encouragé par ses parents à être indépendant. Ils ne l’ont jamais traité différemment de son frère aîné de deux ans, Ellery.

Après Squire, Michael a été mis en binôme avec Holland, qui l’a guidé à travers ses années d’études supérieures, conclues par un master en physique. Il était également à ses côtés durant ses premières années d’emploi. Klondike a guidé Michael pendant une grande partie de sa vie professionnelle, avant d’être remplacé par Linnie, dont la carrière s’est brusquement terminée quand elle a contracté la maladie de Lyme. Fin 1999, c’est au tour de Roselle de guider Michael.
Roselle se révèle rapidement amusante, énergique et calme à la fois, comme la plupart des chiens guides. Joueuse quand elle le peut, mais travailleuse quand elle le doit. Le harnais, pour elle, est comme un uniforme. Lorsque Michael parle de sa vieille coéquipière, il ne tarit pas d’éloge à son sujet. « Quand elle porte son harnais, son comportement change », explique-t-il. « Elle devient moins agitée, plus concentrée, elle prend toujours son travail au sérieux. Elle exige que je fasse mon travail aussi. Et elle aime faire partie d’une équipe. »
Amours chiennes
Six mois après les attentats, Michael a laissé derrière lui 27 ans de carrière dans le domaine de la vente pour devenir le directeur des relations humaines de Guide dogs for the blinds. Toujours précédé par Roselle. Toute sa famille est repartie sur la côte Ouest, tirant un trait sur six ans de vie dans le New Jersey. En juin 2008, Michael a quitté Guide dogs pour créer le Michael Hingson Group afin de se consacrer essentiellement à sa carrière de conférencier et de conseiller les entreprises en matière de formation inclusive et de diversité. Il a également créé la Roselle’s Dream Foundation qui a pour objectif « d’aider la société en général et les aveugles en particulier à comprendre que la cécité ne doit pas empêcher qui que ce soit d’accomplir ce qu’il souhaite. » En 2009, rougissant légèrement de fierté, il est devenu l’ambassadeur national pour la campagne d’alphabétisation Braille, toujours accompagné de sa fidèle Roselle et de ses successeurs.
Avoir survécu aux attentats du 11 septembre 2001 a inévitablement rapproché Roselle et Michael. « Nos vies ont été menacées et évidemment notre relation en est ressortie plus forte », explique Michael. Depuis près de 17 ans, il parcourt le monde pour raconter inlassablement son histoire. Il vole de conférence en conférence, d’allocutions en discours d’inauguration, pour parler de confiance, de persévérance, de handicap et d’esprit d’équipe.

Le matin du 11 septembre 2011, Michael s’était rendu au World Trade Center pour une journée de formation. À cette époque, il était directeur régional des ventes pour une société qui fournit des systèmes de protection des données et de stockage réseau. Quand la tour Nord a été percutée, Michael s’est astreint à ne s’affoler sous aucun prétexte. En effet, il avait un atout que n’importe quel voyant n’avait pas : Roselle. La chienne était là, à ses côtés, toujours aussi calme. Sa tranquillité présageait d’une absence de danger immédiat et Michael a choisi de suivre son jugement et de ne pas céder à la panique. « Roselle et moi, nous sommes une équipe », s’est-il dit au moment d’empoigner le harnais et de descendre les 1463 marches jusqu’à la sortie.
Selon Michael, la confiance inconditionnelle d’un chien pour un humain n’existe pas. Un chien veut de l’amour, mais n’accordera pas nécessairement sa confiance. Pour qu’elle soit forte, il faut qu’elle se développe avec le temps et que le maître arrive à imposer des règles. « Les chiens aiment les règles », affirme Michael. « Ils ont besoin de savoir qui est le patron, qui est le leader. Ils respectent quelqu’un qui les guide, avec amour et confiance. » C’est précisément ce lien profond qui a sauvé Michael. Il n’a fait que se consolider, jusqu’au décès de Roselle en 2011.
Le tonnerre
Le 24 juin 2011, Roselle est emmenée chez son vétérinaire, qui soupçonne un ulcère à l’estomac. Son état empire rapidement. Le médecin et la famille Hingson décident douloureusement de mettre fin à ses souffrances. Roselle s’éteint deux jours plus tard, en héroïne nationale. Après sa mort, elle est élue « chien héros » de l’année 2011 par American Humane Society. Les interventions de Michael à la télévision, ses conférences et surtout les deux livres qu’il a écrits en son honneur n’y sont pas étrangers.
Sorti en 2012, Thunder Dog devient rapidement un best-seller. « Je voulais que les gens comprennent que quand quelque chose d’horrible leur arrive, ils peuvent aller de l’avant. Je voulais que les gens sachent ce qu’est un chien guide, ce qu’est un aveugle ou une personne avec des déficiences visuelles », expliquait-il à l’époque. Thunder Dog est une histoire de persévérance, de compréhension de soi et de confiance en ses propres capacités. Malgré sa peur du tonnerre, Roselle a pu guider son maître à travers 78 étages d’une tour frappée par la foudre. « C’est pour cela que l’éditeur a choisi ce titre, Thunder Dog. Elle était nerveuse bien sûre, mais quand j’ai eu besoin d’elle, elle a fait exactement ce que je voulais qu’elle fasse. »

Près de sept ans après son décès, Michael garde un souvenir ému de Roselle. À ses côtés aujourd’hui, un Labrador noir au regard placide, tout aussi calme que ses prédécesseurs. C’est Alamo, son huitième chien guide, avec qui il travaille depuis plusieurs mois, apparemment avec succès. Les techniques d’entraînements de l’association Guide dogs for the Blinds ont évolué. Les chiens que Michael reçoit sont de plus en plus réactifs et il admet de bon cœur qu’Alamo est peut-être le meilleur qu’il ait jamais eu. « Mais Roselle était tout ce que j’aurais pu attendre d’un chien guide. »
Découvrez tout ce qu’il y a à savoir sur les chiens guides en cliquant ici.
L’article Ce chien guide a sauvé son maître lors des attentats du 11 septembre est apparu en premier sur Ulyces.
01.09.2021 à 09:26
Final Fantasy football : l’histoire totale de MPG racontée par ses créateurs
Servan Le Janne
par Servan Le Janne | 8 min | 17/10/2018 L’herbe folle pousse toujours là où l’attend le moins. En semant négligemment quelques graines il y a sept ans, les trois fondateurs de Mon petit gazon (abrégé MPG) étaient loin de se douter qu’ils récolteraient de tels fruits. Aujourd’hui, le jeu de « fantasy football » rythme le…
L’article Final Fantasy football : l’histoire totale de MPG racontée par ses créateurs est apparu en premier sur Ulyces.
Texte intégral (2380 mots)
L’herbe folle pousse toujours là où l’attend le moins. En semant négligemment quelques graines il y a sept ans, les trois fondateurs de Mon petit gazon (abrégé MPG) étaient loin de se douter qu’ils récolteraient de tels fruits. Aujourd’hui, le jeu de « fantasy football » rythme le week-end de centaines de milliers de fans français. Depuis la terrasse de leur bureau du IXe arrondissement de Paris et sa fausse pelouse, Martin Jaglin, Grégory Rota et Benjamin Fouquet reviennent sur leur épopée digne d’un Petit Poucet en Coupe de France.
 Au début de l’aventure, en 2011, ces trois collègues d’une agence de marketing numérique ont voulu créer un jeu de fantasy football convivial. Leur espèce de Football Manager en ligne, simplifié mais néanmoins arrimé aux performances réelles, était personnel. Ils n’avaient pas le temps d’essayer d’en faire la promotion ou de le complexifier. C’est cette simplicité, conjuguée à une bonne dose de second degré, qui ont fait son succès.
Au début de l’aventure, en 2011, ces trois collègues d’une agence de marketing numérique ont voulu créer un jeu de fantasy football convivial. Leur espèce de Football Manager en ligne, simplifié mais néanmoins arrimé aux performances réelles, était personnel. Ils n’avaient pas le temps d’essayer d’en faire la promotion ou de le complexifier. C’est cette simplicité, conjuguée à une bonne dose de second degré, qui ont fait son succès.
À ceux qui ne connaissent pas encore MPG, Martin Jaglin explique que « chaque week-end, quelqu’un défie un ami dans le jeu virtuel et le bat si ses joueurs jouent bien dans le championnat de France réel ». Le trio se référait aux notes de L’Équipe pour juger leurs performances et aux matchs de la Ligue 1. Ce qui lui a valu des menaces de poursuite. Mais quand, fort de leur succès, ils ont cessé de n’être que des amateurs, pour devenir des promoteurs du football français, Martin, Grégory et Benjamin ont été adoubés par le quotidien et les instances. La réussite est totale.
La fibre du jeu
Martin Jaglin : Au moment de lancer Mon petit gazon, en septembre 2011, je travaillais dans une société de marketing numérique qui marchait bien, 1000mercis. J’y suis arrivé en 2005, deux ans après Grégory et Benjamin. Rien ne nous poussait à chercher une autre activité. De toute manière, ce projet entre potes n’était pas voué à prendre une grande ampleur. L’univers de ce qu’on appelle le « football fantasy », alors bien plus développé en Angleterre qu’en France, ne nous était guère familier. Nous jouions ensemble à FIFA et PES quand un jour, nous avons découvert un jeu créé par des Lyonnais, Fantaleague, qui ressemblait à un Football Manager en ligne. Le côté interactif nous a séduits.

Crédits : L’Équipe
Gregory Rota : Les sites de football fantasy qui existaient ne nous emballaient pas vraiment. En fait, MPG a été conçu comme le jeu auquel nous voulions jouer, et nous avons eu la chance qu’il plaise. Nous étions loin de penser que ça deviendrait une entreprise.
Benjamin Fouquet : Il y avait non seulement une certaine alchimie, mais aussi une complémentarité entre nous trois. En jouant à Fantaleague, nous nous sommes dit que nous pourrions allier nos compétences pour l’améliorer. Fantaleague était un peu trop compliqué. Alors nous avons repris le site pour partir de zéro. Certains collègues se sont mis à jouer mais nous n’en parlions pas tellement au bureau. Ça restait une agence marketing. En revanche, le projet nous a rapprochés d’ami·e·s qui aiment le foot.
 Gregory Rota : Martin a grandi à côté de Paris et supporte donc le PSG, tandis que Benjamin est Bordelais. J’ai beau être originaire de Vesoul, dans l’est de la France, mon cœur battait pour l’Olympique de Marseille. Dans les années 1990, c’était l’équipe qui faisait rêver tant par ses résultats que par la ferveur qu’elle drainait. À cette période-là, il y a eu un premier ordinateur chez moi. J’aimais déjà les jeux vidéo donc je me suis passionné pour le web. En parallèle de mes études en informatique, je jouais à FIFA, PES et Football Manager.
Gregory Rota : Martin a grandi à côté de Paris et supporte donc le PSG, tandis que Benjamin est Bordelais. J’ai beau être originaire de Vesoul, dans l’est de la France, mon cœur battait pour l’Olympique de Marseille. Dans les années 1990, c’était l’équipe qui faisait rêver tant par ses résultats que par la ferveur qu’elle drainait. À cette période-là, il y a eu un premier ordinateur chez moi. J’aimais déjà les jeux vidéo donc je me suis passionné pour le web. En parallèle de mes études en informatique, je jouais à FIFA, PES et Football Manager.
Benjamin Fouquet : Internet m’a toujours attiré mais, comme beaucoup d’étudiants, je n’avais aucune idée du métier que je voulais exercer. J’ai fait une école de commerce pour me spécialiser, au sein de laquelle je me suis naturellement dirigé vers les nouvelles technologies. Ensuite je suis monté à Paris pour travailler dans le marketing en ligne. Je lisais L’Équipe mais je n’étais pas non plus du genre à regarder les notes de chaque joueur après les matchs.
La rançon du succès
Martin Jaglin : Au départ, les notes des joueurs de MPG étaient celles de L’Équipe. Nous avions conçu un robot pour les récupérer sur le site du quotidien sportif. Quand elles ont été retirées d’Internet, nous avons dû les rentrer une par une à partir du journal papier, le dimanche soir et le lundi matin. Dès que le jeu a commencé à se faire un peu connaître, L’Équipe nous a envoyé une lettre en recommandé, menaçant de nous attaquer en justice car nous nous servions de leur propriété intellectuelle. Alors, nous avons dû développer notre propre algorithme.
Benjamin Fouquet : Ça a été un mal pour un bien car cela nous a permis de conserver notre indépendance. Avant ça, c’était vraiment archaïque, on entrait les dernières notes à 7 heures du matin le lundi. Nous nous sommes tournés vers une société qui fournissait des statistiques, Opta, et nous les avons entrées dans un algorithme. Grâce à lui, on avait le pied à l’étrier et on pouvait appliquer la technique à d’autres championnats.
Grégory Rota : À partir de 2015, le site a commencé à être pas mal fréquenté. Nous passions du temps à répondre à des e-mails et corriger les erreurs. En octobre, j’ai pris la décision de quitter mon poste pour m’occuper à plein temps de MPG. Je ne voulais pas regretter de passer à côté de cette aventure. Le site était encore assez laid donc nous avons lancé une campagne de crowdfunding en février 2016. Alors que nous espérions récolter 16 000 euros, les internautes nous en ont donné 40 000. Ça nous a permis de concevoir une application, et d’embaucher un graphiste et un technicien pour refondre le site. On l’a cassé pour tout refaire en trois mois.
Martin Jaglin : À mon tour, j’ai quitté 1000mercis pour consacrer tout mon temps à MPG en 2016. Les réunions se passaient d’abord dans la cuisine de l’un ou de l’autre, puis dans des espaces de co-working. Cela dit, je n’aime pas trop parler de start-up pour décrire MPG. Ça laisse l’impression qu’on émet des idées simplement pour récolter des fonds. Nous avons monté notre entreprise pas à pas, ce qui nous donnait l’impression de réaliser quelque chose de cool qui grandissait petit à petit. Il a bien fallu cinq ans pour qu’on lâche nos emplois.
Benjamin Fouquet : MPG a fonctionné parce qu’il avait un côté trublion par rapport aux jeux de fantasy football classiques. Alors que la plupart proposent de se mesurer à des milliers d’inconnus, nous avons voulu créer un environnement convivial dans lequel s’affrontent des amis. Ça permet de vibrer le week-end et de se chambrer le lundi. Et puis les participants se mettent à suivre les matchs de petites équipes pour savoir si leurs joueurs font de bonnes performances. Ça redore le blason de la Ligue 1.
« La LFP a compris que MPG était une bonne chose pour son image. »
Martin Jaglin : Pourtant, la Ligue de football professionnel (LFP), qui organise le championnat de France, a elle aussi voulu nous attaquer. En avril 2016, la discussion que nous avions avec elle par avocats a fuité dans la presse, ce qui a créé une sorte de mauvais buzz pour elle. Ses dirigeants ont donc fini par nous laisser faire. Le directeur général, Didier Quillot, croyait au projet. Lorsque son président Frédéric Thiriez a été remplacé, au mois de mai, cette position a été infléchie. Finalement, la LFP a compris que MPG était une bonne chose pour son image.
Rotaldo à domicile
Grégory Rota : D’ailleurs, des vrais joueurs sont inscrits sur notre site. Je crois que le premier a été le défenseur du Stade Malherbe de Caen Emmanuel Imorou. Il y a aussi Nicolas Benezet, Valère Germain ou Umut Bozok. Nos utilisateurs ont en général entre 18 et 35 ans et viennent d’un milieu urbain. La LFP estime le nombre de fans de foot en France à 20 millions et nous pensons que trois ou quatre millions sont convertibles à MPG.

Benjamin Fouquet : À la base, MPG était surtout joué en Île-de-France. À Paris, j’ai commencé à voir des gens consulter l’application sur leur portable en 2016. C’était la preuve que ça rentrait dans les conversation et dans le quotidien. Les gens commençaient à en parler à la radio et sur Twitter. On nous a ensuite raconté un tas d’anecdotes de gens qui jouaient en famille ou qui concevaient de gros trophées. Il y a même une mère de famille qui, venant d’accoucher, jouait avec son mari pour garder le lien. Nous avons pénétré le foyer de A à Z.
Grégory Rota : L’application était initialement payante mais nous sommes revenus sur cette décision. Pour payer nos serveurs, nous avons commencé par mettre un peu de publicité. Ce sont en fait les options proposées – comme le mercato permanent ou les maillots personnalisés – qui nous ont permis de gagner de l’argent.
Martin Jaglin : En janvier 2018, nous avons levé un million d’euros auprès d’investisseurs privés comme l’ancien président du PSG Sébastien Bazin, le DJ Martin Solveig et une personne de la famille Amaury, actionnaire de L’Équipe. Nous avons depuis lancé un partenariat avec le quotidien sportif, ainsi qu’avec la LFP.
 Benjamin Fouquet : De la même manière que nos interlocuteurs ne sont plus les mêmes depuis le départ de Frédéric Thiriez à la LFP, ils ont changé à L’Équipe. Les personnes en charge du numérique au sein du média ont fait comprendre à leurs collègues que MPG ne pouvait qu’inciter les fans de football à lire les articles. Désormais, on peut choisir entre les notes décernées par leurs journalistes ou celles de l’algorithme. La deuxième option est plus objective, mais il ne faut pas oublier qu’une frappe de 30 mètres qui termine sur la barre comptera toujours, dans ce cas de figure, comme un tir non cadré. Les joueurs de MPG trouvent ainsi un plus grand intérêt à regarder les matchs. Des collaborations ponctuelles avec Red Bull, Puma et Intersport ont aussi été lancées. Les visites commencent à être régulières et nombreuses.
Benjamin Fouquet : De la même manière que nos interlocuteurs ne sont plus les mêmes depuis le départ de Frédéric Thiriez à la LFP, ils ont changé à L’Équipe. Les personnes en charge du numérique au sein du média ont fait comprendre à leurs collègues que MPG ne pouvait qu’inciter les fans de football à lire les articles. Désormais, on peut choisir entre les notes décernées par leurs journalistes ou celles de l’algorithme. La deuxième option est plus objective, mais il ne faut pas oublier qu’une frappe de 30 mètres qui termine sur la barre comptera toujours, dans ce cas de figure, comme un tir non cadré. Les joueurs de MPG trouvent ainsi un plus grand intérêt à regarder les matchs. Des collaborations ponctuelles avec Red Bull, Puma et Intersport ont aussi été lancées. Les visites commencent à être régulières et nombreuses.
Martin Jaglin : Pour le moment, les championnats français, anglais et espagnols sont sélectionnables sur MPG. Chaque année, on nous demande d’en proposer de nouveaux, ou de créer des versions équivalentes pour d’autres sports comme le rugby ou le basket. On se pose toujours la question, mais nous ne voulons pas ajouter une option pour ajouter une option.
Benjamin Fouquet : Notre objectif est pour le moment de personnaliser davantage l’expérience et de développer notre version espagnole pour trouver des joueurs de l’autre côté des Pyrénées. Environ 90 % de notre audience se trouve en France, mais on essaye d’activer des plateformes d’influence ailleurs.

Couverture : MPG by Ulyces.
L’article Final Fantasy football : l’histoire totale de MPG racontée par ses créateurs est apparu en premier sur Ulyces.
22.06.2021 à 00:30
Parviendra-t-on à créer un vaccin contre le cancer ?
Camille Hamet
par Camille Hamet | 7 min | 13/03/2018 Un vaccin contre le cancer « Un vaccin contre le cancer. » L’expression a été reprise en chœur par plusieurs médias à la publication, en janvier dernier, d’une étude menée par des chercheurs de l’université Stanford, en Californie. Elle laisse rêver au développement d’un vaccin préventif, capable d’empêcher le…
L’article Parviendra-t-on à créer un vaccin contre le cancer ? est apparu en premier sur Ulyces.
Texte intégral (2329 mots)
L’espoir est à nouveau permis. Après avoir mis au point un vaccin contre le Covid-19 avec Pfizer, la société allemande de biotechnologie BioNTech développe à présent un vaccin contre le cancer. Et selon la scientifique et cofondatrice de l’entreprise Özlem Türeci, il pourrait être au point d’ici quelques années seulement. L’invention d’un tel vaccin est précisément la raison pour laquelle BioNTech a été fondé, révélait la chercheuse le 19 mars 2021. Et à l’instar du vaccin contre le Covid-19, les vaccins contre le cancer de BioNTech utiliseront les ARN messagers. Après des décennies de recherches et d’échecs, sera-t-on bientôt débarrassés du fléau du cancer ? On aimerait que ce soit aussi simple.
Un vaccin contre le cancer
« Un vaccin contre le cancer. » L’expression a été reprise en chœur par plusieurs médias à la publication, en janvier 2018, d’une étude menée par des chercheurs de l’université Stanford, en Californie. Elle laisse rêver au développement d’un vaccin préventif, capable d’empêcher le développement de la maladie. Mais comme le rappelle l’Institut Curie, une telle approche n’est possible que si la survenue du cancer a pour origine une infection virale. Ainsi, « la systématisation de la vaccination contre l’hépatite B a largement contribué à prévenir les cancers du foie dans des régions du globe où le taux d’infection par le virus de l’hépatite B est important », et la vaccination contre le papillomavirus humain (HPV) « des jeunes filles entre 11 et 14 ans permettrait d’éviter 70 % des infections à l’origine de cancers » du col de l’utérus.

En France, seules 19 % des femmes sont vaccinées contre le HPV. Mais à l’autre bout du monde, en Australie, on vise les 100 % de vaccination grâce à un système de distribution gratuite aux adolescents âgés de 12 à 13 ans. Aux filles depuis 2007, et aux garçons depuis 2013. Celles et ceux qui se trouvent en dehors de cette tranche d’âge, mais qui ont moins de 19 ans, ont également droit à deux doses gratuites du vaccin. Résultat, le taux d’infection au HPV, qui se transmet notamment par voie sexuelle, a chuté de 22,7 % à 1,1 % entre 2005 et 2015 parmi les femmes âgées de 18 à 24 ans, selon un rapport publié dans le Journal of Infectious Diseases. À ce rythme-là, l’Australie pourrait bientôt devenir le premier pays du monde à éradiquer le cancer du col de l’utérus, d’après l’International Papillomavirus Society.
Contre les autres cancers, il n’est pas question de vaccination préventive, mais de vaccination thérapeutique. « Une situation très différente de celle de la vaccination préventive car l’intrus est déjà présent dans l’organisme et les défenses sont souvent débordées par la prolifération tumorale », précise l’immunologiste Vassili Soumelis. D’autant que, contrairement aux virus, les cellules cancéreuses sont produites par le corps lui-même. Le système immunitaire ne les perçoit pas comme une menace. Il s’agit donc en premier lieu de lui apprendre à reconnaître cette menace afin d’éradiquer les cellules cancéreuses, qui sont néanmoins capables d’envoyer des signaux pour contrer la réponse immunitaire. Le vaccin doit alors être associé à une méthode d’immunothérapie basée sur des checkpoint inhibitors, ou « inhibiteurs de points de contrôle », qui sont quant à eux capables de faire taire ces signaux.
Aux États-Unis, pas moins de 800 essais cliniques incluant des « inhibiteurs de points de contrôle » sont actuellement en cours, contre seulement 200 en 2015. « L’immunothérapie constitue indiscutablement une nouvelle arme de choix contre le cancer », souligne l’immunologiste Sebastian Amigorena. « Cette stratégie thérapeutique soulève beaucoup d’espoirs », poursuit-il. « Il est aujourd’hui possible de traiter des malades atteints de cancers très avancés. Donc chez des patients présentant des cancers moins avancés, les traitements devraient être encore plus efficaces. » Et si le chemin qu’il reste encore à parcourir peut sembler long, celui qui l’a déjà été l’est peut-être davantage.

Les soldats de l’organisme
En 1891, l’orthopédiste new-yorkais William Coley applique, pour la première fois, le principe de l’immunothérapie à la cancérologie. Il injecte alors un mélange de bouillon de bœuf et des streptocoques dans la tumeur d’un homme de 40 ans. Celui-ci est aussitôt pris de fièvre, de frissons et de vomissements. Mais un mois plus tard, la tumeur a considérablement diminué. William Coley reproduit donc l’expérience, sur un millier de patients et avec des degrés de succès extrêmement variables, avant que l’Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux (FDA) n’y mette un terme définitif. Et que l’oncologie ne s’engage résolument sur la voie de la radiothérapie, puis de la chimiothérapie, et enfin de l’hormonothérapie.
Car tout au long du XXe siècle, l’immunothérapie suscite autant d’enthousiasme que de désillusions. Mais en 2001, l’immunologiste Robert Schreiber démontre que les souris immuno-incompétentes développent spontanément des cancers, établissant ainsi le fait que l’absence de système immunitaire favorise l’apparition de tumeurs. Comme l’écrit le cancérologue Wolf Hervé Fridman, « les avancées de la connaissance du système immunitaire avec la découverte des checkpoint inhibitors et des techniques de clonage moléculaire et cellulaire identifiant des antigènes spécifiques des tumeurs et la production de cellules T et d’anticorps spécifiques de ces antigènes ont fait le reste, permettant à l’immunothérapie de devenir le quatrième, et le plus prometteur, pilier du traitement des cancers ».
« Une fois réactivées, les cellules T parviennent à supprimer la tumeur. »
Si l’on considère les cellules T – ou lymphocytes T – comme les soldats de l’organisme, on peut dire qu’ils sont aujourd’hui sur-entraînés, et ce dans l’objectif d’éradiquer le cancer. En effet, dans le cadre des thérapies par cellules CAR-T (« cellules T porteuses d’un récepteur chimérique »), qui ont pour la première fois été approuvées par la FDA en août 2017 pour le traitement d’un cancer du sang particulièrement agressif, la leucémie aiguë lymphoblastique, ces cellules immunologiques sont prélevées sur le patient, puis modifiées génétiquement de manière à leur faire exprimer un récepteur artificiel, dit chimérique, qui cible les cellules cancéreuses, avant d’être réinjectées au patient. Le fait d’utiliser ses propres cellules permet notamment d’éviter les rejets de greffe.
Mais à en croire l’immunologiste Karin Tarte, « un nombre limité de patients répondent aux traitements utilisant des cellules CAR-T ». Et « si des taux exceptionnels de guérison sont atteints dans les leucémies aiguës lymphoblastiques, les guérisons sont moins nombreuses pour ce qui est des autres leucémies et des lymphomes ». Par ailleurs, ce type de traitements peut avoir de dangereux effets secondaires, tels qu’une forte fièvre, des troubles respiratoires, une baisse de tension ou encore des convulsions. Ils impliquent un long processus et ils sont extrêmement coûteux. Si une seule injection de cellules CAR-T suffit, cette injection est actuellement facturée entre 373 000 et 475 000 dollars aux États-Unis. D’où le caractère potentiellement révolutionnaire de l’étude publiée en janvier dernier par les chercheurs de l’université Stanford.
L’optimisme du pionnier
Ces chercheurs ont injecté des quantités infimes de deux agents immuno-stimulants dans les tumeurs solides de souris afin de réactiver les cellules T présentes dans ces tumeurs, c’est-à-dire les cellules T ayant déjà reconnu les cellules cancéreuses comme une menace. Le premier est un court morceau d’ADN, l’oligonucléotide CpG, qui amplifie l’expression d’un récepteur activateur sur les cellules T, OX40. Le second est un anticorps qui se lie à OX40. « Lorsque nous utilisons ces deux agents ensemble, nous constatons l’élimination des tumeurs dans tout le corps », affirme le principal auteur de l’étude, l’oncologue Ronald Levy. « Cette approche contourne le besoin d’identifier des cibles immunitaires spécifiques à une tumeur et ne nécessite pas une activation complète du système immunitaire, ou de personnalisation des cellules immunitaires d’un patient. »
Une fois réactivées, les cellules T parviennent à supprimer la tumeur dans laquelle elles se trouvent. Et elles ne s’arrêtent pas là. Elles partent ensuite à la recherche d’autres cellules cancéreuses de même nature dans le corps de la souris, qu’il s’agisse d’une autre tumeur ou de métastases. Sur les 90 souris atteintes d’un cancer du système lymphatique – le lymphome –, 87 ont complètement guéri et trois ont eu une récidive de la maladie, qui a pu être totalement éliminée par un second traitement. Les chercheurs de l’université Stanford ont en outre observé des résultats similaires chez les souris atteintes de cancers du sein, du côlon et de la peau. Plus étonnant encore, des souris génétiquement modifiées pour développer spontanément des cancers du sein ont bien répondu au traitement. Le traitement de la première tumeur a souvent empêché l’apparition de futures tumeurs et augmenté de manière significative la durée de vie des animaux.

Crédits : AAAS
« Je ne pense pas qu’il y ait une limite au type de tumeurs que nous pourrions potentiellement soigner, tant qu’il a été infiltré par le système immunitaire », précise Ronald Levy. Un optimisme d’autant plus réconfortant qu’il est exprimé par un véritable pionnier de l’immunothérapie des cancers. Ses recherches ont déjà mené à la mise au point du Rituximab, premier anticorps monoclonal homologué par la FDA pour le traitement de certaines leucémies et de certains lymphomes. Il se souvient parfaitement du jour où il a découvert qu’il était possible de générer des anticorps monoclonaux capables de reconnaître les cellules cancéreuses dans l’organisme et de les étiqueter en vue de leur destruction : « C’était le jour de Thanksgiving, 1976. J’ai développé un gel, j’ai vu le résultat et les deux décennies suivantes de ma vie étaient devant mes yeux. J’ai couru dans le couloir pour montrer quelqu’un, mais il n’y avait personne. »
En 1985, il crée un laboratoire, IDEC Pharmaceuticals, pour pouvoir commercialiser le traitement qui a découlé de cette découverte. Mais ce n’est qu’en 1997 que le Rituximab est finalement homologué. Aujourd’hui, environ 500 000 patients en bénéficient chaque année. « Il a été merveilleux d’assister à la transition d’un projet de laboratoire à un médicament sur ordonnance », témoigne Ronald Levy. Reste néanmoins à tester l’efficacité de son tout nouveau traitement sur les êtres humains. L’université Stanford est actuellement en train de recruter une quinzaine de patients atteints de lymphome pour débuter l’essai clinique. Elle ne précise pas la date de publication des premiers résultats, mais si l’histoire de la lutte contre le cancer nous apprend une chose, c’est bien qu’il faut être patient. Et confiant.
Couverture : Test en laboratoire. (Drew Hays/Unsplash)
L’article Parviendra-t-on à créer un vaccin contre le cancer ? est apparu en premier sur Ulyces.
16.04.2021 à 03:00
La police américaine semble raciste. Pourquoi ?
Servan Le Janne
À Minneapolis, sur la 63e Avenue Nord, une Buick LaCrosse blanche est arrêtée sur le bas-côté. Trois policiers s’approchent de la voiture, l’un d’entre eux ouvre la portière et le conducteur sort les mains dans le dos. Alors qu’un des agents tente de le menotter, le jeune Afro-Américain se débat et parvient à regagner le […]
L’article La police américaine semble raciste. Pourquoi ? est apparu en premier sur Ulyces.
Texte intégral (2902 mots)
À Minneapolis, sur la 63e Avenue Nord, une Buick LaCrosse blanche est arrêtée sur le bas-côté. Trois policiers s’approchent de la voiture, l’un d’entre eux ouvre la portière et le conducteur sort les mains dans le dos. Alors qu’un des agents tente de le menotter, le jeune Afro-Américain se débat et parvient à regagner le volant de sa voiture, aux côtés de sa petite amie. Il entend alors une voix féminine hurler « Taser ! Taser ! Taser ! ».
Ce 11 avril 2021, cela fait déjà plus de 15 ans que Kimberly Potter a intégré les forces de police de Minneapolis. Son expérience lui vaut d’ailleurs d’être accompagnée par un jeune agent qu’elle doit former. Alors quand Dante tente de s’échapper, elle ne doute pas une seconde. Elle tend la main vers son taser, le sort de sa gaine, vise le conducteur en fuite et tire. Mais la détonation est assourdissante. « Oh merde, je viens de lui tirer dessus ! » entend-on s’exclamer la policière de 48 ans. Dans la précipitation, elle a confondu son Taser et son arme à feu, blessant mortellement sa cible. Elle aura beau tenté de le ranimer, rien ne pourra ramener le jeune homme à la vie.
Le soir-même, des centaines de manifestants se sont rassemblés devant le poste de police de Brooklyn Center, et les forces de l’ordre ont fait usage de gaz lacrymogène et de grenades assourdissantes pour disperser la foule. Craignant de nouvelles émeutes, le maire de la ville, Jacob Frey, a déclaré l’état d’urgence et instauré un couvre-feu dès le lendemain, demandant le soutien de la Garde nationale. Il faut dire que les tensions sont toujours aussi fortes entre policiers et noirs américains, surtout à Minneapolis, alors que suit son cours le procès de Derek Chauvin, le policier blanc accusé du meurtre de George l’an dernier.
George Floyd
À l’arrière d’une voiture de police, un homme est plaqué au sol, le visage écrasé contre le bitume par le genoux d’un agent de Minneapolis. « Je vais mourir », articule l’Afro-Américain avec peine entre deux râles. « Relaxe », répond le fonctionnaire en maintenant son emprise. Mais George Floyd n’arrive pas à respirer. Après avoir longuement imploré le policier de retirer son genou, ce lundi 25 mai 2020 sur Chicago Avenue South, le quadragénaire accusé d’avoir utilisé de faux documents est conduit à l’hôpital. Il meurt dans les minutes qui suivent.
Le lendemain, les quatre policiers impliqués dans son interpellation sont renvoyés et une enquête est ouverte par le FBI. Horrifiés par les images de cette agonie, filmée par des passants et caméras de surveillance, des internautes du monde entier réclament justice. Tandis que les policiers prétendent que George Floyd a résisté à son arrestation, de nouvelles vidéos semblent contredire cette affirmation en montrant l’homme rester calme pendant que les agents usent de la force contre lui.
Video shows what appears to be the start of the confrontation between #GeorgeFloyd and #Minneapolis #police officers. A restaurant's security footage shows cops taking him into custody, but the restaurant owner says it does not show Floyd resisting #Arrest pic.twitter.com/LjIerm6BaX
— Sn00pdad (@sn00pdad) May 27, 2020
Pour l’avocat de la famille de George Floyd, Benjamin Crump, ces quatre agents blancs ont montré un usage « abusif, excessif et inhumain de la force » face à un délit « non violent ». Il est temps de mettre fin au « profilage racial et à la minimisation des vies noires par la police », demande Crump, qui défend également la famille d’Ahmaud Arbery.
Lui aussi afro-américain, Arbery a été tué le 23 février 2020 sur une petite route de Brunswick, en Géorgie. Dans le lotissement de Satilla Shores, il cherchait à échapper à un homme lorsqu’il a été atteint par trois coups de feu. Il avait 25 ans et n’avait commis aucun délit. En le voyant s’approcher d’une maison en construction, deux riverains, Gregory et Travis McMichael, expliquent l’avoir pris pour un cambrioleur. Et le second lui a ôté la vie.
Entendus par la police, Gregory et Travis ont été relâchés après avoir plaidé la légitime défense. Il a fallu plus de deux mois, et la publication d’une vidéo tournée sur les lieux, mardi 5 mai, pour que la justice de Géorgie convoque un grand jury afin de déterminer si des charges doivent être retenues contre cet ancien policier et son fils. Dimanche 10 mai, à la faveur du retentissement médiatique de la vidéo, ils ont finalement été interpellés. Mais la police ne semblait pas pressée d’élucider cette affaire. Et ce n’est pas la première fois qu’elle bafoue les droits de minorités aux États-Unis.
Des menottes au primaire
Une petite tête dépasse du bureau. Kaia Rolle, 6 ans, est assise sous un néon carré aux airs de puits de lumière, dans une pièce aux murs beiges de l’école Lucious & Emma Nixon d’Orlando, en Floride. Elle jette un regard oblique vers les menottes tendues dans son dos. « Elles sont pour quoi ? » demande la jeune fille d’une voix fluette. « Elles sont pour toi », répond froidement un policier, alors que son collègue ouvre les bracelets métalliques.
« Garde tes mains tendues, OK, ne bouge pas chérie, ça ne va pas faire mal », ordonne ce dernier. « Non je ne veux pas les menottes », sanglote Kaia Rolle. Impuissante, l’élève se laisse guider à l’extérieur du bâtiment, les mains jointes et les joues humides. « La plus grande aventure c’est toi-même », dit une pancarte fixée près de la sortie. Une fois dehors, malgré ses supplications, elle est emmenée vers la voiture de police dans un concert de pleurs. Au commissariat, les forces de l’ordre prennent ses empreintes et la photographient.
En ce jeudi 19 septembre 2019, la police a été appelée par l’établissement afin de prendre en charge une écolière qui avait donné des coups de pieds à trois membres du personnel. Mais quand Dennis Turner a passé les menottes à Kaia Rolle, certains employés lui ont dit que ce n’était pas nécessaire. « J’ai arrêté 6 000 personnes en 28 ans, beaucoup de gens », s’est contenté de plastronner l’agent. « La plus jeune avait 7 ans. Elle a 8 ans non ? » Deux ans de moins, lui a-t-on répondu. « Elle a 6 ans ? Alors elle a battu le record. »
Sa grand-mère, Meralyn Kirkland, a reçu un appel de l’école lui annonçant l’arrestation. « Aucune petite fille de 6 ans ne devrait avoir à raconter qu’on lui a mis les menottes, qu’on l’a placée à l’arrière d’une voiture de police et qu’elle a été amenée dans un centre pour jeunes délinquants pour prendre ses empreintes et des photos », juge-t-elle. Si aucun âge minimum n’existe pour les interpellations en Floride, la police d’Orlando recommande à ses agents de ne pas se servir de menottes pour des enfants de moins de 12 ans. Lundi 23 septembre, elle a d’ailleurs décidé de limoger Dennis Turner, qui avait emmené au poste un autre enfant de six ans le même jour.
« Ce qui est arrivé à ces enfants n’est pas juste de la faute d’un mauvais policier », juge Arwa Mahdawi, éditorialiste du Guardian basée à New York. « C’est la faute d’un système pourri. Ces dernières décennies, les écoles américaines, et notamment ses écoles privées, sont devenues des zones militarisées, où patrouillent de plus en plus d’agents en armes. » En novembre dernier, une école de Pennsylvanie a appelé le 911 parce qu’une fille de six ans, atteinte du syndrome de Down, avait pointé un enseignant en mimant un pistolet avec ses doigts. La direction a même indiqué vouloir réunir une équipe d’évaluation des menaces – une réaction passablement disproportionnée, selon la mère de l’élève, Maggie Gaines.
Pire, des policiers de Fresno, en Californie, n’ont pas hésité à mettre les menottes à un adolescent autiste en pleine crise d’épilepsie vendredi 31 janvier 2020. Lourdes Ponce avait appelé les secours en entendant son fils de 16 ans pris de convulsions dans les toilettes d’un fast-food. Au lieu de l’aider, deux agents ont procédé à son arrestation, toute honte bue. « Mon fils ne faisait de mal à personne, il faisait simplement une crise », s’est indignée Lourdes Ponce. Dans les minutes qui ont suivi, une ambulance a heureusement pu s’occuper de lui.
En avril 2019, une vidéo obtenue par BuzzFeed montrait des membres des forces de l’ordre traîner une adolescente de 16 ans dans les escaliers d’un lycée de Chicago, dans l’Illinois, avant de la frapper et de l’immobiliser avec un Taser. Malgré les critiques qui pleuvent sur eux depuis des années, les gardiens de la paix américains continuent de commettre bavure sur bavure, quand ils ne tuent pas carrément des innocents. Ce phénomène dramatique n’est ni restreint aux écoles, ni à certaines régions du pays. C’est toute une institution qui, à force d’abus, transforme la violence légitime dont elle est censée être dépositaire en violence illégitime. Comme le dit Arwa Mahdawi, il y a quelque chose de pourri au cœur de la police américaine.
Haine infiltrée
Quand le nom de Dennis Turner est sorti dans la presse, les équipe du Orlando Sentinel, un quotidien de la ville de Floride, ont fouillé leurs archives pour retrouver sa trace. Et ils n’ont pas eu à chercher trop loin. Engagé en 1995, ce policier avait été arrêté pour avoir frappé son fils de 7 ans lorsqu’il était revenu de l’école avec de mauvaises notes en 1998. Il avait alors écopé d’une suspension. « Ça ne doit pas vous arrêter d’imposer une discipline à vos enfants », avait-il déclaré à cette occasion, alors que le garçon avait des bleus sur le torse et les bras. Turner avait aussi été sermonné par ses supérieurs en 2015 pour avoir donné cinq coups de Taser à un suspect, dont deux au moment où il était au sol. À l’époque, la Ville d’Orlando avait dû engager 940 000 dollars de frais de justice pour des abus policiers.
Afro-américain comme Kaia Rolle, Dennis Turner est peut-être avant tout le produit d’une société violente. En 2018, des citoyens américains ont commis 16 214 meurtres, soit 2 000 de plus qu’en 2014. Ils ont aussi perpétré 41 tueries de masse en 2019, le nombre le plus élevé jamais dénombré. Sachant qu’un Américain sur quatre est sujet à des troubles psychologiques une fois dans sa vie, à en croire la National Alliance on Mental Illness, l’existence de 270 à 357 millions d’armes à feu sur le territoire n’est pas pour apaiser ceux qui s’occupent de la sécurité. Mais ces chiffres n’expliquent pas l’agressivité de trop nombreux agents à l’égard d’individus aussi inoffensifs que des enfants de six ans. La police est aussi gangrenée par le racisme et trop sûre de ses méthodes brutales.
*
En Alabama, le mouvement des droits civiques est traumatisé par l’impunité réservée par la police au Ku Klux Klan (KKK). Le 14 mai 1961, des membres de ce groupuscule suprémaciste blanc ont attaqué le bus des Freedom Riders qui étaient venus défendre les droits des minorités dans le village d’Anniston. Les pneus du véhicule ont été crevés, les fenêtres brisées et l’intérieur incendié sans que les forces de l’ordre, postées à quelques mètres, ne daignent bouger d’une semelle.

Trente ans plus tard, alors que le Civil Rights Act a interdit les discriminations et que le Ku Klux Klan a reculé, un groupe d’officiers de la police de Los Angeles est accusé d’avoir terrorisé les minorités en vandalisent leurs maisons, en les torturant voire en les tuant. Membres d’un groupe néo-nazi baptisé Lyndwood Vikings, certains écopent de lourde peines et le Los Angeles Sheriff’s Department est condamné à une amende de 9 millions de dollars.
Dans un rapport de FBI rédigé en 2006, des agents du contre-terrorisme préviennent que des suprémacistes blancs ont passé des décennies à tenter « d’infiltrer la police ». Le document sera révélé en 2017 par The Intercept. Entre-temps, en 2012, un policier de Little Rock, dans l’Arkansas, tue un adolescent afro-américain. Il avait participé à une réunion du KKK, tout comme un agent de Holton, dans le Michigan, renvoyé cette année-là. Il faut dire qu’à en croire une étude universitaire de 2014, les enfants noirs sont généralement vus comme « moins innocents » que les blancs aux États-Unis. Ils sont d’ailleurs punis plus souvent dès l’école, d’après un document du ministère de l’Éducation. Sans surprise, les adultes afro-américains ont trois fois plus de chances de finir en prison, selon les chiffres du Violence Policy Center.
Une enquête du Guardian détermine en 2015 que les Noirs-Américains ont neuf fois plus de chances d’être tués par un détenteur de l’autorité que les autres. En attestent les morts de Michael Brown à Ferguson, dans le Missouri, de Freddie Gray à Baltimore, dans le Maryland, de Tamir Rica à Cleveland, dans l’Ohio, et d’Eric Garner à New York, tous abattus pas un policier en dépit de l’absence de danger qu’ils représentaient. Si les forces de police sont particulièrement décentralisées aux États-Unis, avec quelque 750 000 agents locaux et 120 000 agents fédéraux, ces drames ne se déroulent pas forcément à l’endroit où l’on pourrait s’y attendre, à savoir dans le sud du pays, où le racisme est plus ancré et les armes plus disponibles.
Le problème est donc à la fois local et national : une culture de la violence infuse dans les différentes strates de la police américaine et trouve à s’exprimer dans des contextes particuliers, avec d’autant plus d’aise que certains dirigeants semblent s’en accommoder. En 2018, l’ancien procureur général Jeff Sessions a signé un mémorandum pour réduire la capacité du ministère de la Justice à enquêter sur les divisions locales de police, y compris les 14 qui avaient accepté une supervision sous le mandat de Barack Obama. « Les méfaits de quelques individus ne doivent pas remettre en cause le travail légitime et honorable de policiers et d’agences qui préservent la sécurité des Américains », avait-il justifié. Quand il était sénateur de l’Alabama, ce proche de Donald Trump avait déclaré, sur le ton de la blague, que les membres du KKK étaient pour lui des gens « OK », jusqu’à ce qu’il « apprenne qu’ils fument du cannabis ».
Couverture : Justin Snyder
L’article La police américaine semble raciste. Pourquoi ? est apparu en premier sur Ulyces.
29.03.2021 à 00:25
À quoi ressemblera l’Inde du futur ?
Nicolas Prouillac
Au rythme des tablas, des dizaines de milliers de paysans s’avance aux abords de Delhi. Les barrières installées par les forces de l’ordre pour empêcher la population de se joindre à eux sont balayées comme des fétus de paille, et la foule enfle à mesure que la journée avance. Ce 17 mars 2021, les leaders […]
L’article À quoi ressemblera l’Inde du futur ? est apparu en premier sur Ulyces.
Texte intégral (2967 mots)
Au rythme des tablas, des dizaines de milliers de paysans s’avance aux abords de Delhi. Les barrières installées par les forces de l’ordre pour empêcher la population de se joindre à eux sont balayées comme des fétus de paille, et la foule enfle à mesure que la journée avance. Ce 17 mars 2021, les leaders du Samyukta Kisan Morcha, le front paysan uni, ont lancé un nouvel appel à la grève générale dans le pays. Mais plus que ça, c’est un message aux citoyens du monde entier que le Dr Swaiman Singh, une des figures du mouvement, a délivré. « Où que vous soyez dans le monde, il faut défendre vos agriculteurs, il faut défendre votre nation », a déclaré le médecin.
Bien décidé à s’opposer à la réforme agricole menée par le gouvernement, cela fait maintenant près de quatre mois que les paysans de tout le pays se sont regroupés autour de la capitale pour faire entendre leurs voix. « Quand je suis arrivé, j’ai vu que les gens dormaient sur les routes », raconte Taranpreet Singh, qui a participé aux manifestations de décembre. Ce jeune diplômé en finance a décidé de rejoindre le mouvement pour voir l’histoire s’écrire de ses propres yeux.
https://twitter.com/indianproud12/status/1375501807682785283
Depuis le début des contestations, les agriculteurs ont eu le temps de s’organiser et de construire de véritables campements de plusieurs milliers de personnes, aux abords des points de passage vers Delhi. Des centaines de cuisines communautaires ont vu le jour, qui distribuent régulièrement des repas gratuits aux manifestants, même s’il n’y en a pas assez pour tous. Des hôpitaux de fortune ont été installés, où des médecins volontaires s’occupent de soigner ceux dans le besoin. Certains agriculteurs considèrent même ces villes improvisées comme de véritables « Républiques Autonomes ».
Il faut dire que le mouvement repose sur un système de démocratie directe, les Panchayats, issus du mouvement pour l’indépendance d’après la Seconde Guerre mondiale. Ces structures municipales sont élues, et des assemblées générales populaires (Gram Sabha) dictent leur orientation. Les Mahapanchayats sont quant à eux d’énormes assemblées populaires de plusieurs dizaines de milliers de participants. Elles regroupent des centaines de villages, et tous les élus des Panchayats s’y mêlent à la population. C’est dans ces meetings de masse que les têtes de proue du soulèvement paysan annoncent les grandes décisions. Les agriculteurs sont ainsi bien établis et ne comptent donc pas rentrer chez eux, même à l’approche de la saison des récoltes.
Un certain nombre d’entre eux ont même donné leur vie pour la cause. Selon le front paysan uni, il y a eu 300 décès au cours des derniers mois. Alors que certains sont morts dans des accidents ou se sont suicidés, d’autres ont succombé aux intempéries ou de causes naturelles telles que des crises cardiaques. Ils leur ont d’ailleurs rendu hommage à travers le hashtag #300DeathAtProtest (300 morts aux manifestations) lors de la journée du 18 mars. Mais ces pertes ne sont rien en comparaison des 10 281 suicides de paysans indiens en 2019…
Elles ont au contraire raffermi la détermination des protestataires, dont les rangs ne cessent de grossir. Outre les paysans, qui représentent la moitié de la population active du pays, de nombreuses classes de la société se sont aussi jointes aux marches et blocages. Au total, ce sont plus de 250 millions d’Indiens qui ont déjà participé aux contestations à travers le pays, faisant du mouvement la plus grande manifestation de l’histoire de l’humanité.
https://twitter.com/saahilmenghani/status/1375090643517628416
Un désaccord profond
Tout l’enjeu de ce mouvement de contestation a été exposé lors de la 46e session du Conseil des droits de l’homme des Nations unies, le 26 février. À cette occasion, Darshan Pal, le chef de file du front paysan uni, et le représentant indien permanent aux Nation unies Indra Mani Pandey, ont tous deux pu donner leur vision pour l’avenir du pays. « Le gouvernement indien s’est fixé comme objectif de doubler le revenu des agriculteurs d’ici 2024. Cela profitera particulièrement aux petits agriculteurs et offrira plus de choix à ceux qui optent pour eux », a affirmé le représentant du pouvoir indien.
De son côté, le leader de la révolte paysanne a rappelé que l’Inde avait signé la Déclaration des Nations unies sur les droits des paysans en décembre 2018. « Les quelques États où des politiques similaires ont été introduites ont vu les agriculteurs sombrer dans la pauvreté et perdre leurs terres », a témoigné Darshan Pal. Et le pouvoir indien semble encore imperméable aux revendications populaires.
Du côté des paysans, la rage ne faiblit pas. « Nous appellerons tous les travailleurs du pays à faire [les récoltes] avec nous afin de pouvoir continuer à nous battre, ou alors nous les brûlerons », a déclaré un des leaders du mouvement paysan. Il faut dire que beaucoup d’entre eux considèrent qu’ils n’ont plus rien à perdre depuis la mise en place de la réforme agraire. En septembre 2020, le parlement a adopté une loi autorisant les agriculteurs à vendre leur production aux acheteurs de leur choix, plutôt que de se tourner exclusivement vers les « mandis », les marchés contrôlés par l’État.
Ces marchés, qui assuraient un prix de soutien minimal (PSM) pour certaines denrées, avaient été créés dans les années 1950 pour protéger les agriculteurs contre les situations d’abus. Ces prix, fixés au niveau national, permettaient aux paysans indiens de revendre leur production tout en ayant l’assurance d’en tirer une valeur minimale. C’est grâce à ce soutien que de nombreux petits agriculteurs parvenaient encore à nourrir leur famille. « Il faut comprendre que la majorité des fermiers ont une surface plus petite que celle d’un terrain de football », précise Jasleen Kaur, étudiante en sciences politiques à Mumbai. Cependant, ce système existait sans aucune loi pour le garantir, et c’était justement cette décision qu’espéraient voir arriver les producteurs.
Huge farmers rally in Rajasthan, #FarmersProtest is pan India pic.twitter.com/ABJ0FAb47K
— Zora Singh (@global_voice11) March 27, 2021
L’autre point de discorde majeur vient d’une seconde loi prévue dans la réforme gouvernementale. « S’il y a un différend entre un agriculteur et une entreprise, l’agriculteur ne peut plus saisir un tribunal civil », explique la jeune femme. Une part conséquente de la population se retrouve donc privée d’une partie de ses droits. En effet, l’agriculture est l’emploi exercée par 55 % de la population active, soit près de 265 millions de travailleurs indiens. D’après les derniers chiffres du ministère français de l’Agriculture, plus de 600 millions d’Indiens dépendent directement ou indirectement de ce secteur. « Je ne comprends pas ce qu’il se passe », soupire Taranpreet. « Vous ne pouvez pas nier la justice dans un pays démocratique », déplore le jeune militant.
Il semble ainsi que les lois votées en septembre favorisent nettement les grandes entreprises aux dépens des travailleurs locaux. « L’implication de multinationales indiennes, capables de fournir d’importants investissements ciblés pour le stockage ou la réfrigération, conduirait très probablement aussi à ce qu’elles acquièrent localement des positions monopolistiques, autrement dit le pouvoir de contrôler les prix », confirme Bruno Dorin, économiste au Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (Cirad). C’est pourquoi les agriculteurs préfèrent rester défendre leurs droits, et leur unique source de revenus.
Dérive autocratique
Malgré la non-violence prônée par les fermiers, le Jour de la République, une des trois fêtes nationales, avait vu des violences se produire entre les manifestants et les forces de l’ordre. L’occasion rêvée pour le gouvernement de dépeindre les agriculteurs en émeutiers complotistes. En ce jour censé représenter « la suprématie du peuple », des dizaines de milliers d’agriculteurs s’étaient retrouvés pour marcher dans la capitale indienne.
Certains manifestants ont atteint le centre de Delhi et vandalisé des biens publics. D’autres ont atteint le Fort Rouge, symbole de l’indépendance de l’Inde, et ont hissé le Nishan Sahib (un drapeau religieux sikh) ainsi que les drapeaux des syndicats d’agriculteurs au-dessus des remparts. La réponse de la police a provoqué la mort d’un homme, suite à une chute de son tracteur, et de nombreux blessés. Plus de 300 policiers ont également été blessés dans les violences, certains manifestants utilisant des matraques et des armes tranchantes. On a alors cru à la fin du mouvement de révolte avec le départ de plusieurs syndicats et la perte de nombreux soutiens condamnant la violence.
https://twitter.com/saahilmenghani/status/1374751349557006342
Il n’en est rien mais depuis ce jour, l’attitude du gouvernement s’est considérablement durcie. De nombreuses arrestations ont suivi les heurts et Internet a été coupé aux frontières de la capitale. Devant le Parlement, Narendra Modi n’a même plus hésité à parler de « parasites », multipliant les mesures contre ses opposants. « Si quelqu’un se positionne du côté des fermiers, (le gouvernement] tente alors de lui faire peur », confie Taranpreet. C’est d’ailleurs pour éviter des poursuites judiciaires pour conspiration qu’il ne souhaite pas révéler son poste actuel. Ces pressions de la part du gouvernement ont aussi été constatées par Michelle Bachelet, Haut-Commissaire des Nations unies aux droits de l’homme.
« Les accusations de sédition contre des journalistes et des militants pour avoir rapporté ou commenté les manifestations et les tentatives de restreindre la liberté d’expression sur les réseaux sociaux sont des dérogations troublantes aux principes essentiels des droits de l’homme », s’est-elle inquiétée. Une prise de parti qui n’a pas plu au représentant du pouvoir indien. « L’objectivité et l’impartialité doivent être les caractéristiques de toute évaluation des droits de l’homme. Nous sommes désolés de voir que la mise à jour orale du Haut Commissaire fait défaut dans les deux », s’est offensé Indra Mani Pande.
La fin d’un monde
Les réformes entamées par le Premier ministre Narendra Modi et le BJP, le parti nationaliste hindou, s’étendent bien au-delà du milieu agricole. Sa volonté de libéraliser l’économie impacte une grande partie de la société indienne. Le 15 mars dernier, les dix plus importantes confédérations syndicales du pays, en commun avec le soulèvement paysan, ont mené une journée de lutte contre les privatisations en bloquant les gares, en soutien aux cheminots.
Le lendemain, c’était au tour du personnel des banques publiques de lancer une grève nationale, suivis par les assurances publiques et enfin les travailleurs de l’énergie. En quelques jours, ce sont donc des dizaines de milliers de nouveaux manifestants qui ont rejoint la révolte paysanne. Et depuis le 23 mars, de nouvelles mobilisations générales voient le jour dans tout le pays. En réaction, le gouvernement a coupé Internet et l’arrivée en eau potable aux abords des différents campements de manifestants, dans le but de les faire plier. La police a également érigé des barricades supplémentaires, surmontées de barbelés en accordéon, et des centaines d’agent supplémentaires ont été déployés.
https://twitter.com/NavJammu/status/1374172823598424068
La bataille fait aussi rage en ligne. Dans une lettre envoyée à Facebook, WhatsApp et Twitter, le gouvernement indien menace les réseaux sociaux de s’en prendre à leurs employés. Ces derniers risquent la prison si leurs employeurs ne se conforment pas aux lois du pays. Pourtant, les plateformes sont toujours réticentes à l’idée de fournir des informations au gouvernement indien.
Les opposant plient mais ne rompent pas les rang, et leur détermination parvient à toucher de plus en plus de monde. Le succès des plateformes mises en place par les agriculteurs pour diffuser leurs actions au grand public témoigne ainsi de cet engouement collectif : la chaîne YouTube dédiée, Kisan Ekta Morcha, a par exemple dépassé le million d’abonnés en un mois.
La fracture entre la ligne directrice du gouvernement indien et la volonté populaire ne cesse ainsi de s’accentuer à mesure que les semaines passent. Cette situation fait écho au dernier rapport sur la démocratie de l’institut suédois Varieties of Democracy, publié le jeudi 11 mars. L’Inde y est désormais classée dans la catégorie des « autocraties électorales », un système qui a l’apparence des régimes démocratiques, mais sape la neutralité des contre-pouvoirs et transforme les opposants en ennemis de la nation.
Depuis l’accession au poste de Premier ministre du nationaliste hindou Modi, l’institut indépendant note une détérioration des libertés et estime qu’il s’agit d’ « un des changements les plus spectaculaires parmi tous les pays du monde au cours des dix dernières années ». La plus grande démocratie du monde pourrait n’être ainsi plus que l’ombre d’elle-même, mais le peuple indien n’a pas abandonné pour autant ses envies de liberté et de respect.
https://twitter.com/Vikas_Tweets/status/1376030911544717315
La bataille qui se déroule actuellement dans les rues se poursuivra vraisemblablement dans les urnes. En effet, du 27 mars au 2 mai se déroulent les élections législatives pour cinq États du pays, le Bengale, le Tamil Nadu, le Kerala, Pondichéry et l’Assam. Au total, plus de 220 millions de citoyens sont appelés aux urnes. « Ce sont les fermiers qui ont mis Modi au pouvoir en 2014, et qui l’y ont maintenu en 2019, ils peuvent tout aussi bien le faire tomber », explique Shareen.
Ces élections s’annoncent comme un baromètre politique en Inde. Le Kerala et le Bengale sont en effet tous deux dirigés par des coalitions de gauche opposées au gouvernement, et le Tamil Nadu par un parti régional. De plus, ces trois États ont un poids économique et démographique très important. Si un front uni parvient à se former face à l’Alliance démocratique nationale, à laquelle appartient le BJP de Modi, le Premier ministre pourrait perdre en influence pour la première fois depuis son arrivée au pouvoir.
Du point de vue des nationalistes et des castes supérieures, la tendance est à la libéralisation des différents secteurs de l’économie et à la privatisation. Mais c’est exactement l’inverse que souhaitent les contestataires. « Nous ne croyons pas à la main du marché privé », s’est emporté Ruldu Singh Mansa, président du Syndicat des fermiers du Pendjab. « On nous a déjà fait le coup pour la privatisation des transports, des hôpitaux, des écoles. On finit toujours par payer plus cher. » Pour l’opposition et les fermiers, les priorités ne sont pas les mêmes. « La raison pour laquelle on se rassemble, c’est qu’on essaie d’unir la nation, d’unir le monde », a déclaré le Dr Swaiman Singh dans son appel.
En parlant de ceux morts pour leurs idées, il a aussi rappelé ce qu’ils cherchaient à accomplir. « Leur rêve était, pour nous, de passer au-dessus des religions et des castes », a-t-il rappelé, mais aussi « d’avoir un pays où l’éducation est respectée, où les soins sont accessibles à tous, qu’importe la quantité d’argent qu’ils gagnent ». Entre dérive autocratique du pouvoir et volonté d’égalité du peuple, 2021 sera donc une âpre bataille pour l’avenir d’un sixième de la population humaine.
Couverture : Kisan Ekta Morcha/Twitter
L’article À quoi ressemblera l’Inde du futur ? est apparu en premier sur Ulyces.
15.03.2021 à 00:35
Instagram et NFT : comment les artistes numériques ont réussi à percer
Le 25 février dernier s’ouvrait une vente historique pour la société de vente aux enchères britannique Christie’s. Après 255 ans d’existence, la maison proposait pour la première fois la vente d’une œuvre d’art 100 % numérique, baptisée les « Les 5000 premiers jours ». Composée par l’artiste américain Mike Winkelmann, aussi connu sous le nom […]
L’article Instagram et NFT : comment les artistes numériques ont réussi à percer est apparu en premier sur Ulyces.
Texte intégral (3809 mots)
Le 25 février dernier s’ouvrait une vente historique pour la société de vente aux enchères britannique Christie’s. Après 255 ans d’existence, la maison proposait pour la première fois la vente d’une œuvre d’art 100 % numérique, baptisée les « Les 5000 premiers jours ». Composée par l’artiste américain Mike Winkelmann, aussi connu sous le nom de Beeple, cette mosaïque est une compilation des œuvres que l’artiste a produites chaque jour depuis 13 ans. Le spectacle, qui touchait à sa fin le jeudi 11 mars, a été à la hauteur de l’événement.
Le dernier jour d’enchères a vu le prix de l’œuvre s’envoler, pour finalement atteindre la somme hallucinante de 69 millions de dollars. Cet exploit place l’auteur de l’œuvre « parmi les trois artistes vivants les plus cotés », selon Christie’s. L’emballage final a même poussé plusieurs millions de visiteurs à rejoindre le site de l’institution pour assister à l’événement en direct.
Quelques jours auparavant, c’est la chanteuse Grimes qui avait vendu plusieurs courtes vidéos artistiques accompagnées de musiques originales. Si certaines œuvres étaient disponibles en plusieurs centaines d’exemplaires, une autre n’était disponible que pour un seul acheteur. Baptisée « Death of the Old », le clip vidéo de 56 secondes s’est vendu à près de 389 000 dollars. L’heureux acheteur est donc officiellement l’unique propriétaire de la nouvelle création, bien que celle-ci soit accessible à tous sur Internet. Au total, la vente de la collection « WarNymph », qu’elle a créée en collaboration avec son frère, Marc Boucher, aura rapporté à la Canadienne de 32 ans le joli pactole de six millions de dollars.

Image de « Death of the Old »
Dans le même temps, le tout premier message posté sur Twitter a lui aussi été mis aux enchères par son auteur, Jack Dorsey, le créateur du réseau social à l’oiseau bleu. Et s’il faudra attendre la clôture de la vente le 21 mars pour avoir le prix final, la meilleure offre est déjà de 2,5 millions de dollars, une somme que l’entrepreneur compte reverser à des associations caritatives. Et ce ne sont pas les seuls objets numériques que s’arrachent les collectionneurs récemment. Chris Torres, l’artiste derrière Nyan Cat, a remasterisé l’animation originale du meme et l’a vendue pour 560 000 dollars au cours du mois de février…
Le point commun entre ces différents succès : ils sont tous basés sur une technologie qui assure l’authentification et la traçabilité de l’œuvre, tout en empêchant sa reproduction. Ce système, appelé NFT, bouleverse le monde de l’art numérique depuis quelques mois maintenant. « Je considère cela comme le prochain chapitre de l’histoire de l’art », a déclaré Beeple, car il « existe maintenant un moyen de collectionner de l’art numérique ». À l’image des autres secteurs, l’art a donc aussi accéléré sa transformation numérique, nous donnant un aperçu de ce que pourrait être le futur de ce marché si particulier.
De la cryptomonnaie au crypto-art
La fascination d’une partie du monde de l’art pour les NFT remonte au moins à une poignée d’années. Dès 2018, l’artiste américain Kevin Abosch travaillait à donner corps à cette la technologie de la blockchain pour donner un sens et une valeur à ses œuvres. Cette quête l’avait alors conduit à utiliser ce certificat d’authenticité numérique appelé « jeton non-fongible », ou NFT en abrégé, pour donner naissance au « crypto-art ». Dans sa forme la plus simple, une œuvre d’art NFT est composée de deux choses. Tout d’abord, une œuvre d’art, généralement numérique, mais aussi parfois physique. Deuxièmement, un jeton numérique représentant l’œuvre, également créé par l’artiste. Ce jeton est un actif unique stocké sur une blockchain, le type de registre qui sécurise les cryptomonnaies comme le bitcoin.
En d’autres termes, il s’agit d’une capsule numérique qui contient l’œuvre originale ainsi que toutes les informations y étant associées, permettant une authentification et une traçabilité parfaites. « Ce faisant, les NFT ont créé une nouvelle voie pour le marché de l’art numérique », résume Beverly Bueninck, responsable des relations publiques chez Christie’s France.
Mais dans le cas de Kevin Abosch, sa démarche allait encore plus loin. En effet, les œuvres qu’il a produites à l’époque étaient uniquement composées du jeton NFT, sans être connectées à des supports externes, donc sans existence concrète en dehors de la blockchain. « On pourrait dire qu’ils étaient “purs”, car le NFT lui-même était l’art », explique l’artiste avec du recul. « Pour moi, le NFT était un proxy pour distiller de la valeur émotionnelle. »
Si le concept peut paraître abstrait, il a aussi pour but d’amener les gens à réfléchir à la manière dont la technologie blockchain peut être appliquée au monde de l’art. « Les NFT sont particulièrement adaptés aux artistes qui travaillent numériquement, ils fournissent une méthode pour prouver à la fois l’authenticité et la propriété. » Et s’il tient à souligner une certaine artificialité dans la tentative de donner de la rareté à un objet numérique, il n’en résulte pas moins l’outil ultime pour les artistes numériques qui cherchent à valoriser leur art.

89b23 / 80bd5 / c6dc8
Kevin Abosch, 2020
Le marché des NFT est d’ailleurs en pleine expansion. Il couvre de nombreux domaines et peut englober toute une gamme de produits, allant de stickers aux cartes de sport à collectionner, en passant par les personnages de jeux vidéo et l’immobilier virtuel. Fin 2017, le lancement du jeu CryptoKitties avait été le premier succès de ce nouveau système de vente, provoquant même la congestion du réseau Ethereum, sur lequel il était basé. Le but était simple : il fallait collectionner des stickers de chats, et les associer pour créer de nouveaux modèles plus rares. Le succès avait été tel qu’une pièce exclusive s’était vendue pour 170 000 dollars.
Aujourd’hui, même des marques telles que Nike, Louis Vuitton ou la NBA ont déjà créé leurs propres gammes de NFT. La ligue américaine de basket a même mis en ligne le site NBA Top Shot pour permettre aux utilisateurs d’acheter et de vendre des clips vidéo des plus belles actions de jeu. Celui d’un dunk spectaculaire de LeBron James s’est récemment vendu pour plus de 200 000 dollars. Au total, le marché des NFT a d’ailleurs explosé de 200 % en 2020 pour atteindre 250 millions de dollars, selon l’atelier BNP Paribas.
Le marché du crypto-art s’est lui aussi développé au cours de l’année passée. Ainsi, en l’espace de 12 mois, les ventes cumulées des principales plateformes de NFT ont avoisiné les 20 millions de dollars. Cet engouement pousse certains artistes à sauter le pas, comme le Suédois Criss Bellini, qui voit les NFT prendre une part importante dans le monde le l’art numérique. « En Europe c’est plutôt récent, mais aux États-Unis c’est déjà plus accepté. Les gens ne savent juste pas encore ce que c’est », explique-t-il. « Mais d’ici cinq ans les NFT représenteront la majorité de l’art numérique. »
Voir cette publication sur Instagram
Une publication partagée par Criss Bellini | Art (@crissbelliniart)
Et quand il s’agit de trouver le bon modèle économique pour valoriser son art, l’artiste anonyme est un expert. S’il n’a lancé sa carrière sur Instagram qu’en janvier 2020, Criss Bellini a déjà imposé son nom parmi les personnalités artistiques les plus influentes de la plateforme. Ses œuvres, des peintures numériques mixant art traditionnel et pop culture contemporaine, lui ont déjà rapporté son premier million en un an. Mais son succès à lui est lié à une autre mutation du marché de l’art, qui a vu les artistes prendre de plus en plus d’indépendance dans la promotion de leur travail.
La galerie Insta
Derrière son masque cagoule, qui représente pour lui « le reflet le plus fidèle de ce que nous sommes », Criss Bellini a su allier l’élégance de l’art traditionnel à la décadence de la modernité. Il s’inspire notamment de peintures anciennes, qu’il recrée à son image, et leur donne un nouveau sens. Il peint ses œuvres numériquement, avant de les imprimer sur des supports qu’il veut digne de musées. Mais pour conserver un sentiment d’exclusivité, seules 250 pièces par œuvre sont créées. Lorsqu’un design est épuisé, il disparaît pour toujours.
S’il a eu l’idée de procéder ainsi, c’est qu’il s’est rendu compte d’un manque de choix dans le marché de l’art. « Soit je trouvais des posters vraiment bon marché comme tout le monde en a, soit des peintures qui coûtent super cher et pour lesquelles je n’avais pas les moyens », se rappelle l’artiste suédois. Au moment de se lancer, il a donc décidé de se passer d’intermédiaire et d’ouvrir sa propre galerie d’art en ligne, utilisant principalement Instagram, mais aussi les autres réseaux sociaux, comme vitrine de son travail.
Voir cette publication sur Instagram
Une publication partagée par Criss Bellini | Art (@crissbelliniart)
C’est ainsi qu’il est parvenu à atteindre une nouvelle clientèle qui n’aurait jamais investi d’argent dans une toile. « Les gens qui ne savent même pas ce qu’est l’art, qui n’ont jamais acheté d’art, peuvent acheter mes œuvres », affirme Criss Bellini. Il n’y a qu’à voir l’intérêt que celles-ci ont reçu de la part d’influenceurs du monde entier pour comprendre que le peintre anonyme a visé juste. Instagram et son milliard d’utilisateurs actifs mensuels a donc été l’eldorado pour l’artiste suédois. « Tout le monde a Instagram », confirme-t-il. « Donc il est plus facile de montrer qui tu es et ton travail, de toucher davantage de gens. » Il faut dire que la plateforme a tout prévu pour être la plus grande galerie d’art au monde. Depuis son lancement en 2010, elle est une source abyssale d’inspiration et de diffusion pour tous. Et la tendance ne va qu’en s’accélérant, avec de plus en plus de millennials qui achètent des œuvres d’art en ligne, selon un rapport d’Hixos.
En passant directement par les réseaux sociaux, les artistes laissent donc de côté les galeries d’art traditionnelles au profit d’une plus grande indépendance dans leur communication. « Avant, on dépendait totalement des galeries qui exposaient notre travail, et de tout leur système marketing », confie le peintre français Yannick Fournié. Mais la réelle évolution est due à de simples raisons pratiques. « Une galerie a toujours une vingtaine d’artistes avec lesquels elle tourne donc elle ne peut pas garantir à tous une régularité dans la visibilité », explique-t-il, ce qui poussé nombre d’entre eux à prendre leur indépendance.
Avec sa fonctionnalité marchande, Instagram a même offert la possibilité aux créateurs de se passer d’autres plateformes et de vendre directement leurs œuvres à travers leur compte. Mais l’option manque d’authenticité pour Yannick Fournié, qui a opté pour une autre solution. « Je veux pouvoir continuer à proposer un univers », justifie le peintre. Il préfère donc sponsoriser ses publications pour rediriger son audience vers son site. Le numérique se retrouve en conséquence intégré à l’art à tous les niveaux. À tel point que même l’appellation d’art numérique semble perdre son sens.
De nouvelles formes d’art
« L’art numérique, ça ne veut plus rien dire, puisque aujourd’hui tout est numérique », soutient Justine Emard. « Même les peintres travaillent à partir de photos qu’ils ont prises sur leur smartphones. » Après être passée par une école d’art, où elle a pu apprendre à travailler l’image, la Française utilise différents médiums, qui vont de la photographie à la réalité virtuelle, pour délivrer son message. « Je m’intéresse aux liens entre la technologie et nos existences », confie l’artiste. Une de ses créations, baptisée Soul Shift (échange d’âmes), est un film illustrant une interaction entre deux robots humanoïdes générée par une intelligence artificielle.
L’artiste prête également énormément d’attention à la représentation de ses œuvres, à leur format, à l’immersion qu’elle peut procurer au spectateur. Cette physicalité de son travail qu’elle essaie de faire passer semble pourtant à l’opposé de sa nature numérique. Mais ses œuvres sont pensées pour être diffusées dans un espace concret, et chacune d’entre elles a été réalisée en choisissant le médium à travers lequel elle serait la plus impactante. « Pour moi, si on présente des œuvres en ligne, cela doit faire sens avec l’œuvre elle-même », affirme Justine Emard. Et quant à la possibilité d’utiliser un jour les NFT pour une de ses créations, elle ne l’exclut pas.
« C’est une nouvelle façon d’acquérir des œuvres, mais aussi de s’interroger sur le monde qui nous entoure, sur le capitalisme, sur le fait de vouloir posséder. Donc si un jour je fais une œuvre en NFT, ce sera en rapport à ça », songe-t-elle. Au-delà de l’origine de l’œuvre, que ce soit un dessin réalisé sur une tablette ou une reconstitution 3D d’une statue, son travail souligne donc l’impact du moyen de diffusion sur la relation du spectateur avec elle.
De ce point de vue, la réalité virtuelle a révolutionné la conception même des créations, en offrant un nouvel espace illimité pour les artistes du monde entier. Peindre une œuvre virtuelle en trois dimensions, puis la parcourir, la traverser et l’observer sous tous les angles devient alors possible. La technologie permet aussi de jouer sur les perceptions du spectateur, de lui faire vivre des expériences toujours plus immersives. C’est le cas de « The Life », une performance de 19 minutes de l’artiste Marina Abramović, présentée en réalité mixte en 2019.
Les participants, qui avaient enfilé une paire de lunettes IRM, voyaient s’animer un véritable double numérique de la performeuse, devant les murs réels de la galerie et les autres visiteurs en toile de fond. L’évènement, d’après l’artiste, avait pour but de questionner l’immortalité, en proposant une version numérique et donc immortelle de l’artiste. « Cent ans après le moment où quiconque connaissant Marina soit décédé, il y aura des gens qui la verront entrer dans la pièce et ressentiront ce sentiment de connexion, d’expérience humaine », avait ajouté Todd Eckert, le fondateur de Tin Drum, l’équipe de production de réalité mixte derrière le projet.
Si l’immortalité de l’œuvre n’est pas assez, qu’en est-il de celle de l’artiste ? Car si la capacité à inventer, à créer, a toujours été considérée comme l’apanage de l’être humain, nous ne sommes désormais plus les seuls artistes reconnus sur la planète. En effet, un tableau produit par une intelligence artificielle a été vendu en 2018 pour la somme de 432 500 dollars. Il fait partie d’un groupe de portraits de la famille fictive Belamy créé par Obvious, un collectif parisien composé de Hugo Caselles-Dupré, Pierre Fautrel et Gauthier Vernier.

« Les 5000 premiers jours » de Beeple
Ils s’efforcent d’explorer l’interface entre l’art et l’intelligence artificielle, en apprenant à leur algorithme à repérer les différences entre les œuvres produites par les humains et les autres. S’il n’est plus capable de différencier son travail d’une création humaine, alors les créateurs considèrent le tableau comme un original. Mais si le programme arrive à imiter la créativité humaine, il est difficile de considérer qu’il y a une intention, un sens derrière cette production.
Il devient cependant clair que les frontières du monde de l’art se brouillent, que ce soit dans l’appréciation même de ce que l’on considère comme de l’art : une carte à jouer, une paire de chaussure virtuelle ou un jeton NFT, ou dans la façon que l’on a de catégoriser les différents types d’arts. Mais cela n’empêche pas le marché de l’art de gagner en popularité chaque année, et d’intéresser de nouveaux acheteurs de différents horizons. Et avec l’intérêt grandissant vient l’opportunité pour de nouveaux artistes de se lancer, et peut-être d’inventer les outils de demain pour créer ou de consommer de nouvelles formes d’art.
Couverture : GU$$I GANG de Criss Bellini
L’article Instagram et NFT : comment les artistes numériques ont réussi à percer est apparu en premier sur Ulyces.
08.03.2021 à 09:30
Clubhouse : comment devenir un géant des réseaux sociaux dans la douleur
Diffuser en direct une interview exclusive de l’homme le plus riche du monde est une bonne façon de faire parler de votre réseau social. Aussi, quand Elon Musk a annoncé qu’il participait à un live audio sur l’application Clubhouse, la nouvelle s’est propagée comme une traînée de poudre à travers les différentes strates du web. […]
L’article Clubhouse : comment devenir un géant des réseaux sociaux dans la douleur est apparu en premier sur Ulyces.
Texte intégral (2967 mots)
Diffuser en direct une interview exclusive de l’homme le plus riche du monde est une bonne façon de faire parler de votre réseau social. Aussi, quand Elon Musk a annoncé qu’il participait à un live audio sur l’application Clubhouse, la nouvelle s’est propagée comme une traînée de poudre à travers les différentes strates du web. Ce 1er février 2021, beaucoup d’entre nous n’avaient alors jamais entendu parler du nouveau réseau social audio, lancé près d’un an auparavant. En un rien de temps, la capacité maximale de 5 000 auditeurs de la « room » a été atteinte, avec des centaines de journalistes et des flux vidéos redirigés vers YouTube. Depuis ce jour, Clubhouse fait couler beaucoup d’encre et son nombre d’utilisateurs.trices croît de plus en plus rapidement.
Clubhouse n’est pas un réseau social comme les autres. Uniquement basé sur la voix, il est à la croisée d’une radio libre géante et d’une plateforme de podcasts. L’application comprend des salons (ou rooms) aux thématiques précises, créés par les utilisateurs.trices. Si la majorité des discussions tournent encore autour du monde des technologies et de l’entrepreneuriat, tout est possible. Les créateurs.trices des rooms peuvent choisir à qui ils.elles y donnent accès, d’un groupe privé à une discussion ouverte à tous.tes. Ils.elles peuvent aussi donner la parole à l’auditeur.trice de leur choix, en qualité de modérateur.trice, ces derniers.ères n’ayant qu’à « lever la main » pour participer.

Crédits : Erin Kwon
Si cette brève explication est nécessaire, c’est que la plateforme n’est pas encore en libre accès. Toujours en version bêta depuis son lancement en mars 2020, l’application n’est disponible que sur iOS. Et même pour un.e utilisateur.trice Apple, il est nécessaire d’avoir été invité.e par un membre pour intégrer la communauté. Cette fonctionnalité, mise en place pour limiter dans un premier temps le nombre de personnes sur la plateforme, offre au réseau 100 % vocal une image de club VIP. En combinant cet effet « club » et la présence de personnalités allant de Mark Zuckerberg au rappeur 21 Savage, Clubhouse est en voie de devenir un nouveau géant des réseaux.
En quelques semaines, il a décuplé son nombre d’utilisateurs.trices, dépassant récemment la barre des 10 millions de téléchargements. Pourtant, ses développeurs cherchent pour l’instant à garder un certain contrôle sur le nombre d’invitations disponibles. Car si la plateforme fait parler d’elle, ce n’est pas que pour des bonnes raisons. Plusieurs cas d’intimidation et de harcèlement de la part d’utilisateurs.trices ont déjà été rapportés dans les médias, de même que l’apparition de rooms racistes, antisémites ou misogynes. Sans compter les graves préoccupations pour la sécurité des données personnelles des utilisateurs.trices. Clubhouse saura-t-il trouver sa voix au milieu de ce brouhaha ?
Grandir dans l’adversité
Après moins d’un an d’existence, des dizaines d’affaires relevant de l’intimidation ou du harcèlement en ligne sur Clubhouse ont été rapportées. Il faut dire que l’application possède de sérieux désavantages comparée à ses concurrents. Tout d’abord, la plateforme est jeune et toujours en cours de développement, il semble donc normal qu’elle ne puisse pas proposer un service aussi complet et sécurisé que des acteurs mieux établis. Mais en proposant des contenus uniquement vocaux et en direct, il semble impossible pour les développeurs d’empêcher tous les débordements.
Le problème s’est surtout présenté dans le cadre de sujets clivants, lorsque des idéologies s’affrontent et que les débats s’échauffent. L’une des controverses les plus vocales a eu lieu suite aux propos tenus par Pascal-Emmanuel Gobry, auteur français et membre du think tank conservateur américain Ethics & Public Policy Center. « Nous ne savons même pas combien de musulmans il y a en France… Nous ne savons pas combien d’entre eux sont “islamistes”, c’est-à-dire qui soutiendraient la charia », a-t-il déclaré au cours d’une discussion sur Clubhouse. « Car si être islamiste ne signifie pas nécessairement que vous soutenez le terrorisme, il y a nécessairement un spectre, n’est-ce pas ? Le nombre de personnes problématiques est assez important. »
Suite à cette intervention, il a demandé comment faire face aux « potentiels millions » de citoyens musulmans en France qui « rejettent fondamentalement tout ce que la nation défend et veulent soit la détruire, soit la remplacer par un régime de la charia ». En réaction, un vigoureux débat s’est lancé sur le type de discours à empêcher sur la plateforme, et sur les moyens de le faire. C’est d’ailleurs un des points sur lesquels se concentrent le plus les développeurs de l’application, de leur propre aveu.
« Nous avons introduit le blocage, la mise en sourdine, la création de rapports en room et la possibilité pour les modérateurs de mettre fin à une room », écrivent-ils sur leur site. Ils disent aussi « enquêter » chaque fois que quelqu’un signale une violation des conditions d’utilisation ou du règlement de la communauté, et prendre des mesures adaptées. Mais d’après Bacely Yorobi, entrepreneur de la tech ivoirien et fréquent utilisateur de Clubhouse, le problème se trouve plutôt du côté des intervenant.e.s.
https://twitter.com/BacelyYorobi/status/1366957176930119686
Au travers de sa société ConnectX Global, il fait intervenir des talents issus de la diversité, et organise des conférences autour de l’entrepreneuriat, de l’e-commerce, de l’innovation, du codage et du design. « Prendre la parole en public et modérer une audience, ce n’est pas la même chose », explique-t-il. Cet échec dans la modération de la part d’un.e animateur.trice amateur.e est pour l’entrepreneur la cause principale des polémiques actuelles. « Quand c’est mal géré, sur des sujets très polarisés, ça part vite dans tous les sens et il n’y a plus de respect. »
Une dérive à laquelle la nature-même du réseau l’exposait fatalement. La seconde, tout aussi préoccupante, concerne précisément la sécurité des données de ses utilisateurs.trices, auxquel.le.s Clubhouse recommande instamment d’utiliser leur véritable identité. Si dans un premier temps les développeurs annonçaient qu’aucune conversation ne pouvait être enregistrée, plusieurs cas de figures ont prouvé le contraire. Tout d’abord, la plateforme enregistre maintenant une partie des discussions tenues dans chaque room afin de pouvoir, en cas de rapport, enquêter sur de potentiels actes répréhensibles et leurs auteurs. Si aucune réclamation n’est faite, l’enregistrement est supprimé dès la fermeture de la room.
Si le procédé pose des problèmes de sécurité en soi, il ne garantit en aucun cas que des utilisateurs.trices ne puissent pas enregistrer les conversations à l’insu des intervenant.e.s. « Cela m’est déjà arrivé », confie Bacely Yorobi. « Heureusement que je n’avais pas dit quelque chose de négatif. » Clubhouse n’est pour le moment pas un endroit sûr, résume l’entrepreneur ivoirien.
De nombreux.ses utilisateurs.trices ont fait part de leur inquiétude concernant la protection de leurs données personnelles. En cause, l’entreprise américaine fait appel à une start-up basée à Shanghai, appelée Agora, pour gérer une grande partie de ses opérations back-end. En effet, Clubhouse s’appuie sur la société chinoise pour traiter son trafic de données et sa production audio. Sauf que les obligations d’Agora vis-à-vis des lois chinoises sur la cybersécurité signifient qu’elle serait légalement tenue de donner accès aux fichiers audios au gouvernement chinois, s’il juge que leur contenu met potentiellement en danger la sécurité nationale.
« Une plateforme qui a une API et des serveurs gérés par une technologie chinoise ne peut pas être totalement digne de confiance », remarque Bacely Yorobi, précisant tout de même que « les développeurs sont en train de travailler pour basculer tout le système sur une technologie américaine ». Clubhouse semble donc apprendre de ses erreurs jour après jour, comme il s’est construit.
Made in Silicon Valley
« Clubhouse évolue rapidement aujourd’hui, mais à certains égards, on a l’impression que le voyage a commencé il y a longtemps. » C’est ainsi que les deux fondateurs, Paul Davison et Rohan Seth, expliquent la naissance de leur projet. Après leur rencontre en 2011, les deux Américains se sont vite retrouvés autour d’une passion commune : les produits sociaux. À l’époque, Rohan Seth travaillait sur des moyens d’aider ses amis à se retrouver dans les villes, et Paul Davison développait une application appelée Highlight, qui devait aider les utilisateurs.trices à nouer des amitiés autour d’eux. Au cours des dix années suivantes, ils ont tous deux expérimenté de nouvelles applications, échoué et recommencé. À l’automne 2019, le duo a finalement été amené à faire équipe. Après de nombreuses itérations dans l’espace audio, ils finissent par lancer Clubhouse en mars 2020, avec une nouvelle start-up : Alpha Exploration Co.
En mai, l’application comptait 1 500 utilisateurs et annonçait sa première levée de fonds, avec l’ambition de se développer. À travers leur société de capital-risque AH Capital Management, aussi appelée A16Z, les business angels Ben Horowitz et Marc Andreessen ont cru flairer le bon filon. Ils ont donc décidé d’investir une première fois la somme de 10 millions de dollars dans le projet. Au cours des mois qui ont suivi, l’application a continué de se développer et grandir. Fin janvier 2021, deux millions de personnes dans le monde avaient rejoint Clubhouse.
C’est à ce moment-là que Davison et Seth ont annoncé leur deuxième tour de table. Sous la supervision d’Andreessen Horowitz, le réseau social basé à San Francisco a réussi à lever environ 100 millions de dollars, portant sa valorisation à près d’un milliard de dollars, selon Axios. C’est à ce moment-là qu’A16Z a fait jouer ses contacts. La conversation entre Elon Musk et le PDG de Robinhood Markets Inc., Vlad Tenev, à propos de la négociation des actions de GameStop Corp, n’est pas arrivée par hasard. Car A16Z, en plus d’être un gros investisseur de Robinhood et Clubhouse, soutient des startups qui travaillent avec les entreprises de Musk.
Le réseau avait tout d’abord réussi à percer en Chine, où de nombreuses rooms sont apparues début février, permettant aux utilisateurs.trices de débattre notamment du sort des Ouïghours. Mais la politique chinoise concernant les réseaux sociaux et sites étrangers n’a pas changé, et les échanges concernant certains sujets sont toujours mis sous clé. Pékin a finalement décidé d’interdire le réseau social dans le pays, comme il l’a fait pour tous les autres réseaux occidentaux auparavant.
Malgré ce contretemps, sorte de reconnaissance pour la jeune société, les développeurs souhaitent continuer à développer leur réseau. Une part de la dernière levée de fonds sera dédiée au développement d’un programme pour les créateurs.trices de contenu de la plateforme, qui pourrait augmenter leur nombre et ouvrir le canal de revenus de Clubhouse. Cela rappelle le fonds de 200 millions de dollars lancé par TikTok pour soutenir les influenceurs.ceuses de sa plateforme, et les sommes engagées par Snapchat pour attirer les stars sur Spotlight. Car il ne faut pas oublier que si Clubhouse est le premier réseau social 100 % vocal, la concurrence dans le milieu reste rude et peu de bonnes idées ne sont jamais copiées.
La course est lancée
Les géants de l’industrie numérique n’ont pas tardé à réagir face au succès fulgurant de l’application de Paul Davison et Rohan Seth. Et notamment Facebook, qui s’est fait une spécialité du clonage de réseaux populaires ou du rachat de ses concurrents. L’année dernière, la plateforme a lancé Messenger Rooms pour concurrencer l’application vidéo Zoom pendant la pandémie de coronavirus. Instagram, propriété de Facebook, a de son côté rivalisé avec TikTok avec l’ajout des Reels. Et début février 2021, le réseau social a donc commencé à plancher sur un nouveau produit baptisé Fireside, qui doit reprendre exactement les mêmes fonctionnalités de Clubhouse. « L’histoire se répète », note Bacely Yorobi, qui a pu discuter du futur de la plateforme dans des rooms sur le réseau.
Mais l’entreprise dirigée par Mark Zuckerberg n’est pas la première à avoir dégainé. En effet, Twitter a été le plus réactif. Le 17 décembre dernier, le réseau à l’oiseau bleu annonçait le lancement de sa propre itération audio sur iOS, avec le même système de bêta fermée sur invitation. La plateforme, baptisée Spaces, a même pris de vitesse les créateurs de Clubhouse, en lançant sa version disponible sur Android depuis le 2 mars. C’est un sacré avantage quand on sait que le système d’exploitation est celui qu’utilisent 85 % des téléphones portables.

Les Spaces de Twitter
Si la course est déjà lancée entre les géants du milieu et la start-up, d’autres acteurs peuvent encore créer la surprise et venir rafler le gros lot sous le nez des concurrents. C’est l’idée qu’avance Bacely Yorobi. « C’est clair que dans cette bataille, Twitter ne gagnera pas, car il est victime de son histoire, avec énormément de trolls », prédit l’entrepreneur. « Moi, je parie sur Spotify ! On ne les voit pas mais ils arrivent. »
Il faut dire que la puissance de Spotify sur le marché de la musique et du podcast est déjà immense. Les rachats des plateformes de Gimlet Media et d’Anchor lui avaient même permis de consolider sa domination. Il ne serait donc pas étonnant de voir débarquer une fonctionnalité pour permettre des discussions. « ll suffit juste qu’ils développent une couche d’interaction et c’est terminé », conclut le conférencier ivoirien. Clubhouse a ouvert son club privé dans une arène sans merci.
Couverture : Clubhouse par Alexander Shatov
L’article Clubhouse : comment devenir un géant des réseaux sociaux dans la douleur est apparu en premier sur Ulyces.
22.02.2021 à 10:42
Le rap italien est-il génial ou nul ?
Nicolas Prouillac
Assise devant sa maison d’enfance, sur les hauteurs de la petite ville portuaire italienne de La Spezia, en Ligurie, ANNA ressemble à une adolescente comme une autre. Pourtant, la jeune rappeuse de 17 ans est la nouvelle star du rap italien. Depuis la sortie de son single « Bando » début 2020, tout s’est vite […]
L’article Le rap italien est-il génial ou nul ? est apparu en premier sur Ulyces.
Texte intégral (2092 mots)
Assise devant sa maison d’enfance, sur les hauteurs de la petite ville portuaire italienne de La Spezia, en Ligurie, ANNA ressemble à une adolescente comme une autre. Pourtant, la jeune rappeuse de 17 ans est la nouvelle star du rap italien. Depuis la sortie de son single « Bando » début 2020, tout s’est vite enchaîné. Anna Pepe a d’abord signé un contrat avec Virgin Records avant de devenir la plus jeune artiste à atteindre la première place du Hit Parade italien. Au cours des mois qui ont suivi, le morceau est devenu viral grâce à TikTok, traversant les Alpes pour conquérir l’Europe, avec un remix de JUL, et les USA, où il a été repris par le rappeur new-yorkais Rich the Kid. Dans son survêtement noir, celle qui incarne le renouveau du rap italien n’a pas l’air chamboulée outre-mesure.

ANNA
Crédits : Ulyces
Libérée des rythmes trop restrictifs des instrus à l’ancienne, la nouvelle génération d’artistes italiens a profité de l’arrivée de nouvelles influences pour rénover le genre. « Bando » en est l’exemple parfait avec son beat rap electro, signé par le producteur français Soulker. Parmi cette nouvelle vague, on trouve aussi Ernia. Avec la sortie de son dernier album, Gemini, le Mmilanais a prouvé qu’il pouvait naviguer entre différents univers musicaux sans trahir son style. Lorsqu’on lui demande ce qu’il pense du rap italien actuel, lors de notre rencontre à Milan, il répond humblement qu’ « il a commencé à atteindre un niveau intéressant ». « Il y a 10-15 ans, quand tu parlais du rap italien à un étranger, il se marrait », dit-il.
Après des années passées dans l’ombre de ses contreparties anglo-saxonnes, la scène rap italienne a pris son envol, égrainé de collabs internationales. On a notamment vu Capo Plaza apparaître aux côtés de Ninho, ou Sfera Ebbasta sur le titre « Cartine Cartier » de SCH. Le rappeur phocéen JUL a pour sa part repris le titre phare d’ANNA. « Jul a voulu faire ce remix spontanément, car le morceau lui a plu », raconte la jeune rappeuse. « J’ai beaucoup apprécié, car à Milan, on écoute beaucoup de musique française. » Car c’est notamment à Milan que s’écrit que s’écrit l’avenir international du rap italien.
Sous influences
C’est au cœur du QT8, un quartier de Milan, que nous retrouvons Ernia adossé au comptoir du Billard. Ce bar, un des derniers commerces du coin, est aussi son QG depuis des années. « J’y passe tous les jours, au moins pour acheter des cigarettes ou prendre un café », confie-t-il. Quand le rappeur parle du quartier dans lequel il a grandi, on sent l’influence qu’il a eu sur sa musique et sa carrière. « QT8 c’est un peu moi », résume le Milanais. « C’est une voie médiane, ce n’est pas un quartier périphérique dégradé ou populaire, mais ce n’est pas non plus un quartier central. »
Ses parents n’ayant jamais eu d’intérêt pour la musique, Ernia a puisé ses inspirations dans les sessions de freestyles du quartier. Au cours de ces années, il a développé d’excellentes capacités d’adaptation, qui lui permettent aujourd’hui de varier ses sons comme il le souhaite. « Le langage est toujours celui du rap, mais en passant par 1 000 sonorités, souvent en piochant dans l’indie italien », explique-t-il, assis sur une table de billard, tout vêtu de blanc. Dans son dernier album, Gemelli (jumeaux), il aborde d’ailleurs cette thématique des multiples facettes de sa personnalité, passant de la trap au sons plus « mainstream ».

Ernia à Milan
Crédits : Ulyces
L’autre révolution de la scène rap italienne a été l’arrivée de voix féminines. Sous l’influence de super stars internationales, de jeunes Italiennes talentueuses ont osé franchir le pas. Avant ANNA, il y avait Priestess. Avec trois singles diffusés sur les plateformes de streaming, puis l’EP Torno Domani en novembre 2017, la jeune femme fait des millions d’écoutes et parvient à se faire une place. Sur des instrus de trap typiquement américaine, la chanteuse parle sans tabou d’argent, de drogues ou de mecs dans un mélange de rap et de pop. « Ce que je raconte est vrai, c’est la vie d’une jeune fille de 22 ans qui est née et a grandi dans les Pouilles », confiait-elle à l’époque.
C’est sans doute l’authenticité qui fait l’attrait de cette génération. Des artistes qui assument leurs origines, leurs goûts et leurs envies, et qui ne s’interdisent rien. Capo Plaza fait pour sa part partie des nouvelles têtes du rap napolitain, chez qui l’influence de la mafia dans la région transparaît. Avec un style beaucoup plus gang, son quartier et sa ville, Salerne, sont présents dans tous ses textes. Il est sans doute, parmi les artistes cités, celui qui se rapproche le plus des sonorités qui nous sont familières dans l’Hexagone. Après un premier album, intitulé 20, qui l’a fait connaître en 2018, il a d’ailleurs d’ailleurs collaboré sur deux morceaux avec Ninho.
Et les ressemblances entre les deux artistes ne sont pas anodines. « On a grandi en ayant des rappeurs français pour idoles, et même en s’inspirant de certains rappeurs français de notre génération », avoue le Salernitain. Il semble pourtant étrange que les banlieues italiennes aient eu besoin d’autant de temps pour rattraper leur retard sur leurs pairs français ou américains.
Le bélier
À l’instar de l’Hexagone, la culture hip-hop est arrivée en Italie au début des années 1980. Et comme en France, il faudra attendre une décennie supplémentaire pour voir apparaître les premiers groupes, comme Radical Stuff, qui rappent le plus souvent en anglais. Mais c’est dans les années 1990 qu’émerge réellement une première scène italienne, avec notamment Bassi Maestro dans le nord de l’Italie et Sangue Misto dans le sud. Mais la volubilité de la langue italienne colle mal avec les mesures étroites et répétitives des beats de l’époque.
Même dans les années 2000, le rap italien passe largement inaperçu auprès du public français et international. La scène transalpine, portée par Fabri Fibra, commence à tourner en rond, avec une manière de rapper très monocorde – très « à l’ancienne » selon nos critères français.
L’autre frein majeur à son développement est dû à une particularité linguistique italienne. Si en France nous avons bien différents accents, ils n’empêchent pas la compréhension des uns ou des autres. Mais en Italie, ces différences sont bien plus importantes, formant de vrais dialectes. Par exemple pour la série italienne Gomorra, la version originale a dû être sous-titrée en italien pour faciliter la compréhension du napolitain dans tout le pays. Et le milieu du rap en particulier se recentre sur les valeurs de quartier, d’identité et d’appartenance, en faisant usage de ses dialectes. Cette barrière de la langue interne au pays n’a donc pas favorisé l’émergence d’une scène nationale.

Ernia à l’extérieur du stade de San Siro
Crédits : Ulyces
Les premiers à s’être tirés de ce guêpier sont les membres du groupe Troupe d’Elite qui, entre 2011 et 2014, ont proposé un rap alternatif rafraîchissant pour le public de la Botte. Avec son producteur Fonzi Beat, qui y a apporté des sonorités electro, les rappeurs du groupe se font rapidement un nom, avant de se séparer à la suite de désaccords. Parmi les membres, on retrouvait deux des têtes d’affiche de la nouvelle vague : Ghali et Ernia. D’abord critiqués pour leur approche, ces artistes ont rebâti le rap italien et ouvert la porte à de toutes nouvelles créations. Lorsqu’il se remémore cette époque, Ernia se rappelle avant tout de la rupture entre leur musique et ce qui se faisait avant. « Nous sommes les premiers à avoir fait de la trap en Italie », assène-t-il fièrement. « Nous avons été le bélier qui a défoncé la grande porte. »
Mais celui qui a achevé de faire basculer le genre se nomme Sfera Ebbasta. En 2015, le rappeur a percé grâce à la sortie de son projet XDVR. Avec Charlie Charles à la production, il devient vite un succès national. Ses instrumentales trap et cloud rap ont donné aux artistes leurs lettres de noblesse, les amenant à collaborer avec de nombreux autres rappeurs, en Italie comme à l’étranger. Trois ans après, les deux musiciens ont annoncé le lancement du label BillionHeadz Music Group, plateforme grâce à laquelle ils ont enchaîné les featurings, leur permettant de toucher un public plus vaste.
Car c’est là que se trouve la clé du renouveau. Grâce aux plateformes de streaming et aux réseaux, la musique se propage beaucoup plus facilement et les rappeurs italiens ont finalement pu trouver leur audience, chez eux comme à l’étranger. Pour ANNA, c’était grâce à TikTok.
Rockstars
Malgré son succès, la jeune rappeuse continue de vivre une vie d’adolescente normale. Elle vit encore chez sa mère et espère déménager à Milan quand elle sera majeure pour prendre son indépendance. Motivée à s’imposer avec sa musique, elle espère que d’autres Italiennes suivront son exemple.
« Je pense qu’il y beaucoup de jeunes filles talentueuses en Italie, mais elles ne réussissent pas à se faire une place parce qu’elles se sentent un peu écrasées par le machisme ambiance qu’il y a dans la musique italienne », confie-t-elle aux abords du port de La Spezia.

ANNA sur le port de La Spezia
Crédits : Ulyces
L’autre tendance à suivre sera l’effacement des frontières de la musique. Avec l’augmentation des collaborations internationales ces dernières années, les artistes s’influencent de plus en plus pour créer de nouvelles sonorités. Sfera Ebbasta a par exemple publié deux versions de son album Rockstar, une italienne et une internationale.
Sur ce second volet, on retrouve la participation de l’Anglais Tinie Tempah, de l’Allemand Miami Yacine, de l’Espagnol Lary Over et de l’Américain Rich the Kid. Si le contexte actuel ne se prête pas au voyage, le rap italien ne connaît désormais plus aucune frontière.
Couverture : ANNA par Ulyces
L’article Le rap italien est-il génial ou nul ? est apparu en premier sur Ulyces.
19.02.2021 à 09:37
Aux origines du funk carioca, le son des favelas brésiliennes parti à la conquête du monde
Servan Le Janne
Au-dessus d’un mur de caissons de basse, six lettres et quatre chiffres envoient une lumière vert fluo sur les danseurs d’un club de Rio de Janeiro. Il est écrit Furacão 2000. Pour faire futuriste, le collectif qui organise cette soirée en octobre 1995 a non seulement choisi de s’appeler « cyclone », mais aussi d’adjoindre […]
L’article Aux origines du funk carioca, le son des favelas brésiliennes parti à la conquête du monde est apparu en premier sur Ulyces.
Texte intégral (2169 mots)
Au-dessus d’un mur de caissons de basse, six lettres et quatre chiffres envoient une lumière vert fluo sur les danseurs d’un club de Rio de Janeiro. Il est écrit Furacão 2000. Pour faire futuriste, le collectif qui organise cette soirée en octobre 1995 a non seulement choisi de s’appeler « cyclone », mais aussi d’adjoindre à ce nom la promesse du nouveau millénaire à venir. L’ambiance est raccord. Seulement avec le changement d’ère, ce genre d’idées est depuis complètement passé de mode. Mais Furacão 2000 n’est pas ringard. Au contraire, c’est devenu un pilier essentiel de la scène funk brésilienne, aussi appelée funk carioca ou baile funk.
Ce style né en marge dans les années 1970 est devenu un monument de la culture populaire brésilienne, au point de s’exporter de mieux en mieux. À la mi-janvier 2021, la maison de disque Warner Music a annoncé qu’elle distribuerait bientôt Furacão 2000 sur le marché mondial.
Ambassadeur du genre depuis 45 ans, ce collectif devenu label est responsable de la diffusion du funk carioca à l’étranger et de la popularisation du genre dans tout le pays. Pour les médias brésiliens, ce rachat est une réussite et une fierté. Cela prouve que le funk carioca fait son trou à l’international et a encore de beaux jours devant lui, porté par des artistes de renommée mondiale comme MC Niack, Anitta ou Ludmilla. Évidemment, son destin est étroitement lié à l’histoire du collectif Furacão 2000 qui fait office de témoin de l’évolution du baile funk.
Le grand mix
Les membres de Furacão 2000 voient l’intérêt de Warner comme un adoubement. « C’est une audacieuse révolution dans le monde du funk. Il n’y aura pas un endroit sur cette planète qui ne connaisse le son du Furacão ! » s’enthousiasme Leonardo Cezareth, ancien MC du collectif et entrepreneur du funk depuis plus de 20 ans. Le quinquagénaire bedonnant est passé de la composition à la production. Il est bien placé pour savoir que cette ascension n’avait rien d’évident. « Le funk a pris des proportions que nous ne pouvions pas imaginer nous-mêmes », abonde MC Niack, qui vient de devenir une star avant d’avoir 18 ans. « C’est devenu la musique populaire brésilienne et maintenant ça s’écoute à l’étranger. » Difficile à l’époque d’imaginer le sacrement d’une musique censée représenter les favelas et les bas fonds.

MC Niack
Crédits : Ulyces
Baptisé baile funk à l’étranger d’après le nom des soirées qui ont fait sa renommée, ce genre est souvent résumé par le terme funk au Brésil. S’il renvoie à un son assez différent de celui des Isley Brothers ou de Parliament, c’est pourtant bien en remixant des classiques funk que des DJ brésiliens lui ont donné naissance. Le baile funk est inspiré par la Miami bass, un hip-hop électronique né à Miami fait de nombreux breaks, ces instants où seul le beat subsiste, provoquant une irrépressible envie de bouger à son rythme.
Au milieu des années 1970, la Floride est la destination privilégiée des DJ de Rio pour faire le plein de disques américains, si bien que lorsque la Miami Bass arrive à leurs oreilles, ils se l’approprient immédiatement. À l’instar de la samba, qui s’est nourrie autant de rythmes africains que de valses et de tango, le funk brésilien réinterprète la Miami bass en y incorporant de la soul, de la samba et une multitude de styles existants. Le résultat mélange des samples de funk, de soul ou d’electro pop, le tout avec un tempo très relevé.
Trouvant un écho particulier dans les favelas de Rio au milieu des années 1970, la funk carioca reste snobée par les classes sociales supérieures. Elle reflète alors le quotidien de nombreux jeunes brésilien.ne.s et on y parle d’injustice sociale, de sexe, de la fierté d’être noir.e et de discriminations. C’est à ce moment-là, à la fin des années 1970, que se forme le collectif Furacão 2000. Des figures commencent également à émerger doucement telles que DJ Marlboro, considéré aujourd’hui comme le parrain du baile funk. Il a été un des premiers à l’exporter en Europe en signant sur le label allemand Man Recordings en 2004.

Mais la popularité du funk carioca explose véritablement dans tout le Brésil en 1982 avec la sortie du morceau « Planet Rock », du groupe new-yorkais Afrika Bambaataa. Parce que son style est proche des rythmes entendus dans les soirées de Furacão 2000, le titre provoque un engouement nouveau autour du funk au Brésil. La sortie pousse de nouveaux artistes à investir le funk carioca.
Les basses lourdes et le beat électro minimaliste inspirent les DJ partout au Brésil et le virus passe d’une fête à l’autre. Souvent criminalisées par le pouvoir en place, les bailes prennent cependant une place majeure dans la vie nocturne des favelas, place qu’elles occupent encore aujourd’hui. La répression existe d’ailleurs toujours puisque le président Jair Bolsonaro essaye encore à l’heure actuelle de fermer les clubs où se tiennent ces sulfureuses fêtes baile funk.
Des breaks et des balles
Le collectif Furacão 2000 naît de la fusion entre deux collectifs existants : Som 2000 dirigé par Romulo Costa, plutôt orienté soul, et Guarani 2000, avec Gilberto Guarani à sa tête, spécialiste du funk traditionnel. Leurs performances au début des années 1980 ne laissent personne indifférent et commencent à ameuter de plus en plus d’artistes autour d’eux. « Furacão 2000 est une usine à découvrir des talents, le funk prend les gens ordinaires et les encourage à enregistrer, à parler de la vie quotidienne de la communauté », raconte le quinquagénaire Romulo Costa, à la tête du label depuis la fusion et désormais père d’une petite fille. Certains noms se distinguent comme MC Marcinho ou le groupe Força do Rap. Le collectif se développe en même temps que le baile funk. Pour Romulo, « l’histoire de Furacão 2000 est l’histoire du funk ».
Dans les années 1990, un événement marque durablement le funk carioca. À Rio, certaines favelas côtoient les zones huppées de la ville, ce qui amène parfois à des tensions qui dégénèrent en conflits. En 1992, alors que des centaines de jeunes brésilien.ne.s en colère et désemparé.e.s de devoir supporter ces conditions de vie quittent leurs favelas et se réunissent pour une baile improvisée sur la plage d’Arpoador, la situation dégénère. Effrayée par les danses qui deviennent de plus en plus frénétiques, la police intervient brutalement et souffle sur les braises de la violence. Une émeute éclate alors et les images des jeunes déchaîné.e.s font le tour du pays.
Ces émeutes sont alors mises sur le dos de l’ensemble des funkeiros, le nom donné aux adeptes des baile funk. Le gouvernement accuse ces soirées d’encourager la violence et la dissidence et les interdit tout simplement. Désormais illégales, les bailes doivent s’organiser dans la clandestinité. Elles deviennent alors véritablement le symbole des favelas.

Crédits : Furacão 2000
À la manière du gangsta rap, un sous-genre appelé proibidão célèbre le mode de vie des gangs, en parlant de trafic de drogue ou d’armes. Certaines bailes se finissent en échanges de tirs et font couler le sang, encourageant en retour une répression toujours plus forte du gouvernement. Les artistes de Furacão 2000 restent pour leur part sur la ligne des années 1980 et prônent le calme au nom de l’amour de la musique. Ils se structurent en label, qui devient peu à peu la principale maison de disque du funk brésilien.
Cette période sombre pour le funk carioca durera jusqu’en 2000, date à laquelle une loi est votée obligeant les gérant.e.s des clubs à installer des détecteurs de métaux à l’entrée de leur établissement, et à poster des membres de la police militaire à leurs portes s’ils.elles veulent pouvoir à nouveau organiser des bailes. Ils.elles doivent également obtenir une autorisation gouvernementale écrite et les artistes dont la musique est jugée « criminelle » en sont bannis. La carioca est contrainte de se lisser, de faire moins de vagues, pour survivre. Elle devient moins violente dans ses propos avec, dans les années 2000, une focalisation sur l’amour.
Ces chansons d’amour, souvent accompagnées de connotations sexuelles, mettent de côté les difficultés des favelas et installent la vision des baile funk comme d’un rassemblement social pour sortir, flirter et rencontrer des amis. Le groupe Bonde do Tigrão, du label Furacão 2000, incarne parfaitement cette tendance. Le quatuor originaire du quartier paulista de la Cité de Dieu rencontre un gros succès dans tout le pays avec son premier album. Il est disque de platine en 2001 avec 250 000 albums vendus au Brésil.
Pour Furacão, cette décennie voit également l’émergence des femmes MC telles que MC Sabrina ou Gaiola das Popozudas. Ce groupe de danseuses dont le nom signifie littéralement la cage aux folles prône une féminité libérée tant au niveau social que sexuel, avec des thèmes récurrents que l’on retrouve notamment dans les titres : « C’est moi qui paie le motel », « Je vais cocufier ton mari » ou « Les amoureux contre les fidèles ». Le succès de ces piliers du néo-féminisme dans le funk brésilien est tel qu’elles apparaissent en 2005 sur une mixtape du DJ américain Diplo.

MC Niack
Crédits : Ulyces
Non seulement le genre s’exporte mais il se diversifie. Au sein du funk carioca, différents mouvements se développent. « C’est difficile à expliquer même à un Brésilien », rigole MC Niack. « Il y a le mandelão, le brega funk, le 150… Mon truc c’est plutôt le mandelão, qui a un beat plus lourd, un peu comme dans le dubstep. »
Signée chez Furacão 2000 depuis 2010, Anitta (ou MC Anitta) est l’une des ambassadrices du funk carioca dans le monde. En 2017, elle a atteint les 200 millions de vues sur Youtube pour son tube « Vai Malandra » en featuring avec l’américain Maejor Al. Elle incarne la continuité et l’héritage d’un label vieux de 45 ans et fait sans doute partie des raisons ayant poussé Warner Music à intégrer Furacão 2000 à son roster d’artistes. De quoi continuer à insuffler un renouveau à la scène funk carioca et à lui assurer un avenir radieux.
Couverture : MC Niack, par Ulyces
L’article Aux origines du funk carioca, le son des favelas brésiliennes parti à la conquête du monde est apparu en premier sur Ulyces.
18.02.2021 à 11:01
Ital : à la découverte du régime végane précurseur des rastas
Servan Le Janne
Au cœur du XXe arrondissement de Paris, dans la rue des Petites-Écuries, la devanture de Jah Jah By Le Tricycle arbore les couleurs du pays des rastas : rouge, or et vert. Derrière la vitrine, de grands bacs de lentilles corail, de riz, de noix de cajou, de pois chiches et d’épices sont étagés. Il […]
L’article Ital : à la découverte du régime végane précurseur des rastas est apparu en premier sur Ulyces.
Texte intégral (2769 mots)
Au cœur du XXe arrondissement de Paris, dans la rue des Petites-Écuries, la devanture de Jah Jah By Le Tricycle arbore les couleurs du pays des rastas : rouge, or et vert. Derrière la vitrine, de grands bacs de lentilles corail, de riz, de noix de cajou, de pois chiches et d’épices sont étagés. Il n’y a pas un dreadlock dans la longue file de clients qui patiente à l’entrée de cette cantine aux influences jamaïcaines. Seul Daqui, le maître des lieux, a le look rasta, contrebalancé par sa doudoune orange, qui se fond bien dans le quartier.
Il faut dire qu’en cette journée de février, un froid peu caribéen règne. Ce climat hostile n’a pas suffi à décourager les habitué.e.s, venu.e.s chercher coûte que coûte leurs wings de chou fleur ou leur bowl vegane. Bien loin de la terre rasta et de ses bars de plage en bois, Daqui Gomis et Coralie Jouhier ont relevé le défi de réimplanter l’esprit « ital » dans ce petit local en plein cœur de la capitale. Il est de Guinée-Bissau, elle de Guadeloupe, mais ici c’est bien à la Jamaïque qu’ils ont voulu « faire un clin d’œil ». Et le clin d’œil est appuyé : un banc rouge, jaune et vert, des tables colorées, des peintures locales et des portraits de Bob Marley décorent l’endroit. Mais le plus important, ce sont les saveurs et la philosophie importées de la célèbre île.

Crédits : Ulyces
La diète ital est loin d’être la composante de la culture rastafari la plus connue. Elle y tient pourtant une place centrale. Il s’agit, pour le dire vite, d’une alimentation naturelle, locale, bio, sans viande, sans additifs, et pour les puristes sans produits laitiers. Les amateurs de reggae attentifs savent l’importance de la cuisine sur l’île. « J’adore chanter depuis toujours », nous confie par exemple le chanteur Tarrus Riley, membre du mouvement rastafari. « Je chante tout le temps quand je cuisine. »
Quand ce fils du légendaire Jimmy Riley sortait son deuxième album, en 2006, Jah Sun fredonnait « no bones no blood inna we kitchen », ou Macka B faisait l’éloge du véganisme dans « Wha me eat ». C’était avant que la mode vegane ne s’empare des grandes villes du monde entier. Car chez les rastas, le « plant-based », le « made with love » et le « 100% organic » régnaient déjà sur les fourneaux il y a 60 ans.
Ital is vital
Le terme ital (ou I-tal) provient du mot anglais « vital ». Avec cette alimentation dite naturelle, le rasta entend faire progresser sa « livity », cette énergie de vie partagée qui existe selon la croyance rasta en chaque être humain. La livity augmenterait ou diminuerait en fonction de ce que l’on introduit dans son corps.
Apparu dans les années 1930, le rastafarisme est né sous l’impulsion de Leonard Percival Howell – une figure du mouvement que l’histoire a occultée par la suite. Parti très jeune de chez lui, ce Noir jamaïcain navigue sur les mers du monde entier en tant que cuisinier pendant huit ans, avant de s’installer à New York. Il y fonde un café à Harlem, peut-être un des quelque 500 points de vente de marijuana que la police américaine traque à l’époque, selon Hélène Lee, autrice de l’ouvrage Le Premier rasta. Il fréquente un compatriote en la personne du militant Marcus Garvey. Ces accointances ne le laissent pas indemne. L’idée d’un retour du Messie en la personne du roi éthiopien Hailé Sélassié (le ras Tafari Makonnen) fait son chemin, et Howell s’en empare.
Dès son retour forcé en Jamaïque en 1932, il vend des photos de celui qu’il présente comme Dieu, et développe une pensée imprégnée de marxisme, de lutte pour la décolonisation et de mysticisme. En 1939, il crée la communauté de Pinnacle qui regroupe des afrodescendant.e.s et se consacre à la culture de l’herbe sacrée, la marijuana. Également proche des pauvres travailleurs.euses indien.ne.s venu.e.s prendre la place des esclaves noir.e.s, affranchi.e.s deux générations plus tôt, Howell s’en serait inspiré dans sa décision de proscrire la viande de la religion rastafari. Le mouvement s’appuie par ailleurs sur certains passages de la Bible pour justifier cette exigence alimentaire, comme ces deux versets de la Genèse :
« Dieu ajouta : “Or, je vous accorde tout herbage portant graine, sur toute la face de la terre, et tout arbre portant des fruits qui deviendront arbres par le développement du germe. Ils serviront à votre nourriture.”
“Et aux animaux sauvages, à tous les oiseaux du ciel, à tout ce qui se meut sur la terre et possède un principe de vie, j’assigne toute verdure végétale pour nourriture.” Et il en fut ainsi. »

Tarrus Riley
Crédits : Ulyces
Dans un premier temps, les rastafaris se contentent donc de ne pas consommer d’animaux. Ce ne serait qu’à partir des années 1960, au moment de l’indépendance, qu’aurait émergé la philosophie ital. À cette époque, la communauté rasta est en conflit avec le gouvernement britannique. À la suite de plusieurs incidents, le Premier ministre jamaïcain Alexander Bustamante ordonne à la police et à l’armée de lui ramener tous les rastas, qu’ils soient vivants ou morts.
Beaucoup s’enfuient alors des villes pour se réfugier à la campagne. C’est dans cet exil forcé, où les merveilles ultra-transformées des supermarchés sont hors de portée, qu’ils auraient découvert les vertus de ce régime crudivore, sans alcool, cuisiné avec des ustensiles en bois uniquement. Aujourd’hui, l’idée selon laquelle la nourriture doit être le principal médicament demeure ancrée dans la mentalité rasta.
Pas de sel, pas de sucre
Les principaux ingrédients que l’on retrouve souvent dans les plats ital sont sans surprise des denrées accessibles dans les Caraïbes comme le riz, les haricots rouges, les bananes plantains et les noix de coco. Mais pour Troy Levy, chef jamaïcain au visage rond et rieur, toutes les subtilités de ce régime tiennent dans les herbes et les épices, abondantes en Jamaïque : ail, coriandre, gingembre, piments… Autant de ressources précieuses qu’il faut manier à la perfection.
Dans les recettes qu’il sert, ce traiteur tâche de respecter les principes ital à la lettre : pas de sel, pas de sucre, pas de viande, pas de poisson, pas d’aliments transformés et pas même de produits d’origine animale. Le résultat n’en est pas pour autant austère. Troy propose des tacos véganes, un bowl ital, de la polenta à la noix de coco, des boulettes de champignons ou encore du riz frit au chou fleur.
Cuisiner sans additif exige de manier à la perfection les épices, les herbes, et de savoir tirer partie des saveurs que contient chaque ingrédient. « Les deux principaux condiments que les rastas doivent éviter dans leur cuisine sont le sel et le sucre », insiste Troy Levy. « Un plat cuisiné avec du lait de coco naturel sera déjà sucré. Si on utilise bien les différentes épices et les différentes herbes, on n’a ni besoin de sel, ni besoin de sucre. Aucun additif n’est nécessaire. »

Troy Lévy prépare des boulettes aux champignons.
Crédits : Troy Lévy
Chez ce rasta convaincu originaire de la ville de Glengoffe, au nord de la capitale Kingston, la cuisine est une histoire de famille. Tout jeune, il aidait sa mère aux fourneaux. « Mon premier souvenir en cuisine, c’était à huit ans, ma mère avait une grippe. Depuis son lit, elle m’a guidé pour préparer le traditionnel dîner du dimanche : du riz avec des haricots rouges et des légumes cuits dans du lait de coco. Personne n’a voulu croire que j’avais cuisiné ! »
Troy Lévy a ensuite continué son apprentissage dans le restaurant de son beau-père. Mais les saveurs ital, il les tient surtout de son oncle rasta : « J’ai une double culture, ma grand-mère était chrétienne, mais depuis tout petit je mangeais ital chez mon oncle. Encore aujourd’hui c’est lui qui m’inspire le plus : dès que je retourne en Jamaïque, je découvre de nouvelles saveurs. » Sa spécialité ? Le coconut rundown, « un plat de légumes mijotés dans du lait de coco » qu’il dit pouvoir manger indéfiniment.
Tout est bio et Troy Levy tente de recourir à des produits locaux, de connaître leurs producteurs et l’origine de chaque aliment. À ses yeux, « le plus important est d’être conscient de ce que l’on met dans son corps. Non seulement pour être en bonne santé et vivre plus longtemps, mais aussi car c’est en mettant en soi des aliments propres que l’on est propres à l’intérieur, que nos pensées sont plus positives. » Cela implique de cuisiner « avec amour » et pourquoi pas en écoutant Bob Marley ou Garnett Silk Chronixx, ajoute-t-il en souriant.
Les nuances d’ital
À l’instar du rastafarisme qui comporte de nombreux courants, l’ital fait l’objet de différentes interprétations. Toutes les communautés n’observent donc pas les mêmes règles en la matière. Parmi les rasta, les Nyahbinghi et Bobo Ashanti adhèrent à la nourriture ital, tandis que la troisième grande communauté, les « Douze tribus d’Israël », ne lui reconnaissent aucune légitimité. Tous ceux qui revendiquent le fait de consommer ital ne s’imposent d’ailleurs pas un régime sans animaux. Certains tolèrent le poisson, d’autres les produits laitiers ou les œufs. Troy Lévy, lui, est un puriste. « Beaucoup de gens portent des dreads et se disent “rastas”, mais ils sélectionnent ce qui les arrange ». Daqui quant à lui ne partage pas le même point de vue. « Il y a plein de façons de manger ital, les règles ne sont pas figées », estime le trentenaire à la tête du Jah Jah By Le Tricycle. « Certains mangent même du poisson. L’essentiel, c’est d’avoir une nourriture naturelle. »
Au menu du Jah Jah By Le Tricycle, les plats sont tous végétaliens. Sur les produits d’origine animale, Daqui et Coralie ne transigent jamais. Il n’y a pas même une trace de miel dans leurs recettes. « Manger de la viande, déjà, c’est avaler une énergie de mort », assurent-ils. « Notre organisme n’est pas adapté : les vrais carnivores ont un intestin beaucoup plus court, apte à la digérer. Et des dents carnassières. » En revanche, le restaurant n’hésite pas à servir de la bière jamaïcaine, et à mettre du sel ou du sucre dans les plats.

Kingston
Crédits : Ulyces
Quand on cuisine ital en France, il faut faire des concessions, considèrent-ils. « On s’adapte à notre environnement. Le sel, c’est aussi une question d’éducation du palais, et de qualité des produits. En Jamaïque, il n’y en a pas besoin, les légumes et les fruits ont tellement de goût ! Le soleil fait tout. » Avec Jah Jah, le couple espère faire connaître la cuisine ital et montrer les vertus du véganisme. « De plus en plus de personnes s’aperçoivent qu’il y a plus de méfaits que de bienfaits à consommer des animaux », se réjouissent-ils.
Leur cantine prouve par ailleurs que l’alimentation ital est davantage un ensemble de principes à faire régner en cuisine qu’une liste de recettes figées. Ici, les inspirations proviennent du monde entier. Un client peut commander du mafé, des plats d’inspiration japonaise, des dahl de lentilles, mais aussi un hot dog ou un burger vegan.
Pour Troy aussi, la tendance ital a beaucoup à apporter. À ses yeux, il ne fait d’ailleurs aucun doute que la « mode » du véganisme tire toute son inspiration de la Jamaïque. « Mon oncle rasta voyageait énormément quand il était jeune. J’ai vu ses nombreux amis européens et américains venir visiter la Jamaïque. Ils apprenaient auprès de lui à cuisiner ital et je suis sûr que nous sommes à l’origine de son expansion. Ils ont juste remplacé le mot ital par végane, mais c’est la racine de tout ça. » Le chef jamaïcain en tire d’ailleurs parti, et entend prêcher la bonne parole dans le monde entier. Après avoir lancé sa chaîne YouTube « Taste of ital », il s’est lancé dans les ateliers aux quatre coins des États-Unis, avec pour objectif de présenter sa gastronomie aux restaurateurs intéressés. « Je compte faire un atelier en France dès que la situation le permettra ».
Il sera d’autant mieux reçu que la diète ital pourrait offrir une réponse aux défis alimentaires planétaires, déclinable à l’envi selon les cultures et les plantations de chaque région du monde. Après la vague reggae des années 1970 et 1980, la culture rasta semble prête à déferler une nouvelle fois sur le monde.
Couverture : Troy Levy, par Ulyces
L’article Ital : à la découverte du régime végane précurseur des rastas est apparu en premier sur Ulyces.
17.02.2021 à 09:28
Petite histoire du jeu vidéo dans le bloc communiste
Servan Le Janne
Une nuit de juin 1984, Alekseï Pajitnov, ingénieur et mathématicien de l’Académie des sciences de Moscou, perfectionne le programme sur lequel il travaille depuis plusieurs semaines. Passionné de puzzles et de jeux vidéo, Pajitnov profite de son temps libre pour mettre au point des jeux sur son ordinateur. Cette nuit-là, alors que les reflets cathodiques […]
L’article Petite histoire du jeu vidéo dans le bloc communiste est apparu en premier sur Ulyces.
Texte intégral (2729 mots)
Une nuit de juin 1984, Alekseï Pajitnov, ingénieur et mathématicien de l’Académie des sciences de Moscou, perfectionne le programme sur lequel il travaille depuis plusieurs semaines. Passionné de puzzles et de jeux vidéo, Pajitnov profite de son temps libre pour mettre au point des jeux sur son ordinateur. Cette nuit-là, alors que les reflets cathodiques strient sa barbe fournie, toutes les pièces de son puzzle semblent enfin s’assembler. C’est un succès personnel. Il est alors loin de se douter que sa future création deviendra l’un des jeux les plus iconiques de l’histoire du jeu vidéo.
Contraction du chiffre grec « Tetra » et du sport préféré de son créateur, le tennis, Tetris est en train de voir le jour. Après avoir rencontré un franc succès à Moscou et bientôt dans toute la Russie, le jeu attire l’attention d’un investisseur britannique, qui contacte Pajitnov. Le professeur ne ferme pas la porte à une distribution européenne de son invention mais ne donne pas explicitement son accord. Cela n’empêche pas l’éditeur de jeux vidéo Spectrum HoloByte de commercialiser en 1987 sa propre version baptisée Tetris : The Soviet Challenge, agrémentée d’un packaging folklorique aux couleurs du communisme.
On connaît la suite et le succès de Tetris, dont le thème musical reprend le chant pré-révolutionnaire russe « Korobeïniki », qui accélère jusqu’à un rythme effréné à mesure que la partie avance. Après avoir délégué sa distribution en 1989 à Nintendo, Pajitnov a récupéré les droits de son œuvre en 1996 avec la création de The Tetris Company, s’assurant une retraite pour le moins confortable. Le troisième jeu le plus vendu de l’histoire est né de l’autre côté du rideau de fer.
Tandis que le Japon et les États-Unis se sont positionnés comme les acteurs majeurs de l’industrie, le bloc communiste n’est pas resté les bras croisés. Il a au contraire empilé les inventions révolutionnaires comme des blocs de Tetris.
Indiana Jones à Prague
Au début des années 1970, Moscou jette un œil intéressé sur les constructeurs mondiaux de flippers et leurs nouvelles bornes d’arcade. Après les avoir invités au salon Attraction-71, le pouvoir lance la production de ces machines en 1974. On les trouve dans les cinémas et parcs de loisirs russes, où les enfants viennent jouer à Morskoï Boï, un jeu de bataille navale, ou à Konek Gorbunok, l’adaptation d’un film d’animation soviétique sorti en 1947. Ces bornes n’étaient cependant pas monnaie courante partout en URSS et le jeu vidéo restait une denrée rare.
Plus à l’ouest, la situation n’est pas meilleure. En Tchécoslovaquie, État satellite de l’Union soviétique qui a donné naissance à la République tchèque et à la Slovaquie, le jeu vidéo a d’abord été un média très underground. « J’ai commencé à m’intéresser à la programmation au tout début des années 1980 », se souvient František Fuka, un des pionniers à Prague. « À cette époque, si vous vouliez jouer à des jeux vidéo sur votre ordinateur, vous deviez les programmer vous-même. » Dans les années 1980, Fuka est adolescent et tout jeune développeur. Il a gardé de cette époque une douce folie dans les yeux, encadrés par de petites lunettes rectangulaires.

František Fuka
Crédits : Ulyces
Quand il ne déambule pas dans les rues de la capitale tchèque avec ses deux petits chiens, le quadragénaire passe encore son temps à concevoir des jeux. Fuka a fait partie des premiers concepteurs de jeux vidéo tchèques, à une époque où les copies s’échangeaient sous le manteau. « Au début, je travaillais avec des calculatrices programmables et je programmais aussi sur le papier sans ordinateur. Tous les jeux de l’époque n’étaient distribués que de la main à la main. Mes amis et moi faisions une copie sur mon magnétophone et ils en faisaient une copie à leurs amis, etc. »
Sa vocation de développeur lui vient du cinéma. « J’allais voir pratiquement tous les films qui sortaient en Tchécoslovaquie, mais ce n’était pas des films hollywoodiens », précise-t-il. « Le fait que les films soient de purs divertissements n’était pas quelque chose que le régime communiste appréciait particulièrement. » Frustré par le filtrage culturel du régime communiste, František s’est ainsi mis à la programmation pour contrer cette propagande et créer ses propres divertissements.
D’abord rudimentaires, ses jeux se complexifient au fil du temps, et la réputation de développeur de Fuka commence à grandir dans son pays. « Avant d’avoir un ZX Spectrum, j’ai eu un ordinateur Victor et pendant deux ans je pense que j’ai dû faire 200 jeux dessus. Bien sûr, l’ordinateur était très limité : j’ai dû faire un simulateur de vol sans graphismes, il montrait juste les coordonnées sur la carte, la vitesse et l’altitude. » Il devient alors connu pour ses jeux textuels, dont trois jeux Indiana Jones, rare film « capitaliste » qu’il avait pu voir au cinéma et dont il a dû imaginer la suite, les opus suivants n’ayant pas été distribués dans les salles tchèques. À la manière d’un livre dont vous êtes le héros, le joueur doit prendre des décisions et résoudre des énigmes pour progresser dans le jeu, fait uniquement de texte.

Prague
Crédits : Ulyces
Avec la chute du rideau de fer en 1989, il devient plus facile de se procurer des ordinateurs ou des consoles de jeu légalement et toute une génération découvre alors les jeux japonais et américains. Pour rester dans la course, le bloc de l’Est sort en 1991 la console Alf, réponse communiste à la NES de Nintendo, produite dans une usine d’État Biélorusse. On peut alors y jouer à des styles de jeux classiques de l’époque, des jeux de plateforme ou de tir en 2D, des copies de jeux NES à succès comme Super Mario Bros ou Air Fortress. L’éclatement de l’URSS quelques mois plus tard a cependant raison de sa distribution et la console Alf est maintenant parmi les consoles de jeu les plus rares au monde.
Mais le poids de l’idéologie communiste sur les jeux vidéos n’a pas complètement disparu. Elle continue à se faire sentir à l’autre bout du globe.
Cuba libre
À Cuba, l’isolationnisme du régime légué par le bloc communiste, la pauvreté de la population et le retard technologique n’ont jamais laissé place à la création d’un jeu vidéo indépendant. Mais c’est en train de changer.
Josuhe Pagliery est sur le point de lancer le premier jeu vidéo indépendant de l’île. Le développeur en chef de Empty Head Games a transformé son appartement de La Havane en studio de développement. Son espace de travail, à lui et à son associé, David Darias, comprend en tout et pour tout deux ordinateurs. C’est là qu’ils ont inventé Saviorless, un jeu qui met en scène deux personnages qui doivent s’échapper d’une terre inhospitalière et inconnue dans un univers onirique et intriguant, à la direction artistique soignée.
Arborant un t-shirt aux couleurs de son jeu, il revient sur la frustration avec laquelle il a dû composer de n’avoir qu’un accès très limité à son hobby préféré. « Il y avait quelques jeux vidéo cubains dans des universités du pays, mais c’était des clones de jeux existants », raconte-t-il perché sur la terrasse ensoleillée de son appartement, depuis laquelle on aperçoit les toits de tuiles rouges et les palmiers mus par le vent. « On parle des années 1990, époque à laquelle il y avait une vraie barrière technologique, tout était illégal, y compris avoir un ordinateur personnel. Se créait une sorte de contact social entre les personnes qui avaient des jeux vidéo, on échangeait des CD, nos amis qui n’avaient pas de consoles venaient à la maison les weekends. »

Josuhe Pagliery et David Darias
Crédits : Ulyces
Avec le rapprochement entre Cuba et les États-Unis en 2016, à la suite de la visite d’Obama sur l’île, une ouverture a été esquissée. Des entrepreneurs américains se sont alors intéressés à la créativité des jeunes Cubains. C’est grâce à ces rencontres inédites que Josuhe Pagliery a trouvé des moyens pour développer son jeu. Saviorless, détaille cet homme par ailleurs artiste et réalisateur, « prend beaucoup d’éléments de la réalité de Cuba. Il y a quelque chose avec les couleurs, les ruines et le ton mélancolique en général, qui transpire le pays. Je crois que dans cette vision personnelle je reflète un peu l’environnement qui nous entoure ici. »
Le jeune homme est parti d’une feuille blanche. À Cuba, personne n’était capable de lui donner des références ou de lui expliquer comment procéder pour tel ou tel élément technique. Mais il a mis toute sa passion dans le projet et a fini par donner vie à son fantasme. L’action de Saviorless se déroule dans un monde apocalyptique. Orpheline d’un Grand Dieu devenu soudain mutique, cette réalité alternative tombe en ruine, en sorte que ses adeptes perdent la foi. Ils se rendent compte qu’ils vivent dans un jeu vidéo défaillant.
Obligée de retravailler le jeu en profondeur à mi-parcours pour des questions de copyright, l’équipe attend désormais un financement qui lui permettra de finaliser le développement d’ici un an ou deux. En attendant, elle a lancé une démo en novembre 2020.
Le Tamagotchi anticapitaliste
L’héritage de l’idéologie communiste ne laisse pas que des pesanteurs dans le monde du jeu vidéo. À Pittsburgh, en Pennsylvanie, un programmeur italien « de tradition post-marxiste italienne » propose une vision critique du capitalisme aux joueurs. Parti aux États-Unis pour y finir ses études, Paolo Pedercini a fondé le site Molleindustria puis la galerie Like Like, une sorte de Mecque du jeu vidéo artistique, politique et indépendant.
« Likelike s’est lancé il y a quelques années avec le but de remplir le vide que certains jeux, dont les miens, occupent : à mi-chemin entre l’art et le divertissement populaire », explique l’homme aux airs d’adolescent. Avec ses jeux souvent gratuits, Paolo s’attaque à des sujets aussi divers que la consommation de masse, l’exploitation et la disparition des ressources naturelles ou le fonctionnement des appareils de pouvoir.
Son McDonald’s Game est ainsi une parodie de jeu de gestion, un genre traditionnellement ancré dans le productivisme et le capitalisme décomplexé, dans lequel le joueur prend la tête de McDonald’s et doit faire prospérer la chaîne en optimisant au maximum tous ses aspects. « On y apprend qu’il y a de nombreuses manières d’arrondir les angles, de réduire les coûts. On découvre toutes ces stratégies, parfois immorales, qui peuvent comprendre la déforestation, la délocalisation de tribus indigènes, etc. » explique son créateur.

Paolo Pedercini
Crédits : Ulyces
Par la satire et l’exagération, Paolo cherche à faire prendre conscience à son joueur des dérives du géant du fast food et s’attaque à toute l’industrie agro-alimentaire de masse. « J’ai compris que le jeu vidéo pouvait mettre le joueur dans une position de pouvoir, de connaissance et je me suis dit que, grâce à cette vue globale et systémique que peut donner le jeu vidéo, il était possible d’expliquer le processus de mondialisation d’une façon intéressante. »
Son premier jeu, Every Day the Same Dream, développé à l’occasion d’un référendum abolissant certaines protections sociales des travailleurs, marquait déjà sa volonté de porter un message politique. Avec cette sorte de Tamagotchi revisité, le joueur doit s’occuper d’un ouvrier et contrôler quand il doit manger, dormir, travailler ou se divertir. Une façon de dénoncer la mainmise des employeurs sur certains travailleurs précaires. « Je ne pense pas que les jeux puissent changer les esprits », admet-il toutefois. « Je pense que les jeux deviennent une partie de ce que tu absorbes et même s’ils ne changent pas ta façon de penser ils peuvent renforcer des stéréotypes et induire ce qui est normal et possible. »
Si à Prague, František Fuka a un peu participé à ouvrir le pays grâce à ses jeux dans les années 1980 et 1990, Joshue Pagliery semble désormais emprunter cette voie à Cuba. « Faire un jeu vidéo indépendant est compliqué dans n’importe quelle partie du monde, indépendamment de l’endroit, mais on sent qu’on arrive à un produit pertinent pour notre pays et aussi personnellement. », s’enthousiasme le développeur de Saviorless. « Malgré tout le temps passé je crois que la qualité, l’amour, le détail que l’on a mis dans chaque petite chose du jeu est vraiment palpable pour n’importe quelle personne qui le voit et y joue. » Quelque part, c’est donc que les joueurs seront égaux.
Couverture : František Fuka/Ulyces
L’article Petite histoire du jeu vidéo dans le bloc communiste est apparu en premier sur Ulyces.
15.02.2021 à 09:06
Islande : comment les Vikings sont devenus le peuple le plus tolérant du monde
Nicolas Prouillac
Un soleil timide se lève sur la ferme d’Eystra Geldingaholt et ses pâturages à perte de vue. L’hiver approche à Skeiða, région rurale du sud de l’Islande, et des rayons dorés percent le couvercle gris du ciel, qui recouvre les plaines sauvages bordées de montagnes. Dans la grange en tôle éclairée au néon, Pálína Axelsdóttir […]
L’article Islande : comment les Vikings sont devenus le peuple le plus tolérant du monde est apparu en premier sur Ulyces.
Texte intégral (2841 mots)
Un soleil timide se lève sur la ferme d’Eystra Geldingaholt et ses pâturages à perte de vue. L’hiver approche à Skeiða, région rurale du sud de l’Islande, et des rayons dorés percent le couvercle gris du ciel, qui recouvre les plaines sauvages bordées de montagnes. Dans la grange en tôle éclairée au néon, Pálína Axelsdóttir Njarðvík transporte de grands ballots de foin qu’elle disperse pour nourrir plusieurs centaines de moutons islandais. Au milieu des champs couleur blé, la femme de 29 ans immortalise les jeunes brebis de son troupeau, pour poster leurs portraits sur son compte Instagram @farmlifeisland qu’elle a créé en 2015. Elle y raconte son quotidien au sein de la ferme familiale, dans une exploitation agricole isolée du monde aux paysages époustouflants.

Crédits : Ulyces
Ces scènes passionnent les 57 000 abonnés de Palina, dont la réputation dépasse les frontières de l’île. Le tableau est idyllique. Mais le 31 août 2020, la jeune femme poste une photo d’elle embrassant sa compagne, Maria, à l’occasion du deuxième anniversaire de leur relation, révélant incidemment son homosexualité. Aussitôt, son nombre d’abonnés chute, signe que le cliché ne plaît pas à tout le monde. Elle fait pour la première fois face à l’homophobie « Je n’ai jamais rencontré quelqu’un d’homophobe – pas en Islande en tout cas », explique-t-elle stupéfaite.
Il faut dire que ce pays de 350 000 habitants peut facilement apparaître comme un modèle de tolérance. Chaque année, près d’un tiers de la population participe à la Gay Pride. L’événement a même lieu deux fois par an à Reykjavik – en hiver et en été. Il attire des gens du monde entier, avec près de 100 000 participants tous les ans. Quelques étrangers découvrent alors une des sociétés les moins patriarcales de la planète. Rares sont cependant ceux à saisir les origines de cette exception culturelle et le long processus qui, depuis les vikings, a fait de l’Islande le pays inclusif que l’on connaît aujourd’hui.
Les dissidents
Les Vikings posent le pied en Islande pour la première fois vers 861. Selon le Landnámabók, manuscrit détaillant la colonisation de l’île par les Scandinaves, c’est le navigateur Naddoddr et son équipage, alors perdus en mer, qui découvrent cette terre inhospitalière et déserte. Il n’y a là que quelques moines chrétiens irlandais qui ont choisi la réclusion. Une autre version proposée par le Landnámabók présente le Suédois Garðar Svavarsson, premier viking à avoir vécu en Islande et à avoir remarqué qu’il s’agissait d’une île après en avoir fait le tour complet. Il a cependant un précurseur.
Le premier viking à avoir sciemment navigué en direction de l’Islande serait Flóki Vilgerðarson, dit « Floki aux corbeaux ». Accompagné par deux marins, Floki aurait été guidé par un de ses corbeaux et, contemplant l’île du haut d’un fjord enneigé, aurait lui-même baptisé l’île « Iceland », la terre de glace. Il y passe deux rudes hivers en raison du climat hostile et du manque de ressources, et ouvre la voie à une colonisation.
Au fil des années et des arrivées, l’Islande se développe et devient une terre de liberté pour les Vikings. Du vieil islandais víkingr qui se traduit par « pirate », ce mot désigne les guerriers, pillards et commerçants qui fuient la Norvège pendant le règne de son premier souverain, Harald Ier, ou « Harald belle chevelure ». Il monte sur le trône en 872 après une série de conquêtes sur ses voisins, et certains Vikings auraient pris la mer pour éviter de payer des taxes sur leurs terres. Ce point de vue historique est aujourd’hui contesté, et certains archéologues affirment que les premiers explorateurs vikings avaient déjà posé le pied en Islande avant le règne d’Harald Ier.
Dans les années qui suivent, l’Islande devient une terre de dissidents, de ceux qui n’acceptent pas l’autorité du roi. Le pays continue de prospérer et demeure, du fait de son isolement et du peu d’influences extérieures, proche du mode de vie viking, là où les Scandinaves de Norvège, du Danemark et de Suède évoluent peu à peu avec l’expansion du catholicisme. Leur langue se transforme aussi, tandis que l’Islandais demeure proche dans ses racines du vieux Norrois, première langue scandinave médiévale.
Les guerrières
Si certains clichés sur des Vikings violents et bas du front, incarnations d’une masculinité exacerbée, sont fondés, la société Viking était toutefois riche culturellement et parfois moins polarisée en termes de déterminisme de genre qu’on peut l’imaginer. Les femmes jouissaient de droits sociaux rares dans l’Europe médiévale, comme la possibilité de posséder des terres et de demander le divorce, exigeant alors le remboursement complet de leur dot. Le contrat de mariage prévoyait d’ailleurs généralement un partage des biens en cas de rupture.
Selon le chercheur en archéologie Sami Raninen, auteur de l’article « Des Vikings Queer ? Transgression du genre et relations homosexuelles entre la fin de l’âge de fer et le début de la Scandinavie médiévale », il n’était pas rare de voir des femmes occuper des positions dominantes. Même si le pouvoir était traditionnellement détenu par les hommes et que le terme « viking » leur était réservé, elles pouvaient occuper le rôle d’un « fils de substitution », au moins temporairement, en l’absence d’héritier capable ou satisfaisant pour la famille.
Le concept d’honneur et la capacité à se faire respecter étaient probablement plus importants encore que la frontière du genre. Ainsi, lors des expéditions ou des guerres, les femmes pouvaient prendre les armes et être admirées pour cela, dans la plus pure tradition des Skjaldmö, ces « guerrières au bouclier » mythologiques. Certaines fouilles archéologiques ont en effet révélé des tombes de femmes enterrées avec leurs armes, et l’historien byzantin Johannes Skylitzes fait mention de nombreuses femmes combattant avec les Vikings Varègues de Suède contre les Bulgares en 971. Plus tard, c’est l’historien Danois du XIIe siècle Saxo Grammaticus qui fait référence aux « guerrières au bouclier » qui s’habillaient comme des hommes et se consacraient à l’apprentissage du maniement de l’épée et d’autres techniques de guerre. Selon lui, quelque 300 de ces guerrières auraient vaillamment combattu lors de la légendaire bataille de Brávellir au milieu du VIIIe siècle.

Crédits : Ulyces
Certaines femmes ont même atteint un statut privilégié dans le regard de leurs homologues masculins. Aude la Très Sage, parmi les plus importantes figures de la colonisation Islandaise, en fait partie. Mariée à Olaf le Blanc qui devient roi de Dublin, ville fondée par les Vikings au IXe siècle, Aude perd son mari lors d’une bataille puis des années plus tard son seul fils, trahi par son peuple. Ne pouvant prétendre à la couronne de Dublin, Aude ordonne la construction d’un bateau Viking et perpétue les pillages autour des îles britanniques avec son équipage, constitué d’une vingtaine d’hommes et de plusieurs prisonniers.
Adulée et respectée par ses hommes pour son tempérament d’acier, elle acquiert rapidement une renommée grandissante et décide de faire voile vers l’Islande. Arrivée en terre promise, Aude revendique Dalasýsla dans l’ouest de l’île, fait de ses prisonniers des hommes libres et accorde à ses membres d’équipage des terres sur lesquelles vivre et cultiver. Elle contribuera grandement au peuplement de l’Islande, où elle restera jusqu’à sa mort.
Laborieuse fierté
Les relations homosexuelles, en revanche, étaient moins bien tolérées dans une société traditionnelle qui glorifiait la virilité et la dureté. Bien que rarement mentionné dans les textes historiques, le concept d’Ergi désignait un homme qui adoptait des caractéristiques associées à la féminité, ce qui pouvait inclure des rapports sexuels avec d’autres hommes et s’associait hélas à une image d’impuissance, de lâcheté. Alors que la pénétration d’un autre homme pouvait parfois être vue comme un moyen de dominer un ennemi vaincu, l’acte passif était plutôt considéré comme un déshonneur pour sa virilité. Le concept a donné naissance à l’insulte Ragr, et celui qui en était accusé pouvait défier son détracteur jusqu’à la mort pour apporter la preuve de sa masculinité. Afin d’éviter les représailles sanglantes dans une société qui plaçait au centre l’honneur de l’homme, le code de loi Islandais, Grágás interdisait cette insulte au XIIIe siècle, sous peine d’un bannissement temporaire de la société.
L’Islande fait d’ailleurs preuve d’un rare progressisme en matière politique. Dès 930 ses « hommes libres » fondent l’Althing, le plus vieux parlement d’Europe. Ils donnent ainsi naissance à une République qui finit par se fondre dans la couronne de Norvège en 1262, avant de passer sous la domination du royaume de Danemark. Les pratiques homosexuelles ne sont ni mentionnées ni interdites, mais les sagas médiévales islandaises arrivées jusqu’aux historiens montrent donc qu’elles étaient généralement perçues de manière très négative. Entre cette époque et celle d’aujourd’hui, l’histoire de la communauté LGBTQ+ en Islande reste difficile à documenter. Quelques historiens et activistes comme Þorvaldur Kristinsson, auteur islandais et ancien président de la Gay pride de Reykjavík, ont tenté de retracer cet héritage, dont il reste peu de traces écrites.
Dans les siècles qui ont suivi l’arrivée des vikings, l’île a été affectée par l’expansion du christianisme au Xe siècle, puis du protestantisme au XVIe siècle sous l’influence du Danemark. Cette époque est marquée par de grandes épidémies, famines et catastrophes naturelles, qui ralentissent le développement économique et social de l’Islande avant son indépendance du Danemark en 1918. Il faut encore attendre quelques années avant qu’un mouvement s’amorce, et gays et lesbiennes demeurent dans l’ombre, invisibles jusqu’aux années 1950, dans une société marquée par le silence et la peur du rejet.
La deuxième moitié du XXe fait figure de renaissance pour le pays, et amorce une période marquée par une grande progression des droits des LGBTQ+ en Islande. En 1975, le musicien et acteur Hörður Torfason est le premier homme à faire son coming-out, une annonce qui conduira à la perte de son emploi puis de sa maison. Son combat permet toutefois à l’organisation nationale queer islandaise Samtökin 78 de voir le jour dans la foulée en 1978. Ses actions aboutiront à l’autorisation de l’union entre personnes du même sexe en 1996, suivi de la première Gay pride en 1999. L’activisme de la communauté gay et le coming-out de personnalités comme Torfason ont permis, en l’espace de trente ans, de faire de l’île de 300 000 habitants un espace progressiste et inclusif. Seules de rares oppositions de la part de congrégations fondamentalistes chrétiennes subsistent aujourd’hui.
Simple idylle
Maria et Palina ont d’abord été amies. Puis la première a commencé à venir de plus en plus souvent à la ferme d’Eystra Geldingaholt. Les deux jeunes femmes aux longs cheveux blonds, qui se sont rencontrées en 2017 lors d’un camp d’été chrétien, sont tombées amoureuses au cours d’un voyage. En deux ans de relation, elles n’ont jamais eu à subir l’homophobie, et leur relation s’est construite sans difficulté ni crainte du regard des autres. « Je pense que l’Islande est un pays formidable en termes d’égalité de toute sorte. Nous sommes peut-être le meilleur pays au monde ! », se réjouit Palina.

Palina et Maria
Crédits : Ulyces
Premier État à accueillir une cheffe du gouvernement ouvertement lesbienne en 2009 avec la Première ministre Jóhanna Sigurðardóttir, en fonction jusqu’en 2013, l’Islande autorise aussi l’adoption et la procréation médicalement assistée pour les couples homosexuels depuis 2006, et le mariage depuis 2010. Le pays possède d’ailleurs un arsenal très complet de lois pour condamner les propos homophobes, la discrimination dans le monde du travail, et toute forme de discrimination basée sur l’orientation sexuelle ou l’identité de genre. Un véritable havre de paix, à une époque où la communauté LGBT+ reste ostracisée dans de nombreux pays du monde, ce qui explique en partie le fait que l’Islande figure tous les ans dans le top 5 des pays les plus heureux du monde.
Cette célébration de la liberté culmine lors de la Reykjavik Pride, un événement qui dure plusieurs jours et qui constitue une des attractions principales du pays, avec des spectacles et des ateliers en plus de la parade. En 2010, l’ancien maire de Reykjavik, Jon Gnarr, s’est fait remarquer en y défilant habillé en drag queen. En 2016, c’est lors de la Gay Pride que le nouveau président Guðni Th. Jóhannesson, élu depuis seulement quelques jours, prononce un discours historique en revendiquant la tolérance. Pour la première fois dans l’histoire mondiale, un président participe officiellement à une marche des fiertés LGBTQ+.
C’est la raison pour laquelle les deux jeunes femmes ont été tant surprises par la haine qui a suivi la révélation de leur histoire d’amour sur les réseaux sociaux. « J’ai posté une photo à l’occasion de notre anniversaire, à moi et Maria. Et puis j’ai vu le nombre d’abonnés baisser. Il a baissé exactement le jour où j’ai mis la photo en ligne. » Pour le couple, le concept même de coming-out semble dépassé : « Je n’en ai parlé à personne parce qu’on sortait juste ensemble, mes parents le savaient. Et puis la nouvelle s’est répandue. Je n’ai pas fait le tour du quartier pour l’annoncer. Pourquoi aurais-je fait ça ? » se remémore Palina interloquée.

Crédits : Ulyces
Mais loin d’avoir atteint le jeune couple, les insultes n’ont pas eu raison de la popularité et du bonheur de Palina, qui est toujours suivie par environ 57 000 abonnés sur Instagram. Maria y a même vu une opportunité : « J’étais heureuse qu’elle perde tous ces gens qui ne veulent pas la suivre : nous ne voulons pas que des gens qui nous désapprouvent la suivent, alors ça m’a semblé normal », raconte-t-elle avec un sourire. Le couple envisage maintenant d’emménager dans un même appartement à Reykjavik. Devant la grange balayée par les vents, les deux jeunes femmes échangent un regard complice. « Palina et moi, on va vivre ensemble, c’est sûr. Très probablement à Reykjavik mais on n’en est pas sûres. Avec un peu de chance, nous aurons une famille. Et nous serons heureuses et peut-être mariées. »
Couverture : La ferme de Palina et Maria/Ulyces
L’article Islande : comment les Vikings sont devenus le peuple le plus tolérant du monde est apparu en premier sur Ulyces.
13.02.2021 à 10:24
L’écologie peut-elle résoudre le problème du chômage ?
Nicolas Prouillac
Assise à son bureau, Christine Vidal, 60 ans, semble avoir trouvé sa place au milieu des dossiers. Cela fait maintenant trois ans qu’elle travaille chez Actypôles pour « Bébés Lutins », une société qui produit et commercialise des couches lavables en coton Made in France. Un emploi à temps plein qui lui convient parfaitement, dans […]
L’article L’écologie peut-elle résoudre le problème du chômage ? est apparu en premier sur Ulyces.
Texte intégral (2599 mots)
Assise à son bureau, Christine Vidal, 60 ans, semble avoir trouvé sa place au milieu des dossiers. Cela fait maintenant trois ans qu’elle travaille chez Actypôles pour « Bébés Lutins », une société qui produit et commercialise des couches lavables en coton Made in France. Un emploi à temps plein qui lui convient parfaitement, dans une entreprise qui agit pour réduire l’utilisation du plastique. « Je suis tranquille désormais », confie-t-elle.
Si la sexagénaire ne s’inquiète pas pour son avenir professionnel, il n’en a pas toujours été de même. Après un divorce, Christine est rentrée dans sa région natale pour s’installer à Thiers. « Je suis revenue seule avec un bébé, je ne pouvais accepter que des temps partiels, les options n’étaient pas très nombreuses », se souvient-elle. Il faut dire que la sous-préfecture connaît une véritable crise de l’emploi. Thiers, historiquement connue pour son industrie coutelière, a souffert de la mondialisation. Dans certains quartiers, le taux de chômage a grimpé en flèche, touchant 25 % de la population.

La ville de Thiers
La ville a donc intégré le programme expérimental « Territoire zéro chômeur longue durée », lancé en 2016. Concrètement, l’expérimentation propose de fournir un travail aux personnes privées d’emploi depuis plus d’un an. Pour atteindre cet objectif, le programme prévoit de créer des emplois en finançant des activités utiles, sans faire concurrence aux entreprises existantes. C’est par ce biais que Christine a obtenu son CDI en 2017. « La démarche n’est pas basée sur notre CV mais sur nos savoir-faire », explique-t-elle.
Et quoi de plus utile que de bâtir des solutions face à l’urgence climatique. En effet, de nombreuses filières durables et locales restent à développer. C’est à partir de ce constat que deux laboratoires d’idées, Hémisphère gauche et l’Institut Rousseau, ont lancé l’initiative « Un emploi vert pour tous ». Leurs objectifs : éliminer le chômage et mener une transformation écologique de la société.
Mise au vert
À 29 ans, Chloé Ridel a de nombreux combats. La jeune énarque, passée par la Commission européenne et le ministère de l’Économie et des finances, a changé de cap, poussée par une volonté de changement, pour cofonder le collectif « Mieux Voter », qui propose d’améliorer l’élection démocratique par l’adoption du scrutin par « Jugement majoritaire ». Elle est aujourd’hui directrice adjointe de l’Institut Rousseau. « Ce qu’on veut, c’est ouvrir des débouchés concrets et remettre du mouvement dans le débat », explique la gardoise.
Le laboratoire d’idées est né il y a un an avec l’objectif de travailler à une « reconstruction écologique, sociale et républicaine ». S’inspirant de l’expérimentation « Territoire zéro chômeur », la structure a proposé l’instauration d’une garantie à l’emploi vert. « On est dans un contexte où il faut penser des solutions radicalement nouvelles, essayer de nouvelles choses », affirme Chloé. Comme rediriger les dépenses de l’État pour la lutte contre le chômage dans la création de solutions écologiques, tout en générant de l’emploi.

Un emploi vert pour tous
Crédits : Shane Rounce
Le coût de cette politique serait même inférieur aux solutions actuelles. En effet, les dépenses publiques en faveur du marché du travail sont énormes. La privation durable d’emploi coûtait 36 milliards d’euros à l’État en 2015, d’après une étude d’ATD Quart Monde. L’INSEE évalue même l’ensemble des dépenses publiques en faveur des politiques du marché du travail à 66 milliards d’euros en 2017. De son côté, le programme « Territoire zéro chômeur » a montré la possibilité de créer un emploi pour 20 000 euros par an. Pour bénéficier aux 2,8 millions de chômeurs longue durée, le coût de cette solution serait donc de 56 milliards d’euros.
« Dès maintenant on peut pérenniser l’expérimentation “Territoire zéro chômeur de longue durée”, c’est-à-dire l’étendre à la France entière », soutient la directrice adjointe de l’Institut Rousseau. Les résultats du programme donnent en effet des raisons d’être enthousiaste. « Au bout de trois ans, on a atteint l’objectif de zéro chômeur longue durée dans 30 % des territoires. » Mais le projet est entré dans sa seconde phase en décembre dernier. Pour les cinq ans à venir, il ne couvrira que 60 territoires à travers toute la France. C’est pour accélérer ce processus que la pétition « Un emploi vert pour tous » a été lancée. Les initiateurs espèrent transformer la proposition en projet de loi débattue à l’Assemblée nationale.
Mais ce n’est pas la seule proposition de la garantie à l’emploi vert. En plus de financer les Entreprises à but d’emploi (EBE), l’initiative vise aussi à développer d’autres filières d’emplois verts. Elle propose le financement d’emplois dans des entreprises qui vont vers une décarbonation de leur activité, ainsi que dans les associations et les activités publiques, sur le modèle des contrats aidés. Des idées qui, si elles n’ont jamais été appliquées à cette échelle en France, ne sont pourtant pas nouvelles.
L’écologie contre le chômage
« Penser global, agir local. » Cette formule, employée pour la première fois par René Dubos lors du premier sommet sur l’environnement en 1972, est une pierre angulaire des mouvements écologistes. On retrouve ce slogan lors du colloque international « L’Écologie contre le chômage », organisé par les Amis de la Terre en avril 1983, à Paris. Dès cette époque, Alain de Romefort, chef de mission à la promotion de l’emploi, exprimait le besoin d’adapter localement les emplois pour répondre aux besoins spécifiques du territoire. « Des activités favorables à l’environnement sont souhaitables et demandent des emplois moins classiques », peut-on lire dans le rapport du colloque.
En portant un regard neuf sur le problème de l’emploi et en prenant en compte les considérations environnementales, il y a près de quatre décennies, les quarante conférenciers ont théorisé plusieurs solutions, qui semblent sorties des programmes politiques écologistes contemporains. Par exemple, ils préconisent « de petites unités de production, relativement autonomes et bien moins fragiles que les grosses industries », en affirmant que « des centaines de milliers d’emplois de ce type sont souhaitables et probablement rentables dans un contexte fiscal et législatif approprié ». Il semblait donc déjà possible de créer des emplois répondant à des problèmes environnementaux ou sociétaux, sans faire grimper la facture de l’État.

Chloé Ridel
Le principe de garantie à l’emploi a, pour sa part, été théorisé par l’économiste américain Hyman Minsky dès 1973. Son principe central est celui de l’État comme « employeur en dernier ressort », c’est-à-dire que l’État (ou les collectivités locales) s’engage à fournir un emploi utile à la société à tous ceux qui sont prêts à travailler au SMIC. Pour financer cette mesure, il proposait des impôts fortement redistributifs et comptait sur les économies réalisées sur les prestations chômage.
Malgré cela, les politiques françaises pour l’emploi ne sont jamais parvenues à mettre fin au chômage de masse. « Depuis 40 ans, les chômeurs de longue durée forment une masse d’entre un et deux millions de personnes exclues de la société », dénonce Chloé Ridel. Ce n’est pourtant pas le manque d’activité qui pose problème. « Le chômage n’est jamais lié à une pénurie de travail, qui existe en quantité inépuisable, mais à un manque d’emplois », affirme l’initiative « Un emploi vert pour tous ». D’après sa porte-parole, c’est plutôt sur le manque d’efficacité des politiques de lutte contre le chômage qu’il faut se pencher.
Dernièrement, la mesure phare du gouvernement était le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE). Lancé en 2013, son objectif était de favoriser la recherche, l’innovation et le recrutement, grâce à une baisse du coût du travail financée par l’État. Mais la démarche s’est avérée extrêmement coûteuse pour des résultats mitigés. 100 000 nouveaux postes pour un coût unitaire de 280 000 euros : « C’est un somme considérable », s’étonne la militante écologiste. C’est même un véritable « gâchis d’argent public », selon les économistes Aurore Lalucq, Dany Lang et Pavlina Tcherneva.
La solution d’une garantie à l’emploi semble donc bien plus rentable et plus efficace. La clé du dispositif est sa gouvernance, originale et anti-bureaucratique. Elle repose sur des comités locaux de l’emploi, qui associent l’ensemble des acteurs d’un territoire : les personnes privées durablement d’emploi, les collectivités locales, Pôle emploi, les citoyens, les associations, les élus et les entreprises. Le rôle de ces comités locaux est d’identifier, à l’échelle du territoire, les activités utiles et éligibles à la garantie à l’emploi et d’assurer le placement des chômeurs. Ils offrent donc une réponse locale, adaptée aux besoins de la communauté. Et cela fonctionne plutôt bien.
Zéro chômeur, zéro carbone
Après cinq ans d’expérimentation, « Territoire zéro chômeur » est parvenue à éradiquer le chômage de longue durée dans 30 % des zones couvertes. Un exploit réalisé pour la somme de 20 000 euros par an et par emploi, soit 14 fois moins qu’avec le CICE. « C’est une équation complètement différente, et je pense que c’est l’avenir de l’emploi », souligne Chloé Ridel. Et elle n’est pas la seule à être de cet avis.
En effet, la garantie à l’emploi vert a convaincu plusieurs pays d’entamer une réflexion sur leur modèle actuel. La prestigieuse université d’Oxford s’est saisie de l’idée, en novembre 2020, pour lancer une expérimentation de trois ans sur 150 emplois, dans la ville autrichienne de Marienthal. Une récente étude belge, estimant le coût public annuel net d’un tel dispositif au niveau national, a elle aussi publié des résultats encourageants : « En fonction des scénarios de recrutement établis, l’étude conclut ainsi à un gain net moyen pour les finances publiques belges de 2 233 €/an [par personne dans le programme]. » La solution paraît donc viable.
Et la crise actuelle, causée par la pandémie de Covid-19, ne fait qu’ajouter du poids à cet argumentaire. En effet, selon une étude de l’Organisme International du Travail (OIT), le coronavirus a entraîné la perte de l’équivalent de 255 millions d’emplois en 2020 dans le monde. De plus, les jeunes travailleurs ont été particulièrement impactés, soit en perdant leur emploi, soit en quittant la vie active ou encore en retardant leur entrée sur le marché du travail. Ces pertes d’emplois s’élevaient à 8,7 % chez les jeunes (âgés de 15 à 24 ans), par rapport à 3,7 % au-delà de 24 ans. « Cela met en évidence le risque plus que jamais réel d’une génération perdue », fait remarquer l’Observatoire de l’OIT.
« On est en plus dans un contexte de “quoi qu’il en coûte” »
Le moment semble donc opportun pour lancer la rénovation générale du système de l’emploi. « Ça tombe bien, vu qu’on est en pleine crise et que le chômage ne cesse d’augmenter », assène Chloé Ridel. D’autant plus qu’un projet de loi Climat et résilience, porté par Barbara Pompili, a été présenté en Conseil des ministres le mercredi 10 février. Issu des travaux de la Convention citoyenne pour le climat, il regroupe les propositions censées permettre à la France d’opérer une transition écologique et de respecter ses engagements environnementaux. La garantie à l’emploi vert pourrait d’ailleurs venir s’ajouter à la liste des solutions si les élus s’en saisissent. C’est pour cela que l’initiative Un emploi pour tous a lancé une pétition, ainsi qu’un appel à témoignage.
« On est en plus dans un contexte de “quoi qu’il en coûte” », insiste Chloé Ridel, expliquant qu’il est important de ne pas perdre de temps à retrouver le niveau d’emploi d’avant crise. « Ce serait tragique, alors même qu’on est dans la décennie critique pour la lutte face à l’urgence climatique », conclut la militante écologiste. Le projet de loi, composé de 69 articles, doit être examiné par l’Assemblée nationale en commission spéciale début mars, puis en séance publique à partir du 29 mars 2021. Il faudra donc attendre encore quelques mois pour savoir précisément les mesures que prendront les élus. Une décision qui pourrait bouleverser, en bien, le quotidien de millions de Français.
Couverture : Nareeta Martin
L’article L’écologie peut-elle résoudre le problème du chômage ? est apparu en premier sur Ulyces.
11.02.2021 à 00:00
L’histoire vraie de la vidéo la plus terrifiante de tous les temps
Josh Dean
Une femme disparaît C’était le 27 janvier 2013. La jeune Elisa Lam, 21 ans, est descendue d’un train en provenance de San Diego dans le centre-ville de Los Angeles, a rassemblé ses affaires et s’est rendue dans un hôtel situé sur Main Street. Comme presque tous les jours au cours de l’hiver à Los Angeles, le temps était ensoleillé et […]
L’article L’histoire vraie de la vidéo la plus terrifiante de tous les temps est apparu en premier sur Ulyces.
Texte intégral (5763 mots)
Une femme disparaît
C’était le 27 janvier 2013. La jeune Elisa Lam, 21 ans, est descendue d’un train en provenance de San Diego dans le centre-ville de Los Angeles, a rassemblé ses affaires et s’est rendue dans un hôtel situé sur Main Street. Comme presque tous les jours au cours de l’hiver à Los Angeles, le temps était ensoleillé et la température avoisinait les 15°C – le genre de temps qui donne envie aux gens de ne plus jamais repartir. Sous ce chaud soleil d’hiver, dont les rayons étirent les ombres et adoucissent le paysage urbain, il est possible de ne pas tout à fait se rendre compte que ce district de 54 pâtés de maisons est l’un des plus troublés de la ville.
Mais même ainsi, Elisa a dû passer tout près des signes évidents de son délabrement : de vieilles tentes plantées sous des auvents, des abris faits de toiles attachées à des lampadaires, et des hommes avachis dormant sur des cartons aplatis. Cette partie du centre-ville, qui abrite une grande partie des toxicomanes et des citoyens les plus défavorisés de la ville, est connue pour être malfamée. La police la considère comme une « zone de confinement » pour les sans-abris. Sur les cartes, la zone est même appelée skid row, un endroit où tout peut déraper. Et Main Street se trouve en plein cœur du quartier.
Les choses évoluent, pas à pas, à mesure que les promoteurs immobiliers inaugurent de nouvelles résidences, des bars à cocktails chics et des menus dégustations facturés plusieurs centaines de dollars. Mais ces aimants à gentrification sont épaule contre épaule avec les camps précaires et les soupes populaires, et les vieilles tours art-déco ainsi que les grands hôtels qui bordent Main Street offrent pour une bonne part des chambres simples, où les autorités locales entassent et délogent à tour de rôle les résidents miséreux. L’hôtel de Lam – dont ses propriétaires disent qu’il s’agit en réalité d’un hôtel-boutique – était un incontournable de Main Street, et il occupe plusieurs étages d’un de ces bâtiments.
Il fut un temps, le Cecil Hotel était un endroit prestigieux garni de 700 chambres réparties sur 14 étages, mais il s’est peu à peu décomposé. Cela, Lam n’en savait probablement rien. Comme beaucoup d’autres voyageurs de passage dans le centre-ville de L.A., elle avait probablement choisi l’endroit d’après de simples photos trouvées en ligne : les chambres paraissent décentes et le hall, pavé de marbre et décoré de cuivre, est même plutôt impressionnant. Elle prévoyait d’y séjourner quatre nuits : elle arriverait le 31 janvier avant d’enchaîner avec ce qu’elle appelait un « tour de la côte ouest ». Ni la taille, ni le standing exécrable de l’hôtel ne semblaient la déranger outre-mesure. Voici ce qu’elle écrivait sur Tumblr : Il fut construit en 1928, d’où le thème art-déco. Donc oui, c’est un endroit classe, mais comme il se trouve à L.A., naturellement, il a mal vieilli. Je suis sûre que c’est ici que Baz Luhrman devrait filmer Gatsby le Magnifique.
Elle avait intitulé ce message : « #youpiiii il fait beau ». Lam était canadienne, et elle avait passé du temps ces trois dernières années comme étudiante à l’université de la Colombie-Britannique à Vancouver, mais à cause de son combat contre la dépression, elle a manqué plus de cours qu’elle n’en a suivi. Ce voyage en Californie devait faire office de pause, c’était un séjour prévu de longue date qu’elle surnommait son « aventure éclair ».
Ses parents, des immigrés originaires de Hong Kong, n’étaient pas vraiment partants, mais Elisa se sentait largement capable de voyager seule. Elle prenait le bus ou le train pour se déplacer, revenait chaque soir de son périple et postait ponctuellement des photos sur Facebook. À San Diego, elle était allée au zoo et dans un ancien bar clandestin, où elle avait perdu le Blackberry qu’elle avait emprunté à une amie. À Los Angeles, elle a assisté au tournage de l’émission de Conan O’Brien et a exploré la ville à pied.
L’après-midi du 31 janvier, Elisa Lam a traversé quelques pâtés de maison pour se rendre dans une librairie, où elle a acheté des livres ainsi que des CD qu’elle comptait offrir à ses proches une fois rentrée chez elle. « Elle était très extravertie, très vive, très aimable », rapportait quelques jours plus tard Katie Orphan, la gérante de la boutique. Lam craignait que ses achats ne soient trop lourds à transporter pendant le reste de son voyage. Ce soir-là, on l’a aperçue dans le hall du Cecil Hotel. Ensuite, Elisa Lam a disparu.
Une semaine plus tard, le 6 février, des inspecteurs de la division homicide du LAPD ont tenu une conférence de presse. Ils demandaient l’aide des citoyens pour éclaircir la mystérieuse disparition d’une touriste canadienne de 21 ans, qui avait été vue pour la dernière fois au Cecil Hotel durant la nuit du 31 janvier. La police a décrit la touriste en question, Elisa Lam, comme une « femme asiatique d’origine chinoise » aux cheveux noirs et aux yeux bruns, mesurant 1 m 52 et pesant 52 kg. Dans un communiqué de presse affichant une photo récente de Lam – souriante, portant des lunettes, ses mains enfoncées dans les poches d’un sweatshirt à capuche en tartan rose et bleu –, le LAPD a déclaré que la disparition de Lam était « suspecte et laissait penser à un crime ».
Le département a invité quiconque qui possèderait un indice à se manifester. Les parents de Lam ont commencé à se faire du souci pour leur fille après qu’elle ne leur a pas donné de nouvelles le 1er février, stoppant leur rituel du coup de fil quotidien. Au moment où le LAPD a annoncé la disparition d’Elisa, sa famille s’était déjà rendue en ville pour quelques jours afin de faire avancer les recherches. « Ce qui est inhabituel, c’est qu’elle téléphonait à ses parents tous les jours », a déclaré le porte-parole de la police. « Les échanges se sont arrêtés net. » Les Lam étaient présents lors la conférence de presse, debouts derrière le lieutenant Walter Teague tandis qu’il informait les reporters. « Il n’y a plus aucune communication », dit-il. « Cela inquiète sa famille et moi-même, aussi poursuivons-nous l’enquête. »

Malgré la conférence de presse, l’affaire n’a pas fait beaucoup de bruit. On lui a prêté plus d’attention au Canada qu’à Los Angeles, où la disparition d’une jeune femme, bien que n’étant pas monnaie courante, n’est pas non plus un fait exceptionnel. Et au vu de l’absence de nouveaux éléments au fil des jours, la couverture médiatique a simplement cessé. Du moins jusqu’au 13 février, quand le LAPD a sollicité une fois de plus l’aide des citoyens. Cette fois, la police a diffusé une vidéo. Ils ne l’ont pas confirmé à l’époque, mais elle avait été enregistrée par la caméra de surveillance de l’ascenseur du Cecil Hotel, au petit matin du 1er février. Il s’agissait du dernier enregistrement dans lequel Elisa Lam apparaissait. Et il était si étrange, si effrayant et si inexplicable que sa diffusion a chamboulé l’affaire du tout au tout. La vidéo dure 3 minutes et 59 secondes. On y voit Elisa Lam – et elle seule – entrant dans l’un des ascenseurs de l’hôtel le 31 janvier, peu après minuit.
La bande débute avec Lam qui entre dans l’ascenseur. Elle est vêtue de façon décontractée : un sweatshirt à capuche rouge, un short noir et des sandales. Elle se penche en avant à l’intérieur de la cabine pour examiner les numéros inscrits sur les boutons. Elle appuie sur l’un d’eux, situé en bas à gauche du panneau, et se redresse brusquement avant de se placer dans le coin droit de l’ascenseur – certainement en attendant qu’il se mette en marche. Il n’y a rien d’inhabituel à cela. C’est ce que font les gens lorsqu’ils entrent dans un ascenseur. De plus, Lam ne portant pas ses lunettes, il est logique qu’elle ait dû s’approcher des numéros pour parvenir à les lire.
Toutefois, quelques secondes s’écoulent sans que la porte ne se referme. C’est là que Lam fait un pas en avant – à 19 secondes – et se penche vers la porte ouverte avec beaucoup de précaution. Elle inspecte le hall, d’abord à droite, puis à gauche, et ce d’une manière qui semble exagérée, comme quelqu’un qui sur-jouerait son rôle dans un film d’amateurs. Puis elle se précipite à nouveau dans l’ascenseur. Quoi qu’elle ait vu ou entendu, cela semble l’avoir effrayée, et Lam se terre dans le coin droit à l’avant de l’ascenseur, où il serait difficile d’être aperçue par qui que ce soit depuis l’extérieur. Elle ne s’y cache pas bien longtemps. À la 40e seconde, elle regarde une fois de plus à l’extérieur, observant cette fois-ci le côté droit du hall, pendant dix secondes. C’est là que son comportement devient très étrange.
Il y a tant d’éléments étranges et dérangeants dans cet enregistrement qu’il est difficile de savoir par où commencer.
Lam sort de l’ascenseur, y retourne, en ressort, fait une série de pas, et disparaît de l’image en sortant de la porte ouverte par la gauche. Son bras droit pend et on l’aperçoit sur l’image à plusieurs reprises : il est donc évident qu’elle se tient debout, à gauche de la porte ouverte de l’ascenseur. Elle y reste jusqu’à 1 : 30, puis pénètre à nouveau dans l’ascenseur, les mains levées, et appuie sur plusieurs boutons – et même sur tous, à première vue, en insistant sur les boutons en bas à gauche, où se situe le bouton servant à fermer les portes. Celles-ci ne se fermant pas, Lam regagne le hall, et à environ deux minutes de visionnage, elle exécute les gestes qui ont le plus perturbé le public.
Lam regarde attentivement sur la droite, le long du hall, et commence à agiter ses mains, comme si elle dirigeait un orchestre ou tentait de dissiper un nuage de fumée dans l’air. Elle agite ses bras, les poignets souples, puis se tord les mains. Quiconque regarderait cette vidéo pour la première fois et sans son supposerait qu’elle est en train de parler à quelqu’un, à la voir ainsi. Mais personne ne se montre. À 2 : 28, elle sort du cadre pour la première fois, fait une série de petits pas presque titubants, puis disparaît dans le couloir. L’ascenseur se ferme enfin et part sans elle. La vidéo continue alors pendant une minute et demie de plus – un simple plan sur un ascenseur vide. Il y a tant d’éléments étranges et dérangeants dans cet enregistrement qu’il est difficile de savoir par où commencer.
Cette vidéo aurait même été perturbante si l’on était tombé dessus par hasard, sans contexte particulier. Elle est tout bonnement glaçante lorsqu’on sait que la personne qui agit d’une façon si bizarre dans un ascenseur qui ne se met pas en marche, a disparu depuis plus d’une semaine d’un hôtel situé dans un quartier peu fréquentable de la ville. À y regarder de plus près, cependant, d’autres indices étranges se manifestent. Premièrement, l’heure a été retirée de l’enregistrement. La vidéo semble également avoir été légèrement accélérée – mais il est impossible de déterminer de combien de temps sans le timecode. Enfin, il semble y avoir une coupure, ce qui laisse à penser qu’il manque un bout d’enregistrement. Bien entendu, ceci est également impossible à prouver. Le LAPD a diffusé la vidéo sans ajouter de commentaire ou d’explication.
Résultat, la vidéo a fait un carton. Elle a fait le buzz aux États-Unis et en Chine, où elle a rassemblé trois millions de vues et plus de 40 000 commentaires dès les dix premiers jours. Il existe à présent des dizaines de versions de la vidéo sur YouTube, dont certaines avec des voix-off et des théories qui viennent s’y ajouter. La version la plus populaire compte presque 12 millions de vues. En quelques heures, des fils de discussion se sont ouverts sur Reddit et Websleuths, deux plateformes de discussion en ligne dont la deuxième est expressément consacrée aux crimes non-élucidés. Des détectives amateurs s’y réunissent pour éplucher les indices et échanger des spéculations parfois raisonnables, mais souvent ridicules. Dans le cas d’Elisa, les premiers commentaires se basaient sur deux conclusions. Soit la jeune Canadienne portée disparue était sous l’influence d’une substance illicite, soit elle flirtait avec quelqu’un qui n’apparaît pas sur l’image. Peut-être même était-ce les deux ? Ces théories ne sont pas particulièrement concluantes, puisqu’on regarde une vidéo sans son.
Mais la façon qu’ont les théories de partir dans toutes les directions devient manifeste dès les dix premiers commentaires sur Reddit, où un utilisateur suggère qu’Elisa semble avoir consommé de « puissantes drogues psychédéliques » et observe que sa prochaine escale était Santa Cruz, une ville qui, dit-il, « est bien connue pour son trafic de drogues ». Partant de là, la conversation en vient à la possibilité (et la plausibilité) de droguer quelqu’un au LSD à son insu par contact de peau. Les gens ont imaginé toutes sortes de choses en visionnant l’enregistrement : qu’Elisa hallucinait, qu’elle traversait un épisode psychotique, qu’elle jouait à cache-cache, qu’elle était menacée à l’arme à feu par quelqu’un qui n’apparaît pas sur la vidéo… Et en suivant le mauvais lien, on tombe facilement sur des théories aberrantes : des esprits malveillants, le diable qui la possède, un agresseur utilisant un dispositif pour se rendre invisible, ou même une expérience du gouvernement pour contrôler l’esprit des gens. Classique.
De nombreux utilisateurs ont remarqué, à 2 : 27, ce qui semble être un troisième pied appartenant à un individu qui n’est pas visible sur l’image. Ce pied est souvent cité lorsqu’on parle d’un mystérieux assassin. Si l’on regarde attentivement, il s’agit certainement de l’ombre du pied de Lam. Mais beaucoup d’internautes la voient comme la preuve qu’il y avait une autre personne dans le hall qui appelait Elisa et cherchait à l’attirer hors de l’ascenseur. C’est à cette personne que Lam parle lorsqu’elle agite ses bras. C’est la seule conclusion possible. Et le propriétaire de ce mystérieux pied, dit-on, a enlevé Elisa, et l’a soit tuée, soit la détient encore quelque part, peut-être même dans l’une des centaines de chambres du Cecil Hotel…
L’eau sombre
Cinq jours après la diffusion de la vidéo, les clients de l’hôtel se sont plaint auprès des employés que la pression de l’eau était plus basse que d’habitude, et que le peu de liquide qui coulait du robinet leur semblait étrange. Un client a parlé d’un « goût bizarre ». Une autre a affirmé que lorsqu’elle allumait la douche, l’eau qui sortait était noire avant de redevenir claire. Comme beaucoup de bâtiments hauts de l’époque, le Cecil Hotel utilise un système d’approvisionnement en eau par gravité : dans son cas, on trouve quatre réservoirs d’eau de 1 000 gallons (environ 3 800 litres) sur le toit. Et c’est le premier endroit que le réparateur a vérifié lorsqu’il a été envoyé pour trouver la cause du problème de l’eau le matin du 19 février. Le jour suivant, on a entendu dire que le réparateur avait trouvé le cadavre d’une femme dans l’un de ces réservoirs. La presse a immédiatement couché sur papier qu’il pouvait s’agir du corps de Lam, mais le LAPD a refusé de spéculer tant que le légiste n’avait pas fait le travail d’identification.
Et deux jours plus tard, le 21 février, la police a confirmé que le corps était bien celui de Lam. Elle avait été retrouvée dans le fond d’un réservoir rempli d’eau aux trois-quarts, nue, ses vêtements gisant à proximité. Ces derniers – un short (modèle homme, taille M), un t-shirt, des sous-vêtements noirs, des sandales et un sweat à capuche rouge de chez American Apparel – correspondaient exactement à ceux qu’Elisa portait sur la vidéo. La trappe au sommet du réservoir étant trop petite pour que les secouristes y entrent, ils ont utilisé des outils électriques pour découper le bas et accéder au corps. L’opération a duré plusieurs heures. « C’est elle », a annoncé l’agent Diana Figueroa aux journalistes.« Ils l’ont confirmé grâce aux signes distinctifs sur son corps. »
La police a confié à la presse qu’elle envisageait un possible homicide. Le corps de Lam ne présentait aucun signe évident de traumatisme externe, a rapporté un autre porte-parole, qui a ajouté que les inspecteurs soupçonnaient que le corps flottait dans le réservoir depuis le début, plutôt que d’avoir été jeté là récemment. La découverte de Lam dans le réservoir a été une bien sinistre résolution de ce mystère qui a duré trois semaines. Mais au lieu de mettre un terme aux spéculations, les circonstances n’ont fait que les amplifier. Il n’y avait pas de caméras de surveillance sur le toit, et bien que la porte donnant sur le toit n’était pas fermée à clé, le personnel de l’hôtel a assuré qu’elle était dotée d’un système d’alarme.
S’il s’agissait bien d’un meurtre, quelqu’un aurait dû trafiquer cette alarme, grimper en haut d’une échelle de trois mètres à côté du réservoir tout en transportant un corps, ouvrir la trappe et le lâcher dedans sans que personne ne voie quoi que ce soit. Et si ce n’était pas meurtre, alors Lam avait dû faire tout cela seule, c’est-à-dire se rendre sur le toit au beau milieu de la nuit pour escalader un réservoir qu’elle voyait certainement pour la première fois, ouvrir la trappe et, soit y plonger, soit y tomber. Aucune des deux solutions ne paraît sensée.
Le fin mot de l’histoire dépend en grande partie de la façon qu’a chacun de voir le monde. Pour une personne logique ne jurant que par les faits et la raison, l’histoire est toute tracée et rejoint l’hypothèse du LAPD. Pour un esprit fantasque, autrement dit quelqu’un de doté d’une imagination débordante et qui accepte l’existence d’une réalité parallèle ou bien la véracité des théories du complot, l’histoire sera toute autre. C’est parti pour une virée dans les affres du bizarre. Ce qui est évident, c’est que le contexte et les coïncidences ont influencé la manière dont les gens perçoivent l’affaire Elisa Lam. Si une jeune Canadienne avait disparu avant d’être retrouvée morte, disons, dans un hôtel Ibis, l’histoire aurait certes été notable, mais elle n’aurait pas fait long feu. Si la vidéo inexplicablement dérangeante dans l’ascenseur a mis le feu aux poudres, le fait que sa mort soit survenue au Cecil Hotel a largement contribué à rendre l’événement diablement étrange.
Depuis les jours qui ont suivi la disparition de Lam, le Cecil Hotel a été un protagoniste au premier plan de cette histoire, au même titre que la jeune femme qui y a disparu. Et une fois qu’elle a été retrouvée morte, beaucoup d’histoires ont sous-entendu, voire ouvertement affirmé, que l’établissement lui-même avait une part de responsabilité dans cette tragédie. « L’hôtel au cadavre dans son réservoir d’eau a un passé trouble », affichait le gros titre d’un article publié sur le site de CNN, relatant les faits sur la découverte du corps de Lam. « Depuis sa construction en 1927, il a été le théâtre de suicides, de meurtres, de disparitions étranges, et même le refuge de tueurs en série », rapporte un site d’information australien à propos de l’hôtel. « Repaire de meurtriers, de fous dangereux et de fantômes, certains disent que le Cecil Hotel est tout sauf un hôtel lambda : ils disent qu’il est maudit », relate un blog. Un autre le surnomme tout simplement « la centrale des tueurs en série ».
Il est vrai que l’hôtel a été le refuge de certains tueurs en série célèbres. Le Cecil Hotel fut notamment le repaire de Richard Ramirez, dit le « traqueur de la nuit », qui tua au moins 14 personnes durant une odyssée meurtière qui terrorisa Los Angeles durant le printemps et l’été de l’année 1985. Ramirez avait pris l’habitude de retourner au Cecil après un meurtre, et de jeter ses vêtements tachés de sang dans les bennes à ordures derrière l’immeuble, avant de pénétrer dans le hall de l’hôtel nu ou en sous-vêtements. Ce qui n’interpellait personne puisque le Cecil Hotel était dans les années 1980 « un chaos total et constant », d’après les dires du guide touristique et historien amateur Richard Schave.
En 1991, six ans après que Ramirez fut attrapé et condamné à mort, un journaliste autrichien de 41 ans nommé Jack Unterweger séjourna au Cecil Hotel tandis qu’il travaillait pour un magazine autrichien sur une histoire de crime commis à L.A.. Unterweger utilisait son travail de journaliste pour patrouiller aux côté des policiers du LAPD, mais ses escapades étaient en réalité de funestes repérages, car on découvrit qu’Unterweger était également un tueur en série qui étranglait des prostituées. Kim Cooper, la partenaire de Schave sur leurs tournées en bus Esotouric, soupçonne qu’il ait choisi le Cecil Hotel pour son lien avéré avec Ramirez.
Il y eut plusieurs autres morts violentes au Cecil Hotel, dont le viol et le meurtre d’une standardiste en 1964, ainsi qu’au moins trois suicidés. Tous se sont défenestrés, et l’un d’eux a tué le piéton sur lequel il a atterri. Compte tenu du nombre de résidents qui y ont défilé durant un siècle, cela ne semble pas si extraordinaire pour un hôtel de cette taille situé au cœur de la ville, surtout dans un quartier aussi difficile. Les rumeurs selon lesquelles Elizabeth Short – qu’on connaît sous le nom du « Dahlia noir » –aurait séjourné au Cecil Hotel sont probablement infondées, d’après Kim Cooper, qui, étant également auteure, a fait des recherches approfondies sur Short. Short a séjourné non loin, et elle est peut-être passée dans quelques bars sur Main Street, à quelques pas du Cecil Hotel, la nuit de son meurtre notoire. Mais l’histoire s’arrête là.
Malgré cela, l’histoire d’Elizabeth Short est étrangement comparable à celle d’Elisa Lam. Comme l’observe Cooper, toutes deux étaient des femmes d’une vingtaine d’années qui voyageaient seules à Los Angeles depuis San Diego, vues pour la dernière fois dans un hôtel du centre-ville, et portées disparues durant plusieurs jours avant d’être retrouvées mortes dans d’atroces conditions. Pour finir, Cooper déclare que « les morts de ces deux malheureuses ont généré beaucoup de spéculation et d’attention de la part des médias ».

L’opinion la plus répandue est qu’Elisa a été tuée. Cela a aussi été ma première intuition : une jeune femme voyageant seule disparaît d’un hôtel douteux au passé tragique dans une rue peu fréquentable de L.A., puis elle est retrouvée morte deux semaines plus tard, flottant dans un réservoir d’eau sur le toit de l’immeuble. C’est une supposition logique. Mais au fil des semaines et sans suspect à l’horizon, l’histoire est devenue plus trouble. Les parents de Lam n’ont jamais dit un mot à la presse et sont retournés sans un bruit à Vancouver pour enterrer leur fille. (Ils ont plus tard porté plainte contre le Cecil Hotel pour « mort injustifiée ». C’est toujours en suspens.) Le LAPD n’a plus donné de nouvelles non plus, et faute d’informations à divulguer, la presse locale a abandonné l’histoire.
Le vide laissé par l’absence de révélations a bientôt été comblé par toutes sortes de parasites : Aux yeux d’Internet, la mort d’Elisa Lam est un mystère non-élucidé ayant laissé derrière lui un indice indéniable : la vidéo . Les forums sont restés très actifs, leurs utilisateurs échangeant des idées et des théories, introduisant toutes sortes de péripéties et repérant des coïncidences troublantes. Tout d’abord, il y avait la tuberculose. Au moment de la disparition d’Elisa, le Centers for Disease Control a envoyé une équipe pour arrêter une épidémie de tuberculose dans ce même quartier de L.A.. « C’est l’épidémie la plus importante depuis une décennie », a annoncé le directeur du Los Angeles County Department of Public Health.
Mis à part ce détail, toutefois, l’épidémie était anodine. Du moins jusqu’à ce qu’Internet ne découvre un fait dérangeant : le nom du test utilisé pour identifier les victimes potentielles aux alentours de L.A. avait été appelé LAM-ELISA. N’importe quel épidémiologiste vous dira que LAM-ELISA est le test standard pour détecter la tuberculose chez les êtres humains, et ce dans le monde entier. Son nom vient de l’association de Lipoarabinomannan, un marqueur cellulaire présent dans la tuberculose, et d’Enzyme-Linked Immunosorbent Assay, une forme de test dans lequel l’échantillon change de couleur si une substance particulière est présente.

Le tueur en série Jack Unterweger
La coïncidence représente tout de même l’indice de trop pour beaucoup d’intéressés. « Qu’est-ce qui peut bien expliquer ce lien complètement fou entre son nom et le test de tuberculose ? » a demandé un utilisateur sur le forum « conspiration » de Reddit, où la discussion sur l’affaire Lam s’est répandue et a attiré de nouveaux internautes.
« C’est beaucoup trop identique pour être une simple coïncidence », a écrit un autre. « Qu’est-ce qu’il se passe, bordel ? » Ensuite, il y avait les similitudes troublantes entre la mort de Lam et Dark Water, un film d’horreur japonais revu par Hollywood en 2005. Dans la version américaine, l’histoire tourne autour de Dahlia, une femme qui emménage dans un vieil immeuble avec sa petite fille, Cecilia, avant de découvrir que le bâtiment est hanté. La fantôme se manifeste dans un ascenseur défectueux, et à travers l’eau sombre qui s’écoule des robinets, de la baignoire et du plafond.
Lorsque le réparateur empoté se trouve incapable d’arrêter la fuite, Dahlia essaie de la réparer elle-même et atterrit sur le toit de l’immeuble, où elle voit le même liquide sombre s’écouler d’un réservoir d’eau. Lorsqu’elle l’ouvre, le corps d’une jeune fille portée disparue y flotte. Les parallèles avec l’affaire Elisa Lam – l’histoire, le nom des personnages, les détails – sont parfaitement étranges.
À chaque fois que je les passe en revue, j’en ai des frissons. Ajoutées au test de tuberculoses, les similitudes semblent presque incroyables. Vous pouvez imaginer la vitesse à laquelle cette histoire s’est propagée en ligne… Pendant des mois, l’affaire a fait énormément de bruit sur Websleuths, me confirme Tricia Griffith, qui gère le site depuis son domicile dans l’Utah. C’était également l’une des plus évoquées dans le forum Mystères non-élucidés de Reddit. Un redditeur dont le pseudo est maroonwave, et le vrai prénom est Elliot, m’a dit que comme beaucoup de gens, c’est d’avoir vu la vidéo qui l’a fait se plonger dans l’affaire. À ce moment-là, dit-il, il imaginait l’histoire d’Elisa comme une histoire de fantôme. « C’était un tel casse-tête d’essayer de savoir comment elle avait pu s’introduire dans le réservoir. Trouver la clé du mystère semblait impossible », dit-il. « Sans compter qu’il y avait énormément d’intox. »
Traduit de l’anglais par Margaux Fichant, Audrey Previtali et Marie-Audrey Esposito d’après l’article « American Horror Story: The Cecil Hotel », paru dans Matter. Couverture : L’ascenseur du Cecil Hotel, par Daniel Shea.
LISEZ LA SUITE DE L’ENQUÊTE ICI
DANS LES COULOIRS DU CECIL HOTEL EN QUÊTE DE VÉRITÉ ↓
L’article L’histoire vraie de la vidéo la plus terrifiante de tous les temps est apparu en premier sur Ulyces.
09.02.2021 à 00:34
À quoi ressembleront les futurs humains de Mars ?
Malaurie Chokoualé Datou
C’est la ruée vers Mars. En ce mois de février 2021, ce sont pas moins de trois missions spatiales qui sont lancées vers la planète rouge. Cette semaine, des sondes envoyées par la Chine et les Émirats arabes unis entreront dans l’orbite de notre voisine cosmique, à environ 225 millions de kilomètres de la Terre. […]
L’article À quoi ressembleront les futurs humains de Mars ? est apparu en premier sur Ulyces.
Texte intégral (2683 mots)
C’est la ruée vers Mars. En ce mois de février 2021, ce sont pas moins de trois missions spatiales qui sont lancées vers la planète rouge. Cette semaine, des sondes envoyées par la Chine et les Émirats arabes unis entreront dans l’orbite de notre voisine cosmique, à environ 225 millions de kilomètres de la Terre. La semaine suivante, c’est le lander Perseverance de la NASA qui atterrira à la surface poussiéreuse de Mars.
Tandis qu’Elon Musk et SpaceX prévoient les premiers pas d’un humain sur Mars pour 2024, on peut déjà imaginer la forme que prendra la lointaine colonisation de la planète rouge, et l’impact physiologique que celle-ci aura sur les générations d’humains qui vivront à sa surface.
Planète hostile
Le sol rocailleux a laissé une fine pellicule ocre sur les bottines de Christina Levenborn. Aussi loin que porte son regard, les collines aux teintes vermeilles se succèdent en enfilade désordonnée. Parfois ornés d’harmonieuses strates de couleur, ces monticules encerclent son équipe, qui s’affaire depuis deux semaines dans ce paysage lunaire. Longeant le camion chargé de cartons, Levenborn gravit prestement les marches qui la sépare de l’étrange porte percée d’un hublot, et fait son entrée dans l’installation cylindrique.
Pour la décoratrice d’intérieur d’IKEA, cette structure de sept mètres de diamètre aux murs courbés s’est révélée un challenge de taille. Mais tout a été pensé pour s’ajuster aux besoins des six chercheurs·euses qui travaillent au sein de la station. Car IKEA a créé une gamme de meubles sur-mesure pour décorer la station de recherche, alliant intimité et maximisation de l’espace. « Pour l’intérieur, nous avons apporté des produits sur roulettes s’adaptant à la vie en déplacement, des tabourets, des tables ainsi que des chaises empilables afin de gagner de la place », explique Christina Levenborn.
Établie dans le désert de l’Utah depuis 2001, la Mars Desert Research Station fait office de répétition générale dans la conquête de la planète rouge. En simulant la vie sur Mars, ce laboratoire de recherche spatiale permet à des scientifiques d’analyser la faisabilité d’une telle exploration et à la firme suédoise d’étudier de près l’habitat martien idéal ; afin d’être prêts lorsque l’être humain y aura posé ses valises.
Alors que la NASA envisage avec le plus grand sérieux de débuter la colonisation de Mars d’ici 2028, de grandes zones d’ombre subsistent encore. L’heure du départ approche à grands pas, mais l’environnement particulièrement hostile de la planète soulève encore son lot de questions sur le futur de l’évolution humaine charrié par ces colons de l’espace. En changeant d’environnement, l’espèce aussi va changer. Comme le biologiste de l’évolution et auteur du livre Future Humans Scott Solomon, iels sont nombreux·euses à se demander à quoi ressembleront les futurs êtres humains de Mars.
•
Comme les voyages pionniers de Fernand Magellan ou Neil Armstrong en leur temps, la conquête de Mars est un défi sans précédent. Non seulement voyager à travers l’espace comporte des risques pour le corps humain, mais les conditions de vie sur la planète rouge seront particulièrement hostiles.
Pour comprendre les effets des séjours spatiaux sur le corps humain, les jumeaux Mark et Scott Kelly étaient les sujets rêvés. Depuis mars 2016, ces deux astronautes ont fait l’objet d’une étude inédite, afin de comparer leur ADN après un séjour en orbite, d’une durée de 54 jours pour Mark et de 340 jours pour Scott. Au départ, les scientifiques avaient estimé que 7 % de l’ADN de Scott avait été modifié par rapport à son jumeau. Certains de ces changements étaient épigénétiques, c’est-à-dire qu’ils ont modifié de manière réversible l’expression des gènes sans modifier fondamentalement l’ADN. Ainsi, à son retour sur Terre, ces changements ont progressivement disparu.

De gauche à droite, Mark et Scott Kelly. Crédits : Robert Markowitz/NASA
Les scientifiques ont toutefois observé des changements génétiques, des mutations apparues en conséquence de son exposition aux radiations présentes à bord de la Station spatiale internationale, dont le taux est 24 fois plus élevé que sur Terre. Ces modifications sont irréversibles.
Le rayonnement sur Mars est plus dense que sur Terre, à cause de l’absence de champ magnétique et de son atmosphère d’une faible densité, et les colons martien·ne·s seront exposé·e·s à deux types de radiations au cours de leur voyage – solaires et spatiales. « C’est la raison pour laquelle les astronautes ont une limite de temps de séjour dans l’espace, parce qu’ils accumulent des mutations qui augmentent leurs chances de cancer », explique Scott Solomon. La NASA ne tolère pas d’augmentation des risques de cancer supérieure à 3 %, mais la limite de radiations dans le cas d’une mission vers la planète Mars reste encore à déterminer.
Outre les radiations, la micro-gravité sur Mars est un défi pour l’industrie spatiale. En effet, elle n’équivaut qu’à 38 % de celle de la Terre, si bien qu’un être humain de 75 kg ici-bas ne pèserait pas plus de 28 kg sur Mars. Les conséquences de cette micro-gravité sur le corps humain à long terme sont encore à l’étude, mais des recherches ont déjà été menées sur les astronautes en poste dans la Station spatiale internationale, faisant état de différents effets secondaires, globalement temporaires. À leur retour sur Terre, des astronautes ont présenté des troubles de la vision, une perte du goût, des os fragilisés ou encore des pertes d’équilibre, mais les scientifiques n’ont pas encore pu établir formellement que la faible gravité sur Mars aurait des effets similaires.

Crédits : NASA
Face à ces nombreux défis et aux forces évolutives en présence, Scott Solomon suggère que les colons martien·ne·s n’auront d’autres choix que de s’adapter pour survivre en terre hostile, donnant naissance à une nouvelle espèce humaine.
La création d’une espèce
Afin de prédire à quoi ressembleront les êtres humains du futur, les biologistes mettent en parallèle leurs connaissances de l’évolution et des forces évolutives qui rythmeront l’avenir de l’espèce humaine. Mais force est de reconnaître qu’iels travaillent à tâtons. « Il est très difficile de faire des prédictions sur le résultat de la sélection naturelle, par exemple », explique Scott Solomon. « Il est beaucoup plus simple de dire que celle-ci fonctionnera d’une certaine manière dans certaines circonstances. »
Fasciné par l’évolution humaine depuis l’université, Solomon a commencé à s’intéresser à l’évolution récente et future de l’être humain il y a plusieurs années, quand il était professeur de biologie. Un jour, il avait demandé à ses élèves s’iels pensaient que l’évolution était encore en cours et comment. « J’ai vu leur intérêt, ils posaient plein de questions, ils donnaient leur avis », se souvient-il. « C’est là que je me suis dit que c’était un sujet intéressant et je me suis plongé dedans. »
À l’époque, le jeune biologiste s’est rendu compte que bien peu de scientifiques se posaient cette fameuse question, compilant les travaux issus de différentes disciplines. « Mon travail consiste à rassembler des pièces issues de la génétique, de l’anthropologie, de la psychologie, de la médecine, de la microbiologie ou encore de l’épidémiologie pour constituer mon puzzle », résume-t-il. « Compiler toutes ces informations me donne matière à réfléchir à cette question. »

Crédits : Scott Solomon/Twitter
Dans son livre publié en 2016, Scott Solomon s’est demandé ce qu’il faudrait pour qu’une nouvelle espèce humaine voie le jour, et il est arrivé à la conclusion que la situation terrestre actuelle n’était pas propice à cette naissance. Autrefois relativement isolée aux quatre coins de la planète, la population humaine n’en finit pas de se mélanger. Plus que jamais dans l’histoire de son espèce, elle suit le cours de la mondialisation et se tient rarement tranquille.
Or, la clé du processus d’apparition d’une nouvelle espèce est « l’isolement d’une partie de la population » durant une très longue période. Les scientifiques sont à l’heure actuelle incapables de préciser la durée de cet isolement et le nombre de protagonistes nécessaires à la naissance d’une espèce. Les Amérindien·ne·s ont été isolé·e·s du monde pendant 10 à 20 000 ans, mais n’ont pas évolué en une espèce humaine différente, preuve de la longueur substantielle du processus.
Dans le contexte d’homogénéisation actuel, il y a donc peu de chance qu’une telle évolution survienne sur Terre. Le biologiste entrevoit toutefois des chemins différents, encore dissimulés sous des branchages, attendant patiemment d’être déblayés. « L’édition génomique pourrait potentiellement nous amener sur une voie complètement différente », s’exclame Scott Solomon. En effet, des populations humaines différentes pourraient être créées suivant des manipulations du génome humain. Dans un futur indéterminé, l’être humain pourrait ainsi guider lui-même son évolution et façonner des êtres post-humains.
Enfin, d’après Solomon, la conquête spatiale pourrait donner naissance à « de multiples espèces humaines évoluant dans différentes parties du système solaire » ; cette coexistence serait une première depuis la disparition des Néandertaliens.
Une nouvelle espèce sous les étoiles
Pour le biologiste, cette nouvelle espèce dépendra tout d’abord des membres fondateurs·rices de cette nouvelle colonie ; c’est ce qu’il appelle « l’effet fondateur ». En effet, un groupe isolé et restreint d’êtres humains va transmettre ses gènes à de nouvelles générations, sans être nécessairement représentatif de la planète bleue. « Par exemple, si tous les astronautes envoyés sur Mars ont les cheveux roux, Mars sera la planète rouge à plusieurs égards », développe Scott Solomon.

Crédits : SpaceX
Le biologiste a émis une série de suppositions sur l’évolution physique de ces Martiens. D’après lui, la probabilité que l’être humain reste le même sur Mars que sur la Terre est proche de zéro. Par leur isolement, les colons pourraient tout à fait créer une nouvelle espèce humaine, car la « sélection naturelle sera très forte » et les mutations nombreuses. En outre, cette évolution pourrait être « rapide » car si une mutation est bénéfique pour l’être humain – comme le fait de mieux tolérer les radiations par exemple –, elle sera rapidement transmise aux générations suivantes.
Les corps des colons martien·ne·s pourraient ainsi devenir plus robustes et plus forts pour faire face aux conditions martiennes. En effet, face à la perte de masse osseuse liée à la micro-gravité, l’évolution pourrait sélectionner celles et ceux qui ont naturellement des os plus denses et des muscles plus imposants. Pour faire face aux fortes doses de rayons ultraviolets, Solomon envisage que les futur·e·s habitant·e·s de Mars pourraient avoir « la peau plus sombre que quiconque sur Terre », à cause d’une augmentation de la production de mélanine.
En attendant, afin de permettre à l’humanité de s’installer durablement sur la Lune et sur Mars, des scientifiques travaillent d’arrache-pied pour trouver une solution capable de bloquer les radiations, à l’image de la combinaison anti-radiations du héros incarné par Matt Damon dans Seul sur Mars. « On pourrait aussi imaginer vivre sous la surface de Mars et ne jamais en sortir, là on n’aurait pas beaucoup d’exposition aux radiations », poursuit Solomon, que cette idée laisse dubitatif, car les colons spatiaux devront tout de même faire pousser des cultures en surface. « Et puis je pense que psychologiquement, il sera difficile pour les gens de vivre constamment sous terre. »

Crédits : NASA
L’édition génomique pourrait également permettre aux aventuriers·ères des étoiles de s’adapter aux conditions sur Mars, en leur permettant de résister aux radiations, ou réduire la quantité d’oxygène dont iels ont besoin pour vivre. Le problème dans l’immédiat est « qu’on n’en sait pas encore assez sur notre propre génome pour être assez confiant dans le fait que si nous faisons un changement, cela n’aura pas de conséquences imprévues », précise Solomon, qui appelle à davantage de compréhension biologique et éthique avant tout. Pour le biologiste, ce n’est toutefois plus qu’une question de temps avant que l’être humain influence sa propre évolution avec cette technologie, aussi balbutiante soit-elle.
Couverture : Laboratory Equipment.
L’article À quoi ressembleront les futurs humains de Mars ? est apparu en premier sur Ulyces.
08.02.2021 à 00:09
Ce prince saoudien va-t-il racheter l’OM ?
Denis Hadzovic
La rumeur est de retour pour boucher le port de Marseille. Le 5 février 2021 sur Twitter, le journaliste foot de Canal+ Matthias Manteghetti a annoncé sans conditionnel que la vente de l’OM au prince saoudien Al-Walid ben Talal était proche : il évoque notamment un montant de 480 millions d’euros, le retour d’Ocampos, l’intervention […]
L’article Ce prince saoudien va-t-il racheter l’OM ? est apparu en premier sur Ulyces.
Texte intégral (1697 mots)
La rumeur est de retour pour boucher le port de Marseille. Le 5 février 2021 sur Twitter, le journaliste foot de Canal+ Matthias Manteghetti a annoncé sans conditionnel que la vente de l’OM au prince saoudien Al-Walid ben Talal était proche : il évoque notamment un montant de 480 millions d’euros, le retour d’Ocampos, l’intervention d’Emmanuel Macron dans les discussions et un changement de nom du stade Vélodrome.
A suivre toute la journée sur IS+ et Canal+, nos infos et détails sur la #VenteOM :
-Montant de la vente approcherait les 480M€(McCourt en espérait 600).
-Augmentation de capital 2020 : chapeautée par les repreneurs.
-L.Campos ferait partie du projet. Il est à Marseille. #OM 1/2— Matthias Manteghetti (@MManteghetti) February 5, 2021
Une annonce officiellement démentie le jour-même par Frank McCourt, l’actuel détenteur du club, qui estime que ces rumeurs persistantes ont « pour seul objectif de déstabiliser un projet dans lequel [il] s’est investi personnellement depuis plus de quatre ans ». Des rumeurs à ce point persistantes qu’elles n’en seront peut-être bientôt plus du tout.
1 001 promesses
Une lame d’acier fendra bientôt le ciel saoudien. Au pays du sabre, cette tour pointue comme une dague est en train d’être construite à Djeddah, sur les bords de la mer Rouge. Moyennant 1,3 milliard d’euros, l’édifice de 1 001 mètres doit devenir le plus haut de la planète. Avec lui, le prince Al-Walid ben Talal espère se tailler une part plus importante encore du gâteau en Arabie saoudite. Mais ses ambitions sont loin de se limiter à son pays.
Le média italien TuttoMercatoWeb assure qu’Al-Walid ben Talal, dont la fortune s’élève à 17,3 milliards d’euros selon Forbes, pourrait racheter l’Olympique de Marseille. Selon le journaliste Marco Conterio, les négociations sont en cours entre les deux parties avec un budget de 250 millions d’euros évoqué. Il ajoute également qu’en cas d’accord, « et sans le fair play financier », un budget maximal pour le mercato serait préparé.
Des négociations qui coinceraient à plusieurs endroits. Tout d’abord, le propriétaire actuel, Frank McCourt, souhaiterait garder des parts dans le club en cas de revente, à l’image de ce qu’avait fait Margarita Louis-Dreyfus lorsqu’elle avait vendu à l’investisseur américain. Or les Saoudiens entendraient posséder entièrement le club sans avoir à dépendre d’actionnaires, explique Thibaud Vézirian, journaliste du groupe Canal. « Les négos suivent leur cours », insiste Geoffroy Garétier, lui aussi journaliste à Canal +.

Crédits : Rodolfo Manabat
Pour George Malbrunot, ces déclarations sont crédibles. Le reporter au Figaro et spécialiste du Moyen-Orient explique que le prince héritier d’Arabie saoudite Mohammed ben Salmane (MBS) ne serait pas totalement opposé au rachat de l’OM par Al-Walid ben Talal. « Il y a un homme de MBS qui contrôle les activités du groupe Ben Talal. Walid est sous contrôle. Il a pu présenter un dossier de rachat d’un club de foot à l’entourage de MBS », selon un homme d’affaires français dans le Golfe cité par Malbrunot.
Mais à en croire Jean-Baptiste Guégan, professeur de géopolitique du sport à l’ESJ Paris, la relation entre Al-Walid ben Talal et MBS est tendue. Depuis qu’il a été enfermé au Ritz-Carlton pendant la purge anti-corruption lancée par MBS et son fils en 2017, le milliardaire n’est plus libre de ses mouvements. C’est pourquoi « personne ne peut affirmer qu’Al-Walid ben Talal a la possibilité de racheter l’OM », explique Jean-Baptiste Guégan à So Foot.
Il ne fait pourtant aucun doute que l’Arabie saoudite développe aujourd’hui une diplomatie du football avec l’implication du Saudi Public Investment Fund, un fonds d’investissement contrôlé par le prince MBS, dans le potentiel rachat du club britannique de Newcastle. Riyad entend ainsi concurrencer ses voisins du Golfe comme le Qatar ou les Émirats Arabes Unis. Sa stratégie en la matière à mis du temps à se dessiner, mais elle prend aujourd’hui des contours assez nets.
La diplomatie du football
Le nom du prince saoudien a été évoqué une première fois en 2014. Six ans en arrière, l’investisseur souhaitait déjà racheter le club phocéen, mais cela n’a pas abouti. La rumeur a été lâchée par L’Équipe, le lendemain d’une victoire de l’OM face à Bordeaux, alors que la mi-saison n’avait même pas encore été atteinte. À cette époque, Al-Walid ben Talal était déjà la 35e fortune mondiale et aurait été en contact avec un ou plusieurs dirigeants du club, d’après TuttoMercatoWeb. L’Europe découvrait alors l’identité de ce richissime inconnu.
Al-Walid ben Talal est né à Djeddah en 1955. Il est le petit-fils du roi Ibn Saoud, fondateur de l’Arabie saoudite. Après avoir obtenu un diplôme d’administration des entreprises en Californie en 1979, il a bâti sa richesse dans l’immobilier. Ses projets ont fleuri alors que les revenus du royaume s’envolaient grâce au pétrole. En 1980, avec 30 000 dollars en poche, Al-Walid ben Talal a lancé la société Kingdom Establishment for Commerce and Trade. Sa spécialité : la promotion immobilière et le développement de grands projets dans le domaine de la construction. Au fil des ans, il a investi dans différents secteurs à travers le monde et a construit sa fortune.

Alors qu’Al-Walid ben Talal débutait le chantier de la Jeddah Tower, en 2011, l’émir qatari était occupé à racheter le Paris Saint-Germain, pour imiter la couronne des Émirats arabes unis, qui avait absorbé Manchester City en 2008. Mais l’Arabie saoudite ne s’est véritablement intéressée au football qu’après l’accession au pouvoir de MBS, en 2017. Elle a d’abord été accusée d’avoir piraté la chaîne qatarie beIN Sports en 2019. Puis en février, Riyad a ouvert une ligue de football féminine et, en avril, un consortium mené par le Fonds public d’investissement saoudien, piloté par le prince héritier MBS, a affiché son souhait de racheter le club anglais de Newcastle.
Entre-temps, en 2017, Al-Walid ben Talal avait été enfermé au Ritz-Carlton lors d’une grande purge anti-corruption, qui avait mis de nombreux caciques du régime sur la touche. Le milliardaire voyageait un peu partout dans le monde pour rencontrer les chefs d’États de manière officielle et officieuse, ce qui agaçait passablement MBS. « Tu es un homme d’affaires, pas un homme politique, arrête tes rendez-vous », lui a intimé MBS, en ponctionnant six de ses 19 milliards de dollars.
Alors, Al-Walid ben Talal est-il aujourd’hui réellement en capacité de racheter l’Olympique de Marseille ? Pour la source de George Malbrunot, la tutelle de MBS n’empêche pas le projet de rachat : « Al-Walid ne peut plus jouer que la carte hommes d’affaires, s’il veut exister. S’il rachète l’OM, entre la presse, la TV, les droits TV, il sera de nouveau présent dans les journaux », explique l’homme d’affaires.
Dimanche 10 mai, Frank McCourt a démenti la possibilité d’une vente dans les colonnes de La Provence. « Le club peut démentir 1 000 fois, la négo est réelle et chacun est dans son rôle, c’est le business. Je n’ai jamais annoncé que le deal était finalisé, je n’ai jamais annoncé de fake news », rétorque Thibaud Vézirian. La rumeur a d’ailleurs été alimentée par les tractations en coulisse.
Ces dernières semaines, Frank McCourt a fait venir les Britanniques Paul Alridge et Garry Cook au club, deux conseillers qui ont déjà œuvré dans la revente de Manchester City à l’Abu Dhabi United Group, le fonds de la couronne des Émirats arabes unis. Seulement, la mission de Cook se terminera à la fin du mois de mai. D’ici là, les spéculations ont de bonnes chances de continuer.
Couverture : Mauroof Khaleel
L’article Ce prince saoudien va-t-il racheter l’OM ? est apparu en premier sur Ulyces.
05.02.2021 à 00:10
Les multinationales doivent-elles financer la transition écologique mondiale ?
Servan Le Janne
Maintenant que Joe Biden est président des États-Unis et que les Démocrates ont repris le contrôle du Congrès, le sénateur Bernie Sanders et la représentante Alexandria Ocasio-Cortez pourraient s’accorder une trêve et profiter du temps présent. Mais ce n’est pas le genre de la maison. Préoccupés par le futur, le duo qui incarne la « […]
L’article Les multinationales doivent-elles financer la transition écologique mondiale ? est apparu en premier sur Ulyces.
Texte intégral (3329 mots)
Maintenant que Joe Biden est président des États-Unis et que les Démocrates ont repris le contrôle du Congrès, le sénateur Bernie Sanders et la représentante Alexandria Ocasio-Cortez pourraient s’accorder une trêve et profiter du temps présent. Mais ce n’est pas le genre de la maison. Préoccupés par le futur, le duo qui incarne la « nouvelle » gauche américaine presse le président élu de relever le défi écologique. Ils viennent ainsi de l’enjoindre, le 4 février 2021, à déclarer l’état d’urgence climatique.
« Alors que nous faisons face à une crise climatique mondiale, il est impératif que les États-Unis montre la voie au reste du monde en passant d’un système basé sur les énergies fossiles à une énergie durable », a déclaré Bernie Sanders. « La majorité du Congrès doit désormais se dresser contre les industriels des énergies fossiles et leur faire savoir que leurs profits à court terme sont moins important que le futur de la planète. »
Un message du futur
En sortant de l’avion, Alexandria Ocasio-Cortez tombe sur un écran vert. Il annonce que l’aéroport de Copenhague, où elle vient d’atterrir ce mercredi 9 octobre 2019, sera neutre en émission carbone d’ici 2030. « Vous voyez ? » commente-t-elle sur Instagram. « Ce n’est pas insensé. L’action climatique n’est pas un problème de technologie ou de capacité, c’est une question de volonté politique. » Dans la capitale danoise, la représentante du 14ᵉ district de New York au Congrès se rend au sommet du C40, un groupe réunissant les maires de 90 grandes villes du monde.
Alors que le sommet des Nations unies pour le climat de septembre présente un bilan décevant, le C40 a déjà affirmé son « engagement en faveur de la protection de l’environnement, le renforcement de l’économie t la construction d’un futur plus équitable en réduisant les émissions. » Pour le bonheur d’Alexandria Ocasio-Cortez il a aussi affirmé soutenir le Green New Deal qu’elle promeut depuis des mois. « Ce sera ma priorité », a annoncé le premier magistrat de Los Angeles, Eric Garcetti.
« Les dirigeants du monde se sont rencontrés à New York le mois dernier et ils ont encore échoué à s’accorder sur une mesure susceptible ne serait-ce que d’enrayer la crise climatique », s’est lamenté la maire de Paris, Anne Hidalgo. « Leur incompétence menace directement les peuples du monde alors que le temps joue contre nous. » Reste maintenant à s’entendre sur les contours de ce Green New Deal et à le faire accepter par les décideurs nationaux. « Si nous travaillons à unir nos forces à échelle globale, nous serons en mesure de vaincre notre plus grande menace et de saisir notre plus grande opportunité », promet Alexandria Ocasio-Cortez.
•
En quelques mois, Alexandria Ocasio-Cortez a secoué l’univers feutré du Capitole. Tout juste élue à la Chambre de représentants, la députée américaine tente même de semer ses idées sur les terres arides du Sénat, acquis aux Républicains depuis 2014. Elle pourrait avoir l’impression de prêcher dans le désert, ou contre des moulins, si les médias ne portaient pas ses idées jusqu’à l’autre bout du monde, comme le vent disperse les graines à l’extérieur des champs. « AOC » se sait regardée ce mardi 26 mars 2019. Alors, avec un pull et une humeur assortis au banc vert sombre de l’hémicycle, la jeune femme saisit le micro pour en faire un bâton de pèlerin.
Incrustés dans ce haut-lieu de pouvoir depuis des années, les Sénateurs de la majorité reprochent à cette New-Yorkaise un peu trop verte de prendre le parti de l’élite contre le peuple. Le peuple, ils le connaîtraient bien, pour le pratiquer dans les mines de charbon, là où l’écologie ne ferait guère recette. « Il y a un an, j’étais serveuse dans un restaurant de tacos de Manhattan », répond-elle. « Je n’ai eu une assurance santé pour la première fois qu’il y a un mois. Ce n’est pas une question élitiste, c’est une question de qualité de vie. » Les riches sont-ils les seuls à se soucier de la qualité de l’air et de l’eau ? « Allez le dire aux enfants du Bronx qui souffrent du plus haut taux d’asthme du pays, ou aux familles du Flint dont les enfants ont un taux de plomb qui flambe dans le sang. Les gens meurent. »

Par ces mots, la représentante Ocasio-Cortez défend son Green New Deal, présenté par une résolution le 7 février dernier. « Parce que les États-Unis sont historiquement responsables d’une quantité considérable d’émissions de gaz à effet de serre », rappelle le texte, « et qu’ils causaient encore 20 % des émissions globales en 2014, tout en ayant de grandes capacités technologiques, ils devraient avoir un rôle pionnier dans la réduction de ces émissions à travers une transformation de l’économie. » Le quota de pollution à respecter selon les Accords de Paris ne suffit pas – Donald Trump a de toute manière décidé d’en retirer son pays.
Comme le New Deal devait relancer la machine américaine grippée des années 1930, en ponctionnant les mastodontes de l’industrie, le Green New Deal passe par « des investissements publics dans la recherche et le développement d’énergies propres ». La résolution d’Ocasio-Cortez donne la direction à prendre et laisse les précisions pour plus tard. Alors, afin d’exploiter les potentielles divisions sur le sujet entre Démocrates, le chef des Républicains au Sénat Mitch McConnell a précipité le vote au mardi 26 mars, date à laquelle AOC a appelé les membres de son parti à se contenter de voter « présent ». Ils ont été 43 à le faire contre 57 oppositions.
« Encouragée » par ce résultat, la jeune femme soutenue par le philosophe Noam Chomsky poursuit son plaidoyer à travers une vidéo enregistrée avec l’autrice et journaliste de The Intercept Naomi Klein. Le Green New Deal, explique-t-elle dans ce « message du futur », est « la seule manière d’éviter » que « des millions de gens » soient « confrontés à des pénuries de nourriture et d’eau ». Elle ne parle ainsi plus seulement des enfants de l’Iowa et du Bronx, mais aussi de ceux d’ailleurs. À problème global, stratégie globale : puisque les planètes refusent obstinément de s’aligner, les socialistes américains et européens ont décidé de rassembler leurs efforts.
« C’est un moment très important pour cette idée », se réjouit le militant britannique Colin Hines, qui a fondé le Green New Deal Group, une association de militants anglais en 2007. « En Europe et au-delà, les gens n’en peuvent plus d’être sacrifiés au nom de la concurrence internationale. Leurs préoccupations sont à la fois sociales et climatiques, deux dimensions auxquelles le Green New Deal doit apporter des réponses. »
Une idée sans frontière
Bienvenue en « République populaire de Burlington ». Baptisée ainsi par la presse locale lors de l’élection à la mairie de Bernie Sanders, en 1981, la ville du Vermont située au bord du lac Champlain accueille vendredi 30 novembre 2018 l’acte fondateur de Progressive International. Pour l’occasion, le mentor d’Ocasio-Cortez a invité l’ancien ministre des Finances grec Yanis Varoufakis, dont le Mouvement pour la démocratie en Europe (DiEM25) est associé à la nouvelle organisation. « Je porte le message de chacun de nous en Europe pour vos camarades qui luttent afin de reconquérir nos villes, notre monde et notre environnement », déclare l’économiste. « Nous avons besoin que Bernie Sanders se présente à la présidentielle. » Elle aussi présente, Naomi Klein affirme que « n’importe quel candidat voulant se présenter » à la présidentielle de 2020 devrait soutenir le New Green Deal. Et Varoufakis opine.

Crédits : DIEM25
Dans une tribune publiée par le Guardian le 23 avril 2019, celui qui a longtemps bataillé contre l’austérité infligée à son pays par les institutions internationales reprend à son compte le Green New Deal et tente d’en élargir la portée. « Ici en Europe, DieM25 et notre coalition European Spring font campagne sous la bannière d’un agenda d’un Green New Deal détaillé », expose le candidat aux élections européennes en Allemagne. « Au Royaume-Uni, des parlementaires comme Caroline Lucas et Clive Lewis promeuvent une législation similaire. Et aux États-Unis, les militants acharnés du Sunrise Movement travaillent avec des élus comme Alexandria Ocasio-Cortez pour mettre leur proposition sur le devant de l’agenda politique. »
En faisant converger ces luttes, Varoufakis espère récolter 8000 milliards de dollars par an, soit 5 % du PIB mondial, pour les investir dans l’énergie renouvelable et protéger l’environnement en fonction des besoins de chacun plutôt que selon ses moyens. Cet immense plan devrait être financé par un impôt sur les multinationales, dont on sait qu’elles se débrouillent souvent pour en payer le moins possible. En parallèle, propose l’économiste, les banques centrales publiques telles que la Banque européenne d’investissement, la Banque mondiale ou la banque de développement allemande (KfW), pourraient émettre des obligations vertes de manière coordonnée.
« Même si la mise en place technique est compliquée, il faut qu’il y ait une forme de Green New Deal international car le changement climatique n’a pas de frontière », insiste Colin Hines. « Il faut y mettre en valeur le volet social afin que la majorité des gens y trouvent leur intérêt. Je pense que c’est possible car le secteur du développement durable peut à la fois créer des emplois qualifiés et des opportunités d’entreprendre. »
À condition qu’ils coopèrent, les États du monde ont la capacité de produire toute leur énergie de manière renouvelable d’ici 2050, assure une étude de l’université de technologie de Lappeenranta, en Finlande, commandée par le réseau de scientifiques et de parlementaires écologistes Energy Watch Group. Pour le démontrer, les chercheurs ont quantifié les ressources en air, eau et vent qui pouvaient être captées à différents endroits du monde. Ayant aussi passé en revue les questions de stockage, il estiment que des investissement de 699 milliards d’euros par an de 2020 à 2035 et de 488 milliards d’euros de 2035 à 2050 seront nécessaires. Ce n’est donc « pas une question de faisabilité technique mais de volonté politique », concluent-ils.

Colin Hines
Aux États-Unis, le think tank socialiste Data for Progress a tenté de donner une base chiffrée au Green New Deal prôné par Alexandria Ocasio-Cortez. Citant des données de l’Economic Policy Institute, il souligne qu’investir dans l’efficacité des bâtiments et dans un réseau de distribution d’énergies intelligent augmentera le PIB américain de 147 milliards de dollars par an et créera 1,1 million d’emplois dès la première année, alors que les dépenses de santé liées à la pollution sont astronomiques. Sans compter que les ouragans ont coûté 270,3 milliards aux États-Unis et les incendies 18,4 milliards en 2017.
Côté européen, DiEM25 élabore un agenda commun avec différents partis, notamment Génération.s, la formation de Benoît Hamon. Son concurrent aux élections européennes en France, Yannick Jadot, propose lui aussi un Green New Deal dans un entretien accordé au Journal du dimanche le 24 mars. Par ces mots, le candidat d’Europe Écologie Les Verts entend « un plan d’investissement de 100 milliards pour les énergies renouvelables et l’isolation des logements, qui nous permettra, en vingt ans seulement, d’avoir une électricité 100 % renouvelable et ainsi de créer des millions d’emplois ».
En Espagne, le socialiste Pedro Sánchez est le grand vainqueur des élections législatives ce 29 avril 2019. Il propose l’adoption d’un New Deal Verde dans le pays. Et malgré le Brexit, l’idée fait aussi son chemin outre-Manche. C’est même de là qu’elle vient, fait remarquer Colin Hines, qui a fondé le Green New Deal Group il y a 12 ans.
Génération verte
Avec ses longs cheveux blancs sur les oreilles, Colin Hines dénote dans les cortèges de militants écologistes qui, avec Greta Thunberg, réclament des mesures rapides pour la planète. « Voilà des décennies que je suis dans le mouvement », admet-il. Jeune, le Britannique s’intéresse à la croissance démographique et aux problèmes qu’elle charrie. Fondateur de l’association Population Stabilization, il devient l’expert économique de Greenpeace International. « Au départ, nous nous contentions de secouer un drapeau, mais dans les années 1980-1990 nous avons essayé de travailler avec les décideurs pour trouver une solution sans perdre l’équilibre. »
Auteur d’un manifeste pour la relocalisation des activités économiques, mais partisan d’un Royaume-Uni dans l’Union européenne, il rassemble un panel d’activistes autour de l’idée d’une relance par l’écologie. En pleines recherches sur l’économie américaine des années 1930, il reprend à son compte le terme de New Deal. À l’aube de la crise financière de 2008, Roosevelt revient justement à la mode aux États-Unis. Dans le New York Times, l’éditorialiste Thomas Friedman appelle de ses vœux l’émergence d’une « génération plus verte », notant qu’en Angleterre, la température moyenne a été la plus haute jamais relevée depuis qu’on la mesure, en 1659.
Le 15 avril 2007, dans les mêmes colonnes, il exhorte les Américains à adopter un « Green New Deal où le rôle du gouvernement ne serait pas de financer des projets, comme dans le New Deal originel, mais de lancer de la recherche fondamentale, en fournissant des garanties de prêts où cela est nécessaire et en définissant des normes, des taxes et des incitations pour toutes les formes d’énergies propres. » Pour ce journaliste peu suspect de sympathies socialistes, il en va de la position dominante des États-Unis dans le monde. Les membres du Green New Deal Group anglais tiennent d’ailleurs à assurer qu’ils n’ont rien à voir avec lui. « Je ne sais même pas qui est Thomas Friedman », jure alors Richard Murphy, un collaborateur de Colin Hines. « S’il s’est lui aussi servi du terme, c’est une coïncidence complète. »

Crédits : The Intercept
Dans son article de 2007, Friedman remarque alors que Barack Obama est en lice pour la Maison-Blanche, que les États-Unis ont besoin de leur premier président vert. Arrivé au pouvoir en plein crise financière, Obama annonce un plan d’investissement de 150 milliards de dollars en dix ans dans la recherche sur les énergies renouvelables, avec l’espoir de créer cinq millions d’emplois.
À ce « Green New Deal », le Premier ministre britannique Gordon Brown répond par un grand programme de travaux publics de plusieurs milliards. « Il y avait beaucoup d’intérêt pour le sujet », se souvient Colin Hines. Puis le vent a tourné. En contre-point des références à Roosevelt, le parti conservateur de David Cameron exhume le terme « austérité » utilisé juste après la Seconde Guerre mondiale pour en faire la promotion. Les coupes sombres dans les dépenses publiques se succèdent un peu partout en Europe.
En février 2018, une économiste du Green New Deal Group, Ann Pettifor, invite deux confrères américains. Ces collaborateurs d’Alexandria Ocasio-Cortez ramènent à New York l’idée d’un projet de relance par l’écologie sur le modèle Roosevelt. « Avant d’être élue à la Chambre des représentants, AOC a appelé Ann Pettifor et en a discuté avec elle », raconte Colin Hines. Devenue depuis un axe majeure de sa campagne, la mesure trouve un immense écho dans les médias et fait frémir les multinationales. « Elle n’est pas prête de sortir des radars », assure Coline Hines.
Couverture : Bernie Sanders et Alexandria Ocasio-Cortez face à l’urgence climatique.
L’article Les multinationales doivent-elles financer la transition écologique mondiale ? est apparu en premier sur Ulyces.
03.02.2021 à 00:57
Comment on a perdu le sommeil et comment le retrouver
Malaurie Chokoualé Datou
La tête délicatement penchée vers le micro de droite, sa longue queue de cheval légèrement balancée sur le côté, Rosalía jette tour à tour des coups d’œil rieurs à la caméra et au groupe qui l’observe dans un silence amusé. À voix basse, la chanteuse barcelonaise alterne entre les deux bonnettes noires, à tel point que […]
L’article Comment on a perdu le sommeil et comment le retrouver est apparu en premier sur Ulyces.
Texte intégral (3153 mots)
La tête délicatement penchée vers le micro de droite, sa longue queue de cheval légèrement balancée sur le côté, Rosalía jette tour à tour des coups d’œil rieurs à la caméra et au groupe qui l’observe dans un silence amusé. À voix basse, la chanteuse barcelonaise alterne entre les deux bonnettes noires, à tel point que l’auditeur·rice la sent presque tourner autour de sa tête. Les franges de diamants qui lui coulent des épaules et des bras accrochent la lumière des projecteurs et parachèvent ce tableau hypnotisant.
« Il y a un autre son que j’adore faire quand je danse », susurre Rosalía en joignant les doigts. « Le public ne l’entend peut-être pas, mais il le voit, vous savez, il le sent. » L’air concentré, elle claque des doigts d’un micro à l’autre, avant de terminer sa performance par un petit rire enchanté. En proposant dès 2016 à des célébrités de s’improviser youtubeur·euse ASMR le temps d’une vidéo, W Magazine surfait sur la popularité sur YouTube de ces « massages cérébraux », propices à la relaxation et à l’endormissement.
Les chercheurs·euses Emma Barratt et Nick Davis ont étudié ce phénomène encore méconnu et sont arrivés à la conclusion que la majorité des participant·e·s regardaient des vidéos ASMR pour se détendre ou pour dormir. Iels ont en outre observé une amélioration temporaire des symptômes liés à la dépression. En définitive, l’ASMR est symptomatique d’une partie de la population qui ne sait plus qui vers qui se tourner pour trouver le sommeil.
Pour certains toutefois, le sommeil semble être une nuisance chronophage, alors que la médecine continue à marteler ses vertus. « On ne dort pas assez, mais on pense aller bien », souligne Jöran Albers, co-fondateur de Shleep, une start-up d’experts du sommeil qui veut inciter les entreprises à prendre en compte les nuits de leurs employé·e·s. « Il y a quelques années, je bossais comme un fou et j’en étais donc le parfait exemple, puis j’ai réalisé que quelque chose n’allait pas. »

Crédits : Eight Sleep
Quatre milliards de cernes
Après avoir travaillé pendant plusieurs années au sein du cabinet international de conseil en stratégie et management Bain & Company, Jöran Albers s’est senti empreint d’une grande lassitude. Ses collègues, si intelligent·e·s et préoccupé·e·s de leur santé qu’iels fussent, ne semblaient pas heureux·euses. « J’ai démissionné et je sentais que quelque chose n’allait pas dans le monde de l’entreprise », raconte Albers au Web Summit à Lisbonne, début novembre.
Un ancien camarade de l’Institut européen d’administration des affaires (Insead) lui a alors suggéré d’entrer en contact avec Els van der Helm, une experte du sommeil, passionnée depuis l’adolescence par le sujet. Après un doctorat en psychologie à l’université de Californie à Berkeley, celle-ci a travaillé comme consultante en management pour McKinsey & Company. Le peu de considération donné au sommeil et à ses bienfaits pour les employé·e·s l’a stupéfaite. Quand sa route a croisé celle de Jöran Albers, en 2016, elle avait déjà quitté McKinsey.

Jöran Albers et Els van der Helm ont créé Shleep en 2016
Crédits : Shleep
Tou·te·s deux ont comparé leurs expériences et échangé leurs connaissances. « Au début, j’étais sceptique à l’idée de monter un business autour du sommeil », sourit Jöran Albers. « Mais on a commencé à passer en revue des recherches sur le sujet, et c’est là que j’ai réalisé que c’était un problème majeur, dont personne ne parlait, alors que cela empire chaque année. » Shleep était né.
Selon les fondateurs·rices de Shleep, le problème est toujours royalement ignoré à ce jour. « Deux milliards de personnes continuent de ne pas dormir assez », appuie Albers. Si les données sur lesquelles s’appuient Shleep sont principalement américaines, elles sont la preuve d’une situation que la start-up a décidé de globaliser : nous dormons moins en comparaison avec les décennies précédentes. D’après Shleep, près de 8 % de la population essayait de vivre avec six heures ou moins de sommeil par nuit en 1942. L’année dernière, cette part atteignait 50 %.
En outre, les jeunes sont particulièrement exposé·e·s aux troubles du sommeil. Selon une étude rendue publique en mars 2018 par l’Institut national du sommeil et de la vigilance (INSV) et la mutuelle MGEN, 82 % des jeunes entre 15 et 24 ans ont déclaré être fatigués durant la journée et 38 % ont admis dormir moins de sept heures par nuit. En outre, selon l’Inserm, 13 % des 25-45 ans considérairent le sommeil comme une perte de temps en 2017.
Pourtant, « le sommeil est crucial pour de nombreuses parties de notre corps et de notre esprit », déclare Aric Prather, scientifique du sommeil à l’université de Californie à San Francisco (UCSF), qui étudie les causes et les conséquences des nuits trop courtes. « Le sommeil est comme le lave-vaisselle du cerveau », explique Prather.

Crédits : Eight Sleep
Non seulement il renforce le système immunitaire, mais il aide à réguler le métabolisme. De plus, il sert à éliminer les toxines qui s’accumulent dans le cerveau et peut prévenir les maladies neurodégénératives, comme Alzheimer ou Parkinson. L’Inserm rappelle en outre qu’un « sommeil insuffisant chez les adolescent·e·s est corrélé à un plus petit volume de matière grise. »
Seulement, il ne suffit pas de se coucher pour se reposer. Chez les jeunes, les chercheurs·euses de l’INSV ont expliqué cette dette de sommeil à la fois par des difficultés à s’endormir et par des réveils impromptus durant la nuit. Ces troubles sont causés non seulement par une exposition intense aux écrans, mais également par un manque d’activité physique et par des rythmes décalés de sommeil entre les jours de la semaine et le week-end.
« Les raisons sont multiples », approuve Albers. « Bien sûr, la technologie joue un rôle majeur dans cette diminution. » Les écrans peuvent avoir des effets nocifs sur le sommeil. D’après une étude menée par des chercheurs de l’université d’Haïfa en 2017, une exposition intense à leur lumière bleue peut entraîner un endormissement retardé et avoir un impact sur la qualité du sommeil. « La solution doit être l’utilisation de filtres qui empêchent l’émission de cette lumière », explique Abraham Haim, l’un des auteurs de l’étude.
Albers rappelle que la plupart des êtres humains ont besoin de dormir sept à neuf heures par jour; une nuit de plus de huit heures de sommeil est par ailleurs conseillée pour les jeunes entre 15 et 24 ans. Une perte de sommeil n’est pas sans effet sur le corps humain, les études sont toutes d’accord sur ce point. Il existe bien des personnes capables de continuer à vivre normalement avec moins de six heures de sommeil mais, d’après Albers, leur nombre ne correspond qu’à 1 % de l’humanité. « Et il est inutile de vous entraîner, vous ne pouvez rien changer à cela car c’est déterminé génétiquement », poursuit le co-fondateur de Shleep.

Crédits : Matthew T Rader
Shleep vend à ses clients des plateformes de coaching du sommeil à destination de leurs employé·e·s et les accompagne dans leur déploiement. Outre l’application qui se charge de guider l’utilisateur·rice dans sa quête du sommeil, ce·tte dernier·ère dispose d’outils pouvant l’aider à se relaxer ou encore d’accès à des webinars sur différents sujets. « Nous mettons également en contact les personnes avec un expert du sommeil si leurs troubles sont importants », ajoute Albers. « Après huit semaines, on observe qu’on peut diminuer la perte de sommeil de 40 % en 8 semaines, et augmenter la qualité du sommeil de 50 % », ajoute-t-il.
Même si les bénéfices d’un sommeil plus long ne sont pas facile à mesurer, « on demande à nos clients de nous communiquer leur productivité et leur performances, avec en moyenne une amélioration notée de 15 % en 8 semaines », ajoute l’entrepreneur – car évidemment, les entreprises s’intéressent davantage au bien-être de ses employé·e·s quand celui-ci les rend plus productif·ve·s.
Shleep part du principe qu’une entreprise a tout à gagner en s’adaptant aux besoins de ses employé·e·s, que ce soit en termes d’efficacité, de bien-être au travail et de productivité. Chacun·e dispose d’une horloge biologique du sommeil différente, et c’est justement cette particularité qui intéresse une autre start-up, Eight Sleep, qui a justement mis la technologie au service du sommeil.
La tech comme antidote
Le monde de la tech n’est pas désarmé face au manque de sommeil. Puisque, selon la formule du poète Hölderlin, « là où croît le péril croît aussi ce qui sauve », Eight Sleep a créé un lit intelligent. La co-fondatrice de la start-up, Alexandra Zatarain, affirme sentir « une énorme différence » depuis qu’elle s’en sert.
« Quand nous avons commencé il y a quelques années, le concept-même de lit intelligent n’existait pas », rappelle Alexandra Zatarain, qui observe un intérêt grandissant pour les technologies du sommeil.
Aujourd’hui, Eight Sleep voit le nombre d’acteurs dans ce domaine se multiplier. Apparaissent des objets connectés (comme des couettes ou des oreillers), des applications proposant de la méditation guidée, des simulateurs d’aube pour permettre un réveil progressif, et bien d’autres solutions. « On observe le développement d’un mouvement autour du fait que le sommeil améliore la performance, qu’il est naturel, qu’il est gratuit, et que si vous arrivez à l’optimiser vous noterez des bénéfices élevés », conclut Zatarain.

Crédits : Eight Sleep
Eight Sleep est née en 2014 des troubles de sommeil de son PDG, Matteo Franceschetti, par ailleurs conjoint d’Alexandra Zatarain. À l’époque, l’ancien avocat désormais entrepreneur jonglait entre différentes entreprises et voyageait d’un bout à l’autre de la planète. Son sommeil s’en est trouvé affecté. « Il a commencé à étudier différentes solutions, comme le fait de suivre des données liées à son sommeil », raconte Zatarain.
Après avoir essayé toute une série d’applications, qui proposaient par exemple de laisser son téléphone sur son matelas, Franceschetti a réalisé qu’il y avait « un énorme décalage sur le marché ». Il s’est rendu compte « qu’il n’y avait pas de produit permettant d’analyser le sommeil d’un individu avec précision pour changer le comportement ou le facteur qui pouvait l’affecter ». L’idée du projet Eight Sleep a commencé à germer.
L’objectif originel était de pister l’état du sommeil et de collecter des données. Eight Sleep a tout d’abord planché sur la conception d’un accessoire pouvant être placé sur n’importe quel matelas : Smart Tracker, un protège-matelas à la pointe de la technologie, tentant de répliquer ce qui est réalisé au niveau médical. Voyant l’engouement suscité par son premier produit, Eight Sleep a intégré sa technologie directement dans un lit, proposant en outre à l’utilisateur·rice de suivre ses données grâce à une application.

Crédits : Eight Sleep
Le couple voulait à tout prix éviter à l’utilisateur·rice de devoir charger, brancher ou porter quoi que ce soit. « Les prototypes que nous avions faits permettaient simplement d’aller au lit pour recevoir différentes informations », ajoute Zatarain. Quatre ans après le lancement du premier produit, grâce à des capteurs logés dans le matelas, ce dernier est capable de calculer le temps total de sommeil, celui des phases de sommeil, la température du lit, la fréquence cardiaque ou encore la fréquence respiratoire. « Il s’agit une image complète de votre sommeil », résume-t-elle.
Selon Zatarain, la clé du lit est sa capacité à réguler la température. « Même les lits les plus confortables absorbent en général la chaleur du corps beaucoup plus rapidement et celle-ci ne se propage pas dans l’environnement », explique-t-elle. Cette chaleur trouble le sommeil du·de la dormeur·euse. « Vous vous réveillez plus, vous ne pouvez pas rester en sommeil profond aussi longtemps que vous le pourriez », poursuit-elle.
Avec son lit hi-tech, la start-up se targue de résoudre ce problème, car son produit phare, le matelas haut de gamme The Pod (disponible aux États-Unis pour 2 295 dollars), dispose d’une régulation de température personnalisée. Loin des outils technologiques proposés par certaines start-ups, et parce que l’innovation n’a pas toutes les réponses aux problèmes de sommeil, des spécialistes proposent également des solutions simples faciliter l’endormissement.
Loin de toute technologie
Si différentes techniques peuvent fonctionner en fonction du profil, de la méditation à la relaxation des muscles un à un, pour remédier à la dette du sommeil chez les jeunes, l’Institut national du sommeil et de la vigilance leur propose une série d’astuces, loin de toute technologie. La pratique quotidienne d’une activité physique, à raison de trente minutes par jour, est tout d’abord vivement conseillée, toutefois pratiquée entre 4 h et 8 h avant de se coucher. Selon le médecin du sport et spécialiste du sommeil Fabien Sauvet, « ceux qui font du sport s’endorment mieux et plus tôt […], les bénéfices du sport se font sentir quand les séances sont régulières ».
Selon l’INSV, il faudrait en outre « adopter des rythmes réguliers » permettant de synchroniser le rythme veille-sommeil et l’horloge biologique, « en limitant grasse matinée et sieste prolongée » et instaurer « couvre-feu digital » une heure avant de dormir, préférant des activités d’autant plus relaxantes, « comme la lecture ou la musique ». De plus, les excitants comme le café ou le thé retardant l’endormissement, l’Institut recommande de les limiter après 15 h.

La co-fondatrice de la start-up Eight Sleep, Alexandra Zatarain.
Enfin, l’environnement doit être propice au sommeil; de la lumière au bruit, rien ne doit lui nuire au cours de la nuit et maintenir une température de 19°C dans la chambre est idéal en ce sens. De plus, « le lit doit être réservé au sommeil », alerte la pneumologue Maria Pia d’Ortho pour l’INSV. « Ce type de comportement favorise l’ insomnie sur le long terme ».
Enfin, changer ses mauvaises habitudes de sommeil est un processus long qui se réalise pas à pas. « Si vous avez été vous coucher à 1 h pendant des années, il ne faut pas vous attendre à vous endormir à 21 h comme par magie », explique Albers. « Cela ne marchera pas pour tout le monde. » Pour lui, nous sommes sur le point d’entrer dans une révolution du sommeil. Pour le prouver, il tente un parallèle avec la série Mad Men, dans laquelle des publicitaires machistes aux réflexions cyniques ne travaillent jamais sans leurs clopes ou leur verre de whisky.
« Complètement normale dans les années 1960, une situation pareille serait difficilement acceptable aujourd’hui », explique Albers, qui pense entrevoir un chemin similaire pour le sommeil. « Dans 5, 10, 15 ans, on regardera en arrière en se demandant à quoi on pensait à ne dormir pas assez, car c’est la chose la plus bête qui soit. »
Couverture : Ben Blennerhassett
L’article Comment on a perdu le sommeil et comment le retrouver est apparu en premier sur Ulyces.
01.02.2021 à 00:21
À quoi ressemblera la Birmanie du futur ?
Servan Le Janne
Aung San Suu Kyi a été arrêtée par l’armée birmane. C’est ce qu’affirme ce lundi 1er février le porte-parole du parti au pouvoir : la dirigeante a été placée en détention, aux côtés de plusieurs hauts représentants de la Ligue nationale pour la démocratie (NLD), et les militaires ont transféré le pouvoir à leur commandant […]
L’article À quoi ressemblera la Birmanie du futur ? est apparu en premier sur Ulyces.
Texte intégral (1859 mots)
Aung San Suu Kyi a été arrêtée par l’armée birmane. C’est ce qu’affirme ce lundi 1er février le porte-parole du parti au pouvoir : la dirigeante a été placée en détention, aux côtés de plusieurs hauts représentants de la Ligue nationale pour la démocratie (NLD), et les militaires ont transféré le pouvoir à leur commandant en chef avant de déclarer le pays en état d’urgence pour un an.
Selon Myo Nyunt, Aung San Suu Kyi serait détenue dans la capitale, Naypyidaw, et l’armée aurait organisé un véritable « coup d’État ». Une tempête soudaine qui drape l’avenir de la Birmanie un peu plus dans le flou. Pour avoir une idée de ce qui peut advenir, il faut regarder dans son passé, récent et plus lointain.
La fosse
Avec une régularité glaçante, les coups de pelles retournent la terre birmane. À côté du groupe de bouddhistes occupé à creuser, dix de leurs voisins rohingyas attendent la mort attachés les uns aux autres. En cette fin août 2017, un « nettoyage ethnique » démarre selon les Nations Unies dans l’État d’Arakan, à l’ouest du pays. Une semaine après le début de l’offensive des forces de sécurité du Myanmar, quelque 47 000 personnes ont déjà fui vers le Bangladesh voisin. À Inn Din, non loin de la frontière, dix corps sont retrouvés dans une fosse commune le matin du 2 septembre. Deux ont été battus à mort par des civils, et le reste a été tué par les balles de l’armée.
Il y avait « une tombe pour dix personnes », décrit Soe Chay, un soldat à la retraite de la communauté bouddhiste du village qui dit avoir été témoin de cet affreux enterrement. D’après lui, les soldats ont tiré sur chaque homme deux ou trois fois. « Alors qu’ils étaient inhumés, certains faisaient encore du bruit, d’autres étaient déjà morts. » Son témoignage a été recueilli par deux journalistes birmans de l’agence Reuters, Wa Lone et Kyaw Soe Oo. Au moment de la parution de leur article, en février 2018, 690 000 Rohingyas ont fui. Il ne reste aucun des 6 000 membres de cette communauté à Inn Din, mais le duo est parvenu à mettre un visage et un nom sur les dix hommes enterrés. Ils s’appelaient Abul Hashim, Abdul Malik, Nur Mohammed, Rashid Ahmed, Habizu, Abulu, Shaker Ahmed, Abdul Majid, Shoket Ullah et Dil Mohammed.
Lorsque le monde les découvre, Wa Lone et Kyaw Soe Oo croupissent en prison. Arrêtés le soir du 12 décembre, ils ont été transportés vers un centre d’interrogatoire avec des cagoules noires sur le visage. D’après leurs témoignages, ils ont été privés de sommeil pendant trois jours et Kyaw Soe Oo raconte avoir été forcé à rester à genoux trois heures durant. La police nie. Puis, un an et un jour après la découverte de la fosse d’Inn Din, les reporters sont condamnés à sept ans de prison par un tribunal de Yangon (ex-Rangoun). La justice les accuse notamment d’avoir été en possession de « documents confidentiels » pouvant être utilisés par « des ennemis de l’État et des organisations terroristes ». Au cours de l’enquête, un témoin a raconté avoir vu la police glisser des documents sur eux pour leur tendre un « piège ».
Mardi 7 mai 2019, après plus de 500 jours de détentions ponctués par une campagne internationale en leur faveur, Wa Lone et Kyaw Soe Oo ont finalement été libérés dans le cadre d’une procédure d’amnistie. Encerclé par une nuée de confrères à sa sortie de prison, le premier a déclaré avoir « hâte de retourner à la rédaction » et de « revoir [s]a famille et [s]es collègues ». La tâche devrait lui être facilitée par le prix Pulitzer qu’il a reçu avec son collègue pour l’enquête sur Inn Din. Célébrés par l’Unesco, les deux hommes figurent aussi parmi les personnalités de l’année 2018 du magazine Time. Et la grâce qui leur a été accordée marque « un pas vers une plus grande liberté de la presse et un signe de l’engagement du gouvernement en faveur de la transition démocratique en Birmanie », se félicitent les Nations Unies.
Toutes les barrières ne sont néanmoins pas levées pour que la Birmanie emprunte un chemin démocratique, loin s’en faut. Selon l’Assistance Association for Political Prisoners, 25 prisonniers politiques sont encore derrière les barreaux et 283 autres attendent un jugement. L’association en faveur de la liberté d’expression Athan déplore du reste que 173 affaires de diffamation soient passées devant les tribunaux en vertu d’une loi votée en 2013 qui est utilisée pour « étouffer les critiques des autorités de la part des journalistes et des citoyens », juge l’ONG Human Rights Watch. Or, 140 de ces procès ont été ouverts sous le gouvernement d’Aung San Suu Kyi, une Prix Nobel de la paix au pacifisme aujourd’hui bien relatif.
Étrangère aux affaires
L’exode birman n’en finit plus. Au Bangladesh voisin, où 700 000 personnes ont afflué depuis le 25 août 2017, il y avait déjà près de 26 000 réfugiés dans des camps en 1997. À l’époque, le régime militaire en place à Rangoun impose son joug sans partage. Contraint d’organiser des élections en 1990, après un soulèvement, il en a invalidé les résultats et mis la vainqueure, Aung San Suu Kyi, en résidence surveillée. Lauréate du prix Nobel de la paix en 1991, cette fille d’un acteur de l’indépendance profite de sa libération pour prendre la plume en 1997. Pour mettre en lumière l’autoritarisme de la junte, le New York Times lui ouvre ses colonnes.
« Ceux d’entre nous qui ont décidé de travailler pour la démocratie », écrit-elle dans la tribune, « ont fait ce choix avec la conviction que le danger de se soulever pour les droits humains élémentaires dans une société répressive était préférable à la sécurité offerte par une vie silencieuse dans la servitude ». Tête de proue d’un mouvement non-violent, elle croit savoir que « la cause de la liberté et de la justice trouve des échos favorables dans le monde. Partout, peu importe les couleurs de peau ou les croyances, les gens comprennent le besoin humain pour une vie qui va au-delà de la satisfaction de désirs matériels. » Cet appel à la communauté internationale est donc baptisé « s’il vous plaît, utilisez votre liberté pour promouvoir la nôtre ».
Une décennie de lutte plus tard, la junte accepte sous la pression de la rue de réformer la constitution de manière à organiser des élections. Aung San Suu Kyi devient ainsi députée en 2012. À ce poste, alors que l’association Human Rights Watch dénonce une « campagne de nettoyage ethnique », elle refuse de qualifier ainsi les violences contre les musulmans. Comme elle a été mariée à un étranger, la constitution empêche l’ancienne opposante de briguer le poste de présidente. En 2016, elle devient donc conseillère spéciale de l’État et ministre des Affaires étrangères.
Les diplomates étrangers qui plaidaient la cause de Wa Lone et Kyaw Soe Oo n’ont donc guère été étonnés de sa réticence à les soutenir. Irritée par leur lobbying, elle s’est longtemps bornée à s’en remettre à la justice pour tout ce qui concerne ce qu’elle appelle pudiquement « le problème d’Arakan ». Après leur condamnation, le 13 septembre 2018, l’ancienne opposante a assuré, lors du Forum économique mondial de l’Association des Nations d’Asie du Sud-Est à Hanoï, qu’ « ils n’ont pas été emprisonnés parce qu’ils étaient journalistes ».
Alors que l’on pouvait s’attendre à ce que des tensions apparaissent au sommet de l’État entre Aung San Suu Kyi et l’armée, leurs positions semblent au contraire s’aligner, en sorte que la presse américaine ne cesse de pointer sa « déchéance » et qu’Amnesty International lui a retiré un prix. À en croire le journaliste Aung Naing Soe, les critiques qui la visent ou qui visent son parti, La Ligue nationale pour la démocratie (LND), « exposent à des problèmes, surtout quand il est questions des Rohingyas ». Au Comité de protection des journalistes birmans, on souligne même que les reportages sur les violations des droits humains par les militaires entraînent plus de « problèmes » que par le passé.

Un camp de l’État d’Arakan
Crédits : DFID – UK Department for International Development
Alors que 700 000 personnes ont maintenant fui l’Arakan, les élections qui doivent se tenir fin 2020 ont peu de chance d’apaiser les tensions. « Parce que le rapatriement des Rohingyas est largement impopulaire, le sujet sera politisé par les partis qui chercheront à capitaliser sur les conflits latents qui conduisent à la violence », pressentent les chercheurs Mary Callahan et Myo Zaw Oo, dans un rapport publié par l’American Institute for Peace en avril. Vainqueure de 79 % des sièges lors du scrutin de 2015, la LND a d’autant plus de chance de conserver sa majorité qu’elle réalise ses moins bons scores dans les zones où vivent beaucoup de minorités, comme l’Arakan. Lequel Arakan a été déserté par ses musulmans.
Dans cet État où une guérilla s’organise, la Chine fait pression pour reprendre le chantier de barrage qu’elle a lancé avec l’appui d’Aung San Suu Kyi. Avant les élections de 2020, les sujets ne manquent pas pour Wa Lone et Kyaw Soe Oo.
Couverture : Chinh Le Duc
L’article À quoi ressemblera la Birmanie du futur ? est apparu en premier sur Ulyces.
29.01.2021 à 00:01
Le monde sera-t-il sauvé par des adolescents ?
Nicolas Prouillac et Arthur Scheuer
Les résultats sont éloquents. D’après un sondage mené auprès d’1,2 million de personnes dans 50 pays par le Programme des Nations unies pour le développement et l’université d’Oxford, les jeunes sont de loin la population la plus convaincue que le monde fait aujourd’hui face à une « urgence climatique ». C’est notamment le cas de […]
L’article Le monde sera-t-il sauvé par des adolescents ? est apparu en premier sur Ulyces.
Texte intégral (4439 mots)
Les résultats sont éloquents. D’après un sondage mené auprès d’1,2 million de personnes dans 50 pays par le Programme des Nations unies pour le développement et l’université d’Oxford, les jeunes sont de loin la population la plus convaincue que le monde fait aujourd’hui face à une « urgence climatique ». C’est notamment le cas de 83 % des jeunes Canadiens et Allemands, 82 % des Australiens, 81 % des Japonais, 77 % des Français et 75 % des Américains. C’est aussi aux jeunes qu’il appartiendra de sauver le monde.
Climate Fridays
C’est une fille seule au milieu de l’eau. Avec son visage rond et ses nattes, Greta Thunberg semble un peu perdue devant l’imposante façade baroque du parlement suédois, sur l’île de Helgeandsholmen, dans le centre de Stockholm. Ce matin d’août 2018, elle s’est levée comme d’habitude, a pris son petit-déjeuner, quelques prospectus, et s’est postée à l’entrée du Riksdag, copiant l’action des étudiants de Parkland contre les armes à feu aux États-Unis. L’adolescente fait le siège d’un dérèglement climatique meurtrier. Depuis qu’un instituteur lui a montré des photos de monceaux de plastique dans l’océan et d’ours polaires cacochymes, elle ne le supporte pas.
« Et puis quelques médias ont commencé à parler de moi », raconte-t-elle. « Le deuxième jour, des gens m’ont rejoint. Depuis, je ne suis presque plus jamais seule. » La Suédoise de 16 ans raconte son histoire dans un documentaire qui sort ce 23 mai 2019, à l’occasion d’un nouveau jour de grève mondiale en faveur du climat. La mobilisation a lieu à 1594 endroits dans 118 pays, annonçait-elle hier sur Twitter. En mars, le dernier « vendredi pour le futur » avait rassemblé 1,6 million de personnes dans 125 pays. L’affluence monte irrémédiablement, comme le niveau des océans. Pour faire barrage, les jeunes sont au premier rang.
« Depuis maintenant plusieurs mois », écrit un communiqué partagé en amont des manifestations du 24 mai, et signé par 77 organisations, « la jeunesse, consciente des dangers qu’elle encourt pour son avenir, se mobilise massivement partout dans le monde : Youth For Climate et Fridays For Future à l’international sont devenus le symbole du passage à l’action d’une génération déjà pleinement consciente des changements à effectuer dans notre modèle sociétal. » En France, des rassemblements doivent avoir lieu place de l’Opéra à Paris, à 13 heures, et dans des dizaines d’autres villes.

À Davos, en janvier, Greta Thunberg s’inquiétait que « les adultes n’arrêtent pas de dire qu’ils nous sont redevables de leur donner de l’espoir. Mais je ne veux pas de votre espoir. Je ne veux pas que vous voyez plein d’espoir, je veux que vous paniquiez. J’aimerais que vous ressentiez la peur que je ressens chaque jour. Et ensuite je veux que vous agissiez. » Car, s’il fallait encore le dire, la situation est particulièrement critique. Les 11 et 12 mai derniers, le température a atteint un pic extraordinaire de 29°C à l’entrée de l’océan Arctique, au nord-ouest de la Russie. Ce week-end-là, l’observatoire de Mauna Loa en Floride relevait une concentration de dioxyde de carbone dans l’atmosphère de 415 parties par million, soit le plus haut niveau sur 800 000 ans, voire sur trois millions d’années.
« Si nous continuons comme ça, en 2030 nous entraînerons une réaction en chaîne irréversible dont les événements échapperont à tout contrôle », prévient Greta Thunberg. « Ce sera sans retour. » Mise en couverture par le magazine Time la semaine dernière, la Suédoise entend maintenant « parler au monde » au nom de sa génération. Elle réclame le respect de l’Accord sur le climat de Paris et la proclamation d’un état d’urgence climatique. Sa voix porte d’autant plus qu’elle trouve un écho impressionnant chez les jeunes qui l’accompagnent.
De Johannesburg à Séoul en passant par Londres et New Delhi, la planète est tenue à bout de bras par des enfants et des adolescents. Sur leurs pancartes, à l’occasion de la grève du 15 mars, le globe bleu était accompagné d’une phrase digne d’un film de super-héros : « Sauvez le monde. » Fait-on slogan plus fédérateur ? Face à une pollution en forme de tache d’huile, contre laquelle l’innocuité des dirigeants apparaît chaque jour davantage, le mouvement gagne du terrain. C’est un moindre mal pour Greta Thunberg.
La Suédoise de 16 ans était revenue déprimée de la conférence pour le climat qui s’est tenue fin novembre en Pologne. « J’ai réalisé à quel point les gens dont dépend notre futur ne semblent pas prendre la question au sérieux », soufflait-elle. Alors des jeunes gens qui partagent son inquiétude l’ont rejoint. « Make the world Greta again », scandent-ils aujourd’hui pour contrer le négationnisme climatique de Donald Trump. Le président américain rêve de recevoir le prix Nobel de la paix mais c’est bien Greta Thunberg qui a été proposée sur une liste portant 304 noms. Les adultes sont-ils prêts à entendre le cri d’alarme de sa génération ?
L’île aux oiseaux
Derrière des torrents de houle, la silhouette d’un volcan se découpe au milieu de la brume. Après 18 jours de navigation au départ de Cape Town, à l’extrême sud-est de l’Afrique, l’archipel de Tristan da Cunha montre sa roche noire tapissée d’herbe verte. Autour des sommets culminant à 2 000 mètres de hauteur, des colonies de volatiles orbitent à l’infini, toisant les petites maisons rouge et vert déposées sur le bord comme des galets par la marée. Habitée depuis 1811, cette possession britannique qui a la réputation d’être l’île la plus reculée du monde compte aujourd’hui 260 résidents. Réfugiés en Angleterre lors de l’éruption de 1961, ils sont revenus deux ans plus tard pour planter des pommes de terre et élever des vaches, des moutons, des canards et des poulets.

L’archipel de Tristan da Cunha
Leurs jardins proprets semblent s’être détachés du Kent pour dériver dans l’Atlantique et se confondre avec le monde sauvage. Par bonheur, l’homme s’est intégré à ce rocher sans le souiller par ses usines et ses autoroutes. Mais cela a suffi pour tout bousculer. Depuis son arrivée, trois espèces d’oiseaux ont disparu : la gallinule de Tristan (Gallinula nesiotis), l’albatros de Tristan (Diomedea dabbenena) et le nésospize de Tristan (Nesospiza acunhae acunhae). « Nous estimons que ces trois espèces se sont éteintes entre 1869 et 1880 après une période de dégradation de leur environnement et de surexploitation humaine [des ressources], seul l’albatros avait une chance de survie lorsqu’en 1882 les rats noirs sont arrivés, et ont finalement entraîné l’extinction des trois espèces », notent les chercheurs Alexander L. Bond, Kevin R. Burgio et Colin J. Carlson dans un article publié par le Journal of Ornithology en janvier 2019.
Cette « petite équipe informelle », dixit Carlson, développe aussi spatExtinct, un programme permettant d’évaluer les dates d’extinctions à venir espèce par espèce. Elle s’intéresse notamment à des animaux méconnus. « Alors que les chercheurs se sont concentrés sur des extinctions fameuses comme celle du dodo, ou sur des régions très étudiées comme l’Amérique du Nord et Hawaï, les travaux sur les extinctions dans les îles sont moins nombreux », observent-ils. Or, indistinctement, la disparition des animaux les moins visibles met en danger ceux qui prennent le plus de place. Au cours de précédents travaux, Colin J. Carlson soulignait que l’ensemble de la chaîne alimentaire allait être affectée par la disparition d’un tiers des parasites dans le siècle à venir.
Aujourd’hui, il se sert de Twitter pour alerter. « Au moins 7 % des invertébrés sont probablement déjà éteints, ce qui est sans doute suffisant pour que la biosphère s’effondre », indiquait-il le 6 février 2019. La veille, le chercheur partageait des memes et des vidéos de danse depuis son compte, illustré par la photo d’un jeune homme glabre aux cheveux roux et aux lunettes rectangulaires. C’est bien lui. Colin J. Carlson est un scientifique un peu spécial. À 23 ans, cela fait plus d’une décennie qu’il cherche des solutions pour la planète. Diplômé de Stanford à 11 ans, le garçon du Connecticut a fait l’objet d’un portrait du New York Times quand il en avait 12 et, l’année suivante, il a attaqué son université en justice pour infléchir son refus de l’envoyer en travaux pratiques en Afrique du Sud.

Colin J. Carlson
En 2018, une blague du biologiste a été retweetée plus de 33 000 fois : « Vous n’êtes jamais vraiment seul le jour de la Saint-Valentin quand vous pensez à tous ces micro-organismes qui cohabitent avec vous à travers vos vaisseaux sanguins », plaisantait-il. En génie précoce, Colin J. Carlson s’est longtemps senti isolé, ou du moins en décalage. C’est désormais un exemple pour une génération d’enfants préoccupés par l’environnement. En novembre, des bataillons d’adolescents ont occupé le bureau de la nouvelle présidente de la chambre des représentants, la Démocrate Nancy Pelosi, afin de l’enjoindre à prendre des mesures en faveur de la planète. « Quel est votre plan ? » demandaient-ils à l’aide de pancartes orange, avec le soutien de la plus jeune femme élue députée, Alexandria Ocasio-Cortez, 29 ans.
« Nous cherchons à constituer une armée de jeunes gens pour faire du changement climatique une priorité politique », explique un des organisateurs, membre du 200 Sunrise Movement, Garrett Blad, 25 ans. « Nous voulons dénoncer l’industrie pétrolière et ses lobbyistes, et élire une nouvelle génération de décideurs qui défendra l’intérêt général, pas seulement une poignée de riches. » Le défi est grand. En janvier 2019, un tribunal du Colarado a débouté la demande d’associations visant à suspendre la fracturation hydraulique menée par les compagnies pétrolières dans la région. L’un des plaignants, Xiuhtezcatl Martinez, s’est fait connaître en pressant les Nations Unies (ONU) de protéger sa génération en péril en 2015, alors qu’il n’avait que 15 ans.
En décembre, la Suédoise Greta Thunberg, âgée de seulement 16 ans, a alerté contre une « menace existentielle » lors du sommet de l’ONU sur les changements climatiques (COP24). « Les jeunes comprennent les enjeux environnementaux », assure Garrett Blad. « Même ceux qui sont en sixième. Récemment, un professeur a demandé à ses élèves à quoi ressemblait le changement climatique. “Les ouragans Irma, Maria ou les incendies du sud de la Californie”, ont-ils répondu. » Colin J. Carlson n’a même pas attendu d’être au collège pour se préoccuper du problème.
Colin, 11 ans
Depuis Washington, où il vit aujourd’hui, Colin J. Carlson mesure le chemin parcouru. Pendant que les jeunes de son âge visaient le bac, il a tour à tour étudié les arts, l’environnement, l’écologie, l’évolution biologique, la philosophie, la politique et le management. Ce parcours l’a conduit à faire un stage à l’Agence nationale de protection de l’environnement et à donner des cours de biologie. À présent doctorant à l’université de Georgetown, il retourne régulièrement voir sa mère, dans le Connecticut. « J’ai grandi dans un village à la campagne où le changement climatique était un sujet très tabou », raconte-t-il. « Et je pense que ça l’est toujours. C’est d’ailleurs l’une des choses qui m’ont poussé à conduire ce genre de recherches. » Et ses capacités intellectuelles hors du commun ont aidé.
Né un 31 juillet comme Harry Potter, Colin J. Carlson sait articuler des phrases entières à un an et demi. Lorsque son père se suicide, alors qu’il a deux ans, sa mère ne le suspecte pourtant pas encore d’être en avance. « Je me rendais compte de ce qu’il faisait mais pas qu’aucun autre enfant n’en était capable », se souvient la psychologue. Lecteur de l’hebdomadaire Newsweek à 4 ans, son fils finit par faire un test qui révèle un score de QI de 145, quand la moyenne tourne autour de 100. L’homme qui l’a mis au monde avant de disparaître prématurément était lui aussi quelqu’un de brillant. Torturé par ce que les autres pensaient de lui, Cory Carlson est tombé en dépression. Colin a dû composer sans lui et sans beaucoup d’amis, tant sa différence le classait à part.
« À six ans, j’ai dessiné une carte pour mon institutrice », se remémore le jeune homme. « Je lui ai demandé de me donner des choses plus compliquées à faire mais elle a refusé de peur que j’aie ensuite encore envie de faire autre chose. » Alors il quitte l’établissement privé et se met à suivre des cours en ligne. Avant neuf ans, le jeune homme apprend le français, l’histoire européenne et la physique environnementale grâce à l’université du Connecticut, Uconn. Cela lui permet de remporter un concours organisé par le magazine National Geographic, dont le prix est un séjour aux îles Galápagos, un archipel équatorien situé dans le Pacifique.
« Si vous demandiez à un enfant de 13 ans s’il voulait jouer avec moi, la réponse était non »
« Je m’attendais à voir beaucoup de pingouins mais il n’y en avait que cinq », souffle-t-il. « J’ai appris que le nombre se réduisait à cause de la fréquence croissante du phénomène climatique El Niño, dont le changement climatique est responsable. » De retour chez lui, Colin J. Carlson s’inscrit à des cours de biologie et dévore le documentaire d’Al Gore, Une Vérité qui dérange. Sur ces entrefaites, il crée le Cool Coventry Club, une association vouée à sensibiliser aux conséquences de la pollution. En un an, elle initie 50 événements et touche 2 000 personnes, vante-t-il.
Aux sceptiques, le garçon tente calmement d’exposer la situation. « Il ne faut pas dire à ceux qui sont impossibles à convaincre qu’ils se trompent », philosophe-t-il. « J’essaye donc de trouver un terrain d’entente, en partant du fait que tout le monde veut économiser de l’énergie et de l’argent, par exemple. » Après avoir décroché un diplôme de Stanford par correspondance, le militant en herbe est invité à plaider la cause de la planète devant les élus de son État.
Colin J. Carlson a emmagasiné suffisamment de confiance en lui pour vouloir fréquenter les amphithéâtres où les problèmes sont abordés avec un certain détail. Il écrit donc une lettre à la fac. « J’ai 11 ans et j’en aurai 12 d’ici mon inscription », présente-t-il. « Ne prenez pas peur, en vérité je suis quelqu’un de très mature. » Recalé par plusieurs institutions, il est finalement accepté à Uconn, où certaines salles de classe lui demeurent toutefois inaccessibles, de même que les dortoirs. Il lui faut donc faire la navette entre la maison et le campus. À 13 ans, ne pouvant prendre part à un cours prévoyant un voyage en Afrique du Sud, il traîne l’université en justice, attirant ainsi l’attention de la presse.

Crédits : SESYNC
Les États-Unis apprennent alors à apprécier ce bourreau de travail, féru de piano et de randonnée, qui écrit des scénarios ou observe les oiseaux en dehors des cours. « Je suis irritable quand je ne travaille pas », souffle-t-il. Contrairement à la plupart des adolescents, il joue plus volontiers aux échecs qu’aux jeux vidéo et préfère la musique classique que les tubes de la radio. « Si vous demandiez à un enfant de 13 ans s’il voulait jouer avec moi, la réponse était évidemment non », remet-il. Colin J. Carlson est déjà dans la cour des grands.
Les gouvernements en procès
Tout génie qu’il est, Colin J. Carlson a encore besoin d’une calculatrice pour les opérations compliquées, et de sa mère pour l’acheter. En arrivant au centre commercial, en ce début d’année scolaire 2012, un étudiant qui passe là l’interpelle. « Hey Colin, on m’a dit que tu étais un aimant à filles », sourit-il. Le jeune homme s’est bien fait des amies mais la remarque paraît trop intéressée pour le flatter. Il dit de toute manière ne pas trop se soucier du regard des autres : « Je ne cherche ni à devenir célèbre ni à rester en retrait, je veux continuer à faire ce que je fais sans que tout le monde soit en train de m’épier. Et pour le moment, j’aimerais que personne ne se mette sur mon chemin. » Derrière cet esprit brillant se cache une volonté de fer. Des qualités qui ont poussé Business Insider à le citer parmi les 16 enfants les plus intelligents de leur génération aux côtés de Mozart, Picasso et le champion d’échecs Bobby Fischer en 2011.
Cette année-là, après avoir vu le documentaire d’Al Gore, Une Vérité qui dérange, une avocate de l’Oregon enceinte de sept mois entreprend de plaider en faveur de la planète. Julia Olson en discute alors avec une collègue qui dirige le programme juridique de l’environnement et des ressources à l’université, Mary Christina Wood. Par sa bouche, elle apprend que le militant philippin Antonio Oposa a attaqué l’État au nom de 43 enfants pour lutter contre la déforestation et la pollution de la baie de Manille. Les générations qui arrivent en seront les principales victimes, a-t-il dénoncé au début des années 1990, obtenant finalement gain de cause de la part de la Cour suprême. « Ce cas a inspiré beaucoup de juristes dans le monde », avance le directeur du Center for International Environmental Law (CIEL), Daniel Magraw. « Il était concentré sur un territoire local mais a entraîné une théorie en droit international. »

Alec Loorz
Julia Olson décide de décalquer ce types d’actions aux États-Unis en fondant l’association Our Children’s Trust. Le spécialiste du climat James Hansen, de la NASA, lui présente un adolescent prêt à ferrailler devant les tribunaux. Lui aussi frappé par le documentaire d’Al Gore, Alec Loorz s’est engagé dès 12 ans. Avec son organisation Kids vs. Global Warming comme plateforme, il a donné près de 200 conférences dans des écoles du monde entier. À l’en croire, les enfants sont bien plus inquiets de la pollution que ce que peuvent penser leurs parents. « Le fait de devenir grand-père m’a poussé à manifester », explique d’ailleurs James Hansen, qui assure à Alec Loorz que le pire peut encore être évité. « Beaucoup de jeunes réalisent qu’il est urgent d’agir et que nous n’allons pas résoudre le problème simplement en préférant le vélo à la voiture », juge le jeune homme d’aujourd’hui 18 ans.
« Aujourd’hui, c’est l’existence même de ma génération qui est en jeu », abonde un jeune homme dont les longs cheveux bruns tombent sur un costume marine. Ce 29 juin 2018, Xiuhtezcatl Martinez s’adresse d’abord aux Nations Unies dans la langue du peuple nahuatl, dont vient son prénom, puis en anglais. Il n’a que 15 ans mais est déjà parfaitement à l’aise. « C’est vrai qu’il y a peu de gens de cet âge qui discourent devant l’ONU », reconnaît-il. « Mais je parle en public depuis que j’ai six ans dont je ne suis plus vraiment stressé. Par rapport à d’autres discours que j’ai donnés, celui-là était très stérile. Tout ces gens en costume-cravate jouaient sur leur téléphone. Personne n’était intéressé. » Baptisé à l’âge de six ans selon l’alignement des étoiles, Xiuhtezcatl Martinez dit venir d’un peuple qui fait de la conservation de la planète sa mission. « Enfant, je cherchais les grenouilles et les serpents avec mon père, ça m’a fait me sentir important dans le monde », explique-t-il.
Deux mois plus tard, avec 20 autres jeunes gens, âgés de 8 à 19 ans, il porte plainte contre l’État. Ce procès « Juliana v. United States » lancé dans l’Oregon doit permettre de démontrer que le gouvernement, par ses actions responsables du dérèglement climatique, viole les droits constitutionnels des jeunes générations à la vie, à la liberté et à la propriété, et qu’il manque à son devoir de protéger les ressources publiques essentielles. « Nous ne demandons pas d’argent », précise la plaignante qui donne son nom au cas, Kelsey Juliana, « mais nous voulons que le tribunal ordonne au gouvernement de développer et de mettre en place un plan national de protection du climat basé sur les meilleurs ressources scientifiques. » C’est là que les travaux actuellement menés par Colin J. Carlson ont leur importance.

Xiuhtezcatl Martinez
Crédits : Earth Island Institute
« Le changement climatique va presque certainement entraîner des millions de mort », regrette-t-il. Dans un article publié fin 2018 par la revue Nature Climate Change, le jeune chercheur étudie les promesses de la géo-ingénierie pour corriger les désordres de la pollution en manipulant le climat. La gestion du rayonnement solaire propose par exemple d’injecter des particules d’aérosols dans la stratosphère tandis que d’autres approches préconisent de trouver un moyen pour retirer le dioxyde de carbone de l’atmosphère.
Dans tous les cas, « il est trop tôt pour savoir si ces technologie peuvent sauver des vies », prévient-il. « À l’heure actuelle, nous savons que le climat et les maladies sont étroitement liées ce qui soulève de nombreuses questions à propos de la géo-ingénierie. » En d’autres termes, la manipulation de l’environnement présente le risque d’entraîner des maladies imprévues. En faisant tomber les températures aux tropiques, la gestion du rayonnement solaire pourrait notamment favoriser la propagation de la malaria.
Les recherches sur le sujet doivent donc être complétée. En attendant, Colin J. Carlson apporte tout son soutien à Kelsey Juliana, Xiuhtezcatl Martinez, Garrett Blad et Greta Thunberg.
Couverture : We The Future / Are Earth Guardians. (Obey)
L’article Le monde sera-t-il sauvé par des adolescents ? est apparu en premier sur Ulyces.
28.01.2021 à 00:00
Que se passe-t-il avec le sperme ?
Camille Hamet
Une nouvelle fois en ce début d’année 2021, des chercheurs sont arrivés à la conclusion que les mâles de notre espèce perdent progressivement leur capacité à se reproduire. D’après une étude de chercheurs américains rendue publique le 24 janvier, les phtalates et Bphénol A, présents dans les plastiques, les cosmétiques et les emballages alimentaires, seraient […]
L’article Que se passe-t-il avec le sperme ? est apparu en premier sur Ulyces.
Texte intégral (1972 mots)
Une nouvelle fois en ce début d’année 2021, des chercheurs sont arrivés à la conclusion que les mâles de notre espèce perdent progressivement leur capacité à se reproduire. D’après une étude de chercheurs américains rendue publique le 24 janvier, les phtalates et Bphénol A, présents dans les plastiques, les cosmétiques et les emballages alimentaires, seraient à l’origines de nombreux troubles : un nombre croissant de bébés nés avec des pénis plus petits, des taux plus élevés de dysfonctions érectiles, une baisse de la fertilité ou encore l’érosion des différences sexuelles chez certaines espèces animales. Une terrible découverte qui affirme une tendance initiée il y a plusieurs décennies.
L’étude des études
Le taux de spermatozoïdes des hommes nord-américains, européens, australiens et néo-zélandais a diminué de plus de 50 % entre 1973 et 2011. C’est le constat que fait une étude publiée en juillet dernier dans la Oxford University Press, par une équipe de chercheurs de l’université hébraïque de Jérusalem, qui a passé en revue plusieurs milliers de travaux réalisés dans une cinquantaine de pays. « Nous avons utilisé le type de méta-analyse spécifique à la fine pointe de la technologie – une méthode de “méta-régression” pour modéliser les tendances de la concentration de sperme et des spermatozoïdes de 1973 à 2011 », explique l’épidémiologiste Hagai Levine, principal auteur de l’étude.
Cette méthode a permis d’étudier les propriétés des semences de 42 935 hommes. Et si le déclin du taux de spermatozoïdes qu’elle met au jour se poursuit au même rythme dans les prochaines années, les hommes occidentaux auront tout simplement perdu l’intégralité de leurs capacités de reproduction d’ici 2060. D’autant que ce déclin s’est accéléré après l’année 1995. « Nos résultats reflètent un problème de santé publique majeur en termes de fertilité masculine, et de santé masculine en général », insiste Hagai Levine. « Des études récentes ont montré qu’un faible taux de spermatozoïdes est un signe prédictif d’un taux de mortalité, de morbidité et d’hospitalisations plus élevé », ajoute-t-il. « Il est cependant nécessaire de faire davantage de recherche pour comprendre l’utilité du taux de spermatozoïdes en tant que mesure de santé et du mécanisme que cela implique. » Shaun Roman, scientifique de l’université de Newcastle, estime néanmoins que « nous ne sommes pas encore dans une situation de crise » : « Nous devrions souligner le fait qu’il suffit d’un spermatozoïde pour fertiliser un ovule et, en moyenne, les hommes occidentaux en produisent encore 50 millions par éjaculation ». Orly Lacham-Kaplan, de l’Université catholique australienne, ne juge donc pas nécessaire d’inquiéter ses « gars ». Kelton Tremellen, de l’université Flinders, en Australie toujours, pense au contraire que les hommes devraient prendre les résultats de l’étude de l’université hébraïque de Jérusalem comme « un réveil pour adopter un mode de vie sain ». « Bien que nous n’ayons pas exploré les causes du déclin du taux de spermatozoïdes, nous savons que la fertilité masculine est affectée par l’environnement, au sens large, tout au long de la vie, et surtout pendant la période critique du développement du fœtus au début de la grossesse –probablement de la 8e à la 14e semaine », affirme Hagai Levine. « L’exposition aux produits chimiques ou au tabagisme maternel au cours de cette période a une incidence négative sur les résultats masculins chez les animaux et les humains. Puis les habitudes de vie tels que le manque d’activité physique et l’exposition aux produits chimiques tels que les pesticides contribuent à réduire le nombre de spermatozoïdes dans la vie adulte. »

Crédits : Ulyces.co
Quant à Christopher Barrat, professeur de médecine reproductive à l’université de Dundee, en Écosse, il rappelle que « la question de l’éventuel déclin du taux de spermatozoïdes est un vieux débat parmi les scientifiques ». En effet, ces derniers sont conscients de la baisse du taux de spermatozoïdes depuis 1992, mais les résultats de leurs recherches ont longtemps prêté à controverse. L’étude de l’université hébraïque de Jérusalem, elle, se distingue par la qualité de son analyse, selon Christopher Barrat. « Elle a été menée de manière systématique, en tenant compte des défauts relevés sur les précédentes recherches (la méthode utilisée pour compter les spermatozoïdes, par exemple) et en comparant des études pourtant distantes de plusieurs décennies. La plupart des experts s’accordent donc à dire que les données présentées sont d’une grande qualité et que leurs conclusions, bien qu’alarmantes, sont fiables. »
Du sperme artificiel
L’étude de l’université hébraïque de Jérusalem ne relève aucun déclin du taux de spermatozoïdes chez les hommes asiatiques, africains ou sud-américains. Mais comme le note Christopher Barrat, « les données en provenance de ces régions sont, il est vrai, peu nombreuses ». Pour lui aussi, l’explication la plus rationnelle au déclin du taux de spermatozoïdes chez les hommes occidentaux est à chercher du côté de l’environnement, mais il appelle à poursuivre les recherches sur ce sujet. « Des différences existent (…) en fonction des zones géographiques », souligne-t-il. « La détermination des facteurs – génétiques ? environnementaux ? – à l’origine de ces différences sera primordiale pour parvenir à un traitement susceptible de limiter les effets négatifs de la chute du taux de spermatozoïdes. »  Parmi les polluants incriminés par le professeur de médecine reproductive se trouve le bisphénol A, composant de plastiques et de résines par ailleurs suspecté de favoriser les maladies cardiovasculaires, l’obésité et l’hyperactivité.
Parmi les polluants incriminés par le professeur de médecine reproductive se trouve le bisphénol A, composant de plastiques et de résines par ailleurs suspecté de favoriser les maladies cardiovasculaires, l’obésité et l’hyperactivité.
En 2013, une équipe de chercheurs français de l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm) a maintenu des testicules fœtaux dans des boites de culture, en exposant certains à du bisphénol A. Il est alors apparu que ces testicules produisaient moins de testostérone que les autres, ce qui a conduit les chercheurs à penser que le bisphénol A pourrait être au moins en partie responsable de la chute de la production spermatique, ainsi que de l’augmentation de l’incidence des défauts congénitaux de masculinisation et du cancer testiculaire observées au cours des dernières décennies. Mais Christopher Barrat recommande également de ne pas fumer de cigarettes, lesquelles ne contiennent pas moins de 4 000 substances potentiellement toxiques pour les spermatozoïdes, dont la cotinine, le cadmium, la nicotine, ou encore les hydrocarbures polyaromatiques. Les spermatozoïdes des fumeurs vont moins vite, sont moins nombreux dans un volume donné, et ont une forme atypique qui leur rend difficile l’accès à l’ovule. C’est ce que montre une étude menée en 2016 par une équipe de chercheurs internationale qui a recensé l’ensemble des publications scientifiques portant sur le lien entre tabac et qualité du sperme pour en sélectionner 20, incluant près de 6 000 participants. Seules deux d’entre elles suggèrent que l’arrêt du tabac est associé à une amélioration de la qualité du sperme…
« D’une manière générale, conserver un mode de vie sain a son importance », affirme Christopher Barrat. La relation entre surpoids et réduction du taux de spermatozoïdes a par exemple été démontrée par une étude conduite en 2010 par des chercheurs français sur 1 940 personnes. Selon cette étude, plus le surpoids est important, plus la qualité du sperme diminue, particulièrement en ce qui concerne la concentration et le nombre total de spermatozoïdes. La concentration en spermatozoïdes baisse de 10 % pour les patients en surpoids par rapport à ceux de poids normal, et de 20 % pour les obèses, chez qui la mobilité des spermatozoïdes baisse de 10 %. Le nombre total de spermatozoïdes, de 184 à 194 millions par millilitre (M/ml) chez les gens de poids normal, baisse à 164-186 M/ml chez ceux en surpoids, et à 135-157 M/ml chez les obèses. Et si tabac et junk food vous semblent indispensables, vous aurez peut-être bientôt la possibilité de vous procurer un sperme humain de qualité artificiel. Après tout, il existe déjà du sperme de souris de qualité artificiel. Ce sont des chercheurs chinois de l’université médicale de Nanjing qui sont parvenus à le créer à partir de cellules souches, dans le cadre d’une étude publiée dans la revue Cell Stem Cell datée de janvier 2016. Une technologie qui pourrait aider les scientifiques à étudier plus directement le développement des spermatozoïdes chez les mammifères et renforcer les efforts dans la mise au point de traitements de l’infertilité masculine chez les humains. D’autant que ce sperme artificiel a permis d’engendrer des souriceaux sains.
Couverture : Le sperme triste. (Ulyces.co)
L’article Que se passe-t-il avec le sperme ? est apparu en premier sur Ulyces.
25.01.2021 à 00:13
Poutine va-t-il diriger la Russie pour l’éternité ?
Servan Le Janne
Plus de 85 millions de paires d’yeux sont rivées sur un somptueux palais construit sur les bords de la mer Noire. La magnifique demeure de près de 18 000 m², aux faux airs de Versailles, serait officieusement la propriété de Vladimir Poutine, dénonce une vidéo publiée le 19 janvier 2021 sur la chaîne YouTube d’Alexeï […]
L’article Poutine va-t-il diriger la Russie pour l’éternité ? est apparu en premier sur Ulyces.
Texte intégral (2819 mots)
Plus de 85 millions de paires d’yeux sont rivées sur un somptueux palais construit sur les bords de la mer Noire. La magnifique demeure de près de 18 000 m², aux faux airs de Versailles, serait officieusement la propriété de Vladimir Poutine, dénonce une vidéo publiée le 19 janvier 2021 sur la chaîne YouTube d’Alexeï Navalny, le plus véhément opposant à l’actuel gouvernement de la Fédération de Russie.
L’enquête prétend démasquer un vaste système de corruption organisé autour du président russe pour la construction de ce projet, qui se chiffre à plus d’un milliard d’euros. Une « bombe » qui menace de faire vaciller le trône sur lequel Vladimir Poutine compte rester assis encore de longues années.
Le coup d’État incolore
Sous l’aigle à deux têtes des armoiries russes, Vladimir Poutine dépose une chemise jaune au pupitre de la Douma. Après avoir enchaîné les poignées de main à la tribune, devant un Parlement levé comme un seul homme, il lui fait face. Ses cheveux taupes, qui ne tirent que légèrement vers le gris, semblent avoir arrêté de tomber depuis quelques années. Le président n’a guère vieilli. Et il est peut-être là pour un moment. Ce 10 mars 2020, l’ancien membre des services secrets est venu donner sa vision de la révision constitutionnelle qu’il a impulsée en janvier. « Les Russes doivent avoir une alternative dans n’importe quelle élection », plaide-t-il, avant d’ajouter que « la stabilité est peut-être plus importante et doit être prioritaire ».
Après son intervention, les députés russes votent un amendement constitutionnel pour remettre ses compteurs à zéro. Le nombre de mandats présidentiels sera bien limité à deux, qu’ils soient successifs ou non, là où ils sont actuellement plafonnés à deux d’affilée. Mais les quatre règnes de Poutine, entre 2000 et 2008 puis de 2012 à aujourd’hui, ne compteront plus. En clair, il pourra se représenter en 2024. Cet amendement voté par 380 parlementaires et repoussé par les 44 communistes a été voté définitivement le 22 avril dernier. Poutine pourra ainsi continuer à gouverner la Russie jusqu’en 2036.
•
Le dernier écho d’un orchestre résonne contre les dorures de la salle Andreïevski, au Kremlin. Une voix grave s’élève alors d’un homme mince au visage anodin, presque effacé. Il jure sa fidélité à la constitution, la main posée sur le texte de 1993. Au-dessus de son crâne, l’aigle à deux têtes des armoiries nationales plane au milieu d’un rideau bleu roi. Ce 7 mai 2000, devant une salle levée comme un seul homme, Vladimir Poutine devient président de la fédération de Russie.
Vingt ans plus tard, sous le même aigle à deux têtes et devant une salle plus droite encore, l’ancien membre des services secrets s’engage à revisiter une loi fondamentale qui n’a guère bougé depuis lors. Devant les parlementaires, ce mercredi 15 janvier 2020, il commence par promettre l’extension de l’allocation maternité aux famille n’ayant qu’un enfant, alors qu’il fallait jusqu’ici en avoir deux pour en bénéficier. Puis, ayant écarté la perspective d’une nouvelle constitution, Poutine fait part de son désir de l’amender.
Aussitôt, un vaste pan de la presse internationale s’en prend à une réforme qui « pourrait le maintenir au pouvoir » selon Reuters, est « conçue pour perpétuer son pouvoir », écrit l’universitaire britannique Richard Sakwa dans The Conversation, ou « ouvre la voie à son règne indéfini », à en croire le Financial Times. Pour le Guardian, il ne fait aucun doute que Poutine « prévoit de rester au pouvoir après 2024 », qui marquera la fin de son deuxième et dernier mandat consécutif autorisé par la constitution. N’a-t-il pas déjà contourné cette règle en cédant la place à un affidé, Dmitri Medvedev entre 2008 et 2012, pour mieux revenir à la présidence ensuite ?
Cette fois, explique une tribune du New York Times, « le leader russe manœuvre pour rester au pouvoir indéfiniment ». Certes prévoit-il de limiter le nombre de mandats présidentiels à deux, qu’ils soient successifs ou non, ce qui empêcherait tout retour. Mais voilà, il « n’a pas besoin d’être Président pour rester au sommet », ajoute le Washington Post. Le principe de la réforme est d’ailleurs approuvé par l’intégralité des 432 membres de la Douma (chambre basse) jeudi 23 janvier, et Dmitri Medvedev a été sèchement congédié, le poste de Premier ministre revenant au discret Mikhaïl Michoustine.

Crédits : Kremlin
« C’était un homme usé, accusé d’enrichissements douteux et dont la cote de popularité était mauvaise », observe Jean Radvaniy, professeur émérite à l’Institut national des langues et civilisations orientales (Inalco) spécialisé dans la géopolitique russe. Le vice-Premier ministre Vitali Moutko, le ministre de la Culture Vladimir Medinski et la ministre de l’Éducation Olga Vassilieva payent aussi leur impopularité. En revanche, des piliers du régime comme Sergueï Lavrov (Affaires étrangères), Sergueï Choïgou (Défense) et Vladimir Kolokoltsev (Intérieur) restent.
En phase avec les titres anglo-saxons suscités, l’opposant Leonid Volkov, chef de cabinet d’Alexei Navalny, estime qu’il « est clair pour tout le monde que tout est fait pour remettre le pouvoir à Poutine à vie ». Le chef du Parti du changement, à la Douma de 2011 à 2016, Dmitri Goudkov, en parlent même comme d’un « coup d’État constitutionnel ». Seulement rien, dans les plans affichés par Poutine le 15 janvier 2020, ne ressemble à une manœuvre pour se maintenir au pouvoir.
Le président russe souhaite réviser la constitution afin de graver la suprématie de la loi russe sur le droit international dans le marbre, donner au Parlement le prérogative de nommer les membres du gouvernement, soumettre la nomination des chefs des agences de sécurité à une consultation du Conseil de la fédération et donc limiter le nombre de mandats présidentiels à deux au lieu de deux consécutifs. « Des commentateurs pensent qu’ils veut garder le pouvoir pour lui, en fait on n’en sait rien », tique Jean Radvaniy. « Il n’est pas exclu qu’il abandonne tout à condition qu’il ait mis en place une succession qu’il considère comme suffisamment stable et assurée. » Mais sont intervention à la Douma le 10 mars montre qu’il n’est pas encore décidé à céder la main.
Mentor mentor
Sous l’aigle à deux têtes projeté dans son dos, Vladimir Poutine poursuit le discours marathon dont il a le secret. « Il est important d’assurer un meilleur équilibre entre les différentes branches de l’État », déclare-t-il devant quelques mines circonspectes ce 15 janvier 2020. Si la réforme va à son terme, le Conseil de la fédération (chambre haute) aura le pouvoir de révoquer les juges de la Cour suprême et de la Cour constitutionnelle en cas d’actes déshonorants. La procédure sera initiée par le Président. Il pourra aussi mettre en branle une étude de la constitutionnalité des lois fédérales, par la Cour constitutionnelle, avant leur ratification. Enfin et surtout, le Conseil d’État deviendra une agence gouvernementale dont la fonction sera garantie par la constitution.
Rassemblement de leaders nationaux et régionaux présidé par Poutine, cet organe ne dispose pour le moment que d’un pouvoir consultatif. La réforme prévoit de lui confier la définition des « orientations de politique interne et étrangère de la Fédération de Russie et des principaux domaines de développement socio-économique ». À l’instar de Masha Gesse, journaliste au New Yorker et auteure du livre The Future Is History: How Totalitarianism Reclaimed Russia, certains imaginent donc Poutine en prendre la tête après y avoir déplacé le centre du pouvoir et « laissé une présidence éviscérée pour son successeur ».
Lors d’une interview à la télévision, le chef d’État a cependant réprouvé la perspective de devenir le « mentor » du prochain président en 2024, dans la mesure où elle entraînera la coexistence de deux centres de pouvoir, « une situation néfaste pour un pays comme la Russie » selon lui. Alors, quel rôle entend-il donner au Conseil d’État ? Sur ce mystère quasi-complet, le passé jette une lumière timide. En novembre 2000, un président encore vert réactive ce comité issu de la période soviétique. Poutine veut lui donner le rôle « stratégique » de prendre des positions sur « des sujets clés du développement du pays », « sans se substituer au travail du Parlement et du gouvernement ».

Crédits : Kremlin
À cette période, le moral du pays est loin d’être au beau fixe. « Plus de 40 % de nos citoyens vivaient sous le seuil de pauvreté, le système de sécurité sociale était en ruine, sans parler des forces armées qui avaient pratiquement cessé d’exister », retraçait-il dans le documentaire Conversations avec Monsieur Poutine, sorti en 2017. « Le séparatisme dominait. Je ne vais pas m’étendre là-dessus mais je veux juste dire que la constitution russe ne s’appliquait pas partout sur le territoire et une guerre faisait rage au Caucase – une guerre civile qui était alimentée par des éléments radicaux de l’étranger. » L’ex-officier du KGB fait là référence au conflit en Tchétchénie, pour lequel il avait promis que les « terroristes » seraient tués jusque « dans les chiottes ».
Une offensive impitoyable est aussi lancée contre certains oligarques. C’est la fin d’un règne pour ce qu’on a appelé la Semibankirchtchina sous l’ère de Boris Eltsine (1991-1999), autrement dit le gouvernement des sept banquiers : Boris Berezovski (Logovaz et Obiédinionni), Vladimir Goussinski (Most), Alexandre Smolenski (Stolitchni), Vladimir Potanine (Onexim), Mikhaïl Khodorkovski (Menatep), Piotr Aven et Mikhaïl Fridman (Alfa). L’économie russe reste toutefois centrée autour de mastodontes, puisque 23 groupes contrôlaient un tiers de son industrie en 2005.
Poutine n’en finit ni avec les oligarques ni avec la corruption, mais fait le ménage pour imposer son joug. « La politique de Poutine n’a pas eu pour but de réguler l’activité des oligarques, d’encadrer leur extension, mais de régner par des mesures discrétionnaires », juge Christof Ruehl, à cette période économiste en chef de la Banque mondiale à Moscou. Il devient ainsi petit à petit une figure non seulement incontournable mais aussi irremplaçable.
Prolongement
Deux mois après avoir juré de respecter la constitution, sous l’aigle à deux têtes, Vladimir Poutine donne son premier discours annuel à la nation. Comme il le fera vingt ans plus tard, le président russe commence, ce 8 juillet 2000, par s’inquiéter de la démographie. La population a chuté de 750 000 individus en moyenne depuis quelques années, ce qui risque, à un tel rythme, d’entraîner une perte de 22 millions de personnes dans les 15 ans à venir. À la faveur d’une embellie économique, facilitée par la reprise en main des hydrocarbures par l’État et une simplification du droit des entreprises, le taux de natalité repart à la hausse dans la seconde moitié de la décennie.
Poutine réussit donc à instiller un semblant de stabilité dans une société russe marquée par une décennie de troubles. Eltsine a donc bien choisi son successeur, après avoir longtemps tâtonné. À partir du moment où il a commencé à préparer son départ, en 1998, ce dernier a éprouvé trois Premiers ministres avant de nommer Poutine, Sergueï Kiriyenko, Yevgueniy Primakov et Sergueï Stepashin. Quand il s’est enfin décidé, il a présenté son successeur à Bill Clinton comme « un homme solide, au courant des différents sujets relevant de sa compétence. C’est aussi quelqu’un de rigoureux, fort et très sociable. »
Échaudé par l’instabilité de la décennie précédente, Poutine commence par assurer ses arrières. En 2001, une loi accorde au président russe l’immunité une fois son mandat terminé et une retraite de 580 035 roubles par mois, soit 8 460 euros. Puis la création du parti Russie unie lui assure une base parlementaire confortable, en sorte qu’il juge en mai 2003 que le gouvernement peut procéder de la majorité issue des législatives. Trois ans plus tard, le chef d’État change légèrement d’opinion.
« Je suis intimement convaincu qu’à l’ère post-soviétique, alors que notre économie se développe et que notre indépendance se consolide, de manière à définir les principes du fédéralisme, nous avons besoin d’un pouvoir présidentiel fort », affirme-t-il lors d’une conférence de presse. « Pour le moment, nous n’avons pas développé de partis politiques stables. Comment parler d’un gouvernement issu des partis dans ces conditions ? Ce serait irresponsable. »

Crédits : Kremlin
À la fin de son deuxième mandat, Poutine est si puissant qu’il est libre de choisir son successeur. Alors que certains observateurs redoutent un changement de la constitution de nature à lui permettre de rester en poste, comme Loukachenko et Karimov l’ont fait en Biélorussie et en Ouzbékistan, il assure vouloir respecter la loi fondamentale. « J’ai certaines idées sur la manière de faire évoluer la situation du pays pour ne pas le déstabiliser, pour ne pas faire peur aux gens et aux entreprises », déclare-t-il. Son choix se porte sur Medvedev, qui le nomme dans la foulée Premier ministre.
Poutine a beau avoir choisi son homme, des tensions apparaissent en 2011. Le pouvoir est contesté par de grandes manifestations de rue. Surtout, l’équipe de Dmitri Medvedev a laissé passer des résolutions aux Nations unies autorisant l’intervention d’une coalition internationale en Libye, entraînant le renversement de Mouammar Kadhafi. Cet épisode aurait convaincu Poutine de la nécessité de revenir à la présidence et aurait contribué à préciser sa stratégie au Moyen-Orient. Il s’est du reste montré résolument offensif sur la scène internationale, en annexant la Crimée en 2014. Depuis, la chute des cours du pétrole a en revanche entraîné une baisse du pouvoir d’achat.
Les mesures sociales annoncées le 15 janvier 2020 doivent contre-balancer ce bilan économique contrasté. La réforme de la constitution prévoit à ce titre une indexation du salaire minimum et des prestations sociales sur l’évolution du seuil de pauvreté. Avec le nouveau Premier ministre, Mikhaïl Michoustine, il possède quelqu’un qui « connaît très bien l’économie, s’est avéré compétent et est visiblement apprécié », remarque Jean Radvaniy. D’ici 2024, le chef d’État « va essayer différentes personnes à différents postes comme l’avait fait Eltsine ». Sauf qu’il n’est semble-t-il pas prêt à lâcher le pouvoir.
Couverture : Kremlin
L’article Poutine va-t-il diriger la Russie pour l’éternité ? est apparu en premier sur Ulyces.
22.01.2021 à 00:10
À quoi ressemblera la première colonie spatiale ?
Servan Le Janne
À une palourde, voilà à quoi pourrait bien ressembler la première colonie spatiale humaine. Et elle pourrait voir le jour – ou plutôt la nuit éternelle des espaces infinis qui nous entourent – d’ici à peine une quinzaine d’années, à en croire son concepteur l’astrophysicien finlandais Pekka Janhunen, qui la dévoilait en novembre 2020. Le […]
L’article À quoi ressemblera la première colonie spatiale ? est apparu en premier sur Ulyces.
Texte intégral (4423 mots)
À une palourde, voilà à quoi pourrait bien ressembler la première colonie spatiale humaine. Et elle pourrait voir le jour – ou plutôt la nuit éternelle des espaces infinis qui nous entourent – d’ici à peine une quinzaine d’années, à en croire son concepteur l’astrophysicien finlandais Pekka Janhunen, qui la dévoilait en novembre 2020.
Le scientifique a imaginé une station spatiale énergétiquement autonome grâce à deux miroirs géants, déployés de part et d’autre d’une base circulaire capable d’accueillir 50 000 humains, veaux, vaches, cochons et végétaux. Ce n’est pas sa seule originalité, puisqu’elle serait placée en orbite autour de la planète naine Cérès, dans la ceinture d’astéroïdes, et construite à partir de matériaux extraits directement de sa surface.
Autant dire que 15 ans semble irréaliste pour la concrétisation d’un tel projet, mais son existence ravive la soif de colonisation spatiale de l’espèce humaine, et nous amène à nous interroger sur la forme que prendra notre première véritable incursion dans l’espace, détachés de notre chère planète bleue.

Blue Moon
De la Terre, l’Homme verra bientôt une autre planète bleue scintiller comme en miroir dans le ciel. C’est la promesse faite par Jeff Bezos. Sur la scène du Convention Center de Washington, jeudi 9 mai 2019, le patron d’Amazon a présenté « Blue Moon », un appareil de 15 tonnes qui se posera sur la Lune en 2024. « Il est temps de retourner là-haut, mais cette fois pour y rester », lance-t-il à une foule de journalistes triés sur le volet. Capable de transporter 3,6 tonnes de matériel, cet alunisseur posera la première pierre de la route que l’homme le plus riche du monde veut créer dans l’espace. Il devrait atteindre le pôle sud de la Lune afin d’exploiter l’eau glacée qui s’y trouve, de manière à la transformer en hydrogène. À partir de ce carburant, il sera ensuite possible d’explorer le système solaire. « Et des choses incroyables se produiront », promet le patron d’Amazon.
Pour ne pas présenter cette mission comme un fantasme de milliardaire, Bezos assure qu’étant donnée la croissance démographique, « nous allons manquer d’énergie. C’est un problème mathématique, ça va arriver. » Alors que les ressources s’épuiseront selon lui sur Terre, le reste du système solaire est riche. « Voulons-nous stagner et rationner ou voulons-nous le dynamisme et la croissance ? » interroge-t-il. « Le choix est vite fait. Nous savons ce que nous voulons, il ne reste plus qu’à nous mettre au travail. » Pour aider la NASA à envoyer des astronautes sur la Lune, comme le veut Donald Trump, sa société Blue Origin est la mieux placée, vante-t-il : elle a été fondée en 2000, soit deux ans avant SpaceX, l’entreprise d’Elon Musk.

Crédits : Blue Origin
« Oh arrête de nous titiller Jeff », a tweeté le créateur de Tesla en apprenant la nouvelle. Le 20 juin prochain, Musk devrait donner plus de détails sur les moyens mis en œuvre dans le projet Starship pour bâtir une base habitable et autonome sur Mars. La planète rouge possède l’avantage de se situer « assez loin de la Terre », ce qui lui donne plus de chance de survie qu’une structure sur la Lune. Elle pourrait alors représenter la première de nombreuses colonies à venir.
Quant à Jeff Bezos, il ne vise pas seulement la Lune. Le patron d’Amazon songe à construire des stations spatiales orbitales géantes, dont la rotation serait source de gravité. De telles structures, imaginées par le physicien de Princeton Gerard K. O’Neill, pourraient accueillir un billion de personnes dans un cadre aussi élaboré que bucolique. « Ce serait une civilisation incroyable », s’émeut Jeff Bezos. On y vivrait constamment comme aux « meilleurs jours de Maui », une île d’Hawaï, tout en pouvant revenir sur Terre. Cette perspective n’excite d’ailleurs pas seulement le PDG. Il existe même déjà une nation spatiale avant l’heure.
Asgardia
Igor Ashurbeyli tient la Terre entre ses mains. « Aujourd’hui, Asgardia est le foyer de citoyens de plus de 200 pays », se rengorge ce quinquagénaire russe en manipulant le globe de la taille d’un enfant qui trône dans son bureau. Le « père fondateur » est un bonhomme rond à la moustache et aux cheveux blancs. Son regard céruléen perce derrière des verres sans monture et un cillement incessant. Ce 12 janvier 2017, plein de flegme, il s’adresse aux « hommes du futur » de la « nation spatiale » créée trois mois auparavant.
Pendant la première année du calendrier asgardien, lui et ses 100 000 compatriotes ont beaucoup à faire : « Approuver une constitution, élire un gouvernement, choisir un drapeau, un hymne, un insigne et beaucoup d’autres choses. » Ainsi affranchi des lois terrestres, le nouvel État pourra commencer à prévoir son installation dans l’espace. Mardi 13 juin 2017, lors d’une conférence de presse organisée à Hong Kong, Igor Ashurbeyli a annoncé le lancement d’un satellite contenant des données en septembre, une première étape avant de quitter ce monde. À terme, Asgardia doit envoyer un appareil réunissant les conditions propices à la vie. Comme dans le film Elysium (2013), cette station spatiale pourrait prendre la forme d’un gigantesque anneau tapissé de végétation et sillonné d’eau. C’est du moins le modèle à l’étude, doté de suffisamment de gravité et de ressources pour que l’espèce se perpétue loin du berceau.
Conquête
Du haut du plus grand immeuble de Hong Kong, les Asgardiens cherchent un nouveau pied-à-terre sur la voûte céleste. Mardi 13 juin, dans un gratte-ciel de la péninsule asiatique, Igor Ashurbeyli organisait la deuxième conférence de presse de la « nation spatiale ». À partir de « ce lieu qui est presque le plus proche de l’espace », il a donné à chacun de ses citoyens le droit de charger 300 kilobits de données personnelles dans le cargo orbital ATK Cygnus, qui partira pour la Station spatiale internationale (ISS) en septembre. Qu’il s’agisse d’une photo de « votre chaton, de votre voisin, de votre mère ou de votre enfant », a précisé le Russe, « vos données seront conservées pour toujours dans la mémoire de la nouvelle humanité spatiale puisqu’elles seront réinstallées dans chaque satellite d’Asgardia, pas seulement dans l’espace proche mais sur la Lune et ailleurs dans l’univers. » Quel intérêt ?
Pour John Strickland, membre du directoire de la National Space Society, la conservation d’information revêt un intérêt stratégique : « Nous sommes essentiellement entouré par des données génétiques. Elles peuvent être transportées ailleurs et restaurées dans le futur. » En cas de catastrophe, leur conservation empêcherait l’extinction des espèces connues actuellement. « Les progrès en biologie laissent augurer des vies plus longues, ce qui pourrait engendrer des problèmes économiques et sociaux », ajoute-t-il. Sans parler du risque nucléaire. Igor Ashurbeyli cite à dessein la Lune comme une première étape car l’Agence spatiale européenne (ESA) veut y installer un village. Pour faire avancer cette idée qu’il porte depuis son arrivée à la présidence de l’ESA, en juillet 2015, Johann-Dietrich Woerner a réalisé une vidéo de promotion en mars 2016 dans laquelle il vante les missions qui pourraient y être menées « dans la science, les affaires, le tourisme ou même l’exploitation minière ». Construite à l’aide des ressources de sa planète par des robots grâce à l’impression 3D, la base viendrait remplacer la Station spatiale internationale, dont le programme doit prendre fin en 2024. D’ici là, dès 2018, la Chine enverra une sonde sur le pôle sud de la Lune afin de chercher de l’eau et les États-Unis analyseront la composition du sol de Mars grâce à la mission In Sight. L’Europe a elle a dû reporter l’envoi de son rover Exomars à 2020.
« La prochaine étape logique », d’après Woerner, est la création d’une colonie évoluant en dehors de la Terre. Mais cette ambition que fait sienne Elon Musk à travers SpaceX soulève quelques questions. Pour répondre aux plus immédiates d’entres elles, un groupe de de l’ESA et de l’agence spatiale russe Roscosmos s’est mis dans les condition d’un voyage vers la Planète rouge en 2010. Baptisé Mars500, ce projet reproduisait les conditions rencontrées durant un vol spatial. « La question principale », indique l’un des participants, l’ingénieur français Romain Charles, « était de savoir si l’homme est psychologiquement et physiologiquement capable d’endurer le confinement d’un voyage vers la planète Mars, en estimant que cela prendrait huit mois à l’aller, un mois sur place et huit mois au retour ».
Après ce long périple cloué à un simulateur de l’Institut des problèmes bio-médicaux de Moscou, la réponse donnée a été oui. Mais deux facteurs extrêmement importants n’ont pas été analysés : le manque de gravité et les radiations. À mesure que l’on s’éloigne d’un astre, l’effet de son champ de pesanteur se réduit. Sujet à un flottement dans l’espace, le corps d’un cosmonaute perd des muscles et de la résistance osseuse. Il est ainsi bien plus fragile. Or, les radiations émises par l’explosion d’étoiles lointaines le mettent aussi à l’épreuve. « Quand on quitte la proche banlieue terrestre, ces dernières peuvent produire des dégâts dans le corps humain », prévient Romain Charles. À une distance raisonnable du champ magnétique de la Terre qui les dévient, les dommages ne sont pas trop graves. Mais au large, tout indique qu’elles sont mortelles. Pour s’en protéger, « on a pensé à une coque en plomb, mais c’est très lourd », explique Romain Charles. « L’eau est un bon bouclier, mais ça pose plein de problème techniques. » La NASA étudie, elle, une solution à base de nanotubes de nitrure de bore hydrogénées (BNTT). « Cette matière est très résistante, même à très haute chaleur », observe Sheila Thibeault, une chercheuse de l’agence spatiale. À l’aune des progrès techniques, la colonisation de Mars apparaît « possible » à John Strickland. « C’est une planète qui ressemble assez à la Terre, il y a certes des choses à régler, mais ça pourrait être fait en 200 ans. »
En cas d’échec du processus de terraformation, c’est-à-dire de transformation de la Planète rouge en une planète bleue, l’option d’un vaisseau auto-suffisant serait à creuser. Elle présenterait l’avantage de permettre aux Hommes d’aller d’une orbite à l’autre, en quête d’autres formes de vie. « On peut imaginer faire tourner une station cylindrique par rapport à un axe central pour créer une gravité artificielle », détaille Romain Charles. « Des systèmes à deux stations reliées par un long filin autour duquel elles pivotent ont aussi été imaginées. On a testé de petites centrifugeuses dans les stations pour créer une gravité artificielle, cela fonctionne. » Seulement, « nous sommes actuellement incapables de lancer une fusée de plus de cinq mètres de largeur », tempère John Strickland. Avant d’imaginer un cylindre où nous reproduire, il faut donc déjà savoir comment quitter la Terre. 
Tore
Un nuage de poussière avale la capsule Soyouz dès son atterrissage dans une plaine du Kazakhstan. Après six mois dans l’espace, Thomas Pesquet et Oleg Novitski retrouvent la planète qu’ils ont observée avec tant de plaisir depuis la Station spatiale internationale, à 400 kilomètres d’altitude. Ce vendredi 2 juin 2017, ils peuvent enfin retirer les combinaisons sur mesure qui les empêchaient de grandir, l’absence d’apesanteur engendrant un allongement de la colonne vertébrale. Comme si l’Homme n’était pas tout à fait préparé à prendre une telle hauteur. Il ne peut pourtant s’en empêcher. « La Terre est le berceau de l’humanité, mais on ne passe pas sa vie entière dans un berceau », disait Constantin Tsiolkovski en 1911. Auteur d’œuvres visionnaires sur l’exploration spatiale, ce scientifique russe a ouvert la voie aux avionneurs puis aux astronautes. Pour se propulser à la verticale, et donc se libérer de l’attraction, l’homme doit utiliser la réaction, théorise-t-il en 1883 dans L’Espace libre. Après avoir dessiné un « train-fusée » et un « ascenseur cosmique », il lance l’idée d’une installation spatiale rotative produisant sa propre gravité dans la nouvelle de science-fiction Au-delà de la Terre.
Une véritable ville pourrait s’y développer autour de productions industrielles et agricoles. Parmi ses inspirations, Tsiolkovski cite Jules Verne, dont les romans d’anticipation passent de main en main dans les milieux scientifiques. Inspiré par De la Terre à la Lune (1865), le physicien allemand Hermann Oberth se met à imaginer des appareils à plusieurs étages. « S’il y a une petite fusée au-dessus d’une grande et que la grande est propulsée alors que la petite est allumée, leur vitesse sera plus grande », écrit-il dans le livre La Fusée dans l’espace interplanétaire. Il y mentionne pour la première fois le mot Raumstation, c’est-à-dire « station spatiale » en allemand. L’un de ses disciples, Wernher von Braun, le reprend dans À travers la frontière spatiale en 1952.  Sur un modèle élaboré en 1928 par l’ingénieur slovène Herman Potočnik, von Braun conceptualise une roue de 76 mètres de diamètre, en orbite à 1 700 mètres autour de la Terre, dont la rotation à trois tours par minute créerait un phénomène de gravité artificielle. Vendu à quatre millions d’exemplaires, le numéro du magazine Collier’s dans lequel est publié son article en 1952 « fait grandement évoluer l’état de l’opinion publique à propos des voyages dans l’espace », souligne l’historien de la NASA Mike Wright. « Il rend réaliste l’idée d’une exploration spatiale pacifique. » L’idée se diffuse également au travers des fictions réalisées par les studios Disney, avec lesquelles il collabore. Fasciné par les étoiles des pages du magazine Astounding Stories, le fils de fermier anglais Arthur C. Clarke pense à la même époque qu’aller sur Mars prendra 100 jours dans les années 1990. D’échanges à la British Interplanetary Society, il en est venu à écrire des articles puis des livres au sujet d’invasions extraterrestres (La Fin de l’enfance en 1953) et de conquêtes spatiales (La Cité et les Astres, en 1956). Dans un registre plus terre à terre, les Soviétiques envoient Spoutnik en orbite en 1957.
Sur un modèle élaboré en 1928 par l’ingénieur slovène Herman Potočnik, von Braun conceptualise une roue de 76 mètres de diamètre, en orbite à 1 700 mètres autour de la Terre, dont la rotation à trois tours par minute créerait un phénomène de gravité artificielle. Vendu à quatre millions d’exemplaires, le numéro du magazine Collier’s dans lequel est publié son article en 1952 « fait grandement évoluer l’état de l’opinion publique à propos des voyages dans l’espace », souligne l’historien de la NASA Mike Wright. « Il rend réaliste l’idée d’une exploration spatiale pacifique. » L’idée se diffuse également au travers des fictions réalisées par les studios Disney, avec lesquelles il collabore. Fasciné par les étoiles des pages du magazine Astounding Stories, le fils de fermier anglais Arthur C. Clarke pense à la même époque qu’aller sur Mars prendra 100 jours dans les années 1990. D’échanges à la British Interplanetary Society, il en est venu à écrire des articles puis des livres au sujet d’invasions extraterrestres (La Fin de l’enfance en 1953) et de conquêtes spatiales (La Cité et les Astres, en 1956). Dans un registre plus terre à terre, les Soviétiques envoient Spoutnik en orbite en 1957.
Lancé quatre ans plus tard, le programme Apollo aboutit en 1969, quelques mois après la parution de 2001, L’Odyssée de l’espace. Son scénario est rendu célèbre par le film éponyme de Stanley Kubrick. On y découvre une station formée d’une double-roue. Au début des années 1970, alors que Soviétiques et Américains mettent sur pied des satellites en forme de tubes hérissés de panneaux solaires et thermiques, ceux des futuristes conservent le modèle cylindrique. En 1973, la NASA parvient à envoyer une espèce de moulin baptisé Skylab au voisinage de la Terre, là où Arthur C. Clarke imagine un immense vaisseau rond se déployer dans Rendez-vous avec Rama. Des concepts de roues ou de tores sont aussi esquissés à la demande de l’agence spatiale américaine par Don Davis et Rick Guidice. À l’université de Stanford, le physicien Gerard K. O’Neill reprend les sphères élaborée par John Desmond Bernal en 1929 pour proposer son propre schéma de 500 mètres de diamètre tournant à 1,9 tour par minute. Il inspirera plus tard Jeff Bezos.
Une usine spatiale
Si la station Mir (1986-2001) et la Station spatiale internationale (ISS, lancée en 1998) ressemblent plus à un étendoir qu’aux énormes donuts pensés pour accueillir une colonie, c’est que leur proximité avec la Terre ne les exposent pas aux conditions extrêmes de l’espace lointain. « La protection du champ magnétique terrestre est encore assez présente dans l’ISS, donc les astronautes subissent plus de radiation que nous sur Terre mais ça reste dans des proportions correctes », explique Romain Charles. Une micropesanteur existe ainsi dans les stations qui gravitent autour du globe. Mais la forme des satellites est surtout contrainte par la taille réduite des objets que nous sommes en mesure d’envoyer. Bâtir un anneau à l’image de celui d’Elysium réclame donc d’établir une usine dans l’espace. « Vous avez besoin de robots », explique John Strickland. « Ils pourraient œuvrer sur des rails pour ne pas avoir à se soucier de la gravité. Rendre cela soutenable financièrement nécessitera l’emploi de fusées réutilisables. » La société de Jeff Bezos, Blue Origin, œuvre en ce sens en construisant une usine de fusées en Floride.
La conquête spatiale s’industrialise. Une fois l’usine installée, elle aura comme objectif de produire un cylindre dont la rotation engendre une gravité artificielle où l’air est respirable. « Cela fait 40 ans que nous construisons des vaisseaux adaptés à la respiration humaine », rappelle un autre directeur de la National Space Society, Al Globus. « Nous avons juste besoin de les faire plus grands. » Différents filtres absorbent l’humidité dans les stations spatiales et capturent le dioxyde de carbone rejeté par la respiration, dont la toxicité à haute dose peut être mortelle. Ce système en circuit fermé engendre également de l’eau. Son autonomie repose néanmoins pour le moment sur certains composants comme le silice, régulièrement réapprovisionnés depuis la Terre.
Par conséquent, l’environnement de l’ISS présente des caractéristiques propices au développement de plantes. Sauf que faute de gravité suffisante, leurs racines, tiges et feuilles poussent en tout sens, à moins d’être guidées par de la lumière. Un jardinage méticuleux a permis à l’astronaute américain Scott Kelly de faire pousser deux fleurs de zinnia dans la Station spatiale internationale. En février 2017, des algues sont même revenues sur Terre après avoir passé 530 jours à l’extérieur de l’appareil, exposées aux radiations et aux basses températures. Or, remarque Romain Charles, « des systèmes à base d’algues microscopiques permettent de produire de l’oxygène. Ils ne fonctionnent cependant plus si elles mutent sous l’effet des radiations. » Depuis une vingtaine d’années, des chercheurs de l’université autonome de Barcelone tablent sur un écosystème pouvant fonctionner en vase clos. Basé sur le recyclage, le projet Melissa est censé se réapprovisionner en eau, en nourriture et en oxygène sans apport extérieur. Il est expérimenté sur des rats qui vivent dans l’un des cinq compartiments où les composants nécessaires se renouvellent de manière indépendante. Une ingénierie complexe : « Connecter deux compartiments, c’est gérable », relève le responsable de cette expérience menée pour le compte de l’ESA, Christophe Lasseur. « Mais lorsque nous passerons à trois, puis quatre et cinq, la complexité s’amplifiera. » En attendant, « il n’y a pas encore de système clos complet qui donne satisfaction », admet Romain Charles.
Dans l’espace, l’Homme peut en tout cas raisonnablement espérer pouvoir se reproduire. Malgré une exposition à des radiations cent fois plus élevées que celles atteignant la Terre, le sperme de douze souris ayant séjourné 288 jours dans la Station spatiale internationale a pu donner la vie. Les altérations de l’ADN n’ont pas eu d’effet néfaste sur le développement de leur progéniture, ont constaté les chercheurs japonais de l’université de Yamanashi à Kofu, en juin 2017. La nouvelle a dû réjouir le « père de la nation spatiale » Igor Ashurbeyli. Mais elle ne profitera au mieux qu’à ses petits-enfants. 
Couverture : Bienvenue sur Kalpana One. (Bryan Versteeg)
L’article À quoi ressemblera la première colonie spatiale ? est apparu en premier sur Ulyces.
21.01.2021 à 00:01
L’endroit le plus mystérieux du monde : la vraie histoire de la Zone 51
Antoine Coste Dombre
Matty Roberts est un mec sympa. Ce Californien de Bakersfield au visage bonhomme, encadré par un bouc épais et de longs cheveux châtains, affiche ses passions au vu de tous sur Internet : les grosses cylindrées, le metal, les séries B et les teckels. Ses potes l’adorent, c’est un marrant. Tout a d’ailleurs commencé par […]
L’article L’endroit le plus mystérieux du monde : la vraie histoire de la Zone 51 est apparu en premier sur Ulyces.
Texte intégral (4659 mots)
Matty Roberts est un mec sympa. Ce Californien de Bakersfield au visage bonhomme, encadré par un bouc épais et de longs cheveux châtains, affiche ses passions au vu de tous sur Internet : les grosses cylindrées, le metal, les séries B et les teckels. Ses potes l’adorent, c’est un marrant. Tout a d’ailleurs commencé par une blague sur Facebook.
Le 27 juin 2019, Matty a créé le groupe « Storm Area 51, They can’t stop all of us », où il invite la communauté à envahir la célèbre Zone 51 pour en révéler les secrets. L’idée est simple : « Ils ne pourront pas tous nous arrêter. » Étrangement séduisante. Pendant trois jours, la blague n’a fait rire que 40 personnes. Et puis le feu a pris d’un coup.
Aujourd’hui, ce sont près de deux millions de personnes qui disent vouloir se rendre sur le mystérieux site pour « voir les extraterrestres » le 20 septembre 2019. La blague ne fait pas rire l’US Air Force. « Nous décourageons quiconque de tenter de pénétrer dans une zone où nous entraînons les Forces armées américaines », a déclaré un porte-parole de l’US Air Force.

La couverture du groupe Facebook
Mais les militaires ne sont pas les seuls à s’inquiéter. Avec 184 chambres d’hôtel, deux stations-service, un supermarché et un hôpital, le comté de Lincoln, dans le Nevada, n’est pas fait pour accueillir 1,9 million de personnes. Oh bien sûr, la plupart des « participant(e)s » ne viendront pas, « mais si 500 ou 1000 personnes débarquent, nous aurons des problèmes », a confié le shérif du comté Kerry Lee au Las Vegas Sun. Les 26 policiers qu’il a sous ses ordres sont bien d’accord.
Pourtant, malgré les mises en garde, le 20 septembre prochain risque de voir un nombre étonnant de gens affluer sur les terres arides qui entourent le terrain de l’armée américaine, qui fascine le monde entier depuis 72 ans. Crash d’ovni, avions espions et photographies classées Secret Défense : voici tout ce qu’on sait vraiment de la Zone 51.
Secret Défense

William Colby
19 avril 1974. William Colby est assis devant son bureau de Langley, en Virginie, au quartier général de la CIA. Cheveux impeccablement coiffés, allure sévère et tiré à quatre épingles, le directeur de l’Agence centrale de renseignement américaine est soucieux. Il vient de recevoir un mémo faisant état d’un « petit problème » concernant une zone interdite, une portion de territoire totalement dissimulée aux civils. Le dos droit dans son fauteuil en cuir sombre, William Colby a raison de ne pas être serein : une photographie des activités de la Zone 51 pourrait avoir fuité.
En cause, les astronautes de la dernière mission Skylab, l’ancêtre de la Station spatiale internationale, réalisé par la NASA. Ils ont pris plus de 19 400 photos lors de leur dernier voyage dans l’espace. L’une d’entre elles donne à voir la base secrète la mieux gardée des États-Unis dans ses plus détails les plus intimes. L’acte était-il intentionnel ? S’agissait-il d’une simple maladresse des astronautes de la NASA ? La réponse n’a jamais été dévoilée. Mais pour William Colby, la seule existence du cliché pourrait entraîner de graves conséquences : le risque que l’image tombe aux mains des Soviétiques est trop important. Elle doit absolument être classée Secret Défense, et vite.
William Colby organise immédiatement une réunion entre les différentes agences américaines pour demander sa classification. La NASA et le département de l’Intérieur s’y opposent sans détour. Un cas classique de concurrence entre agences gouvernementales. Pourtant, un accord existe entre la NASA et les services secrets américains : toute photo prise par un satellite ou des astronautes doit d’abord passer par le Centre national d’interprétation photographique (NPIC), basé à Washington. Au sein de ce service dirigé par la CIA, on vérifie et interprète toutes les photos aériennes et satellites. Dans ce cas précis, la question est de savoir si une photo prise par un programme non classé Secret Défense peut être classifiée. La CIA obtiendra finalement gain de cause.
Plus de 40 ans plus tard, le contenu de cette image reste un mystère absolu. La photo a été retirée des dossiers Skylab 4. Face à l’influence de la CIA et à la puissance des secrets entourant la base militaire, la NASA et l’Intérieur n’ont pas eu leur mot à dire. Cette base, on l’appelle Dreamland, Watertown, The Ranch, Paradise Ranch, The Farm, The Box, Groom Lake… ou encore Zone 51. Elle conservera donc tous ses secrets. Colby peut dormir tranquille.
Groom Lake Road
Au beau milieu du désert du Nevada, dans la vallée de Tikaboo, la ville de Rachel est la seule commune à des kilomètres à la ronde. Perdue dans le comté de Lincoln à trois heures de route au nord de Las Vegas, Rachel et sa cinquantaine d’habitants sont plantés là, dans le désert du Grand Bassin des États-Unis. Un no man’s land où règne sans partage une chaleur ardente. Rachel est une ancienne ville minière de tungstène dont la plupart des habitants vivent dans des ranchs. Ici, il n’y a pas de mairie, pas de station essence, pas même de supermarché ou d’épicerie, seulement le « Little A’Le’Inn », une petite auberge qui accueille les voyageurs audacieux ou égarés.
C’est l’unique village qui donne sur la route 375, une interminable voie goudronnée qui mène droit vers les mines. Et au-delà ? Une portion de sentier terreux appelé Groom Lake Road, qui semble ne mener nulle part. Enfin, pas tout à fait. Au bout de ce chemin poussiéreux s’étend une zone interdite d’accès. La voie terreuse laisse à nouveau place à une route goudronnée qui s’enfonce et grimpe plus avant dans ces collines désertiques et inhospitalières. À la frontière entre terre et goudron, pas de barrière ou de poste de garde, juste une paire intimidante de panneaux d’interdiction d’aller plus loin, accompagnés de pancartes sommant les voyageurs de rebrousser chemin.
De multiples interdictions y sont placardées, telles que « NO DRONE ZONE » ou « PHOTOGRAPHIE INTERDITE ». Toute transgression expose l’imprudent à un maximum de 1 000 dollars d’amende et six mois d’emprisonnement.  Si un touriste un peu trop curieux s’avance près de la limite indiquée, un 4×4 blanc ou beige banalisé apparaît. En sortent deux soldats en treillis couleur sable, armes chargées aux mains, qui intiment vigoureusement le voyageur de reprendre sa route dans le sens inverse. Comment ont-ils pu s’apercevoir d’une présence intrusive ?
Si un touriste un peu trop curieux s’avance près de la limite indiquée, un 4×4 blanc ou beige banalisé apparaît. En sortent deux soldats en treillis couleur sable, armes chargées aux mains, qui intiment vigoureusement le voyageur de reprendre sa route dans le sens inverse. Comment ont-ils pu s’apercevoir d’une présence intrusive ?
Dans le ciel immense, pas un drone en vue. Le désert semble mort. Mais d’une manière ou d’une autre, tout est enregistré sur cette route. Les habitants de Rachel racontent à mi-voix que des détecteurs de mouvements se terrent partout dans la zone qui encercle Groom Lake. Jusqu’en 2013, les autorités américaines se refusaient à tout commentaire sur les activités de la Zone 51, accentuant les spéculations et le climat de mystère sur la région.
« Tous les interdits qui entourent la Zone 51 font que les gens veulent savoir ce qui s’y passe », explique l’historien Peter Merlin. Spécialisé dans l’aéronautique, il a enquêté pendant plus de 30 ans sur Groom Lake et ses énigmes. Pour lui, une seule certitude ressort des nombreux mythes qui l’entourent : la Zone 51 existe bel et bien et elle est encore active aujourd’hui. « Il est absolument certain qu’il s’y passe des choses », conclut-il. Mais quoi ?
Avions espions
La nuit du mercredi 2 juillet 1947, un orage s’abat sur la région environnant Roswell, une petite ville du Nouveau-Mexique. Dans une zone désertique et difficile d’accès, battue par une pluie diluvienne, une explosion terrible se fait entendre, accompagnée d’un arc lumineux qui traverse le ciel. Ça ne ressemble pas à un coup de tonnerre. Le lendemain, alors qu’il promène ses chèvres, William « Mac » Brazel découvre sur son terrain des débris éparpillés sur une vaste surface. Mac, chapeau de cowboy vissé sur la tête, est propriétaire d’un ranch. Comme plusieurs de ses voisins, il a déjà retrouvé sur ses terres des débris de ballons météorologiques, mais cette fois, il est surpris par l’aspect de sa trouvaille. Il en ramasse quelques-uns qu’il ramène chez lui.
Quelques jours plus tard, il se décide à faire part de sa trouvaille à George Wilcox, le shérif du comté de Chaves. Celui-ci appelle le Roswell Army Air Field, le camp militaire basé à côté de la ville. Deux soldats se rendent sur les lieux pour inspecter les fameux débris et, dès le lendemain, le colonel Blanchard fait boucler le périmètre du crash. En moins de temps qu’il n’en faut pour le dire, les débris sont ramassés et emmenés par camion à la base de Roswell.
Le jour-même, le colonel annonce, via un communiqué, que les débris retrouvés proviennent d’une « soucoupe volante ». En un rien de temps, toute la presse du pays est en effervescence et se rue dans le région. Mais quelques heures plus tard, le brigadier-général Roger Ramey annonce que le colonel Blanchard s’est trompé. Il s’agirait non pas d’une soucoupe volante, mais des restes d’un ballon météorologique couplé à un réflecteur radar.
C’est dans la Zone 51, à en croire les plus fervents ufologues, que seraient entreposés les vestiges du crash de Roswell. À les en croire, ils constitueraient la preuve de la relation secrète qu’entretient l’armée américaine avec des espèces extraterrestres.
En 2013, un rapport officiel sur l’histoire du programme d’avions espions U-2 entre 1954 et 1974, rédigé par deux historiens de la CIA, a été entièrement déclassifié. Il relate en des termes détaillés l’histoire de la Zone 51 et ce qu’on y aurait réalisé pendant ces deux décennies de secrets. D’après ce document de plus 400 pages, c’est en 1955 que débute véritablement l’histoire de la Zone 51.
À l’époque, la CIA est à la recherche d’un site pour procéder aux essais du U-2, le nouvel avion espion mis au point par l’entreprise Lockheed Martin, leader mondial dans le domaine de la défense et de la sécurité. L’appareil doit être testé à l’abri des regards indiscrets, alors que les États-Unis sont en pleine guerre froide contre l’URSS. La zone doit offrir une piste suffisamment longue et résistante pour supporter le poids du nouvel appareil, des réserves de carburant considérables et la proximité d’une administration militaire, pour la logistique.
Le lieu choisi par la CIA se situe dans une région administrative que d’anciennes cartes du gouvernement appellent la « Zone 51 ». Elle se trouve à côté de Groom Lake, un lac asséché coincé entre les montagnes. Sa situation géographique est parfaite puisque la zone est déjà largement interdite d’accès au public. La petite base, qui sera ensuite rénovée et agrandie, est entourée de la zone militaire de Nellis et du site d’essais nucléaires du Nevada (NTS), en service de 1951 à 1992. L’endroit est inhospitalier, et pour convaincre les ingénieurs et les militaires de venir travailler au sein de cette nouvelle base, Kelly Johnson, un des ingénieurs en chef du projet U-2, décide de renommer l’endroit Paradise Ranch – un des premiers surnoms de la zone.
De 1955 à 1974, les projets d’avions espions se sont enchaînés.
À partir de 1955 et des premiers tests de l’avion espion U-2, des témoignages faisant état observations d’ovnis dans la zone commencent à apparaître. « Les vols à haute altitude du U-2 ont rapidement entraîné un effet secondaire inattendu : l’augmentation phénoménale des signalements d’objets volants non-identifiés », racontent les deux historiens de la CIA. À l’époque, les avions de ligne volent à une hauteur de 3 000 à 6 000 mètres, quand les U-2 se déplacent à plus de 20 000 mètres. « De tels signalements arrivaient fréquemment en début de soirée, de la part de pilotes commerciaux volant d’est en ouest », disent-ils.
À cette heure de la journée, le Soleil était bas sur l’horizon, plongeant les avions « dans l’ombre » et rendant difficile leur identification à l’œil nu. Quand un U-2 volait dans les environs à très haute altitude, le Soleil se reflétait sur ses ailes métalliques, ce qui donnait l’impression aux pilotes de voir des objets enflammés, écrivent-ils. Le phénomène était également observé sur la terre ferme. « À cette époque, personne n’imaginait qu’un vol habité était possible à cette altitude, ce qui fait que personne ne s’attendait à voir un objet si haut dans le ciel », poursuivent les deux historiens. Toujours d’après le rapport, le caractère ultra-secret du programme U-2 empêchait les membres de l’Air Force chargés d’enquêter sur les signalements d’ovnis d’expliquer les véritables raisons de ces phénomènes.
De 1955 à 1974, les projets d’avions espions se sont enchaînés. Avant même que le U-2 ne soit totalement développé, le projet OXCART a été lancé par la CIA en 1962. Cet appareil de reconnaissance à haute altitude était capable d’atteindre la vitesse de Mach 3, soit trois fois la vitesse du son. Kenneth Collins a aujourd’hui 80 ans. Cet ancien pilote d’essais de la CIA a effectué de nombreux vols avec le U-2 et l’OXCART dans les années 1960. Il se souvient en détail du 24 mai 1963, le jour de son crash avec l’OXCART, dans l’Utah.
« Trois hommes sont arrivés en pick-up et m’ont proposé de l’aide. Je leur ai dit de ne pas s’approcher de l’avion, que j’avais une charge nucléaire à bord », se souvient-il. La CIA a fait signer à tous les témoins un engagement de confidentialité et déguisé l’accident en expliquant qu’il s’agissait d’un simple avion de l’US Air Force. Après avoir été récupéré, le pilote a subi un interrogatoire de la CIA, dont les agents lui ont administré un sérum de vérité : « Ils voulaient s’assurer que je n’avais rien oublié de leur dire des circonstances de l’accident. »
Quelques jours plus tard, le dimanche soir, trois agents l’ont ramené chez lui. « L’un d’eux conduisait ma voiture, les deux autres m’ont porté à l’intérieur et m’ont jeté sur le lit. J’étais défoncé à cause des médicaments. Ils ont donné les clefs de voiture à Jane, mon épouse, et sont repartis sans dire un mot. »
La vérité est ailleurs
Robert Scott Lazar a tout du scientifique des années 1970. D’imposantes lunettes posées sur le nez, les cheveux châtains mi-longs recouvrant ses oreilles. Il se fait connaître pour la première fois dans le Los Alamos Monitor, un journal local du Nouveau-Mexique, en 1982. L’article parle d’un dragster qu’il aurait construit avec un scientifique de la NASA. Le journal présente alors « Bob » Lazar, qui dit être diplômé du MIT et du California Institute of Technology (Caltech), comme « un physicien travaillant au centre de recherche de Physics Facility (LAMPF) ».
Mais c’est le 13 mai 1989 que Bob Lazar accède à une notoriété mondiale : lors d’une interview donnée à une chaîne télévisée de Las Vegas, le scientifique affirme avoir travaillé dans la très secrète Zone 51.  Lazar explique avoir été ingénieur et scientifique durant un an, entre 1988 et 1989, dans la base de la CIA. Et il n’est pas avare de détails : devant son interlocuteur médusé, il raconte avoir été attribué au secteur 4, proche de Groom Lake et caché sous la montagne, à Papoose Lake.
Lazar explique avoir été ingénieur et scientifique durant un an, entre 1988 et 1989, dans la base de la CIA. Et il n’est pas avare de détails : devant son interlocuteur médusé, il raconte avoir été attribué au secteur 4, proche de Groom Lake et caché sous la montagne, à Papoose Lake.
Au cours de ses diverses missions, Bob Lazar dit avoir travaillé sur la propulsion d’un nouveau genre d’appareils militaires. Mais après des recherches poussées sur le matériel qu’on mettait à sa disposition, il parvient à la conclusion que les neufs engins gardés dans le Secteur 4 ne sont pas d’origine terrestre. Dans son témoignage, Bob Lazar explique s’en être rendu compte après être monté à bord d’un des appareils. Pour lui, l’engin était « construit pour une personne à la morphologie différente de celle d’un pilote humain ».
Une enquête du Los Angeles Times de 1993 montre qu’il n’y a aucune trace de son passage au MIT et à Caltech. Le docteur en physique David L. Morgan a également remis en question les propos de Bob Lazar. Ce dernier s’est défendu en affirmant que le gouvernement américain, ou une « autorité plus haut placée », avait effacé les traces pour lui faire perdre tout crédibilité. C’est pour se protéger qu’il aurait réalisé l’interview du 13 mai 1989.
Quoi qu’il en soit, cette interview et le témoignage de Bob Lazar ont connu une diffusion mondiale, et relancé, au début des années 1990, le mythe qui entoure la Zone 51. En quelques années, elle a été happée Hollywood qui a fini de graver son nom dans l’imaginaire collectif avec X-Files (1993) et Independence Day (1996). Celui de Bob Lazar, en revanche, est presque tombé aux oubliettes – un documentaire Netflix lui était consacré en 2018.
~
Peter Merlin porte la raie sur le côté, les cheveux courts au niveau des tempes et une fine moustache qui épouse les contours de sa lèvre supérieure. Il se montre le plus souvent affublé d’un grand chapeau beige et d’un blouson en cuir. Après avoir travaillé si longtemps sur la Zone 51 et ses mystères, il en parle aujourd’hui avec beaucoup de calme et de sérénité : « Le seul véritable mystère qui entoure la Zone 51 aujourd’hui concerne la nature des programmes qui n’ont pas encore été déclassifiés. »
Lorsqu’on lui demande si Bob Lazar dit vrai, il n’hésite pas une seconde : « En plus de trente ans de recherches, je n’ai trouvé aucune preuve crédible, si ce n’est les avions espions militaires et les armes qui ont été testés dans la Zone 51. Malgré cela, le mythe persiste. » Pour lui, les récentes divulgations de la CIA n’y feront rien car les gens aiment le mystère. « Moins on en sait sur la Zone 51, plus il est facile de remplir les blancs avec son imagination », conclut-il.

Peter W. Merlin
Mais un événement récent est venu secouer le monde des ufologues. En 2015, le Dr Robert Krangle, physicien et consultant régulier du laboratoire de Los Alamos, a affirmé se souvenir parfaitement de Bob Lazar. Son témoignage inattendu a donné une nouvelle dimension aux propos de celui qui, plus de 25 ans plus tôt, disait avoir travaillé sur des appareils extraterrestres dans l’enceinte de la Zone 51.
« Bob Lazar était aussi physicien que moi : ça se voyait tout de suite à la rangée de stylos de couleur qui dépassaient de sa chemise », dit-il sur le ton de la plaisanterie. Le physicien ajoute plus sérieusement que Bob Lazar participait aux réunions de sécurité « durant lesquelles on nous donnait le briefing habituel, qui exigeait qu’on ne dise rien à l’extérieur de ce qu’on allait voir ou faire à Los Alamos ». Robert Krangle est à ce jour la seule personne à avoir publiquement validé le passé et les travaux de Bob Lazar…
~
En octobre 2016, deux hommes se sont un peu trop approchés du site secret de Groom Lake Road. Joe et Garrett McCullough ne sont pas des chasseurs d’ovnis, ni des théoriciens du complot. Ce père et son fils sont des aventuriers vlogueurs dont l’activité favorite est d’explorer le monde sur leurs motos. Dans leur vidéo publiée le 10 octobre 2017, ils tentent de s’introduire sur la Zone 51. Pour ce faire, ils ont étudié en détail de nombreuses cartes de la région et de ses alentours, afin de trouver un chemin détourné. Les deux motards s’élancent sur le chemin de traverse en filmant leur avancée avec des caméras embarquées.
Tandis qu’ils roulent roulent sur un chemin de terre non balisé, un 4×4 blanc les dépasse dans un nuage de poussière, deux hommes en treillis derrière le volant. Stupéfaits, les deux pilotes décident néanmoins de continuer leur route jusqu’aux panneaux interdisant d’aller plus loin. Ils font halte et c’est alors que le 4×4 blanc surgit sur la piste avant de s’arrêter. Les deux soldats en sortent en braquant leurs armes sur eux. Après les avoir fouillés sans ménagements, ils les somment de rebrousser chemin immédiatement. Loin de la Zone 51 et de ses secrets.
Couverture : Groom Lake vu du ciel.
BIENVENUE À ROSWELL, CAPITALE MONDIALE DES OVNIS
Depuis 1947, la ville de Roswell est un lieu sacré pour tous les amateurs d’OVNI. Chaque année, des milliers de personnes accourent à son festival.
Chaque été, des milliers de personnes déferlent dans la ville de Roswell, au Nouveau-Mexique. Ils viennent assister au festival annuel des OVNI, le UFO Festival. L’événement a lieu pour l’anniversaire du fameux crash de vaisseau extraterrestre que le gouvernement américain aurait cherché à passer sous silence, durant l’été 1947. Pendant quatre jours et quatre nuits, cette petite ville d’ordinaire tranquille et old fashion accueille une effusion carnavalesque de food trucks, de concours de costumes, de spectacles de son et lumière et de stands débordant de babioles en tout genre pour fanas d’extraterrestres.

Le musée de Roswell
Crédits : Gabriela Campos
Cette année, un alien de six mètres de haut se dresse sur Main Street et veille sur les festivités. Sous ses grands yeux noirs et luisants se déverse un flot régulier de visiteurs, dont bon nombre sont vêtus de costumes futuristes. Cette lente procession fait route vers le concours de costumes du samedi, organisé dans la grande salle municipale. « C’est comme Mardi Gras, mais avec des extraterrestres », résume Janet Jones, la propriétaire du Roswell Space Center. C’est l’une des six boutiques permanentes de la ville. Elle y vend toutes sortes d’objets et de vêtements en rapport avec les OVNI et les extraterrestres.
IL VOUS RESTE À LIRE 80 % DE CETTE HISTOIRE
L’article L’endroit le plus mystérieux du monde : la vraie histoire de la Zone 51 est apparu en premier sur Ulyces.
20.01.2021 à 00:25
40 histoires pour comprendre l’Amérique de Joe Biden et Donald Trump
Ulyces
Cliquez sur les titres bleus pour lire l’article correspondant. Au cœur du monde fou de la Maison-Blanche sous Trump Après avoir évincé ses conseillers les moins dociles, Donald Trump multiplie les embardées. Le Président est en roue libre. Un parrain à la Maison-Blanche : comment Trump s’est appuyé sur la mafia pour réussir Dans le livre […]
L’article 40 histoires pour comprendre l’Amérique de Joe Biden et Donald Trump est apparu en premier sur Ulyces.
Texte intégral (2668 mots)
Cliquez sur les titres bleus pour lire l’article correspondant.

Au cœur du monde fou de la Maison-Blanche sous Trump
Après avoir évincé ses conseillers les moins dociles, Donald Trump multiplie les embardées. Le Président est en roue libre.
Un parrain à la Maison-Blanche : comment Trump s’est appuyé sur la mafia pour réussir
Dans le livre Un parrain à la Maison-Blanche, le journaliste d’investigation Fabrizio Calvi revient sur les anciens liens du président américain avec la mafia.
Donald Trump est-il supérieurement intelligent ?
Critiqué pour la pauvreté de son vocabulaire et ses réflexions à l’emporte pièce, Trump affirme pourtant être un champion des tests de QI.

Crédits : Ulyces
L’odieux divorce de Donald et Ivana Trump
Un portrait saisissant de Donald Trump en 1990, business man alors sur le déclin et en plein divorce avec Ivana Trump.
Avant Trump, qui était le pire président de l’histoire des États-Unis ?
La concurrence est rude.
Cliquez sur les titres bleus pour lire l’article correspondant.

Que se passe-t-il à la frontière entre les États-Unis et le Mexique ?
La photo d’un père salvadorien et de sa fille, noyés à la frontière la semaine dernière, accuse la politique migratoire américaine.
Les États-Unis peuvent-ils acheter le Groenland ?
Pour contrer les menées russes et chinoises dans l’Arctique, Donald Trump envisage d’acheter le Groenland au Danemark.
Les États-Unis risquent-ils de provoquer une épidémie mondiale ?
Alors le Congrès se demande si la maladie de Lyme a été créée par le Pentagone, la vulnérabilité des installations où sont conservés les virus est pointée du doigt.
Les États-Unis sont-ils en train de regagner leur influence en Amérique du Sud ?
En soutenant l’opposition vénézuélienne face à Maduro, les USA cherchent à se faire un nouvel allié en Amérique du Sud.

Crédits : Unsplash
Comment les États-Unis prennent discrètement le contrôle de la Somalie
Washington est en train d’intensifier grandement sa présence en Somalie. Et ce n’est pas sans agenda.
Comment démanteler les GAFAM ?
Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft sont trop gros. Peut-on légalement les faire éclater ?

Space Force : comment les États-Unis vont militariser la conquête de l’espace
Au mépris des efforts de limitation des armements, les États-Unis sont en train de préparer leur armée pour la guerre dans l’espace.
Comment le Pentagone va créer des super-soldats cyborgs
En couplant les dernières avancées des neurosciences et les nouvelles technologies, l’US Army imagine déjà la soldat augmenté de 2050.
La guerre des étoiles a-t-elle déjà commencé ?
Non seulement les satellites pullulent dans l’orbite terrestre, mais ils commencent à se menacer les uns les autres.
Sommes-nous en pleine cyberguerre mondiale ?
Au lieu d’ouvrir des conflits par les obus, les États se lancent dorénavant de discrètes mais fréquentes attaques informatiques. Et les tensions grimpent.
La CIA utilise-t-elle toujours la torture ?
Les interrogatoires de la CIA étaient brutaux et bien pires que ce que l’agence prétendait. Il se pourrait qu’ils continuent.

Crédits : White House
Amazon va-t-il devenir le nouveau bras droit de la Défense américaine ?
Jeff Bezos, en plus de briguer le projet JEDI du Pentagone, a déjà commencé à vendre un système de reconnaissance faciale à la police d’Orlando et du comté de Washington, dans l’Oregon.
Au cœur d’Anduril, la start-up de la Silicon Valley qui met l’IA au service de l’US Army
Fervent patriote en chemise à fleurs, le jeune Palmer Luckey veut doter l’armée américaine de la meilleure intelligence artificielle.
Cette start-up américaine construit dans l’ombre un réseau de surveillance mondial
Avec Palantir, un ex-partenaire d’affaires d’Elon Musk aux positions très controversées fournit aujourd’hui des technologies à la DGSE.
Cliquez sur les titres bleus pour lire l’article correspondant.

Peut-on vraiment lutter contre le réchauffement climatique sans les États-Unis ?
Depuis sa décision de se retirer de l’Accord de Paris, le reste du G20 se ronge les ongles en pensant au futur.
Les multinationales doivent-elles financer la transition écologique mondiale ?
Alors qu’Alexandria Ocasio-Cortez pousse sans relâche son projet de Green New Deal aux USA, il fait sa place en France et ailleurs en Europe.
Le réchauffement climatique nous oblige-t-il à sortir du capitalisme ?
Les récents désastres climatiques pointent tous le même suspect du doigt. L’urgence climatique va-t-elle causer la perte du capitalisme au profit de la survie de l’humanité ?

La police américaine semble raciste. Pourquoi ?
Malgré le scandale que chaque bavure policière provoque, des agents américains continuent d’opérer avec une violence hors de toute proportion.
Les intelligences artificielles sont racistes. Voici pourquoi
Alors que les algorithmes colonisent l’administration et la police, leurs biais racistes apparaissent au grand jour.
Aux États-Unis, un algorithme empêchait les patients noirs de recevoir des greffes de reins
Des médecins de Harvard ont démontré que, parmi les cas qu’ils ont étudiés, 64 patients afro-américains auraient pu être inscrits sur liste d’attente de greffe rénale si leur dossier avait été traité par le même algorithme que celui des personnes blanches.
Pourquoi Hollywood traite-t-il si mal les femmes ?
Reconnu coupable de viol, le producteur Harvey Weinstein a longtemps profité d’une incroyable impunité à Hollywood.

Crédits : Ulyces
Sous Trump, 545 enfants migrants séparés de leurs parents ne les ont jamais retrouvés
Dans le cadre de la politique de « tolérance zéro » contre l’immigration clandestine mise en place par l’administration Trump, plus de 1 000 enfants ont été séparés de leurs parents depuis 2017.
Comment en finir avec la surveillance de masse ?
La surveillance de masse n’est pas une fatalité. Partout, le lanceur d’alerte Edward Snowden voit germer des idées pour la combattre.
Calexit : la Russie tente-t-elle de voler la Californie aux États-Unis ?
La République indépendante de Californie n’existe pas, mais elle a une ambassade en Russie depuis le 18 décembre 2016. L’ambition de ses ambassadeurs ? La sécession.
Comment les gamers américains font intervenir le SWAT pour battre leurs adversaires
« Swatter », cela veut dire appeler le numéro d’urgences et feindre une situation grave dans l’espoir de provoquer une intervention de la police, et plus précisément du SWAT (Special Weapons and Tactics).
Vapoter tue : au cœur de la crise de la vape américaine
De plus en plus de médecins avertissent sur la dangerosité du vaping. Les récentes tragédies aux USA tendent à leur donner raison.
Cliquez sur les titres bleus pour lire l’article correspondant.

Comment Elon Musk a fait de Tesla le constructeur automobile le plus valorisé au monde
C’est officiel, Tesla est le constructeur automobile le plus cher du monde en Bourse. En reprenant l’entreprise il y a 16 ans, Elon Musk a fait mieux que réussir son pari.
La fortune de Jeff Bezos a dépassé 200 milliards de dollars
Tout le monde ne connaît pas la crise. D’après le magazine Forbes, Jeff Bezos possède désormais une fortune de plus de 200 milliards de dollars (169 milliards d’euros). La hausse des cours d’Amazon lui a permis d’amasser 74 milliards de dollars rien qu’en 2020.
Faut-il interdire les milliardaires ?
Les grandes fortunes lancent volontiers des opérations caritatives pour lutter contre la pauvreté. Mais elles refusent de payer plus d’impôts.
Kylie Jenner ou comment devenir milliardaire en 2019
Plus jeune self-made milliardaire de tous les temps, Kylie Jenner s’est servie d’Instagram pour accumuler une richesse mirobolante en un temps record.

Crédits : Ulyces
Au cœur du club secret qui réunit les hommes les plus puissants de la planète
Les 1 % les plus riches des États-Unis ont leur colonie de vacances : un club très privé où s’encanailler à l’abri des regards.
Silicon Mafia : au cœur du Boys Club très fermé de la Silicon Valley
La génération des anciens de PayPal a passé le flambeau à celle des anciens d’Airbnb et Uber, qui perpétue une tradition délétère. Quand la Silicon Valley a de faux airs de mafia.
Au cœur des réseaux sociaux réservés aux super-riches
La distinction sociale marche à plein sur internet. Pour préserver l’entre-soi en ligne, les riches ont fondé une flopée de réseaux sociaux.
Epstein était-il à la tête d’un réseau de personnalités pédophiles ?
L’ex-compagne de Jeffrey Epstein doit faire face à la justice dans une affaire de pédocriminalité qui implique de hautes personnalités.
BONUS
Pourquoi les Américains mettent-ils de l’ananas sur les pizzas ?
C’est une idée étrange qui persiste outre-Atlantique : depuis 1962, les Canadiens et les Américains mettent de l’ananas sur leurs pizzas.
Couverture : Joe Biden VS Donald Trump (DR/Unsplash)
L’article 40 histoires pour comprendre l’Amérique de Joe Biden et Donald Trump est apparu en premier sur Ulyces.
19.01.2021 à 00:04
Manger de la viande est-il un crime ?
Servan Le Janne
C’est une première en France. Pour son édition 2021, le Guide Michelin a récompensé d’une étoile le restaurant vegan ONA (pour « Origine non animale »), ouvert par la cheffe Claire Vallée à Arès en Gironde, en 2016. Une reconnaissance sans égale pour le restaurant éthique, qui officialise en quelque sorte le respect du monde […]
L’article Manger de la viande est-il un crime ? est apparu en premier sur Ulyces.
Texte intégral (2159 mots)
C’est une première en France. Pour son édition 2021, le Guide Michelin a récompensé d’une étoile le restaurant vegan ONA (pour « Origine non animale »), ouvert par la cheffe Claire Vallée à Arès en Gironde, en 2016. Une reconnaissance sans égale pour le restaurant éthique, qui officialise en quelque sorte le respect du monde de la haute gastronomie pour une cuisine aussi raffinée qu’engagée.
« J’ai été prévenue jeudi soir par le guide Michelin et là, c’est comme si un train m’était passé dessus. Je ne me rends pas compte », a confié la restauratrice de 41 ans. Elle a d’ailleurs été auréolée d’une seconde étoile, verte celle-ci, qui récompense des restaurants écoresponsables. « Deux d’un coup, c’est beaucoup ! » Peut-être est-ce un signe que l’ère vegan est bien arrivée.
Tués dans l’œuf
Au fond de la poubelle, une forêt d’ailes déplumées et de pattes inertes émerge d’un informe duvet jaune, parsemé de morceaux de coquilles. Dans ce charnier de canetons, quelques becs piaillent désespérément. Personne n’entend leur cri au domaine de la Peyrouse, une exploitation située à Coulounieix-Chamiers, en Dordogne, et rattachée au lycée agricole de Périgueux. En 2019, son foie gras a reçu la médaille d’or au concours général agricole. Pour le produire, les femelles sont pourtant envoyées au bac équarrissages où, à peine sorties de l’œuf, elles meurent de faim ou d’étouffement. Leur foie est trop petit ou trop nervuré pour être utilisé. Près de 35 % des éclosions sont ainsi perdues.
De leur côté, les mâles sont élevés quelques semaines avant d’être gavés à la pompe pneumatique. En 2018, 30 millions de canards et 260 000 oies ont reçu ce traitement dans l’Hexagone, ce qui a envoyé à la mort quelque 16 millions de femelles. Selon la directive européenne du 20 juillet 1998, « les méthodes d’alimentation et les additifs alimentaires qui sont source de lésions, d’angoisse ou de maladie pour les canards, ou qui peuvent aboutir au développement de conditions physiques ou physiologiques portant atteinte à leur santé et au bien-être ne doivent pas être autorisés. » Mais le texte n’a jamais été transposé en Hongrie, en Bulgarie, en Espagne, en Belgique et en France.
En revanche, la loi autorise l’élimination des femelles par gazage ou broyage, auxquels le domaine de la Peyrouse a donc préféré l’entassement. « Les pratiques de cet établissement constituent un délit », pointe Sébastien Arsac, porte-parole de L214. Dans une vidéo publiée mercredi 11 décembre, cette association de défense des animaux dévoile des images tournées au sein de l’établissement en octobre et novembre. Elles ont été transmises à la Direction départementale de la cohésion sociale (DDCSPP) qui a constaté, lors d’une inspection, « le recours à une méthode non réglementaire d’euthanasie par asphyxie des canettes à l’issue du sexage ».
Mis en demeure de se conformer à la législation, le domaine de la Pérouse s’est semble-t-il exécuté. « Dès l’éclosion suivante, le 26 novembre, la DDCSPP a constaté la mise en œuvre de dispositions conformes à la réglementation garantissant l’euthanasie immédiate », a appris Le Monde. Pour le montrer, le directeur de l’exploitation, François Héraut a reçu les caméras de France 3. « Quelle que soit la méthode d’euthanasie c’est une phase douloureuse, peu glorieuse et très mal comprise du grand public », indique-t-il avant d’ouvrir la porte de la salle où les canetons sont désormais broyés. Mais il refuse de laisser ce grand public examiner cette pratique, en demandant aux journalistes d’arrêter de filmer.
François Héraut a raison. Quelle que soit la méthode d’euthanasie c’est une phase douloureuse, peu glorieuse, voire carrément écœurante pour beaucoup de Français. Selon un sondage de 2017 réalisé par l’institut Yougov à la demande de L214, 58 % d’entre eux sont favorables à l’interdiction du gavage contre 51 % en 2015, 47 % en 2014 et 44 % en 2013. Si le foie gras « fait partie du patrimoine culturel et gastronomique protégé en France », aux termes de l’article L654-27-1 du code rural et de la pêche maritime, l’article L214-1 du même code énonce quant à lui que « tout animal étant un être sensible doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce ». L’association lui doit d’ailleurs son nom.

Crédits : L214
Or, les canards mulards gavés au domaine de la Peyrouse et ailleurs « sortent du laboratoire », observe Brigitte Gothière, co-fondatrice de L214. Leur espèce a été élaborée par l’homme en sorte qu’ils ne savent pas voler et que leur foie développe une stéatose hépatique. « Ça peut virer en cirrhose », ajoute Brigitte Gothière. L’association demande donc l’interdiction du gavage mais aussi, plus largement, une réduction de la cruauté faite aux animaux. « Il faut qu’on réussisse à sortir d’un système qui les tue pour les manger », estime la co-fondatrice. En une minute, 2400 bêtes périssent dans les abattoirs français.
Tout êtres sensibles qu’ils sont d’après l’article L214-1, les animaux « sont soumis au régime des biens », précise l’article 515-14 du code civil. On peut donc en être propriétaire et « sous réserve des lois qui les protègent » disposer de leur mort. C’est pourquoi Brigitte Gothière juge que « nos lois doivent évoluer de façon à permettre aux animaux de prendre leur place pleine et entière. Ça ne veut pas dire donner un droit de vote aux poules mais leur accorder une considération équivalente. D’ailleurs, des juristes s’intéressent à la question. »
La théorie et la pratique
Michael Mansfield ne peut pas toujours gagner. Surnommé « Moneybags Mansfield » pour sa capacité à empocher le pactole lors de procès médiatisés, cet avocat britannique a signé une tribune, le 3 décembre 2019, appelant à voter pour les travaillistes aux élections législatives britanniques, seuls à même de garantir « un futur promettant une éducation, une santé, des emplois et des logements décents, ainsi que des solutions durables à la crise climatique ». Hélas pour lui, la gauche a subi une défaite cinglante. Alors l’homme de 77 ans s’est lancé un autre défi, lui aussi très compliqué. Il plaide pour l’interdiction de la viande : « Vu les préjudices que la consommation de viande fait à la planète, il n’est pas absurde de penser que ce sera un jour illégal. »
Si cette perspective peut sembler surréaliste, il en allait de même il y a quelques années pour l’interdiction de fumer à l’intérieur, appuie-t-il. « Nous savons que les 3 000 plus grosses entreprises au monde sont responsables de plus d’1,5 billion de livres de dommages à l’environnement, et la viande et les produits laitiers sont en tête de liste. Nous le savons parce que les Nations unies nous l’ont appris. » L’avocat se réfère à un rapport du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (Giec) paru en août 2019. Ce document recommande de manger plus d’aliments à base de plantes afin de « mitiger et d’atténuer » le dérèglement climatique, tout en engendrant « des bénéfices pour la santé humaine ».

Michael Mansfield
Crédits : Brian O’Neill
Les assiettes française avaient beau recevoir 12 % de viande en moins en 2016 qu’en 2007, selon une étude du Centre de recherche pour l’étude et l’observation des conditions de vie (Crédoc), les végétariens ne représentent que 2 % de la population. La tendance est à la baisse ailleurs en Europe. Une étude publiée par la revue Nature en 2018 affirme que les habitants des pays occidentaux doivent réduire de 90 % leur consommation de viande au profit des fruits et des légumineuses de manière à de minimiser l’impact de l’alimentation humaine sur l’environnement. « Un régime végétarien est la meilleure façon de réduire votre impact sur la planète », observe un des chercheurs impliqués, Joseph Poore.
Encore faut-il le pouvoir. Atteinte par les symptômes de l’arthrite auto-immune dès l’âge de 2 ans, l’Américaine Mikhaila Peterson a tout essayé pour se soigner. Après avoir eu les chevilles et les hanches remplacées à 17 ans et avoir essayé une tonne de médicaments, elle a décidé d’éliminer des aliments. Peu à peu, elle s’est rendue compte que seule la viande ne provoquait pas d’éruptions cutanées. Elles a donc adopté un régime uniquement carné qui, malgré son manque de diversité, réglait bien ses problèmes.
« J’ai une théorie », sourit-elle. « Dans le corps, les plantes libèrent des protéines qui peuvent traverser l’intestin de certaines personnes et passer dans le sang. C’est ce qui entraîne des réactions inflammatoires. » Ces protéines seraient aussi responsables des intolérances au gluten. Et Mikhaila Peterson y est visiblement si sensible qu’elle a dû se contenter de viande, où elles ont déjà été digérées par un animal. Cela dit, le « régime du lion » adopté par la jeune femme risque d’entraîner des graves désordres sur le long terme.

Mikhaila Peterson
« Physiologiquement, c’est une très mauvaise idée », affirme le spécialiste de l’écologie microbienne américain Jack Gilbert. « Vos cellules risquent de manquer d’acides gras, vous pouvez avoir des problèmes cardiaques et tout votre microbiote sera dévasté. » Les apports en protéines, glucides et les graisses contenus par la viande peuvent en revanche être trouvés dans les végétaux. Sauf cas extrême, comme celui de Mikhaila Peterson, il vaut donc mieux manger de tout, sauf de la viande, que le contraire.
« On sait se nourrir autrement », défend Brigitte Gothière. Une telle conversion peut passer par l’émotion ressentie devant des vidéos comme celle du domaine de la Peyrouse, mais « cette émotion nous guide dans notre raisonnement car il y a quelque chose d’injuste dans le fait de manger des animaux », ajoute-t-elle. « Nous ne sommes pas en situation de survie mais nous faisons passer notre envie de manger un steak avant la nécessité de ne pas infliger de souffrance à un animal. »
Une interdiction de la viande porte toutefois le risque de « provoquer une réaction défensive qui aliénerait à la cause des gens qui pourraient être convaincus que nous devons faire quelque chose contre le dérèglement climatique », considère Lorraine Withmarsh, professeure de psychologie environnementale à l’université de Cardiff. S’il y a donc quelque chose à bannir, c’est le modèle agricole qui engendre le plus de souffrance animale et les plus grands dégâts sur la planète. Et les consciences suivront.
Couverture : Stijn te Strake
L’article Manger de la viande est-il un crime ? est apparu en premier sur Ulyces.
18.01.2021 à 00:10
Peut-on vivre jusqu’à 200 ans ?
Servan Le Janne
C’est une légende vieille comme Hérode. « Je détesterais mourir deux fois, c’est si ennuyeux », aurait soufflé le prix Nobel de physique Richard Feynmann, sur son lit de mort, en 1988. À l’époque, María Blasco venait d’obtenir son diplôme de biologie à l’Université autonome de Madrid. Quittant le « désert scientifique » espagnol pour continuer ses recherches […]
L’article Peut-on vivre jusqu’à 200 ans ? est apparu en premier sur Ulyces.
Texte intégral (3371 mots)
C’est une légende vieille comme Hérode. « Je détesterais mourir deux fois, c’est si ennuyeux », aurait soufflé le prix Nobel de physique Richard Feynmann, sur son lit de mort, en 1988. À l’époque, María Blasco venait d’obtenir son diplôme de biologie à l’Université autonome de Madrid. Quittant le « désert scientifique » espagnol pour continuer ses recherches sur le vieillissement aux États-Unis, elle y a trouvé une philosophie. « Je suis d’accord avec Feynman quand il disait que nous ne sommes qu’au tout début de l’histoire de la race humaine », glisse-t-elle aujourd’hui dans son laboratoire, situé derrière la façade en verre du Centre national de recherches oncologiques de Madrid (CNIO).
Si la complexité de la vie n’est pour le moment pas à la portée de ses microscopes, « le jour où nous saurons tout arrivera », assure-t-elle, « et nous serons capable de soigner toutes les maladies, de les prévenir et de vivre bien plus qu’aujourd’hui. » En 2016, la scientifique a publié le livre Mourir jeune à 140 ans. Elle estime aujourd’hui que cet horizon est bien modeste : « La biologie moléculaire n’a commencé qu’à la fin des années 1950. Cela ne fait pas un siècle et nous avons déjà fait des pas de géant. Nous ne pouvons pas imaginer à quoi ressemblera l’humanité quand nous saurons tout. »

María Blasco
Crédits : Poweraxle
María Blasco en sait déjà un peu plus que le commun des mortels. Avec deux collègues du CNIO, Miguel Muñoz-Lorente et Alba Cano-Martin, elle vient de présenter les résultats d’une expérience saisissante. Dans un numéro de la revue Nature Communications paru le 17 octobre 2019, les trois chercheurs expliquent avoir développé des souris qui vivent en moyenne 24 % plus vieilles que les autres. Elles présentaient qui plus est « moins de signes de vieillissement métabolique ».
À partir de travaux antérieurs, l’équipe de Blasco est parvenue à allonger les télomères des rongeurs. Ces morceaux d’ADN placés à l’extrémité des chromosomes, deviennent de plus en plus courts à mesure que les cellules se divisent et se dégradent. Ils ont donc un lien avec le vieillissement. D’autres scientifiques l’avaient déjà montré en renforçant des télomères grâce à une enzyme, la télomérase. Mais cette fois, aucune modification du génome n’a été nécessaire. Des cellules pluripotentes ont été cultivées in vitro pour favoriser la division cellulaire et ainsi allonger les télomères. Elles ont ensuite donné naissance à des souris. « Il y a une chance d’allonger la vie sans altération des gênes », se réjouit María Blasco. La nouvelle arrive trop tard pour Richard Feynmann mais elle va réjouir un autre Américain, Dave Asprey.
La salle des machines
Sur l’île de Vancouver, au sud-ouest du Canada, une maison forestière en tôle verte et grise, prolongée par une terrasse en bois, se cache parmi les sapins. Le chemin bordé de lavande fleure bon les vacances ou la retraite spirituelle. On croirait que le temps s’est arrêté. C’est justement ce que souhaite son propriétaire. « Mon but est de vivre jusqu’à 180 ans », lâche d’emblée Dave Asprey, qui n’en a encore que 45. Avec ses lunettes jaunes et sa mèche grisonnante, cet Américain n’a pas l’air plus extraverti que les artistes qui vivent dans le coin. Mais il ne vit pas dans un atelier ou une galerie. « Attention : tout ce qui se trouve dans ce labo peut vous tuer », est-il écrit sur la porte. Et Asprey est prêt à mourir pour réaliser son rêve.
Derrière la porte, au rez-de-chaussée, le parquet est recouvert de machines futuristes. Il y a un grand tube argenté à taille humaine pour la cryothérapie, censée soigner le corps par le froid. À ses côtés, pareil à une cabine de bronzage, un caisson blanc sert à réparer les cellules grâce à la projection de lumières rouges. Pour « activer différentes parties de leur cerveau », les patients peuvent entrer dans une chambre qui, tournant sur elle-même, fait penser à ces simulateurs vidéo qu’on trouve dans les parcs d’attraction. Enfin, une sorte de cabine de pilotage clouée au sol augmente la pression atmosphérique sur demande.

Crédits : Bulletproof
À la sortie de ces appareils, Dave Asprey gobe l’un des 100 suppléments alimentaires qu’il prend chaque jour. Rien ne l’arrête. Chaque mois, il fréquente une clinique de Park City, dans l’Utah, pour qu’un chirurgien prélève un demi-litre de moelle osseuse sur ses hanches. Les cellules souches qui s’y trouvent sont ensuite filtrées pour être réinjectées au niveau de la moelle épinière et du cerveau. À sa demande, les médecins en introduisent aussi dans son cuir chevelu afin d’éviter la calvitie, dans son visage pour lisser les rides et même au niveau de ses organes sexuels, dont la vigueur doit être renforcée. L’efficacité du procédé n’est pas encore prouvée scientifiquement. Mais Dave Asprey a déjà sorti plus d’un million de dollars de sa poche pour soigner son organisme. Et il est prêt à en dépenser beaucoup d’autres.
Aux États-Unis, et notamment en Californie, de plus en plus de cliniques proposent des thérapies de ce type. Partant du principe que les cellules souches que l’on trouve dans l’embryon, le fœtus et le moelle osseuse sont capables de se renouveler, elles promettent de retarder le vieillissement. « C’est une capacité de régénération que l’on possède en étant jeune mais qui se perd ensuite », précise Julien Cherfils, chercheur à l’Institut de recherche sur le cancer et le vieillissement (IRCAN). Plus l’âge d’une personne est avancée, moins ses tissus se réparent correctement en cas de lésion. Sauf à administrer des cellules souches : leur activité a déjà permis de restaurer du cartilage. Et elles sont aussi utilisées afin de régénérer le système immunitaire des patients atteints de leucémie.
Mais le vieillissement, tempère Julien Cherfils, « n’est pas qu’un processus cellulaire ». Dave Asprey ne parie d’ailleurs pas seulement sur les cellules souches. Il est prêt à expérimenter à peu près tout ce qui a une chance de fonctionner. Sur son blog, il donne d’ailleurs des moyens simples pour protéger ses télomères : méditer, limiter les contacts avec un environnement pollué, faire de l’exercice et adopter un régime sain. Il conseille aussi de consommer du TA-65, une enzyme censée renforcer les extrémités des chromosomes. Il faut toutefois payer 600 dollars pour une cure de trois mois, dont l’efficacité est sujette à caution.
Ce « biohacker » né au Nouveau-Mexique en a les moyens. Après avoir amassé un peu d’argent dans la Silicon Valley, il a monté un empire dans la santé : sa société de compléments alimentaires Bulletproof Nutrition Inc., qui a levé neuf millions de dollars, est complétée par un podcast, Bulletproof Radio, et cinq livres sur l’optimisation de soi.

Crédits : Bulletproof
Le café magique
Au rez-de-chaussée de la maison de Vancouver, dans la salle où Dave Asprey prépare son corps à vivre 180 ans, le logo de Bulletproof Nutrition Inc. est partout. On retrouve le colibri orange jusque dans la cuisine, sur un appareil bien moins impressionnant : une machine à café. Ce grand brun au nez aquilin et aux joues creusées par des fossettes a commencé son aventure dans l’univers du biohacking en lançant le Bulletproof Coffee en 2014, comme d’autres commencent leur journée par un expresso. La recette qu’il a partagée pour la première fois en 2009 est simple : il suffit de verser du café dans un mixeur avec du beurre et de mélanger le tout. « De petites gouttes de graisse suspendues dans du liquide changent la façon avec laquelle votre corps reçoit l’eau », assure-t-il. « Si vous mangez du beurre et buvez du café à côté, ce n’est pas la même chose. »
La boisson a « un énorme effet sur votre énergie et vos fonctions cognitives », promet le site. « Bulletproof Coffee a aidé beaucoup de monde, que ce soient des PDG ou des athlètes professionnels en passant par des parents débordés, à faire plus de choses satisfaisantes. » Kourtney Kardashian et Jimmy Fallon ont bu quelques-unes des 150 millions de tasses servies d’après l’entrepreneur. Le second en a même parlé comme d’une boisson « délicieuse », « bonne pour vous et votre cerveau ». Aucune étude scientifique n’en prouve pourtant les vertus. Au contraire, toutes les analyses sérieuses du cocktail en pointent l’inanité.
Mais voilà, Dave Asprey sait monnayer le café depuis longtemps. Au lycée, sur son ordinateur, il écoulait des t-shirts ornés de l’inscription « la caféine est ma drogue ». Non seulement il se considère comme « le premier à vendre tout et n’importe quoi sur Internet » mais, à l’entendre, les ingénieurs ont reçu ses enseignements pour tisser la Toile quand il était professeur à l’université de Californie à Santa Cruz. En bon initiateur de la Silicon Valley, il travaillait pour l’entreprise qui hébergeait le premier serveur de Google d’un côté, et prenait de l’ayahuasca de l’autre. Cette quête de soi masquait mal ses problèmes : on lui a tour à tour diagnostiqué un syndrome d’Asperger, des désordres de l’attention, des troubles obsessionnels compulsifs, de l’arthrite, une fibromyalgie, la maladie de Hashimoto et une maladie de Lyme chronique. Pour ne rien arranger, son poids a atteint jusqu’à 130 kilos.

Crédits : Bulletproof
Pour le réduire, les méthodes classiques ne fonctionnaient guère. Il avait beau faire du sport pendant 90 minutes et se serrer la ceinture, sa silhouette bougeait à peine. « J’étais probablement en mauvaise santé et plus fort, il n’y avait que deux machines que je ne poussais pas à fond à la salle de gym mais je pesais toujours autant », souffle-t-il. Exaspéré par cette discipline stérile, l’informaticien s’est mis à expérimenter sur son corps, dont certains gènes sont ceux « d’inventeurs », explique-t-il en faisant référence à sa grand-mère ingénieure nucléaire. « J’ai aussi de la famille de Roswell, donc il y a de l’extraterrestre et des radiations en moi », plaisante-t-il. Délesté de 22 kilos grâce à un régime à faible teneur en glucide, Asprey a mis toute son attention sur ce que son corps ingère.
Pendant des soirs entiers, après le travail, il s’est documenté sur les médicaments bénéfiques à son organisme. Fort de ces connaissances, il a commencé à fréquenter le Silicon Valley Health Institute et à partager des conseils sur Internet. Dans le milieu de la tech, où la compétition est féroce, d’autres ont commencé à appliquer la logique d’optimisation propres aux start-ups à leur personne, en mesurant scrupuleusement leur alimentation, en se mettant au sport ou en tablant sur la méditation pour améliorer leur forme et, partant, leur productivité. Ce n’est ainsi pas un hasard si le fonds d’investissement Trinity Ventures a investi neuf millions de dollars dans Bulletproof en 2015.
Cobaye
Sur le balcon en bois de sa maison de Vancouver, Dave Asprey agite les bras et parle avec emphase. « Il n’est pas juste que seules les célébrités, les forces spéciales ou d’autres rares personnes aient accès à cette technologie », se lamente-t-il en prenant les accents Démocrates qu’on connaît aux grandes fortunes de la tech. « Cela devrait être – et cela sera disponible pour tout le monde », jure-t-il, comme s’il était à la tête d’une ONG. Pour cela, l’entrepreneur n’espère rien de moins qu’un détricotage en règle de la législation sur la santé. Celle-ci « nous a conduits à la pyramide alimentaire qui entraîne des maladies du cœur, des cancers et du diabète chez un nombre de personnes inégalé », juge-t-il. « Notre système médical est lent à innover, c’est inhumain de dire à quelqu’un qu’il ne peut pas ingérer ce qu’il veut. C’est un droit humain basique. Je ne veux pas gaspiller 150 dollars et une heure de ma vie pour obtenir la permission de prendre une substance. »
Sa femme, docteure, n’est pas d’accord. Peut-être est-elle légèrement effrayée par ses expériences. Ayant appris que l’exposition au froid augmentait la résilience, Asprey a un jour fait la sieste au milieu de blocs de glace. Il s’est réveillé avec une brûlure au troisième degré. Une autre fois, il s’est exposé à de la lumière infrarouge dans l’espoir que cela améliore sa faculté d’apprentissage. Au lieu de quoi il a bégayé pendant plusieurs heures. Les résultats du Bulletproof Coffee sont aussi loin d’être univoques. Tandis que certains internautes se réjouissent d’avoir perdu du poids en en buvant, quantité de consommateurs ont vu leur niveau de cholestérol grimper dangereusement. Selon lui, l’huile d’olive est à proscrire, de même que le kale et les légumineuses présentent des risques d’inflammation. Autant dire que les diététiciens le détestent.

Crédits : Bulletproof
« Cela suit le même schéma que les autres régimes à la mode », peste une spécialiste, Abby Langer. « La situation est simplifiée pour promettre une expérience extraordinaire et une perte de poids irréaliste. Cela fonctionne grâce à la psychologie : les gens aiment sentir qu’ils font partie d’un groupe qui a accès à une connaissance secrète. » Les compléments alimentaires recommandés par Asprey pour améliorer le fonctionnement du cerveau n’ont pas davantage fait leur preuve en laboratoire. « L’amélioration cognitive est un jeu à somme nulle », professe le neurologue Murali Doraiswamy. « Quand vous améliorez une fonction, cela se fait en général aux dépens d’une autre. » Dans son empressement à s’appliquer des expériences scientifiques dont l’efficacité n’est pas même démontrée sur des rats, l’Américain ne fait toutefois pas complètement n’importe quoi.
Les travaux sur les cellules souches dont il s’inspire sont prometteurs. Pour avoir transformé une cellule adulte en cellule souche présentant les qualités de celles trouvées dans l’embryon, le Japonais Shinya Yamanaka a reçu le prix Nobel de médecine en 2012. L’année précédente, le chercheur français Jean-Marc Lemaître parvenait avec ses collègues de l’Institut de génomique fonctionnelle (Inserm, CNRS, université de Montpellier) à rajeunir des cellules de donneurs âgés in vitro. Quatre ans plus tard, des scientifiques du Salk Institute of Biological Studies de San Diego ont révèlé avoir augmenté l’espérance de vie de souris de 18 à 27 semaines grâce à cette méthode. L’année suivante, l’Allemand Hartmut Geiger et ses collègues ont employé une protéine pour que les cellules souches âgées de rongeurs produisent autant de globules blancs que des jeunes. Ils espèrent que cela pourra servir à soigner des personnes atteintes de cancers du sang.
« À mon avis, les méthodes à base de cellules souches présentent surtout un intérêt pour les thérapies », observe Julien Cherfils. « On sait qu’elles peuvent aider dans le cadre du traitement de l’arthrose et pour d’autres pathologies, sous certaines conditions, mais il est impossible de généraliser. » Le chercheur suggère donc de trouver des moyens de bien vieillir en prévenant ou en traitant les maladies associées à l’âge plutôt que de viser 180 ans. Mais que leurs visées soient curatives ou non, les recherches alimentent toujours l’espoir de Dave Asprey et de quelques autres. En 2016, l’Américaine Elizabeth Parrish a affirmé avoir rajeuni ses cellules en trouvant un moyen d’en rallonger les télomères, ces morceaux d’ADN dont la taille diminue à chaque division cellulaire. Elle aurait ainsi gagné 20 ans
Parrish s’est appliquée deux thérapies géniques expérimentales à base de télomérase. Cette enzyme qui aurait la propriété de renforcer les télomères a été découverte en 1984 par les Américaines Elizabeth Blackburn et Carol Greider. « Est-ce que nos recherches montrent qu’en maintenant vos télomères vous vivrez des centaines d’années ? » écrit la première dans le livre The Telomere Effect, publié en 2017. « Non, les cellules vieillissent et vous finissez par mourir. » Quant à la deuxième, elle a dirigé les recherches de María Blasco à son arrivée aux États-Unis, au Cold Spring Harbor Laboratory.
La méthode de Parrish présente un risque de cancer, pointe Julien Cherfils. D’ailleurs, un conseiller de l’entreprise de biotechnologies de la quadragénaire, BioViva, s’est dit « très inquiet ». Il « incite vivement à réaliser des études pré-cliniques. » L’expérience menée par María Blasco et ses collègues est moins dangereuse car elle ne passe pas par des modifications génétiques. Mais rien ne prouve pour le moment qu’elle est transposable à l’homme. Dave Asprey est prévenu.
Couverture : Dave Asprey. (Bulletproof Labs)
L’article Peut-on vivre jusqu’à 200 ans ? est apparu en premier sur Ulyces.
15.01.2021 à 01:56
Le difficile combat de Netflix pour se faire accepter de l’industrie cinématographique
Arthur Scheuer
« Nous aimons vraiment les films », plaide Ryan Reynolds. « On adore ça, mais ce qu’on aime encore plus, c’est faire des films pour les fans [de cinéma ?] que vous êtes », renchérit Dwayne Johnson. Les deux stars hollywoodiennes font partie de la horde d’acteurs.trices et réalisateurs.trices qui vont rejoindre l’écurie Netflix en […]
L’article Le difficile combat de Netflix pour se faire accepter de l’industrie cinématographique est apparu en premier sur Ulyces.
Texte intégral (2408 mots)
« Nous aimons vraiment les films », plaide Ryan Reynolds. « On adore ça, mais ce qu’on aime encore plus, c’est faire des films pour les fans [de cinéma ?] que vous êtes », renchérit Dwayne Johnson. Les deux stars hollywoodiennes font partie de la horde d’acteurs.trices et réalisateurs.trices qui vont rejoindre l’écurie Netflix en 2021. Le 12 janvier, la reine des plateformes de streaming a annoncé la sortie de 71 films dans l’année, à raison d’un nouveau long-métrage par semaine.
À la faveur de la pandémie, en réponse à la multiplication des plateformes et dans l’espoir de conserver son avance sur le géant Disney+, Netflix n’a jamais autant déployé d’efforts pour se faire accepter de l’industrie cinématographique. Le chemin est long, difficile, et il reste encore bien des obstacles à surmonter pour que les studios, le public et la critique lui reconnaissent sa légitimité. Un combat qui sera peut-être gagné en 2021, ou pas.
Tapis rouge
La tapis rouge va être foulé par les plus grands noms du cinéma, la 91e cérémonie des Oscars va commencer sur les notes d’un medley de Queen, et Steven Spielberg n’a qu’un titre à la bouche : Green Book. C’est dans une véritable campagne en faveur du film de Peter Farrelly que se lance le réalisateur, auprès des 6 000 membres de l’Académie des arts et sciences du cinéma. S’il a probablement succombé au charme de cet Americana moderne, Steven Spielberg a une idée bien précise derrière la tête lorsqu’il vante ainsi les mérites de Green Book.

Crédits : Oscars
Pour le cinéaste, voter en faveur du film distribué par Universal Pictures revient surtout à voter contre Roma, le film d’Alfonso Cuarón distribué par Netflix. Car s’il y a bien un invité qui n’a selon lui pas sa place aux Oscars, c’est la plateforme de streaming, et donc son contenu. Pourtant favori pour recevoir la statuette du meilleur film, Roma s’incline effectivement face à Green Book, mais repart tout de même avec trois Oscars. Netflix n’a pas tout perdu, et cette conclusion semble insoutenable pour Spielberg, qui n’attend que quelques heures après la fin de la cérémonie pour déclarer la guerre à la plateforme.
Non content de la victoire de son protégé, Steven Spielberg s’engage ainsi fin février à évincer Netflix de toutes les cérémonies des Oscars à venir. Le réalisateur est en en effet « persuadé qu’il y a une différence entre la diffusion en streaming et la diffusion au cinéma », comme le rapporte un porte-parole d’Amblin, la société de production du cinéaste. « Il serait heureux que les autres membres du comité de l’Académie rejoigne sa campagne [contre Netflix] », précise-t-il.
Du côté de l’Académie, on confirme qu’une « discussion sur les règles d’attribution des Oscars est en cours et que le comité abordera la question lors de la réunion du mois d’avril ». Prudent sur sa stratégie de communication, Netflix ne répond à ces attaques qu’à travers un tweet, n’ayant besoin de citer personne pour se faire comprendre. « Nous aimons le cinéma. Voilà d’autres choses que nous aimons : en offrir l’accès à ceux qui ne peuvent pas toujours se permettre d’y aller, ou qui vivent dans des villes non équipées. Laisser absolument tout le monde profiter des nouvelles sorties au même moment. Donner plus de moyens aux cinéastes pour partager leur art », rétorque la plateforme le 4 mars 2019.

Concrètement, Steven Spielberg et les studios de cinéma traditionnels ont une longue liste de reproches à faire à Netflix. Le site de streaming aurait ainsi dépensé un budget faramineux dans sa campagne pour les Oscars, estimé à 50 millions de dollars, quand Green Book se serait contenté d’une somme estimée entre 5 et 25 millions. L’un des autres principaux reproches faits aux films de la plateforme est leur faible, voire inexistante, diffusion dans les salles de cinéma. Netflix ne fait pas non plus état de son « box office », et les films sont bien sûr accessibles aux 137 millions d’abonnés à tout moment. Autant d’implications qui sont synonymes de concurrence déloyale pour certains observateurs, et qui déséquilibrent le poids des films dans la course aux récompenses.
Pour d’autres, ces arguments sont infondés et frisent même l’hypocrisie, quand on sait que Jurassic Park, signé Steven Spielberg, est présent dans le catalogue Netflix depuis le 1er mars 2019, comme d’autres de ses films avant. Les chiffres du box office n’ont par ailleurs aucun impact sur les qualifications des films aux Oscars et, chaque année, des longs-métrages n’ayant bénéficié que d’une seule semaine de diffusion cinématographique sont nommés par l’Académie. Avec le développement des plateformes de streaming telles qu’Amazon Prime Video, Hulu et prochainement Disney +, certains affirment donc que ce n’est pas à ces nouveaux acteurs de s’adapter à une industrie cinématographique à la traîne, mais bien aux studios et distributeurs de se réinventer pour continuer d’exister… et pourquoi pas de les concurrencer.
Têtes d’affiche
Las de voir le monopole de Netflix s’affirmer, Disney et AT&T (le propriétaire de chaînes câblées et du studio WarnerMedia, auquel est rattaché HBO) ont annoncé leur arrivée sur le marché du streaming. Des démarrages tardifs, mais qui pourraient bien poursuivre la mue de l’industrie du cinéma. Les studios commencent ainsi doucement à vouloir récupérer leurs contenus, obligeant Netflix à trouver une parade à l’amaigrissement inéluctable de son catalogue. La volonté du site de produire plus de films et de séries apparaît dès lors comme un moyen de palier cette désaffection. Début 2019, la plateforme annonçait la production de 90 films dans l’année, avec un budget total de huit milliards de dollars. Un moyen d’assurer le renouvellement constant de son catalogue, mais aussi d’attirer de grands noms du cinéma, en mettant l’accent sur une liberté de création qu’ils ne trouveraient plus au sein des studios traditionnels.

Dans les bureaux de Netflix
Crédits : Netflix
À l’ère du binge-watching sur smartphone, où l’on n’attend plus d’être installé dans les fauteuils des salles obscures pour regarder un film, Netflix dépasse de loin les capacités de production des studios historiques tels que Warner, Disney ou la Twentieth Century Fox. Quand la plateforme de streaming annonce 90 films, Disney n’en promet que 10 et Warner 23 en 2019. Est-ce à dire qu’elle privilégie la quantité à la qualité ? Contre cette idée, le site de streaming promet au moins 20 longs-métrages « premium », avec Martin Scorsese, Steven Soderbergh, Noah Baumbach ou encore Guillermo del Toro derrière la caméra. Avec en plus 35 films de genre et 35 documentaires et films d’animation, Netflix place ses pions, produit des contenus variés, et satisfait une audience toujours plus large, « des plus petits aux grands-parents », quand les grands studios peinent parfois à financer un nombre annuel de productions bien inférieur.
« Quel grand studio aurait produit un film comme Okja, de Bong Joon-ho, qui met en scène un super-cochon et une petite-fille, avec un budget de 50 millions de dollars ? Aucun. Eux ne se préoccupent que du fait de ne pas perdre d’argent. Pas nous », affirme ainsi Ted Sarandos, responsable du contenu chez Netflix. Un argument validé par Martin Scorsese, qui a pu mettre en scène The Irishman, avec Robert DeNiro, grâce à la plateforme de streaming. « Le cinéma des 100 dernières années a disparu. Netflix sait prendre des risques et The Irishman est un film risqué. Pendant cinq ou sept ans, personne n’a voulu le financer… et on se fait tous vieux ! Netflix a pris le risque », déclarait ainsi Martin Scorsese au festival international du film de Marrakech en 2018, alors que Paramount Pictures s’était retiré du projet un an plus tôt.
Triomphe
Soutenir un film tel que Roma était ainsi pour l’entreprise de Los Gatos l’occasion de s’offrir un carton d’invitation au sein des meilleurs festivals de cinéma internationaux. Maintenant que l’œuvre d’Alfonso Cuarón a raflé trois Oscars et deux Golden Globes à Los Angeles, quatre BAFTA à Londres, un Goya en Espagne, le Lion d’Or à la Mostra de Venise, Netflix a réussi un coup qui lui permet presque de faire l’unanimité… sauf en France, où le différend qui oppose le Festival de Cannes à Roma est loin d’être artistique, mais bien économique.
L’exception française est intenable pour Netflix.
Ce récent succès a donné le signe que le site de streaming pouvait aussi soutenir un cinéma d’auteur ambitieux. Une vision que partage naturellement Cannes. Mais le festival est une institution historique qui entretient des liens plus qu’étroits avec les exploitants français. Mécontents de l’épisode cannois de 2017, les distributeurs français ont fait pression pour que l’expérience Okja et The Meyerowitz Stories ne se renouvelle pas en 2018. En compétition officielle, les deux films ne sont jamais sortis en salles, Netflix faisant fi de la réglementation française, et plaçant Thierry Frémaux, le délégué général du Festival de Cannes, dans une position extrêmement délicate. « J’ai été lourdement critiqué. J’ai failli perdre mon poste. C’était très violent », confiait-il en avril 2018, alors que la sélection officielle des films en compétition vinait d’être dévoilée, et ne faisait état d’aucun film Netflix.
Cette année-là, suite au scandale de 2017, le Festival de Cannes réclame que les studios dont les longs-métrages sont en compétition s’engagent formellement à les sortir dans les salles françaises. Une prérogative sur laquelle Netflix aurait pu céder, si elle n’impliquait pas un délai de carence de trois ans avant que les films ne puissent être diffusés sur une quelconque plateforme de vidéo à la demande, selon la chronologie des médias française. « Ils auraient pu dire : “Pas de problème, nous allons faire une exception pour le film d’Alfonso Cuarón et accepter qu’il sorte en France.” J’aurais adoré ça, et je continue à les supplier pour qu’ils le fassent. Ils seraient passés pour des héros », déplore Thierry Frémaux, bien qu’il qualifie d’ « absurde » la réglementation sur les trois ans de délai. « D’un point de vue personnel, je pense qu’il est temps de changer cela », précise-t-il.
L’exception française est intenable pour Netflix, qui ne peut se permettre de bouleverser son modèle économique en privant ses abonnés de son propre contenu. « Le Festival de Cannes a choisi de célébrer la distribution plutôt que l’art cinématographique. Nous sommes à 100 % en faveur de l’art cinématographique, comme tous les autres festivals du monde. Nous espérons qu’il va se moderniser, mais s’il choisit de rester coincé dans l’histoire du cinéma, tant pis », lâche alors, cinglant, Ted Sarandos.

OKJA, de Bong Joon-ho, premier long-métrage ambitieux de la plateforme
Si les discussions entre la plateforme et le festival sont toujours en cours, une entente parfaite sera probablement difficile à établir pour l’édition 2019, qui se déroulera du 14 au 25 mai prochains. Le Festival de Cannes pourrait exiger de Netflix qu’il ne sorte en salles que les films récompensés, ou présenter les œuvres telles que The Irishman hors-compétition, puisque la règle de la distribution en salles ne s’impose pas pour cette catégorie.
« J’aime beaucoup Ted Sarandos. Un jour, nous serons de nouveau ensemble sur le tapis rouge. Beaucoup de choses vont changer », promettait Thierry Frémaux à l’aube de l’édition 2018 du festival.
Couverture : Netflix.
L’article Le difficile combat de Netflix pour se faire accepter de l’industrie cinématographique est apparu en premier sur Ulyces.
14.01.2021 à 01:00
Voici comment le prince héritier d’Arabie saoudite change radicalement le royaume
Servan Le Janne
La ville du futur verra le jour en Arabie saoudite. C’est l’engagement qu’a pris le prince Mohammed ben Salmane en annonçant la construction imminente de The Line, une ville inédite qui s’étendra sur une ligne droite de 170 km, sans rues ni voitures, et sans émissions. Pour l’économiste saoudien Mazen Al-Sudairi, « c’est une nouvelle […]
L’article Voici comment le prince héritier d’Arabie saoudite change radicalement le royaume est apparu en premier sur Ulyces.
Texte intégral (3900 mots)
La ville du futur verra le jour en Arabie saoudite. C’est l’engagement qu’a pris le prince Mohammed ben Salmane en annonçant la construction imminente de The Line, une ville inédite qui s’étendra sur une ligne droite de 170 km, sans rues ni voitures, et sans émissions. Pour l’économiste saoudien Mazen Al-Sudairi, « c’est une nouvelle ère de civilisation, un nouveau modèle pour une ville propre, convenable et sans carbone ».
The Line n’est que le dernier d’une longue série de projets innovants et d’apparentes transformations apportées au royaume par le prince héritier, depuis son arrivée au pouvoir en 2017.

The Line
L’homme pressé
Il y a des hommages dont on se passerait volontiers. Sous son foulard blanc tacheté de rouge, Mohammed ben Nayef dissimule mal la peine qu’il a, ce mercredi 22 juin 2017, à recevoir le baisemain de Mohammed ben Salmane. Par cette révérence, la couronne d’Arabie saoudite qui était promise au premier passe sur la tête de son jeune cousin, elle aussi coiffée par la traditionnelle shemagh. Le désaveu porte les habits du respect. Après deux ans et demi de règne, le roi a décidé d’écarter son neveu au profit de son fils. Malade, l’octogénaire remet les clés du royaume entre les mains d’un homme de 32 ans. Présenté comme quelqu’un de fougueux, sinon d’impétueux, le nouveau prince héritier compte bien régner sans partage.
Près de trois ans plus tard, le 7 mars 2020, le New York Times et le Wall Street Journal annoncent l’arrestation de plusieurs membres de la famille royale. Jusqu’ici placé en résidence surveillée, Mohammed ben Nayef est désormais en détention aux côtés du prince Ahmed ben Abdulaziz al Saud, qui est aussi le frère du roi Salmane. Selon une source citée par CNN, ils ont rejoint le fils du roi, Turki bin Abdullah, en prison. Autant dire que Mohammed ben Salmane (MBS) a fait le ménage autour de lui.
En novembre 2017, MBS avait fait arrêter quatre ministres, dix anciens membres du gouvernement et au moins onze princes dont Turki bin Abdullah et le milliardaire Al-Walid ben Talal, un des hommes les plus puissants du royaume. Pour assurer le succès de cette opération menée par le nouveau comité anti-corruption, le Ritz Carlton – où la famille royale à ses habitudes – a été évacué et l’aéroport privé fermé.
Plus jeune prince à diriger le pays depuis sa fondation en 1932, Mohammed ben Salmane est un « homme pressé », juge la journaliste Clarence Rodriguez. Il « ne semble pas manifester un respect excessif pour les personnages âgées de la famille », juge son confrère Olivier Da Lage. Porteur d’un projet économique libéral et ambitieux, Visions 2030, il montre un visage offensif sur la scène internationale et autoritaire en interne. Après avoir annoncé la délivrance de visas de tourisme et un assouplissement du code vestimentaire en septembre 2019, MBS a levé l’interdiction de la Saint-Valentin en février dernier. Et en pleine épidémie de coronavirus (Covid-19), il a décidé de baisser les prix du pétrole national, ce qui n’a fait qu’approfondir la déstabilisation de l’économie mondiale.
Pour ce pays ultra-conservateur, sa nomination était bien plus qu’une révolution de palais.

Salmane ben Abdelaziz Al Saoud, suivi du prince Mohammed ben Salmane
Crédits : vision2030.gov.sa
Le renouveau
Le long des autoroutes qui traversent le désert saoudien, la même pancarte revient de loin en loin. « Remercie Dieu », est-il écrit entre Médine et La Mecque, les deux villes saintes de l’islam, et jusqu’à la capitale, Riyad. Depuis l’unification des tribus de la péninsule sous le sabre de la famille Al Saoud, en 1934, chaque cérémonie de succession offre l’occasion de renouveler le pacte entre les pouvoirs politique et religieux, forgé par le fondateur de la dynastie, Mohammed Ibn Saoud, à la fin du XVIIIe siècle. La dernière intronisation ne fait pas exception.
Lors de son arrivée sur le trône, le roi Salmane s’est posé en garant de la pérennité du régime. « Nous resterons, avec la force de Dieu, sur le chemin droit que cet État a suivi depuis sa création par le souverain Abdel Aziz ben Saoud et par ses fils après lui », déclare le sixième de la lignée à la mort de son frère, Abdallah, en janvier 2015. À peine trois mois plus tard, il renverse pourtant l’ordre de succession en privant son demi-frère, Moukrine, du statut de prince héritier au profit de son neveu, le ministre de l’Intérieur Mohammed ben Nayef (MBN).
Nommé ministre de la Défense, son fils, Mohammed ben Salmane (MBS), arrive en deuxième place. MBS « est l’homme de confiance de son père », remarque le journaliste de RFI Olivier Da Lage, auteur du livre Géopolitique de l’Arabie saoudite. « Quand il était gouverneur de Riyad (de 1955 à 1960 et de 1963 à 2011) puis lorsqu’il est devenu ministre de la Défense (2011-2015) et enfin prince héritier (2012-2015), Salmane a nommé son fils chef de cabinet. » Une fois au pouvoir, il en fait un ministre de la Défense aux attributions élargies. À ce poste, le jeune homme engage l’armée saoudienne au Yémen afin de contrer la rébellion houthiste qui s’y déploie avec l’aide de l’Iran. Cette opération, « Tempête décisive », coalise l’Égypte, la Jordanie, le Soudan, le Maroc et les membres du Conseil de coopération du Golfe (Oman excepté).

Mohammed ben Nayef
Alors encore numéro 2 et prince héritier, le « Monsieur sécurité » du royaume donne son accord à l’intervention. Fils d’un ancien ministre de l’Intérieur, MBN lui a succédé en 2012, après des formations auprès du FBI et de Scotland Yard. Réputé pour sa participation au démantèlement de groupes terroristes et sa politique de réinsertion de djihadistes, il est aussi connu pour son travail de sape de l’opposition. En 2011, « Ben Nayef est intervenu pour éviter que le Printemps arabe ne souffle en Arabie saoudite », résume Clarence Rodriguez, journaliste française qui a passé 12 ans dans le pays, auteure du livre Révolution sous le voile.
Il apporte aussi tout son soutien à la répression meurtrière employée par le gouvernement du Bahreïn contre les contestataires. Depuis, le blogueur Raif Badawi croupit en prison, de même qu’Ali Mohammed al-Nimr, condamné à mort pour avoir participé à des manifestations dans l’est du pays. Son oncle, le clerc chiite Nimr Baqr al-Nimr passe par l’épée en janvier 2016. En réaction, l’ambassade d’Arabie saoudite en Iran est incendiée, ce qui entraîne la rupture des relations diplomatiques entre les deux États. « Comment avoir un dialogue avec un régime basé sur une idéologie extrémiste ? » se défend MBS, en qualité de ministre de la Défense du si modéré royaume wahhabite…
Ce conflit ouvert n’arrange rien. Pour ne pas céder des parts de marché à son rival, Riyad maintient le volume de sa production de pétrole, ce qui a pour effet d’entraîner le prix du baril au-dessous des 35 dollars. Une situation difficilement tenable puisque plus de 70 % des revenus proviennent de l’or noir. En avril, Ben Salmane présente son projet « Visions 2030 » pour diversifier et réformer l’économie saoudienne sur un modèle « thatchérien ». L’annonce crée quelques remous dans un pays où 3 des 5,5 millions d’employés seraient fonctionnaires.

Crédits : CEDA
Vision 2030
L’Arabie saoudite est construite sur des sables mouvants. Garantes de sa prospérité, les énormes réserves de pétrole découvertes dans les années 1930 ont une valeur qui fluctue en fonction des prix du marché. Voilà bientôt trois ans qu’ils sont bas. Mais l’érosion de cette manne essentielle au fonctionnement de l’État est surtout due à une lame de fond : la croissance démographique. Alors qu’il n’utilisait que 5 % de sa production dans les années 1970, le pays en consommait 25 % en 2012. En seulement cinq ans, de 2008 à 2013, la part du brent vendu à l’étranger est passée de 93 % à 84 % du total des exportations. Aujourd’hui, « 65 % de la population a moins de 25 ans », souligne Clarence Rodriguez. Si bien qu’à rythme d’extraction constant, le pays pourrait devenir importateur de pétrole d’ici 2037. Il ne restera alors plus rien des 2 000 milliards de dollars de revenus puisés dans le sol entre 1973 et 2002.
Pour récolter la même somme, le plan Vision 2030 envisage de vendre 5 % des actifs de Saudi Aramco, la compagnie nationale d’hydrocarbures. Sa supervision est assurée par MBS en qualité de président du Conseil des affaires économiques et de développement. « La question de la privatisation de va pas de soi », tempère Olivier Da Lage. « La date d’introduction en bourse du capital est repoussée en permanence. » Clarence Rodriguez invite aussi à la prudence : « Ça paraît compliqué de vendre alors qu’on parle de pénurie du pétrole à venir. Est-ce que vous investiriez sachant que dans quelques dizaines d’années il y aura une raréfaction ? »
Par ailleurs, tous les membres de la famille royale ne sont pas convaincus de l’intérêt de la cession d’une partie de ce fleuron national qui concourt pour 45 % à la richesse du Royaume. Face à la chute des cours, le régime s’était déjà lancé, fin 2015, dans un « plan de transformation nationale » à même d’éviter l’assèchement de son budget. Ayant dû ponctionner 700 milliards dans ses réserves pour couvrir ses pertes au printemps, il avait engagé des mesures comprenant le rapatriement d’avoirs investis à l’étranger, la suspension de chantiers d’infrastructures, et le gel des embauches ainsi que des promotions.
Des coupes sombres avaient également été données dans les subventions de l’eau, de l’électricité et de l’essence, dont les prix ont sensiblement augmenté. « Cette population qui était sous perfusion étatique l’est aujourd’hui beaucoup moins », observe Clarence Rodriguez. « On lui demande de se serrer la ceinture alors que la guerre du Yémen coûte quasiment sept milliards par mois. » Or, et la guerre et l’austérité vont se poursuivre.

Des jets saoudiens au-dessus du Yémen
Crédits : Hassan Ammar/AP
Le plan Vision 2030 « a été rédigé par des cabinets de consultants occidentaux », signale Olivier Da Lage. Pour réduire la dépendance de l’État à sa ressource fossile, il parie sur une industrie minière jusqu’ici délaissée et le développement des énergies renouvelables. Le pays assure qu’il couvrira 10 % de ses besoins énergétiques grâce aux éléments d’ici 2023. En parallèle, la construction d’un nouvel aéroport et d’une route entre Médine et La Mecque devrait participer au doublement du nombre de touristes.
Ces projets s’accompagneront d’une « diminution du nombre de fonctionnaires, des subventions et des allocations diverses ainsi que d’une privatisation des entreprises d’État », selon Olivier Da Lage. Des sacrifices qui auront d’autant plus de mal à passer que, si la famille royale mène grand train, c’est loin d’être le cas de tous. Sur le million d’emplois créés dans le secteur privé entre 2004 et 2014, beaucoup sont occupés par des étrangers. En octobre 2016, l’achat d’un yacht de 500 millions de dollars par le prince Ben Salmane a fait des vagues. « Le mécontentement de la population a amené les autorités à annuler des réductions d’allocations », explique Olivier Da Lage.
Mais depuis, le roi Salmane a réduit tous les contre-pouvoirs qui semblaient pouvoir s’opposer à son fils. Afin de lui donner les coudées franches, il a ainsi remercié le ministre du Pétrole Ali al-Nouaïmi en mai 2017, en poste depuis deux décennies. « Les princes et responsables plus âgés et plus expérimentés qui auraient pu lui faire de l’ombre ont été écartés », constate Olivier Da Lage.
Délesté de certaines entraves, MBS risque d’entrer dans un rapport de force avec sa population. « La remise en cause de l’économie rentière et de l’État-providence peut potentiellement bouleverser les grands équilibres de la société saoudienne », avertit le chercheur David Rigoulet-Roze, auteur lui aussi d’un livre intitulé Géopolitique de l’Arabie saoudite. « Dans les ctrois prochaines années, si rien n’est fait, il peut y avoir une implosion », estime Clarence Rodriguez. Tout dépendra de la capacité du prince à répondre aux aspirations de la jeunesse.

Le prince Ben Salmane
Crédits : AFP/HO/MISK
Une jeune voix
Plus à l’aise que Donald Trump lors de la danse du sabre, le roi Salmane était moins en verve pendant le reste de la visite du président américain à Riyad, en mai 2017. S’aidant d’une canne pour marcher, l’homme de 81 ans est apparu fatigué. « Son discours n’était pas très audible », se souvient Clarence Rodriguez. Tout le contraire de celui de son fils, dont la voix porte dans le monde. En mars 2017, il s’était rendu aux États-Unis pour préparer la venue de Trump. « Il avait aussi rencontré Vladimir Poutine et François Hollande, à une époque où il ne cachait pas, en privé, vouloir devenir roi », confie la journaliste. Même s’il parle très mal l’anglais, le prince « a donné des interviews à la presse occidentale – ce qui n’est pas très habituel pour les dirigeants saoudiens », pointe Olivier Da Lage. «Ilse présente comme l’incarnation de la modernité, de l’avenir de l’Arabie saoudite. »
En 2016, MBS a conseillé à son père de donner moins d’importance aux oulemas, c’est-à-dire aux théologiens du royaume. Sa nomination est néanmoins intervenue un jour de fête religieuse, une manière de leur donner des gages. « Pour diriger le pays, il faut parvenir à un consensus entre les responsables religieux, les tribus et les hommes d’affaires », indique Clarence Rodriguez. « Il a besoin de l’islam pour asseoir son autorité, c’est l’ADN du pays. » Le pouvoir de la Mutawa, la police religieuse, a été considérablement réduit la même année. Ses officiers « ne peuvent plus arrêter ou détenir des personnes, ni demander leurs cartes d’identité, ni les suivre ».
Selon des témoignages, certains n’hésitaient pas à porter des coups aux femmes en raison de leur tenues. Celles-ci ont désormais le droit de tenir un volant et ont pu voter et se présenter aux élections municipales de 2015. Mais seules 20 candidates ont été élues sur les plus de 2 000 sièges à pourvoir. En mai 2017, le roi a émis un décret autorisant les femmes à se passer de l’autorisation de leur « tuteur » pour voyager, étudier et avoir accès à certains soins. Un aval est toujours indispensable dans l’optique de se marier, porter plainte, travailler, consulter un médecin.

Riyad devra incarner le futur du pays
Pour modéré qu’il soit, le changement « va très vite aux yeux des caciques », relativise Clarence Rodriguez, qui précise par ailleurs que MBS « ne peut pas balayer toute son éducation conservatrice ». Une indication sur les changements à venir sera donnée par son implication dans la Commission de la condition de la femme des Nations unies dont l’Arabie saoudite est membre jusqu’en 2022. Il s’est en tout cas engagé à faire passer de 22 à 30 % le taux de femmes parmi les travailleurs en 15 ans.
Autre illustration de cette politique des petits pas, un concert dans la capitale, en mars 2017, a été autorisé par le pouvoir pour la première fois depuis trente ans. Il fallait toutefois être un homme pour s’y rendre. Deux mois plus tard, lors du remaniement gouvernemental, un ministère du Divertisement a été créé, pavant le chemin à des spectacles de théâtre ou des projections de cinéma, toujours interdits. Si cet élan venait à se conforter, il serait « plutôt une bonne chose pour la jeunesse qui ne voit pour l’heure son salut que sur les réseaux sociaux », considère Clarence Rodriguez.
Aussi, le prince jouit-il d’une bonne réputation auprès des jeunes, ternie par la détérioration de l’économie. « Certains l’idolâtrent, d’autres doutent », dit la journaliste. « Vous avez presque 30 % de chômage dans la jeunesse. » Maintenant qu’il s’est mis une partie des dignitaires religieux à dos et que la guerre au Yémen s’enlise de façon catastrophique dans les affres de la famine et du choléra, le futur souverain n’a pas le droit à l’erreur. « S’il vient à apparaître faible, tout le monde lui tombera dessus », prévient Olivier De Lage.
Conscient de ne pas faire l’unanimité, Mohammed ben Salmane est donc en train d’écarter les hommes de pouvoirs qui pourraient entraver ses plans. Le prince Al-Walid ben Talal est visiblement de ceux-là. Après avoir participé à l’acquisition du Plaza Hotel new-yorkais de Donald Trump, le milliardaire s’en était pris, en décembre 2015 au futur président américain en le traitant de « honte pour les États-Unis. » À quoi, l’intéressé avait répondu : « Ce crétin de Ben Talal veut contrôler nos politiciens américains avec l’argent de papa. Il ne pourra pas le faire quand je serai élu. » Le cas échéant, Trump a développé de bonnes relations avec MBS. Et, en octobre 2017, trois officiels de la Maison Blanche, dont le gendre du chef d’État, Jared Kushner, ont été vus en Arabie Saoudite. À croire que Washington ne voit pas d’un mauvais œil la montée en puissance du nouvel homme fort.
Ces signes d’ouverture ne sont pas synonyme de démocratie, comme en atteste le meurtre du journaliste Jamal Khashoggi en 2018. Depuis, tandis que le pays annonçait la délivrance inédite de visas de tourismes et un assouplissement du code vestimentaire, plus de 30 opposants ont été arrêtés selon les chiffres de l’association Human Rights Watch. « Mohammed ben Salmane a permis la création d’un secteur des loisirs et a autorisé les femmes à voyager et à conduire, mais sous sa supervision, les autorités saoudiennes ont également emprisonné un grand nombre des principaux intellectuels et activistes réformistes du pays, dont certains avaient précisément milité en faveur de ces changements », a déclaré Michael Page, directeur adjoint de la division Moyen-Orient à Human Rights Watch, en novembre 2019. « Une Arabie saoudite réellement réformiste ne soumettrait pas ses principaux activistes à des actes de harcèlement, à la prison et aux mauvais traitements. »
Début mars 2019, en pleine campagne d’arrestations, l’Arabie saoudite a décidé d’augmenter sa production de pétrole en pleine crise économique. Alors que l’épidémie de coronavirus (Covid-19) faisait plonger les bourses mondiales, la mesure a entraîné une baisse du cours de brut de 30 %. Riyad préservait ainsi ses parts de marché au détriment des grandes compagnies pétrolières, qui voyaient leurs valeurs dévisser. Pour Mohammed ben Salmane c’était là-encore un moyen d’affirmer la puissance de sa stratégie résolument offensive.
Couverture : Riyad, de nuit. (Ulyces.co)
L’article Voici comment le prince héritier d’Arabie saoudite change radicalement le royaume est apparu en premier sur Ulyces.
12.01.2021 à 07:16
Ces nanorobots vont peut-être vaincre le cancer
Denis Hadzovic
Robots autonomes Dans les laboratoires de l’Institut Max-Planck, à Stuttgart, des mouvements minuscules font avancer la science à grand pas. Mercredi 20 mai, les chercheurs allemands ont présenté un robot microscopique qui ressemble à un leucocyte. Produit dans la moelle osseuse, ce globule blanc qui circule dans le sang joue un rôle primordial dans la […]
L’article Ces nanorobots vont peut-être vaincre le cancer est apparu en premier sur Ulyces.
Texte intégral (1239 mots)
Robots autonomes
Dans les laboratoires de l’Institut Max-Planck, à Stuttgart, des mouvements minuscules font avancer la science à grand pas. Mercredi 20 mai, les chercheurs allemands ont présenté un robot microscopique qui ressemble à un leucocyte. Produit dans la moelle osseuse, ce globule blanc qui circule dans le sang joue un rôle primordial dans la défense de l’organisme face aux infections. En copiant la forme, la taille et les capacités du leucocyte, le nanorobot pourrait révolutionner les traitements de certaines maladies, et même guérir des cancers.
Pour cela, le nanorobot va naviguer directement dans les couches profondes des tissus de l’organisme, comme seul le leucocyte en est capable. Il accédera ainsi à des chemins actuellement hors d’atteinte, explique Metin Sitti, directeur du département des systèmes intelligents de l’Institut Max-Planck. Grâce à ses propriétés magnétiques, le robot peut être téléguidé par les scientifiques une fois propulsé dans les vaisseaux sanguins. Élaboré à partir de micro-particules de verre, l’appareil a un diamètre de 8 micromètres. D’un côté, il est recouvert d’une fine pellicule de nickel et d’or, tandis que l’autre face est dotée de molécules spécifiques qui peuvent reconnaître et combattre des cellules cancéreuses.
« Grâce aux champs magnétiques qu’ils utilisent, nos nanorobots peuvent naviguer à contre-courant dans un vaisseau sanguin artificiel, ce qui est difficile vu la puissance du flux sanguin et l’environnement rempli de cellules. Nos robots peuvent aussi reconnaître des cellules cancéreuses de façon totalement autonome, grâce à leur revêtement qui leur permet de libérer des molécules spécifiques tout en étant en mouvement », explique Yunus Alapan, chercheur et auteur de l’étude. Jusqu’ici, les nanorobots ont permis d’identifier et de localiser plusieurs cancers dans des organismes artificiels.

En 2018, des chercheurs de l’université de l’Arizona avaient déjà développé des nanorobots capables de détruire les tumeurs cancéreuses. L’étude avait permis de tester l’efficacité d’un système robotique autonome sur des souris ayant développé un cancer du sein, de l’ovaire, du poumon ou du mélanome. Le but était d’interrompre le flux sanguin en direction des tumeurs afin de les affaiblir à l’aide d’une protéine responsable de la coagulation sanguine : la thrombine.
Les nanorobots ont provoqué des lésions tissulaires sur les cellules tumorales dans les 24 h après l’injection, sans altérer les tissus sains. L’organisme a ensuite éliminé la tumeur naturellement, mais au bout de trois jours, tous les vaisseaux tumoraux présentaient un thrombus (caillot) qu’il fallait ensuite retirer. La méthode a donc de bonnes chances de fonctionner chez l’être humain mais les chercheurs allemands pensent avoir trouvé une meilleure solution.
Les limites de l’infiniment petit
Le secteur des nanorobots charrie autant d’espoirs que de dollars. En République tchèque, le directeur de l’Institut de technologie et de chimie de Prague Martin Pumera a déjà levé 11,5 millions d’euros dans le développement de nanorobots. Sa société, Advanced Functional Nanorobotics, espère pouvoir traiter de nombreuses maladies, incluant les problèmes de fertilité, grâce à ses robots tueurs de cancers dont l’efficacité a déjà été prouvée sur des souris. En France, la start-up Eligo Bioscience a levé près de 25 millions d’euros depuis sa fondation en 2014. Cela lui a permis de développer un robot d’une taille de 40 nanomètres, capable de cibler et de tuer certaines souches spécifiques d’une bactérie dans l’intestin. Il s’y connecte puis leur injecte de l’ADN afin de les annihiler.
Si ces sociétés on tout intérêt à vanter leurs solutions révolutionnaires, les scientifiques font preuve de prudence. À l’Institut Max-Planck de Stuttgart, ils prennent quelques pincettes pour évoquer l’efficacité des nanorobots. S’ils ont pu repérer leurs appareils dans des vaisseaux sanguins artificiels grâce à des microscopes, et les guider en utilisant des bobines électromagnétiques, « la résolution des technologies d’imagerie clinique n’est pas assez développée pour traquer les micro-robots à l’intérieur d’un organisme humain », explique Ugur Bozuyuk, coauteur de l’étude. Un seul robot ne serait du reste pas suffisant pour traiter une infection et il faudrait donc en contrôler un multitude pour que l’effet thérapeutique soit suffisant. « Nous en sommes encore loin », reconnaît Ugur.
Pour le moment, les micro-robots ne sont capables de circuler qu’à travers certains tissus faciles d’accès comme l’œil ou le tube digestif. L’environnement y est moins hostile que dans les vaisseaux, où le flux sanguin peut perturber le travail de ces appareils. Or pour atteindre des zones plus profondes de l’organisme, il n’y a qu’un seul chemin : la circulation sanguine, où les capacités de mouvement des robots sont plus restreints.

Les équipes d’Eligo
Ces problèmes ne paraissent pas insurmontables à Martin Pumera et Xavier Duportet, le PDG d’Eligo. Le premier rêve d’un « porteur de médicaments qui traque les cellules malades et, lorsqu’il les atteint, libère des traitements, s’auto-détruit et disparaît. Vous utiliserez mille fois moins de médicaments et limiterez les effets secondaires avec une meilleure qualité de vie des patients soignés. » Le procédé serait le même du côté d’Eligo : « Nos nanorobots pourraient être emballés dans des pilules et être délivrés dans le système digestif où ils pourront bouger librement pour se connecter à la bactérie ciblée », explique Xavier Duportet.
De la même manière, un nanorobot capable de se mouvoir dans les vaisseaux sanguins pourrait approcher une cellule cancéreuse afin d’y injecter de quoi la tuer. Une équipe de chercheurs saoudiens et espagnols vient de montrer comment les tumeurs pouvaient être détruites par un minuscule fil de fer qui dissémine un médicament anti-cancer tout en perforant la membrane de leurs cellules. Ce n’est donc plus qu’une question de temps avant que ces scientifiques saoudiens, espagnols, allemands, américains, français ou tchèques ne trouvent un moyen d’appliquer leur procédé à l’être humain.
Couverture : Shutterstock
L’article Ces nanorobots vont peut-être vaincre le cancer est apparu en premier sur Ulyces.
08.01.2021 à 00:44
Les secrets de l’école qui forme les futurs Jeff Bezos et Elon Musk
Servan Le Janne
La scène Dans le hall de Corus Quay, le long d’un mur végétal, un parterre d’étudiants attend impatiemment, assis sur une pelouse artificielle. Derrière eux, par les murs transparents de ce grand bloc de vitres, on peut voir les quais de Toronto, au bord du lac Ontario. À droite d’un toboggan en spirale blanc, Nadeem […]
L’article Les secrets de l’école qui forme les futurs Jeff Bezos et Elon Musk est apparu en premier sur Ulyces.
Texte intégral (2868 mots)
La scène
Dans le hall de Corus Quay, le long d’un mur végétal, un parterre d’étudiants attend impatiemment, assis sur une pelouse artificielle. Derrière eux, par les murs transparents de ce grand bloc de vitres, on peut voir les quais de Toronto, au bord du lac Ontario. À droite d’un toboggan en spirale blanc, Nadeem Nathoo monte soudain sur scène, déclenchant une salve d’applaudissements. En ce mois de mai 2018, le directeur du TKSummit souhaite la bienvenue à « des gens de Google, Microsoft, la NASA, Instagram, Facebook, Tesla, ou encore Oculus. Nous avons de la chance car cela n’arrive nulle part ailleurs dans le monde ». Les yeux des adolescents brillent. Après lui, ce sera leur tour de prendre le micro.

Ananya contrôle un robot par la pensée
Crédits : Ananya Chadha
Malgré leur jeunesse, les élèves de la Knowledge Society parlent savamment d’intelligence artificielle, de voitures sans conducteur, de réalité virtuelle, d’édition génétique, de cryptomonnaies ou d’exploration spatiale. À 14 ans, Sabarish Gnanamoorthy est non seulement le plus jeune développeur de casques HoloLens soutenu par Microsoft, mais il figure aussi parmi les dix acteurs de la réalité virtuelle à suivre selon le site VeeR. Un autre élève, Andrew Been, prétend avoir construit un modèle réduit de réacteur nucléaire dans son garage. Il n’a que 12 ans. Leur aîné, Tommy Moffat, 17 ans, se passionne pour les calculateurs quantiques.
Certains, comme Ananya Chadha, ont encore un appareil dentaire. Pour commencer sa présentation, déjà rompue à l’art du storytelling, la jeune fille raconte une anecdote de sa prime jeunesse. « Je me souviens que quand j’avais neuf ans, j’ai vu le film Mathilda. Ça parle d’une petite fille super intelligente qui peut contrôler des objets à l’aide de son cerveau. » Dès la projection terminée, la Canadienne a essayé de déplacer un stylo sans le toucher pendant 20 minutes. Rien n’a bougé. Il lui a fallu attendre l’âge de 16 ans pour réaliser le tour.
« Prochaine diapo », demande-t-elle, sur quoi on lui apporte une télécommande. Ça, elle ne sait pas encore le maîtriser par la pensée. En revanche, la vidéo projetée à l’écran la montre en pleine séance de magie. Reliée à un ordinateur par des câbles, des électrodes fixées sur son crâne, elle fait avancer une petite voiture téléguidée sans bouger. La salle applaudit. Une fois descendue de scène, parée pour un entretien individuel, la jeune femme brune de Toronto s’épanche sur d’autres prouesses. Elle a aussi utilisé l’outil d’édition génomique CRISPR-Cas9 pour traiter des maladies chez les souris, et a étudié la blockchain ainsi que la réalité augmentée. Elle est capable d’expliquer simplement ces différentes technologies. Pourtant, relativise Navid Nathoo, « elle avait peur de parler aux gens » il n’y a pas si longtemps. C’est sa rencontre avec lui, au sein de la Knowledge Society, qui l’a transformée.

Crédits : Ananya Chadha
Fondée en mai 2016 par Navid Nathoo et son frère, Nadeem, cette école qui n’ouvre que le week-end « forme des jeunes gens de 13 à 17 ans à devenir leur être optimal », explique Navid. Venus de l’univers des start-ups et de la finance, ils ont eu l’idée d’appliquer leurs schémas à l’enseignement. Ainsi, la Knowledge Society est un incubateur de personnes plutôt que d’entreprises, une pépinière de jeunes talents plutôt que de jeunes pousses. « Au lieu d’essayer de lancer des sociétés qui vaudront des milliards de dollars, elle tente de former les gens qui créeront ces sociétés », résume Ananya Chadha. « Ils veulent refondre le système éducatif. Ça a changé ma vie. »
Ravi de ce satisfecit, Navid Nathoo considère néanmoins qu’il reste beaucoup à faire. Il voit plus grand. Avec l’argent récolté par la vente de sa start-up, Airpost, au géant de l’informatique Box, en 2015, il ne souhaite pas simplement aider des adolescents à développer leur potentiel. L’objectif est surtout – vaste programme –, de « résoudre les problèmes les plus importants au monde ». Pour cela, le vingtenaire a besoin de lever un bataillon de super-entrepreneurs sur le modèle de Steve Jobs ou Elon Musk, dont le succès s’est selon lui construit « en dépit du système éducatif ». Navid et son frère sont convaincus qu’un pas de côté mène aux meilleures idées. Et ils ont des raisons de le croire.
Exil
Tout le monde n’aime pas la Knowledge Society autant qu’Ananya Chadha. Certaines écoles apprécient son travail. Mais pour nombre de professeurs, le cursus classique prime sur ces cours facultatifs, qui ne sont pas reconnus par le ministère de l’Éducation canadien. Pire, des établissements n’hésitent pas à sanctionner leurs élèves s’ils sont absents à cause d’une activité en lien avec cette deuxième école, comme à l’occasion d’une conférence donnée au Web Summit. D’après Navid Nathoo, il y a une véritable inertie dans l’enseignement moderne, tandis que l’univers des start-ups est en perpétuelle ébullition. Les diplômés d’aujourd’hui savent pondérer le risque, moins optimiser le succès, juge-t-il : « Avec mon frère, nous cherchons toujours le meilleur scénario, pas à éviter le pire. Ça vient de nos parents. »

Nadeem et Navid Nathoo
Crédits : TKS
Ces derniers ont grandi dans des pays africains limitrophes, sans jamais s’y croiser. Tous deux ont été contraints à l’exil. Originaire d’Ouganda, la mère de Navid et Nadeem a dû fuir le régime fou d’Amin Dada. Par chance, elle suivait les préceptes de l’ismaélisme, un courant de l’islam chiite dont les membres étaient aidés par la riche famille Agha Khan. Sans cela, elle n’aurait jamais pris d’avion pour Vancouver. Le maire actuel de la ville de Calgary, Naheed Nenshi, a aussi bénéficié de ce soutien. Lui était originaire de Tanzanie, comme le père de Navid. Mais ce dernier a emprunté un chemin plus sinueux. Dépossédé de ses terres par une nationalisation, il a atterri en Angleterre avant d’avoir 15 ans. Privé de lycée, l’adolescent travaillait comme contrôleur aérien la nuit et vendait du pain le jour. Il fallait au moins ça pour aider deux sœurs et autant de frères.
Après avoir racheté la boulangerie où il travaillait, le père Nathoo décide de lancer son entreprise au Canada, où il rencontre sa femme. Elle aussi a dû mettre un terme à ses études prématurément, à l’université, pour aider ses proches. « Ils n’ont pas de diplômes mais sont très intelligents », observe Navid. « Ils m’ont transmis leur ténacité, leur persévérance, cet état d’esprit peu conventionnel. Ils ont eu du succès en dépit des conventions. C’est aussi le cas d’Elon Musk et Steve Jobs. » Afin d’éviter les sentiers battus et de suivre les préceptes altruistes des Agha Khan, le jeune homme quitte Calgary aussi souvent que possible. Son frère et lui se rendent au Bangladesh pour aider à la mise en place de micro-crédits, puis au Tadjikistan, afin de développer l’éducation dans les régions montagneuses situées dans le nord du pays.
Voilà pour les excentricités. Car à côté de ces expériences hors du commun, les deux frères étudient le commerce. « Il est difficile d’avoir un impact sans comprendre les chiffres », justifie Navid. Ça tombe bien, ils n’ont guère de secret pour lui. Pendant que Nadeem entre dans la grand cabinet de conseil McKinsey, Navid fait de son entreprise, Airpost, un spécialiste reconnu de la sécurisation des données hébergées sur le cloud pour les professionnels. À son rachat par Box, l’homme d’alors 25 ans devient responsable d’une équipe composée d’anciens étudiants de Stanford, Berkeley, Harvard, du MIT et d’autres grandes universités. Mais comme l’expérience de ses parents le lui a appris, « un diplôme ne garantit pas le succès et ne définit pas l’intellect ».
Dopamine
Le Bangladesh a vu passer Ananya Chadha avant Navid Nathoo. Elle arrivait alors du Bahreïn et s’apprêtait à continuer un long périple, faisant étape à Madagascar, au Vietnam et à Dubaï pour finalement arriver au Canada à l’âge de trois ans. Elle avait alors déjà vu beaucoup de choses, au gré des déplacements de ses parents. Son père participait à la mise en place d’usines de vêtements dans différents pays. Et parce qu’elle travaillait pour une multinationale dotée de bureaux partout dans le monde, sa mère était elle aussi très mobile. Pourtant, la famille serait arrivée sans grandes ressources à Toronto. « Nous n’étions pas riches, mais mes parents m’ont porté beaucoup d’attention », raconte Ananya. « Eux-mêmes en avaient reçu dans leur enfance. »

Démonstration à la TV
Pour faire plaisir à leur fille unique, nouvelle venue à Toronto, les parents d’Ananya Chadha l’inscrivent à diverses activités. Elle s’essaye à la gymnastique, au skateboard, au ski, au chant, à la danse, aux échecs, aux maths ou encore à la natation. Dès que l’ennui la guette, la jeune Indienne est libre de s’arrêter, et elle ne s’en prive pas. Finalement, les sciences restent toujours dans le paysage. « Je n’ai jamais été exceptionnelle en sport », explique-t-elle. « Je n’étais pas mauvaise mais pas extraordinaire. En revanche, au CE1, j’étais capable de faire de longues divisions alors que mes camarades en étaient encore aux additions. » Ananya trouve là un moyen de se faire remarquer. Elle confie même avoir reçu « un afflux de dopamine » dû à la reconnaissance de sa qualité.
À 12 ans, la spécialiste des maths rejoint une colonie de vacances consacrée aux sciences à Toronto. Elle est complètement fascinée par les maquettes et autres réalisations qu’on lui demande de faire. Son intérêt pour les cours d’aéronautique est tout aussi aigu. Le simple fait de devoir trouver la forme optimale à donner à un avion en papier la réjouit. « J’ai toujours aimé faire des choses, les partager et avoir de la reconnaissance. OK, c’est un peu égoïste, mais bon j’imagine que c’est comme ça que fonctionne mon cerveau », sourit-elle. Souhaitant rejoindre une autre classe enseignant la théorie du vol, à 14 ans, elle en parle à son père. « Il m’a demandé s’ils me donneraient des cours de vol à proprement parler et je lui ai répondu que non. Le jour-même, nous étions à l’aéroport pour m’inscrire à un véritable cours de vol. Avec ma licence de pilote en poche à 14 ans, je me suis dit que je pouvais faire ce que je voulais. »
Alors qu’elle est en quatrième, Ananya Chadha participe à un concours scientifique. Au déjeuner, elle discute avec une neuroscientifique spécialisée dans l’étude des neuro-transmetteurs, thème qu’Ananya avait « un peu étudié ». L’enseignante lui propose alors de venir à son laboratoire. Au retour de sa première visite, l’adolescente « saute littéralement de joie » – elle y décroche un stage et la secondera dans ses recherches. Elle est sur de bons rails pour entrer à la Knowledge Society, au moment de sa création, en 2016, avec encore une fois une joie non dissimulée. « À chaque cours, une fois par semaine, on nous présente une nouvelle technologie », décrit-elle. « Si quelque chose nous plaît, on est encouragés à l’approfondir seuls. »
La deuxième partie du programme est consacrée au développement humain, pour se comprendre soi-même, et une troisième à la compréhension du monde. Ananya Chadha change. Elle se détache d’anciens amis qui ont fini par la trouver « bizarre » et passe davantage de temps avec ses camarades de la Knowledge Society. « Je me sens beaucoup plus intégrée qu’avant », assure-t-elle. « Nous avons beaucoup de choses en commun, comme notre ambition ou notre goût de l’apprentissage. » La confiance suit peu à peu.
À la fin d’un événement avec l’école, tandis qu’elle est prête à partir, Navid Nathoo l’interpelle : « Tu vas où ? Tu n’as parlé à personne. » Devant son étudiante devenue de marbre, le fondateur du projet pointe cinq participants au hasard et lui intime d’aller les voir pour se présenter. Depuis, Ananya Chadha n’a plus peur de parler. Elle confie même volontiers les « choses stupides » qu’elle a coutume de faire. « Je fais beaucoup de choses pour me sentir unique », avoue-t-elle. « Je n’ai jamais bu de soda, ni de café, je n’ai jamais mâché de chewing-gum, je mange sans sauce, et sans épice. Je veux me sentir différente. » Comme si le pas de côté était indispensable.

Elle vient en paix
Crédits : Ananya Chadha
Justement, Navid Nathoo ne reste pas en place. Développée en Amérique du Nord pour des raisons pratiques, la Knowledge Society sera exportée en 2019, promet-il. « J’étais à Dubaï la semaine dernière et je pense que beaucoup de choses intéressantes se passent là-bas », cite-t-il en exemple. « Je préfère me concentrer sur les villes où l’on parle anglais car il est plus facile d’adapter les programmes mais je reste très ouvert. » Ses étudiants les plus âgés sont déjà en stage chez des partenaires tels que Google, Microsoft, Airbnb ou Facebook. Ainsi, « nous n’avons plus seulement à croiser les doigts en attendant le prochain Elon Musk », assure-t-il. À supposer qu’Elon Musk aurait aimé la formation.
Couverture : The Knowledge Society. (TKS)
L’article Les secrets de l’école qui forme les futurs Jeff Bezos et Elon Musk est apparu en premier sur Ulyces.
- GÉNÉRALISTES
- Ballast
- Fakir
- Interstices
- Lava
- La revue des médias
- Le Grand Continent
- Le Diplo
- Le Nouvel Obs
- Lundi Matin
- Mouais
- Multitudes
- Politis
- Regards
- Smolny
- Socialter
- The Conversation
- UPMagazine
- Usbek & Rica
- Le Zéphyr
- Idées ‧ Politique ‧ A à F
- Accattone
- Contretemps
- A Contretemps
- Alter-éditions
- CQFD
- Comptoir (Le)
- Déferlante (La)
- Esprit
- Frustration
- Idées ‧ Politique ‧ i à z
- L'Intimiste
- Jef Klak
- Lignes de Crêtes
- NonFiction
- Nouveaux Cahiers du Socialisme
- Période
- Philo Mag
- Terrestres
- Vie des Idées
- ARTS
- Villa Albertine
- THINK-TANKS
- Fondation Copernic
- Institut La Boétie
- Institut Rousseau
- TECH
- Dans les algorithmes
- Framablog
- Goodtech.info
- Quadrature du Net
- INTERNATIONAL
- Alencontre
- Alterinfos
- CETRI
- ESSF
- Inprecor
- Journal des Alternatives
- Guitinews
- MULTILINGUES
- Kedistan
- Quatrième Internationale
- Viewpoint Magazine
- +972 mag
- PODCASTS
- Arrêt sur Images
- Le Diplo
- LSD
- Thinkerview
- Fiabilité 3/5
- Slate
- Ulyces
- Fiabilité 1/5
- Contre-Attaque
- Issues
- Korii
- Positivr
- Regain