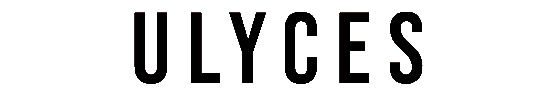22.02.2021 à 10:42
Le rap italien est-il génial ou nul ?
Nicolas Prouillac
Assise devant sa maison d’enfance, sur les hauteurs de la petite ville portuaire italienne de La Spezia, en Ligurie, ANNA ressemble à une adolescente comme une autre. Pourtant, la jeune rappeuse de 17 ans est la nouvelle star du rap italien. Depuis la sortie de son single « Bando » début 2020, tout s’est vite […]
L’article Le rap italien est-il génial ou nul ? est apparu en premier sur Ulyces.
Texte intégral (2092 mots)
Assise devant sa maison d’enfance, sur les hauteurs de la petite ville portuaire italienne de La Spezia, en Ligurie, ANNA ressemble à une adolescente comme une autre. Pourtant, la jeune rappeuse de 17 ans est la nouvelle star du rap italien. Depuis la sortie de son single « Bando » début 2020, tout s’est vite enchaîné. Anna Pepe a d’abord signé un contrat avec Virgin Records avant de devenir la plus jeune artiste à atteindre la première place du Hit Parade italien. Au cours des mois qui ont suivi, le morceau est devenu viral grâce à TikTok, traversant les Alpes pour conquérir l’Europe, avec un remix de JUL, et les USA, où il a été repris par le rappeur new-yorkais Rich the Kid. Dans son survêtement noir, celle qui incarne le renouveau du rap italien n’a pas l’air chamboulée outre-mesure.

ANNA
Crédits : Ulyces
Libérée des rythmes trop restrictifs des instrus à l’ancienne, la nouvelle génération d’artistes italiens a profité de l’arrivée de nouvelles influences pour rénover le genre. « Bando » en est l’exemple parfait avec son beat rap electro, signé par le producteur français Soulker. Parmi cette nouvelle vague, on trouve aussi Ernia. Avec la sortie de son dernier album, Gemini, le Mmilanais a prouvé qu’il pouvait naviguer entre différents univers musicaux sans trahir son style. Lorsqu’on lui demande ce qu’il pense du rap italien actuel, lors de notre rencontre à Milan, il répond humblement qu’ « il a commencé à atteindre un niveau intéressant ». « Il y a 10-15 ans, quand tu parlais du rap italien à un étranger, il se marrait », dit-il.
Après des années passées dans l’ombre de ses contreparties anglo-saxonnes, la scène rap italienne a pris son envol, égrainé de collabs internationales. On a notamment vu Capo Plaza apparaître aux côtés de Ninho, ou Sfera Ebbasta sur le titre « Cartine Cartier » de SCH. Le rappeur phocéen JUL a pour sa part repris le titre phare d’ANNA. « Jul a voulu faire ce remix spontanément, car le morceau lui a plu », raconte la jeune rappeuse. « J’ai beaucoup apprécié, car à Milan, on écoute beaucoup de musique française. » Car c’est notamment à Milan que s’écrit que s’écrit l’avenir international du rap italien.
Sous influences
C’est au cœur du QT8, un quartier de Milan, que nous retrouvons Ernia adossé au comptoir du Billard. Ce bar, un des derniers commerces du coin, est aussi son QG depuis des années. « J’y passe tous les jours, au moins pour acheter des cigarettes ou prendre un café », confie-t-il. Quand le rappeur parle du quartier dans lequel il a grandi, on sent l’influence qu’il a eu sur sa musique et sa carrière. « QT8 c’est un peu moi », résume le Milanais. « C’est une voie médiane, ce n’est pas un quartier périphérique dégradé ou populaire, mais ce n’est pas non plus un quartier central. »
Ses parents n’ayant jamais eu d’intérêt pour la musique, Ernia a puisé ses inspirations dans les sessions de freestyles du quartier. Au cours de ces années, il a développé d’excellentes capacités d’adaptation, qui lui permettent aujourd’hui de varier ses sons comme il le souhaite. « Le langage est toujours celui du rap, mais en passant par 1 000 sonorités, souvent en piochant dans l’indie italien », explique-t-il, assis sur une table de billard, tout vêtu de blanc. Dans son dernier album, Gemelli (jumeaux), il aborde d’ailleurs cette thématique des multiples facettes de sa personnalité, passant de la trap au sons plus « mainstream ».

Ernia à Milan
Crédits : Ulyces
L’autre révolution de la scène rap italienne a été l’arrivée de voix féminines. Sous l’influence de super stars internationales, de jeunes Italiennes talentueuses ont osé franchir le pas. Avant ANNA, il y avait Priestess. Avec trois singles diffusés sur les plateformes de streaming, puis l’EP Torno Domani en novembre 2017, la jeune femme fait des millions d’écoutes et parvient à se faire une place. Sur des instrus de trap typiquement américaine, la chanteuse parle sans tabou d’argent, de drogues ou de mecs dans un mélange de rap et de pop. « Ce que je raconte est vrai, c’est la vie d’une jeune fille de 22 ans qui est née et a grandi dans les Pouilles », confiait-elle à l’époque.
C’est sans doute l’authenticité qui fait l’attrait de cette génération. Des artistes qui assument leurs origines, leurs goûts et leurs envies, et qui ne s’interdisent rien. Capo Plaza fait pour sa part partie des nouvelles têtes du rap napolitain, chez qui l’influence de la mafia dans la région transparaît. Avec un style beaucoup plus gang, son quartier et sa ville, Salerne, sont présents dans tous ses textes. Il est sans doute, parmi les artistes cités, celui qui se rapproche le plus des sonorités qui nous sont familières dans l’Hexagone. Après un premier album, intitulé 20, qui l’a fait connaître en 2018, il a d’ailleurs d’ailleurs collaboré sur deux morceaux avec Ninho.
Et les ressemblances entre les deux artistes ne sont pas anodines. « On a grandi en ayant des rappeurs français pour idoles, et même en s’inspirant de certains rappeurs français de notre génération », avoue le Salernitain. Il semble pourtant étrange que les banlieues italiennes aient eu besoin d’autant de temps pour rattraper leur retard sur leurs pairs français ou américains.
Le bélier
À l’instar de l’Hexagone, la culture hip-hop est arrivée en Italie au début des années 1980. Et comme en France, il faudra attendre une décennie supplémentaire pour voir apparaître les premiers groupes, comme Radical Stuff, qui rappent le plus souvent en anglais. Mais c’est dans les années 1990 qu’émerge réellement une première scène italienne, avec notamment Bassi Maestro dans le nord de l’Italie et Sangue Misto dans le sud. Mais la volubilité de la langue italienne colle mal avec les mesures étroites et répétitives des beats de l’époque.
Même dans les années 2000, le rap italien passe largement inaperçu auprès du public français et international. La scène transalpine, portée par Fabri Fibra, commence à tourner en rond, avec une manière de rapper très monocorde – très « à l’ancienne » selon nos critères français.
L’autre frein majeur à son développement est dû à une particularité linguistique italienne. Si en France nous avons bien différents accents, ils n’empêchent pas la compréhension des uns ou des autres. Mais en Italie, ces différences sont bien plus importantes, formant de vrais dialectes. Par exemple pour la série italienne Gomorra, la version originale a dû être sous-titrée en italien pour faciliter la compréhension du napolitain dans tout le pays. Et le milieu du rap en particulier se recentre sur les valeurs de quartier, d’identité et d’appartenance, en faisant usage de ses dialectes. Cette barrière de la langue interne au pays n’a donc pas favorisé l’émergence d’une scène nationale.

Ernia à l’extérieur du stade de San Siro
Crédits : Ulyces
Les premiers à s’être tirés de ce guêpier sont les membres du groupe Troupe d’Elite qui, entre 2011 et 2014, ont proposé un rap alternatif rafraîchissant pour le public de la Botte. Avec son producteur Fonzi Beat, qui y a apporté des sonorités electro, les rappeurs du groupe se font rapidement un nom, avant de se séparer à la suite de désaccords. Parmi les membres, on retrouvait deux des têtes d’affiche de la nouvelle vague : Ghali et Ernia. D’abord critiqués pour leur approche, ces artistes ont rebâti le rap italien et ouvert la porte à de toutes nouvelles créations. Lorsqu’il se remémore cette époque, Ernia se rappelle avant tout de la rupture entre leur musique et ce qui se faisait avant. « Nous sommes les premiers à avoir fait de la trap en Italie », assène-t-il fièrement. « Nous avons été le bélier qui a défoncé la grande porte. »
Mais celui qui a achevé de faire basculer le genre se nomme Sfera Ebbasta. En 2015, le rappeur a percé grâce à la sortie de son projet XDVR. Avec Charlie Charles à la production, il devient vite un succès national. Ses instrumentales trap et cloud rap ont donné aux artistes leurs lettres de noblesse, les amenant à collaborer avec de nombreux autres rappeurs, en Italie comme à l’étranger. Trois ans après, les deux musiciens ont annoncé le lancement du label BillionHeadz Music Group, plateforme grâce à laquelle ils ont enchaîné les featurings, leur permettant de toucher un public plus vaste.
Car c’est là que se trouve la clé du renouveau. Grâce aux plateformes de streaming et aux réseaux, la musique se propage beaucoup plus facilement et les rappeurs italiens ont finalement pu trouver leur audience, chez eux comme à l’étranger. Pour ANNA, c’était grâce à TikTok.
Rockstars
Malgré son succès, la jeune rappeuse continue de vivre une vie d’adolescente normale. Elle vit encore chez sa mère et espère déménager à Milan quand elle sera majeure pour prendre son indépendance. Motivée à s’imposer avec sa musique, elle espère que d’autres Italiennes suivront son exemple.
« Je pense qu’il y beaucoup de jeunes filles talentueuses en Italie, mais elles ne réussissent pas à se faire une place parce qu’elles se sentent un peu écrasées par le machisme ambiance qu’il y a dans la musique italienne », confie-t-elle aux abords du port de La Spezia.

ANNA sur le port de La Spezia
Crédits : Ulyces
L’autre tendance à suivre sera l’effacement des frontières de la musique. Avec l’augmentation des collaborations internationales ces dernières années, les artistes s’influencent de plus en plus pour créer de nouvelles sonorités. Sfera Ebbasta a par exemple publié deux versions de son album Rockstar, une italienne et une internationale.
Sur ce second volet, on retrouve la participation de l’Anglais Tinie Tempah, de l’Allemand Miami Yacine, de l’Espagnol Lary Over et de l’Américain Rich the Kid. Si le contexte actuel ne se prête pas au voyage, le rap italien ne connaît désormais plus aucune frontière.
Couverture : ANNA par Ulyces
L’article Le rap italien est-il génial ou nul ? est apparu en premier sur Ulyces.
19.02.2021 à 09:37
Aux origines du funk carioca, le son des favelas brésiliennes parti à la conquête du monde
Servan Le Janne
Au-dessus d’un mur de caissons de basse, six lettres et quatre chiffres envoient une lumière vert fluo sur les danseurs d’un club de Rio de Janeiro. Il est écrit Furacão 2000. Pour faire futuriste, le collectif qui organise cette soirée en octobre 1995 a non seulement choisi de s’appeler « cyclone », mais aussi d’adjoindre […]
L’article Aux origines du funk carioca, le son des favelas brésiliennes parti à la conquête du monde est apparu en premier sur Ulyces.
Texte intégral (2169 mots)
Au-dessus d’un mur de caissons de basse, six lettres et quatre chiffres envoient une lumière vert fluo sur les danseurs d’un club de Rio de Janeiro. Il est écrit Furacão 2000. Pour faire futuriste, le collectif qui organise cette soirée en octobre 1995 a non seulement choisi de s’appeler « cyclone », mais aussi d’adjoindre à ce nom la promesse du nouveau millénaire à venir. L’ambiance est raccord. Seulement avec le changement d’ère, ce genre d’idées est depuis complètement passé de mode. Mais Furacão 2000 n’est pas ringard. Au contraire, c’est devenu un pilier essentiel de la scène funk brésilienne, aussi appelée funk carioca ou baile funk.
Ce style né en marge dans les années 1970 est devenu un monument de la culture populaire brésilienne, au point de s’exporter de mieux en mieux. À la mi-janvier 2021, la maison de disque Warner Music a annoncé qu’elle distribuerait bientôt Furacão 2000 sur le marché mondial.
Ambassadeur du genre depuis 45 ans, ce collectif devenu label est responsable de la diffusion du funk carioca à l’étranger et de la popularisation du genre dans tout le pays. Pour les médias brésiliens, ce rachat est une réussite et une fierté. Cela prouve que le funk carioca fait son trou à l’international et a encore de beaux jours devant lui, porté par des artistes de renommée mondiale comme MC Niack, Anitta ou Ludmilla. Évidemment, son destin est étroitement lié à l’histoire du collectif Furacão 2000 qui fait office de témoin de l’évolution du baile funk.
Le grand mix
Les membres de Furacão 2000 voient l’intérêt de Warner comme un adoubement. « C’est une audacieuse révolution dans le monde du funk. Il n’y aura pas un endroit sur cette planète qui ne connaisse le son du Furacão ! » s’enthousiasme Leonardo Cezareth, ancien MC du collectif et entrepreneur du funk depuis plus de 20 ans. Le quinquagénaire bedonnant est passé de la composition à la production. Il est bien placé pour savoir que cette ascension n’avait rien d’évident. « Le funk a pris des proportions que nous ne pouvions pas imaginer nous-mêmes », abonde MC Niack, qui vient de devenir une star avant d’avoir 18 ans. « C’est devenu la musique populaire brésilienne et maintenant ça s’écoute à l’étranger. » Difficile à l’époque d’imaginer le sacrement d’une musique censée représenter les favelas et les bas fonds.

MC Niack
Crédits : Ulyces
Baptisé baile funk à l’étranger d’après le nom des soirées qui ont fait sa renommée, ce genre est souvent résumé par le terme funk au Brésil. S’il renvoie à un son assez différent de celui des Isley Brothers ou de Parliament, c’est pourtant bien en remixant des classiques funk que des DJ brésiliens lui ont donné naissance. Le baile funk est inspiré par la Miami bass, un hip-hop électronique né à Miami fait de nombreux breaks, ces instants où seul le beat subsiste, provoquant une irrépressible envie de bouger à son rythme.
Au milieu des années 1970, la Floride est la destination privilégiée des DJ de Rio pour faire le plein de disques américains, si bien que lorsque la Miami Bass arrive à leurs oreilles, ils se l’approprient immédiatement. À l’instar de la samba, qui s’est nourrie autant de rythmes africains que de valses et de tango, le funk brésilien réinterprète la Miami bass en y incorporant de la soul, de la samba et une multitude de styles existants. Le résultat mélange des samples de funk, de soul ou d’electro pop, le tout avec un tempo très relevé.
Trouvant un écho particulier dans les favelas de Rio au milieu des années 1970, la funk carioca reste snobée par les classes sociales supérieures. Elle reflète alors le quotidien de nombreux jeunes brésilien.ne.s et on y parle d’injustice sociale, de sexe, de la fierté d’être noir.e et de discriminations. C’est à ce moment-là, à la fin des années 1970, que se forme le collectif Furacão 2000. Des figures commencent également à émerger doucement telles que DJ Marlboro, considéré aujourd’hui comme le parrain du baile funk. Il a été un des premiers à l’exporter en Europe en signant sur le label allemand Man Recordings en 2004.

Mais la popularité du funk carioca explose véritablement dans tout le Brésil en 1982 avec la sortie du morceau « Planet Rock », du groupe new-yorkais Afrika Bambaataa. Parce que son style est proche des rythmes entendus dans les soirées de Furacão 2000, le titre provoque un engouement nouveau autour du funk au Brésil. La sortie pousse de nouveaux artistes à investir le funk carioca.
Les basses lourdes et le beat électro minimaliste inspirent les DJ partout au Brésil et le virus passe d’une fête à l’autre. Souvent criminalisées par le pouvoir en place, les bailes prennent cependant une place majeure dans la vie nocturne des favelas, place qu’elles occupent encore aujourd’hui. La répression existe d’ailleurs toujours puisque le président Jair Bolsonaro essaye encore à l’heure actuelle de fermer les clubs où se tiennent ces sulfureuses fêtes baile funk.
Des breaks et des balles
Le collectif Furacão 2000 naît de la fusion entre deux collectifs existants : Som 2000 dirigé par Romulo Costa, plutôt orienté soul, et Guarani 2000, avec Gilberto Guarani à sa tête, spécialiste du funk traditionnel. Leurs performances au début des années 1980 ne laissent personne indifférent et commencent à ameuter de plus en plus d’artistes autour d’eux. « Furacão 2000 est une usine à découvrir des talents, le funk prend les gens ordinaires et les encourage à enregistrer, à parler de la vie quotidienne de la communauté », raconte le quinquagénaire Romulo Costa, à la tête du label depuis la fusion et désormais père d’une petite fille. Certains noms se distinguent comme MC Marcinho ou le groupe Força do Rap. Le collectif se développe en même temps que le baile funk. Pour Romulo, « l’histoire de Furacão 2000 est l’histoire du funk ».
Dans les années 1990, un événement marque durablement le funk carioca. À Rio, certaines favelas côtoient les zones huppées de la ville, ce qui amène parfois à des tensions qui dégénèrent en conflits. En 1992, alors que des centaines de jeunes brésilien.ne.s en colère et désemparé.e.s de devoir supporter ces conditions de vie quittent leurs favelas et se réunissent pour une baile improvisée sur la plage d’Arpoador, la situation dégénère. Effrayée par les danses qui deviennent de plus en plus frénétiques, la police intervient brutalement et souffle sur les braises de la violence. Une émeute éclate alors et les images des jeunes déchaîné.e.s font le tour du pays.
Ces émeutes sont alors mises sur le dos de l’ensemble des funkeiros, le nom donné aux adeptes des baile funk. Le gouvernement accuse ces soirées d’encourager la violence et la dissidence et les interdit tout simplement. Désormais illégales, les bailes doivent s’organiser dans la clandestinité. Elles deviennent alors véritablement le symbole des favelas.

Crédits : Furacão 2000
À la manière du gangsta rap, un sous-genre appelé proibidão célèbre le mode de vie des gangs, en parlant de trafic de drogue ou d’armes. Certaines bailes se finissent en échanges de tirs et font couler le sang, encourageant en retour une répression toujours plus forte du gouvernement. Les artistes de Furacão 2000 restent pour leur part sur la ligne des années 1980 et prônent le calme au nom de l’amour de la musique. Ils se structurent en label, qui devient peu à peu la principale maison de disque du funk brésilien.
Cette période sombre pour le funk carioca durera jusqu’en 2000, date à laquelle une loi est votée obligeant les gérant.e.s des clubs à installer des détecteurs de métaux à l’entrée de leur établissement, et à poster des membres de la police militaire à leurs portes s’ils.elles veulent pouvoir à nouveau organiser des bailes. Ils.elles doivent également obtenir une autorisation gouvernementale écrite et les artistes dont la musique est jugée « criminelle » en sont bannis. La carioca est contrainte de se lisser, de faire moins de vagues, pour survivre. Elle devient moins violente dans ses propos avec, dans les années 2000, une focalisation sur l’amour.
Ces chansons d’amour, souvent accompagnées de connotations sexuelles, mettent de côté les difficultés des favelas et installent la vision des baile funk comme d’un rassemblement social pour sortir, flirter et rencontrer des amis. Le groupe Bonde do Tigrão, du label Furacão 2000, incarne parfaitement cette tendance. Le quatuor originaire du quartier paulista de la Cité de Dieu rencontre un gros succès dans tout le pays avec son premier album. Il est disque de platine en 2001 avec 250 000 albums vendus au Brésil.
Pour Furacão, cette décennie voit également l’émergence des femmes MC telles que MC Sabrina ou Gaiola das Popozudas. Ce groupe de danseuses dont le nom signifie littéralement la cage aux folles prône une féminité libérée tant au niveau social que sexuel, avec des thèmes récurrents que l’on retrouve notamment dans les titres : « C’est moi qui paie le motel », « Je vais cocufier ton mari » ou « Les amoureux contre les fidèles ». Le succès de ces piliers du néo-féminisme dans le funk brésilien est tel qu’elles apparaissent en 2005 sur une mixtape du DJ américain Diplo.

MC Niack
Crédits : Ulyces
Non seulement le genre s’exporte mais il se diversifie. Au sein du funk carioca, différents mouvements se développent. « C’est difficile à expliquer même à un Brésilien », rigole MC Niack. « Il y a le mandelão, le brega funk, le 150… Mon truc c’est plutôt le mandelão, qui a un beat plus lourd, un peu comme dans le dubstep. »
Signée chez Furacão 2000 depuis 2010, Anitta (ou MC Anitta) est l’une des ambassadrices du funk carioca dans le monde. En 2017, elle a atteint les 200 millions de vues sur Youtube pour son tube « Vai Malandra » en featuring avec l’américain Maejor Al. Elle incarne la continuité et l’héritage d’un label vieux de 45 ans et fait sans doute partie des raisons ayant poussé Warner Music à intégrer Furacão 2000 à son roster d’artistes. De quoi continuer à insuffler un renouveau à la scène funk carioca et à lui assurer un avenir radieux.
Couverture : MC Niack, par Ulyces
L’article Aux origines du funk carioca, le son des favelas brésiliennes parti à la conquête du monde est apparu en premier sur Ulyces.
18.02.2021 à 11:01
Ital : à la découverte du régime végane précurseur des rastas
Servan Le Janne
Au cœur du XXe arrondissement de Paris, dans la rue des Petites-Écuries, la devanture de Jah Jah By Le Tricycle arbore les couleurs du pays des rastas : rouge, or et vert. Derrière la vitrine, de grands bacs de lentilles corail, de riz, de noix de cajou, de pois chiches et d’épices sont étagés. Il […]
L’article Ital : à la découverte du régime végane précurseur des rastas est apparu en premier sur Ulyces.
Texte intégral (2769 mots)
Au cœur du XXe arrondissement de Paris, dans la rue des Petites-Écuries, la devanture de Jah Jah By Le Tricycle arbore les couleurs du pays des rastas : rouge, or et vert. Derrière la vitrine, de grands bacs de lentilles corail, de riz, de noix de cajou, de pois chiches et d’épices sont étagés. Il n’y a pas un dreadlock dans la longue file de clients qui patiente à l’entrée de cette cantine aux influences jamaïcaines. Seul Daqui, le maître des lieux, a le look rasta, contrebalancé par sa doudoune orange, qui se fond bien dans le quartier.
Il faut dire qu’en cette journée de février, un froid peu caribéen règne. Ce climat hostile n’a pas suffi à décourager les habitué.e.s, venu.e.s chercher coûte que coûte leurs wings de chou fleur ou leur bowl vegane. Bien loin de la terre rasta et de ses bars de plage en bois, Daqui Gomis et Coralie Jouhier ont relevé le défi de réimplanter l’esprit « ital » dans ce petit local en plein cœur de la capitale. Il est de Guinée-Bissau, elle de Guadeloupe, mais ici c’est bien à la Jamaïque qu’ils ont voulu « faire un clin d’œil ». Et le clin d’œil est appuyé : un banc rouge, jaune et vert, des tables colorées, des peintures locales et des portraits de Bob Marley décorent l’endroit. Mais le plus important, ce sont les saveurs et la philosophie importées de la célèbre île.

Crédits : Ulyces
La diète ital est loin d’être la composante de la culture rastafari la plus connue. Elle y tient pourtant une place centrale. Il s’agit, pour le dire vite, d’une alimentation naturelle, locale, bio, sans viande, sans additifs, et pour les puristes sans produits laitiers. Les amateurs de reggae attentifs savent l’importance de la cuisine sur l’île. « J’adore chanter depuis toujours », nous confie par exemple le chanteur Tarrus Riley, membre du mouvement rastafari. « Je chante tout le temps quand je cuisine. »
Quand ce fils du légendaire Jimmy Riley sortait son deuxième album, en 2006, Jah Sun fredonnait « no bones no blood inna we kitchen », ou Macka B faisait l’éloge du véganisme dans « Wha me eat ». C’était avant que la mode vegane ne s’empare des grandes villes du monde entier. Car chez les rastas, le « plant-based », le « made with love » et le « 100% organic » régnaient déjà sur les fourneaux il y a 60 ans.
Ital is vital
Le terme ital (ou I-tal) provient du mot anglais « vital ». Avec cette alimentation dite naturelle, le rasta entend faire progresser sa « livity », cette énergie de vie partagée qui existe selon la croyance rasta en chaque être humain. La livity augmenterait ou diminuerait en fonction de ce que l’on introduit dans son corps.
Apparu dans les années 1930, le rastafarisme est né sous l’impulsion de Leonard Percival Howell – une figure du mouvement que l’histoire a occultée par la suite. Parti très jeune de chez lui, ce Noir jamaïcain navigue sur les mers du monde entier en tant que cuisinier pendant huit ans, avant de s’installer à New York. Il y fonde un café à Harlem, peut-être un des quelque 500 points de vente de marijuana que la police américaine traque à l’époque, selon Hélène Lee, autrice de l’ouvrage Le Premier rasta. Il fréquente un compatriote en la personne du militant Marcus Garvey. Ces accointances ne le laissent pas indemne. L’idée d’un retour du Messie en la personne du roi éthiopien Hailé Sélassié (le ras Tafari Makonnen) fait son chemin, et Howell s’en empare.
Dès son retour forcé en Jamaïque en 1932, il vend des photos de celui qu’il présente comme Dieu, et développe une pensée imprégnée de marxisme, de lutte pour la décolonisation et de mysticisme. En 1939, il crée la communauté de Pinnacle qui regroupe des afrodescendant.e.s et se consacre à la culture de l’herbe sacrée, la marijuana. Également proche des pauvres travailleurs.euses indien.ne.s venu.e.s prendre la place des esclaves noir.e.s, affranchi.e.s deux générations plus tôt, Howell s’en serait inspiré dans sa décision de proscrire la viande de la religion rastafari. Le mouvement s’appuie par ailleurs sur certains passages de la Bible pour justifier cette exigence alimentaire, comme ces deux versets de la Genèse :
« Dieu ajouta : “Or, je vous accorde tout herbage portant graine, sur toute la face de la terre, et tout arbre portant des fruits qui deviendront arbres par le développement du germe. Ils serviront à votre nourriture.”
“Et aux animaux sauvages, à tous les oiseaux du ciel, à tout ce qui se meut sur la terre et possède un principe de vie, j’assigne toute verdure végétale pour nourriture.” Et il en fut ainsi. »

Tarrus Riley
Crédits : Ulyces
Dans un premier temps, les rastafaris se contentent donc de ne pas consommer d’animaux. Ce ne serait qu’à partir des années 1960, au moment de l’indépendance, qu’aurait émergé la philosophie ital. À cette époque, la communauté rasta est en conflit avec le gouvernement britannique. À la suite de plusieurs incidents, le Premier ministre jamaïcain Alexander Bustamante ordonne à la police et à l’armée de lui ramener tous les rastas, qu’ils soient vivants ou morts.
Beaucoup s’enfuient alors des villes pour se réfugier à la campagne. C’est dans cet exil forcé, où les merveilles ultra-transformées des supermarchés sont hors de portée, qu’ils auraient découvert les vertus de ce régime crudivore, sans alcool, cuisiné avec des ustensiles en bois uniquement. Aujourd’hui, l’idée selon laquelle la nourriture doit être le principal médicament demeure ancrée dans la mentalité rasta.
Pas de sel, pas de sucre
Les principaux ingrédients que l’on retrouve souvent dans les plats ital sont sans surprise des denrées accessibles dans les Caraïbes comme le riz, les haricots rouges, les bananes plantains et les noix de coco. Mais pour Troy Levy, chef jamaïcain au visage rond et rieur, toutes les subtilités de ce régime tiennent dans les herbes et les épices, abondantes en Jamaïque : ail, coriandre, gingembre, piments… Autant de ressources précieuses qu’il faut manier à la perfection.
Dans les recettes qu’il sert, ce traiteur tâche de respecter les principes ital à la lettre : pas de sel, pas de sucre, pas de viande, pas de poisson, pas d’aliments transformés et pas même de produits d’origine animale. Le résultat n’en est pas pour autant austère. Troy propose des tacos véganes, un bowl ital, de la polenta à la noix de coco, des boulettes de champignons ou encore du riz frit au chou fleur.
Cuisiner sans additif exige de manier à la perfection les épices, les herbes, et de savoir tirer partie des saveurs que contient chaque ingrédient. « Les deux principaux condiments que les rastas doivent éviter dans leur cuisine sont le sel et le sucre », insiste Troy Levy. « Un plat cuisiné avec du lait de coco naturel sera déjà sucré. Si on utilise bien les différentes épices et les différentes herbes, on n’a ni besoin de sel, ni besoin de sucre. Aucun additif n’est nécessaire. »

Troy Lévy prépare des boulettes aux champignons.
Crédits : Troy Lévy
Chez ce rasta convaincu originaire de la ville de Glengoffe, au nord de la capitale Kingston, la cuisine est une histoire de famille. Tout jeune, il aidait sa mère aux fourneaux. « Mon premier souvenir en cuisine, c’était à huit ans, ma mère avait une grippe. Depuis son lit, elle m’a guidé pour préparer le traditionnel dîner du dimanche : du riz avec des haricots rouges et des légumes cuits dans du lait de coco. Personne n’a voulu croire que j’avais cuisiné ! »
Troy Lévy a ensuite continué son apprentissage dans le restaurant de son beau-père. Mais les saveurs ital, il les tient surtout de son oncle rasta : « J’ai une double culture, ma grand-mère était chrétienne, mais depuis tout petit je mangeais ital chez mon oncle. Encore aujourd’hui c’est lui qui m’inspire le plus : dès que je retourne en Jamaïque, je découvre de nouvelles saveurs. » Sa spécialité ? Le coconut rundown, « un plat de légumes mijotés dans du lait de coco » qu’il dit pouvoir manger indéfiniment.
Tout est bio et Troy Levy tente de recourir à des produits locaux, de connaître leurs producteurs et l’origine de chaque aliment. À ses yeux, « le plus important est d’être conscient de ce que l’on met dans son corps. Non seulement pour être en bonne santé et vivre plus longtemps, mais aussi car c’est en mettant en soi des aliments propres que l’on est propres à l’intérieur, que nos pensées sont plus positives. » Cela implique de cuisiner « avec amour » et pourquoi pas en écoutant Bob Marley ou Garnett Silk Chronixx, ajoute-t-il en souriant.
Les nuances d’ital
À l’instar du rastafarisme qui comporte de nombreux courants, l’ital fait l’objet de différentes interprétations. Toutes les communautés n’observent donc pas les mêmes règles en la matière. Parmi les rasta, les Nyahbinghi et Bobo Ashanti adhèrent à la nourriture ital, tandis que la troisième grande communauté, les « Douze tribus d’Israël », ne lui reconnaissent aucune légitimité. Tous ceux qui revendiquent le fait de consommer ital ne s’imposent d’ailleurs pas un régime sans animaux. Certains tolèrent le poisson, d’autres les produits laitiers ou les œufs. Troy Lévy, lui, est un puriste. « Beaucoup de gens portent des dreads et se disent “rastas”, mais ils sélectionnent ce qui les arrange ». Daqui quant à lui ne partage pas le même point de vue. « Il y a plein de façons de manger ital, les règles ne sont pas figées », estime le trentenaire à la tête du Jah Jah By Le Tricycle. « Certains mangent même du poisson. L’essentiel, c’est d’avoir une nourriture naturelle. »
Au menu du Jah Jah By Le Tricycle, les plats sont tous végétaliens. Sur les produits d’origine animale, Daqui et Coralie ne transigent jamais. Il n’y a pas même une trace de miel dans leurs recettes. « Manger de la viande, déjà, c’est avaler une énergie de mort », assurent-ils. « Notre organisme n’est pas adapté : les vrais carnivores ont un intestin beaucoup plus court, apte à la digérer. Et des dents carnassières. » En revanche, le restaurant n’hésite pas à servir de la bière jamaïcaine, et à mettre du sel ou du sucre dans les plats.

Kingston
Crédits : Ulyces
Quand on cuisine ital en France, il faut faire des concessions, considèrent-ils. « On s’adapte à notre environnement. Le sel, c’est aussi une question d’éducation du palais, et de qualité des produits. En Jamaïque, il n’y en a pas besoin, les légumes et les fruits ont tellement de goût ! Le soleil fait tout. » Avec Jah Jah, le couple espère faire connaître la cuisine ital et montrer les vertus du véganisme. « De plus en plus de personnes s’aperçoivent qu’il y a plus de méfaits que de bienfaits à consommer des animaux », se réjouissent-ils.
Leur cantine prouve par ailleurs que l’alimentation ital est davantage un ensemble de principes à faire régner en cuisine qu’une liste de recettes figées. Ici, les inspirations proviennent du monde entier. Un client peut commander du mafé, des plats d’inspiration japonaise, des dahl de lentilles, mais aussi un hot dog ou un burger vegan.
Pour Troy aussi, la tendance ital a beaucoup à apporter. À ses yeux, il ne fait d’ailleurs aucun doute que la « mode » du véganisme tire toute son inspiration de la Jamaïque. « Mon oncle rasta voyageait énormément quand il était jeune. J’ai vu ses nombreux amis européens et américains venir visiter la Jamaïque. Ils apprenaient auprès de lui à cuisiner ital et je suis sûr que nous sommes à l’origine de son expansion. Ils ont juste remplacé le mot ital par végane, mais c’est la racine de tout ça. » Le chef jamaïcain en tire d’ailleurs parti, et entend prêcher la bonne parole dans le monde entier. Après avoir lancé sa chaîne YouTube « Taste of ital », il s’est lancé dans les ateliers aux quatre coins des États-Unis, avec pour objectif de présenter sa gastronomie aux restaurateurs intéressés. « Je compte faire un atelier en France dès que la situation le permettra ».
Il sera d’autant mieux reçu que la diète ital pourrait offrir une réponse aux défis alimentaires planétaires, déclinable à l’envi selon les cultures et les plantations de chaque région du monde. Après la vague reggae des années 1970 et 1980, la culture rasta semble prête à déferler une nouvelle fois sur le monde.
Couverture : Troy Levy, par Ulyces
L’article Ital : à la découverte du régime végane précurseur des rastas est apparu en premier sur Ulyces.
17.02.2021 à 09:28
Petite histoire du jeu vidéo dans le bloc communiste
Servan Le Janne
Une nuit de juin 1984, Alekseï Pajitnov, ingénieur et mathématicien de l’Académie des sciences de Moscou, perfectionne le programme sur lequel il travaille depuis plusieurs semaines. Passionné de puzzles et de jeux vidéo, Pajitnov profite de son temps libre pour mettre au point des jeux sur son ordinateur. Cette nuit-là, alors que les reflets cathodiques […]
L’article Petite histoire du jeu vidéo dans le bloc communiste est apparu en premier sur Ulyces.
Texte intégral (2729 mots)
Une nuit de juin 1984, Alekseï Pajitnov, ingénieur et mathématicien de l’Académie des sciences de Moscou, perfectionne le programme sur lequel il travaille depuis plusieurs semaines. Passionné de puzzles et de jeux vidéo, Pajitnov profite de son temps libre pour mettre au point des jeux sur son ordinateur. Cette nuit-là, alors que les reflets cathodiques strient sa barbe fournie, toutes les pièces de son puzzle semblent enfin s’assembler. C’est un succès personnel. Il est alors loin de se douter que sa future création deviendra l’un des jeux les plus iconiques de l’histoire du jeu vidéo.
Contraction du chiffre grec « Tetra » et du sport préféré de son créateur, le tennis, Tetris est en train de voir le jour. Après avoir rencontré un franc succès à Moscou et bientôt dans toute la Russie, le jeu attire l’attention d’un investisseur britannique, qui contacte Pajitnov. Le professeur ne ferme pas la porte à une distribution européenne de son invention mais ne donne pas explicitement son accord. Cela n’empêche pas l’éditeur de jeux vidéo Spectrum HoloByte de commercialiser en 1987 sa propre version baptisée Tetris : The Soviet Challenge, agrémentée d’un packaging folklorique aux couleurs du communisme.
On connaît la suite et le succès de Tetris, dont le thème musical reprend le chant pré-révolutionnaire russe « Korobeïniki », qui accélère jusqu’à un rythme effréné à mesure que la partie avance. Après avoir délégué sa distribution en 1989 à Nintendo, Pajitnov a récupéré les droits de son œuvre en 1996 avec la création de The Tetris Company, s’assurant une retraite pour le moins confortable. Le troisième jeu le plus vendu de l’histoire est né de l’autre côté du rideau de fer.
Tandis que le Japon et les États-Unis se sont positionnés comme les acteurs majeurs de l’industrie, le bloc communiste n’est pas resté les bras croisés. Il a au contraire empilé les inventions révolutionnaires comme des blocs de Tetris.
Indiana Jones à Prague
Au début des années 1970, Moscou jette un œil intéressé sur les constructeurs mondiaux de flippers et leurs nouvelles bornes d’arcade. Après les avoir invités au salon Attraction-71, le pouvoir lance la production de ces machines en 1974. On les trouve dans les cinémas et parcs de loisirs russes, où les enfants viennent jouer à Morskoï Boï, un jeu de bataille navale, ou à Konek Gorbunok, l’adaptation d’un film d’animation soviétique sorti en 1947. Ces bornes n’étaient cependant pas monnaie courante partout en URSS et le jeu vidéo restait une denrée rare.
Plus à l’ouest, la situation n’est pas meilleure. En Tchécoslovaquie, État satellite de l’Union soviétique qui a donné naissance à la République tchèque et à la Slovaquie, le jeu vidéo a d’abord été un média très underground. « J’ai commencé à m’intéresser à la programmation au tout début des années 1980 », se souvient František Fuka, un des pionniers à Prague. « À cette époque, si vous vouliez jouer à des jeux vidéo sur votre ordinateur, vous deviez les programmer vous-même. » Dans les années 1980, Fuka est adolescent et tout jeune développeur. Il a gardé de cette époque une douce folie dans les yeux, encadrés par de petites lunettes rectangulaires.

František Fuka
Crédits : Ulyces
Quand il ne déambule pas dans les rues de la capitale tchèque avec ses deux petits chiens, le quadragénaire passe encore son temps à concevoir des jeux. Fuka a fait partie des premiers concepteurs de jeux vidéo tchèques, à une époque où les copies s’échangeaient sous le manteau. « Au début, je travaillais avec des calculatrices programmables et je programmais aussi sur le papier sans ordinateur. Tous les jeux de l’époque n’étaient distribués que de la main à la main. Mes amis et moi faisions une copie sur mon magnétophone et ils en faisaient une copie à leurs amis, etc. »
Sa vocation de développeur lui vient du cinéma. « J’allais voir pratiquement tous les films qui sortaient en Tchécoslovaquie, mais ce n’était pas des films hollywoodiens », précise-t-il. « Le fait que les films soient de purs divertissements n’était pas quelque chose que le régime communiste appréciait particulièrement. » Frustré par le filtrage culturel du régime communiste, František s’est ainsi mis à la programmation pour contrer cette propagande et créer ses propres divertissements.
D’abord rudimentaires, ses jeux se complexifient au fil du temps, et la réputation de développeur de Fuka commence à grandir dans son pays. « Avant d’avoir un ZX Spectrum, j’ai eu un ordinateur Victor et pendant deux ans je pense que j’ai dû faire 200 jeux dessus. Bien sûr, l’ordinateur était très limité : j’ai dû faire un simulateur de vol sans graphismes, il montrait juste les coordonnées sur la carte, la vitesse et l’altitude. » Il devient alors connu pour ses jeux textuels, dont trois jeux Indiana Jones, rare film « capitaliste » qu’il avait pu voir au cinéma et dont il a dû imaginer la suite, les opus suivants n’ayant pas été distribués dans les salles tchèques. À la manière d’un livre dont vous êtes le héros, le joueur doit prendre des décisions et résoudre des énigmes pour progresser dans le jeu, fait uniquement de texte.

Prague
Crédits : Ulyces
Avec la chute du rideau de fer en 1989, il devient plus facile de se procurer des ordinateurs ou des consoles de jeu légalement et toute une génération découvre alors les jeux japonais et américains. Pour rester dans la course, le bloc de l’Est sort en 1991 la console Alf, réponse communiste à la NES de Nintendo, produite dans une usine d’État Biélorusse. On peut alors y jouer à des styles de jeux classiques de l’époque, des jeux de plateforme ou de tir en 2D, des copies de jeux NES à succès comme Super Mario Bros ou Air Fortress. L’éclatement de l’URSS quelques mois plus tard a cependant raison de sa distribution et la console Alf est maintenant parmi les consoles de jeu les plus rares au monde.
Mais le poids de l’idéologie communiste sur les jeux vidéos n’a pas complètement disparu. Elle continue à se faire sentir à l’autre bout du globe.
Cuba libre
À Cuba, l’isolationnisme du régime légué par le bloc communiste, la pauvreté de la population et le retard technologique n’ont jamais laissé place à la création d’un jeu vidéo indépendant. Mais c’est en train de changer.
Josuhe Pagliery est sur le point de lancer le premier jeu vidéo indépendant de l’île. Le développeur en chef de Empty Head Games a transformé son appartement de La Havane en studio de développement. Son espace de travail, à lui et à son associé, David Darias, comprend en tout et pour tout deux ordinateurs. C’est là qu’ils ont inventé Saviorless, un jeu qui met en scène deux personnages qui doivent s’échapper d’une terre inhospitalière et inconnue dans un univers onirique et intriguant, à la direction artistique soignée.
Arborant un t-shirt aux couleurs de son jeu, il revient sur la frustration avec laquelle il a dû composer de n’avoir qu’un accès très limité à son hobby préféré. « Il y avait quelques jeux vidéo cubains dans des universités du pays, mais c’était des clones de jeux existants », raconte-t-il perché sur la terrasse ensoleillée de son appartement, depuis laquelle on aperçoit les toits de tuiles rouges et les palmiers mus par le vent. « On parle des années 1990, époque à laquelle il y avait une vraie barrière technologique, tout était illégal, y compris avoir un ordinateur personnel. Se créait une sorte de contact social entre les personnes qui avaient des jeux vidéo, on échangeait des CD, nos amis qui n’avaient pas de consoles venaient à la maison les weekends. »

Josuhe Pagliery et David Darias
Crédits : Ulyces
Avec le rapprochement entre Cuba et les États-Unis en 2016, à la suite de la visite d’Obama sur l’île, une ouverture a été esquissée. Des entrepreneurs américains se sont alors intéressés à la créativité des jeunes Cubains. C’est grâce à ces rencontres inédites que Josuhe Pagliery a trouvé des moyens pour développer son jeu. Saviorless, détaille cet homme par ailleurs artiste et réalisateur, « prend beaucoup d’éléments de la réalité de Cuba. Il y a quelque chose avec les couleurs, les ruines et le ton mélancolique en général, qui transpire le pays. Je crois que dans cette vision personnelle je reflète un peu l’environnement qui nous entoure ici. »
Le jeune homme est parti d’une feuille blanche. À Cuba, personne n’était capable de lui donner des références ou de lui expliquer comment procéder pour tel ou tel élément technique. Mais il a mis toute sa passion dans le projet et a fini par donner vie à son fantasme. L’action de Saviorless se déroule dans un monde apocalyptique. Orpheline d’un Grand Dieu devenu soudain mutique, cette réalité alternative tombe en ruine, en sorte que ses adeptes perdent la foi. Ils se rendent compte qu’ils vivent dans un jeu vidéo défaillant.
Obligée de retravailler le jeu en profondeur à mi-parcours pour des questions de copyright, l’équipe attend désormais un financement qui lui permettra de finaliser le développement d’ici un an ou deux. En attendant, elle a lancé une démo en novembre 2020.
Le Tamagotchi anticapitaliste
L’héritage de l’idéologie communiste ne laisse pas que des pesanteurs dans le monde du jeu vidéo. À Pittsburgh, en Pennsylvanie, un programmeur italien « de tradition post-marxiste italienne » propose une vision critique du capitalisme aux joueurs. Parti aux États-Unis pour y finir ses études, Paolo Pedercini a fondé le site Molleindustria puis la galerie Like Like, une sorte de Mecque du jeu vidéo artistique, politique et indépendant.
« Likelike s’est lancé il y a quelques années avec le but de remplir le vide que certains jeux, dont les miens, occupent : à mi-chemin entre l’art et le divertissement populaire », explique l’homme aux airs d’adolescent. Avec ses jeux souvent gratuits, Paolo s’attaque à des sujets aussi divers que la consommation de masse, l’exploitation et la disparition des ressources naturelles ou le fonctionnement des appareils de pouvoir.
Son McDonald’s Game est ainsi une parodie de jeu de gestion, un genre traditionnellement ancré dans le productivisme et le capitalisme décomplexé, dans lequel le joueur prend la tête de McDonald’s et doit faire prospérer la chaîne en optimisant au maximum tous ses aspects. « On y apprend qu’il y a de nombreuses manières d’arrondir les angles, de réduire les coûts. On découvre toutes ces stratégies, parfois immorales, qui peuvent comprendre la déforestation, la délocalisation de tribus indigènes, etc. » explique son créateur.

Paolo Pedercini
Crédits : Ulyces
Par la satire et l’exagération, Paolo cherche à faire prendre conscience à son joueur des dérives du géant du fast food et s’attaque à toute l’industrie agro-alimentaire de masse. « J’ai compris que le jeu vidéo pouvait mettre le joueur dans une position de pouvoir, de connaissance et je me suis dit que, grâce à cette vue globale et systémique que peut donner le jeu vidéo, il était possible d’expliquer le processus de mondialisation d’une façon intéressante. »
Son premier jeu, Every Day the Same Dream, développé à l’occasion d’un référendum abolissant certaines protections sociales des travailleurs, marquait déjà sa volonté de porter un message politique. Avec cette sorte de Tamagotchi revisité, le joueur doit s’occuper d’un ouvrier et contrôler quand il doit manger, dormir, travailler ou se divertir. Une façon de dénoncer la mainmise des employeurs sur certains travailleurs précaires. « Je ne pense pas que les jeux puissent changer les esprits », admet-il toutefois. « Je pense que les jeux deviennent une partie de ce que tu absorbes et même s’ils ne changent pas ta façon de penser ils peuvent renforcer des stéréotypes et induire ce qui est normal et possible. »
Si à Prague, František Fuka a un peu participé à ouvrir le pays grâce à ses jeux dans les années 1980 et 1990, Joshue Pagliery semble désormais emprunter cette voie à Cuba. « Faire un jeu vidéo indépendant est compliqué dans n’importe quelle partie du monde, indépendamment de l’endroit, mais on sent qu’on arrive à un produit pertinent pour notre pays et aussi personnellement. », s’enthousiasme le développeur de Saviorless. « Malgré tout le temps passé je crois que la qualité, l’amour, le détail que l’on a mis dans chaque petite chose du jeu est vraiment palpable pour n’importe quelle personne qui le voit et y joue. » Quelque part, c’est donc que les joueurs seront égaux.
Couverture : František Fuka/Ulyces
L’article Petite histoire du jeu vidéo dans le bloc communiste est apparu en premier sur Ulyces.
15.02.2021 à 09:06
Islande : comment les Vikings sont devenus le peuple le plus tolérant du monde
Nicolas Prouillac
Un soleil timide se lève sur la ferme d’Eystra Geldingaholt et ses pâturages à perte de vue. L’hiver approche à Skeiða, région rurale du sud de l’Islande, et des rayons dorés percent le couvercle gris du ciel, qui recouvre les plaines sauvages bordées de montagnes. Dans la grange en tôle éclairée au néon, Pálína Axelsdóttir […]
L’article Islande : comment les Vikings sont devenus le peuple le plus tolérant du monde est apparu en premier sur Ulyces.
Texte intégral (2841 mots)
Un soleil timide se lève sur la ferme d’Eystra Geldingaholt et ses pâturages à perte de vue. L’hiver approche à Skeiða, région rurale du sud de l’Islande, et des rayons dorés percent le couvercle gris du ciel, qui recouvre les plaines sauvages bordées de montagnes. Dans la grange en tôle éclairée au néon, Pálína Axelsdóttir Njarðvík transporte de grands ballots de foin qu’elle disperse pour nourrir plusieurs centaines de moutons islandais. Au milieu des champs couleur blé, la femme de 29 ans immortalise les jeunes brebis de son troupeau, pour poster leurs portraits sur son compte Instagram @farmlifeisland qu’elle a créé en 2015. Elle y raconte son quotidien au sein de la ferme familiale, dans une exploitation agricole isolée du monde aux paysages époustouflants.

Crédits : Ulyces
Ces scènes passionnent les 57 000 abonnés de Palina, dont la réputation dépasse les frontières de l’île. Le tableau est idyllique. Mais le 31 août 2020, la jeune femme poste une photo d’elle embrassant sa compagne, Maria, à l’occasion du deuxième anniversaire de leur relation, révélant incidemment son homosexualité. Aussitôt, son nombre d’abonnés chute, signe que le cliché ne plaît pas à tout le monde. Elle fait pour la première fois face à l’homophobie « Je n’ai jamais rencontré quelqu’un d’homophobe – pas en Islande en tout cas », explique-t-elle stupéfaite.
Il faut dire que ce pays de 350 000 habitants peut facilement apparaître comme un modèle de tolérance. Chaque année, près d’un tiers de la population participe à la Gay Pride. L’événement a même lieu deux fois par an à Reykjavik – en hiver et en été. Il attire des gens du monde entier, avec près de 100 000 participants tous les ans. Quelques étrangers découvrent alors une des sociétés les moins patriarcales de la planète. Rares sont cependant ceux à saisir les origines de cette exception culturelle et le long processus qui, depuis les vikings, a fait de l’Islande le pays inclusif que l’on connaît aujourd’hui.
Les dissidents
Les Vikings posent le pied en Islande pour la première fois vers 861. Selon le Landnámabók, manuscrit détaillant la colonisation de l’île par les Scandinaves, c’est le navigateur Naddoddr et son équipage, alors perdus en mer, qui découvrent cette terre inhospitalière et déserte. Il n’y a là que quelques moines chrétiens irlandais qui ont choisi la réclusion. Une autre version proposée par le Landnámabók présente le Suédois Garðar Svavarsson, premier viking à avoir vécu en Islande et à avoir remarqué qu’il s’agissait d’une île après en avoir fait le tour complet. Il a cependant un précurseur.
Le premier viking à avoir sciemment navigué en direction de l’Islande serait Flóki Vilgerðarson, dit « Floki aux corbeaux ». Accompagné par deux marins, Floki aurait été guidé par un de ses corbeaux et, contemplant l’île du haut d’un fjord enneigé, aurait lui-même baptisé l’île « Iceland », la terre de glace. Il y passe deux rudes hivers en raison du climat hostile et du manque de ressources, et ouvre la voie à une colonisation.
Au fil des années et des arrivées, l’Islande se développe et devient une terre de liberté pour les Vikings. Du vieil islandais víkingr qui se traduit par « pirate », ce mot désigne les guerriers, pillards et commerçants qui fuient la Norvège pendant le règne de son premier souverain, Harald Ier, ou « Harald belle chevelure ». Il monte sur le trône en 872 après une série de conquêtes sur ses voisins, et certains Vikings auraient pris la mer pour éviter de payer des taxes sur leurs terres. Ce point de vue historique est aujourd’hui contesté, et certains archéologues affirment que les premiers explorateurs vikings avaient déjà posé le pied en Islande avant le règne d’Harald Ier.
Dans les années qui suivent, l’Islande devient une terre de dissidents, de ceux qui n’acceptent pas l’autorité du roi. Le pays continue de prospérer et demeure, du fait de son isolement et du peu d’influences extérieures, proche du mode de vie viking, là où les Scandinaves de Norvège, du Danemark et de Suède évoluent peu à peu avec l’expansion du catholicisme. Leur langue se transforme aussi, tandis que l’Islandais demeure proche dans ses racines du vieux Norrois, première langue scandinave médiévale.
Les guerrières
Si certains clichés sur des Vikings violents et bas du front, incarnations d’une masculinité exacerbée, sont fondés, la société Viking était toutefois riche culturellement et parfois moins polarisée en termes de déterminisme de genre qu’on peut l’imaginer. Les femmes jouissaient de droits sociaux rares dans l’Europe médiévale, comme la possibilité de posséder des terres et de demander le divorce, exigeant alors le remboursement complet de leur dot. Le contrat de mariage prévoyait d’ailleurs généralement un partage des biens en cas de rupture.
Selon le chercheur en archéologie Sami Raninen, auteur de l’article « Des Vikings Queer ? Transgression du genre et relations homosexuelles entre la fin de l’âge de fer et le début de la Scandinavie médiévale », il n’était pas rare de voir des femmes occuper des positions dominantes. Même si le pouvoir était traditionnellement détenu par les hommes et que le terme « viking » leur était réservé, elles pouvaient occuper le rôle d’un « fils de substitution », au moins temporairement, en l’absence d’héritier capable ou satisfaisant pour la famille.
Le concept d’honneur et la capacité à se faire respecter étaient probablement plus importants encore que la frontière du genre. Ainsi, lors des expéditions ou des guerres, les femmes pouvaient prendre les armes et être admirées pour cela, dans la plus pure tradition des Skjaldmö, ces « guerrières au bouclier » mythologiques. Certaines fouilles archéologiques ont en effet révélé des tombes de femmes enterrées avec leurs armes, et l’historien byzantin Johannes Skylitzes fait mention de nombreuses femmes combattant avec les Vikings Varègues de Suède contre les Bulgares en 971. Plus tard, c’est l’historien Danois du XIIe siècle Saxo Grammaticus qui fait référence aux « guerrières au bouclier » qui s’habillaient comme des hommes et se consacraient à l’apprentissage du maniement de l’épée et d’autres techniques de guerre. Selon lui, quelque 300 de ces guerrières auraient vaillamment combattu lors de la légendaire bataille de Brávellir au milieu du VIIIe siècle.

Crédits : Ulyces
Certaines femmes ont même atteint un statut privilégié dans le regard de leurs homologues masculins. Aude la Très Sage, parmi les plus importantes figures de la colonisation Islandaise, en fait partie. Mariée à Olaf le Blanc qui devient roi de Dublin, ville fondée par les Vikings au IXe siècle, Aude perd son mari lors d’une bataille puis des années plus tard son seul fils, trahi par son peuple. Ne pouvant prétendre à la couronne de Dublin, Aude ordonne la construction d’un bateau Viking et perpétue les pillages autour des îles britanniques avec son équipage, constitué d’une vingtaine d’hommes et de plusieurs prisonniers.
Adulée et respectée par ses hommes pour son tempérament d’acier, elle acquiert rapidement une renommée grandissante et décide de faire voile vers l’Islande. Arrivée en terre promise, Aude revendique Dalasýsla dans l’ouest de l’île, fait de ses prisonniers des hommes libres et accorde à ses membres d’équipage des terres sur lesquelles vivre et cultiver. Elle contribuera grandement au peuplement de l’Islande, où elle restera jusqu’à sa mort.
Laborieuse fierté
Les relations homosexuelles, en revanche, étaient moins bien tolérées dans une société traditionnelle qui glorifiait la virilité et la dureté. Bien que rarement mentionné dans les textes historiques, le concept d’Ergi désignait un homme qui adoptait des caractéristiques associées à la féminité, ce qui pouvait inclure des rapports sexuels avec d’autres hommes et s’associait hélas à une image d’impuissance, de lâcheté. Alors que la pénétration d’un autre homme pouvait parfois être vue comme un moyen de dominer un ennemi vaincu, l’acte passif était plutôt considéré comme un déshonneur pour sa virilité. Le concept a donné naissance à l’insulte Ragr, et celui qui en était accusé pouvait défier son détracteur jusqu’à la mort pour apporter la preuve de sa masculinité. Afin d’éviter les représailles sanglantes dans une société qui plaçait au centre l’honneur de l’homme, le code de loi Islandais, Grágás interdisait cette insulte au XIIIe siècle, sous peine d’un bannissement temporaire de la société.
L’Islande fait d’ailleurs preuve d’un rare progressisme en matière politique. Dès 930 ses « hommes libres » fondent l’Althing, le plus vieux parlement d’Europe. Ils donnent ainsi naissance à une République qui finit par se fondre dans la couronne de Norvège en 1262, avant de passer sous la domination du royaume de Danemark. Les pratiques homosexuelles ne sont ni mentionnées ni interdites, mais les sagas médiévales islandaises arrivées jusqu’aux historiens montrent donc qu’elles étaient généralement perçues de manière très négative. Entre cette époque et celle d’aujourd’hui, l’histoire de la communauté LGBTQ+ en Islande reste difficile à documenter. Quelques historiens et activistes comme Þorvaldur Kristinsson, auteur islandais et ancien président de la Gay pride de Reykjavík, ont tenté de retracer cet héritage, dont il reste peu de traces écrites.
Dans les siècles qui ont suivi l’arrivée des vikings, l’île a été affectée par l’expansion du christianisme au Xe siècle, puis du protestantisme au XVIe siècle sous l’influence du Danemark. Cette époque est marquée par de grandes épidémies, famines et catastrophes naturelles, qui ralentissent le développement économique et social de l’Islande avant son indépendance du Danemark en 1918. Il faut encore attendre quelques années avant qu’un mouvement s’amorce, et gays et lesbiennes demeurent dans l’ombre, invisibles jusqu’aux années 1950, dans une société marquée par le silence et la peur du rejet.
La deuxième moitié du XXe fait figure de renaissance pour le pays, et amorce une période marquée par une grande progression des droits des LGBTQ+ en Islande. En 1975, le musicien et acteur Hörður Torfason est le premier homme à faire son coming-out, une annonce qui conduira à la perte de son emploi puis de sa maison. Son combat permet toutefois à l’organisation nationale queer islandaise Samtökin 78 de voir le jour dans la foulée en 1978. Ses actions aboutiront à l’autorisation de l’union entre personnes du même sexe en 1996, suivi de la première Gay pride en 1999. L’activisme de la communauté gay et le coming-out de personnalités comme Torfason ont permis, en l’espace de trente ans, de faire de l’île de 300 000 habitants un espace progressiste et inclusif. Seules de rares oppositions de la part de congrégations fondamentalistes chrétiennes subsistent aujourd’hui.
Simple idylle
Maria et Palina ont d’abord été amies. Puis la première a commencé à venir de plus en plus souvent à la ferme d’Eystra Geldingaholt. Les deux jeunes femmes aux longs cheveux blonds, qui se sont rencontrées en 2017 lors d’un camp d’été chrétien, sont tombées amoureuses au cours d’un voyage. En deux ans de relation, elles n’ont jamais eu à subir l’homophobie, et leur relation s’est construite sans difficulté ni crainte du regard des autres. « Je pense que l’Islande est un pays formidable en termes d’égalité de toute sorte. Nous sommes peut-être le meilleur pays au monde ! », se réjouit Palina.

Palina et Maria
Crédits : Ulyces
Premier État à accueillir une cheffe du gouvernement ouvertement lesbienne en 2009 avec la Première ministre Jóhanna Sigurðardóttir, en fonction jusqu’en 2013, l’Islande autorise aussi l’adoption et la procréation médicalement assistée pour les couples homosexuels depuis 2006, et le mariage depuis 2010. Le pays possède d’ailleurs un arsenal très complet de lois pour condamner les propos homophobes, la discrimination dans le monde du travail, et toute forme de discrimination basée sur l’orientation sexuelle ou l’identité de genre. Un véritable havre de paix, à une époque où la communauté LGBT+ reste ostracisée dans de nombreux pays du monde, ce qui explique en partie le fait que l’Islande figure tous les ans dans le top 5 des pays les plus heureux du monde.
Cette célébration de la liberté culmine lors de la Reykjavik Pride, un événement qui dure plusieurs jours et qui constitue une des attractions principales du pays, avec des spectacles et des ateliers en plus de la parade. En 2010, l’ancien maire de Reykjavik, Jon Gnarr, s’est fait remarquer en y défilant habillé en drag queen. En 2016, c’est lors de la Gay Pride que le nouveau président Guðni Th. Jóhannesson, élu depuis seulement quelques jours, prononce un discours historique en revendiquant la tolérance. Pour la première fois dans l’histoire mondiale, un président participe officiellement à une marche des fiertés LGBTQ+.
C’est la raison pour laquelle les deux jeunes femmes ont été tant surprises par la haine qui a suivi la révélation de leur histoire d’amour sur les réseaux sociaux. « J’ai posté une photo à l’occasion de notre anniversaire, à moi et Maria. Et puis j’ai vu le nombre d’abonnés baisser. Il a baissé exactement le jour où j’ai mis la photo en ligne. » Pour le couple, le concept même de coming-out semble dépassé : « Je n’en ai parlé à personne parce qu’on sortait juste ensemble, mes parents le savaient. Et puis la nouvelle s’est répandue. Je n’ai pas fait le tour du quartier pour l’annoncer. Pourquoi aurais-je fait ça ? » se remémore Palina interloquée.

Crédits : Ulyces
Mais loin d’avoir atteint le jeune couple, les insultes n’ont pas eu raison de la popularité et du bonheur de Palina, qui est toujours suivie par environ 57 000 abonnés sur Instagram. Maria y a même vu une opportunité : « J’étais heureuse qu’elle perde tous ces gens qui ne veulent pas la suivre : nous ne voulons pas que des gens qui nous désapprouvent la suivent, alors ça m’a semblé normal », raconte-t-elle avec un sourire. Le couple envisage maintenant d’emménager dans un même appartement à Reykjavik. Devant la grange balayée par les vents, les deux jeunes femmes échangent un regard complice. « Palina et moi, on va vivre ensemble, c’est sûr. Très probablement à Reykjavik mais on n’en est pas sûres. Avec un peu de chance, nous aurons une famille. Et nous serons heureuses et peut-être mariées. »
Couverture : La ferme de Palina et Maria/Ulyces
L’article Islande : comment les Vikings sont devenus le peuple le plus tolérant du monde est apparu en premier sur Ulyces.
13.02.2021 à 10:24
L’écologie peut-elle résoudre le problème du chômage ?
Nicolas Prouillac
Assise à son bureau, Christine Vidal, 60 ans, semble avoir trouvé sa place au milieu des dossiers. Cela fait maintenant trois ans qu’elle travaille chez Actypôles pour « Bébés Lutins », une société qui produit et commercialise des couches lavables en coton Made in France. Un emploi à temps plein qui lui convient parfaitement, dans […]
L’article L’écologie peut-elle résoudre le problème du chômage ? est apparu en premier sur Ulyces.
Texte intégral (2599 mots)
Assise à son bureau, Christine Vidal, 60 ans, semble avoir trouvé sa place au milieu des dossiers. Cela fait maintenant trois ans qu’elle travaille chez Actypôles pour « Bébés Lutins », une société qui produit et commercialise des couches lavables en coton Made in France. Un emploi à temps plein qui lui convient parfaitement, dans une entreprise qui agit pour réduire l’utilisation du plastique. « Je suis tranquille désormais », confie-t-elle.
Si la sexagénaire ne s’inquiète pas pour son avenir professionnel, il n’en a pas toujours été de même. Après un divorce, Christine est rentrée dans sa région natale pour s’installer à Thiers. « Je suis revenue seule avec un bébé, je ne pouvais accepter que des temps partiels, les options n’étaient pas très nombreuses », se souvient-elle. Il faut dire que la sous-préfecture connaît une véritable crise de l’emploi. Thiers, historiquement connue pour son industrie coutelière, a souffert de la mondialisation. Dans certains quartiers, le taux de chômage a grimpé en flèche, touchant 25 % de la population.

La ville de Thiers
La ville a donc intégré le programme expérimental « Territoire zéro chômeur longue durée », lancé en 2016. Concrètement, l’expérimentation propose de fournir un travail aux personnes privées d’emploi depuis plus d’un an. Pour atteindre cet objectif, le programme prévoit de créer des emplois en finançant des activités utiles, sans faire concurrence aux entreprises existantes. C’est par ce biais que Christine a obtenu son CDI en 2017. « La démarche n’est pas basée sur notre CV mais sur nos savoir-faire », explique-t-elle.
Et quoi de plus utile que de bâtir des solutions face à l’urgence climatique. En effet, de nombreuses filières durables et locales restent à développer. C’est à partir de ce constat que deux laboratoires d’idées, Hémisphère gauche et l’Institut Rousseau, ont lancé l’initiative « Un emploi vert pour tous ». Leurs objectifs : éliminer le chômage et mener une transformation écologique de la société.
Mise au vert
À 29 ans, Chloé Ridel a de nombreux combats. La jeune énarque, passée par la Commission européenne et le ministère de l’Économie et des finances, a changé de cap, poussée par une volonté de changement, pour cofonder le collectif « Mieux Voter », qui propose d’améliorer l’élection démocratique par l’adoption du scrutin par « Jugement majoritaire ». Elle est aujourd’hui directrice adjointe de l’Institut Rousseau. « Ce qu’on veut, c’est ouvrir des débouchés concrets et remettre du mouvement dans le débat », explique la gardoise.
Le laboratoire d’idées est né il y a un an avec l’objectif de travailler à une « reconstruction écologique, sociale et républicaine ». S’inspirant de l’expérimentation « Territoire zéro chômeur », la structure a proposé l’instauration d’une garantie à l’emploi vert. « On est dans un contexte où il faut penser des solutions radicalement nouvelles, essayer de nouvelles choses », affirme Chloé. Comme rediriger les dépenses de l’État pour la lutte contre le chômage dans la création de solutions écologiques, tout en générant de l’emploi.

Un emploi vert pour tous
Crédits : Shane Rounce
Le coût de cette politique serait même inférieur aux solutions actuelles. En effet, les dépenses publiques en faveur du marché du travail sont énormes. La privation durable d’emploi coûtait 36 milliards d’euros à l’État en 2015, d’après une étude d’ATD Quart Monde. L’INSEE évalue même l’ensemble des dépenses publiques en faveur des politiques du marché du travail à 66 milliards d’euros en 2017. De son côté, le programme « Territoire zéro chômeur » a montré la possibilité de créer un emploi pour 20 000 euros par an. Pour bénéficier aux 2,8 millions de chômeurs longue durée, le coût de cette solution serait donc de 56 milliards d’euros.
« Dès maintenant on peut pérenniser l’expérimentation “Territoire zéro chômeur de longue durée”, c’est-à-dire l’étendre à la France entière », soutient la directrice adjointe de l’Institut Rousseau. Les résultats du programme donnent en effet des raisons d’être enthousiaste. « Au bout de trois ans, on a atteint l’objectif de zéro chômeur longue durée dans 30 % des territoires. » Mais le projet est entré dans sa seconde phase en décembre dernier. Pour les cinq ans à venir, il ne couvrira que 60 territoires à travers toute la France. C’est pour accélérer ce processus que la pétition « Un emploi vert pour tous » a été lancée. Les initiateurs espèrent transformer la proposition en projet de loi débattue à l’Assemblée nationale.
Mais ce n’est pas la seule proposition de la garantie à l’emploi vert. En plus de financer les Entreprises à but d’emploi (EBE), l’initiative vise aussi à développer d’autres filières d’emplois verts. Elle propose le financement d’emplois dans des entreprises qui vont vers une décarbonation de leur activité, ainsi que dans les associations et les activités publiques, sur le modèle des contrats aidés. Des idées qui, si elles n’ont jamais été appliquées à cette échelle en France, ne sont pourtant pas nouvelles.
L’écologie contre le chômage
« Penser global, agir local. » Cette formule, employée pour la première fois par René Dubos lors du premier sommet sur l’environnement en 1972, est une pierre angulaire des mouvements écologistes. On retrouve ce slogan lors du colloque international « L’Écologie contre le chômage », organisé par les Amis de la Terre en avril 1983, à Paris. Dès cette époque, Alain de Romefort, chef de mission à la promotion de l’emploi, exprimait le besoin d’adapter localement les emplois pour répondre aux besoins spécifiques du territoire. « Des activités favorables à l’environnement sont souhaitables et demandent des emplois moins classiques », peut-on lire dans le rapport du colloque.
En portant un regard neuf sur le problème de l’emploi et en prenant en compte les considérations environnementales, il y a près de quatre décennies, les quarante conférenciers ont théorisé plusieurs solutions, qui semblent sorties des programmes politiques écologistes contemporains. Par exemple, ils préconisent « de petites unités de production, relativement autonomes et bien moins fragiles que les grosses industries », en affirmant que « des centaines de milliers d’emplois de ce type sont souhaitables et probablement rentables dans un contexte fiscal et législatif approprié ». Il semblait donc déjà possible de créer des emplois répondant à des problèmes environnementaux ou sociétaux, sans faire grimper la facture de l’État.

Chloé Ridel
Le principe de garantie à l’emploi a, pour sa part, été théorisé par l’économiste américain Hyman Minsky dès 1973. Son principe central est celui de l’État comme « employeur en dernier ressort », c’est-à-dire que l’État (ou les collectivités locales) s’engage à fournir un emploi utile à la société à tous ceux qui sont prêts à travailler au SMIC. Pour financer cette mesure, il proposait des impôts fortement redistributifs et comptait sur les économies réalisées sur les prestations chômage.
Malgré cela, les politiques françaises pour l’emploi ne sont jamais parvenues à mettre fin au chômage de masse. « Depuis 40 ans, les chômeurs de longue durée forment une masse d’entre un et deux millions de personnes exclues de la société », dénonce Chloé Ridel. Ce n’est pourtant pas le manque d’activité qui pose problème. « Le chômage n’est jamais lié à une pénurie de travail, qui existe en quantité inépuisable, mais à un manque d’emplois », affirme l’initiative « Un emploi vert pour tous ». D’après sa porte-parole, c’est plutôt sur le manque d’efficacité des politiques de lutte contre le chômage qu’il faut se pencher.
Dernièrement, la mesure phare du gouvernement était le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE). Lancé en 2013, son objectif était de favoriser la recherche, l’innovation et le recrutement, grâce à une baisse du coût du travail financée par l’État. Mais la démarche s’est avérée extrêmement coûteuse pour des résultats mitigés. 100 000 nouveaux postes pour un coût unitaire de 280 000 euros : « C’est un somme considérable », s’étonne la militante écologiste. C’est même un véritable « gâchis d’argent public », selon les économistes Aurore Lalucq, Dany Lang et Pavlina Tcherneva.
La solution d’une garantie à l’emploi semble donc bien plus rentable et plus efficace. La clé du dispositif est sa gouvernance, originale et anti-bureaucratique. Elle repose sur des comités locaux de l’emploi, qui associent l’ensemble des acteurs d’un territoire : les personnes privées durablement d’emploi, les collectivités locales, Pôle emploi, les citoyens, les associations, les élus et les entreprises. Le rôle de ces comités locaux est d’identifier, à l’échelle du territoire, les activités utiles et éligibles à la garantie à l’emploi et d’assurer le placement des chômeurs. Ils offrent donc une réponse locale, adaptée aux besoins de la communauté. Et cela fonctionne plutôt bien.
Zéro chômeur, zéro carbone
Après cinq ans d’expérimentation, « Territoire zéro chômeur » est parvenue à éradiquer le chômage de longue durée dans 30 % des zones couvertes. Un exploit réalisé pour la somme de 20 000 euros par an et par emploi, soit 14 fois moins qu’avec le CICE. « C’est une équation complètement différente, et je pense que c’est l’avenir de l’emploi », souligne Chloé Ridel. Et elle n’est pas la seule à être de cet avis.
En effet, la garantie à l’emploi vert a convaincu plusieurs pays d’entamer une réflexion sur leur modèle actuel. La prestigieuse université d’Oxford s’est saisie de l’idée, en novembre 2020, pour lancer une expérimentation de trois ans sur 150 emplois, dans la ville autrichienne de Marienthal. Une récente étude belge, estimant le coût public annuel net d’un tel dispositif au niveau national, a elle aussi publié des résultats encourageants : « En fonction des scénarios de recrutement établis, l’étude conclut ainsi à un gain net moyen pour les finances publiques belges de 2 233 €/an [par personne dans le programme]. » La solution paraît donc viable.
Et la crise actuelle, causée par la pandémie de Covid-19, ne fait qu’ajouter du poids à cet argumentaire. En effet, selon une étude de l’Organisme International du Travail (OIT), le coronavirus a entraîné la perte de l’équivalent de 255 millions d’emplois en 2020 dans le monde. De plus, les jeunes travailleurs ont été particulièrement impactés, soit en perdant leur emploi, soit en quittant la vie active ou encore en retardant leur entrée sur le marché du travail. Ces pertes d’emplois s’élevaient à 8,7 % chez les jeunes (âgés de 15 à 24 ans), par rapport à 3,7 % au-delà de 24 ans. « Cela met en évidence le risque plus que jamais réel d’une génération perdue », fait remarquer l’Observatoire de l’OIT.
« On est en plus dans un contexte de “quoi qu’il en coûte” »
Le moment semble donc opportun pour lancer la rénovation générale du système de l’emploi. « Ça tombe bien, vu qu’on est en pleine crise et que le chômage ne cesse d’augmenter », assène Chloé Ridel. D’autant plus qu’un projet de loi Climat et résilience, porté par Barbara Pompili, a été présenté en Conseil des ministres le mercredi 10 février. Issu des travaux de la Convention citoyenne pour le climat, il regroupe les propositions censées permettre à la France d’opérer une transition écologique et de respecter ses engagements environnementaux. La garantie à l’emploi vert pourrait d’ailleurs venir s’ajouter à la liste des solutions si les élus s’en saisissent. C’est pour cela que l’initiative Un emploi pour tous a lancé une pétition, ainsi qu’un appel à témoignage.
« On est en plus dans un contexte de “quoi qu’il en coûte” », insiste Chloé Ridel, expliquant qu’il est important de ne pas perdre de temps à retrouver le niveau d’emploi d’avant crise. « Ce serait tragique, alors même qu’on est dans la décennie critique pour la lutte face à l’urgence climatique », conclut la militante écologiste. Le projet de loi, composé de 69 articles, doit être examiné par l’Assemblée nationale en commission spéciale début mars, puis en séance publique à partir du 29 mars 2021. Il faudra donc attendre encore quelques mois pour savoir précisément les mesures que prendront les élus. Une décision qui pourrait bouleverser, en bien, le quotidien de millions de Français.
Couverture : Nareeta Martin
L’article L’écologie peut-elle résoudre le problème du chômage ? est apparu en premier sur Ulyces.
- GÉNÉRALISTES
- Ballast
- Fakir
- Interstices
- Lava
- La revue des médias
- Le Grand Continent
- Le Diplo
- Le Nouvel Obs
- Lundi Matin
- Mouais
- Multitudes
- Politis
- Regards
- Smolny
- Socialter
- The Conversation
- UPMagazine
- Usbek & Rica
- Le Zéphyr
- Idées ‧ Politique ‧ A à F
- Accattone
- Contretemps
- A Contretemps
- Alter-éditions
- CQFD
- Comptoir (Le)
- Déferlante (La)
- Esprit
- Frustration
- Idées ‧ Politique ‧ i à z
- L'Intimiste
- Jef Klak
- Lignes de Crêtes
- NonFiction
- Nouveaux Cahiers du Socialisme
- Période
- Philo Mag
- Terrestres
- Vie des Idées
- ARTS
- Villa Albertine
- THINK-TANKS
- Fondation Copernic
- Institut La Boétie
- Institut Rousseau
- TECH
- Dans les algorithmes
- Framablog
- Goodtech.info
- Quadrature du Net
- INTERNATIONAL
- Alencontre
- Alterinfos
- CETRI
- ESSF
- Inprecor
- Journal des Alternatives
- Guitinews
- MULTILINGUES
- Kedistan
- Quatrième Internationale
- Viewpoint Magazine
- +972 mag
- PODCASTS
- Arrêt sur Images
- Le Diplo
- LSD
- Thinkerview
- Fiabilité 3/5
- Slate
- Ulyces
- Fiabilité 1/5
- Contre-Attaque
- Issues
- Korii
- Positivr
- Regain