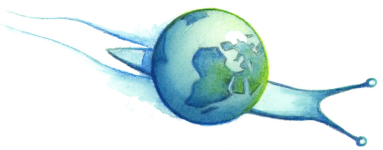la Maison commune de la décroissance
Fleur Bertrand-Montembault
Texte intégral (1374 mots)
Depuis 2023, la MCD se rend chaque année à la Conférence internationale de la décroissance (International Degrowth Conference), organisée tous les étés dans une ville différente en Europe. En 2023, je m’étais rendue une semaine à Zagreb (en lire un retour ici), en 2024, j’avais fait un passage éclair à Pontevedra pour assister, comme tous les ans, à la rencontre de l’International Degrowth Network qui précède la Conférence, et en 2025, j’ai passé une semaine à Oslo pour participer conjointement aux deux événements, dont la programmation complète peut être retrouvée ici.
Si je n’avais qu’une chose à retenir de cette édition 2025, je choisirais sans hésiter, alors que je n’en attendais rien de particulier, le discours d’Erik Gómez-Baggethun, président de l’ISEE (the International Society for Ecological Economics, partenaire de la conférence cette année) à la cérémonie d’ouverture.

Pour regarder cette vidéo (en anglais), cliquez sur le lien contenu dans l’image ci-dessous et avancez jusqu’à 15:55.
Pourquoi retenir ce discours d’introduction en particulier ? Parce qu’il tente courageusement de politiser la décroissance (pour quelqu’un qui vient de l’économie écologique, c’est assez surprenant). Comment ?
1- En apprenant du succès de nos adversaires politiques
Politiser la décroissance, c’est reconnaître l’importance de travail idéologique qui doit être fourni en amont de toute constitution d’un mouvement politique d’envergure. M. Gómez-Baggethun ne le rappelle que trop bien : pour l’ordre néolibéral cela a pris plusieurs décennies, en travaillant dans l’ombre de la théorie économique keynésienne, hégémonique lors de l’après-guerre en Europe. Mais ces années de travail théorique, construit « brique après brique », ont permis de fournir un « corpus idéologique cohérent » (et c’est exactement l’objet de la MCD) reposant sur des revendications claires et identifiables, en particulier la promotion de l’individualisme et la mise en avant d’une institution « unique » : le marché. Tout ça au nom d’une valeur supérieure : la liberté (promue dans sa compréhension libérale et individualiste). C’est ce qu’il faut comprendre lorsque l’on parle d’instauration de « narratif » et de « récit » : c’est une vision du monde qui s’impose, qu’elle traite de la nature de l’homme, de la société, des relations entre ses membres et avec « l’extérieur », et des institutions qui sont chargées d’organiser ces relations.
2 – En construisant des alliances politiques
Après la construction d’une « vision alternative qui adresse les problèmes et les anxiétés du présent et crée un espoir », Erik Gómez-Baggethun considère que la deuxième étape de politisation du mouvement serait la constitution d’une « alliance assez large de forces politiques pour l’imposer » (il utilise le terme anglais « enforce »). Si, politiquement, cela reste un propos assez courant, ce qui est intéressant dans son approche , c’est qu’il soulève que pour ça, la décroissance doit être autocritique (et c’est déjà une position défendue depuis longtemps par la MCD et Michel Lepesant, voire à ce sujet l’article sur « La démocratie des minoritaires« ). Il nous adresse plusieurs questions que nous avons tendance à poser de manière rhétorique, alors qu’il faudrait vraiment que nos travaux s’y confrontent : la décroissance est-elle réellement désirable ? « Sommes-nous assez honnêtes quand nous défendons une décroissance heureuse »? Et surtout, à qui parlons-nous ? « Sommes-nous capables de parler au commun et à la société dans son ensemble ? » Comment ne pas se laisser emprisonner dans ce qu’il nomme les « lifestyle effects », c’est-à-dire la réduction qui consiste à assimiler les décroissants à une élite urbaine intellectuelle ? Pour cela, il ne faut pas en adopter les narratifs et en particulier celui qui consiste à affirmer que le changement passera par une meilleur « éducation » des gens : en réalité c’est d’eux (« people at large ») que nous devons apprendre. Renversement qui suppose de porter un projet politique d’égalité.
3- En faisant de l’égalité la valeur phare de notre projet politique
Erik Gómez-Baggethun, vers la fin de son discours souligne que la notion d’égalité « est tombée en disgrâce » en politique au profit de la notion de liberté (sous sa forme libérale-individualiste) et que l’existence d’inégalités a été naturalisée : elles apparaissent désormais comme un phénomène normal et acceptable. Cette acceptation généralisée des inégalités est soutenue par une vision méritocratique de l’égalité : celle qui consiste à dire que si politique d’égalité il y a, elle doit favoriser uniquement « l’égalité des chances », c’est à dire la possibilité pour tous.tes de se trouver sur « la ligne de départ » de la course. L’égalité des chances, c’est clamer que tout le doit monde doit avoir la même chance de participer à la grande compétition qu’est la vie en société. Cela produit ce qu’il appelle « une société divisée de gagnants arrogants et de perdants humiliés » (parce que si la distribution des places est présentée comme une question de mérite et de réussite individuelle, chacun peut se vanter d’avoir mieux réussi que les autres ou à l’inverse se sentir responsable de ses échecs).
Au contraire, en tant que décroissant-es, nous devons porter un discours d’égalité qui vise la possibilité que chacun-e soit en même temps au, ou en tout cas, au même, point d’arrivée à la fin de la course. Ce qui implique d’organiser la vie de la société sur la base de la « la solidarité, la coopération, des hiérarchies minimales… » et nous ajouterons, de faire passer la préservation de la vie en commun avant la liberté individuelle. C’est pourquoi les décroissant-es, pour faire de la décroissance des inégalités la première des décroissances doivent avoir pour objectif de conserver la vie sociale. À la MCD, nous défendons un projet politique d’égalité radicale, passant notamment par l’instauration d’un revenu inconditionnel (mesure plancher) et d’un revenu maximal (mesure plafond).
Pour conclure, il faut retenir de ce discours que la révolution que nous appelons de nos vœux, car la décroissance est bel et bien un projet révolutionnaire et radical comme Erik Gómez-Baggethun l’affirme, se doit d’être préparée : c’est uniquement en se préparant politiquement que le mouvement décroissant gagnera en maturité et sera alors à même de saisir la prochaine fenêtre d’opportunité politique qui s’offrira à lui…
Rédaction
Texte intégral (927 mots)
Encore une fois, retour sur nos (f)estives de cet été parce que le recul permet, nous l’espérons, de dégager 2 pistes décisives pour une décroissance radicale, histoire de commencer à controverser, sans polémique, avec la décroissance mainstream.
1. La première piste est l’autocritique de la décroissance proposée par Onofrio Romano : là où la décroissance mainstream en est à plaider que la rupture avec « la croissance et son monde » doit passer par une « forme » horizontaliste, Onofrio montre que cette forme reste « conforme » au Régime de croissance.
A la MCD, nous en déduisons qu’il ne pourra y avoir de rupture politique avec la croissance qu’à condition de rompre aussi avec les facilités de l’horizontalisme. Et cela pour une raison qui devrait interroger tous les décroissants : si, au nom d’une injonction horizontaliste, on en reste à toujours se féliciter de la « richesse de l’hétérogénéité » des « mouvements » décroissants, c’est comme si on réduisait un arbre à ses branches tout en négligeant et le tronc et les racines. Mais si les branches symbolisent la diversité et la variété, le tronc symbolise le commun et les racines symbolisent les conditions de possibilité de ce commun.
C’est pourquoi la MCD se donne pour objectif une définition commune de la décroissance et pour mission de réfléchir à ses conditions politiques de possibilités.
2. La deuxième piste porte justement sur ce qu’il faut entendre par « commun » et, pendant les (f)estives, elle a été abordée lors de nos débats sur la propriété ; en particulier à propos d’une différence entre propriété commune et propriété publique, ce qui a mis en avant une distinction entre « bien commun » et « intérêt général », et en arrière-plan la question de l’État, celle de sa nécessaire et radicale critique mais aussi celle du type de structure en capacité d’organiser la coordination politique des entités participant à la vie sociale (sauf à croire, comme les libéraux, à la formation spontanée du commun).
Où est passé le bien commun ? se demandait le philosophe François Flahault (2011, 1001 nuits) quand il faisait remarquer :
- « La notion de croissance économique… supplée vaguement à une conception du bien commun qui nous fait défaut, sans même pouvoir prétendre en occuper légitimement la place » (p.12).
- « Dans le meilleur des cas, la notion de bien commun (ou celle de bien public) se voit-elle remplacer par celle d’intérêt général, qui est l’addition et la composition des intérêts individuels » (p.14).
- « Comprendre comment l’existence de chaque personne dépend de ce bien premier qu’est la coexistence » (p.24).
Que de sujets de discussion pour une décroissance qui voudrait s’occuper des racines, consolider un tronc commun et ensuite se féliciter des branches.
Pour les années à venir, ce devrait être l’occasion pour la MCD de passer à son étape suivante : après les tâtonnements de sa mise en place, la consolidation et de son objectif et de sa mission.
Sans attendre, voici déjà de quoi réfléchir à une distinction claire entre « bien commun » et « intérêt général » (ce qui renvoie à notre critique unanime, lors de ces (f)estives, de l’individualisme, fût-il anarchiste) :
- Le « bien commun » (et on peut penser en priorité à la coexistence) est ce qui est partagé par tou.te.s les associés d’une communauté. Il est le même (idem) pour tou.te.s et en ce sens, chaque personne peut identifier ce bien commun avec son intérêt particulier. Un « bien commun », c’est un intérêt particulier qui est le même pour tou.te.s.
- Alors qu’un « intérêt général » n’est peut-être l’intérêt d’aucun particulier qui compose une communauté : parce qu’il est l’intérêt du « tout » qui dépasse la simple addition des « parties ». Autrement dit, et c’est toute la différence avec le bien commun, la défense de l’intérêt général suppose la capacité de se décentrer de ses intérêts particuliers, voire d’être capable de les faire passer après l’intérêt général.
Il n’y a donc pas opposition entre bien commun et intérêt général mais chacun.e peut voir que l’un est plutôt d’influence horizontaliste alors que l’autre envisage une forme de verticalisme. Mais pourquoi pas, à la condition impérative que cette verticalité soit envisagée de façon remontante (bottom-up) et certainement pas de façon descendante (top-down) !
Amitiés  entretenues,
entretenues,
La Maison commune de la décroissance
Fleur Bertrand-Montembault
Texte intégral (2936 mots)
Le mot de la MCD : Le vendredi 20 juin 2025, juste avant mon départ pour la conférence internationale de la décroissance à Oslo, je suis intervenue pour la MCD au festival « La Bascule », au Havre. Au départ sollicité-es pour faire une intervention généraliste sur la décroissance, la tenue de deux autres ateliers intitulés respectivement « Permaculture, un mode de vie » et « Permaculture, volet social » m’ont donné l’idée d’intervenir sur « Permaculture, volet politique : la décroissance », une idée initiée au sein de la MCD par Michel Lepesant, qui a d’ailleurs depuis écrit un article intitulé « Les 5 zones de la permapolitique, premier repérage ». L’idée générale de l’intervention était de défendre en quoi la politique avait besoin d’une zone de radicalité, incarnée par la décroissance, comparée pour cela à la zone 5 en permaculture . S’en est suivie une discussion autour de ce qui représentait des actes politiques ou non, et une tentative de classement par « échelle de politisation » de la zone 1 à la zone 5.
Merci à Noémie pour son invitation et son accueil !
Un rappel sur le zonage en permaculture
En permaculture, chaque zone est délimitée en fonction de ses besoins en visite et intervention.
La permaculture distingue généralement 5 zones différentes classées de la zone la plus intensive à la zone la plus sauvage (zones 1 à 5). La zone 0 correspond au centre du système, autrement dit à la maison.
Zone 1
Cette zone de soin intensif nécessite une observation et un travail permanents. La zone accueille en général le potager et les animaux domestiques
Zone 2
Cette zone est cultivée de manière semi-intensive. Elle peut accueillir les animaux de basse-cour et toutes les cultures qui exigent un entretien régulier (désherbage, irrigation, mulching, etc.).
Zone 3
Cette zone contient les cultures ou les prairies dédiées à la production de la biomasse, aux vergers et aux haies. Les animaux de la ferme y trouvent leur place : vaches, moutons, chèvres, chevaux, etc.
Zone 4
Cette zone semi-sauvage exige peu de soins. Les animaux comme la vache ou le cochon peuvent s’y nourrir de manière autonome. On y trouve des arbres utiles, notamment pour le bois de chauffage, des plantes sauvages médicinales et comestibles, du foin, des haies…
Zone 5
Cette zone sauvage accueille des plantes et des animaux indigènes. La nature n’est soumise à aucune intervention humaine hormis la cueillette de plantes utiles et le ramassage de bois. Il s’agit d’une zone de taillis, de bois ou de forêt.
C’est cette zone 5 de la permaculture qui va nous intéresser pour penser la radicalité en politique : la politique a également besoin d’une part sauvage.
L’intérêt de penser en termes de « part sauvage »
Dans son livre « La part sauvage du monde » 1, la philosophe Virginie Maris nous enjoint à résister aux courants philosophiques constructivistes refusant la dualité nature / culture qui font du monde un monde seulement humain. Pour penser les enjeux écologiques de notre temps, elle nous invite au contraire à penser la nature comme une altérité. Refuser la dualité culture / nature, c’est refuser l’existence de l’altérité. À contrario, dans sa conception de la « nature-altérité », la nature se définit comme ce que les humains n’ont pas créé et ce sur quoi ils ne devraient pas avoir (em)prise : c’est « la part sauvage du monde ». Penser la part sauvage du monde a bien évidemment un intérêt écologique : c’est le seul moyen de mettre une limite au désir de contrôle total de l’humain. La part sauvage du monde présuppose « des lieux » où la nature n’est pas subordonnée aux besoins humains mais « laissée vivre », par elle-même et pour elle même, sans intervention extérieure ou pour le dire autrement, sans colonisation humaine. Conserver une part sauvage du monde, c’est accepter qu’à certains endroits la nature nous échappe. L’équivalent de la part sauvage du monde en permaculture, c’est la fameuse zone 5 évoquée plus haut.
Mais penser la part sauvage du monde, c’est aussi une question stratégique. Et c’est là qu’on peut faire le parallèle avec la politique. Car Virginie Maris alerte également sur les autres conséquences de vouloir domestiquer la nature tout le temps et partout :
« A délaisser la défense de la nature sauvage… le risque est grand de laisser progressivement se réduire l’éventail des possibles, d’admettre sans même y porter attention que, année après année, génération après génération, le point de référence que constitue l’extrémité sauvage du monde naturel ne se rapproche de l’état dégradé des écosystèmes intensivement exploités jusqu’à disparaître définitivement » […] les individus ont tendance à ne pas désirer beaucoup plus que ce qu’ils peuvent obtenir. Ce phénomène d’ajustement des préférences aux conditions réelles est dynamique. Du coup, lorsqu’on se trouve dans une situation qui se dégrade progressivement, on s’habitue à des choses qui auraient semblé inacceptables si elles étaient intervenues brusquement »
En lisant ce paragraphe, on voit bien que ce qui est appliqué à la nature est applicable à la politique.
En admettant que la zone 5 en permaculture (celle où les humains n’interviennent pas) est au potager ce que la part sauvage est au monde entier, il faut se poser la question : qu’est-ce que serait « la zone 5 » ou la « part sauvage » du champ politique ? Et ensuite, qu’est-ce que serait un champ politique sans zone 5 ?
Permaculture et politique
Si « zoner » la nature revient à la caractériser de son état le plus domestiqué à son état le plus sauvage, quel pourrait être un zonage pertinent pour caractériser le champ politique ?
Cela pourrait prendre la forme d’une tentative de « gradation » du moins politique (la zone 1) au plus politique (la zone 5).
Deux manières de remplir les zones peuvent être envisagées : soit en définissant la zone 1 puis « en montant les escaliers », soit en définissant la zone 5 « et en les descendant » ensuite.
J’aimerais pour cette fois, juste me questionner et me concentrer sur la zone 5 en partant du principe que si l’on peut graduer le politique c’est en évaluant sa radicalité. La zone la plus politique c’est la zone c’est donc la plus radicale.
Que signifie être radical en politique ? Parle-t-on de radicalité en acte ? Le risque c’est alors d’assimiler la zone 5 à une zone impliquant nécessairement la violence comme outil de la radicalité : la question de la violence en politique est une question épineuse, que je choisis donc d’évacuer pour le moment, pour ne pas risquer de la traiter maladroitement.
Peut-on alors envisager une autre forme de radicalité qui ne passe pas par l’action directe ? Le sens étymologique du mot radical, nous l’indique :
I. − Adjectif
A. − Relatif à la racine, à l’essence de quelque chose.
1. Qui concerne le principe premier, fondamental, qui est à l’origine d’une chose, d’un phénomène.
a) Qui a une action décisive sur les causes profondes d’un phénomène.
b) PHILOS. Qui va jusqu’au bout de chacune des conséquences impliquées par le choix initial.
Être radical, si je pousse la métaphore en politique, c’est : aller à la racine de nos maux politiques ; c’est chercher à combattre les causes et non pas les effets ; chercher les causes, c’est chercher les schémas/les cadres de pensée et les idéologies qui guident les actes et les décisions politiques et s’y opposer ; s’y opposer c’est construire un mouvement politique sur des bases conceptuelles claires et solides ; être radical, c’est aussi être cohérent : non pas être intransigeant, mais préférer « faire sens » que « faire nombre ».
Plutôt qu’une radicalité en acte, c’est une radicalité de la pensée qui émerge ici. La zone 5 pourrait donc être une zone plutôt fréquentée par les penseurs, les intellectuels, les théoriciens, les militants-chercheurs « occupés au travail idéologique » du mouvement qui les porte. Ce travail idéologique, il n’est pas coupé du réel (la zone 5 n’est pas une tour d’ivoire, elle est connectée aux autres zones) mais s’alimente du terrain (pratique des « savoirs remontants » par la conceptualisation des pratiques) tout en alimentant les autres dimensions de la lutte politique. C’est une zone qui n’a que faire des compromissions, voire même des compromis, dans la recherche et la construction d’un cadre politique clair et cohérent.
À une époque où les idéologies majoritaires, en particulier le libéralisme, poussent à la « sortie de la politique » (le mot est de l’un des conseillers hyper-méga-ultra libéral de Trump, dont le nom m’échappe à la rédaction de cet article) et où la tendance est donc à la dépolitisation, le risque est grand de voir la théorie décroissante, parce qu’elle prône au contraire la repolitisation et assume de définir et rendre visible un cadre politique clair, cohérent en opposition à la croissance, et parce qu’elle est minoritaire, ramenée au rang de secte ou de « dérive sectaire ».
La démocratie des minoritaires
Pour être radical sans être sectaire, il faut défendre la « démocratie des minoritaires » 2 :
« la démocratie des minoritaire, les libertaires de la décroissance l’ont toujours revendiquée quand ils affirment clairement qu’il faut rompre avec l’illusion de la prise préalable des pouvoirs centraux comme condition sine qua non de toute transformation de la société. On défend en fait une stratégie minoritaire par basculement de l’Imaginaire et pas du tout d’une stratégie majoritaire par renversement du Pouvoir. Comment en effet oublier que toute stratégie majoritaire a toujours justifié que pour « faire nombre » il fallait des compromis, qu’il fallait écarter la cohérence du « faire sens » pour préférer le grisâtre des inventaires à la Prévert (125 propositions !) à la diversité colorée d’un programme constitué de « belles revendications » ?
La démocratie des minoritaires, c’est dire que tout mouvement politique doit « tolérer toutes les critiques : et pas seulement celles dirigées contre les adversaires. ». C’est un mouvement « qui verrait au contraire dans la formulation de critiques en interne la condition nécessaire d’une réelle transformation démocratique de la société ».
Laisser la place à la radicalité c’est donc laisser la place à l’autocritique : s’autocritiquer c’est tout sauf être sectaire.
Étendre la définition de la décroissance
Sur la forme, la démocratie des minoritaires. Et sur le fond, pour assumer cette radicalité de la pensée décroissante, il faut assumer d’étendre sa portée politique.
Première étape : assumer totalement le mot de décroissance parce que c’est le bon mot (et alors, tant pis s’il n’est pas « attractif », « pas sexy », pas « rassembleur » : l’important c’est qu’il fasse sens, et c’est à partir du sens qu’on peut espérer faire nombre et pas l’inverse.)
C’est le bon mot parce qu’il signifie très exactement sa raison d’être : son opposition politique à la croissance. On retrouve dans cette racine dé-, les éléments de radicalité présentés plus haut « Qui va jusqu’au bout de chacune des conséquences impliquées par le choix initial. : s’opposer à la croissance (qui est à la « racine », l’origine, le « principe premier » de nos maux politiques) c’est chercher à dé-croître.
Mais qu’est-ce que la croissance ? ça n’est pas seulement un phénomène économique et social, c’est aussi un phénomène politique. Par conséquent nous avons besoin d’une critique politique de la croissance, peut-être même avant de sa critique économique et sociale. Cela implique une triple définition de la décroissance
D’abord, la décroissance comme décrue : il ne suffit plus de dire « Halte à la croissance » ou d’objecter à la croissance : quand les plafonds sont largement dépassés, il ne suffit plus de se demander comment rester dans le même monde avec une croissance nulle mais bel et bien d’organiser le reflux, la marche arrière pour revenir sous les plafonds de la soutenabilité écologique et sociale.
Deuxièmement, la décroissance comme décolonisation des imaginaires, en particulier en s’élevant contre le bras armé de cette colonisation, la publicité.
Troisièmement, en s’attaquant au régime politique de croissance et à ses bases idéologiques : et en particulier l’individualisme et le neutralisme (il faut lire à ce propos les écrits d’Onofrio Romano et de Michel Lepesant)
D’un point de vue politique quelles conséquence y aurait-il à appauvrir ou à supprimer la zone 5 ?
Un champ politique sans zone 5 s’approche dangereusement du monde dans lequel on vit : un monde extrêmement dépolitisé, prônant volontiers l’apolitisme, ou se contentant de « petite politique ». Or nous avons besoin de radicalité en politique pour ne pas nous « habituer » : sinon, comme pour la nature, c’est l’ensemble du référentiel « de ce qu’il est permis d’espérer » qui se rabougrit considérablement.
D’autre part, adopter une posture radicale, ça n’est pas se contenter de s’attaquer aux effets du monde dont on veut sortir, mais prendre « le mal à la racine ».
La zone 5 ne suffit pas en soi, mais il faut qu’elle soit écoutée dans les autres zones, qu’elle infuse en dehors de son périmètre restreint. Comme la part sauvage du monde, la zone de radicalité en politique est une vigie : elle nous permet de garder le cap.
Quelques notes sur la discussion collective qui s’en est suivie
Après cette présentation, les participant-es étaient invité-es à nommer des actes qu’ils considéraient comme de nature à changer le monde et à les placer en dans une des zones de la permapolitique, ou tout du moins tenter une hiérarchisation de ces actes, du plus radical au moins radical.
Un accord sur les petits gestes comme faisant partie de la zone 1 a été assez vitre trouvé par les participant-es.
Ensuite, l’enjeu a été de classer : manif catégorielle (« de profs »), manif générale, distribution de tracts pour une association comme L214, création d’une coopérative d’alimentation et quelques autres exemples évoqués au fur et à mesure de la discussion…
On peut tirer de cet échange deux fils pour continuer la réflexion sur ce qui est politique ou non, ce qui est radical ou non :
- l’importance politique de l’acte peut-il être mesuré par son effet ? Et si oui, cette mesure de « l’efficacité de l’acte » peut-elle être seulement quantitative ?
- L’importance politique de l’acte est-il lié à son désintéressement ? Cela signifierait-il que plus l’acte a ce qu’on pourrait appeler « une portée universelle » et que moins la personne qui le pratique en retire des bénéfices personnels directs, plus il est politique ?
Notes et références
Rédaction
Lire plus (349 mots)
Cela va faire bientôt 10 années qu’en sous-titre de toutes les (f)estives, nous ajoutons : pour une critique radicale de l’individualisme.
Ce fut encore le cas lors de cette édition 2025 :
- La rencontre avec Onofrio Romano, c’est la rencontre avec une critique radicale de la croissance, non pas comme économie, non pas comme monde socioculturel, mais comme « régime de croissance », comme régime politique de croissance. Onofrio Romano, par ses analyses tant historiques que conceptuelles, nous a montré comment l’idéologie libérale avait installé depuis quelques siècles des dispositifs de domination. Le point commun de ces dispositifs, c’est ce qu’il dénonce comme « horizontalisme », c’est-à-dire une façon soi-disant neutre de tolérer la liberté d’expression des individus mais en réalité une façon de neutraliser toutes les oppositions, tous les conflits alors que ce sont ces controverses qui nourrissent la discussion démocratique.
- Le focus sur la propriété est lui aussi venu buter sur la question de l’individualisme : car, au cœur de l’idéologie propriétaire, il y a cette rhétorique que la première des libertés individuelles, la plus naturelle, c’est la propriété privée. Le plus surprenant fut de s’apercevoir que cet individualisme peut venir se nicher même dans des discours apparemment attractifs quand il s’agit de lutter contre les dominations.
Bon, le mieux, c’est d’aller lire les comptes-rendus.
Et puisque dynamique il y a eu, alors il faut savoir la dépenser : c’est dans cet esprit que nous reprenons les rendez-vous du premier samedi du mois – les cafés-décroissance – qui seront pour le moment entièrement consacrés à un projet de fresque de la décroissance.
Bon Pote
Actu-Environnement
Amis de la Terre
Aspas
Biodiversité-sous-nos-pieds
Bloom
Canopée
Décroissance (la)
Deep Green Resistance
Déroute des routes
Faîte et Racines
Fracas
F.N.E (AURA)
Greenpeace Fr
JNE
La Relève et la Peste
La Terre
Le Lierre
Le Sauvage
Low-Tech Mag.
Motus & Langue pendue
Mountain Wilderness
Negawatt
Observatoire de l'Anthropocène