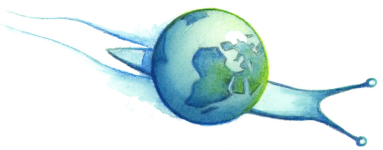Articles intégraux en PDF
la Maison commune de la décroissance
L’accord final de la COP 30 : sens ou non-sens ?
Rédaction
Texte intégral (726 mots)
A l’issue de la COP30, faut-il se réjouir de l’accord obtenu entre les délégations de 194 pays – en l’absence des USA de Trump – ou bien faut-il déplorer l’absurdité dans laquelle semble s’enfoncer, COP après COP, un agenda mondial censé affronter prioritairement l’urgence climatique ?
Avec cet accord, on ne cesse t’entendre que « le pire a été évité ». Super, mais de quel « pire » est-il ici question ? Là, on croit rêver quand on s’aperçoit que ce pire aurait été la validation de la ligne trumpienne d’une remise en cause de la réalité du changement climatique.
A partir d’un tel effondrement des exigences, on comprend mieux pourquoi la COP30 a été un gigantesque recul sur la question cruciale d’une sortie des énergies fossiles. Et là on peut être précis : les combustibles fossiles ne sont évoqués qu’implicitement par le biais d’une « référence au consensus des Emirats arabes unis » : lors de la COP28 de Dubaï, en 2023, les parties s’étaient engagées à « une transition hors des énergies fossiles ».
Autrement dit, à la COP30, c’est retour en deçà de la COP28 !
Se pose alors la question politique : comment un tel « accord » est-il possible ? Parce que la règle de la décision se fait au consensus et que, dans ce cas, il n’y a plus que 2 options possibles : l’absence d’accord ou bien un accord sous le joug de la partie prenante la plus égoïste, la plus intransigeante. Et dans le cas de la COP30, il s’agissait des pays pétroliers, menés par l’Arabie saoudite, mais aussi de l’Inde ou de la Russie.
Les Européens ont plusieurs fois menacé de quitter Belém sans accord. Mais au final, ils ont signé l’accord.
Ils ont fait le choix de « rester ensemble en désaccord » plutôt que celui de « rester en accord avec soi-même ». Ils ont donné la priorité au « faire nombre » sur le « faire sens ».
Quiconque s’est déjà un peu engagé dans l’organisation collective d’une alternative concrète, même au niveau le plus local, s’est déjà retrouvé devant ce hiatus entre le sens et le nombre. L’enjeu n’est pas de renoncer à l’un au profit de l’autre. L’enjeu est de se demander auquel donner priorité. Au nom d’un critère simple : des 2 façons de prioriser, laquelle a le plus de risque d’aboutir au sacrifice de l’une des 2 exigences ?
- L’argumentaire du « faire nombre » repose sur l’efficacité et l’urgence du présent.
- L’argumentaire du « faire sens » repose sur la cohérence et l’urgence du futur.
Car tel est le hiatus porté par toute urgence : c’est que la catastrophe annoncée pour le futur ne peut être affrontée qu’ici et maintenant.
Alors comment trancher ? D’expérience :
- La priorité accordée au « faire sens » sur le « faire nombre » ne peut pas garantir le succès ; car une stratégie n’est pas une prophétie. Mais si succès il y a, il sera sensé.
- La priorité accordée au « faire nombre » est d’emblée un renoncement au « faire sens » et comme seul le « sens » peut faire « lien » alors l’alternative finit toujours, à terme, par retourner dans le as usual, c’est-à-dire l’éparpillement et le repli sur ses positions.
Et en attendant ?
Comme de toutes les façons, nos alternatives n’en sont pas encore à prétendre « faire nombre », prenons le temps de « faire sens ».
C’est ce genre de pari qui nous anime quand nous portons un projet tel celui de la Fresque de la décroissance (Prochaine visiodiscussion : le samedi 6 décembre à 10h ). C’est ce que Serge Latouche appelait le pari de la décroissance.
PDFTexte intégral (726 mots)
A l’issue de la COP30, faut-il se réjouir de l’accord obtenu entre les délégations de 194 pays – en l’absence des USA de Trump – ou bien faut-il déplorer l’absurdité dans laquelle semble s’enfoncer, COP après COP, un agenda mondial censé affronter prioritairement l’urgence climatique ?
Avec cet accord, on ne cesse t’entendre que « le pire a été évité ». Super, mais de quel « pire » est-il ici question ? Là, on croit rêver quand on s’aperçoit que ce pire aurait été la validation de la ligne trumpienne d’une remise en cause de la réalité du changement climatique.
A partir d’un tel effondrement des exigences, on comprend mieux pourquoi la COP30 a été un gigantesque recul sur la question cruciale d’une sortie des énergies fossiles. Et là on peut être précis : les combustibles fossiles ne sont évoqués qu’implicitement par le biais d’une « référence au consensus des Emirats arabes unis » : lors de la COP28 de Dubaï, en 2023, les parties s’étaient engagées à « une transition hors des énergies fossiles ».
Autrement dit, à la COP30, c’est retour en deçà de la COP28 !
Se pose alors la question politique : comment un tel « accord » est-il possible ? Parce que la règle de la décision se fait au consensus et que, dans ce cas, il n’y a plus que 2 options possibles : l’absence d’accord ou bien un accord sous le joug de la partie prenante la plus égoïste, la plus intransigeante. Et dans le cas de la COP30, il s’agissait des pays pétroliers, menés par l’Arabie saoudite, mais aussi de l’Inde ou de la Russie.
Les Européens ont plusieurs fois menacé de quitter Belém sans accord. Mais au final, ils ont signé l’accord.
Ils ont fait le choix de « rester ensemble en désaccord » plutôt que celui de « rester en accord avec soi-même ». Ils ont donné la priorité au « faire nombre » sur le « faire sens ».
Quiconque s’est déjà un peu engagé dans l’organisation collective d’une alternative concrète, même au niveau le plus local, s’est déjà retrouvé devant ce hiatus entre le sens et le nombre. L’enjeu n’est pas de renoncer à l’un au profit de l’autre. L’enjeu est de se demander auquel donner priorité. Au nom d’un critère simple : des 2 façons de prioriser, laquelle a le plus de risque d’aboutir au sacrifice de l’une des 2 exigences ?
- L’argumentaire du « faire nombre » repose sur l’efficacité et l’urgence du présent.
- L’argumentaire du « faire sens » repose sur la cohérence et l’urgence du futur.
Car tel est le hiatus porté par toute urgence : c’est que la catastrophe annoncée pour le futur ne peut être affrontée qu’ici et maintenant.
Alors comment trancher ? D’expérience :
- La priorité accordée au « faire sens » sur le « faire nombre » ne peut pas garantir le succès ; car une stratégie n’est pas une prophétie. Mais si succès il y a, il sera sensé.
- La priorité accordée au « faire nombre » est d’emblée un renoncement au « faire sens » et comme seul le « sens » peut faire « lien » alors l’alternative finit toujours, à terme, par retourner dans le as usual, c’est-à-dire l’éparpillement et le repli sur ses positions.
Et en attendant ?
Comme de toutes les façons, nos alternatives n’en sont pas encore à prétendre « faire nombre », prenons le temps de « faire sens ».
C’est ce genre de pari qui nous anime quand nous portons un projet tel celui de la Fresque de la décroissance (Prochaine visiodiscussion : le samedi 6 décembre à 10h ). C’est ce que Serge Latouche appelait le pari de la décroissance.
Statuts 2025 de l’association Maison commune de la décroissance
Rédaction
Texte intégral (1218 mots)
Article 1 – Dénomination
Est fondée entre les adhérent.e.s aux présents statuts une association à but non lucratif, régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901, ayant pour titre : « La Maison commune de la décroissance ».
Article 2 – Objet
Association d’éducation populaire, la Maison commune de la décroissance (la MCD) a pour objet de diffuser la philosophie de la décroissance définie comme un trajet vers des sociétés écologiquement soutenables, socialement décentes et démocratiquement organisées, qui passe par la baisse de l’extraction, de la production, de la consommation, et des pollutions.
La philosophie politique qu’elle élabore vise la défense d’un environnement naturel préservé, condition sine qua non de la vie sociale.
La décroissance est à la fois une décrue économique, une décolonisation des imaginaires et elle promeut la repolitisation de la conception commune de la vie bonne (par un plaidoyer en faveur des autolimitations, de la vie sociale, et de la dépense commune).
Grâce à son site, ses rencontres, des conférences, des arpentages, des podcasts, des vidéos et des films présents sur les réseaux sociaux, l’accès aux connaissances est libre et ouvert à tou-te-s
Article 3 – Siège social
Son siège social est fixé au : 13 rue de l’espérance, 75013 Paris.
Celui-ci peut être modifié par la Coopérative selon les modalités définies dans le Règlement Intérieur (R.I.)
Article 4 – Adhésion
L’association se compose de l’ensemble de ses membres physiques et personnes morales adhérentes.
Pour adhérer l’association, en tant que membre physique ou personne morale, il faut :
- Avoir versé la cotisation annuelle définie à l’art.2 du R.I.
- Avoir souscrit à la Charte de la MCD.
Article 4bis – Groupe territorial local
Les membres de l’association peuvent s’organiser en groupe local, tel que défini à l’art.10 du R.I.
Article 5 – Ressources
Les ressources de l’association sont constituées par :
- les cotisations de ses membres ;
- les donations de Fondations ;
- les actions de terrain engagées ;
- les dons et legs ;
- et toute autre ressource autorisée par la loi.
Article 6 – La Coopérative
La Coopérative est l’organe de gestion et d’organisation de la MCD. Elle coordonne les validations administratives, logistiques, financières et idéologiques de l’association.
En son sein, au consensus, elle choisit un bureau composé au minimum d’un.e président.e d’un.e trésorier.e et d’un.e secrétaire ; dont la fonction principale est celle d’être employeur.
Son fonctionnement interne est défini à l’art.3 du R.I.
Article 7 – La Mutuelle
L’A.G.O. confie à la Mutuelle la discussion du projet idéologique de la MCD.
Elle est composée d’adhérents, regroupés ou non en commissions ad hoc thématiques, qui participent à la discussion ou à des projets portés par la MCD, en partenariat ou pas avec d’autres associations : les (f)estives, la Caravane contre-croissance, La Fresque, les livrets autoédités, le concours de nouvelles, des vidéos et des podcasts…
Son fonctionnement interne est défini à l’art.4 du R.I.
Article 8 – L’assemblée Générale Ordinaire (A.G.O.)
L’A.G.O. est ouverte à tous les adhérents de l’association. Elle se réunit chaque année, dans les conditions définies à l’art.11 du R.I. Elle valide les grandes orientations de l’association.
Article 9 – Assemblée générale Extraordinaire (A.G.E.)
Celle-ci peut être convoquée par la Coopérative, par l’A.G.O. ou par le quart des membres adhérents, suivant les modalités définies à l’article 12 du R.I.
Article 10 – Modification des Statuts
La validation de la modification des Statuts se fait en convoquant une A.G.E qui statue à la majorité des deux tiers des présents selon les modalités précisées à l’article 13 du R.I.
Article 11 – Règlement intérieur
Le R.I. est établi par le Coopérative, qui le fait approuver par l’A.G.O. à la majorité des deux tiers des présents.
Le règlement est destiné à fixer les différents points non précisés par les Statuts, notamment ceux qui ont trait à l’organisation interne de l’association, et prévoit les règles de conduite des adhérents en général, des membres de la Coopérative et de la Mutuelle en particulier.
Article 11 bis – Charte
La Charte est établie par le Coopérative, qui le fait approuver par l’A.G.O. à la majorité des deux tiers des présents.
La Charte vise à présenter sur une page l’objet de l’association, tel que défini à l’article 2 de ces Statuts.
Article 12 – Modification du Règlement intérieur et de la Charte
Le R.I. et la Charte peuvent être modifiés sur proposition de la coopérative, de l’A.G.O. ou à la demande d’un dixième des adhérents de l’association. Les modifications doivent être validées par une A.G.O. à la majorité des deux tiers des présents selon les modalités précisées au R.I. Toute modification du R.I. ou de la Charte fait l’objet d’une communication aux adhérents de l’association dans un délai de quinze jours.
Article 13 – Dissolution de l’association
La durée de l’association est illimitée. Cependant, une dissolution peut être prononcée par les deux tiers au moins des membres présents à l’A.G.E. Un ou plusieurs liquidateurs sont nommés par celle-ci et l’actif, s’il y a lieu, est dévolu conformément à l’art.9 de la loi du 1/7/1901 et au décret du 16/8/1901.
PDFTexte intégral (1218 mots)
Article 1 – Dénomination
Est fondée entre les adhérent.e.s aux présents statuts une association à but non lucratif, régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901, ayant pour titre : « La Maison commune de la décroissance ».
Article 2 – Objet
Association d’éducation populaire, la Maison commune de la décroissance (la MCD) a pour objet de diffuser la philosophie de la décroissance définie comme un trajet vers des sociétés écologiquement soutenables, socialement décentes et démocratiquement organisées, qui passe par la baisse de l’extraction, de la production, de la consommation, et des pollutions.
La philosophie politique qu’elle élabore vise la défense d’un environnement naturel préservé, condition sine qua non de la vie sociale.
La décroissance est à la fois une décrue économique, une décolonisation des imaginaires et elle promeut la repolitisation de la conception commune de la vie bonne (par un plaidoyer en faveur des autolimitations, de la vie sociale, et de la dépense commune).
Grâce à son site, ses rencontres, des conférences, des arpentages, des podcasts, des vidéos et des films présents sur les réseaux sociaux, l’accès aux connaissances est libre et ouvert à tou-te-s
Article 3 – Siège social
Son siège social est fixé au : 13 rue de l’espérance, 75013 Paris.
Celui-ci peut être modifié par la Coopérative selon les modalités définies dans le Règlement Intérieur (R.I.)
Article 4 – Adhésion
L’association se compose de l’ensemble de ses membres physiques et personnes morales adhérentes.
Pour adhérer l’association, en tant que membre physique ou personne morale, il faut :
- Avoir versé la cotisation annuelle définie à l’art.2 du R.I.
- Avoir souscrit à la Charte de la MCD.
Article 4bis – Groupe territorial local
Les membres de l’association peuvent s’organiser en groupe local, tel que défini à l’art.10 du R.I.
Article 5 – Ressources
Les ressources de l’association sont constituées par :
- les cotisations de ses membres ;
- les donations de Fondations ;
- les actions de terrain engagées ;
- les dons et legs ;
- et toute autre ressource autorisée par la loi.
Article 6 – La Coopérative
La Coopérative est l’organe de gestion et d’organisation de la MCD. Elle coordonne les validations administratives, logistiques, financières et idéologiques de l’association.
En son sein, au consensus, elle choisit un bureau composé au minimum d’un.e président.e d’un.e trésorier.e et d’un.e secrétaire ; dont la fonction principale est celle d’être employeur.
Son fonctionnement interne est défini à l’art.3 du R.I.
Article 7 – La Mutuelle
L’A.G.O. confie à la Mutuelle la discussion du projet idéologique de la MCD.
Elle est composée d’adhérents, regroupés ou non en commissions ad hoc thématiques, qui participent à la discussion ou à des projets portés par la MCD, en partenariat ou pas avec d’autres associations : les (f)estives, la Caravane contre-croissance, La Fresque, les livrets autoédités, le concours de nouvelles, des vidéos et des podcasts…
Son fonctionnement interne est défini à l’art.4 du R.I.
Article 8 – L’assemblée Générale Ordinaire (A.G.O.)
L’A.G.O. est ouverte à tous les adhérents de l’association. Elle se réunit chaque année, dans les conditions définies à l’art.11 du R.I. Elle valide les grandes orientations de l’association.
Article 9 – Assemblée générale Extraordinaire (A.G.E.)
Celle-ci peut être convoquée par la Coopérative, par l’A.G.O. ou par le quart des membres adhérents, suivant les modalités définies à l’article 12 du R.I.
Article 10 – Modification des Statuts
La validation de la modification des Statuts se fait en convoquant une A.G.E qui statue à la majorité des deux tiers des présents selon les modalités précisées à l’article 13 du R.I.
Article 11 – Règlement intérieur
Le R.I. est établi par le Coopérative, qui le fait approuver par l’A.G.O. à la majorité des deux tiers des présents.
Le règlement est destiné à fixer les différents points non précisés par les Statuts, notamment ceux qui ont trait à l’organisation interne de l’association, et prévoit les règles de conduite des adhérents en général, des membres de la Coopérative et de la Mutuelle en particulier.
Article 11 bis – Charte
La Charte est établie par le Coopérative, qui le fait approuver par l’A.G.O. à la majorité des deux tiers des présents.
La Charte vise à présenter sur une page l’objet de l’association, tel que défini à l’article 2 de ces Statuts.
Article 12 – Modification du Règlement intérieur et de la Charte
Le R.I. et la Charte peuvent être modifiés sur proposition de la coopérative, de l’A.G.O. ou à la demande d’un dixième des adhérents de l’association. Les modifications doivent être validées par une A.G.O. à la majorité des deux tiers des présents selon les modalités précisées au R.I. Toute modification du R.I. ou de la Charte fait l’objet d’une communication aux adhérents de l’association dans un délai de quinze jours.
Article 13 – Dissolution de l’association
La durée de l’association est illimitée. Cependant, une dissolution peut être prononcée par les deux tiers au moins des membres présents à l’A.G.E. Un ou plusieurs liquidateurs sont nommés par celle-ci et l’actif, s’il y a lieu, est dévolu conformément à l’art.9 de la loi du 1/7/1901 et au décret du 16/8/1901.
Règlement intérieur de la Maison commune de la décroissance (MCD) – Novembre 2025
Rédaction
Texte intégral (2816 mots)
En tant qu’association la Maison commune de la décroissance a besoin d’un Règlement Intérieur (R.I). Ce R.I. a pour objectif de préciser le fonctionnement de la MCD, il a été adopté lors de l’Assemblée Générale extraordinaire du 8 novembre 2025 à Charpey.
Règlement intérieur de la Maison commune de la décroissance (MCD)
L’association a pour objet de faire connaître la décroissance au travers de la Maison commune de la décroissance (la MCD).
1. Le siège social.
Il est aujourd’hui au : 13, rue de l’espérance, 75013 Paris.
La Coopérative peut changer de siège social à la demande d’un seul membre de la coopérative, si celui-ci propose une autre adresse. Encore faut-il que la majorité qualifiée des 2/3 des membres acceptent le changement après recherche de consensus.
2. Adhésion
Pour devenir membre il faut adhérer à la charte de l’association et s’acquitter de la cotisation.
Le montant de la cotisation annuelle est de 20 € à 80 €.
L’adhésion est valable sur l’année glissante, i.e. pendant les 12 mois qui suivent le paiement.
Tout nouvel adhérent se verra expliquer le fonctionnement de la MCD par un de ses membres, et remettre un livret d’accueil.
Les membres honoraires de la MCD, validés par la Coopérative, sont dispensés de cotisation.
3. La Coopérative.
3.1. Composition
Elle est composée de 3 à 11 membres bénévoles au maximum.
Les membres de la Coopérative s’engagent à respecter les « procédures de coordination » de la MCD (Annexe 1).
Les salarié.e.s participent à ses discussions, sans droit de vote au sein de la Coopérative.
En son sein, au consensus, elle choisit un bureau composé au minimum d’un.e président.e, d’un.e trésorier.e et d’un.e secrétaire-gestionnaire ; dont la fonction principale est celle d’être employeur.
C’est pendant une A.G.O. que la Coopérative peut renouveler ses membres ; et si les effectifs le permettent, elle peut intégrer un nouveau membre « au fil de l’eau ».
Au consensus, tout nouveau membre entre sur candidature et en devient membre effectif après une période de 6 mois, pour une durée totale de 3 ans, renouvelable.
3.2. Rôle de la Coopérative, et ses décisions
La Coopérative joue le rôle de conseil d’administration, elle est l’organe de gestion et d’organisation de la MCD. Elle coordonne les validations administratives, logistiques, financières et idéologiques de l’association.
La Coopérative peut mandater un de ses membres pour la représenter au sein d’autres structures associatives.
Elle établit chaque année la feuille de route de la MCD, qu’elle présente en A.G.O.
Elle se réunit (visioconférence) au moins 1 fois par mois ou sur demande d’un de ses membres.
Les prises de décision au sein de la Coopérative se font au consensus, sinon, à défaut, à la majorité des 2/3. Le quorum est égal à la moitié + 1 du nombre des membres de la Coopérative.
Toute décision ou texte proposé par un adhérent à diffuser hors de la coopérative doit être soumis aux membres de la coopérative qui disposent de 96 heures pour émettre un avis. L’absence de réponse vaut pour accord, sauf en cas de demande de délai explicite. En cas d’urgence, si la décision (ou le texte) ne peut être soumise à vote, elle doit au moins être revue et validée par 3 membres de la coopérative qui auront échangé par mail ou téléphone. Un mail est alors envoyé à l’ensemble des membres de la coopérative en précisant date, décision ou texte, participants à la validation et réserves éventuelles.
3.3. Délégation
Ces dispositions peuvent être outrepassées lorsqu’un membre de la Coopérative (par exemple, si responsable du site internet) a reçu mandat de celle-ci lors une précédente réunion pour prendre une décision ou diffuser un texte sur un sujet précis. Cette délégation est consignée dans le CR de ladite réunion.
3.4. Porte-parolat et plaidoyer
Par des membres bénévoles de la Coopérative ou par un salarié, les activités de représentation et de diffusion du corpus de la MCD sont coordonnées au sein de la Coopérative, conformément à ses « procédures de coordination » (annexe 1).
3.5. Positionnement sur les élections
La MCD ne se présente pas aux élections et n’autorise personne à le faire en son nom.
La MCD élabore un projet et des propositions politiques qui organisent démocratiquement la décroissance.
Lors des périodes électorales, la Coopérative peut décider de soutenir officiellement des candidatures conformes à son objet.
4. La Mutuelle.
Organe de partage et de discussion du projet politique de la MCD.
→ Elle est composée d’adhérents volontaires, regroupés ou non en commissions ad hoc thématiques, qui participent à la discussion ou à des projets portés par la MCD, en partenariat ou pas avec d’autres associations.
- Les bénévoles comme les salariés s’y engagent à respecter les « procédures de coordination » de la MCD (Annexe 1)
- Les commissions ad hoc résultent de l’initiative d’au moins 1 animateur.euse à qui la Coopérative confie la responsabilité de l’organisation des travaux.
- Les commissions ad hoc sont composées de membres cooptés, qui peuvent ne pas être adhérents de la MCD.
→ Idéologiquement, la Mutuelle distingue entre ce qui appartient au « noyau » de la MCD et ce qui se situe sur des rayons qui ont ainsi une dimension exploratoire. https://ladecroissance.xyz/2016/11/11/noyau-philosophique/
Toutes les activités de la Mutuelle doivent rester dans le cadre des statuts de la MCD et de ce RI.
Toute expression publique (publication, intervention, prise de position…) doit être validée par la Coopérative, garante de l’objet de la MCD.
Pour la rejoindre, contacter : mutuelle-mcd@framagroupes.org
5. Sortie de la Mutuelle et de la Coopérative
Tout membre d’une de ces instances peut en sortir volontairement, à tout moment.
La sortie peut être contrainte par décision de la Coopérative, en cas de non-respect significatif et répété des procédures de coordination.
La sortie peut être temporaire ou définitive.
6. La Compagnie
Les « compagnes et compagnons » de la MCD sont membres honoraires ou cotisants de l’association, et choisis par la Coopérative.
Sans être obligatoirement membres de la Coopérative ou de la Mutuelle, ils peuvent intervenir dans le débat public, en se revendiquant de la MCD.
7. Les publications
Les textes, podcasts et vidéos diffusés par les membres de la MCD sont de 3 ordres :
- Articles et interventions diffusés sur des sites internet (de la MCD, Wikipedia, autres…) ou dans la presse et signés MCD : ils doivent avoir fait l’objet d’une validation par la Coopérative. Le nom de l’auteur peut figurer mais en indiquant que c’est pour la MCD.
- Tribunes libres et billets, diffusés sur le site MCD ou tout autre support (réseaux sociaux, sites, presse) et signés par leur auteur : ils peuvent être suivi du lien vers le site MCD mais, le cas échéant, avec une mention indiquant que les opinions exprimés dans le texte n’engagent pas la MCD. Cela permet notamment d’émettre des avis sur des sujets pour lesquels il n’y a pas consensus au sein de la MCD.
- Commentaires et avis courts émis sur des pétitions en lignes ou dans des forums de discussion par exemple : l’auteur peut faire apparaître son appartenance à la MCD et donner le lien du site internet. Ces communications doivent être reportées dans notre main courante pour information, statistiques et rappel à l’ordre si dérapage.
Par ailleurs, des publications de non-membres pourront être publiées sur le site de la MCD après accord de la Coopérative et à condition que le texte soit en phase avec l’objet de l’association.
Enfin, les personnes ou structures reprenant les idées ou propos de la MCD sont priées de mentionner leur origine, et leur auteur ou autrice, par courtoisie et transparence. Nos publications sont sous licence CC BY-NC-SA.
8. Cohérence et transparence
Tous les membres de la Coopérative, de la Mutuelle, et les salariés disposent d’un lien vers un framacalc qui servira de main courante pour l’association.
Toute activité devra y être succinctement présentée : nom, datations, objet, commentaires.
9. Remboursement des frais
Les frais occasionnés par l’accomplissement du mandat des membres de la coopérative, de la mutuelle, d’un groupe ad hoc ou des tâches de salariés peuvent être remboursés sur justificatifs adressés au sécrétaire-gestionnaire.
10. Groupe territorial local
Tout adhérent de la MCD peut prendre l’initiative de créer un groupe local dans le but de diffuser et de relocaliser le corpus de la MCD.
- Les activités principales sont :
- Intervention directe ou invitée dans des rencontres locales.
- Séances d’arpentage et de lectures discutées de textes.
- Contribution locale à la Cartographie systémique défendue par la MCD.
- Tout groupe local renseigne de toutes ses activités sur la main courante.
11. L’assemblée générale ordinaire
L’A.G.O. est ouverte à tous les membres à jour de cotisation. La convocation se fera au moins 15 jours à l’avance par l’envoi d’un mail aux adhérents. Toutefois ceux qui en font la demande recevront une convocation par courrier.
Le lieu de l’A.G.O. est choisi par la Coopérative.
Seuls les membres présents, sur place ou en visioconférence, peuvent voter (pas de procuration).
12. Assemblée générale extraordinaire.
Celle-ci peut être convoquée par la Coopérative, par l’A.G.O. ou par le quart des membres adhérents (par un courriel envoyé à la Coopérative de la MCD).
La convocation à cette assemblée se fera selon les mêmes modalités que celles de l’A.G.O. En particulier dans le cas d’une double convocation : A.G.E. suivie immédiatement d’une A.G.O.
13. Modification des Statuts, de la Charte et du Règlement Intérieur.
Les modifications des statuts ou de la Charte peuvent être proposées soit par la Coopérative, soit par la moitié des adhérents de l’association.
Les modifications demandées devront être adressées à la Coopérative par courriel.
Le règlement intérieur pourra être modifié par la Coopérative qui devra le faire valider lors de l’A.G.O. suivante.
Les modifications des statuts ou de la Charte seront validées par la majorité qualifiée des 2/3 des membres présents d’une A.G.E. (cf. Article 10 des statuts).
14. Exclusion d’un.e adhérent.e
La Coopérative se réserve la possibilité d’exclure un.e adhérent.e de l’association dans les cas suivants :
- Déclaration publique au nom de la MCD sans validation préalable de la Coopérative. Cela signifie que tout membre est libre de ses propos à condition de ne pas les tenir au nom de la MCD
- Plus largement, toute attitude pouvant nuire à la visibilité et à la crédibilité de la MCD, et à son fonctionnement convivial.
Après un avertissement, si le membre récidive, la Coopérative l’avertira de son exclusion par l’envoi d’un courriel avec l’état de la notification.
En cas de manquement grave, l’exclusion peut être immédiate.
L’exclusion peut être temporaire ou définitive.
Annexe 1
Propositions pour des procédures autocritiques de coordination
Ce qu’il est normal de demander à un salarié comme à un bénévole
- Faire jusqu’au bout ce qu’on a commencé, correctement, dans les délais.
- Responsabilité = Mandat de confiance (on fait confiance à celui à qui une activité est confiée et dont il devient responsable).
- Validations idéologique, logistique et financière en amont (par la Coopérative) et validation continue pendant la réalisation (par un sous-groupe had hoc).
- Il n’y a pas de domination mais il y a des dépendances des membres de la MCD vis-à-vis de la MCD. Ne pas confondre indépendance et autonomie : un « mandaté » a une part d’autonomie, mais il n’est pas indépendant.
- Ne jamais mettre la MCD en dépendance d’une initiative individuelle.
- Se rendre compte = rendre des comptes. Il faut accepter qu’une activité soit évaluée et que soit demandé un correctif : ce qui présuppose une grille d’évaluation (annexe 2)
- Un projet doit pouvoir être facilement continué par un autre, par la personne ou le groupe qui en prend la suite.
- Honorer les auteurs : que ce soit à l’intérieur de la MCD, dans un texte ou une intervention (par une référence explicite) ou dans un événement-MCD (festives, caravane…).
Annexe 2
Check-list des compétences et des vigilances
Administration, logistique Partenariat – réseautage Plaidoyer – Visibilité 1. Faire 1.1 Pas fait 1.2 A ½ fait 2. Faire correctement 2.1 Transparence 2.2 Validations 2.3 Cadrage MCD 2.4 Minutie 2.5 Crédibilité 3. Dans les délais 3.1 A la dernière minute 3.2 Hors délai
PDFTexte intégral (2816 mots)
En tant qu’association la Maison commune de la décroissance a besoin d’un Règlement Intérieur (R.I). Ce R.I. a pour objectif de préciser le fonctionnement de la MCD, il a été adopté lors de l’Assemblée Générale extraordinaire du 8 novembre 2025 à Charpey.
Règlement intérieur de la Maison commune de la décroissance (MCD)
L’association a pour objet de faire connaître la décroissance au travers de la Maison commune de la décroissance (la MCD).
1. Le siège social.
Il est aujourd’hui au : 13, rue de l’espérance, 75013 Paris.
La Coopérative peut changer de siège social à la demande d’un seul membre de la coopérative, si celui-ci propose une autre adresse. Encore faut-il que la majorité qualifiée des 2/3 des membres acceptent le changement après recherche de consensus.
2. Adhésion
Pour devenir membre il faut adhérer à la charte de l’association et s’acquitter de la cotisation.
Le montant de la cotisation annuelle est de 20 € à 80 €.
L’adhésion est valable sur l’année glissante, i.e. pendant les 12 mois qui suivent le paiement.
Tout nouvel adhérent se verra expliquer le fonctionnement de la MCD par un de ses membres, et remettre un livret d’accueil.
Les membres honoraires de la MCD, validés par la Coopérative, sont dispensés de cotisation.
3. La Coopérative.
3.1. Composition
Elle est composée de 3 à 11 membres bénévoles au maximum.
Les membres de la Coopérative s’engagent à respecter les « procédures de coordination » de la MCD (Annexe 1).
Les salarié.e.s participent à ses discussions, sans droit de vote au sein de la Coopérative.
En son sein, au consensus, elle choisit un bureau composé au minimum d’un.e président.e, d’un.e trésorier.e et d’un.e secrétaire-gestionnaire ; dont la fonction principale est celle d’être employeur.
C’est pendant une A.G.O. que la Coopérative peut renouveler ses membres ; et si les effectifs le permettent, elle peut intégrer un nouveau membre « au fil de l’eau ».
Au consensus, tout nouveau membre entre sur candidature et en devient membre effectif après une période de 6 mois, pour une durée totale de 3 ans, renouvelable.
3.2. Rôle de la Coopérative, et ses décisions
La Coopérative joue le rôle de conseil d’administration, elle est l’organe de gestion et d’organisation de la MCD. Elle coordonne les validations administratives, logistiques, financières et idéologiques de l’association.
La Coopérative peut mandater un de ses membres pour la représenter au sein d’autres structures associatives.
Elle établit chaque année la feuille de route de la MCD, qu’elle présente en A.G.O.
Elle se réunit (visioconférence) au moins 1 fois par mois ou sur demande d’un de ses membres.
Les prises de décision au sein de la Coopérative se font au consensus, sinon, à défaut, à la majorité des 2/3. Le quorum est égal à la moitié + 1 du nombre des membres de la Coopérative.
Toute décision ou texte proposé par un adhérent à diffuser hors de la coopérative doit être soumis aux membres de la coopérative qui disposent de 96 heures pour émettre un avis. L’absence de réponse vaut pour accord, sauf en cas de demande de délai explicite. En cas d’urgence, si la décision (ou le texte) ne peut être soumise à vote, elle doit au moins être revue et validée par 3 membres de la coopérative qui auront échangé par mail ou téléphone. Un mail est alors envoyé à l’ensemble des membres de la coopérative en précisant date, décision ou texte, participants à la validation et réserves éventuelles.
3.3. Délégation
Ces dispositions peuvent être outrepassées lorsqu’un membre de la Coopérative (par exemple, si responsable du site internet) a reçu mandat de celle-ci lors une précédente réunion pour prendre une décision ou diffuser un texte sur un sujet précis. Cette délégation est consignée dans le CR de ladite réunion.
3.4. Porte-parolat et plaidoyer
Par des membres bénévoles de la Coopérative ou par un salarié, les activités de représentation et de diffusion du corpus de la MCD sont coordonnées au sein de la Coopérative, conformément à ses « procédures de coordination » (annexe 1).
3.5. Positionnement sur les élections
La MCD ne se présente pas aux élections et n’autorise personne à le faire en son nom.
La MCD élabore un projet et des propositions politiques qui organisent démocratiquement la décroissance.
Lors des périodes électorales, la Coopérative peut décider de soutenir officiellement des candidatures conformes à son objet.
4. La Mutuelle.
Organe de partage et de discussion du projet politique de la MCD.
→ Elle est composée d’adhérents volontaires, regroupés ou non en commissions ad hoc thématiques, qui participent à la discussion ou à des projets portés par la MCD, en partenariat ou pas avec d’autres associations.
- Les bénévoles comme les salariés s’y engagent à respecter les « procédures de coordination » de la MCD (Annexe 1)
- Les commissions ad hoc résultent de l’initiative d’au moins 1 animateur.euse à qui la Coopérative confie la responsabilité de l’organisation des travaux.
- Les commissions ad hoc sont composées de membres cooptés, qui peuvent ne pas être adhérents de la MCD.
→ Idéologiquement, la Mutuelle distingue entre ce qui appartient au « noyau » de la MCD et ce qui se situe sur des rayons qui ont ainsi une dimension exploratoire. https://ladecroissance.xyz/2016/11/11/noyau-philosophique/
Toutes les activités de la Mutuelle doivent rester dans le cadre des statuts de la MCD et de ce RI.
Toute expression publique (publication, intervention, prise de position…) doit être validée par la Coopérative, garante de l’objet de la MCD.
Pour la rejoindre, contacter : mutuelle-mcd@framagroupes.org
5. Sortie de la Mutuelle et de la Coopérative
Tout membre d’une de ces instances peut en sortir volontairement, à tout moment.
La sortie peut être contrainte par décision de la Coopérative, en cas de non-respect significatif et répété des procédures de coordination.
La sortie peut être temporaire ou définitive.
6. La Compagnie
Les « compagnes et compagnons » de la MCD sont membres honoraires ou cotisants de l’association, et choisis par la Coopérative.
Sans être obligatoirement membres de la Coopérative ou de la Mutuelle, ils peuvent intervenir dans le débat public, en se revendiquant de la MCD.
7. Les publications
Les textes, podcasts et vidéos diffusés par les membres de la MCD sont de 3 ordres :
- Articles et interventions diffusés sur des sites internet (de la MCD, Wikipedia, autres…) ou dans la presse et signés MCD : ils doivent avoir fait l’objet d’une validation par la Coopérative. Le nom de l’auteur peut figurer mais en indiquant que c’est pour la MCD.
- Tribunes libres et billets, diffusés sur le site MCD ou tout autre support (réseaux sociaux, sites, presse) et signés par leur auteur : ils peuvent être suivi du lien vers le site MCD mais, le cas échéant, avec une mention indiquant que les opinions exprimés dans le texte n’engagent pas la MCD. Cela permet notamment d’émettre des avis sur des sujets pour lesquels il n’y a pas consensus au sein de la MCD.
- Commentaires et avis courts émis sur des pétitions en lignes ou dans des forums de discussion par exemple : l’auteur peut faire apparaître son appartenance à la MCD et donner le lien du site internet. Ces communications doivent être reportées dans notre main courante pour information, statistiques et rappel à l’ordre si dérapage.
Par ailleurs, des publications de non-membres pourront être publiées sur le site de la MCD après accord de la Coopérative et à condition que le texte soit en phase avec l’objet de l’association.
Enfin, les personnes ou structures reprenant les idées ou propos de la MCD sont priées de mentionner leur origine, et leur auteur ou autrice, par courtoisie et transparence. Nos publications sont sous licence CC BY-NC-SA.
8. Cohérence et transparence
Tous les membres de la Coopérative, de la Mutuelle, et les salariés disposent d’un lien vers un framacalc qui servira de main courante pour l’association.
Toute activité devra y être succinctement présentée : nom, datations, objet, commentaires.
9. Remboursement des frais
Les frais occasionnés par l’accomplissement du mandat des membres de la coopérative, de la mutuelle, d’un groupe ad hoc ou des tâches de salariés peuvent être remboursés sur justificatifs adressés au sécrétaire-gestionnaire.
10. Groupe territorial local
Tout adhérent de la MCD peut prendre l’initiative de créer un groupe local dans le but de diffuser et de relocaliser le corpus de la MCD.
- Les activités principales sont :
- Intervention directe ou invitée dans des rencontres locales.
- Séances d’arpentage et de lectures discutées de textes.
- Contribution locale à la Cartographie systémique défendue par la MCD.
- Tout groupe local renseigne de toutes ses activités sur la main courante.
11. L’assemblée générale ordinaire
L’A.G.O. est ouverte à tous les membres à jour de cotisation. La convocation se fera au moins 15 jours à l’avance par l’envoi d’un mail aux adhérents. Toutefois ceux qui en font la demande recevront une convocation par courrier.
Le lieu de l’A.G.O. est choisi par la Coopérative.
Seuls les membres présents, sur place ou en visioconférence, peuvent voter (pas de procuration).
12. Assemblée générale extraordinaire.
Celle-ci peut être convoquée par la Coopérative, par l’A.G.O. ou par le quart des membres adhérents (par un courriel envoyé à la Coopérative de la MCD).
La convocation à cette assemblée se fera selon les mêmes modalités que celles de l’A.G.O. En particulier dans le cas d’une double convocation : A.G.E. suivie immédiatement d’une A.G.O.
13. Modification des Statuts, de la Charte et du Règlement Intérieur.
Les modifications des statuts ou de la Charte peuvent être proposées soit par la Coopérative, soit par la moitié des adhérents de l’association.
Les modifications demandées devront être adressées à la Coopérative par courriel.
Le règlement intérieur pourra être modifié par la Coopérative qui devra le faire valider lors de l’A.G.O. suivante.
Les modifications des statuts ou de la Charte seront validées par la majorité qualifiée des 2/3 des membres présents d’une A.G.E. (cf. Article 10 des statuts).
14. Exclusion d’un.e adhérent.e
La Coopérative se réserve la possibilité d’exclure un.e adhérent.e de l’association dans les cas suivants :
- Déclaration publique au nom de la MCD sans validation préalable de la Coopérative. Cela signifie que tout membre est libre de ses propos à condition de ne pas les tenir au nom de la MCD
- Plus largement, toute attitude pouvant nuire à la visibilité et à la crédibilité de la MCD, et à son fonctionnement convivial.
Après un avertissement, si le membre récidive, la Coopérative l’avertira de son exclusion par l’envoi d’un courriel avec l’état de la notification.
En cas de manquement grave, l’exclusion peut être immédiate.
L’exclusion peut être temporaire ou définitive.
Annexe 1
Propositions pour des procédures autocritiques de coordination
Ce qu’il est normal de demander à un salarié comme à un bénévole
- Faire jusqu’au bout ce qu’on a commencé, correctement, dans les délais.
- Responsabilité = Mandat de confiance (on fait confiance à celui à qui une activité est confiée et dont il devient responsable).
- Validations idéologique, logistique et financière en amont (par la Coopérative) et validation continue pendant la réalisation (par un sous-groupe had hoc).
- Il n’y a pas de domination mais il y a des dépendances des membres de la MCD vis-à-vis de la MCD. Ne pas confondre indépendance et autonomie : un « mandaté » a une part d’autonomie, mais il n’est pas indépendant.
- Ne jamais mettre la MCD en dépendance d’une initiative individuelle.
- Se rendre compte = rendre des comptes. Il faut accepter qu’une activité soit évaluée et que soit demandé un correctif : ce qui présuppose une grille d’évaluation (annexe 2)
- Un projet doit pouvoir être facilement continué par un autre, par la personne ou le groupe qui en prend la suite.
- Honorer les auteurs : que ce soit à l’intérieur de la MCD, dans un texte ou une intervention (par une référence explicite) ou dans un événement-MCD (festives, caravane…).
Annexe 2
Check-list des compétences et des vigilances
| Administration, logistique | Partenariat – réseautage | Plaidoyer – Visibilité | |||
| 1. Faire | 1.1 Pas fait | ||||
| 1.2 A ½ fait | |||||
| 2. Faire correctement | 2.1 Transparence | ||||
| 2.2 Validations | |||||
| 2.3 Cadrage MCD | |||||
| 2.4 Minutie | |||||
| 2.5 Crédibilité | |||||
| 3. Dans les délais | 3.1 A la dernière minute | ||||
| 3.2 Hors délai |
Ni l’économie ni la technologie ne sont des sciences, ce sont des politiques
Rédaction
(420 mots)
Que ce soit à propos des débats sur la « taxe Zucman » ou de la politique agressive de taxation menée aujourd’hui par les E.U., chacun peut aujourd’hui facilement s’apercevoir que tout discours sur l’économie est en réalité un prise de position politique. Et pour les plus masochistes d’entre nous, on peut recommander de suivre, sur les « chaînes d’infos » : Nathalie Saint-Cricq (France Info), Nicolas Doze (BFM TV), François Lenglet (LCI), tous ces parfaits « chiens de garde » du néolibéralisme dominant.
L’économie est une politique. Et si on radicalise l’analyse, il faut ajouter que : la technologie est aussi une politique. Comment ne pas le voir en ce moment avec le déferlement IA et ses accointances avec la poussée libertarienne chez ses « designers ».
Et si on avance encore d’un cran : il faut dénoncer l’économisation et aussi la technologisation du monde. En tant que décroissants, il nous faut relire les analyses de Serge Latouche sur l’occidentalisation du monde. Occidentalisation = économisation + technologisation.
Et si on continue, on peut se demander ce qui les rend possibles : pour s’apercevoir que l’emprise de l’économie comme celle de la technologie reposent sur une même fable = celle de leur neutralité (politique).
Mais d’où vient cette fable de la neutralité ?
C’est là qu’on en arrive à voir dans cette fable un dispositif de neutralisation et dans ce dispositif… une politique. D’autant que ce dispositif de neutralisation est une tentative pour dépolitiser… la politique.
D’où l’hypothèse qu’in fine, si l’on veut sortir de ces emprises, il ne suffit pas de définir la décroissance comme une « décrue » (économique), ni comme une « décolonisation » (technologique) mais aussi comme le renversement d’un « régime » (politique) = le renversement du régime politique de croissance.
Tel peut être le cadre de ce que serait une Fresque de la décroissance, projet de la MCD qui sera discuté lors du Café décroissant du samedi 1er novembre.
Amitiés  entretenues,
entretenues,
La Maison commune de la décroissance
PDF(420 mots)
Que ce soit à propos des débats sur la « taxe Zucman » ou de la politique agressive de taxation menée aujourd’hui par les E.U., chacun peut aujourd’hui facilement s’apercevoir que tout discours sur l’économie est en réalité un prise de position politique. Et pour les plus masochistes d’entre nous, on peut recommander de suivre, sur les « chaînes d’infos » : Nathalie Saint-Cricq (France Info), Nicolas Doze (BFM TV), François Lenglet (LCI), tous ces parfaits « chiens de garde » du néolibéralisme dominant.
L’économie est une politique. Et si on radicalise l’analyse, il faut ajouter que : la technologie est aussi une politique. Comment ne pas le voir en ce moment avec le déferlement IA et ses accointances avec la poussée libertarienne chez ses « designers ».
Et si on avance encore d’un cran : il faut dénoncer l’économisation et aussi la technologisation du monde. En tant que décroissants, il nous faut relire les analyses de Serge Latouche sur l’occidentalisation du monde. Occidentalisation = économisation + technologisation.
Et si on continue, on peut se demander ce qui les rend possibles : pour s’apercevoir que l’emprise de l’économie comme celle de la technologie reposent sur une même fable = celle de leur neutralité (politique).
Mais d’où vient cette fable de la neutralité ?
C’est là qu’on en arrive à voir dans cette fable un dispositif de neutralisation et dans ce dispositif… une politique. D’autant que ce dispositif de neutralisation est une tentative pour dépolitiser… la politique.
D’où l’hypothèse qu’in fine, si l’on veut sortir de ces emprises, il ne suffit pas de définir la décroissance comme une « décrue » (économique), ni comme une « décolonisation » (technologique) mais aussi comme le renversement d’un « régime » (politique) = le renversement du régime politique de croissance.
Tel peut être le cadre de ce que serait une Fresque de la décroissance, projet de la MCD qui sera discuté lors du Café décroissant du samedi 1er novembre.
Amitiés  entretenues,
entretenues,
La Maison commune de la décroissance
Bon Pote
Actu-Environnement
Amis de la Terre
Aspas
Biodiversité-sous-nos-pieds
Bloom
Canopée
Décroissance (la)
Deep Green Resistance
Déroute des routes
Faîte et Racines
Fracas
F.N.E (AURA)
Greenpeace Fr
JNE
La Relève et la Peste
La Terre
Le Lierre
Le Sauvage
Low-Tech Mag.
Motus & Langue pendue
Mountain Wilderness
Negawatt
Observatoire de l'Anthropocène